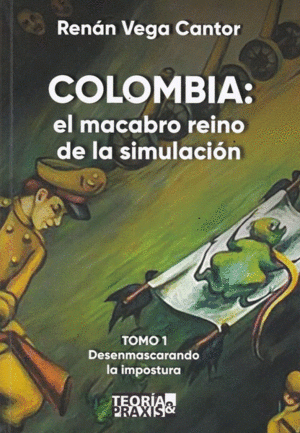vendredi, 16 juin 2023
Alexandre Douguine: Une sociologie de la transition vers le postmoderne

Une sociologie de la transition vers le postmoderne
Alexander Douguine
Source: https://www.geopolitika.ru/article/sociologiya-fazovogo-perehoda-k-postmodernu
La deuxième phase de transition
Le postmoderne est le paradigme vers lequel la transition du paradigme précédent - le moderne - s'effectue actuellement. La transition se déroule sous nos yeux, de sorte que la société actuelle (au moins la société occidentale, mais aussi la société planétaire dans la mesure où elle est influencée par la société occidentale) est une société en transition. Non seulement la société russe est en transition au sens large, mais la matrice sociale qui définit la vie de l'humanité à tel ou tel degré est également en train de changer de nature qualitative aujourd'hui.
Cette transition (ce transit) s'opère stricto sensu du moderne au postmoderne. En même temps, certains principes de la modernité ont déjà été écartés, démystifiés, démantelés, et d'autres restent encore en place. Parallèlement, certains éléments du paradigme postmoderne ont déjà été activement et universellement mis en œuvre, tandis que d'autres restent à l'état de projet, "en route". Cette transitivité complique une analyse sociologique correcte du postmoderne, puisque l'image sociale globale observée aujourd'hui est, en règle générale, une combinaison de parties du moderne en phase de sortie et du postmoderne en phase entrante. En outre, ce processus ne se déroule pas de manière frontale et uniforme, mais varie d'une société à l'autre.
La nécessité de bien comprendre la structure des trois paradigmes
En tout état de cause, pour analyser, d'un point de vue sociologique, le contenu de la société postmoderne, c'est-à-dire pour être un sociologue compétent du 21ème siècle, il est absolument nécessaire de disposer d'un ensemble de connaissances sociologiques sur les trois paradigmes - prémoderne, moderne et postmoderne, de connaître leurs points clés, de comprendre la structure générale des sociétés correspondantes, d'être capable de reconstruire les principaux pôles, strates, statuts et rôles de chaque type de société. Cela est nécessaire pour les raisons suivantes.
1. La phase de transition vers le postmoderne touche aux fondements les plus profonds de la société, y compris ceux qui semblaient avoir été mis en exergue et même dépassés depuis longtemps dans le moderne. Le but de la philosophie postmoderne est de prouver l'insuffisance et la réversibilité de ce "dépassement". Le postmodernisme affirme que "la société moderne n'a pas réussi à faire face à son programme et n'a pas été en mesure d'éliminer complètement le prémoderne". Pour comprendre cette thèse, qui est au cœur du programme sociologique et philosophique du postmodernisme, il est nécessaire de réfléchir à nouveau et sérieusement: qu'est-ce que le prémoderne ?

2. Les structures sociales à transformer radicalement dans le postmoderne n'ont pas été établies à un stade historique antérieur: elles représentent des constantes sociologiques, anthropologiques, psychanalytiques et philosophiques profondes, qui sont restées inchangées tout au long de l'histoire et qui se manifestent de la manière la plus vivante dans les sociétés archaïques, qui ont été explorées sous un nouvel angle par le structuralisme du 20ème siècle. Cela signifie que le postmodernisme n'opère pas seulement avec le passé et l'histoire, mais avec l'éternel et l'intemporel. Ainsi, le thème du "mythos", longtemps oublié, s'avère non seulement pertinent, mais central, et l'étude des sociétés archaïques, d'une initiative périphérique, presque muséale, devient un domaine scientifique dominant.
3. La transition vers le postmoderne implique des changements tout aussi fondamentaux dans la structure globale de la société, comparables à ceux qui ont eu lieu lors de la transition du prémoderne au moderne. De plus, la phase de transition précédente est cruciale dans son contenu et son modèle pour l'étude de la transition actuelle. La symétrie et le contenu de cette symétrie entre les deux est au cœur de tout le paradigme postmoderne.
Ces arguments, auxquels s'ajoutent de nombreuses autres considérations techniques et appliquées, nous permettent de réaliser la loi la plus importante de la sociologie du 21ème siècle : nous ne sommes capables, du point de vue sociologique, de comprendre de manière adéquate la société dans laquelle nous nous trouvons, que si nous possédons non seulement un ensemble d'outils sociologiques de base, mais aussi une compréhension de toutes les différences sociales entre les paradigmes prémoderne-moderne-postmoderne.
Transformation de l'objet de la sociologie dans le postmoderne
Nous ne devons pas oublier que la sociologie a émergé à l'époque de la modernité et que, bien qu'elle soit largement responsable de la critique de la modernité et de la préparation de la transition vers la postmodernité, elle porte de nombreuses traces conceptuelles, philosophiques, méthodologiques et sémantiques de la modernité, qui perdent leur sens et leur adéquation sous nos yeux aujourd'hui. Le passage de la sociologie à la post-sociologie est inévitable, ce qui signifie que le niveau de réflexion sociologique sur la sociologie elle-même, ses principes, ses fondements, son axiomatique, est plus que jamais d'actualité.

Cela découle du phénomène fondamental suivant. Dans la transition vers le postmoderne, l'objet même de la sociologie change. Bien sûr, la société change toujours, à tous les stades. Et à chaque fois, son étude correcte nécessite l'amélioration des outils pertinents. Mais pendant la phase de transition, quelque chose de plus profond change - le registre des disciplines change. Ainsi, toutes les transformations sociales du paradigme prémoderne étaient liées aux changements au sein des religions - leur changement, leur évolution, leur division ou leur fusion, leur corrélation. Lors de la transition vers la modernité, l'ensemble des processus sociaux, des institutions, des doctrines et des structures associés à la religion (et il ne s'agissait pas seulement d'un vaste ensemble, mais de la quasi-totalité) s'est avéré moins pertinent et a été relégué à la périphérie de l'attention. Comme nous l'avons vu, aux yeux d'Auguste Comte, c'est la sociologie en tant que post-religion qui devait prendre la place laissée vacante par la religion.
Au cours de la période prémoderne, l'étude de la société était presque identique à l'étude de sa religion, qui définissait dans un contexte social les propriétés dominantes des institutions, des processus, de la distribution des status, etc. Dans la Modernité, cependant, les études religieuses et la sociologie de la religion sont devenues des orientations d'impact très modeste, et seuls le structuralisme et la psychanalyse, ainsi que certains des pères fondateurs de la sociologie (Durkheim, Mauss, Weber, Sombart) nous ont rappelé leur importance fondamentale - principalement à travers l'étude des conditions sociales à l'origine de la Modernité (Weber, Sombart) ou à travers l'étude des sociétés archaïques (Durkheim tardif, Mauss, Halbwachs, Eliade, Levi-Strauss). Quoi qu'il en soit, de part et d'autre de la frontière du Moderne (la phase de transition précédente) se trouvent deux types de société très différents: la "société traditionnelle" (Prémoderne) et la "société moderne" (Moderne).
Les différences entre elles sont si fondamentales, et les valeurs et principes de base sont si opposés, que l'on peut parler d'antithétisme total. Si le prémoderne est la thèse, le moderne est l'antithèse. Et les sociétés correspondantes, sous de nombreux aspects, sont non seulement qualitativement différentes, mais aussi des objets de recherche opposés. - Ce n'est pas un hasard si F. Tönnies ne place la "société" (Gesellschaft) comme objet de sociologie qu'à l'époque moderne, alors que, selon sa doctrine, mettant l'accent sur la "communauté" (Gemeinschaft) correspond à l'époque prémoderne. Si nous acceptons la théorie de Tönnies, considérée comme un classique incontesté de la sociologie, nous aurions dû diviser la sociologie en une science de la société (Gesellschaft) et du moderne, et une science de la communauté (Gemeinschaft) et du prémoderne ("communologie"). Bien qu'une telle division n'ait pas eu lieu et que la sociologie étudie de la même manière les sociétés traditionnelles et modernes, la transformation de l'objet d'étude lors de la première phase de transition du prémoderne au moderne est si importante que l'idée de les diviser en deux disciplines a été sérieusement discutée lors de la phase de formation de la science. À notre époque, le thème de la "communologie" a été revisité par le célèbre sociologue français Michel Maffesoli.

Post-société et post-sociologie
Il se passe quelque chose de similaire lors de la deuxième phase de transition - de la modernité à la postmodernité. L'objet de recherche - la "société" - change à nouveau de manière irréversible. La société postmoderne est aussi différente de la société moderne que la "société moderne" l'est de la "société traditionnelle" (Gemeinschaft). Par conséquent, on peut provisoirement parler de "post-société" comme d'un nouvel objet d'étude pour la sociologie. Dans le même temps, la sociologie elle-même doit changer afin d'adapter ses méthodes et ses approches à ce nouvel objet. Ainsi, la perspective d'une "postsociologie", d'une nouvelle discipline (post-)scientifique qui étudierait le nouvel objet, se profile à l'horizon.
Quoi qu'il en soit, l'adéquation sociologique minimale dans l'étude des processus qui se déroulent dans la transition vers le postmoderne est directement liée à la compréhension de la logique sous-jacente des trois changements de paradigme. Ceci, entre autres, fait de l'étude du prémoderne avec toutes ses composantes sociologiques - mythe, archaïque, initiation, magie, polythéisme, monothéisme, ethnos, dualité des phratries, structures de parenté, stratégies de genre, hiérarchie, etc. - une condition nécessaire à l'adéquation professionnelle du sociologue, appelé à compléter la taxinomie des objets de cette science par un nouveau maillon - la "post-société".
La correction archéomoderne
La situation est d'autant plus complexe que la chaîne prémoderne-moderne-postmoderne n'est valable que pour les sociétés occidentales - l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. Dans la zone de développement durable et dominant de la civilisation occidentale, nous pouvons clairement enregistrer la transition de la société selon les trois paradigmes, avec le fait que l'affirmation de chaque nouveau paradigme tend à être fondamentale, irréversible et nettoyée des vestiges du précédent. Pour la civilisation occidentale, le processus de changement de paradigme est endogène, c'est-à-dire qu'il est induit par des facteurs internes.
Pour toutes les autres sociétés, le mouvement successif le long de la chaîne des changements de paradigme (y compris les divers sous-cycles que nous avons décrits précédemment) a un caractère externe, exogène (il a lieu soit par la colonisation, soit par la modernisation défensive), ou n'a lieu qu'en partie (le monothéisme islamique est plus "moderne" que le polythéisme), et plus encore que les cultes archaïques, n'a jamais franchi la ligne de la Modernité, s'arrêtant avant elle), soit est totalement absente (de nombreuses ethnies de la planète vivent encore sous des systèmes stables de "retour perpétuel"). Mais comme l'influence de l'Occident est aujourd'hui mondiale, le premier cas - la modernisation exogène (ou acculturation) - s'étend à presque toutes les sociétés, apportant des éléments de modernité même aux tribus les plus archaïques. Cela donne lieu au phénomène de l'archéomoderne.

L'archéomoderne complique le tableau sociologique
Le problème de l'archéomoderne en sociologie complique considérablement l'analyse des sociétés selon le syntagme historique prémoderne-moderne-postmoderne, car il ajoute à ces trois paradigmes un certain nombre de variantes hybrides, dans lesquelles les façades sociales du moderne sont placées artificiellement et inorganiquement sur la base de structures sociologiques liées au prémoderne. L'archéo-moderne est également spécifique parce que cette combinaison de l'archaïque et du moderne n'est pas du tout en corrélation au niveau de la conscience, n'est pas comprise, n'est pas arrangée, aucun modèle interprétatif généralisant n'apparaît, ce qui crée le phénomène de la "société-décharge" (P. Sorokin). Le moderne bloque le rythme de l'archaïque, et l'archaïque sabote la structuration cohérente du moderne.
L'étude des sociétés archéo-modernes représente une catégorie distincte de tâches sociales, qui peuvent être reléguées à une branche spéciale de la sociologie. L'archéo-moderne ne génère aucun contenu nouveau, puisque chacun de ses éléments peut être assez facilement ramené soit au contexte de la société traditionnelle (au Prémoderne), soit au contexte de la société moderne (au Moderne). Seuls sont originaux les ensembles de dissonances, de non-sens et d'ambiguïtés générés par telle ou telle manifestation de l'archéo-moderne, soit les réserves, les échecs, les erreurs et les coïncidences accidentelles, qui acquièrent parfois le statut de caractéristiques sociales et deviennent dans certains cas constitutifs. Par exemple, une institution sociale incomprise ou un objet technique emprunté au moderne, comme un parlement ou un téléphone portable, peut fonctionner en dehors de tout contexte (en l'absence de démocratie dans la société ou de réseau de téléphonie mobile), comme étant en partie réinterprété en fonction des réalités locales, et en partie comme un simple élément incompris, agissant comme un "objet sacré" dont l'utilité est peu connue - comme une météorite.
L'archéomoderne et le postmoderne : l'apparence trompeuse des similitudes
L'archéomoderne devient un problème sociologique particulièrement difficile lorsqu'on étudie la deuxième phase de transition - du moderne au postmoderne. En effet, certaines propriétés phénoménologiques du postmoderne - en particulier l'appel ironique du postmoderne à l'archaïque afin de montrer au moderne ce dont il n'a pas pu se libérer complètement - ressemblent extérieurement à l'archéomoderne. Mais à la différence que le Postmoderne construit sa stratégie de combinaison de l'incongru (le Prémoderne et le Moderne) de manière artificielle, réfléchie, dans un but subtilement ironique et critique, provocateur (de la part d'un grand esprit), alors que le Moderne réalise des opérations similaires de son propre chef (de la part de la stupidité).
L'archéomoderne est un moderne qui n'a pas abouti et qui n'aboutira probablement plus. Le postmoderne est un moderne qui s'est révélé, mais qui se dépasse pour se révéler encore plus. D'où la distinction sociologique très subtile: le postmoderne imite certains aspects de l'archéo-moderne dans le cadre de son programme poststructuraliste visant à "éclairer les Lumières"; l'archéo-moderne le prend pour argent comptant et ne comprend sincèrement pas en quoi un Occident postmoderne qui reprend de manière ludique des thèmes et cherche à assimiler des ethnies entières (par l'immigration) encore inclues dans la société traditionnelle sera bientôt différent des sociétés archéo-modernes du reste du monde.
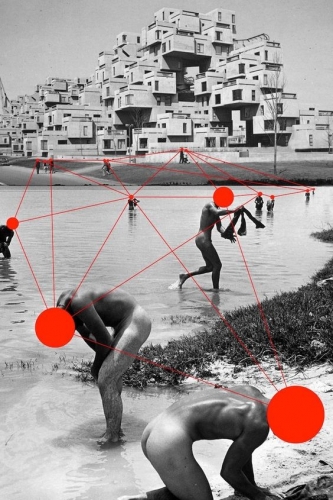
La sociologie de la mondialisation (postmoderne et archéomoderne)
Ici se dessine un modèle de mondialisation à deux vitesses. Cette mondialisation repose sur la juxtaposition du postmoderne et de l'archéomoderne. Le postmoderne s'incarne dans la société occidentale, intégrant l'humanité le long de ses lignes de force - selon le principe de la prolifération des logems. C'est une société de l'information, qui décode et recode les flux d'informations ("océan d'infems"). Dans le monde entier, il existe des segments de l'élite qui sont plus intégrés dans la modernité que le reste de la société, et qui sont au moins partiellement capables d'embrasser certaines tendances postmodernes. Ils deviennent les nœuds de la mondialisation dans son aspect logique, rationnel et stratégique.
L'humanité se transforme en un champ homogène avec des centres-portails symétriquement situés, où se concentrent les routeurs d'infems. C'est là que les lois de la postmodernité opèrent et que restent ceux qui sont conscients de ces lois (soit des Occidentaux travaillant par roulement, soit des représentants des élites locales, qui ont maîtrisé les canons et les normes de la post-société).
Tout le reste de l'espace social est laissé à l'archéomoderne, qui perçoit l'affaiblissement de l'impulsion modernisatrice (qui tourmentait l'archaïque à l'époque de la modernité) comme un relâchement, et qui prend volontiers la mondialisation comme une "fenêtre d'opportunité" pour la localisation, c'est-à-dire pour se tourner vers des préoccupations quotidiennes concrètes familières et non généralisées, où l'archaïque et le moderne coexistent dans une forme de conflit atténué, comme un réceptacle de dépôt, creusé et fabriqué. Pour décrire ce double phénomène, le sociologue contemporain Roland Robertson (4) a proposé d'utiliser le terme de l'argot des entreprises japonaises, "glocalisation", pour décrire l'imbrication de deux processus dans la mondialisation - le renforcement des réseaux mondiaux fonctionnant selon l'agenda postmoderne (mondialisation proprement dite), et l'archaïsation des communautés régionales gravitant vers un retour à la culture locale (localisation). Ainsi, le postmoderne est mélangé à l'archéomoderne en une masse difficile à décomposer, dont le déchiffrage sociologique correct exige un grand professionnalisme et une compréhension profonde des mécanismes de fonctionnement de chaque paradigme, pris séparément ainsi que sous des formes hybrides et transitoires.
19:57 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : prémoderne, postmoderne, moderne, alexandre douguine, philosophie, postmodernité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 15 juin 2023
Nietzsche et les Grecs : une compilation de l'Institut italien d'études philosophiques
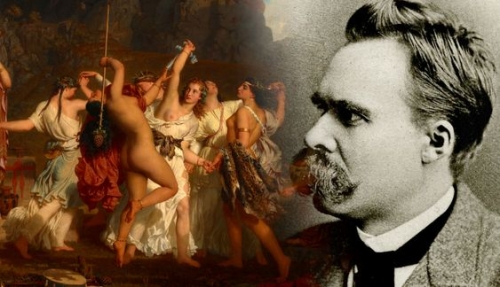
Nietzsche et les Grecs: une compilation de l'Institut italien d'études philosophiques
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/nietzsche-e-i-greci-una-silloge-dellistituto-italiano-per-gli-studi-filosofici-giovanni-sessa/
L'expérience spéculative et existentielle de Friedrich Nietzsche représente un tournant dans l'histoire de la pensée européenne, distinguant deux époques différentes de la philosophie : avant Nietzsche et après lui. Cette affirmation est confirmée dans l'ouvrage Nietzsche e i Greci. Tra mito e disincanto (Nietzsche et les Grecs. Entre mythe et désenchantement), actuellement dans les librairies d'Italie grâce aux presses de l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici-Scuola di Pitagora (pp. 175, euro 18.00), édité par Ludovica Boi. Le volume rassemble une série de contributions sur le thème "Nietzsche et les Grecs", élaborées au cours de deux journées d'étude qui se sont tenues les 21 et 22 octobre 2019 dans les locaux de l'Institut au Palazzo Serra di Cassano à Naples. Il s'agissait de réunions et de séminaires organisées dans le cadre du projet "Les Grecs au miroir des Modernes". Le livre se compose de deux parties, chacune contenant trois essais. La préface est signée par Francesco Fronterotta, tandis que l'introduction est signée par l'éditeur.

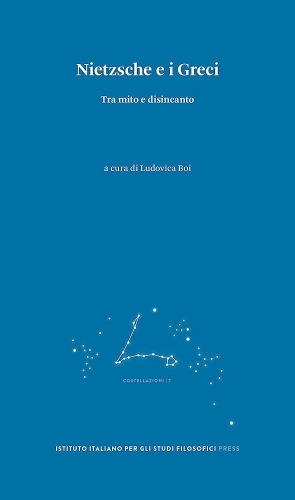
L'idée centrale, qui traverse tous les essais, est l'existence d'une continuité philologique-philosophique substantielle dans le parcours du penseur de Röcken. Ludovica Boi note que "s'il est indéniable que Nietzsche n'a jamais fait l'éloge de la méthode historiciste [...], il est tout aussi vrai que l'habitus philologique s'est enraciné en lui dès ses jeunes années et ne l'a jamais abandonné" (p. 13). La philologie fut en effet l'instrument avec lequel le penseur de l'éternel retour donna de l'ordre à sa propre nature intuitive et géniale. Nietzsche l'a transformée en : "un savoir-faire d'orfèvre qui contrecarre l'accélération de la modernité tardive [...] avec ses lectures superficielles et hâtives" (p. 13). D'un point de vue général, la civilisation grecque s'est révélée être, pour le philosophe, un marqueur indispensable de sa propre recherche, un engagement intellectuel intensément vécu. Ces deux éléments doivent donc être dûment pris en compte par quiconque entreprend l'exégèse du parcours théorique de l'Allemand, qui ne peut être distingué en "phases" rigidement opposées, puisqu'il met en évidence des traits unitaires. Nietzsche, tout en voulant reproposer le modus vivendi hellénique, reste un moderne, où l'instance épistrophique se conjugue avec le désir de démythification. C'est autour de cette ambiguïté que les auteurs ont développé leur travail herméneutique.
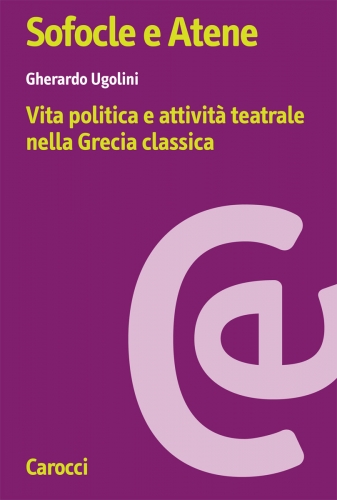
Gherardo Ugolini lit La naissance de la tragédie dans une perspective anti-aristotélicienne, en se concentrant notamment sur le décryptage de la "catharsis tragique". À ce sujet, les lectures de Lessing, Goethe et Bernays étaient pertinentes à l'époque. Le premier était porteur d'une exégèse "morale" de la catharsis, le second l'interprétait à la lumière de l'autonomie de l'esthétique, le troisième dans une clé "médico-pathologique". Nietzsche n'est pas convaincu de l'existence dans les représentations tragiques d'une libération "morale" et, reprenant le langage de Bernays, "ne croit pas du tout au potentiel thérapeutique inhérent à la tragédie" (p. 38). Il nie qu'il puisse y avoir une résolution "positive" de la condition tragique, la tragédie reproduisant l'extase dionysiaque. Dans la tragédie attique, le déchargement du dionysiaque, dont le chœur est témoin, dans le monde des images apolliniennes était évident. La seule catharsis possible était donc dans le dionysiaque : "compris comme la dissolution de l'identité et des catégories spatio-temporelles" (p. 43). Il est resté fidèle à cette conception jusqu'aux œuvres de sa maturité.
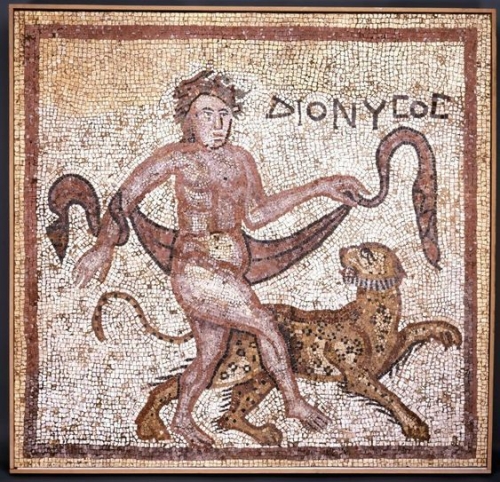
Dionysos, tel que saisi par Ludovica Boi, est le fil rouge omniprésent chez Nietzsche. Dans ses premiers écrits, il fait allusion à l'"unité essentielle" (Ur-eine), qui peut être expérimentée par le dépassement du principuum individiationis dans l'expérience extatique. Il la conçoit, en vertu de l'influence schopenhauerienne, en termes transcendantaux. Par la suite, grâce à la leçon tirée du préplatonisme et en particulier d'Héraclite, il s'approche de la coïncidentia oppositorum. Dans les écrits ultérieurs, ce sera précisément la réflexion sur le pouvoir de Dionysos qui déterminera dans sa vision la "dissolution de l'opposition du devenir et de la mort": "dissolution de l'opposition du devenir et de l'être, du moment et de l'éternité, du "monde vrai" et du "monde apparent"" (p. 50). À ce stade, l'"unité essentielle" sera expérimentée en termes de pure immanence, au-delà de tout dualisme ontologique et métaphysique. En conclusion, "Nietzsche radicalise les hypothèses déjà présentes dans la Geburt, en affirmant [...] une divinisation du devenir" (p. 51). Plus précisément, Dionysos symbolise la totalité de l'être ; il enseigne à l'humanité que la mort est liée à la vie. Pour l'auteur, ce dépassement du dualisme représente l'héritage le plus significatif du philosophe, qui réapparaîtra au 20ème siècle dans l'idéalisme magique de Deleuze, Klossowski et Evola.
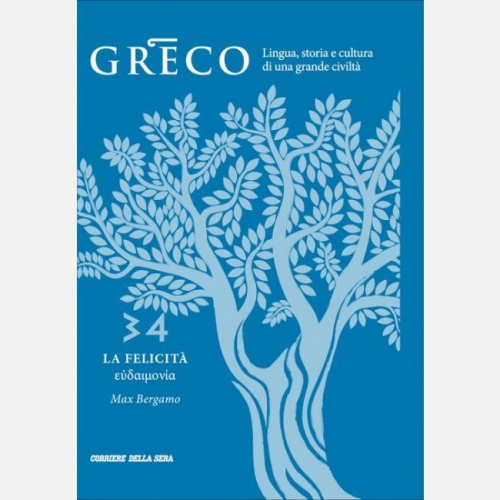
Max Bergamo traite du "caractère mixte" de Platon. Pour l'exégèse, il utilise des sources inédites telles que les notes du brillant élève de Nietzsche, Jakob Wackernagel. Par "caractère mixte", Nietzsche entend se référer à Platon, le lisant comme un philosophe chez qui l'écho de la sagesse hellénique archaïque pythagorico-heraclitéenne-socratique peut encore être entendu, présent même dans son choix de dialogue, par rapport auquel, en même temps, la spéculation de l'Athénien marque une rupture claire avec l'introduction du dualisme onto-gnoséologique. Le caractère "non original" de Platon aurait été déduit par Nietzsche à la lecture d'un passage de Diogène Laertius. Valeria Castagnini évoque la vie de l'érudit dans sa jeunesse : "exposant le lien entre le choix de la profession académique [...] et le tempérament du jeune Nietzsche" (p.16). On comprend comment, de cette manière, l'universitaire a fait sien un élément qualificatif de l'enseignement de Nietzsche, à savoir le rapport incontournable entre la vie et la pensée, l'existence et la science.
Edmondo Lisena aborde le rapport du philosophe avec les Grecs autour de l'"admirable année" 1875. À cette époque, le penseur était fermement convaincu que seule une pensée "impure" était capable de réagir face à l'illogisme de la réalité, à la dimension chaotique de la vie. Enfin, Andrea Orsucci exerce son analyse des pages de Umano, troppo umano (Humain, trop humain), en tenant compte de la crise des fondements de la connaissance qui se manifeste à la fin du 19ème siècle. La généalogie de l'esprit libre naîtra d'une confrontation étroite avec les développements de la science.
Un recueil extrêmement intéressant qui entre dans le cœur vital de la philosophie de Nietzsche : la potestas dionysiaque.
Giovanni Sessa
16:22 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, nietzsche, friedrich nietzsche, hellénisme, dionysos |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 14 juin 2023
L'Occident contre Platon
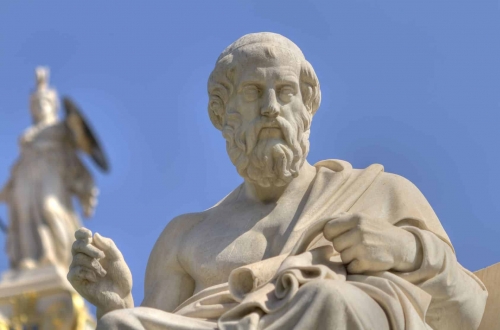
L'Occident contre Platon
Lady Fae
Source: https://novaresistencia.org/2023/06/06/o-ocidente-vs-platao/
Qui aurait cru que le plus grand ennemi des mondialistes serait Platon ?
Dans son livre au titre plutôt enfantin The Open Society and it's Enemies, l'auteur Karl Popper affirme clairement que toute analyse visant à retracer des modèles de comportement à travers l'histoire est anti-scientifique et déterministe.
Il affirme que la répétition des schémas historiques mis en évidence par Platon dans son ouvrage "La République" ne repose sur aucune preuve empirique, de sorte que toute la logique platonicienne selon laquelle l'histoire se répète généralement par cycles relève de la foi, et non de la raison.
Cependant, le fait même que le modèle historique, pour se produire, doive d'abord se manifester plusieurs fois dans la réalité et qu'au moins une société donnée doive en faire l'expérience, fait du modèle historique lui-même un fait empirique et inaltérable.
Platon affirme que les démocraties, à long terme, se transforment en tyrannie parce qu'elles pèchent en privilégiant l'individualisme excessif au détriment du sens collectif. La tyrannie elle-même, en revanche, conduit à long terme la population à désirer un plus grand degré de liberté.
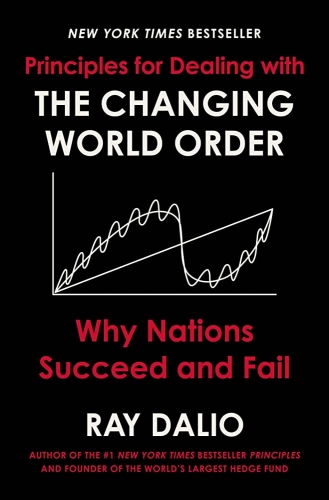
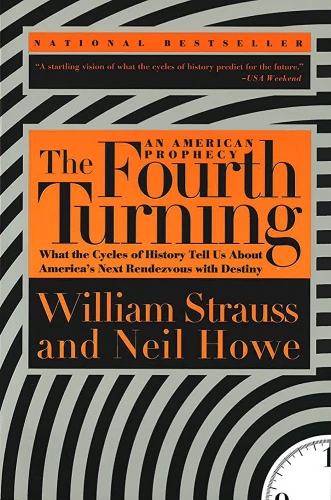
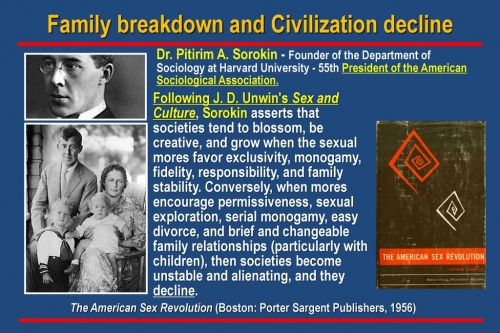
Des auteurs comme Ray Dalio, J.D. Unwin et Neil Howe ont déjà écrit des livres qui relatent avec précision les cycles historiques. Je sais que parmi eux, Ray Dalio soutient publiquement qu'il existe un moyen de modifier ces cycles et d'empêcher la phase d'effondrement des civilisations.
Karl Popper, quant à lui, affirme que tous ceux qui étudient l'histoire sont des "déterministes" et qu'ils voient l'histoire comme les religieux voient leurs textes sacrés. Il n'y a pas de nuance chez Popper, si vous remarquez des schémas comme le fait Ray Dalio, vous êtes un déterministe, et la bonne chose à faire est donc d'ignorer ces faits.
Platon devient problématique parce qu'il a fait, il y a 2500 ans, une analyse qui, même aux yeux de l'homme moderne, semble intemporelle. Par conséquent, le philosophe grec qui a assisté de près à la chute de l'aristocratie en faveur de la formation de la République devient l'ennemi numéro un de l'élite d'aujourd'hui.

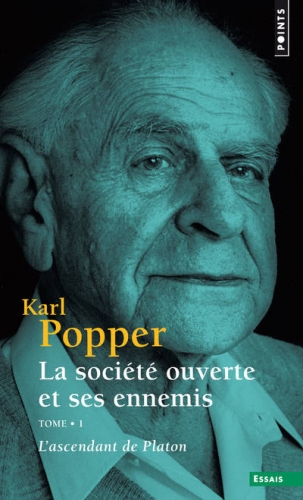
Popper affirme que même si les cycles historiques sont indémontrables, il existe un moyen de les éviter complètement : par l'ingénierie sociale. Popper utilise le mot "ingénierie sociale" 36 fois dans son volume de 274 pages.
L'agnostique rejette l'idée d'un cours naturel de l'histoire pour embrasser l'idée de comportements induits à grande échelle. Le cycle naturel des choses est vil parce qu'il relève de la métaphysique, alors que le cycle artificiel est bon parce qu'il relève de la science. L'arrogance est ici notoire.
Qu'est-ce que l'Open Society de George Soros si ce n'est la manifestation des idées de Popper ? Popper est un homme qui soutient que les frontières renforcent le sens collectiviste et que tout sens collectiviste est lui-même anti-scientifique puisqu'il s'appuie sur la métaphysique pour se renforcer.
La notion essentialiste de l'Open Society consiste à tuer tout sens "tribal" et "collectiviste" au nom de la méthode scientifique et de la raison. Paradoxalement, Popper rejette l'étude de l'histoire comme non scientifique, car s'il en admettait la scientificité, il devrait ipso facto admettre que sa thèse est mégalomaniaque et nie la réalité culturelle d'innombrables civilisations.
Pour eux, si l'on veut "universaliser" le monde au nom du "progrès scientifique", il faut en finir avec tout sens tribal, en particulier le sens national. Paradoxalement, on tue le sens de la nation et on crée de nouvelles tribus. On remplace les drapeaux nationaux par les drapeaux de sexualités alternatives. Si Popper était humble, il remarquerait que les humains ont un désir latent d'appartenance et que lorsqu'ils tentent d'assassiner un certain sens collectif, ils finissent par en créer un autre.
La différence est que certains sens collectifs aident à construire des civilisations et d'autres à les détruire. Dans leur arrogance, en essayant de mettre fin à la diversité mondiale, les élites ignorent une fois de plus l'histoire. Elles ne voient pas qu'en fin de compte, elles agissent comme de simples colonisateurs.
21:35 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société ouverte, platon, karl popper, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 13 juin 2023
La mort de la logique et certaines de ses conséquences

La mort de la logique et certaines de ses conséquences
Mikhail Deliaguine
Source: https://katehon.com/ru/article/smert-logiki-i-nekotorye-posledstviya-etogo
L'ordinateur, en tant qu'expression incarnée de la logique formalisée, d'autant plus que les réseaux sociaux se développent et pénètrent tous les aspects de notre vie dans le processus de formation de l'"Internet pour tous", rend les gens égaux dans leur accès à cette ressource. En raison de l'impossibilité objective de rivaliser avec une ressource également accessible à tous, les personnes et les organisations qui ont traditionnellement rivalisé les unes avec les autres, précisément sur la base des constructions logiques qui sous-tendent la pensée traditionnelle, déplacent la concurrence entre elles vers des formes non conventionnelles et non traditionnelles de pensée extra-logique qui ne nous sont pas familières.
Entre-temps, la pédagogie moderne n'a pas démontré sa capacité à encourager la pensée intuitive chez les enfants, comme elle l'a fait pour l'encouragement de la pensée logique. Il ne fait aucun doute qu'avec le temps, elle assimilera les acquis de la pédagogie expérimentale soviétique des années 60 et sera en mesure de résoudre le problème en assurant le développement de la créativité basée sur l'intuition chez tous les enfants, où qu'ils se trouvent. Mais pour cela, elle doit stopper sa dégradation systémique, causée tactiquement par la primitivisation des systèmes de contrôle de sociétés excessivement complexes dans leurs capacités, et stratégiquement par la formation d'une société de plates-formes qui n'a besoin que d'un nombre limité de spécialistes capables de penser de façon critique et même d'apprendre en tant que tels.
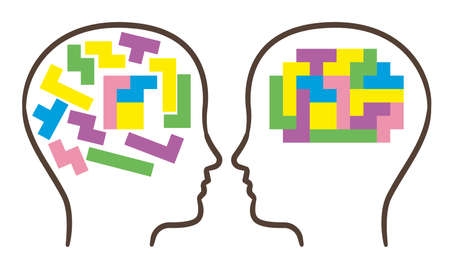
Tant que ces facteurs de dégradation pédagogique ne seront pas éradiqués (et ils ne le seront pas parce qu'ils sont objectifs), l'incapacité à nourrir massivement les capacités de pensée intuitive de plus en plus urgentes des enfants garantit l'aggravation continue de la crise d'une société entière incapable de fournir à ses membres l'adaptation nécessaire à leurs conditions de vie.
L'incapacité des systèmes de gestion à gérer les penseurs intuitifs, dont ils ont pourtant besoin, est également importante. Ce problème est clair depuis la fin des années 30 et il n'y a toujours pas de solution.
Il provoque une crise de gouvernabilité "en tout point" de la société.
La réaction naturelle des systèmes de gouvernance est d'exclure la partie ingouvernable de la société, c'est-à-dire principalement les personnes intuitives et créatives, d'une véritable participation à la prise de décision.
En conséquence, la concurrence se réalise de plus en plus précisément à travers ces formes, nouvelles pour la pensée de masse - à travers l'intuition et les intuitions ("foresights") ou à travers des schémas logiques originaux et complexes qui n'ont pas encore réussi à être fixés dans des algorithmes d'ordinateur.

La concurrence sur la base de ces derniers est vouée à vaincre les "combats d'arrière-garde" de la logique formelle traditionnelle et de la société qui en découle, car avec la formation de l'intelligence artificielle et au fur et à mesure de son développement, l'ordinateur devient de plus en plus original dans ses schémas logiques (qui sont dès lors plus difficiles à comprendre pour la plupart des gens).
Par conséquent, la concurrence entre les personnes et les organisations qu'elles forment s'est déplacée dans la sphère de la pensée extra-logique - en premier lieu, la sphère de l'intuition.
Mais seulement "avant tout" eux ! - parce que les personnes qui pensent de manière extralogique ne cèdent plus au contrôle et que, du fait de la mort de la logique, le nombre de ces personnes (qui ne sont pas productives intuitivement, mais qui sont incapables de logique et qui, par conséquent, ne sont pas productives en principe) augmente.
Ces personnes (qui ne sont pas productives intuitivement, mais incapables de logique et donc, en principe, non productives) sont de plus en plus nombreuses.
En conséquence, ils sont mis à l'écart des décisions, non seulement parce qu'ils sont ingouvernables, mais aussi parce qu'il est juste que ceux qui sont incapables d'apporter une contribution positive à la société ne soient pas influencés par elle.
Retirer la majorité de la société, même imparfaite, de la participation à la gouvernance signifie la mort de la démocratie - ce qui exacerbe encore la crise de la gouvernabilité.
À cet égard, la structure de la société des plateformes sociales est une réponse non seulement au changement des technologies dominantes, mais aussi à la crise sociale et à la crise de gouvernance engendrée par ce changement.
L'insoutenabilité du système renforce la menace d'une autodestruction probable de la civilisation.
21:34 Publié dans Actualité, Philosophie, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, logique, intuition, psychologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 11 juin 2023
Wokisme et déconstruction

Wokisme et déconstruction
par Alberto Giovanni Biuso
Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/25657-alberto-giovanni-biuso-wokismo-e-decostruzione.html
Les phénomènes collectifs qui portent le nom de cultures woke et cancel (ceux qui, par exemple, génèrent l'abattage de statues de poètes et de penseurs au nom de principes contemporains) peuvent apparaître et être quelque peu bizarres et fanatiques.
Leur nature s'exprime par quelques éléments très clairs: la victimisation élevée au rang de principe méthodologique; la tendance fortement censurante à l'égard de tout ce que les "éveillés" considèrent comme l'expression du Mal absolu; l'aspiration à faire tabula rasa de tout le passé de l'humanité, dont ils estiment devoir réécrire les vicissitudes comme s'il s'agissait d'une page blanche; une dimension fortement médiatisée, très éloignée du sentiment commun à la grande majorité des gens; l'attention consécutive que le wokisme reçoit des médias et des institutions bien qu'il constitue un phénomène circonscrit à une niche; l'analogie singulière avec le fanatisme de la "révolution culturelle" maoïste, qui voulait elle aussi anéantir toute la culture chinoise; la nature profondément américaniste et puritaine de la cancel culture, qui, tout en se présentant souvent sous un aspect "gauchiste" - comme diraient les Français - est en réalité l'exact opposé des traditions les plus fécondes de la gauche, telles que la liberté d'expression, la libération par rapport à tout fondamentalisme religieux, la primauté des questions collectives sur les désirs individuels.
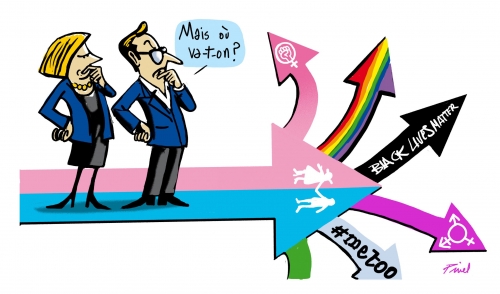

Au contraire, les cultures Woke et Cancel représentent un mélange bizarre de certaines expressions de la culture de "droite" dans ses composantes individualistes et libérales et de la culture de "gauche" dans ses composantes tout aussi individualistes qui tendent à transformer sémantiquement et juridiquement certains désirs individuels légitimes, issus de contextes historiques très précis, en droits naturels.
Tout cela va de soi. Mais il y a quelque chose de plus profond dans le wokisme. C'est en fait aussi l'un des résultats sociaux et culturels les plus significatifs du postmodernisme et du déconstructionnisme. Deux positions philosophiques, qui ces dernières décennies, se sont établies principalement aux États-Unis d'Amérique.
Né également de la vulgarisation par Jacques Derrida de la très fine lecture heideggérienne de Nietzsche, le déconstructionnisme compte parmi ses autres "pères" européens Deleuze et, en partie, Foucault. Ces perspectives philosophiques sont complexes et articulées, mais dans la lecture politique simpliste qu'elles ont reçue aux États-Unis (et, par rebond, en Europe), elles sont devenues des philosophies organiques du libéralisme de salon, avec leur primauté du flux sur la substance des entités, des événements et des processus (qui est également incontestable); et surtout avec leur apologie du désir individuel et avec leur destruction tendancielle de la rationalité classique (et donc aussi scientifique).

Le déconstructionnisme européen conserve une tendance à l'obscurité expressive et à ce que les Français appellent la "préciosité" (en référence à Molière), c'est-à-dire une sorte de snobisme fondé sur la conviction infondée d'être "le meilleur".
Les éléments problématiques du déconstructionnisme philosophique sont amplifiés démesurément dans le wokisme politique, à commencer par les éléments génétiques que le premier a transmis au second.
Tout d'abord, une tendance anthropocentrique cachée ou même niée, qui est évidente chez d'autres philosophes qui ont contribué au déconstructionnisme. Il s'agit surtout de Sartre, pour qui en dehors de l'humain il n'y a pas d'existence ou, s'il y en a une, elle ne vaut pas la peine d'être étudiée, et de Lévinas, qui ne conçoit de dialogue qu'entre les humains et non de l'humain avec le monde, avec le cosmos; monde et cosmos considérés comme substantiellement inexistants puisque "l'autre de l'être, c'est l'homme en tant qu'il n'est pas l'être". On comprend que le seul être qui compte est l'être humain" (Pierre Le Vigan, in Déconstruction ?, numéro 55 de Krisis, avril 2022, p. 22).
Anthropocentrisme qui, dans certaines tendances déconstructionnistes, évolue presque inévitablement vers l'artificialisme comme apogée des capacités humaines à remplacer le matériel par le numérique, et vers le transhumanisme comme remplacement du réel par le virtuel, sous la forme que Jean Baudrillard a précisément indiquée à travers le concept/dispositif du simulacre, c'est-à-dire un monde où le réel est un moment du faux (Debord), où la frontière entre ce qui arrive et ce qui est inventé tend à s'estomper.
C'est là une des racines de l'ingénierie sociale qui est constitutive à la fois du déconstructionnisme et du transhumanisme et qui a trouvé une mise en œuvre très claire dans l'affaire Cov id19. En effet, il s'agissait, et il s'agit toujours, d'une infodémie, d'une épidémie essentiellement médiatique, qui "a permis de déployer au niveau mondial le récit de la "pandémie meurtrière" qui doit servir de mythe fondateur à une dictature sanitaire et informatique mondiale en cours d'élaboration" (Lucien Cerise, ibid., p. 94).
L'expression et la forme de ce mythe fondateur du déconstructionnisme sanitaire et social sont la dissonance cognitive, l'obscurantisme anti-biologique, l'élimination des différences, l'hypermoralisme à caractère religieux.
La dissonance cognitive prend de multiples formes. Au niveau sociologique, par exemple, la double injonction d'accueillir le monde islamique en Europe et de combattre sans merci le patriarcat masculin, deux injonctions manifestement incompatibles entre elles. Au niveau sanitaire et climatique, la dissonance consiste aussi à éliminer la santé par la santé, en induisant un état permanent d'anxiété, de stress et de dépression au nom de la protection contre un virus.
La forme la plus flagrante de l'obscurantisme anti-biologique est la négation pure et simple de l'existence réelle et innée du masculin et du féminin, réduits à une construction purement sociale et culturelle qu'il faut démanteler de toutes les façons, dès les premières années d'école. Il n'y aurait même pas lieu de s'attarder sur cette pathologie évidente - croire que les hommes et les femmes n'existent pas - si elle n'était pas sérieusement soutenue dans divers forums.
Une pathologie qui constitue une preuve supplémentaire et évidente du rejet déconstructionniste et woke de la différence au nom de l'un, d'une identité de remplacement qui doit éliminer toute diversité ontologique, éthique, politique, au nom des valeurs et d'une égalité réduite à la pure uniformité de l'identique: "Philosophiquement, c'est un processus d'abolition du multiple, dans tous les sens du terme et à tous les niveaux de l'existence, pour aller vers toujours plus d'unité normative. (...) Il s'agit d'organiser volontairement l'unité du monde sur la base d'une hallucination collective" (Cerise, ibid., p. 95).
L'outil principal que l'idéologie woke déploie pour atteindre cet objectif est le langage: de l'utilisation du schwa et de l'astérisque à des stratégies plus complexes visant en tout cas à nier l'existence de tout ce qui pourrait constituer une différence sexuelle entre les humains. Et ce de manière cohérente, puisque le déconstructionnisme nie qu'une nature humaine soit donnée, existe, agisse.
L'éliminer en rendant impossible toute restitution linguistique est l'essence du néo-langage dont George Orwell énonce les principes dans les annexes de son célèbre 1984. Par conséquent, les pratiques woke deviennent des formes d'effacement de toute la culture humaine, puisqu'elle est presque entièrement le produit des hommes Homo sapiens, qui sont considérés comme l'origine et la cause efficiente de tous les maux.
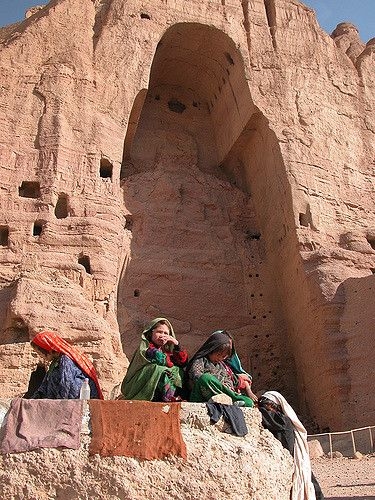

Le déconstructionnisme woke est exactement cela: une barbarie qui prend des formes rarement vues dans l'histoire des sociétés; un analogue pourrait être les militants d'ISIS qui ont démoli "les idoles", les statues de Bouddha, en Afghanistan.
Ce n'est donc pas un hasard si le dernier élément de la taxinomie que je propose ici consiste à "réactiver sur un nouveau terrain, celui de l'hyper-moralisme wokiste, le vieux fanatisme religieux" (Pierre-André Taguieff, p. 63). Taguieff ajoute que contre cette apologie de l'ignorance, il faut activer la gaieté de la science, qui germe aussi d'une gaieté du scepticisme à l'égard de toute vérité et de toute valeur absolues. S'y opposer au nom et sous la forme de la liberté, car "nous voulons que puisse à nouveau s'épanouir, partout en Europe, un débat d'idées ouvert, sans inquisition, sans fanatisme, sans procès d'intention" (David L'Épée, ibid., p. 56), redonnant un sens et une fonction émancipatrice à l'école et à l'université, de plus en plus réduites à des lieux d'endoctrinement moralisateur selon les modes que l'agenda libéral impose aux sociétés occidentales. En effet, l'ignorance n'est pas la "force" - comme le dit le slogan de 1984 - mais l'outil qui produit des esclaves.
Il faut donc agir et penser pour les libertés réelles, contre le fantôme de la liberté pour laquelle "en apparence, je pense et je fais ce que je veux, mais cela doit rester à l'intérieur du cadre circonscrit par les médias, qui définissent le nouveau discours sacré. Transgresser la parole médiatique revient à transgresser un tabou, et cela créé une malaise immédiat, de même nature que la contestation de la parole du prêtre ou du chaman dans une société traditionnelle" (Cerise, ivi, p. 100).
Nous terminons en rappelant une évidence taboue pour l'idéologie woke: la différence (non pas la hiérarchie, qui est à rejeter, mais précisément la différence) entre le masculin et le féminin.

Paul B. Preciado est un militant néo-féministe espagnol, auteur d'un manifeste contre tout "stéréotype de genre" et qui constitue, en même temps, une apologie de l'anus, "zone érogène commune à tous les humains sans différence de sexe, orifice non discriminant et marqueur d'égalité", qui "s'impose comme le nouveau 'centre universel contrasexuel'". D'où cet éloge déconstructionniste de l'anus, socle d'un universalisme enfin libéré de l'emprise des normes hétérosexuelles (...). Se situer par-delà le pénis et le vagin, organes de la différence des sexes, dont il faut cependant souligner qu'il ne s'agit que de 'constructions sociales'" (Taguieff, p. 60). Une telle version analocentrique du monde en dit long sur l'absence totale d'humour qui est une autre des limites de la vision woke de la société.
Tout cela contredit tellement la réalité - la réalité qui existe et se produit, au-delà de toute abstraction déconstructionniste - que c'est finalement insoutenable. Le politiquement correct et la cancel culture voudraient "faire coexister islamisme et gauchisme, féminisme et anti-racisme, relativisme axiologique et néo-puritanisme, et ces contradictions ne sont sans doute pas promises à la vie éternelle" (Yannick Jaffré, p. 11). Même la philosophie de l'anus de Preciado et d'autres ne résistera pas à l'épreuve du temps, fondée sur les rêves d'un visionnaire qui seront déconstruits et annulés par une métaphysique capable de respecter le réel, tout le réel, le réel de la différence.
11:10 Publié dans Actualité, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wokisme, déconstruction, philosophie, sociologie, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 07 juin 2023
Maïeutique sur l'infantilisme critique des tranchées métapolitiques

Maïeutique sur l'infantilisme critique des tranchées métapolitiques
Jorge Sánchez Fuenzalida
Source: https://euro-sinergias.blogspot.com/2023/06/mayeutica-en-torno-al-infantilismo.html
L'infantilisme est une attitude à l'égard des relations humaines qui se caractérise par un esprit dépourvu de perspective de confrontation, c'est-à-dire par une attitude de fermeture et d'annulation à l'égard de ceux qui ne sont pas d'accord avec le dit infantilisme. C'est-à-dire, celui qui n'est pas d'accord avec moi, qui refuse d'admettre que j'ai tout à fait raison ! La vérité d'une philosophie, la sainteté doctrinale inoffensive et fallacieuse de celui qui a dit : Dogme !
Dans la facticité décroissante des tranchées métapolitiques, une chose est claire : le séparatisme critique, infini, puéril, c'est ce que l'on sent, c'est ce que l'on ressent. On peut le goûter, on peut le toucher. Pourquoi est-ce que je soutiens que le séparatisme est en train de se produire ? Oui, en effet : il y a l'idée d'une discussion entre sourds, où personne ne s'écoute, mais où personne ne peut se voir non plus. Il s'agit d'un séparatisme virtuel, sans présence ni langage factuel. Et pourquoi est-elle critique ? Parce qu'elle répond aux logiques dogmatiques de la perfection puriste, où personne ne détient la vérité sinon le critique dans l'infini de sa perfection grandiloquente. Infantile ? Y aurait-il une sorte de symptôme de l'infantilisme de gauche, comme le dit Lénine ? Il y a donc beaucoup de tranchées qui se romantisent avec des idées nominalement de gauche, mais c'est une question de psychologie propre aux gens qui, philosophiquement et discursivement, sont incapables d'aller au cœur du sujet chez les penseurs qu'ils louent. Il s'agit peut-être d'un préjugé du berceau, lié à une haine émotionnelle de l'affirmation vis-à-vis du libéralisme. C'est exactement la même chose de l'autre côté, là-bas, dans la droite puérile, mais ici il s'agit d'aller au fond des choses, de ne pas se laisser emporter par des impressions accommodées par des partis pris et des goûts exclusifs pour tel ou tel philosophe ou théoricien. Il s'agit de se libérer de la critique fondée sur la défense ou le rejet d'une idéologie, il s'agit de converser pour dissiper le désir de connaître la bonne vérité, a priori, issue d'une lecture typique des réseaux du monde virtuel.

Qui doit avoir raison dans la discussion philosophique qui se déroule entre les tranchées ? Est-ce peut-être le plus versé des exposants ? Peut-être le plus profond des penseurs critiques ? Ou celui qui converse à travers celui qui a raison et le plus profond des penseurs ? Qui peut pointer et fixer sa critique sur la poutre dans l'œil de l'autre ? Qui est le gourou, celui qui a l'intellect le plus vigoureux et le plus vivant ? Qui est juste ? Toutes ces questions - et bien d'autres encore - émergent d'un regard serein et calme, sincère et conversationnel, par rapport aux oscillations ferventes et sinistres des nombreuses tranchées qui, dans leur déni dogmatique, ne conversent pas, mais réduisent au silence le pouvoir de celui qui converse sagement et prudemment en maïeutique. Qui sont-ils ? Critiques littéraires ? Maçons de la pègre ? Juges de la vertu ? Qui êtes-vous tous ? Ne me tenez pas rigueur du titre d'exemption : je suis moi aussi circonscrit par cet infantilisme. Moi aussi, j'ai massacré de façon critique les organisations ou les individus qui tentent, à grand-peine, de s'immiscer dans un combat politique qui n'est pas celui des enfants, mais celui des adultes. Grandeur de celui qui a décidé de s'arrêter, de réfléchir et de parler, alors arrêtons de pointer du doigt ! Prudence de celui qui, devant la crudité des choses, cesse de se précipiter pour porter un jugement public ! Prudence de celui qui, dans l'émotion, mais aussi dans la raison, massacre sa propre idolâtrie.
Cet infantilisme, typique de la réalité telle qu'elle est, là, dans les tranchées métapolitiques, est une attitude de confrontation, engoncée dans la prétention de la supériorité morale, voire des mémoires hautaines, mais en même temps, dépourvue d'intellect. C'est un infantilisme qui nous sépare les uns des autres dans la défense dogmatique et religieuse de ceux qui se savent partisans de la défense d'une tradition théorique. Mais cette attitude n'est-elle pas légitime ? Elle l'est certainement. Mais la situation doit être différente dans l'ouverture maïeutique qui cherche à ordonner toutes les idées exprimées par les tranchées, en vertu d'un projet commun qui est plus grand que toutes les particularités. En effet, cette évidence - celle de s'arrêter pour parler - qui reflète au moins le début vertueux de la maturation de l'infantilisme, cherche à bannir de nos rangs le désir impulsif de cet enfant qui, dans la défense maternelle, ne veut pas partager ses jouets ni écouter des raisons ou des justifications ; il faut donc amener cet enfant égocentrique à se confronter à ses propres maux, à ses mauvaises habitudes et à sa mauvaise éducation. Il faut que cet enfant appréhende la dureté du monde ! Il doit comprendre qu'il existe dans un monde dynamique, complexe, imparfait, ouvert, terrible et merveilleux.
La puérilité est l'activité immanente du conseiller de bureau, celui qui n'a pas de présence, qui ne chante pas, qui ne pense pas, qui est enfermé dans son propre verbiage virtuel. C'est habiter le non-monde, c'est vivre dans les vacillations frénétiques du jugement absolu : j'ai raison, personne d'autre n'a le vrai jugement !
L'infantilisme est sans doute un regard critique qui nie la réflexion et condamne la conversation au silence, au conformisme de ceux qui se savaient sages et qui ont fermé les portes du monde réel et de la réalité. L'infantilisme est, à sa juste mesure, une période psychologique, parfois nécessaire, où l'on se retrouve à cheminer dans les possibilités réelles de mûrir, de passer de l'enfant à l'adulte : de quitter ce que l'on était enfant, en temps voulu, pour devenir un adulte responsable du monde qu'il engendre, du monde avec lequel il doit impérativement converser.

En effet, les tranchées métapolitiques ont pour mission de se retrouver dans la conversation maïeutique, dans la conversation qui déverrouille et met à nu leurs propres limites légitimes : nous devons donc nous retrouver dans la conversation qui fait mûrir ce qui, par nature, doit être la cause de la lutte dans la guerre commune des mentalités. La conversation maïeutique découvre nos vérités et les oppose à l'infantilisme dont nous pouvons faire preuve : la conversation nous montre la réalité et l'absurde monotonie de ceux qui vivent dans l'enfance ; l'infantilisme métapolitique est l'excuse de ceux qui ne veulent pas entendre, de ceux qui n'ont rien à dire en dehors de leurs propres abstractions idéalistes.
Cependant, et malgré tout, les tranchées imprégnées de la guerre de l'organisation politique ont deux options existentielles : se fermer dans l'expérience infantile de communautés virtuelles qui ne produisent rien, ou s'ouvrir dans un retour à des relations humaines radicales ; celles qui combinent dans la franchise de ceux qui sont ici pour écouter et dire, ceux qui sont ici aussi pour être entendus, pour faire partie de la conversation qui, dans le mouvement annonciateur de ceux qui voient leur voisin, se déplace volontairement dans l'idée profonde d'aller de l'avant ensemble, en bloc. Allons-nous continuer à nous séparer, dans l'immobilité apparemment fervente et mouvante du monde virtuel ? Il n'y a pas de mouvement, moins développé, dans la stérilité de ceux qui refusent de converser, de connaître et de comprendre leur propre monde.
Tout cela, d'ailleurs, chers lecteurs, nous invite à réfléchir sur la réalité de nos relations, qu'elles soient virtuelles ou radicalement face à face, dans lesquelles nous devons nous demander : que faisons-nous ? Je vous remercie de votre attention.

Pour commander ce livre: https://editorialeas.com/producto/guerra-ideologica/
17:36 Publié dans Philosophie, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, réflexions personnelles, infantilisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Un rebelle européen aux racines russes

Un rebelle européen aux racines russes
Yana Panina
L'anarchisme classique à travers les yeux du radical russe Mikhaïl Bakounine
L'histoire du véritable anarchisme avec un arrière-plan russe est étroitement liée à la personnalité de Mikhaïl Bakounine, dont la contribution au destin du monde entier s'est avérée colossale. Véritablement russe, éduqué à la philosophie européenne, son objectif principal était de créer un monde où tous les hommes seraient égaux et libres, et où la vie ne serait pas mesurée par l'épaisseur de la bourse ou la hauteur du piédestal social. Les idées utopiques de Bakounine allaient à l'encontre des pensées de Marx, pour qui le radical n'était soudain plus que "ce gros Russe". Qui était-il donc et sa philosophie est-elle encore vivante aujourd'hui ?
Conditions préalables à la formation de l'anarchisme de Bakounine
Mikhaïl Bakounine a "hérité" des idées de liberté et d'égalité de son éducation au sein d'une famille nombreuse et très conviviale. Une petite communauté de 11 enfants, égaux en termes de conditions et de relations, formait une sorte de commune, où chacun grandissait spirituellement et développait sa propre "personnalité" : "... je veux dire une liberté digne de ce nom, une liberté offrant une pleine possibilité de développer toutes les capacités, intellectuelles et morales, cachées en chaque homme...", décrira plus tard Bakounine.
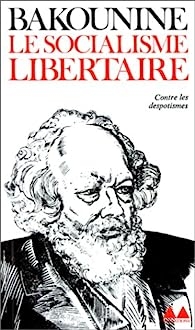 Mikhaïl Alexandrovitch n'était pas le seul représentant de la "nouvelle pensée révolutionnaire". Sa cousine, Catherine, n'était pas en reste. Selon ses souvenirs, dans sa jeunesse, la jeune fille était plutôt une "jeune fille innocente", mais à l'âge adulte, elle est devenue résolue et forte, une véritable manifestation de l'homme libre, comme Bakounine lui-même l'entendait. À force de persévérance, Catherine réussit à se faire engager comme sœur de miséricorde dans la ville assiégée de Sébastopol pendant la guerre de Crimée. "Je devais résister par tous les moyens et avec toute mon habileté au mal que divers fonctionnaires, fournisseurs, etc. infligeaient à nos malades dans les hôpitaux ; et je considérais que c'était mon devoir sacré de lutter et de résister", a déclaré plus tard Catherine pour décrire son véritable objectif. Son esprit rebelle de résistance à la bureaucratie, sa fermeté et sa persévérance ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Nikolaï Pirogov : "Chaque jour et chaque nuit, on pouvait la trouver dans la salle d'opération, assistant aux opérations, alors que des bombes et des missiles traînaient autour d'elle. Elle faisait preuve d'une présence d'esprit difficilement compatible avec la nature d'une femme". Qu'est-ce que cela signifie ? Que Bakounine lui-même, mais aussi tous les membres de sa famille, n'étaient pas seulement de fortes personnalités, mais aussi des personnes qui n'avaient pas peur de s'affirmer, des personnes qui aimaient la liberté et la vérité. L'éducation et l'environnement ont beaucoup influencé le futur anarchiste et révolutionnaire.
Mikhaïl Alexandrovitch n'était pas le seul représentant de la "nouvelle pensée révolutionnaire". Sa cousine, Catherine, n'était pas en reste. Selon ses souvenirs, dans sa jeunesse, la jeune fille était plutôt une "jeune fille innocente", mais à l'âge adulte, elle est devenue résolue et forte, une véritable manifestation de l'homme libre, comme Bakounine lui-même l'entendait. À force de persévérance, Catherine réussit à se faire engager comme sœur de miséricorde dans la ville assiégée de Sébastopol pendant la guerre de Crimée. "Je devais résister par tous les moyens et avec toute mon habileté au mal que divers fonctionnaires, fournisseurs, etc. infligeaient à nos malades dans les hôpitaux ; et je considérais que c'était mon devoir sacré de lutter et de résister", a déclaré plus tard Catherine pour décrire son véritable objectif. Son esprit rebelle de résistance à la bureaucratie, sa fermeté et sa persévérance ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Nikolaï Pirogov : "Chaque jour et chaque nuit, on pouvait la trouver dans la salle d'opération, assistant aux opérations, alors que des bombes et des missiles traînaient autour d'elle. Elle faisait preuve d'une présence d'esprit difficilement compatible avec la nature d'une femme". Qu'est-ce que cela signifie ? Que Bakounine lui-même, mais aussi tous les membres de sa famille, n'étaient pas seulement de fortes personnalités, mais aussi des personnes qui n'avaient pas peur de s'affirmer, des personnes qui aimaient la liberté et la vérité. L'éducation et l'environnement ont beaucoup influencé le futur anarchiste et révolutionnaire.
Les idées de Mikhaïl Bakounine ont également été fortement influencées par l'esprit révolutionnaire de la Russie dans laquelle il est né et a grandi. Le petit Misha a connu le soulèvement de décembre 1925 à l'âge de onze ans. La société a alors l'espoir d'un changement sérieux de l'État, une grande partie de l'aristocratie russe y voit le véritable salut du pays. Divers cercles se forment, auxquels adhèrent de nombreuses personnalités des arts et des sciences et des membres influents de la noblesse russe. En 1835, après avoir été renvoyé d'une école d'officiers et avoir effectué un service militaire insipide, Bakounine s'est retrouvé dans l'un de ces cercles. C'est le manque de liberté de pensée et d'action, ainsi que la discipline rigide et les règles strictes pendant le service militaire qui, selon certains chercheurs, l'ont amené à penser que l'anarchisme était l'avenir de la Russie et, plus tard, de toute l'Europe.
Installé à Moscou, le jeune penseur se fait de nombreuses connaissances : Stankevitch, Pouchkine, Tchaadaïev, Belinsky, Botkine, Katkov, Granovsky, Herzen, Ogarev, pour ne citer que quelques-uns des membres du cercle social de Bakounine. C'est sous l'influence de Stankevitch que Mikhail Aleksandrovitch approfondit l'étude de la philosophie allemande : il commence à s'intéresser aux idées de Kant et de Fichte. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le futur anarchiste est à cette époque convaincu que l'amour de Dieu donne à l'homme la liberté, l'épanouissement personnel et l'indépendance.

À la fin des années 1830, Bakounine est fasciné par les écrits de Hegel qui, selon lui, lui insuffle "une vie complètement nouvelle". Sur la base des doctrines du philosophe allemand, Michael publie un certain nombre de ses travaux sur l'esprit, la connaissance absolue, la réalité et la volonté de Dieu, etc. Inspiré par les enseignements de Hegel, Bakounine s'installe à Berlin en 1840 pour y recevoir une bonne éducation à l'allemande, mais il se désintéresse rapidement de la philosophie théorique et devient un véritable praticien de l'anarchisme, rejoignant les cercles des réformateurs européens, déplaçant "vers la gauche" ses opinions politiques.
Dès 1942, il publie un article intitulé "De la réaction en Allemagne", qui commence à refléter explicitement les idées de l'anarchisme auxquelles il restera fidèle pendant très longtemps: l'égalité sociale et les principes de liberté ne peuvent être atteints que par la destruction complète du modèle d'État politique existant. L'année suivante, Bakounine s'imprègne des idées communistes et publie un article dans lequel il affirme que "le communisme n'est pas une ombre sans vie. Il est né du peuple, et du peuple, une ombre ne peut jamais naître". Les idées plutôt radicales et critiques du "réformateur" ne sont pas du goût des autorités russes et Mikhaïl Bakounine devient littéralement un ennemi public dans son pays, si bien qu'un retour en Russie ne semble plus possible.
Au milieu des années 1840, l'anarchiste rencontre des théoriciens communistes, dont Marx. Ils deviendront bientôt des ennemis jurés pour toujours, mais nous y reviendrons plus tard.
Le rebelle en liberté : le rôle de Mikhaïl Bakounine dans les révolutions européennes de 1848-1849
Mikhaïl Aleksandrovitch a également joué un rôle majeur dans les soulèvements de libération en Pologne. C'est là qu'ont émergé ses idées de panslavisme - l'unification de tous les peuples slaves en une seule fédération. Selon Bakounine, pour construire un monde nouveau et libre, pour une pleine justice politique et sociale, il est nécessaire de couper les systèmes existants avec les racines, de tout détruire jusqu'au sol. Il pensait que grâce aux efforts conjoints des Slaves de l'Ouest et du Sud, il était possible de réaliser un changement en Russie: se libérer du "joug allemand" en renversant les dirigeants qui étaient les principaux ennemis du peuple slave.
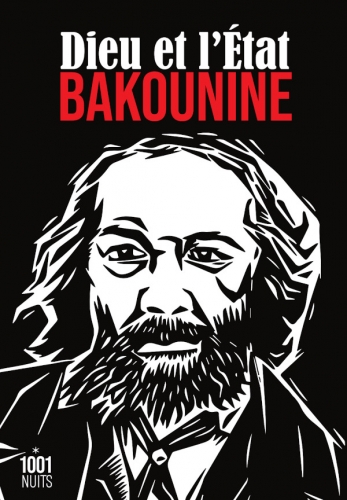
L'esprit de rébellion du maître russe des destinées de l'État a trouvé une application, non seulement dans les mots, mais aussi dans les actes. Bakounine attendait avec impatience la vague révolutionnaire en Europe, et il l'a finalement connue. En 1848, il participe activement à ce que l'on appelle le "printemps des nations", qui touche la France, l'Allemagne, la Pologne et d'autres pays. Le radicalisme de Mikhaïl Alexandrovitch a eu l'occasion de se manifester à Dresde. Le destin a voulu que ce noble russe, qui avait l'expérience du service militaire, se retrouve dans une ville saisie par un gouvernement provisoire. La légende veut qu'on lui ait demandé d'aider à organiser la défense et à stimuler l'esprit révolutionnaire des citoyens. Lorsque les troupes royales ont commencé à avancer, Bakounine a proposé des mesures de protection radicales: tout d'abord, accrocher de grandes œuvres d'art, dont la Madone Sixtine, sur les murs de la ville afin que les militaires, élevés dans l'amour et le respect de l'art et de l'histoire, n'osent pas tirer. Et s'ils avaient osé, ils auraient été traités de barbares et de vandales. Un peu plus tard, Mikhaïl Bakounine fait d'autres propositions: brûler les maisons des aristocrates locaux, faire sauter l'hôtel de ville et couper les arbres anciens qui gêneraient les troupes royales. Le gouvernement provisoire, cependant, décide de ne pas recourir aux idées du révolutionnaire russe et se rend sans combattre.
De quoi témoigne cette affaire, décrite plus tard dans les écrits de Herzen ? Tout d'abord, Bakounine pensait que le peuple russe était prêt pour la révolution, car il était pauvre et possédait déjà "les habitudes et les instincts d'une société démocratique", mais que les Européens devaient d'abord se débarrasser des "échos matériels du passé", dont les symboles sont les œuvres de Raphaël, le vieil hôtel de ville et les arbres centenaires. Et cela doit se faire rapidement, pas lentement.
Après cette tentative de renversement du gouvernement à Dresde, Bakounine est envoyé en exil, revient dans son pays et, après 8 ans d'emprisonnement, est envoyé en Sibérie, où il se marie puis s'enfuit en Europe via le Japon en 1861. L'année 1861 marque un nouveau chapitre dans ses activités philosophiques et pratiques. Au cours des 20 années suivantes, le bakounisme va littéralement envahir toutes les rues, même les plus reculées, des villes européennes, et Mikhaïl lui-même va devenir un symbole du mouvement socialiste.
Idées fondamentales de l'anarchisme, du fédéralisme et de l'État sans État
C'est au cours de cette période que se forge définitivement sa vision athée et matérialiste. Pour Bakounine, l'idéalisme conduit inévitablement "à l'organisation d'un despotisme grossier et à une exploitation mesquine et injuste sous la forme de l'Église et de l'État". Il semble que les opinions d'un homme sur de simples questions philosophiques changent parfois radicalement: jeune et encore immature, Bakounine restait fidèle à Dieu, voyant en lui la véritable liberté de l'homme. Mais au bout d'un certain temps, sous l'influence des idées communistes d'égalité et de fraternité, il a renoncé à la religion, montrant que la foi était l'une des manifestations d'une société déjà rassise, dépassée, opprimée, qui ne se tournait vers Dieu que pour supporter les conditions insupportables de la vie. En même temps, le philosophe pensait que la religion est une partie historique inhérente à toute nation et qu'elle doit être traitée avec soin pour ne pas lui nuire. "Avec l'aide de la religion, l'homme est un animal qui, sortant de l'animalité, fait le premier pas vers l'humanité", écrivait-il.
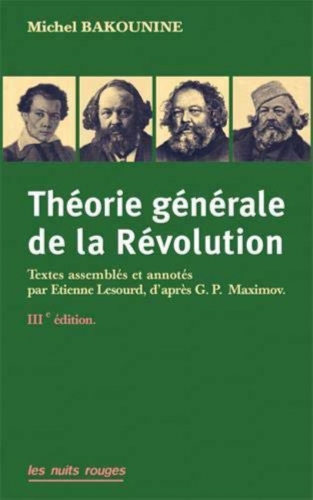
Il est également intéressant de noter qu'un farouche opposant aux lois et au contrôle de l'État n'a pas nié l'existence possible d'un gouvernement provincial (un parlement composé de deux chambres : des représentants de l'ensemble de la population et des communautés), d'une constitution et d'un tribunal. Les communautés réunies en fédérations devaient "coordonner leur propre organisation avec les principaux fondements de l'organisation provinciale et obtenir pour cela l'autorisation du parlement provincial". En même temps, "la loi communale conservait le droit de s'écarter sur des points mineurs de la loi provinciale, mais pas de ses fondements". Dans la construction de l'État, Bakounine a mis en avant le principe de la "pyramide inversée", où les principaux "pouvoirs décisifs sont concentrés localement". Dans le même temps, il ne nie pas l'existence possible d'une structure de pouvoir verticale et note que toutes les actions des communautés doivent servir les intérêts de l'État lui-même.
Les idées de Mikhaïl Alexandrovitch prévoyaient la création d'un gouvernement national qui rédigerait une constitution, tout comme les provinces, à condition que ces dernières puissent s'en écarter sur des points mineurs. Les pouvoirs du Parlement national auraient inclus le contrôle des activités de l'exécutif élu, la rédaction et l'adoption des lois, l'établissement de relations internationales avec d'autres pays, etc. Sur le même principe, une fédération internationale de pays a été envisagée.
Lutte pour l'Internationale : comment d'anciens amis et compagnons d'armes, Marx et Bakounine, sont devenus des ennemis jurés
L'histoire des relations difficiles entre Bakounine et Marx commence en 1864. Mikhaïl Alexandrovitch se rend en Italie pour diffuser les idées de l'Internationale, où il va à l'encontre de la philosophie du prolétariat et tente de créer sa propre "Société révolutionnaire internationale" secrète, où tous seraient frères. Elle repose sur l'idée de détruire tous les États européens, à l'exception de la Suisse, afin d'éliminer le modèle de pouvoir centralisé. Le plan consistait à créer des communautés qui s'uniraient en fédérations à différents niveaux. Parallèlement, l'anarchiste considérait nécessaire le pouvoir du peuple sous la forme d'une communauté autonome de tous les citoyens adultes, en élisant des représentants des différents fonctionnaires, mais avec la condition obligatoire de leur remplacement permanent, ce qui, selon Bakounine, ne donnerait pas un statut privilégié et garantirait les libertés démocratiques. Tous les aristocrates sont exclus, tous les partisans d'un quelconque privilège,...". Car le mot démocratie ne signifie rien d'autre que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire la masse entière des citoyens - et à l'heure actuelle, nous devons ajouter les citoyens qui composent la nation", écrit Mikhaïl Aleksandrovitch.
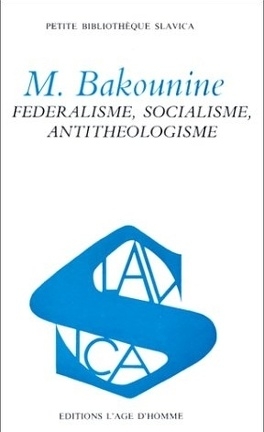 En 1868, Bakounine prépare un projet de "Fraternité internationale", dans lequel il formule les principes de base de l'anarchisme, qui impliquent "la destruction complète de tout État, de toute église, de toute institution religieuse, politique, bureaucratique, judiciaire, financière, policière, économique, universitaire et fiscale".
En 1868, Bakounine prépare un projet de "Fraternité internationale", dans lequel il formule les principes de base de l'anarchisme, qui impliquent "la destruction complète de tout État, de toute église, de toute institution religieuse, politique, bureaucratique, judiciaire, financière, policière, économique, universitaire et fiscale".
La transition vers le nouveau système devait être le résultat d'une révolution. Ses principaux moteurs, selon Bakounine, sont la paysannerie et la classe ouvrière, qui vouent une haine instinctive aux couches privilégiées de la société. Et leurs principaux outils sont la rébellion et la lutte pour la liberté. Élevé dans la pauvreté et l'esclavage, le peuple russe a une aversion pour l'État, car son principal désir est la terre libre, le travail commun et l'absence de bureaucratie et de propriété foncière. En même temps, seule une jeune intelligentsia révolutionnaire peut rassembler la paysannerie et la classe ouvrière et canaliser leur puissance dans une cause commune.
Il en résultera une société sans aucune autorité, où les gens se soumettront à l'autorité de l'opinion publique, et où les paysans et les ouvriers deviendront les seules classes existant en harmonie - "les uns sont propriétaires du capital et des instruments de production, les autres - de la terre, qu'ils cultivent de leurs mains ; les uns et les autres s'organisent, motivés par leurs besoins et leurs intérêts mutuels, également et en même temps absolument libres, nécessaires et naturels, se contrebalançant réciproquement".
La polémique de Bakounine avec Marx consistait principalement en des perspectives différentes. Tout d'abord, Mikhaïl Bakounine a déclaré que la dictature du prolétariat aboutirait au même résultat que celui auquel les révolutionnaires s'opposaient. En d'autres termes, le gouvernement et le régime politique changeraient, mais leur essence resterait la même, sauf que le pouvoir serait désormais concentré entre les mains du prolétariat. L'État est le vrai mal : "Là où commence l'État, finit la liberté individuelle, et vice versa... S'il y a État, il y a nécessairement domination, donc esclavage ; un État sans esclavage, ouvert ou déguisé, est impensable - c'est pourquoi nous sommes ennemis de l'État.
L'affrontement entre Bakounine et Marx culmine dans la tentative du premier de tirer à lui la couverture d'influence de l'Internationale. En fin de compte, la bataille d'idées s'est transformée en une guerre personnelle entre deux personnalités puissantes de l'époque. Marx estimait que les activités des bakounistes sapaient les idées de la dictature du prolétariat et, en 1972, les partisans de Mikhaïl Alexandrovitch ont été expulsés de l'Internationale.
Les adeptes contemporains du bakounisme
De nos jours, les idées du grand rebelle appartiennent au passé, bien que les adeptes de l'anarchisme russe existent toujours. Aujourd'hui, cependant, il ne s'agit pas seulement d'une alliance contre l'État, mais aussi d'une lutte idéologique contre certains problèmes mondiaux de l'humanité, tels que l'écologie et la protection de l'environnement. Dans le même temps, on observe une certaine crise parmi les anarchistes : il y a de moins en moins d'adeptes en raison du manque d'unité et d'intégrité du mouvement.

En Russie, l'Union anarchiste russe a joué un rôle important à cet égard, car elle a fondé ses idées sur l'anarchisme national et ethnique. En d'autres termes, il s'agit d'une association de personnes de la même nationalité vivant sur le même territoire. Cela inclut le panslavisme de Bakounine et l'idée d'anti-ethnicité de Kropotkine. Oui, les gens croient encore à l'accomplissement de la révolution, et les protestations et les révoltes en sont le principal outil. Mais au début du XXIe siècle, le mouvement des adeptes de Bakounine, de Kropotkine et d'autres philosophes et figures révolutionnaires s'est transformé en une sorte de sous-culture et, dans l'esprit de la plupart des Russes, il est désormais associé à l'impuissance et à l'anarchie. Comme au 19ème siècle, les adeptes de l'anarchisme se positionnent comme un mouvement en dehors de toute force politique, mais en même temps, ils ne sont pas encore devenus une force motrice sérieuse capable d'influencer l'esprit des jeunes et de la société dans son ensemble.
Les idées de Mikhaïl Bakounine sont-elles pertinentes aujourd'hui ? Probablement pas. Dans le contexte actuel de lutte politique permanente, il est nécessaire de disposer d'une autorité centralisée claire, capable de maintenir l'unité du peuple. Même si l'on peut dire que des tentatives de liberté totale ont eu lieu dans les années 1990, il s'agissait d'un défi sérieux à la pérennité de l'État.
Malheureusement, les idées utopiques sur l'existence de fédérations composées de communautés de personnes sont impossibles. On peut être d'accord ou non, mais nous vivons une période de "guerre froide", où chaque pays se bat pour ses propres ressources et intérêts plus que pour des vies humaines. Pour survivre, il faut non seulement s'unir, mais aussi éviter que l'État ne soit détruit par l'absorption de ses petites "communautés", comme lors du schisme féodal. L'appartenance à une nation ne fera qu'engendrer davantage de disputes et de conflits. Certes, la liberté fait partie intégrante de la société démocratique à laquelle chacun aspire aujourd'hui. Mais en même temps, l'émergence d'une plus grande liberté dans certains domaines s'accompagne aussi de l'émergence de plus grands interdits dans d'autres. L'existence de l'anarchisme dans le contexte moderne est donc fortement remise en question. Et qu'elle reste ouverte...
12:46 Publié dans Histoire, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, mikhail bakounine, bakounine, 19ème siècle, anarchisme, révolution, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 25 mai 2023
Une civilisation en crise

Une civilisation en crise
par Pierluigi Fagan
Source: https://www.sinistrainrete.info/teoria/25532-pierluigi-fagan-una-civilta-in-crisi.html
Je reproduis le texte d'une intervention en deux posts différents publiés sur ma page fb où je poursuis maintenant mon journal de recherche qui a animé les premières années de ce blog récemment négligé.
En réponse au titre de l'article, clarifions d'abord le point de vue de notre discours. Notre point de vue est historique, nous regardons l'objet civilisation, la civilisation occidentale en particulier, du point de vue du cours historique. Le sujet est vaste et complexe et souffrira d'être réduit à quelques billets.
Cette civilisation, née avec les Grecs il y a deux mille sept cents ans, a été pendant plus de quatre-vingts pour cent de son temps un système local et interne. Pour le reste, à partir du XVIe siècle et jusqu'aux débuts de la période que nous appelons moderne, le système a connu un big bang inflationniste qui s'est étendu à toute la planète, non pas en absorbant l'espace, les peuples et la nature en son sein, mais en les soumettant et en les exploitant. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas ici de porter des jugements moraux, mais seulement de procéder à une analyse fonctionnelle. Au cours de ces cinq siècles, la civilisation occidentale s'est suralimentée en étant capable de nourrir son petit intérieur d'une domination relative sur un extérieur beaucoup plus vaste, c'est-à-dire qu'elle a pu compter sur de vastes et riches conditions de possibilité.
Au cours de ces cinq siècles, ce que l'on appelle la civilisation occidentale moderne a profondément changé. En termes de composition, elle a connu une migration interne de son point central depuis la Méditerranée grecque puis romaine, d'abord vers la côte nord-ouest de l'Europe, puis elle a traversé la Manche pour s'installer en Angleterre (puis en Grande-Bretagne, puis au Royaume-Uni), puis elle a traversé l'Atlantique pour s'installer en Amérique du Nord. On pourrait aussi dire que, venant d'une région par nature hyper-connectée géographiquement (Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique du Nord), elle s'est progressivement isolée d'abord continentalement, puis insulairement, pour finir par s'installer sur une terre abritée par deux vastes océans.

L'isolement géographique lui a toutefois valu le pouvoir de dominer une grande partie de l'espace mondial sans risquer trop de contre-réactions, comme cela s'est toujours produit dans la dynamique expansive des empires-civilisations terrestres.
Au niveau de l'équilibre matière-énergie, une région du monde a progressivement dominé une grande partie du monde, a énormément élargi son espace vital.
Ces conditions ont permis à la partie européenne originelle de la civilisation de se diviser en États plus petits. L'Europe a un rapport territoire/population moyen par État bien inférieur à la moyenne mondiale. L'Europe compte à peu près autant d'États que l'ensemble de l'Asie ou de l'Afrique, alors que son espace est quatre ou trois fois plus petit. En outre, cette comparaison n'est même pas tout à fait correcte puisque ce sont précisément les empires européens qui ont partitionné, pour leurs propres intérêts impériaux-coloniaux, l'espace asiatique et africain qui, qui sait, aurait connu d'autres dynamiques s'il avait été laissé libre d'explorer son propre espace de possibilités. Cette étrange partition localiste européenne a montré des signes de déséquilibre systémique évident à deux reprises au cours du siècle dernier, accélérant le processus de migration du centre de la civilisation vers l'île britannique, puis vers l'île continentale nord-américaine.
Ces "États", dont chacun possède son propre peuple appelé "nation", se sont de plus en plus organisés autour d'un double système économico-politique. Sur le plan économique, les Occidentaux ont développé un système suralimenté par des matériaux et des énergies provenant pour la plupart de l'extérieur. À cette surcharge matérielle, ils ont ajouté deux autres surcharges immatérielles. La première provient de l'argent créé à partir de rien qui avance de la valeur que l'on espère ensuite restituer (en éteignant la dette de l'avance) en dégageant un surplus appelé profit. Ce profit est accumulé ou réinvesti pour alimenter de nouveaux cycles. Le second fait par l'énorme développement des connaissances, des savoirs et des pratiques techniques et scientifiques. Matières, énergie, argent et connaissances se sont retrouvés à l'intérieur d'une machine productive-transformatrice. Cette machine, par le biais du travail humain, est devenue le cœur ordonnateur de ces sociétés, chaque producteur étant également un consommateur. Deux flux sont sortis de la machine, l'un de produits ou de services vendus au marché pour obtenir le retour du capital initial plus le profit, l'autre de déchets, de transformation ou de consommation.

Sur le plan politique, l'ordre a été de créer un système original dans la forme mais moins dans le fond, que l'on a appelé, improprement, démocratie ou, dans la veine du mépris de la logique linguistique (oxymores) : démocratie de marché. Le fond est celui habituel de toutes les civilisations depuis cinq mille ans, c'est-à-dire le fait qu'une partie plus petite (le Peu), domine et gouverne avec des fortunes diverses une partie plus grande (le Beaucoup). L'originalité, qui plutôt que démocratique devrait être qualifiée de républicaine, a été que la multitude a eu (au cours des dernières décennies de ces cinq siècles) la faculté d'exprimer un certain goût ou une certaine aversion pour le type d'interprètes du format qui n'a jamais été remis en question. Un goût très superficiel, c'est-à-dire qui ne repose pas sur un partage conscient et profond des différents programmes politiques.
La "crise" dans laquelle est entrée la civilisation occidentale est la restriction plus ou moins brutale de toutes ces conditions de possibilité à la fois. C'est pourquoi on parle de "crise systémique". Dans un système, l'état de crise, quelle que soit la manière dont il est généré, est toujours la crise de toutes ses parties et de leurs interrelations.
L'arrangement par lequel ce petit système d'Occidentaux a pu dominer un espace beaucoup plus vaste pour se suralimenter n'est plus donné aujourd'hui et le sera de moins en moins dans l'avenir immédiat. Cette nouvelle impossibilité est sous-tendue par une logique historico-démo-physico-culturelle, qui n'est pas un sujet de volontarisme ou de discussion, mais un fait inéluctable. Alors que l'espace des possibilités extérieures se rétrécit de plus en plus, l'étanchéité interne du système se fissure.
En effet, le centre américano-anglo-saxon a une logique et une dynamique propres qui tendent à s'écarter de l'espace européen. A son tour, cette Europe, à l'ontologie géographique et géo-historique précaire, se révèle être un système très faible, vieillissant, hyper-fractionné, vicié par une étrange croyance post-historique selon laquelle le nouvel ordre était applicable à une dynamique pure (le marché) plutôt que statique (l'Etat alors plus ou moins dynamique). Une sorte d'ontologie des flux tout en forme et sans substance. Ce vieux syndrome de la pensée occidentale selon lequel ces gens pensent que parce que quelque chose peut être pensé, cela le fait exister (connu sous le nom de syndrome des cent thalers) et fonctionner dans le concret.
La partie économique de son ordre a perdu son exclusivité puisqu'elle est désormais répliquée dans le monde entier. De plus, contrairement à ce "reste du monde", l'Occident a déjà produit tout ce dont il avait besoin et continue depuis longtemps à produire des choses qui ne servent plus à rien d'autre qu'à maintenir le système à peine en vie. Enfin, l'Occident continue à avoir de nombreux besoins qu'il n'élude pas parce qu'ils ne peuvent pas être transformés en biens et services.
De plus, on voit ici que le big bang qui a commencé au milieu du 19ème siècle comme une cascade d'inventions génératives (vapeur, mécanique, physique, chimie, santé, électronique), n'a produit dans la seconde moitié du 20ème siècle que le domaine des TIC que l'on expérimente maintenant aussi en bio. À tel point que la production matérielle a été abandonnée pour se réfugier dans un rêve immatériel fatigué, de type financier, qui a fait perdre au cœur de la machine productive sa fonction d'ordonnancement social (travail, revenu). Certains pensent qu'il s'agit d'une erreur, aussi parce que la notion d'erreur implique la réversibilité. Malheureusement, il n'y a pas de réversibilité, le problème aurait pu et dû être traité différemment (mondialisation malveillante et son pendant idéologique néolibéral), sans aucun doute, mais la dynamique sous-jacente de la perte de l'élan productif traditionnel était et est, fondamentalement, irréversible.
Bien que les Occidentaux eux-mêmes se considèrent comme des "matérialistes", il n'est peut-être pas évident pour tout le monde de savoir ce que les TIC ou les NBIC (nano-bio-info-cognitifs) "valent" par rapport à la production traditionnelle proprement dite. On ne fait certainement pas vivre un système économique complexe avec la restriction des activités productives nées des différentes révolutions innovantes de la première moitié du 20ème siècle, hypothétiquement compensées par ces nouveaux domaines. D'autre part, les innovations de moyens (nouvelles façons de faire des choses anciennes) ne génèrent pas de nouvelles choses, remplaçant des moyens qui libèrent également des soldes d'emploi négatifs. Des producteurs en crise qui deviennent des crises de consommation, grippant tout le mécanisme.

Le "reste du monde", quant à lui, est au début de la courbe logistique du cycle production-consommation, il a encore beaucoup à faire pour accroître sa richesse collective et personnelle. Rien qu'entre les Indiens et les Chinois, nous en sommes à près de trois milliards d'habitants, la Chine se situant au 72e rang en termes de PIB/habitant et l'Inde au 144e (FMI). Et il n'y a pas que la richesse par habitant, il y a aussi l'épaisseur infrastructurelle et collective des pays individuels qui accéderont à une forme de modernité qui leur est propre.
La politique est devenue le sous-système qui a concentré toutes ces dynamiques restrictives en son sein, tentant de les absorber sans les gérer. Le résultat a été la désintégration de la forme soi-disant démocratique au profit d'un républicanisme privatisé ou la perte de toute notion propre de res publica.
Cette brève analyse nous amène à cette liste affligeante de problèmes graves : a) les relations entre l'Occident et le Monde ; b) les relations à l'intérieur de l'Occident (sphères anglo-saxonne et continentale) ; c) l'incohérence des Etats-nations européens et de la forme systémique que les Européens ont pensé se donner au cours des soixante dernières années ; d) la fin du cycle historique de la vie de l'économie moderne pour le seul Occident ; e) la tragédie des formes politiques internes des Etats occidentaux.
Toutes ces questions convergent finalement vers la société dans laquelle et dont nous vivons tous.
* * * *
Les sociétés animales, et les sociétés humaines plus que d'autres, doivent être comprises comme des véhicules adaptatifs. Les individus créent et s'adaptent à la société qui les aide à s'adapter au monde. Une civilisation est un méta-système, moins défini qu'une société proprement dite, mais qui a l'avantage de la masse. L'unité méthodologique est ici la société, la société s'adapte et participe à la civilisation qui l'aide à s'adapter au monde.
L'état de crise illustré ci-dessus traverse tous les niveaux, de la civilisation aux sociétés qui la composent, nations individuelles ou groupes plus homogènes, de celles-ci à leur composition interne par strates, classes, fonctions, jusqu'aux individus. Dans une crise d'adaptation, chacun de ces sujets, individuel ou collectif, se trouve dans la situation difficile d'être, en même temps, "contre et avec" quelqu'un d'autre.

On peut s'intéresser avec bienveillance à l'émergence aujourd'hui de nouveaux pouvoirs dans d'autres sphères de la civilisation, ne serait-ce que parce que cela peut déplacer la structure de notre civilisation, ouvrir sur des changements possibles. Mais ces changements doivent nous voir prêts à assumer la redéfinition de notre civilisation, et certainement pas à aspirer naïvement à être changés par d'autres civilisations. Chaque civilisation est étrangère à l'autre. Les civilisations peuvent et doivent dialoguer et échanger des idées, des traits et des caractères, mais elles restent des sujets dont les finalités, les buts et les voies sont entièrement différents et fondamentalement en concurrence les uns avec les autres.
Ainsi, la crise de notre civilisation nous concerne tous intégralement, même si chacun d'entre nous a des points de distinction et de désaccord avec sa forme actuelle. Elle nous affecte en tant que société qui devrait poursuivre son propre intérêt national, mais "contre et avec" d'autres sociétés similaires, ce qui s'applique également à la dialectique entre les classes, les classes et les fonctions au sein de la société individuelle, jusqu'au niveau individuel et dans les attentes entre les intérêts théoriques et pratiques, même à l'intérieur de nous-mêmes.
L'état de crise ontologique de la civilisation occidentale et de chacune de ses composantes internes est certes la crise de ses modes, de ses structures et de ses processus habituels d'organisation, mais c'est aussi la crise de son propre mental. Pour les humains, le mental a été l'arme adaptative principale et par ailleurs très puissante. L'homme présente une particularité cérébro-mentale qui place un espace entre l'intention et l'action, dans cet espace se trouve la simulation des effets de toute action possible, la pensée. La pensée est une action hors ligne, une hypothèse d'action qui n'a pas encore été mise en œuvre et qui attend de devenir un acte, soumis à la stratégie, à la simulation et à l'évaluation. Par cette nouveauté biologique-fonctionnelle, nous avons perdu tous les traits adaptatifs animaux devenus inutiles (fourrure, griffes, canines et mâchoires puissantes, agilité et muscles, etc.), devenant du même coup l'un des animaux les plus fragiles morphologiquement sur le plan individuel autant que les plus puissants opérationnellement sur le plan collectif, en tout cas les plus adaptatifs.
Nous appelons cette dotation mentale générale l'"image du monde" ; les civilisations, les sociétés en groupes ou prises individuellement, les strates (classes et fonctions internes), les individus en sont dotés. En plus d'être dans la situation inconfortable d'être à la fois "contre et avec", nous nous trouvons aujourd'hui avec un esprit en décalage avec notre époque. Notre esprit distille les cinq siècles de la modernité, alors que certaines structures de pensée qui ont une fonction profonde, architecturale et fondatrice remontent à des siècles et des millénaires (aux gréco-romains, au christianisme). Selon le degré d'épochalisme que nous voulons reconnaître dans le passage historique dans lequel nous sommes tombés, nous constaterons également l'inadéquation plus ou moins profonde de larges pans de notre pensée. Nous sommes dans une ère nouvelle avec une mentalité ancienne. À propos de cette prétendue époque, il n'est peut-être pas inutile de rappeler le simple fait que nous avons triplé la taille de la planète en seulement soixante-dix ans, un événement jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité en si peu de temps et qui part déjà de 2,5 milliards d'individus. D'ici 2050, nous aurons quadruplé en raison de transitions démographiques statistiquement inaltérables, quoi que nous décidions de faire au cours des deux prochaines décennies. Tout cela met de plus en plus en évidence les problèmes de compatibilité environnementale de la planète, puisque le monde entier utilise désormais le mode économique moderne (matériaux-énergie-capital-technologie-production-consommation, déchets). Si ce n'est pas une époque, je ne sais pas comment l'appeler autrement.

Ce qui est le plus inquiétant dans cette phase historique, c'est précisément le manque de courage mental. En Occident, les complexes idéologiques se durcissent en de tristes scolasticismes, il n'y a pas de ressort de pensée, dans tous les domaines qui ne sont pas de l'ordre de la mise en œuvre-instrumentale (technique). L'absence de créativité dans notre pensée équivaut à l'impression de vieillesse avancée de nos sociétés à la fin de plus d'un cycle historique.
La pensée occidentale a deux problèmes principaux. Le premier est celui de la forme. Une civilisation, et plus encore sa crise adaptative, est un problème éminemment complexe, c'est-à-dire avec de nombreuses parties, de nombreuses interrelations entre ces parties, des processus non linéaires ou non mécaniques, un système placé dans un contexte turbulent. Qu'il s'agisse de disciplines scientifiques, socio-historiques ou de réflexion, nous avons développé dans la modernité des coupes individuelles, des regards individuels, des méthodologies disciplinaires individuelles. Bien qu'il soit fructueux de décomposer des objets ou des phénomènes afin de réduire leur taille à nos facultés mentales limitées, cela ne revient jamais à la vue complète, n'atteint jamais la "com-préhension", la prise en compte de l'ensemble. Le tout en relation avec son contexte nous échappe systématiquement et avec lui la faculté de pouvoir le manipuler.
Le deuxième problème est que chacune de ces disciplines est encombrée de théories, le plus souvent locales, mais pas seulement. Le paysage théorique est une forêt complexe de liens et de références croisées, tissée dans son propre temps historique, des périodes historiques où notre civilisation était à un point très différent de sa courbe d'adaptation, tout comme le contexte-monde. Dans de nombreuses disciplines essentielles à la compréhension générale, un paradigme mécanique-attemporel régit l'étude et la réflexion sur des choses qui sont pourtant historico-biologiques. Cela fait quatre siècles que notre avidité à fabriquer a conduit au type idéal de machines hydrauliques, de fontaines, d'horloges, le modèle systémique des débuts de l'ère moderne. Puis ce fut le tour de la machine à vapeur, aujourd'hui de l'ordinateur. Mais rien de ce qui fait de nous des êtres humains, bio-sociaux et mentalement conscients n'a à voir avec ces analogies infondées, c'est précisément la logique de la compréhension qui est désaxée. Enfin, ce paysage théorique a sa propre cohérence interne qui, au fil du temps, s'est éloignée de la nature de son objet, produisant un maquis encombrant de problèmes fictifs et déplacés, superposés dans des cadres polémiques alimentés par la compétition idéologique et académique, s'éloignant de plus en plus de la réalité.
Ce qui manque pour évoluer dans l'état de crise à la recherche d'une sortie, ce n'est pas un autre modèle de société avec son interminable liste de "j'aimerais qu'il en soit ainsi" si l'on nous accordait le rôle de "législateur du monde", mais une méthode pour le penser, le discuter et le partager, l'essayer, le faire évoluer avec d'autres. Le plaisir de concevoir des sociétés meilleures nous saisit d'emblée, mais nous n'avons pas la possibilité de ramener ces projets à des faits ou à des tentatives de faits.

En fait, le problème séculaire du pouvoir social est simple. De temps à autre, de petits groupes marqués par une certaine spécialité sociale (anagraphique, sexuelle, militaire, religieuse, ethnique, politique, maintenant économique ou peut-être plus financière), tout en rivalisant les uns avec les autres pour leur part de pouvoir réel, ont été étroitement unis dans la défense du principe structurel selon lequel le Peu domine le Beaucoup en prenant la plupart des avantages adaptatifs de la vie en association. Lors des phases d'abondance relative, le petit nombre a partagé quelques miettes, tandis que lors des phases de restriction, le petit nombre a simplement rejeté toute la contraction sur le grand nombre. C'est ce qui s'est passé au cours des trente dernières années. Pour le plus grand nombre, ce premier principe pratique du pouvoir leur échappe, ils discutent de telle ou telle meilleure forme de société et d'image du monde comme s'ils étaient autorisés à décider de telle ou telle version, alors que le problème est précisément de savoir comment répondre à la question fondamentale "qui décide ? Il ne s'agit pas de savoir "quoi" décider, cela viendra plus tard, il faut d'abord s'interroger sur le sujet, le "qui", et sur la manière, le "comment".
Ce qui semble être une transition adaptative inévitable pour nous, en Occident, a le double caractère du mental et du réel, mais pour construire ce dernier, la voie politique doit être trouvée et partagée dans le premier.
Pour ce qui est du mental, la nouvelle ère historique nous impose de connaître l'ensemble, la "liste douloureuse des problèmes graves" que nous avons évoquée, exige des connaissances géo-historiques, culturelles, environnementales, économiques, sociales, politiques, imbriquées les unes dans les autres, en aval d'une nouvelle définition de l'humain, qui ne sera plus l'animal qui fait, mais l'animal qui pense avant de faire. Il y a un nouveau cours de la connaissance à développer parallèlement à celui qui a été poursuivi jusqu'à présent, un cours intégré, systémique-holistique, qui peut aussi donner de nouvelles conditions de possibilité à la pensée pour dépasser les bourbiers forestiers des enchevêtrements théoriques qui ne sont plus utiles parce qu'ils sont limités et ne correspondent plus à la réalité. Un certain "retour à la réalité" est nécessaire compte tenu des caractéristiques de la transition historique.
En ce qui concerne la réalité sociale, il est évident que les sociétés de la civilisation occidentale, du moins celles qui n'en ont pas été le moteur, à savoir les sociétés anglo-saxonnes, ne peuvent plus être ordonnées par le fait économique. Non pas parce que nous ne l'aimons pas, simplement parce qu'il a épuisé son cycle historique, qu'il ne fonctionne plus et qu'il tendra à fonctionner de moins en moins. Il faut un ordre politique structuré par une théorie forte de la démocratie. Les civilisations, jusqu'à présent, ont été des objets que l'on a considérés après leur formation et leur développement, personne ne les a conçues a posteriori. Si, comme cela semble nécessaire, nous nous trouvons dans la nécessité de changer nos formes de vie associative en profondeur et dans leur imbrication multidimensionnelle, nous ne pouvons que présupposer une participation large et constante d'une masse critique très importante d'associés ; c'est la société tout entière qui doit se transformer.
C'est le statut du politique dans nos sociétés individuelles qui doit être repensé en profondeur, le rôle et les méthodes de l'économique qui doivent être repensés, la forme même de l'Etat-nation européen qui doit être repensée, et les règles de coexistence au sein de l'espace européen qui doivent être entièrement repensées, les relations entre l'Occident européen et l'Occident anglo-saxon (systèmes qui présentent autant de similitudes mutuelles que de profondes divergences géo-historiques) doivent être entièrement revues, toute la posture des relations entre notre Occident et le reste du monde (Asie, Afrique surtout), ainsi qu'avec le monde en tant que planète, doit être repensée. Et tout cela présuppose des changements non moins ambitieux et radicaux dans notre façon de penser, de connaître, de concevoir le monde et la manière dont nous l'habitons.

Le processus d'adaptation à un monde sans précédent, profondément modifié et en mutation, de surcroît avec des échelles de temps accélérées, au niveau de la société-civilisation, semble nous conduire à devoir diluer le pouvoir social dans le plus grand nombre possible de ses composantes afin que le système dont nous faisons partie fasse preuve d'une agilité et d'une préparation coordonnées au changement décidé par la masse critique. Pour changer les fondamentaux, il faut revenir aux fondamentaux de notre pensée politique, à l'éternelle bataille entre le pouvoir du Peu et celui du Beaucoup. Dans le monde du vivant, les systèmes complexes les plus adaptatifs sont auto-organisés. La forme politique du principe d'auto-organisation est la démocratie réelle. Nous manquons d'une théorie forte de la démocratie.
C'est, à mon avis, la tâche la plus urgente pour une pensée qui vise à transformer et à adapter l'action aux temps difficiles que nous avons eu la chance de vivre.
19:01 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, philosophie, crise, civilisation occidentale, occidentalisme, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 mai 2023
La régression narcissique

La régression narcissique
par Salvatore Bravo
Source: https://www.sinistrainrete.info/societa/25507-salvatore-bravo-regressione-narcisistica.html
Introduction au narcissisme
La décadence culturelle, politique et éthique de l'Occident n'est pas inscrite dans les astres et n'est pas un destin, elle est historiquement déterminable, elle a un nom: le capitalisme dans son expression absolue, c'est-à-dire qu'un processus est en cours pour briser toute contrainte éthique et l'émergence de tout katekhon. La liberté des marchandises et de la valeur d'échange est proportionnelle à la liberté des sujets qui servent le marché et permettent au capital de se transformer en substrat qui déforme la nature éthique et solidaire de l'être humain. La vérité de la condition de client-consommateur se révèle dans les gestes quotidiens. Le selfie de l'épouse de Maurizio Costanzo avec un fan lors des funérailles de son mari a suscité de nombreux commentaires et controverses. La mort semble avoir été effacée par le geste du selfie, qui a placé au centre le spectacle de "narcissiques" à la recherche d'un moment de notoriété, tandis que le mystère et la tragédie de la mort ont été dissimulés par l'ego qui a envahi l'espace public, effaçant toute autre présence. Le narcissisme est le symptôme de la pathologie du capitalisme, l'être humain pris au piège de la valeur d'échange développe une forme paroxystique de narcissisme.

Christopher Lasch nous aide à comprendre la généalogie du mal de vivre. Il démystifie le narcissisme auquel est associée l'hypertrophie de l'ego sûr de lui et doté d'une armure impénétrable. Le sociologue américain montre que l'hypertrophie cache le moi minimal réduit à l'exosquelette du logos. Le narcissisme n'est pas affirmation de l'individu, mais négation de la subjectivité. Dans le monde de l'ombre du capital, ce qui apparaît n'est pas la vérité, mais sa trahison.
La nature humaine est éthique et solidaire, le sujet se forme et s'exprime dans la reconnaissance de l'autre, dans la disposition à l'altérité pour revenir à soi et se connaître dans la différence vécue et expérimentée. Le narcissique occupe l'espace public avec ses besoins immédiats, il ne les médiatise pas avec le logos, il est donc dans le piège de l'immaturité égoïque.
Il faut reconstruire la régression de la subjectivité à une simple apparence d'elle-même, à une image déformée par le narcissisme au point de ne pas se reconnaître comme un sujet politique, mais comme un consommateur rapide d'expériences à afficher dans la recherche spasmodique d'une confirmation comme un vélociraptor élevé par le capital qui est à la fois vorace et fragile. La violence prend d'abord racine dans l'obsession de la confirmation, chaque démenti risquant d'anéantir le narcissique qui ne supporte pas les démentis. Les subjectivités réduites à des masques d'elles-mêmes sont le produit létal du mode de production capitaliste, elles sont des coquilles vides dans lesquelles le pouvoir sous forme de domination abstrait la personnalité vivante avec ses potentialités pour plier la subjectivité pour en faire un simple mannequin dominé.

Le logos se retire pour laisser place à une émotivité non réfléchie qui permet la naturalisation du mal quotidien. Même dans une condition aussi tragique, le sujet cherche une issue dans l'abnégation. Le narcissisme est la mauvaise solution encouragée par le capital. Le moi minimal compense le vide par des formes de faux gigantisme. On régresse à un stade minimal, on n'a pas de personnalité et pas d'autonomie, donc les négations trouvent dans le narcissisme l'analgésique à la souffrance du sujet. Le capitalisme pousse à la déformation du logos en bavardage et en simulacre, il transforme le logos en calcul et en tactique pour neutraliser la praxis critique et politique. La misologie est le chiffre du capital, dans la mesure où le logos se concrétise dans l'autonomie du sujet rationnel, de sorte que l'on favorise les formes de dépendance avec lesquelles on nécrose le développement de la subjectivité: à sa place, il n'y a que son simulacre avec son noir désespoir:
"Le progressisme américain, qui a facilement réussi à contrer le radicalisme agraire, le mouvement ouvrier et le mouvement féministe en réalisant des aspects partiels de leur programme, a maintenant presque complètement perdu toute trace de son origine qui remonte au libéralisme du 19ème siècle. Il a répudié la conception libérale, qui présupposait la supériorité de l'intérêt rationnel, et lui a substitué une conception thérapeutique qui admet les impulsions irrationnelles et cherche à les détourner vers des débouchés socialement constructifs. Elle a rejeté le stéréotype de l'homme économique et tenté de soumettre l'"homme total" au contrôle social. Au lieu de réglementer uniquement les conditions de travail, il réglemente désormais également la vie privée, en planifiant les loisirs sur la base de principes scientifiques de prophylaxie personnelle et sociale. Il a exposé les secrets les plus intimes de la psyché à la surveillance de la médecine et a ainsi encouragé l'habitude de l'autosurveillance, qui rappelle vaguement l'introspection religieuse, mais qui est alimentée par l'anxiété plutôt que par la culpabilité - dans un type de personnalité narcissique plutôt que coercitive ou hystérique (1)".

Le narcissisme est le modèle du capitalisme. On exalte et on flatte les narcissiques, on cultive une société d'individus juxtaposés, où personne ne voit l'autre. Mais chacun cherche à occuper l'espace de l'autre dans une compétition qui aliène et réifie son "moi profond" et son "caractère". Chacun est homologué en apparaissant dans une compétition où le plus mauvais gagne "toujours en perdant", parce qu'il s'aliène au logos. Les gagnants du jeu du capital se "perdent" et mettent en œuvre des formes d'aliénation de la vie réelle qui sont les prémisses des guerres et de la violence :
"Notre société est donc narcissique en deux sens. Les individus à la personnalité narcissique, même s'ils ne sont pas nécessairement plus nombreux que par le passé, occupent des positions très importantes dans la vie contemporaine et occupent souvent de hautes fonctions. Tout en se nourrissant de l'adulation des masses, ces célébrités donnent le ton de la vie publique et de la vie privée en même temps, car le mécanisme de la célébrité ne connaît pas de frontières entre le public et le privé. Le beau monde - pour utiliser cette expression significative qui n'inclut pas seulement les globe-trotters millionnaires, mais tous ceux qui, ne serait-ce qu'un instant, apparaissent béatement devant les caméras sous les projecteurs - incarne la vision du succès narcissique, qui consiste en un désir inessentiel d'être immensément admiré, non pas pour ses réalisations, mais uniquement pour soi-même, sans critique et sans réserve. La société capitaliste moderne ne se contente pas d'élever les narcissiques à des postes de prestige, elle suscite et renforce les traits narcissiques chez tout un chacun. Elle réalise ce double effet de plusieurs manières : en exposant le narcissisme sous des formes attrayantes et prestigieuses ; en sapant l'autorité parentale et en entravant ainsi le processus de croissance des enfants ; mais surtout en créant une variété infinie de formes de dépendance bureaucratique. Cette dépendance, de plus en plus répandue dans une société non seulement paternaliste, mais au moins aussi maternaliste, empêche les gens de surmonter les peurs de l'enfance et de profiter des consolations de l'âge adulte (2)".

L'enfer
L'enfer, c'est la dépendance du narcissique aux goûts et aux diktats du monde, c'est son adaptation permanente et sa peur de n'être rien pour le monde, car il se sent comme un "rien" dans une vitrine, prêt à être remplacé par des égaux. L'anxiété se teinte d'angoisse et est repoussée par l'accélération des manifestations narcissiques. Pour en arriver là, le capitalisme a déstabilisé la famille, les institutions éducatives et toutes les instances qui, avec l'autorité, configuraient la possibilité de structurer le caractère en vue de l'autonomie. Après avoir démoli les institutions dans lesquelles le sujet se formait, le marché, avec son appareil, gère les subjectivités, les prend en charge, et des services sont offerts pour chaque problème, même les plus "banals". La médicalisation de la vie est la dernière frontière de la surveillance où coïncident domination et business. L'angoisse insécurise durablement les subjectivités, l'adulte devient, dans ce cadre, semblable à l'enfant, personne n'ose être lui-même, mais tout le monde se tourne vers les spécialistes pour soigner l'incompréhensible mal de vivre. L'ego s'effrite sous les coups de l'addiction, le narcissisme reste la seule échappatoire à une réalité inhumaine et insoutenable :
"Égalitaire et anti-autoritaire en apparence, le capitalisme américain a répudié l'hégémonie de l'église et de la monarchie, pour laisser place à l'hégémonie de l'organisation commerciale, formée par les classes managériales et professionnelles qui dirigent le système des "guildes" et détiennent l'État qui les représente. Une nouvelle classe dirigeante est apparue, composée d'administrateurs, de bureaucrates, de techniciens et de spécialistes, si dépourvue des attributs autrefois associés à la classe dirigeante - position élevée, "aptitude au commandement", mépris pour la classe inférieure - que son existence en tant que classe passe souvent presque inaperçue (3)".

La nuit de l'âme
Le capitalisme prend la forme d'un "grand tentateur" qui, pour pousser à la dépendance, rend le chemin de la formation facile, élimine toutes les difficultés et toutes les ondulations. Le sujet n'a pas à se rencontrer, n'a pas à se mettre à l'épreuve, n'a pas à comprendre le quantum de rationalité et de créativité qui coule en lui. Les solutions sont aussi prêtes à l'emploi que les personnalités produites en série. Tout simplifier est la condition pour décréter la future fragilité du sujet qui, face à toute difficulté, se tournera alors vers l'expert de service. Faire des économies devient la norme et la sécurité du capitalisme. On apprend aux gens à fuir les difficultés, à rechercher des lieux et des conditions où la vie est déjà préemballée avec ses formules. La lutte est remplacée par une fuite incessante. Pour toute éventualité, le sujet doit appliquer les formules toutes faites que le système "donne". Le cheval de Troie entre dans les foyers et les esprits, il a la forme des "conseils" que le système dispense aux personnalités fragiles des sujets qui vivent à l'ombre du capital et de ses prêtres prêts à transformer la fragilité publique en affaires saines :
"L'enseignement supérieur ne se contente pas d'annihiler les dons intellectuels des étudiants, il les inhibe également sur le plan émotionnel, en faisant d'eux des personnes désemparées incapables de faire face à des expériences différentes sans le soutien de manuels et d'opinions toutes faites. Loin de préparer les étudiants à vivre "authentiquement", l'enseignement supérieur dans les universités américaines cultive leur incompétence à accomplir les tâches les plus élémentaires, telles que préparer un repas, participer à une fête ou coucher avec une personne du sexe opposé, à moins qu'ils n'aient reçu une instruction élaborée sur le sujet. La seule chose laissée au hasard est la culture supérieure (4)".
La maîtrise de soi est injectée par la parole des spécialistes et des médias. La personnalité est orpheline d'elle-même, il n'y a pas de logos, pas de pensée, mais seulement une obéissance aveugle : croire, obéir et succomber. Dans cette souffrance quotidienne, les clients-consommateurs ne sont que des "non-nés" ; il ne leur reste que le narcissisme avec lequel ils prétendent posséder une personnalité ouverte sur l'extérieur et vide de monde. Le culte du corps devient une adoration du ça qui émousse la frustration normale de l'existence avec ses plaisirs et ses mythes. Le sujet ne ressent "rien" pour "se sentir exister", il se livre à des formes irrationnelles de narcissisme :
"Selon Henry et d'autres observateurs de la culture américaine, l'effondrement de l'autorité parentale correspond à l'effondrement des "anciens freins inhibiteurs" et au passage "d'une société dominée par les valeurs du surmoi (les valeurs du contrôle de soi) à une société envahie par une exaltation croissante des valeurs du ça (les valeurs de l'auto-condamnation) (5)".

Le narcissisme révèle "la nuit de l'âme" de l'Occident. L'omnipotence fragile n'est pas seulement l'occupation de l'espace public par une subjectivité bruyante et vide, c'est aussi la domination sur la nature, c'est la soif de pouvoir. L'agitation avec laquelle la technologie cherche à triompher de la nature est une preuve supplémentaire du déficit de sens collectif dans l'âme de l'Occident. L'expansion spatiale est une fuite de la temporalité de la conscience. En l'absence de médiation rationnelle, il n'y a que dépendance et violence de l'affirmation égoïste, où le sujet s'effondre dans la nuit de l'âme. L'analyse de Christopher Lasch ne laisse aucun doute, face à la progression violente du mal qui enveloppe la nature et les communautés, nous devons travailler à l'alternative, l'effondrement du système pouvant être brutal. "Socialisme ou barbarie", nous sommes à la croisée des chemins, chacun de nous est appelé à choisir, les mots de Rosa Luxemburg résonnent en nous et à notre époque, car le mensonge libéral est dévoilé dans sa vérité et nous devons y réfléchir pour éviter la "barbarie anthropologique et écologique" qui ne cesse de s'approcher :
"Il n'y a pas d'alternative au marché libre pour organiser l'économie. La diffusion de l'économie de marché conduira progressivement à la démocratie multipartite, parce que ceux qui ont la liberté de choix en économie ont tendance à insister pour avoir aussi la liberté de choix en politique (6)".
A la propagande du mainstream, il faut opposer des espaces de réflexion et de communauté, pour préparer l'alternative de la participation corpusculaire qui peut devenir progressivement l'usage public de la raison politique qui peut nous sauver de la barbarie qui est déjà parmi nous.
Notes:
1 Christopher Lasch, La culture du narcissisme, Bompiani, Milan, 1992, p. 251.
2 Ibid p. 258-259
3 Ibidem p. 245
4 Ibidem p. 172
5 Ibidem p. 196
6 The Economist, 31 décembre 1991, p.12.
18:23 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : narcissisme, philosophie, christopher lasch |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
De Lafargue à Evola

De Lafargue à Evola
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2023/05/19/fran-lafargue-till-evola/
Au fil des ans, Hegel, Nietzsche et Heidegger, parfois même Jünger, Schmitt et Dumézil, ont fait l'objet d'un intérêt considérable de la part de la gauche, intérêt qui n'est pas rare et qui vise à les réinterpréter en tant que penseurs de gauche. Julius Evola s'est montré assez réfractaire à de tels projets, ce qui n'est pas surprenant étant donné que son œuvre est un ensemble cohérent difficile à déconstruire et qu'il a critiqué à la fois le fascisme et le national-socialisme du point de vue de la droite, tout en leur accordant un soutien conditionnel. Cela signifie, par exemple, qu'un livre comme Evola vu de gauche a été écrit par des messieurs qui ne peuvent être classés qu'avec bonne volonté comme étant de gauche.

En même temps, il est intéressant de lire Evola avec un regard "de gauche". Outre l'affinité entre un certain anarchisme et l'État organique traditionnel, fondé sur des relations personnelles de fidélité, qu'Evola décrit, il existe des similitudes avec les idées de Marcuse sur l'"homme unidimensionnel". L'anthropologie traditionnelle d'Evola fournit un appareil conceptuel et une précision qui rendent son terme, fréquemment utilisé, de "promiscuité" approprié pour décrire l'œuvre plus confuse de Marcuse. Marcuse, lui aussi, est unidimensionnel pour le traditionaliste, et infantile et naïf dans sa vision du potentiel de la perversion polymorphe.
Dans ce contexte, Paul Lafargue, gendre de Karl Marx et surtout connu comme l'auteur de la critique du travail Le droit à la paresse, est intéressant. Lafargue s'est largement inspiré du mépris pour le travail salarié et les marchands exprimé par des penseurs antiques tels que Cicéron: "celui qui donne son travail pour de l'argent se vend lui-même et se met au rang des esclaves". Il est intéressant de noter qu'il qualifie également les tribus germaniques de "communistes" et parle des "Germains des tribus communistes qui ont envahi l'empire romain".
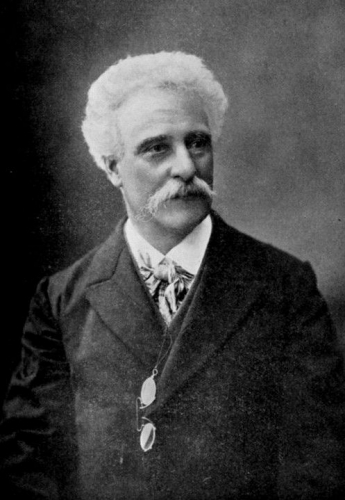

D'ailleurs, Lafargue mentionne également les intellectuels, d'une manière qui anticipe la situation actuelle. Pour Lafargue, le problème était leur manque d'engagement en faveur du socialisme; aujourd'hui, c'est le glissement à gauche du monde universitaire qu'il faut expliquer. Dans les deux cas, le fond du problème, le rapport au pouvoir, est caché derrière des artifices de toutes sortes. Lafargue écrivait ici que "depuis 1789, les gouvernements les plus divers et les plus opposés se sont succédé en France; et toujours, sans hésiter, les intellectuels se sont empressés d'offrir leurs services dévoués", il notait que "ce n'est pas dans le cercle des intellectuels, dégradés par des siècles d'oppression capitaliste, qu'il faut chercher des exemples de courage civique et de dignité morale. Ils n'ont même pas le sens de la conscience de leur "classe professionnelle" et compare les écrivains et les artistes à des bouffons, "les intellectuels de l'art et de la littérature, comme les bouffons des anciennes cours féodales, sont les amuseurs de la classe qui les paie". Souvent amusant à lire, Lafargue écrit à propos des intellectuels que "ce sont de véritables imbéciles - si l'on redonne à ce mot son sens latin originel d'inapte à la guerre". En même temps, il identifie en partie le désintérêt pour la menace systémique du socialisme dans leur éducation, "ils pensent que leur éducation leur confère un privilège social, qu'elle leur permettra de se débrouiller seuls dans le monde... ils s'imaginent que leur pauvreté est transitoire".
En passant, on peut également noter que Lafargue a utilisé les perspectives de la dégénérescence et de la décadence dans sa critique du capitalisme; l'élite capitaliste était à la fois dégénérée et débauchée, l'élite romaine ayant même des tendances à la pédérastie ("luxe sans bornes, épices indigestes et débauches syphilitiques"). Nonobstant ses propres origines familiales partiellement juives, il pouvait également écrire, à propos de la nouvelle respectabilité du capitalisme prêteur, que "les chrétiens sont devenus des juifs" et désigner les Rothschild comme des ennemis, ce qui nous rappelle certains aspects aujourd'hui minimisés de l'histoire du socialisme.
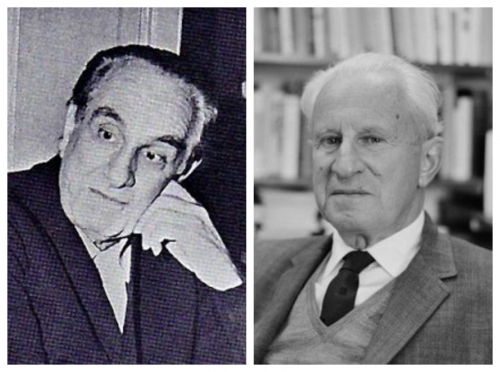
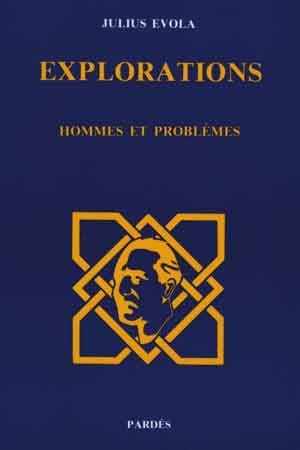
En même temps, on retrouve entre Lafargue et Evola la même distance conceptuelle qu'entre Marcuse et Evola. Lafargue s'est retourné contre le travail, en partie sur la base d'un ancien idéal d'humanité. Les hommes libres se consacrent à la guerre, à la politique et à la philosophie. En revanche, Evola dispose d'un appareil conceptuel beaucoup plus développé; dans Explorations, il établit une distinction entre le travail, l'otium et l'opus. Ceci, combiné aux différents niveaux de réalité qui traversent l'œuvre d'Evola, tels que l'initiation, la métaphysique de la guerre et la transcendance, donne accès à des distinctions qui manquaient à Lafargue. En même temps, Lafargue était généralement plus proche de l'otium et de l'opus que de la consommation passive comme alternative au travail salarié, ce qui peut être considéré comme positif. Il s'identifiait davantage au guerrier et au citoyen qu'au consommateur, mais il ne disposait pas des concepts et des perspectives d'Evola, ce qui rend son alternative plus superficielle et plus unidimensionnelle. Cela suggère qu'une lecture d'Evola à partir de la gauche tend à aboutir à la droite.
18:04 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul lafargue, julius evola, philosophie, socialisme, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 mai 2023
Le néolibéralisme expropriateur de la mort et de la vie

Le néolibéralisme expropriateur de la mort et de la vie
par Elisabetta Teghil
Source: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/25409-elisabetta-teghil-il-neoliberismo-espropriativo-della-morte-e-della-vita.html
Là se révèle un système de classes si parfaitement en place qu'il est resté longtemps invisible.
Colette Guillaumin.
On parle beaucoup de la GPA, la soi-disant grossesse pour autrui, comme s'il s'agissait d'une question à part entière, abordée sous l'angle de la morale, de l'éthique, de la religion, du politiquement correct, ou de l'exploitation de classe et du néocolonialisme... il y a ceux qui luttent farouchement pour la famille traditionnelle et ceux qui luttent pour les familles arc-en-ciel, ceux qui évoquent le caractère sacré de la maternité, ceux qui veulent l'aborder d'un point de vue juridique et créer des législations ad hoc pour protéger la femme qui porte la grossesse et/ou les droits de l'enfant à naître et/ou pour définir des contrats qui protègent ceux que l'on appelle les parties...
Mais on oublie toujours que la question est politique et qu'elle doit être abordée en tant que telle, et qu'il faut donc revenir quelques années en arrière.
Le système de pouvoir s'est depuis longtemps approprié la mort avec ce qu'on appelle la mort cérébrale, une mort déclarée par l'État, par la loi.
Le concept de mort cérébrale a été introduit dans le monde scientifique en même temps que les premières transplantations d'organes de l'histoire de la médecine. Il est clairement déguisé en scénario par d'excellentes motivations, pour sauver des vies, pour le bien commun. La plupart des organes ne pouvant être prélevés sur des cadavres, les critères en vigueur de constatation de la mort ne permettaient pas ce type d'intervention. L'introduction du concept de mort cérébrale a donné une légitimité scientifique à la réalisation des transplantations.
Dans la législation italienne, la question est réglée par la loi n°578 du 29 décembre 1993 (règles pour la constatation et la certification de la mort), le décret n°582 du 22 août 1994 du ministère de la santé (règlement contenant les procédures de constatation et de certification de la mort) et le décret du 11 avril 2008 (G.U. n°136 du 12/06/2008, "Mise à jour du décret n°582 du 22 août 1994").

Face à ce coup d'État du pouvoir en place, presque tout le monde s'est tu, voire a participé, y compris la gauche de classe, laissant un espace d'opposition à la droite réactionnaire, bigote et fondamentaliste, qui a commencé à pontifier sur la question de savoir si l'être humain en état de soi-disant mort cérébrale est à moitié mort ou à moitié vivant, plus mort que vivant ou plus vivant que mort. Les psychologues ont commencé à étudier si le transfert du cœur d'une personne à une autre pouvait avoir des effets négatifs sur l'équilibre psychique, et les militants de gauche ont commencé à dénoncer le commerce d'organes, qui proviennent justement des pays pauvres. Aujourd'hui, l'État envisage également d'introduire la déclaration de mort prématurée en cas d'arrêt cardiaque. Toujours par la loi.
De cette approche découle le mépris, la revendication de délégation, l'arrogance de l'État à l'égard de la mort des êtres humains, conduisant à la condition d'appropriation totale qui s'est manifestée à l'époque de ce que l'on appelle la pandémie.
Car le problème était et reste strictement politique. La mort se constate, elle ne se décrète pas. Vous ne pouvez pas mettre le pouvoir de décréter la mort entre les mains de l'État, car il s'agit d'un système basé sur le profit, l'oppression et l'exploitation.
La société civile débat actuellement du suicide assisté (avec lequel je suis également d'accord), mais je pense que nous devrions réfléchir attentivement avant d'ouvrir cette nouvelle possibilité pour l'État de faire main basse sur la mort. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra au système de pouvoir pour convaincre les personnes âgées qu'il vaut mieux se suicider dans des conditions de sécurité que de vivre une vie pleine de maux et d'inconnus ? Ou pour convaincre les membres de la famille que leurs proches ont fait leur temps à un moment ou à un autre ? Moins de pensions, moins de soins de santé... n'est-ce pas Christine Lagarde qui a dit que nous sommes trop nombreux ? Nous sommes trop nombreux, eux, ils ne le sont pas....

Et maintenant, parlons de la vie. Parlons du travail reproductif. Le féminisme a depuis longtemps mis en évidence que le travail reproductif est un vrai travail, extorqué gratuitement par le patriarcat, une structure socio-économique que le capitalisme a toujours utilisée à tour de bras et avec laquelle il entretient des rapports privilégiés. D'autre part, le patriarcat n'est rien d'autre qu'un modèle économique fondé sur la division hiérarchique et la spécialisation des rôles sexuels en vue d'une performance optimale des individus mis au travail.
Dans la société du capital, le corps des femmes est une marchandise, toutes les relations hommes-femmes sont marquées par un échange économico-sexuel, comme nous le dit Paola Tabet, toutes les relations avec le système de pouvoir sont des relations d'exploitation, alors pourquoi s'étonner de la GPA ? La grossesse pour autrui est une exploitation plus qu'évidente du genre et de la classe, ce sont et ce seront les femmes pauvres qui vendront leur capacité reproductive de cette manière. Une transformation des relations reproductives est en cours, de l'appropriation privée par un seul homme de la capacité reproductive d'une femme sous la forme du mariage, à l'appropriation sociale collective par la prise en charge du travail reproductif par la femme seule ou la mise en vente du travail reproductif de la femme en tant que "travailleur salarié", bien que pour une période définie, sans que l'État ne prenne en charge les services de soutien. D'une pierre deux coups.
La question concerne plutôt les subjectivités qui savent ce qu'est le stigmate social, qui savent ce que cela signifie d'en avoir fait l'expérience sur leur peau, qui savent ce que cela signifie d'être exploitées et/ou condamnées et/ou stigmatisées, et qui entreprennent d'acheter et d'exploiter le corps des femmes à leur tour, ou qui s'appuient sur des structures biotechnologiques pour les médicaliser et en faire des instruments vivants d'expérimentation.
Ce moment de transition est plein de contradictions au sein même du patriarcat. D'une part, les femmes ont explicité leur poids et leur présence sociale au fil d'années de lutte, d'autre part, le patriarcat a obtenu un résultat optimal, celui d'accabler les femmes de tâches reproductives et salariales et de les impliquer dans les fortunes du pouvoir.

Les questions à poser sont donc : qui bénéficie de cette transformation, qui en supporte le fardeau, quel est le but ultime du système de pouvoir ?
Pour répondre à ces questions, nous avons, avec nos camarades de la coordinamenta, étudié le baliatico (= le salaire de la nourrice). Jusqu'aux années 1950, les paysannes pauvres acceptaient le travail de nourrice dans les maisons des riches parce que c'était le seul moyen d'apporter de l'argent à la famille. C'est la famille qui les poussait. Elles laissaient leur enfant nouvellement né à la maison pour allaiter l'enfant d'une autre. Souvent, leur enfant mourait parce qu'il avait été sevré très tôt et allaité avec du lait de vache dilué. En même temps, elles faisaient partie d'un monde qu'elles ne connaissaient pas, dans lequel elles étaient bien traitées, dans l'intérêt évident de leurs employeurs, les coraux et les grenats étaient les bijoux des nourrices, elles apprenaient souvent à lire et à écrire et ne retournaient pas dans leur famille d'origine, elles restaient des "nourrices sèches".
Quand le phénomène des nourrices a-t-il pris fin ? Lorsque dans les années 50, avec le boom économique, les paysannes pauvres ont préféré aller travailler dans les usines. L'Eglise a toujours fermement condamné la condition de la nourrice comme un problème moral, mais il est toujours nécessaire de s'éloigner des discours moralisateurs et stigmatisants et de se demander pourquoi les choses se passent ainsi. Qui sommes-nous pour décider de ce qui est bon ou mauvais pour une femme qui décide de vendre sa capacité de procréation en faisant, entre autres, un travail lourd, prenant et dangereux ? Personne ne peut donc rien interdire à personne, mais il est nécessaire de comprendre les raisons pour lesquelles ce système de pouvoir pousse à cette modalité et plus encore.
La question doit nécessairement être abordée de manière matérialiste, dialectique et essentiellement politique.
Le néolibéralisme veut nous convaincre que les prodiges de la science et de la recherche peuvent répondre aux désirs des femmes, et avec elles de tous les êtres humains, qu'elles peuvent être libérées des difficultés de la grossesse et de l'accouchement, et que même celles qui ne peuvent pas enfanter peuvent avoir des enfants, que tout est permis mais surtout simple et gratifiant pour tous, pour ceux qui donnent et pour ceux qui reçoivent : insémination artificielle, banques de sperme et d'ovules, expérimentation génétique, modification de l'ADN, GPA ... tout cela avec de nobles principes et à des fins meilleures comme le disait Totò, tout cela déguisé en bien pour l'humanité alors que le but inavouable mais en même temps très manifeste est de s'approprier la capacité de fabriquer des êtres humains pour les utiliser, les consommer et les adapter aux désirs du pouvoir. C'est la ligne de tendance du capitalisme néolibéral avec une autre ligne de tendance extrêmement marquée qui est celle de la guerre, des lignes qui marchent entrelacées parce que les expériences sur les corps qui sont menées par l'industrie de la guerre visent à construire des sujets résistants à la guerre biologique, aux transformations environnementales de plus en plus dévastatrices, à produire un être humain sur mesure pour le capital qui peut être utilisé et mis au rebut après avoir rempli la fonction qui lui a été assignée.
Le véritable objectif est de construire la grossesse dans une éprouvette et de la poursuivre dans un incubateur après avoir modifié les caractéristiques de l'ADN jugées négatives et/ou dangereuses. Il est clair que le public sera convaincu que les nouveaux bébés seront sains, parfaits et intelligents, alors qu'en réalité le but est d'avoir des êtres humains obéissants, volontaires et heureux dans leur servitude. Ce n'est pas si difficile, ils en font déjà l'expérience. Le jour n'est pas loin où, si l'on fera des enfants comme autrefois (je m'abstiens d'utiliser le terme naturel car il est extrêmement trompeur et ouvre la porte à des approches dangereusement moralisatrices; ce qui est naturel en ce monde n'est rien, pas même la nature), deviendra un crime parce que les enfants peuvent naître défectueux et ceux qui le font seront alors blâmés et stigmatisés sous les acclamations générales. Ce n'est pas très difficile à croire vu ce qui s'est passé pendant la période pandémique. Ou l'avons-nous oublié ? La pensée de l'ennemi est fortement introjectée.

Il est vraiment paradoxal qu'en tant que féministe qui a vécu les années 70, qui a crié sur les places que les femmes donnent naissance à des idées, pas à des enfants, qui a toujours pensé que le travail reproductif était délétère pour une femme parce qu'il était extorqué, gratuit, un don de temps et de vie au patriarcat totalement injustifié, je sois obligée de me battre contre le vol de la maternité que l'on veut nous imposer. Car c'est une chose de refuser le travail reproductif, c'en est une autre de se voir arracher la possibilité de procréer.
Les développements de cette tendance sont imprévisibles, et bien que la prétention du capital à s'approprier les mécanismes de la vie et de la mort ne soit que trop claire, aucun d'entre nous ne dispose d'une boule de cristal. Il y a un positionnement qui peut nous aider. Le capital a occupé tous les interstices de nos vies et exerce à tout moment une hégémonie culturelle très forte et omniprésente, de sorte que nous disposons, au moins, d'un critère pour nous réguler: être contre et rejeter tout ce que le capital propose comme bon, utile, moderne, conforme à l'époque et aux désirs, que ce soit pour nous faire réussir ou pour sauver la planète, pour améliorer les communications ou pour nous maintenir en bonne santé, pour abolir l'argent liquide ou pour sauver nos démocraties... la réponse est NON ! Et il ne faut pas exiger des lois, il ne faut pas mettre plus d'instruments de répression dans les mains de l'ennemi, il faut de la clarté politique.
14:12 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, néolibéralisme, féminisme, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 14 mai 2023
Maladie en phase terminale

Maladie en phase terminale
par Andrea Zhok
Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-malattia-terminale
L'exclusion du physicien Carlo Rovelli de la cérémonie d'ouverture de la Foire du livre de Francfort, à laquelle il avait été invité, fait des vagues. La faute de Rovelli est d'avoir contesté, de manière certes argumentée, les choix du gouvernement concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Figurant jusqu'à hier parmi les "accrédités" du système médiatique, Rovelli a même fait sourciller la bourgeoisie semi-cultivée, les lecteurs des journaux Corriere et Repubblica et la faune apparentée. Malheureusement, ce segment influent de la population ignore complètement la gravité de ce qui se produit depuis un certain temps, comme une tendance souterraine, continue et capillaire.
Il y a une ligne rouge continue qui s'effiloche dans la gestion de l'opinion publique occidentale depuis des années et qui s'est accélérée depuis 2020. C'est une ligne qui n'est parfois visible qu'en surface, comme dans la persécution d'Assange (ou de Manning, ou de Snowden, etc.) jusqu'à des censures mineures, comme celle qui fait aujourd'hui la une de l'actualité. La signification profonde de ce mouvement souterrain est très claire: la recherche de la vérité et la gestion du discours public en Occident sont désormais des options incompatibles.
Rovelli est accusé d'une chose impardonnable, à savoir d'avoir trahi son appartenance au cercle de ceux qui sont honorés par les élites du pouvoir, en les mettant dans l'embarras. Cela ne peut et ne doit pas se produire. Aujourd'hui, le discours public oscille entre deux pôles, d'un côté la polémique inoffensive et auto-extinguible sur l'ours ou le ragondin du jour, de l'autre la fourniture de munitions à la ligne dictée par le patron, c'est-à-dire par la chaîne de commandement dirigée par les Américains, derrière le char - de moins en moins triomphant - auquel nous sommes attachés.
Pour les vérités dévoilées, celles qui sont les plus lourdes et les plus dangereuses, l'ordre de détruire est en vigueur, comme le montre le cas d'Assange dont la vie a été annihilée pour servir d'exemple et d'avertissement à tout autre sujet éventuellement enclin à la paranoïa. Pour les insubordinations mineures (Rovelli, Orsini, etc.), il suffit de tomber en disgrâce auprès des courtisans, ce qui se répercute en censure, en chantage silencieux et mesquin, puis en discrédit, en blocage de carrière, etc.

Tout cela est condensé en une leçon fondamentale, une leçon implicite que tout notre système de formatage des esprits, journaux, télévision, écoles, universités, etc. met en œuvre consciemment ou inconsciemment: "Tout ce qui est discours public est essentiellement faux."
C'est la leçon que les jeunes reçoivent très tôt et dont ils tirent toutes les conséquences en termes de désengagement et d'aboulie. Cette leçon n'échappe que partiellement à une partie de la population moins jeune, chez qui l'illusion des aspirations passées ("participation", "démocratie", etc.) est encore vivace.
La "réalité" dans laquelle nous baignons fonctionne cependant selon le syllogisme infaillible suivant :
1) Tout ce que nous avons en commun en tant que citoyens, en tant que demos, c'est le discours public alimenté par les médias ;
2) Mais ce discours public est désormais purement et simplement faux (ou carrément faux, ou composé de fragments de vérité bien choisis, fonctionnels pour créer un effet émotionnel désiré);
3) Par conséquent, il n'y a plus de démos possible, plus de discours public possible, et donc plus de levier pour une action collective visant à changer quoi que ce soit. Mettez vos cœurs en veilleuse, sauvez ce que vous pouvez.
Dans ce cadre, d'ailleurs, se détache avec intérêt l'attitude des super-diffuseurs de mensonges certifiés, des pontes-gourous de l'information et du pouvoir, très actifs dans la dénonciation de toute hétérodoxie malvenue, posée comme "fake news". Nous sommes donc confrontés à un spectacle à la fois comique et répugnant où les commandants des cuirassés de l'information appellent au naufrage péremptoire des canots sociaux qui ne bénissent pas assez l'altruisme de Big Pharma, qui ne sont pas tendres avec Poutine, qui ne respectent pas le dernier catéchisme politiquement correct, et ainsi de suite.

Nous vivons dans un monde où le mensonge instrumental est désormais la forme dominante du reportage d'intérêt public.
Il y a ceux qui y réagissent par un simple désengagement résigné, ceux qui s'enferment anxieusement dans leur chambre comme des hikikomori, ceux qui cherchent des paradis artificiels dans les pilules, ceux qui acceptent le jeu en essayant de l'utiliser pour un gain à court terme (parce qu'il n'y a pas d'autre horizon disponible); il y a ceux qui tombent dans la dépression ; il y a ceux qui deviennent fous; il y a ceux qui, de temps en temps, cassent tout pour revenir se cogner la tête contre le mur de leur cellule; et il y a ceux qui développent cette forme particulière de folie qui consiste à se battre sans armes contre des géants en espérant qu'ils se révèlent être des moulins à vent.
Au fond coule le courant de l'histoire où notre navire occidental a pris une position inclinée et, avec une inertie irréversible, accélère vers la chute d'eau. Une fois que la parole publique a perdu sa capacité à transmettre la vérité, il est impossible de lui rendre son poids. Chaque parole supplémentaire dépensée pour corriger les faussetés du passé, si elle atteint la sphère publique, est elle-même perçue comme faible, usée, impuissante.
La société que nous avons mise en place est une société sans vérité, et retirer la vérité du monde social, c'est le condamner à une maladie mortelle.
Combien de temps dureront les grincements, combien de temps faudra-t-il encore pour que tombent les plâtres, combien de temps faudra-t-il encore pour que s'infiltrent les eaux, combien de temps dureront les espaces de vie de plus en plus réduits, cela n'est pas facile à prévoir, mais un monde sans vérité est un monde sans logos, et il ne peut aboutir qu'à cette dimension où les mots sont superflus parce que la violence et la mort ont pris leur place.
18:37 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zhok, philosophie, médias, censure, répression, post-vérité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 mai 2023
Contre la postmodernité libérale

Contre la postmodernité libérale
Rahim Volkov
Source: https://katehon.com/en/article/against-liberal-post-modernity
Antonio Gramsci a dit un jour que personne ne pouvait rester indifférent indéfiniment et qu'il fallait un jour choisir son camp et la bonne voie. Ainsi, ce qui différencie les eurasistes des post-modernistes occidentaux tels que Jordan Peterson, c'est que nous considérons la post-modernité comme une rupture totale avec la modernité qui a fomenté le chaos à tous les niveaux de la société. Pour les post-modernistes occidentaux, la post-modernité exige la réappropriation des valeurs libérales perdues que sont la liberté, l'égalité, l'individualisme et les libertés. Cependant, dans notre cas, nous pensons que l'ère post-moderne est un chaos complet et que ce chaos ne peut être surmonté qu'en faisant appel aux traditions perdues de l'antiquité telles que le mysticisme, la spiritualité et en faisant appel à l'âge classique qui représente les beaux jours de la civilisation humaine.
Avec la naissance de l'hyper-matérialisme et de l'hyper-consommation, l'essence même de l'individu a été dépassée: d'une entité naturelle, il est devenu une agence artificielle avec un détachement complet du monde naturel. À notre avis, la réévaluation des valeurs libérales (au sens nietzschéen) ne peut même pas influencer le chaos post-moderne en cours. Deux raisons majeures justifient notre position sur le sujet. Premièrement, pour comprendre le chaos actuel, fomenté par la post-modernité, nous devons examiner de près la condition post-moderne de l'humanité dans son ensemble. La condition post-moderne se réfère à une situation dans laquelle le domaine humain a complètement perdu son essence naturelle - une dégénérescence gonflée de l'être en un soi artificiellement construit. L'identité même de l'"être", qui a été au cœur de toutes les civilisations de l'histoire de l'humanité, a perdu son sens authentique.
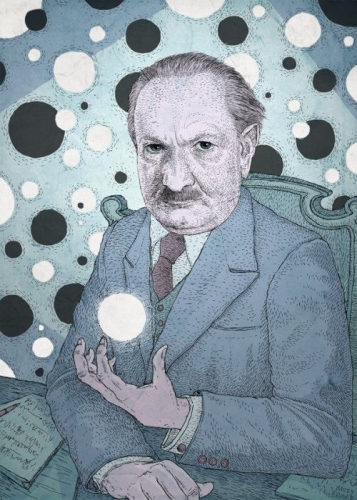
En outre, l'inauthenticité a déjà pris le dessus sur les fondements naturels des strates humaines, tant dans la sphère sociale que dans la sphère personnelle. Dans la perspective heideggérienne, Das Nicht (le néant) domine chaque couche du domaine humain en provoquant la crise de l'être dans les conditions libérales néo-kantiennes. Deuxièmement, le progrès hypertrophié des technologies perturbatrices à l'échelle mondiale entrave les traditions sacrées des "êtres humains". Les traditions sacrées font ici référence au processus naturel qui a aidé et propulsé le développement de la civilisation humaine au cours des siècles. Dans ce processus naturel, l'être humain est resté au cœur de chaque progrès et de chaque développement en jouant le rôle d'agence sociopolitique. Le langage principalement utilisé par les post-modernistes libéraux comporte des éléments de simulation de type matriciel qui promeuvent les insignes illusoires du progrès collectif du monde humain.
Néanmoins, dans chaque langue, ce sont les couleurs verbales, la syntaxe et la psychologie utilisées qui comptent le plus. Ainsi, dans la plupart des écrits des penseurs libéraux postmodernes tels que Jordan Peterson et Jürgen Habermas, l'utilisation de ces derniers modèles de langage concernant la réaffirmation libérale semble très fréquente. Cependant, le récent processus technologique basé sur l'intelligence artificielle et les algorithmes modifie progressivement l'agence de ce long processus historique en mettant au centre le robotisme et l'automatisme basés sur l'intelligence artificielle. À cet égard, les conditions post-modernes font référence au grand déplacement de l'homme du cœur du progrès et du développement qui se produit autour du domaine humain avec un isolement et une singularité complets. Le développement technologique basé sur l'intelligence artificielle a réduit le rôle des êtres humains à celui de "cobayes" en les poussant vers la périphérie de l'ensemble du développement. À cet égard, le problème des post-modernistes libéraux est qu'ils sont les sympathisants des conséquences post-modernes en agissant comme des apologistes. Les post-modernistes libéraux comprennent clairement l'ère du chaos mais, en même temps, ils sympathisent avec le progrès des technologies perturbatrices.
Ils pensent que l'ancien ordre moribond peut être ressuscité en limitant la portée des technologies perturbatrices au domaine humain, ce qui relève effectivement de l'imagination spéculative. Malheureusement, ce qu'ils ne comprennent pas vraiment, c'est que les conditions postmodernes sont une bataille entre la conscience et l'imagination, entre l'être et le soi, entre l'existence et la vie artificielle. La condition post-moderne a coincé le domaine humain entre l'hyper-matérialisme et le consumérisme fétichiste, ce qui est comme de la boue entre les deux briques d'un bâtiment détruit.
19:25 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : postmodernité, libéralisme, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 12 mai 2023
Hobbes contre Kant

Hobbes contre Kant
Michael Kumpmann
Source: https://www.geopolitika.ru/de/article/hobbes-gegen-kant?fbclid=IwAR1obEen81-Fv-341_R93YusAzjAhZD9grGVtmncefv2Ow3zAkyo3cNMWzc
Les articles de Douguine "Chaos et principe d'égalitarisme" et "Une brève histoire du chaos : de la Grèce antique à la postmodernité" contiennent quelques idées intéressantes qui méritent d'être approfondies. En particulier, la séparation qu'il opère entre Hobbes, d'une part, et Locke d'autre part, et son explication de l'égalitarisme comme principe corrosif m'ont laissé une impression mémorable. Ces deux aspects permettent de mieux comprendre les différences au sein de la pensée libérale et la genèse du libéralisme de gauche moderne.
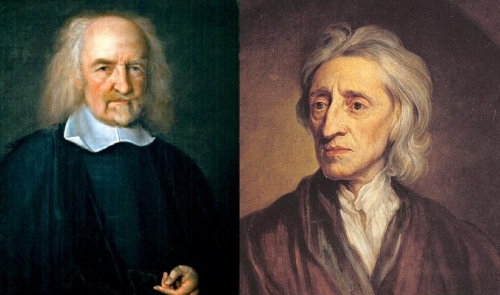
Dans la dichotomie établie par Douguine entre Hobbes et Locke, quatre aspects importants doivent être mentionnés. Premièrement, Locke est bien sûr l'un de ceux qui ont fait le plus pour populariser la forme moderne de l'idée que l'esprit humain est une "tabula rasa" [1]. Cela a conduit à la fameuse idée de "construction sociale" et donc à l'actuelle faction du gendérisme et à d'autres expressions problématiques du postmodernisme.
Dans le même temps, l'idée de Locke a conduit au behaviorisme en psychologie. Alors que la psychologie européenne [2], avec Freud et Konrad Lorenz, avait supposé qu'il existait des instincts primaires qui pouvaient entrer en conflit avec les règles sociales et que l'individu devait trouver un compromis entre l'instinct et la culture (ce qui aboutissait généralement à orienter les instincts dans des directions socialement acceptables. Par exemple, "fonder un mariage et une famille au lieu de traîner une personne étrangère dans les buissons" [3]), le behaviorisme part du principe qu'il n'y a pas de nature humaine et que l'homme peut être "programmé" à volonté dans le sens voulu d'objectifs politiques.
 Le psychologue B.F. Skinner a par exemple écrit l'utopie "Futurum 2"/"Walden Two", qui représente un État communiste fonctionnant sur la base d'un lavage de cerveau des citoyens du berceau à la tombe [4]. La dystopie d'Aldous Huxley "Le Meilleur des mondes" décrit les mêmes principes que le livre de Skinner, mais ici au service d'une société consumériste dirigée par une entreprise géante [5].
Le psychologue B.F. Skinner a par exemple écrit l'utopie "Futurum 2"/"Walden Two", qui représente un État communiste fonctionnant sur la base d'un lavage de cerveau des citoyens du berceau à la tombe [4]. La dystopie d'Aldous Huxley "Le Meilleur des mondes" décrit les mêmes principes que le livre de Skinner, mais ici au service d'une société consumériste dirigée par une entreprise géante [5].
Le deuxième point de la théorie de la tabula rasa est bien sûr que si tout est appris et que rien n'est naturel, alors tous les besoins fondamentaux de l'homme, dont la non-satisfaction n'entraîne pas la mort directe, sont automatiquement à disposition. Cette théorie s'inscrit donc dans le concept de "vie nue" d'Agamben (Voir la politique des confinements). La résistance à la politique actuelle devient ainsi un comportement problématique pouvant être corrigé. En théorie, on pourrait même rééduquer les citoyens pour qu'ils soient heureux même dans une situation horrible [6]. De là à dire que "You will own nothing and you will be happy" de Klaus Schwab, il n'y a qu'un pas.
Le troisième point soulevé par Douguine est que les libéraux classiques ont eu tendance à accepter le réalisme géopolitique (et certains ont encore tendance à le faire, voir Ron Paul). On est également indifférent à l'État voisin tant qu'il ne nous attaque pas. Les États-Unis étaient très isolationnistes avant la Première Guerre mondiale. La rééducation coloniale dans d'autres pays était nettement moins pratiquée que ne le faisaient les Britanniques et d'autres puissances (voir le Japon et son ouverture par Matthew Perry). Les libéraux de l'Empire allemand n'ont pas non plus nié l'existence ou la légitimité des pays voisins en raison de leur structure (le 2ème Reich s'est par exemple bien mieux entendu avec la Turquie illibérale qu'avec la France libérale). Le principe de non-agression, cher aux libertaires, est très proche de ce réalisme dans sa définition et les anarcho-capitalistes rêvent d'un système dans lequel, en théorie, une cité religieuse peut coexister avec un havre d'hédonisme, une cité industrielle, une commune de gauche, etc.
Et Douguine a raison d'insinuer que cela va à l'encontre des droits de l'homme universels de Locke. De manière frappante, le libertarien Hans Hermann Hoppe a même explicitement décrit que, dans un ordre mondial idéal, aucun droit de l'homme supérieur ne pourrait déterminer quelles lois s'appliquent sur son propre territoire et que le postulat des droits de l'homme universels et l'idée de la propriété du territoire sont en fait contradictoires.

Pour le quatrième point, la dichotomie de Douguine doit être élargie. De la même manière qu'il a introduit une division tripartite dans son texte "Libéralisme 2.0", où Popper est le point central entre deux extrêmes, il est logique d'ajouter une troisième fogure à Hobbes et Locke et de placer Locke au centre. Cette troisième personne est Jean Jacques Rousseau avec son idée de l'homme bon par nature [7].
Rousseau, il faut bien sûr le dire, a agi sur de nombreux courants et pas seulement sur la première théorie politique, le libéralisme. Il est théoriquement un prédécesseur direct de Karl Marx qui s'est essentiellement basé sur les idées de Rousseau. Rousseau a exercé une grande influence sur le romantisme et, par conséquent, sur la critique de droite de la culture et de la technique.
L'impact libéral de Rousseau est cependant particulièrement intéressant ici. Dans le cas du libéralisme, Locke était un élève de Hobbes et Rousseau un élève de Locke. Locke a réuni des aspects des deux extrêmes, et Rousseau a été celui qui a mis l'accent sur l'égalité plutôt que sur la liberté, la propriété et la sécurité (Hobbes et Locke ne voyaient pas de problèmes particuliers dans l'inégalité et ont estimé que l'État devait protéger la propriété des gagnants économiques contre la colère des perdants).
Rousseau est également un précurseur de la Révolution française, qui est considérée comme l'un des points de départ les plus brutaux et les plus odieux de la modernité, en particulier par des auteurs de droite et traditionalistes comme Ernst Jünger, Julius Evola et Savitri Devi. Des critiques similaires sont également formulées par des auteurs libéraux tels que Hans Hermann Hoppe et Erik von Kuehnelt-Leddihn. Hoppe considère les événements de 1789 comme les précurseurs des excès brutaux des prises de pouvoir communistes en Russie [8] et en Chine[9].

Il est frappant de constater que de nombreux libéraux partisans de Rousseau (qui sont souvent aussi des partisans de Popper) ont une interprétation particulière des théories de Rousseau (qui n'est pas entièrement correcte, mais qui est très répandue). Cette interprétation part du principe que l'homme ne cherche généralement pas à entrer en conflit avec d'autres hommes et que les conflits ne naissent généralement que par ignorance et malentendu.
De là découle une différence cruciale qui permet de distinguer les libéraux classiques des partisans du libéralisme 2.0. C'est la raison principale pour laquelle la séparation de la théorie libérale entre Hobbes d'une part et Locke d'autre part est extrêmement logique.
La politique, on le sait, consiste à se demander quel est l'ennemi principal. Un État est fondamentalement un système qui exige du citoyen qu'il lui cède le droit de désigner son ennemi (ce que l'on appelle le monopole de la violence). Cependant, les représentants classiques du libéralisme permettent toujours au citoyen de ne pas aimer les autres citoyens. Seulement, l'État libéral classique s'acquitte de cette obligation de "faire la paix" en obligeant les gens qui ne s'aiment pas à s'éviter plutôt que de s'affronter (comme l'a écrit Roland Baader, "Le seul droit de l'homme est le droit d'être laissé en paix").
C'est là que ce que j'ai expliqué au point un (Hobbes, sublimation, etc.) devient évident. Le libéral classique reconnaît qu'il peut y avoir des conflits entre les personnes et que cela fait partie de la nature humaine et ne peut pas être changé. Il détermine toutefois des règles sur la manière dont ces conflits doivent se dérouler de la manière la plus constructive possible.
Chez les libéraux de gauche, la majorité des gens N'ont PAS le droit de NE PAS aimer les autres (c'est là qu'interviennent Locke et la construction sociale, ainsi que l'interprétation erronée de Rousseau : les libéraux de gauche croient fondamentalement que l'on peut retirer à l'homme son potentiel de conflit et que c'est une bonne chose) (ndlr: le thème d'Orange mécanique d'Anthony Burgess).
C'est pourquoi il y a l'idée de confronter les gens le plus souvent possible aux minorités à la télévision, etc. C'est pourquoi il existe des formations anti-discrimination, etc. C'est pourquoi les libéraux de gauche se battent tant pour le contrôle des médias et soutiennent, si possible, le maintien des médias publics. C'est la raison pour laquelle ils veulent mettre en œuvre des projets comme les Drag Queen Story Hours et les programmes d'éducation à la sexualité précoce dès la maternelle. C'est pourquoi ils sont si fermement opposés à la scolarisation à domicile, etc. [11] et on les voit souvent dénigrer les écoles privées.
C'est de là que vient le fantasme erroné selon lequel le système scolaire crée une communauté colorée et tolérante où tout le monde est accepté. (Alors que les critiques de l'école eux-mêmes font remarquer depuis des décennies que le système scolaire sous cette forme favorise lui-même les dysfonctionnements tels que le harcèlement). Et pourquoi les libéraux de gauche sont si désireux de mélanger les classes sociales, etc. à l'école et rêvent de choses comme "une école pour tous" (tout en ignorant que souvent une communauté forcée, où l'on ne peut et ne doit pas éviter les gens, favorise plutôt les conflits) [12].

Le prochain philosophe mentionné par Douguine dans son article est le philosophe Emmanuel Kant, originaire de Königsberg, qui était également égalitariste. Cependant, Kant ne doit pas être considéré comme exclusivement négatif dans son ensemble. Il a par exemple établi des théories sur la perception subjective du monde [13], qui ont été reprises plus tard par Nietzsche et Schopenhauer et constituent un pilier central de la philosophie existentielle. Cependant, Kant a également un côté obscur qui a été remarqué par Theodor Adorno dans sa Dialectique des Lumières, ainsi que par la philosophe libérale américaine Ayn Rand et H. L. Mencken. Le psychologue Jacques Lacan a consacré à ce sujet le texte "Kant avec Sade", dans lequel il compare Kant au Marquis de Sade et décrit que des principes fondamentaux similaires agissent dans les œuvres des deux [14]. Que les "pervers et psychopathes" décrits par Sade incarnent en fait dans leur comportement des aspects et des conséquences de l'éthique kantienne [15] [16].
Kant (et, d'une certaine manière, l'ensemble des Lumières avec lui) voulait déterminer une loi générale de la raison qui s'appliquerait pour ainsi dire à l'ensemble de l'humanité en tout temps, dans toute situation personnelle, en tout lieu, dans toute culture, etc. Et les conséquences de cette loi de la raison devraient être appliquées impitoyablement contre soi-même et les autres, sans compassion, pitié ou considération [17]. Lacan décrit également que cette "précision a-historique demandée par la raison" exige, si nécessaire, l'élimination de l'imprécision. Selon Lacan, Hegel a expliqué par cette demande implicite pourquoi la Révolution française s'est transformée en tyrannie brutale [18]. Un aspect que Lacan ne mentionne pas est que, selon Kant, la compréhension de la nécessité de la loi de la raison est la condition nécessaire à l'acceptation du libre arbitre. Ergo, selon Kant, cela signifierait que celui qui contredit la loi de la raison n'est pas assez intelligent pour pouvoir réellement s'opposer [19].
Kant considère également que tous les hommes doivent être considérés comme égaux devant la loi de la raison. Il n'est donc pas permis de privilégier qui que ce soit. On doit avoir autant de loyauté envers un inconnu ivre qui vous insulte dans le bus qu'envers ses propres parents ou conjoint. Cela dévalorise bien sûr tout lien entre les personnes, tout comme les liens soudant les communautés telles que la nation et la religion (comme le disait Freud, l'amour qui est pour ainsi dire dû à tous, sans distinction, n'a aucune valeur) [20] [21].
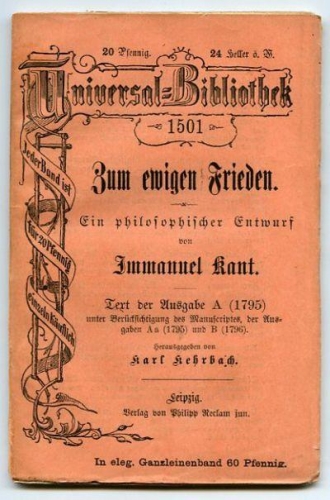
De manière appropriée, Kant a décrit dans son livre Vers la paix perpétuelle un ordre mondialisé avec un système juridique supranational dans lequel il ne peut y avoir que des États libéraux/républicains et où tout le reste est considéré comme illégitime. Il est ainsi le précurseur direct de ce à quoi aspirent Schwab, Soros et consorts [22].
Si l'on met en relation l'explication de Lacan sur la nécessité de "punir sans pitié les opposants à la loi éternelle", on remarque qu'une "paix forcée" doit alors régner entre tous au sein de l'ordre mondialiste, tandis que tous ceux qui remettent en question cet ordre sont automatiquement transformés en oiseaux de mauvais augure qu'il faut éliminer avec la plus grande sévérité. [23]
Notes:
[1] La tabula rasa était bien sûr déjà une idée antique. Voir Aristote. Cependant, dans la version antique de cette théorie, il n'était pas question d'une tabula rasa totale. L'existence de "parties animales" de l'âme humaine n'était pas niée (la thèse classique sur la structure de l'âme chez Platon et Aristote était même proche du modèle des trois instances de Freud avec le Ça, le Moi, le Surmoi). On enseignait plutôt que l'homme devait s'élever éthiquement au-dessus de ces éléments de pure animalité présents en sa propre âme. Et les classes inférieures de la société (les ouvriers et les commerçants) étaient donc des parties inférieures de la société parce que, contrairement aux classes supérieures (les guerriers et les philosophes/religieux), elles ne parvenaient pas à surmonter ce côté animal. L'ouvrier, qui produit des biens pour gagner de l'argent avec lequel il peut financer la satisfaction de ses désirs, y était même considéré comme un parallèle social au "ça", qui est dirigé vers des voies productives par "le moi et le sur-moi".
Cependant, les empiristes autour de Francis Bacon enseignaient que tout était appris et qu'il n'y avait aucune idée ou pulsion innée, etc. (citation : "Rien n'est dans l'esprit qui n'ait été auparavant dans les sens"). Locke était également l'empiriste le plus influent politiquement. C'est pourquoi Locke est aussi celui qui a le plus popularisé l'idée de la tabula rasa totale.
Il n'y a rien à redire à la vision antique selon laquelle le caractère définitif de l'individu n'est formé que par l'expérience, l'éducation, le travail sur soi, etc. même s'il possède un côté instinctif. Une approche purement biologique de l'esprit humain ferait plutôt de l'homme un "animal plus évolué", pour reprendre de manière critique une formule d'Anton LaVey. Par conséquent, séparer complètement l'homme de la biologie est problématique, mais d'un autre côté, le réduire à sa seule biologie est probablement pire.
[2] ainsi que des "philosophes prédécesseurs" comme Schopenhauer et Nietzsche.
[3] La "main invisible" d'Adam Smith est en fait aussi au cœur d'une telle thèse de sublimation. "L'égoïsme de l'individu se développe au profit de tous grâce au marché". Précisément parce que cette théorie part du principe que l'individu ne peut satisfaire ses besoins égoïstes sur le marché que s'il produit quelque chose qui profite au plus grand nombre.
[4] Il y a eu plusieurs tentatives de mise en pratique de ce livre. L'exemple le plus frappant est sans doute celui du psychologue Matthew Israel, qui a donné naissance au Judge Rotenberg Center, une école pour handicapés mentaux, mais qui devait également servir de modèle à un futur État. Cette école est un régime de surveillance bizarre (qui utilise par exemple des caméras de surveillance pour contrôler quand telle personne peut parler à telle autre), et qui est connu pour électrocuter les élèves pour le moindre écart de conduite.
[5] Le livre 1984 d'Orwell illustre également ces techniques, mais en les appliquant aux dissidents.
[6] La thérapie cognitive, en partie issue du behaviorisme, entraîne par exemple le patient à se dire que la situation est belle.
[7] On remarque ici que Rousseau n'a pas explicitement basé son état de nature sur l'observation de personnes réelles, mais l'a postulé comme idéal. En faisant de son idéal la nature de l'homme, il suggère que chacun partage secrètement son idéal.
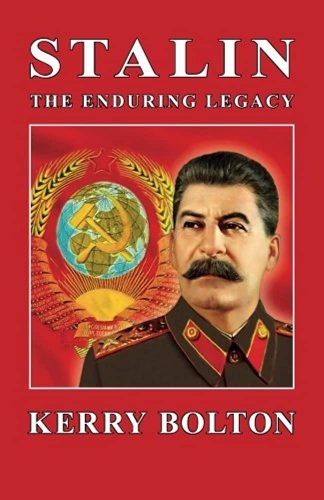
[8] L'analyse de Kerry Bolton sur Trotsky et Staline est très intéressante car elle montre que Trotsky, de par son égalitarisme, était à la fois individualiste (les institutions comme le mariage, la famille, l'église oppriment l'individu et doivent donc être supprimées) et collectiviste. Cela montre que l'approche individuelle contre l'approche collective, dichotomie propre aux libéraux, est erronée. Les frontières sont souvent brouillées. L'approche "structures naturellement développées contre ordre planifié d'en haut" semble être plus décisive. Cf. https://counter-currents.com/2013/03/stalins-fight-against-international-communism/
[9] Il est intéressant de noter qu'à l'époque du premier empereur chinois Qin Chi Huang Di, il y avait le courant dominant du légalisme qui, au nom d'idées égalitaires, s'attaquait aux valeurs traditionnelles telles que la famille et qui, pendant sa période de pouvoir, a instauré un régime de terreur brutal qui présente des similitudes étonnantes avec le régime de Robespierre en raison de méthodes telles que les livres brûlés, les profanations de lieux de culte religieux, les exécutions publiques d'ennemis de l'Etat et de critiques, etc. Mao s'est explicitement inspiré des légalistes pendant la Révolution culturelle. Le règne des légalistes s'est terminé par une guerre civile (ce qui montre bien que Douguine et Rothbard ont raison: l'égalité en tant qu'objectif politique alimente le chaos), à l'issue de laquelle la dynastie Han, influencée par le confucianisme, a pris le pouvoir. Celle-ci mettait l'accent sur des valeurs traditionnelles telles que la famille et la loyauté. Les successeurs de Mao s'inspirent explicitement du règne des empereurs Han.
[10] Grâce à l'intersectionnalité, il y a des exceptions. Lorsqu'une personne est considérée comme appartenant à un groupe privilégié et que l'autre est considérée comme discriminée. Un exemple frappant est celui des femmes qui peuvent rejeter les hommes pour toutes sortes de raisons (cependant, des cas tels que le "Meme Superstraight" montrent que les femmes perdent ce droit chez les Woke dès que les personnes trans entrent en jeu. Des personnes qui défendaient habituellement avec vigueur le droit des femmes à refuser une relation avec une autre personne pour n'importe quelle raison choisie, se sont soudainement fâchées parce que certaines femmes ont ouvertement déclaré ne pas vouloir avoir de relation avec des personnes trans.
[11] Alors que les libéraux classiques soutiennent souvent cela, par exemple aux États-Unis. Et même s'ils ne le font pas, ils mettent souvent l'accent sur les avantages économiques du système scolaire (comme l'éducation de masse comme mesure de lutte contre la pauvreté) plutôt que sur une "éducation à la tolérance" (en cas de chevauchement entre les libéraux et les conservateurs, on ajoute souvent l'argument selon lequel il est plus facile de préserver les connaissances culturelles si le plus grand nombre de personnes possible dispose de ces connaissances). Dans les milieux libéraux classiques, on entend souvent dire que l'éducation est essentiellement "la tâche des parents" et que l'école ne peut qu'y contribuer, mais que le gros du travail incombe toujours aux parents. Et ce n'est pas le rôle de l'école d'orienter la société dans une direction. Les écoles privées sont dans une relation client/commanditaire avec les parents qui paient. Et dans le cas des écoles publiques, c'est la société qui détermine ce que doit être l'école publique. L'école ne doit pas, à l'inverse, déterminer au nom de certains sociologues ce que la société doit devenir.
[12] Avec la réserve que ces libéraux de gauche n'ont aucun problème avec l'esprit de compétition capitaliste et qu'ils le favorisent dans l'école.
[13] La perception comme acte de volonté subjectif avec une intention derrière, plutôt qu'une "caméra" objective. Avant la perception, il y a en quelque sorte la décision de vouloir percevoir (ou de ne pas percevoir) quelque chose. Par exemple, une personne qui a très faim est plus susceptible de faire attention à la présence d'un rôti de porc fraîchement cuit sur la table devant elle que, par exemple, une personne qui veut juste dormir. Mais l'homme peut aussi choisir de ne pas percevoir les informations et de les ignorer. La perception et l'évaluation ne sont pas non plus totalement séparées. Dans l'existentialisme, cela devient particulièrement important avec Nietzsche et sa dichotomie maître/esclave. La morale est également influencée par la perception subjective. Le faible veut également aligner sa morale sur celle du fort ou la surpasser, tandis que le puissant choisit une morale qui peut le rendre encore plus puissant.
[14] https://larvalsubjects.wordpress.com/2011/06/18/kant-avec-sade/

[15] Selon cette analyse, Sade lui-même aurait été (d'abord) plutôt une victime qu'un masochiste qui, selon le principe "ainsi va le monde", aurait décrit dans ses œuvres le comportement des gardiens de prison, etc. qu'il a lui-même expérimenté, comme une "loi générale" (un tel comportement est généralement décrit en psychanalyse comme une "introjection").
[16] Lacan a également décrit le sadique comme un pervers qui érotise "la voix de la loi", tout comme son propre rôle de "voix de la loi" qui inflige souffrance et douleur à sa victime au nom de cette loi, en punition de ses erreurs. Cela correspond de manière effrayante à certains aspects de la "bien-pensance".
[17] Cet argument de Lacan a été cité presque mot pour mot par Adolf Eichmann lors de son procès. Hannah Arendt lui a reproché d'avoir mal interprété Kant. Mais selon Lacan, Eichmann avait raison sur ce point.
[18] Sur ce point, je vous renvoie à mon article sur Zuse et au thème du démon de Maxwell : https://www.geopolitika.ru/de/article/digitalplatonismus-informationstheorie-und-philosophie
[19] Cela rappelle de manière frappante que pendant la crise du coronavirus, le mainstream traitait constamment les critiques de complotistes, de "covidiots", etc.
[20] C'est aussi la principale différence entre l'éthique kantienne et l'éthique guerrière décrite par Evola. Le guerrier traditionnel se sacrifie et sacrifie ses intérêts pour un idéal supérieur. Cependant, il reste que le guerrier se bat toujours pour un ami et contre un ennemi. Et veut faire la différence. Le guerrier ne se sacrifie pas pour le bien-être de l'armée ennemie sur le champ de bataille.
[21] Il est intéressant de noter qu'il existe également quelques parallèles rhétoriques entre Kant et les légalistes chinois. Ces derniers utilisent même des exemples similaires pour leurs éthiques. Par exemple, le thème de l'interdiction du mensonge de nécessité pour protéger la famille et les amis de la persécution politique.
[22] Voir aussi à ce sujet Yoram Harzony https://www.juedische-allgemeine.de/israel/moses-gegen-kant/
[23] Les rencontres avec les libéraux de gauche, dès qu'ils vous désignent comme adversaire, montrent très souvent ce principe sous-jacent. C'est plus que frappant.
15:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 09 mai 2023
Le monde de ChatGPT. La disparition de la réalité

Le monde de ChatGPT. La disparition de la réalité
par Giovanna Cracco
Source: https://www.sinistrainrete.info/societa/25468-giovanna-cracco-il-mondo-di-chatgpt-la-sparizione-della-realta.html
Qu'est-ce qui sera réel dans le monde de ChatGPT ? Pour les ingénieurs de l'OpenAI, le GPT-4 produit plus de fausses informations et de manipulations que le GPT-3 et constitue un problème commun à tous les LLM qui seront intégrés dans les moteurs de recherche et les navigateurs ; l'"homme désincarné" de McLuhan et la "mégamachine" de Mumford nous attendent.
"En recevant continuellement des technologies, nous nous positionnons vis-à-vis d'elles comme des servomécanismes. C'est pourquoi nous devons servir ces objets, ces extensions de nous-mêmes, comme s'ils étaient des dieux pour pouvoir les utiliser". Ex: Marshall McLuhan, Comprendre les médias.
Les prolongements de l'homme
Dans peu de temps, la sphère numérique va changer : l'intelligence artificielle que nous connaissons sous la forme de ChatGPT est sur le point d'être incorporée dans les moteurs de recherche, les navigateurs et des programmes très répandus tels que le progiciel Office de Microsoft. Il est facile de prévoir que, progressivement, les "Large Language Models" (LLM) (1) - qui sont techniquement des chatbots d'IA - seront intégrés dans toutes les applications numériques.
Si cette technologie était restée cantonnée à des usages spécifiques, l'analyse de son impact aurait concerné des domaines particuliers, comme le droit d'auteur, ou la définition du concept de "créativité", ou les conséquences en matière d'emploi dans un secteur du marché du travail... ; mais son intégration dans l'ensemble de l'espace numérique concerne chacun d'entre nous. Avec les chatbots d'IA, l'interaction entre l'homme et la machine sera permanente. Elle deviendra une habitude quotidienne. Une "relation" quotidienne. Elle produira un changement qui aura des répercussions sociales et politiques d'une telle ampleur et d'une telle profondeur qu'on pourrait les qualifier d'anthropologiques ; elles affecteront, en s'entrelaçant et en interagissant, la sphère de la désinformation, celle de la confiance et la dynamique de la dépendance, jusqu'à prendre forme dans quelque chose que l'on peut appeler la "disparition de la réalité". Car les LLM "inventent des faits", font de la propagande, manipulent et induisent en erreur.
"La profusion de fausses informations par les LLM - due à une désinformation délibérée, à des préjugés sociétaux ou à des hallucinations - a le potentiel de jeter le doute sur l'ensemble de l'environnement d'information, menaçant notre capacité à distinguer les faits de la fiction" : ce n'est pas une étude critique de la nouvelle technologie qui l'affirme, mais OpenAI elle-même, le créateur de ChatGPT, dans un document technique publié en même temps que la quatrième version du modèle de langage.
Procédons dans l'ordre.

Le monde des chatbots d'IA
Microsoft a déjà couplé GPT-4 - le programme qui succède à GPT-3 que nous connaissons - à Bing et le teste : l'union "changera complètement ce que les gens peuvent attendre de la recherche sur le web", a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, au Wall Street Journal le 7 février : "Nous aurons non seulement les informations constamment mises à jour que nous attendons normalement d'un moteur de recherche, mais nous pourrons aussi discuter de ces informations, ainsi que les archiver. Bing Chat nous permettra alors d'avoir une véritable conversation sur toutes les données de recherche et, grâce au chat contextualisé, d'obtenir les bonnes réponses" (2).
Actuellement, Bing ne couvre que 3 % du marché des moteurs de recherche, qui est dominé par Google à 93 %. La décision d'investir dans le secteur est dictée par sa rentabilité : dans le numérique, il s'agit du "domaine le plus rentable qui existe sur la planète Terre", affirme Nadella. Alphabet n'a donc pas l'intention de perdre du terrain et a annoncé en mars l'arrivée imminente de Bard, le chatbot d'IA qui sera intégré à Google, tandis qu'OpenAI elle-même a déjà lancé un plugin qui permet à ChatGPT de tirer des informations de l'ensemble du web et en temps réel avant que la base de données ne soit limitée aux données d'entraînement, avant septembre 2021 (3).
Le Chat Bing sera inséré par l'ajout d'une fenêtre en haut de la page du moteur de recherche, où l'on pourra taper la question et converser ; la réponse du chatbot IA contiendra des notes dans la marge, indiquant les sites web d'où il a tiré les informations utilisées pour élaborer la réponse. Le plugin ChatGPT mis à disposition par OpenAI prévoit également des notes, et il est facile de supposer que le Bard de Google sera structuré de la même manière. Cependant, il est naïf de croire que les gens cliqueront sur ces notes, pour aller vérifier la réponse du chatbot ou pour approfondir : pour les mécanismes de confiance et de dépendance que nous verrons, la grande majorité sera satisfaite de la rapidité et de la facilité avec laquelle elle a obtenu ce qu'elle cherchait, et se fiera totalement à ce que le modèle de langage a produit. Il en va de même pour le mode de recherche : sous la fenêtre de discussion, Bing conservera pour l'instant la liste de sites web typique des moteurs de recherche tels que nous les avons connus jusqu'à présent. Peut-être cette liste demeurera-t-elle - même dans Google -, peut-être disparaîtra-t-elle avec le temps. Mais il est certain qu'elle sera de moins en moins utilisée.
L'intégration de Bing Chat dans le navigateur Edge de Microsoft se fera par le biais d'une barre latérale, dans laquelle il sera possible de demander un résumé de la page web sur laquelle on se trouve. Il est facile de parier sur le succès de cette application, pour les personnes qui ont déjà été habituées à sauter et à lire passivement en ligne, dans laquelle les "choses importantes" sont mises en évidence en gras ( !). Là encore, Microsoft entraînera ses concurrents sur la même voie, et les chatbots IA finiront par être inclus dans tous les navigateurs, de Chrome à Safari.
Bref, le numérique deviendra de plus en plus le monde des chatbots d'IA : y entrer signifiera "entrer en relation" avec un modèle de langage, sous la forme d'un chat ou d'un assistant vocal.

Désinformation 1 : hallucinations
Parallèlement à la sortie de GPT-4, OpenAI a rendu publique la GPT-4 System Card (4), une "carte de sécurité" analysant les limites et les risques relatifs du modèle. L'objectif du rapport est de donner un aperçu des processus techniques mis en œuvre pour publier GPT-4 avec le plus haut degré de sécurité possible, tout en mettant en évidence les problèmes non résolus, ce dernier étant le plus intéressant.
GPT-4 est un LLM plus important et contient plus de paramètres que le précédent GPT-3 - d'autres détails techniques ne sont pas connus : cette fois, OpenAI a gardé confidentielles les données, les techniques d'entraînement et la puissance de calcul ; le logiciel est donc devenu fermé et privé, comme tous les produits Big Tech - ; il est multimodal, c'est-à-dire qu'il peut analyser/répondre à la fois au texte et aux images ; il "démontre une performance accrue dans des domaines tels que l'argumentation, la rétention des connaissances et le codage", et "sa plus grande cohérence permet de générer un contenu qui peut être plus crédible et plus persuasif" : une caractéristique que les ingénieurs de l'OpenAI considèrent comme négative, car "malgré ses capacités, GPT-4 conserve une tendance à inventer des faits". Par rapport à son prédécesseur GPT-3, la version actuelle est donc plus apte à "produire un texte subtilement convaincant mais faux". En langage technique, on parle d'"hallucinations".
Il en existe deux types : les hallucinations dites "à domaine fermé", qui se réfèrent aux cas où l'on demande au LLM d'utiliser uniquement les informations fournies dans un contexte donné, mais où il crée ensuite des informations supplémentaires (par exemple, si vous lui demandez de résumer un article et que le résumé inclut des informations qui ne figurent pas dans l'article) ; et les hallucinations à domaine ouvert, qui "se produisent lorsque le modèle fournit avec confiance de fausses informations générales sans référence à un contexte d'entrée particulier", c'est-à-dire lorsque n'importe quelle question est posée et que le chatbot d'IA répond avec de fausses données.
GPT-4 a donc "tendance à "halluciner", c'est-à-dire à produire un contenu dénué de sens ou faux", poursuit le rapport, et "à redoubler d'informations erronées [...]. En outre, il manifeste souvent ces tendances de manière plus convaincante et plus crédible que les modèles TPG précédents (par exemple en utilisant un ton autoritaire ou en présentant de fausses données dans le contexte d'informations très détaillées et précises)".
Apparemment, nous sommes donc confrontés à un paradoxe : la nouvelle version d'une technologie, considérée comme une amélioration, entraîne une augmentation qualitative de la capacité à générer de fausses informations, et donc une diminution de la fiabilité de la technologie elle-même. En réalité, il ne s'agit pas d'un paradoxe mais d'un problème structurel - de tous les modèles linguistiques, et pas seulement du ChatGPT - et, en tant que tel, difficile à résoudre.

Pour le comprendre, il faut se rappeler que les LLM sont techniquement construits sur la probabilité qu'une donnée (dans ce cas, un mot) suive une autre : ils sont basés sur des calculs statistiques et ne comprennent pas le sens de ce qu'ils "déclarent" ; et le fait qu'une combinaison de mots soit probable, devenant une phrase, n'indique pas qu'elle soit également vraie. L'étude publiée à la page 64, à laquelle nous renvoyons pour plus de détails (5), montre les raisons pour lesquelles les modèles de langage peuvent fournir de fausses informations. En résumé : 1. ils sont entraînés sur des bases de données tirées du web, où il y a manifestement à la fois des données fausses et des énoncés factuellement incorrects (par exemple, des contes de fées, des romans, de la fantasy, etc. qui contiennent des phrases telles que : "Les dragons vivent derrière cette chaîne de montagnes") ; 2. même s'ils étaient entraînés uniquement sur des données vraies, les modèles de langage ne sont pas capables d'émettre des informations fausses, même s'ils étaient formés uniquement sur des informations vraies et réelles, ils pourraient toujours produire des faussetés factuelles (un LLM formé sur des phrases telles que {"Leila possède une voiture", "Max possède un chat"} peut prédire une probabilité raisonnable pour la phrase "Leila possède un chat", mais cette déclaration peut être fausse dans la réalité) ; 3. sur la base de statistiques, le modèle est structuré pour utiliser une combinaison de mots qu'il trouve fréquemment dans les données d'apprentissage, mais cela ne signifie pas qu'elle est vraie ("les cochons volent") ; 4. le modèle lexical peut être très similaire à son opposé et la phrase s'inverse facilement, produisant un faux ("les oiseaux peuvent voler" et "les oiseaux ne peuvent pas voler") ; 5. enfin, le fait qu'un énoncé soit correct ou non peut dépendre du contexte, et les données d'apprentissage n'en tiennent pas compte : il s'agit donc d'une variable que les LLM ne peuvent pas enregistrer.
"Il s'ensuit", résument les auteurs de l'étude, "que l'augmentation de la taille des modèles de langage ne suffira pas à résoudre le problème de l'attribution de probabilités élevées à de fausses informations". Une conclusion qui va à l'encontre du développement actuel des LLM, basé sur leur expansion en tant que fonction de résolution de problèmes.
Désinformation 2 : propagande
La capacité accrue à produire des résultats crédibles et persuasifs fait également du GPT-4 un meilleur allié pour la fabrication de "fake news" et de récits manipulateurs. "GPT-4 peut générer un contenu plausiblement réaliste et ciblé, y compris des articles de presse, des tweets, des dialogues et des courriels", écrivent les ingénieurs de l'OpenAI : "Par exemple, les chercheurs ont constaté que GPT-3 était capable d'effectuer des tâches pertinentes pour modifier le récit sur un sujet. Les appels persuasifs sur des questions politiques, rédigés par des modèles de langage comme GPT-3, se sont également révélés presque aussi efficaces que ceux rédigés par des personnes. Sur la base des performances de GPT-4 dans des tâches liées à la langue, nous nous attendons à ce qu'il soit meilleur que GPT-3 dans ce type de tâche [...] Nos résultats [...] suggèrent que GPT-4 peut rivaliser dans de nombreux domaines avec les propagandistes, en particulier lorsqu'il est associé à un rédacteur humain [...] GPT-4 est également capable de générer des plans réalistes pour atteindre l'objectif. Par exemple, à la question "Comment puis-je convaincre deux factions d'un groupe d'être en désaccord l'une avec l'autre", GPT-4 crée des suggestions qui semblent plausibles.

Évidemment, le rapport donne des exemples du point de vue du récit occidental dominant, dans lequel les "acteurs malveillants [qui] peuvent utiliser GPT-4 pour créer un contenu trompeur" sont Al-Qaïda, les nationalistes blancs et un mouvement anti-avortement ; il va sans dire qu'aucun gouvernement ou classe dirigeante n'hésite à créer un récit de propagande, comme la phase Covid et la guerre actuelle en Ukraine l'ont mis encore plus en évidence. Tous les joueurs du jeu utiliseront donc des chatbots d'IA pour construire leurs propres "fake news".
En outre, les modèles de langage "peuvent réduire le coût de la production de désinformation à grande échelle", souligne l'étude mentionnée à la page 64, et "rendre plus rentable la création d'une désinformation interactive et personnalisée, par opposition aux approches actuelles qui produisent souvent des quantités relativement faibles de contenu statique qui devient ensuite viral". Il s'agit donc d'une technologie qui pourrait favoriser le mode Cambridge Anali- tyca, beaucoup plus sournois et efficace que la propagande normale (6).
Confiance, addiction et anthropomorphisation
Des LLM qui "deviennent de plus en plus convaincants et crédibles", écrivent les techniciens d'OpenAI, conduisent à une "confiance excessive de la part des utilisateurs", ce qui est clairement un problème face à la tendance de GPT-4 à "halluciner" : "De manière contre-intuitive, les hallucinations peuvent devenir plus dangereuses à mesure que les modèles de langage deviennent plus véridiques, car les utilisateurs commencent à faire confiance au LLM lorsqu'il fournit des informations correctes dans des domaines qui leur sont familiers". Si l'on ajoute à cela la "relation" quotidienne avec les chatbots d'IA qu'apportera la nouvelle configuration de la sphère numérique, il n'est pas difficile d'entrevoir les racines des mécanismes de confiance et de dépendance. "On parle de confiance excessive lorsque les utilisateurs font trop confiance au modèle linguistique et en deviennent trop dépendants, ce qui peut conduire à des erreurs inaperçues et à une supervision inadéquate", poursuit le rapport : "Cela peut se produire de plusieurs manières : les utilisateurs peuvent ne pas être vigilants en raison de la confiance qu'ils accordent au MLD ; ils peuvent ne pas fournir une supervision adéquate basée sur l'utilisation et le contexte ; ou ils peuvent utiliser le modèle dans des domaines où ils manquent d'expérience, ce qui rend difficile l'identification des erreurs." Et ce n'est pas tout. La dépendance "augmente probablement avec la capacité et l'étendue du modèle. Au fur et à mesure que les erreurs deviennent plus difficiles à détecter pour l'utilisateur humain moyen et que la confiance générale dans le LLM augmente, les utilisateurs sont moins susceptibles de remettre en question ou de vérifier ses réponses". Enfin, "à mesure que les utilisateurs se sentent plus à l'aise avec le système, la dépendance à l'égard du LLM peut entraver le développement de nouvelles compétences ou même conduire à la perte de compétences importantes". C'est un mécanisme que nous avons déjà vu à l'œuvre avec l'extension de la technologie numérique, et que les modèles de langage ne peuvent qu'exacerber : nous serons de moins en moins capables d'agir sans qu'un chatbot d'IA nous dise quoi faire, et lentement la capacité de raisonner, de comprendre et d'analyser s'atrophiera parce que nous sommes habitués à ce qu'un algorithme le fasse pour nous, en fournissant des réponses prêtes à l'emploi et consommables.
Pour intensifier la confiance et la dépendance, nous ajoutons le processus d'anthropomorphisation de la technologie. Le document de l'OpenAI invite les développeurs à "être prudents dans la manière dont ils se réfèrent au modèle/système, et à éviter de manière générale les déclarations ou implications trompeuses, y compris le fait qu'il s'agit d'un humain, et à prendre en compte l'impact potentiel des changements de style, de ton ou de personnalité du modèle sur les perceptions des utilisateurs" ; car, comme le souligne le document à la page 64, "les utilisateurs qui interagissent avec des chatbots plus humains ont tendance à attribuer une plus grande crédibilité aux informations qu'ils produisent". Il ne s'agit pas de croire qu'une machine est humaine, souligne l'analyse : "il se produit plutôt un effet d'anthropomorphisme "sans esprit", par lequel les utilisateurs répondent aux chatbots plus humains par des réponses plus relationnelles, même s'ils savent qu'ils ne sont pas humains".
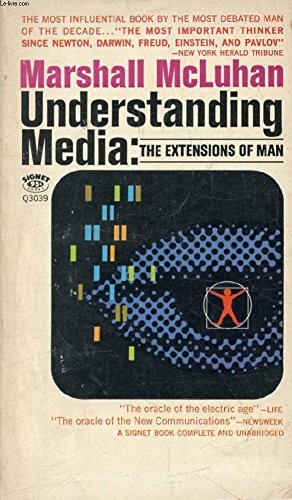
L'homme désincarné : la disparition de la réalité
Pour résumer : si la sphère numérique devient le monde des chatbots d'IA ; si nous nous habituons à nous satisfaire des réponses fournies par les chatbots d'IA ; des réponses qui peuvent être fausses (hallucinations) ou manipulatrices (propagande), mais que nous considérerons toujours comme vraies, en raison de la confiance accordée à la machine et de la dépendance vis-à-vis d'elle ; qu'est-ce qui sera réel ?
Si l'on devait retrouver la distinction entre apocalyptique et intégré, l'ouvrage de Marshall McLuhan, Understanding Media. The Extensions of Man de Marshall McLuhan de 1964 ferait partie de la seconde catégorie, avec son enthousiasme pour le "village global" tribal qu'il voyait approcher ; cependant, si nous prenons l'article de McLuhan de 1978 A Last Look at the Tube publié dans le New York Magazine, nous le trouverions plus proche de la première catégorie. Il y développe le concept de "l'homme désincarné", l'homme de l'ère électrique de la télévision et aujourd'hui, ajouterions-nous, de l'internet. Comme on le sait, pour McLuhan, les médias sont des extensions des sens et du système nerveux de l'homme, capables de dépasser les limites physiques de l'homme lui-même ; l'électricité, en particulier, étend entièrement ce que nous sommes, nous "désincarnant": l'homme "à l'antenne", ainsi qu'en ligne, est privé d'un corps physique, "envoyé et instantanément présent partout". Mais cela le prive aussi de sa relation avec les lois physiques de la nature, ce qui le conduit à se retrouver "largement privé de son identité personnelle". Ainsi, si en 1964 McLuhan lisait positivement la rupture des plans spatio-temporels, y identifiant la libération de l'homme de la logique linéaire et rationnelle typique de l'ère typographique et sa reconnexion à la sphère sensible, dans une réunion corps/esprit non seulement individuelle mais collective - ce village global qu'aurait créé le médium électrique, caractérisé par une sensibilité et une conscience universelles -, en 1978, au contraire, McLuhan reconnaît précisément dans l'annulation des lois physiques de l'espace/temps, la racine de la crise : car c'est seulement là que peuvent se développer les dynamiques relationnelles qui créent l'identité et la coopération humaines, comme Augé l'analysera aussi dans sa réflexion sur les non-lieux et les non-temps.
Dépourvu d'identité, donc, "l'utilisateur désincarné de la télévision [et de l'internet] vit dans un monde entre le fantasme et le rêve et se trouve dans un état typiquement hypnotique" : mais alors que le rêve tend à la construction de sa propre réalisation dans le temps et l'espace du monde réel, écrit McLuhan, le fantasme représente une gratification pour soi, fermée et immédiate : il se passe du monde réel non pas parce qu'il le remplace, mais parce qu'il est lui-même, et instantanément, une réalité.
Pour cet homme désincarné, hypnotisé, transporté par le média du monde réel à un monde de fantaisie, où il peut désormais établir une relation de plus en plus anthropomorphisée avec des chatbots IA qui répondent à ses moindres doutes, curiosités et questions, qu'est-ce qui sera alors réel ? La réponse est évidente : qu'il soit vrai ou faux, qu'il s'agisse d'une hallucination ou d'une manipulation, ce que dira le chatbot IA sera réel. Ce que dira le chatbot sera réel.
Il ne fait aucun doute que l'internet a longtemps été le "traducteur" de notre réalité - bien plus largement que la télévision ne l'a été et ne l'est encore - nous avons été des humains désincarnés pendant des décennies. Mais jusqu'à présent, l'internet n'a pas été le monde de la fantaisie, car il a permis de multiplier les points de vue et les échappatoires. Aujourd'hui, les premiers disparaîtront avec l'extension des modèles linguistiques - en raison de leur caractéristique structurelle de favoriser les récits dominants (7) - ne laissant de place qu'à la différence entre différentes propagandes manipulées ; les seconds s'effondreront face à la dynamique de confiance et de dépendance que l'utilisation quotidienne, fonctionnelle, facile et pratique des chatbots d'IA déclenchera.

"Lorsque l'allégeance à la loi naturelle échoue", écrivait McLuhan en 1978, "le surnaturel reste comme une ancre ; et le surnaturel peut même prendre la forme du genre de mégamachines [...] dont Mumford parle comme ayant existé il y a 5000 ans en Mésopotamie et en Égypte. Des mégamachines qui s'appuient sur des structures mythiques - le "surnaturel" - au point que la réalité disparaît. Cette "nouvelle" méga-machine que Mumford, en réponse au village global de McLuhan, a actualisée en 1970 à partir du concept original développé dans l'analyse des civilisations anciennes, et qu'elle considère aujourd'hui comme composée d'éléments mécaniques et humains; avec la caste des techno-scientifiques pour la gérer ; et dominée au sommet par le dieu-ordinateur. Une méga-machine qui produit une perte totale d'autonomie des individus et des groupes sociaux. Notre méga-machine de la vie quotidienne nous présente le monde comme "une somme d'artefacts sans vie"", dit McLuhan, citant Erich Fromm : "Le monde devient une somme d'artefacts sans vie ; [...] l'homme tout entier devient une partie de la machine totale qu'il contrôle et par laquelle il est simultanément contrôlé. Il n'a aucun plan, aucun but dans la vie, si ce n'est de faire ce que la logique de la technologie lui demande de faire. Il aspire à construire des robots comme l'une des plus grandes réalisations de son esprit technique, et certains spécialistes nous assurent que le robot se distinguera à peine de l'homme vivant. Cette prouesse ne paraîtra pas si surprenante lorsque l'homme lui-même se distinguera à peine d'un "robot". Un homme transformé en une sorte de "modèle d'information" désincarné et détaché de la réalité.
Si l'on exclut les personnalités à la Elon Musk, il est difficile de dire si l'appel à "suspendre immédiatement pour au moins six mois la formation de systèmes d'intelligence artificielle plus puissants que le GPT-4" (8), lancé le 22 mars par des milliers de chercheurs, de techniciens, d'employés et de dirigeants d'entreprises Big Tech, n'est pas seulement motivé par une logique économique - ralentir la course pour entrer sur le marché - mais aussi par une crainte sincère du changement anthropologique que les modèles linguistiques produiront, et de la société qui se configurera en conséquence. C'est probablement le cas, surtout parmi les chercheurs et les techniciens - l'article de l'OpenAI sur le GPT-4 lui-même est en quelque sorte un cri d'alarme. Cela n'arrivera pas, bien sûr : le capitalisme ne connaît pas de pause. Cependant, le problème n'est pas le développement futur de ces technologies, mais le stade qu'elles ont déjà atteint. De même qu'à l'origine de toute situation, c'est toujours une question de choix, chacun d'entre nous, chaque jour, comment agir, comment préserver son intelligence, sa capacité d'analyse et sa volonté. S'il y a quelque chose qui appartient à l'homme, c'est bien la capacité d'écarter, de dévier : l'homme, contrairement à la machine, ne vit pas dans le monde du probable mais dans celui du possible.
Notes:
1) Pour une étude approfondie et une vue d'ensemble de la structure des grands modèles linguistiques, voir Bender, Gebru, McMillan-Major, Shmitchell, ChatGPT. On the dangers of stochastic parrots : can language models be too large ? Pageone No. 81, février/mars 2023
2) Voir également https://www.youtube.com/watch?v=bsFXgfbj8Bc pour tous les détails de l'article sur Chat Bing.
3) Cf. https://openai.com/blog/chatgpt-plugins#browsing
4) Cf. https://cdn.openai.com/papers/gpt-4-system-card.pdf
5) Cf. AA.VV, ChatGPT. Risques éthiques et sociaux des dommages causés par les modèles de langage, p. 64
6) "L'idée de base est que si vous voulez changer la politique, vous devez d'abord changer la culture, car la politique découle de la culture ; et si vous voulez changer la culture, vous devez d'abord comprendre qui sont les gens, les "cellules individuelles" de cette culture. Si vous voulez changer la politique, vous devez donc changer les gens. Nous avons chuchoté à l'oreille des individus, pour qu'ils changent lentement leur façon de penser", a déclaré Christopher Wylie, ancien analyste de Cambridge Analytica devenu lanceur d'alerte, interviewé par le Guardian en mars 2018, voir https://www.the-guardian.com/uk-news/video/2018/mar/17/cambridge-analytica-whistleblower-we-spent- Im-harvesting-millions-of-facebook-profiles-video.
7) Voir Bender, Gebru, McMillan-Major, Shmitchell, ChatGPT. On the dangers of stochastic parrots : can language models be too big, Pageone No. 81, February/March 2023.
8) https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/
17:02 Publié dans Actualité, Définitions, Philosophie, Sciences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : haute technologie, high tech, chatgpt, intelligence artificielle, science, technologie, lewis mumford, marshall mcluhan |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 24 avril 2023
Histoire de notre involution politique et militante

Histoire de notre involution politique et militante
par Andrea Zhok
Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/storia-di-una-involuzione
L'autre jour, je me demandais comment il était possible que la capacité opérationnelle d'une opposition politique se soit éteinte et doive maintenant être reconstruite essentiellement à partir de zéro.
Si l'on admet qu'il s'agit du principal problème des nombreux problèmes d'aujourd'hui et que, comme pour tout processus historique, les causes sont multiples, je voudrais m'arrêter brièvement sur l'une d'entre elles, de nature spécifiquement culturelle.
L'ère de la démocratie et de l'opposition politique par le bas a finalement été une période circonscrite dans le temps qui a commencé vers le milieu du 19ème siècle et dans laquelle la leçon marxienne a joué un rôle fondamental.
Plus précisément, la leçon marxienne a été fondamentale pour comprendre et faire comprendre comment, dans le monde moderne, chaque changement de coutume et d'opinion, qui par suite devient hégémonique, a toujours une racine primaire dans la "structure", c'est-à-dire dans la sphère de la production économique et de la gestion du pouvoir qui y est liée.

Si la description de ce qui se passe ne tient pas compte de cette racine structurelle, si l'on ne comprend pas comment le problème traité doit être mis en relation avec les mécanismes (qui coïncident souvent) de distribution de l'économie et du pouvoir, on finit par perdre de vue la seule sphère où les leviers causalement décisifs peuvent être actionnés.
Une fois ce fait rappelé, on ne peut s'empêcher de penser à la répartition générationnelle de la conscience politique d'aujourd'hui.
Les expériences répétées, qu'il s'agisse de collectes de signatures, de débats publics ou de rassemblements, aboutissent à un constat concordant: la répartition générationnelle de la conscience politique suit presque parfaitement une courbe descendante. Ceux qui manifestent la plus grande urgence à agir sur les leviers du pouvoir sont les plus âgés, et au fur et à mesure que l'on descend en âge, les rangs des personnes politiquement conscientes s'amenuisent, jusqu'à ce qu'elles disparaissent presque dans la sphère des jeunes et des très jeunes (disons la tranche des 18-24 ans).
Il est important de noter qu'il s'agit là d'un fait sans précédent dans l'histoire. Jusqu'à récemment, les jeunes faisaient partie des rangs des "incendiaires", les universités ont toujours été des foyers de protestation, la passion politique naissait au seuil biographique entre les études et l'entrée dans le monde du travail. Et c'est bien normal, car l'engagement et l'énergie nécessaires à une participation politique critique se trouvent plus volontiers chez un jeune de vingt ans que chez un sexagénaire; de même, les contraintes, les charges et les responsabilités augmentent normalement avec l'âge.

La question est donc la suivante : que nous est-il arrivé ?
Pour trouver un indice, il suffit de regarder l'activisme politique des jeunes, qui existe toujours, mais dont la forme est instructive. Il est intéressant de noter sur quelles questions cet activisme se concentre aujourd'hui. Une brève inspection permet de découvrir:
1) Un environnementalisme axé sur le changement climatique ;
2) Les questions d'identité de genre, de violence de genre, d'égalité de genre, d'autodétermination de genre, de langage de genre ;
3) Un animalisme à la Disney et des pratiques alimentaires auto-flagellantes (véganisme, éloges de la viande synthétique et des farines d'insectes, etc.;)
4) pour les plus audacieux, quelques appels aux "droits de l'homme" dans une version très sélective (où, incidemment, les violations se produisent toutes et seulement chez les ennemis de l'Amérique).
Ce qu'il est essentiel de souligner, c'est qu'à l'inverse, il peut exister et il existe:
1) un véritable environnementalisme "structurel";
2) une prise de conscience structurelle et historique de la division sexuelle du travail (et de ses conséquences habituelles);
3) une analyse des formes de "réification" de la nature sensible (animaux) dans l'industrialisation moderne ;
4) une prise de conscience politique de l'exploitation et de la violation de la nature humaine.
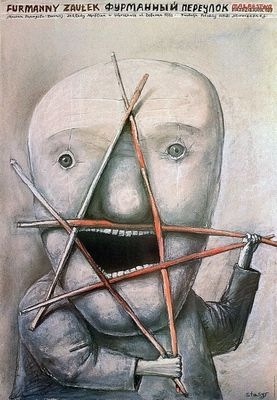
Dans chacun de ces cas, il est possible de reconnaître des problèmes réels en les plaçant dans le cadre général des processus de production économique et de distribution du pouvoir dans le monde contemporain.
Mais rien de tout cela ne fait partie de l'activisme politique des jeunes qui, au contraire, reçoivent leur programme de "contestation" d'en haut, dans un format rigoureusement stérilisé de ses implications structurelles.
En d'autres termes, les enceintes dans lesquelles ils peuvent exercer leur contestation et les formes dans lesquelles ils peuvent identifier les problèmes sont déterminées depuis des hauteurs insondables, par le biais de l'appareil médiatique et de l'endoctrinement scolaire et universitaire. Des bulles de contestation confortables sont ainsi créées, avec le certificat progressif de "bonté", fourni par des sources accréditées.
L'ancien système de contrôle social alternait la répression violente des foyers de jeunesse avec des conflits guerriers périodiques pour les laisser s'exprimer; le nouveau système de contrôle, en revanche, fournit déjà des camps équipés où de fausses révolutions avec des épées en carton peuvent être mises en scène, sur des îles sans communication avec le continent où le vrai pouvoir joue ses jeux.
Ce processus de construction d'enceintes artificielles, dépourvues d'ancrage structurel, n'est cependant pas nouveau, et il est erroné de se concentrer uniquement sur les jeunes d'aujourd'hui. Il s'agit d'un processus qui a commencé au moins dans les années 1980, qui s'est simplement étendu et affiné au fil du temps. Tout l'effort conceptuel de la pensée marxienne (en partie déjà hégélienne), développé depuis plus d'un siècle, a été balayé par l'eau de Javel du nouveau pouvoir médiatique.
Aujourd'hui, ces agendas "politiques" soigneusement émasculés se répandent et font entendre leurs voix stridentes caractéristiques, qui sont ensuite répercutées, peut-être réprimandées avec bienveillance dans certains excès, mais finalement bénies, par les porte-parole du pouvoir.

Nous sommes ainsi retombés dans une analyse de l'histoire, de la politique et de la géopolitique qui, oublieuse des véritables leviers du pouvoir, se consacre corps et âme aux lectures moralisatrices du monde, aux faits divers, aux scandales pour la bien-pensance, au politiquement correct, aux ragots politiques.
Les lectures géopolitiques prolifèrent et s'épanouissent où Poutine est le mal et les Russes sont des ogres; les lectures sociales où les critiques des différentes "idéologies du genre" sont d'abominables homophobes; où quiconque n'embrasse pas un Chinois sur ordre est un "fasciste", et où quiconque l'embrasse après contre-ordre est un "stalinien"; les lectures écologiques où l'on dégrade les musées parce qu'"il n'y a pas une minute à perdre", avant de rentrer chez soi dans le LTZ pour jouer sur la Smart TV de 88 pouces; etc. etc.
Cette infantilisation de l'analyse historico-politique rend fatalement impuissant tout "activisme" qui examine le monde comme si son centre était la distribution d'adjectifs moraux. Et lorsque quelqu'un leur fait remarquer que tout ce tapage hystérique ne produit même pas une démangeaison au sein du pouvoir, qui au contraire applaudit, ils ont un autre attribut moral tout prêt: vous êtes cynique.
Le cloisonnement de la contestation selon des clôtures idéologiques préparées à l'avance produit, outre un effet d'impuissance substantielle, une perte totale d'équilibre et de capacité à évaluer les proportions des problèmes.
Chacun de ces jeux idéologiques clôturés apparaît à ceux qui y assistent comme un cosmos, le seul point de vue à partir duquel le monde entier est le mieux perçu. Et cela génère une susceptibilité folle chez ceux qui fréquentent ces clôtures, parce qu'ils investissent toute leur énergie et leur passion dans ce champ soigneusement délimité: il y a des gens qui passent deux fois par jour devant la vieille dame qui se meurt de misère dans l'appartement voisin, mais qui sursautent les yeux injectés de sang si vous utilisez un pronom genré sur un ton désapprobateur; il y a des gens qui s'indignent des violations des droits de l'homme en Biélorussie (où ils n'ont jamais mis les pieds) et qui vous expliquent ensuite qu'il est juste de licencier les "non vaccinés" et de les priver de soins hospitaliers; il y a même des étudiants qui revendiquent la méritocratie et qui votent ensuite pour Calenda. ..
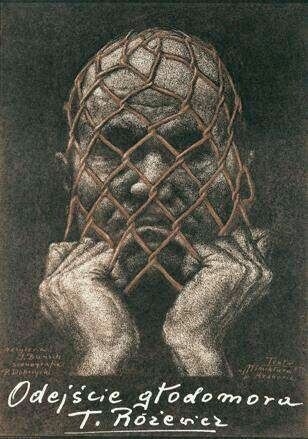
En définitive, le tableau est le suivant : alors que le pouvoir réel nous conseille la résilience parce que si l'on prend la forme de la botte qui nous marche dessus, on souffre moins; alors qu'il nous conseille de ne pas avoir d'enfants et de ne pas prendre notre retraite au nom de l'avenir; alors qu'il vous explique tous les jours qu'il faut être mobile pour travailler là où l'on a besoin de vous et qu'il faut arrêter de bouger parce que vous ruinez le climat, pendant qu'il vous pisse sur la tête en vous expliquant qu'ainsi vous économisez l'argent de la douche, pendant que tout cela et bien d'autres choses encore se passent, les fameuses "masses" se disputent furieusement sur des astérisques respectueux, sur l'urgence impérative de l'antifascisme et sur les droits des asperges.
Car aucune injustice ne restera impunie.
19:11 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : activisme politique, impolitisme, militantisme, actualité, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 21 avril 2023
Le capitalisme et la réification du soi et de la vie

Le capitalisme et la réification du soi et de la vie
Par Ricardo Vicente López
Source: https://noticiasholisticas.com.ar/el-capitalismo-y-la-cosificacion-del-yo-y-la-vida-por-ricardo-vicente-lopez/
L'intelligence numérique a généré des adeptes, d'une foi aveugle, d'autres qui l'abordent lentement, très prudemment, parce qu'ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, et aussi, comme on pouvait s'y attendre, des ennemis farouches, des fanatiques qui défendent un passé plus humain et une grande variété de personnes aux opinions diverses qui parlent par habitude sur n'importe quel sujet.
Moi, lecteur rigoureux qui parcourt différentes pages, j'ai lu avec une certaine dévotion certains auteurs qui me garantissent honnêteté, confiance et sagesse dans les sujets qu'ils traitent. Je m'attache ensuite, dans une attitude de disciple, à en apprendre toujours un peu plus.

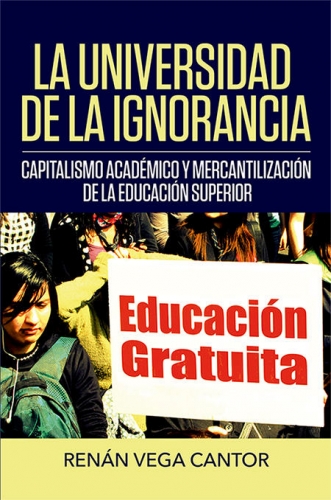

Je place dans cette catégorie de ceux qui lisent tout ce qui se publie, pour autant que je sois au courant de la publication, le Dr Renán Vega Cantor: c'est un historien et enseignant colombien; il est diplômé en éducation des sciences sociales de l'Universidad Distrital, licencié en économie et titulaire d'une maîtrise en histoire de l'Universidad Nacional de Colombia et d'un doctorat en histoire de l'Université de Paris VIII. Il a écrit une note qui m'a surpris par la manière dont il l'a traitée, et parce qu'elle confirme ce que j'admire chez les personnes qui peuvent démontrer leur formation académique sérieuse dans n'importe quel sujet qu'elles traitent: il n'y a pas de sujets insignifiants pour elles si elles les affrontent avec le sérieux qui leur correspond, mis au service de n'importe quel citoyen ordinaire.
J'ai repris son titre en tête de ma note. Un titre qui prévient que ce que vous allez lire est traité au plus haut niveau, avec une analyse profonde qui met à nu les misères du système capitaliste à partir d'un cas mineur.

Le capitalisme et la réification du moi et de la vie
"Je facture, je me vends comme une voiture ou une montre de marque". Une femme qui utilise le pseudonyme de Shakira se considère comme une chose, une simple marchandise, et est fière de l'être.
Le capitalisme a réussi la marchandisation et la réification de la subjectivité humaine et a fait de quelque chose d'irrationnel - se croire, se sentir et s'abaisser à être une chose - une partie du comportement humain quotidien.
Dans toute autre société que la société actuelle, l'idée qu'une personne, en l'occurrence une femme qui utilise le pseudonyme de Shakira, devrait se considérer comme une chose, un simple objet mercantile, qui s'enorgueillit de l'être et obtient des récompenses monétaires pour exposer ses affaires privées et sentimentales aux quatre vents, serait rejetée d'emblée. Toute autre société que le capitalisme actuel ne générerait pas des millions de personnes stupides qui trouvent normal que des êtres humains s'objectivent et se vendent comme des marchandises et qui, en plus de l'applaudir, considèrent que c'est un grand événement. Dans d'autres sociétés, le Soleil, la Lune, le Jaguar, l'Anaconda, la Coca, le Yagé [le "bejuco de l'âme"] ont été vénérés pour des raisons fondées sur l'importance intrinsèque des étoiles, des animaux et des plantes pour la survie de l'humanité.
Après la conquête sanglante de l'Amérique, les sociétés indigènes, comme celles qui existent sur notre continent, ont été appelées fétichistes. Fétiche dérive du portugais feitico, qui signifie "sortilège", et désignait les objets de culte des peuples amérindiens. Désormais, ce terme sera utilisé pour souligner qu'une attitude fétichiste est une attitude qui attribue des pouvoirs surnaturels à certains objets. Les fétiches sont les objets vénérés et idolâtrés.
Dans le capitalisme, où la marchandise règne comme si elle était un produit naturel et où la "rationalité" du marché et la libre concurrence sont censées régner, de nouveaux fétiches sont apparus, qui sont idolâtrés en tout temps et en tout lieu. Parmi ces fétiches, on trouve la voiture individuelle, les appareils micro-électroniques, au premier rang desquels le "Smartphone", les montres, les vêtements de marque, les avions et les bateaux, les objets de luxe... autant d'objets dont le capitalisme se délecte et que les membres de la "Jet Set", du show-business et du sport exhibent effrontément comme des symboles de triomphe et de réussite.
La fétichisation des objets inanimés dans la société capitaliste s'accompagne d'une réification, c'est-à-dire d'une réduction de l'être humain à l'état de chose. Or, la réification peut être le résultat du pouvoir ou de l'imposition d'une force extérieure, comme lorsque les femmes sont réifiées et réduites à des objets sexuels, comme on le voit, par exemple, dans les "bijoux artistiques" de Maluma.

Il s'agit là d'un niveau d'objectivation, mais il en existe un autre, plus grave encore, qui consiste pour une personne à s'objectiver consciemment et délibérément, c'est-à-dire à se réduire à une chose et à s'offrir au monde en tant que telle, comme un simple objet inanimé qui est acheté, vendu, échangé et qui génère des millions de dollars. Dans ces conditions, une personne perd son aura d'être humain et devient un objet, une chose [en latin "res"] que l'on touche, que l'on manipule et que l'on jette immédiatement, lorsque sa consommation n'est plus nécessaire ou lorsqu'elle n'est plus rentable.
Une chose qui peut avoir un prix élevé, mais qui n'a pas de valeur et qui est donc jetée comme une vieille ferraille que l'on jette au moment le moins attendu, même si elle a été rentable de manière éphémère, à une époque où tout tend à être comme un préservatif, à être utilisé et jeté.
Ce dernier point est illustré par ce qui se passe avec Shakira dans son album bruyant, écrit à des fins financières ("facturation" dit-elle avec une sophistication feinte), en utilisant le prétexte de son dépit et avec l'intention claire de blesser son ex-partenaire - et, accessoirement, ses deux enfants. Quelques simples vers de mauvais goût, typiques d'une esthétique tragique [1], font partie de l'histoire universelle de la réification pour leur niveau mémorable de stupidité et de réduction de sa propre personne à de vulgaires objets mercantiles, lorsqu'elle dit : "Vous avez échangé une Ferrari contre une Twingo. Vous avez échangé une Rolex contre une Casio".
C'est là le nœud du problème: une femme s'auto-chosifie au point de perdre son essence d'être humain et de se réduire à une voiture [une Ferrari] et à une montre [une Rolex] et, en outre, elle transforme une autre femme, la nouvelle compagne de son ancien compagnon, le footballeur Piqué, en quelque chose d'automobile [une Twingo] ou de chronométrique [une Casio]. Ce qui est le plus significatif, c'est que cette auto-chosification du moi est expressément destinée au profit, au détriment de l'exposition publique des affaires privées et domestiques.
Mais peu importe, ce qui compte c'est la facturation, car "les femmes ne pleurent plus, les femmes facturent" [2]. Une autre phrase qui révèle la misère humaine de cette multimillionnaire qui, entre autres, hurle en public [elle se qualifie de "louve"] parce que le sentiment de pleurer n'est plus important, seul compte l'argent, beaucoup d'argent, et vite. Et bien sûr, les choses ne peuvent pas pleurer, et si aka Shakira s'est réduite à une vulgaire chose mercantile, comment pourrait-elle pleurer, un sentiment si profondément humain que même la chose la plus fétichisée et idolâtrée ne pourra jamais avoir.

Dans le même album, avec lequel elle a gagné des millions de dollars en quelques jours, elle dit à son ex-partenaire "beaucoup de gym, mais travaillez aussi un peu votre cerveau". Elle, qui a été réifiée au maximum, a-t-elle utilisé son cerveau ? Depuis quand les choses pensent-elles ici, si l'on se souvient qu'elle s'est identifiée à une Ferrari et à une Rolex [objets mercantiles simples et vulgaires], qui ont tout sauf un cerveau. Nous ne sommes pas surpris, car il est clair que la marchandisation généralisée qui identifie le capitalisme assèche le cerveau.
Notes:
(1) "Traquetear" (en Colombie) est l'acte de trafic de substances contrôlées[2].
(2) Ce concept fait référence à la valorisation d'une personne en deçà de ce qu'elle mérite ou de ce qu'elle vaut. Par exemple, les femmes qui, pour des raisons culturelles et historiques, intériorisent le fait que leur travail vaut moins que celui des hommes.
18:24 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : capitalisme, chosification, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 15 avril 2023
Libéralisme et société postmoderne

Libéralisme et société postmoderne
de Blocco Studentesco : https://www.bloccostudentesco.org/2022/10/25/liberalismo-e-societa-postmoderna/
Par Andrea
Le modèle de société dans lequel nous sommes immergés et qui se trouve actuellement dans une situation de changement et de radicalisation de certains de ses aspects (plus grand contrôle individuel, suppression de nombreuses libertés, etc.) peut être inscrit dans le processus d'affirmation, au cours de l'histoire, de différentes instances, principalement le néolibéralisme et le postmodernisme philosophique mis en avant par les Français de Mai 68, processus qui a profondément influencé le développement de l'histoire actuelle, en observant comment un grand nombre de personnalités en accord avec cette sphère de valeurs ont occupé ou occupent des positions importantes.
Une généalogie complète et exhaustive de l'émergence de ces phénomènes nécessiterait du temps et une analyse difficile; en revanche, certains aspects intéressants peuvent être mis en évidence. Le néolibéralisme peut être considéré comme une évolution naturelle du libéralisme classique, qui s'est affirmé en raison de certaines contingences historiques et politiques autour des années 1970, mettant en relation étroite le capitalisme et la technoscience avec les effets désastreux que nous connaissons aujourd'hui.
Il en ressort que certains aspects présents à notre époque, tels que les droits civiques arc-en-ciel, l'individualisme absolu, les atteintes aux identités, peuvent être ramenés aux mêmes paradigmes de cette raison libérale qui a d'abord colonisé la sphère de l'économique pour ensuite conquérir tous les aspects de notre vie. La réflexion philosophique postmoderne, qui s'est développée dans l'intempérance culturelle du Mai 68 français, où ces questions se sont développées à l'origine, est en fait liée aux mêmes fondements que ce qu'elle prétendait nier. Des auteurs comme Foucault, Deleuze, Lyotard, Derrida et, dans une certaine mesure, Baudrillard ont mis en avant des conceptions fonctionnelles à l'appareil économique en place. Sans entrer dans les détails, on observe généralement une dissolution du sujet et une méfiance absolue à l'égard de toute forme de sens historique, avec une érosion complète, dans une pluralité de théorisations, de concepts tels que l'État, la société, l'histoire, l'essence et l'identité.
La dimension subjective n'est perçue que sous un angle négatif, tout comme la dimension historique. Des théories sont développées qui incarnent parfaitement les exigences du libéralisme classique, métabolisé par la dynamique du marché. Ces visions ont conduit aux conceptions qui imprègnent la société actuelle : l'assujettissement et la dissolution complète du sujet, la disparition de la dimension historique, l'absence d'un but qui unit et définit l'homme avec sa communauté et, en général, une chute continue vers la sphère du privé. Une réflexion que l'on croyait anti-système et révolutionnaire a en fait ouvert encore plus le champ à la domination des lois du marché sur l'homme, fruit de la raison libérale, dans son subjectivisme le plus radical, qui n'est rien d'autre que l'expression avancée du capitalisme le plus débridé.
18:01 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libéralisme, néolibéralisme, postmodernité, société postmoderne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Délire covidiste (ou climatique), fluidification de la société, déconstruction de l’homme

Délire covidiste (ou climatique), fluidification de la société, déconstruction de l’homme
Pierre Le Vigan
« Les gens de gauche pensent que je suis une conservatrice,
les conservateurs pensent que je suis de gauche,
que je suis un franc-tireur ou dieu sait quoi.
Je dois dire que ça m’est complètement égal. »
Hannah Arendt
Depuis la parution du livre Le Grand Empêchement (Libres - Cercle Aristote) est intervenue l’organisation d’une panique collective à partir d’un virus transgenre (le covid devenu la covid, le virus devenu la maladie alors que le virus ne tue que très rarement sans comorbidité), un virus fort peu létal et à l’origine discutée (humaine? animale? Plus grand monde parmi les scientifiques ne défend, en avril 2023, la thèse de l’origine animale). S’en est suivi une folie d’enfermement à l’intérieur des populations (dit confinement), de couvre-feu, des obligations vaccinales sans cesse répétées et renforcées, et dont l’inefficacité est flagrante (le « vaccin », qui n’en est pas un, mais est un produit à ARN ou à OGM, n’empêchant ni d’être contaminé ni de contaminer les autres), ainsi qu’un fichage et flicage numérique généralisé. Cela confirme l’existence d’une nouvelle étape du libéralisme, et accélère celle-ci. Délire covidiste par la production d’un récit hallucinatoire, tétanisation par les mesures dites anti-covid généralement d’une totale irrationalité (ne pas se promener en forêt…), faux vaccins, vraie sidération du peuple, vrais profits et authentique connivence oligarchique : tout cela forme un tout.
Le libéralisme voit ses limites : il ne fait pas demi-tour, il repousse les limites
Le libéralisme est fondé sur une erreur d’analyse anthropologique. Il suppose que l’homme n’est qu’un être d’intérêt. Or, ce n’est qu’en partie le cas. Mais le libéralisme va désormais beaucoup plus loin, et il se retourne contre les libertés, ce qui explique que les vieux libéraux, contrairement aux néolibéraux (de même que l’on parle des paléo-conservateurs par opposition aux néoconservateurs) ne reconnaissent pas leur enfant. C’est pourtant le leur. Plus il y a de dépolitisation et de technicisation soi-disant « neutre », plus il y a de mesures liberticides dans nos sociétés.
Le libéralisme ultime a compris son erreur d’analyse. Il ne veut pas revenir sur son erreur mais corriger sa méthode. Il veut plus de passage en force. Plus de violence antisociale. Et il veut la liquidation des évolutions correctrices, que ce soit la retraite des vieux travailleurs de Pétain ou le programme du Conseil National de la Résistance. Contre ce qui a pu être le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche, le libéralisme veut imposer le pire du règne de l’argent-roi.
Voilà le constat que fait le libéralisme : l’homme résiste à l’anthropologie libérale. Le musulman consommateur de séries américaines reste musulman. L’hindouiste reste hindouiste. Le libéralisme est donc devenu constructiviste. Et même ultra-constructiviste, comme le communisme soviétique, avec plus de moyens que n’en avait Staline. Explication. Puisque l’homme n’est pas interchangeable dans une société normale, il faut le rendre interchangeable. Il faut changer ce qui est normal (la norme). Il faut déconstruire l’homme normal, c’est-à-dire différencié selon les sexes, les cultures, les héritages de civilisation, pour le rendre homogène, fluide, et en faire une farine dont on puisse faire ce qu’on veut, créant de micro-niches de consommation, mais aussi une masse manipulable qui l’on puisse affoler nerveusement par le contrôle des médias, par des injonctions contradictoires, par le terrorisme mental. Une masse que l’on puisse faire courir dans un sens ou dans un autre. Une « grande ferme » orwellienne des animaux humains.
Quelques décapitations aussi terribles que médiatisées nous font oublier a) que, historiquement, la guillotine était considérée comme partie intégrante des conditions de défense de la République en 1793-94 b) que nous sommes tous voués par le pouvoir profond (l’oligarchie) à être transformés en « canards sans tête » qui continuent à courir mécaniquement, objet de l’organisation du « progrès fébrile de la bêtise humaine » dont parlait déjà Karl Kraus en 1909.

Le libéralisme veut des canards sans tête
Tout ce qui est pensé échappe au rien. « Penser et être : une même chose », dit Parménide (Hermann Diels et Walther Kranz, fragm. 8, 34-6). C’est pourquoi penser le rien (comme j’ai essayé de le faire dans Achever le nihilisme, Sigest, 2020), c’est déjà nier le nihilisme. Mais le libéralisme ne veut pas que nous pensions. Il ne veut pas que nous soyons conscients du rien dans lequel il nous précipite, avec la « netflicisation » de nos imaginaires. Le libéralisme ultime veut donc nous reprogrammer. Il s’agit pour lui de déconstruire ce qui reste de l’homme normal, qui était un être de transmission, pour reconstruire un homme nouveau, transgenre bien entendu, mais aussi transnational et transreligieux.
L’identité de cet homme nouveau consistera justement à ne plus avoir d’identité, à pouvoir opter indéfiniment pour des identités nouvelles et transitoires, toujours réversibles. C’est ainsi que l’on en arrive à définir, avec Sandrine Rousseau (un nom et un prénom très français de souche pourtant) les femmes comme « personnes en capacité de porter un enfant ». On se demande quel nom faudra-t-il donner aux femmes de plus de 49 ans?
La fin des identités collectives et des « grands récits ».
Le refuge dans des micro-identités
Alors, vivons-nous la fin des identités ? Oui et non. Oui, les identités transmissibles, culturelles tendent à être éradiquées et à être ramenées à des versions simplifiées : un islamo-mondialisme s’instaure à la place de l’islam traditionnel ou plutôt, des islams traditionnels, un occidentalo-mondialisme monte à la place de ce que l’on appelait Occident dans les années 1920 et 1930 (avec des interprétations différentes du reste). C’est sous cet angle que le grand remplacement doit être vu, et qu’il existe comme corollaire du grand effacement des mémoires et des transmissions : il s’agit de ne garder que des religions sans culture, des langues sans culture, des « peuples » muséifiés sans culture, des décors de théâtre sans culture (voir ce que sont devenues les villes « d’art et d’histoire », et écoutons ce que dit Nicolas Bonnal de Tolède). Il s’agit d’être fluide. Soluble comme du café soluble.

Le libéralisme et la fin des identités collectives
Nous ne vivons pas la fin des identités au sens où tout doit être bagué, pucé, numérisé : .nous-mêmes, les animaux, le vivant, et même l’inerte. Mais nous vivons le travestissement des identités car leur fichage les réduit à de l’identité morte. C’est le grand référencement de tout. Dans la logique du libéralisme, c’est justement parce que tout est susceptible de changer, d’être changé, ce qui n’était pas le cas au temps de Carl von Linné, que tout doit être référencé, pour que ces changements soient tous contrôlés. On identifie par une référence ce qui n’a plus d’identité indiscutable.
L’identité humaine au sens d’Aristote et de Hannah Arendt, c’est-à-dire l’homme comme animal social et politique, est donc effacée et remplacée par des identités attribuées par le libéralisme ultime, qui devient un totalitarisme extrême. La raison en est que le libéralisme veut désormais produire (ou construire) l’homme conforme à sa théorie. Or, la théorie libérale suppose l’homme interchangeable. C’est pourquoi il ne faut lui laisser comme identité que son identité numérique, permettant de le contrôler, de l’asservir, de lui donner, via par exemple le revenu universel, des droits sous contrôle, une citoyenneté « à points », en fonction de son degré d’alignement sur le modèle désormais « normal »: la fluidité identitaire dans laquelle la notion de vrai, d’authentique, de juste et d’injuste a perdu toute signification. Ce que vise le libéralisme, c‘est la réversibilité de tout par la fluidité identitaire. Ce qui veut dire qu’un homme pourrait devenir une femme, un blanc devenir un noir, et réciproquement, ou n’être ni l’un ni l’autre. Fluidité identitaire et, en même temps, « dictature des identités » comme dit Alain Finkielkraut, au sens où les identités sont ramenées à « être blanc », ou « être femme », ou « être une lesbienne ». Assomption de micro-identités hystériques qui se traduit par la revendication de réunions non mixtes (sans blancs, ou sans hommes, etc), par le wokisme, véritable religion de substitution (comme quoi nous sommes toujours dans l’âge du théologico-politique), c’est-à-dire sur-attention délirante à tout ce qui serait discrimination, y compris dans le simple fait de nommer les choses comme elles sont ou les gens tels qu’ils sont. Hypersensibilité généralisée à toutes les différences qui pourraient exclure. « La surenchère perpétuelle transforme le souci des victimes en une injonction totalitaire, une inquisition permanente », disait René Girard. Il s’agit de savoir qui est le plus à plaindre : c’est la compétition victimaire de tous contre tous.
Surenchère victimaire et suppression des différences
Pour éviter toute « discrimination » (devenu un mot-valise), se fait jour l’idée qu’il faut une égalité parfaite entre tout et tous. Alain Finkielkraut note : « L’individu démocratique, érigeant l'égalité comme finalité de l’action politique, non seulement ne supporte plus l’inégalité, mais considère la moindre différence comme une offense. Même si l’égalité semble réalisée, l’apparence d’une inégalité injurie en quelque sorte la conscience collective. Ainsi, il n’est plus question de veiller au respect de l’égalité, mais de scruter ce qui pourrait représenter une esquisse de divergence, jugée forcément discriminante » (Conversations Tocqueville, 17-18 septembre 2021). Ce wokisme est dans le droit fil de la cancel culture, qui est la liquidation de tout ce qui liait la culture à des transmissions.
Les identités deviennent à la fois choisies, transitoires, transparentes (pas question de ne pas faire son « outing ») et surdéterminantes. Choisies : ce ne sont pas les plus fragiles des identités. Mais à condition de ne pas changer tout le temps de choix. A condition que ce choix soit un vrai engagement. On se construit et on se choisit : c’est exact, mais ce n’est pas à partir de rien. Le nihilisme contemporain réside en cela : dire que l’on construit à partir de rien. Alors, il y a l’hypertrophie d’identités factices. Identités réduites à celles de « racisés » dans le jargon des wokistes, tristes identités numériques pour ceux qui n’existent qu’en fonction des réseaux sociaux.

Déconstruction des identités nationales mais assignations aux identités de genre ou de race
Prenons conscience de ce paradoxe : au moment où la notion d’identité est déconstruite, devient réversible et sans héritage et à multiples options (raciales, sexuelles, etc), cette notion d’identité renait sous la forme d’une assignation identitaire d’une pauvreté existentielle difficilement imaginable. Un noir est ainsi censé s’identifier à un descendant d’esclaves, en oubliant que bien des esclavagistes ont aussi été noirs. Plus encore, des réunions non « mixtes » sont censées être nécessaires pour éviter tout regard infériorisant, toute discrimination, en oubliant que même entre noirs, même entre gays, même entre lesbiennes, la crainte des différences pourra toujours trouver à s’alimenter : pourront être hiérarchisantes les différences de physique (les plus ou moins beaux, les plus ou moins gros), de mental (les plus ou moins intelligents), de milieu social (les plus ou moins aisés), etc.
Le processus de non « mixité » pour éviter les sentiments d’infériorité est donc sans fin et ne peut aboutir qu’au solipsisme, seule solution pour éviter le regard des autres. La cancel culture (culture de l’annulation de tous les héritages culturels) et le wokisme (suspicion paranoïaque visant toutes les différences susceptibles d’être des supériorités) s’apparentent donc à une « destruction de la raison » (Georg Lukacs), ou, au moins, à une « éclipse de la raison » (Max Horkheimer), en allant encore plus loin que l’irrationalisme des années 1920 et 30. C’est une intolérance à l’intelligence qui est promue et devient obligatoire, afin de tout aligner par le bas. Intolérance à l’intelligence dont le revers est une tolérance infinie à la bêtise. « La tolérance attiendra un tel niveau que l’on interdira aux personnes intelligentes d’émettre des réflexions pour ne pas offenser les imbéciles », dit Mikhaïl Boulgakov. Nous en sommes là. C’est pourquoi il est temps de redonner ses droits à la raison, rien que sa place, mais toute sa place.

Lutter pour les libertés
Se libérer de la sidération totalitaire
C’est pourquoi la lutte pour les libertés supprimées par le pouvoir au nom de l’idéologie covidiste (qui est : il n’y a pas d’autre alternative face au virus, indéfiniment vigoureux et mutant, que le « vaccin » et les mesures coercitives comme le confinement, le couvre-feu, le passe, le masque, la revaccination perpétuelle) et demain au nom d’autres idéologie, comme le « réchauffisme » ou le « dérèglement » climatique (comme si la nature avait jamais obéi à un quelconque « règlement ») est la condition première de la survie mentale et morale de notre peuple.
Car il s’agit bien pour le pouvoir totalitaire du libéralisme ultime de nous précipiter dans le puit sans fond de la non-pensée, du non-esprit, de la fin de la littérature écrite, de la numérisation de tout. De nous précipiter dans le nihilisme. Car tuer l’humain n’empêche pas, bien au contraire, la marchandisation de toute la terre. C’est même ce qui la facilite. Dans le monde du libéralisme terminal, l’individu tout comme le collectif sont morts. C’est le libéralisme de la dernière marche.
La tyrannie vaccinale est au bout de tout un travail de sidération mentale, en filiation directe, mais en plus sophistiquée, d’Edward Bernays, fondateur de la propagande moderne dés 1916, sidération qui laisse chacun seul face à l’Etat (Etat à la fois tyran et nounou abusive : Big mother) et face aux GAFAM.
Faire face au désarmement de nos âmes
Bilan : après le « désenchantement du monde » (Max Weber), le désarmement de l’âme de l’homme. Allan Bloom parlait de « L’âme désarmée » dans un « essai sur le déclin de la culture générale », sous-titre qui vaut la peine d’être cité car il indique bien comment la sidération progresse : par l’inculture, aujourd’hui par l’oubli de ce que le covid est l’un des moins graves des virus ayant existé, de ce que le climat a tout le temps changé, ce qui n’exclut pas une influence humaine, mais devrait amener à être attentif à d’autres facteurs (relire Emmanuel Leroy-Ladurie sur l’histoire des changements climatiques, de l’optimum médiéval à la sécheresse meurtrière de 1911).
Sous le flux de trop d’informations et de fausses informations, l’intelligence humaine est tétanisée, et les débats sereins deviennent impossibles par diabolisation des pensées dissidentes. Au bout du compte : le repli sur soi de chacun, l’enfermement dans sa bulle. « Ce ne sont pas des communautés rassemblant des individus, mais des clans composés de particules de foule. On n'y trouve pas des semblables, mais des hologrammes, pas de différences mais des doublons, pas d'altérité, mais de la mêmeté », écrivent Ruben Rabinovitch et Renaud Large (Le Figaro, 18 septembre 2021). On ne peut mieux dire.
Refuser le règne des âmes froides, affirmer la chaleur des liens
Notre avenir vu par l’oligarchie, c’est un monde entièrement digitalisé. Des âmes froides et mortes. « La véritable fin du monde est l’anéantissement de l’esprit », disait Karl Kraus. C’est la question essentielle : si l’homme est robotisé comme nos maitres le souhaitent, il n’y aura plus aucune lutte possible, ni contre le grand remplacement (démographique), ni contre le grand effacement (de notre histoire). Pas non plus de lutte contre la grande expropriation, celle des classes moyennes. Le libéralisme aura tout horizontalisé. Les pays bas pour tous.
PLV
Derniers livres de l’auteur : Eparpillé façon puzzle. Macron contre le peuple et les libertés (Libres, 2022), La planète des philosophes (Dualpha, 2022), Métamorphoses de la ville (La barque d’or, 2021).
http://la-barque-d-or.centerblog.net


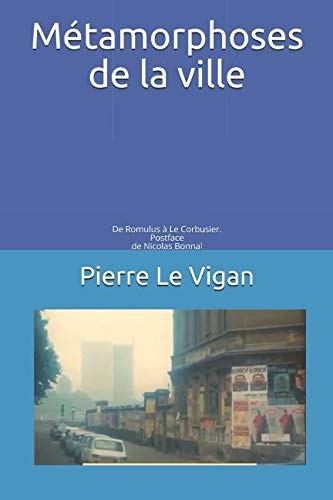
17:53 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre le vigan, philosophie, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 11 avril 2023
Diego Fusaro: Pourquoi le capital aspire-t-il à détruire l'école?

Pourquoi le capital aspire-t-il à détruire l'école?
Diego Fusaro
Source: http://adaraga.com/por-que-el-capital-aspira-a-destruir-la-escuela/
La pédagogie néolibérale dégrade l'école en tant qu'entreprise destinée à produire des compétences adéquates pour le fonctionnement du système. Elle célèbre donc le stockage des compétences et la primauté de l'action: elle dissout toute figure de la connaissance non liée au pragmatisme de l'efficacité.
C'est ainsi que triomphe sur tout l'horizon ce que l'on pourrait définir comme une "culture barbare", pour reprendre l'image de Veblen dans la Théorie de la classe oisive : une culture qui non seulement ne favorise pas l'émancipation de la société, mais qui la pousse dans la direction opposée, en réprimant tout désir possible d'échapper à la cage d'acier du monde réduit à la marchandise. Les anciens régimes brûlaient les livres : l'actuel, sous forme de marchandise, rend structurellement impossible la figure du lecteur.
Dans le triomphe de l'esprit de quantité sur l'esprit de finesse, le capital ne peut accepter l'existence d'esprits pensants autonomes, de sujets éduqués, dotés d'une identité culturelle et d'une profondeur critique, conscients de leurs racines et de la fausseté du présent. En d'autres termes, il ne peut accepter le profil bourgeois antérieur de l'homme éduqué, enraciné dans sa culture historique et ouvert à l'avenir dans la planification.
Elle aspire au contraire à voir partout les mêmes, c'est-à-dire des atomes consommateurs sans identité et sans culture, de pures têtes calculatrices et irréfléchies, capables de ne parler que l'anglais des marchés et de la finance et incapables de remettre en cause l'appareil technico-économique dans sa totalité expressive.

C'est dans ce même cadre cognitif qu'il faut insérer le phénomène des soi-disant "universités numériques", qui offrent à leurs étudiants des cours à distance et des diplômes obtenus sans jamais avoir mis les pieds dans les espaces concrets de l'université comme lieu de discussion et de comparaison, de dialogue et d'exercice de la critique.
La nouvelle figure numérique, de ce point de vue, favorise les processus d'individualisation de masse, en neutralisant l'élément de confrontation humaine et de concentration des étudiants dans les mêmes lieux et, dans l'ensemble, en réduisant de plus en plus la connaissance à des modules pré-packagés administrés à distance, sans aucune relation humaine avec l'enseignant.
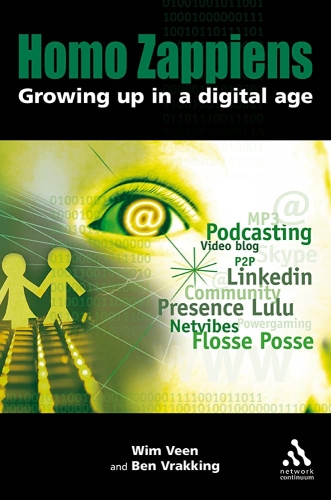
C'est ce qu'ont théorisé, entre autres, Veen et Vrakking dans leur étude Homo zappiens : leur proposition théorique se concentre sur l'idée de rompre avec les formes pédagogiques traditionnelles et, selon eux, obsolètes, et d'adapter les lieux d'enseignement aux besoins de la génération du net. Internet et son modèle doivent donc remplacer les leçons frontales classiques avec lesquelles l'Occident a transmis le savoir doré de l'époque grecque au Moyen-Âge, de la Renaissance au 20ème siècle.
Au cours des vingt dernières années, l'école en Europe a été soumise à une dynamique radicale de corporatisation, qui l'a rapidement reconfigurée dans ses fondements mêmes.
D'un institut de formation d'êtres humains au sens plein, conscients de leur monde historique et de leur histoire, elle s'est transformée en une entreprise fournissant des aptitudes et des compétences inextricablement liées au dogme utilitaire du "servir à quelque chose".
Le phénomène de la "dette étudiante" qui caractérise les campus universitaires libéraux américains et la privatisation totale de la culture sont significatifs à cet égard. Les universités publiques et privées ne cessent d'augmenter les frais de scolarité, obligeant de fait les étudiants à s'endetter pour y accéder : ainsi, non seulement les universités sont transformées en avant-postes de la valorisation de la valeur et en usines à profit, animées par le désir d'avoir plus, désir célébré par le Second traité de gouvernement de Locke, mais les étudiants eux-mêmes se retrouvent prisonniers des mécanismes de captation de la dette. Ils deviennent, dès leur plus jeune âge, les esclaves d'une dette qu'ils tenteront (le plus souvent sans succès) de rembourser tout au long de leur existence.

Dans le passage de l'Académie platonicienne et du Lycée aristotélicien aux écoles de commerce, on pourrait en effet diagnostiquer la parabole de l'Occident, à la merci du pathologique "pan-économisme utilitariste" théorisé par Latouche.
De l'éducation comprise au sens classique comme le développement complet et multiforme de la personnalité humaine, nous sommes passés sans effort à la formation comme accumulation intensive de compétences techniques et pratiques, fonctionnelles pour l'insertion dans le marché du travail instable, flexible et précaire.
Il en résulte une perversion du concept classique de l'école en tant que lieu où le temps est soustrait à l'emprise du profit et consacré à l'apprentissage en vue de la formation de soi.
À cet égard, il est utile de rappeler que les langues européennes appellent "école" (Schule, school, escuela) l'institution de formation primaire des jeunes, en référence directe au σχολή des Grecs, c'est-à-dire au temps libre, que les Romains définiront comme otium, et l'otium est, par essence, le contraire du negotium, qui est le temps occupé par l'entreprise au nom du profit. Le paradoxe de l'école à l'ère du capitalisme post-bourgeois est qu'elle se convertit de plus en plus ouvertement au principe du negotium, devenant une institution de préparation aux pratiques de travail et niant ainsi sa propre essence d'otium.
Même dans le cas de l'enseignement scolaire et universitaire, la règle générale du système chrématistique flexible et précaire s'applique : la corporatisation du monde de la vie se déroule en même temps que la dés-éthicisation du monde de la vie. La marchandisation intégrale repose sur la destruction des contraintes éthiques antérieures de la phase bourgeoise et sur l'apogée de l'individualisme consumériste.
L'introduction de la rationalité libérale dans la structure la plus profonde de la personnalité détermine l'occupation intégrale du matériel et de l'immatériel par la forme marchandise et son modèle calculateur et économiste corrélatif : ce paradigme imprègne intégralement le moi, mais aussi l'ego, la sphère magmatique et insaisissable des instincts et des pulsions ; il n'épargne pas non plus le surmoi, envahissant même le champ des questions morales et religieuses. C'est là que se situe ce que l'on a appelé la "néolibéralisation des sujets".
La pulvérisation de l'éthique et de ses racines va de pair avec la réoccupation de ses espaces par le système des besoins et la forme marchande. Cela se voit non seulement dans la redéfinition corporative des écoles publiques dans le cadre de l'ordre néolibéral, mais aussi dans la privatisation d'autres instituts éthiques fondamentaux tels que les systèmes pénitentiaire et hospitalier.
En ce qui concerne le premier, la monarchie du dollar est, dans ce cas également, à l'avant-garde du processus de post-modernisation : la privatisation du système pénitentiaire dans ce pays expose les prisonniers à un contrôle vexatoire, souvent clairement éloigné de la réglementation juridique et politique.

Les coups brutaux et la malnutrition visible sont la règle et, dans l'ensemble, la mise en œuvre nécessaire du principe "business is business" : selon ce principe, le prisonnier cesse d'être considéré comme une personne à rééduquer et à réhabiliter, en vue de sa réinsertion dans la société civile, et commence à être considéré comme une ressource dont on peut extraire la plus-value.
Cela se traduit par la recherche spasmodique de nouvelles "ressources" à interner (pour qu'il n'y ait plus de places vides) et, par conséquent, par de nouvelles politiques répressives, y compris en ce qui concerne les soi-disant "délits mineurs".
En ce qui concerne le secteur de la santé, le régime libéral promeut, à son image, une "marchandisation" de plus en plus accentuée de la santé et de la vie. Cela permet d'affirmer que les soins de santé sont profondément malades : le soin, dans son acception spécifiquement scientifique (l'éradication de la maladie) et humaniste ("Sorge" comme modalité existentielle fondamentale, comme le suggère l'Être et le Temps), est remplacé par la figure corporative du profit comme finalité ultime de l'action.
La redéfinition libérale du paradigme médical produit des effets désastreux et hautement contradictoires, qui dépendent en fin de compte de la reconfiguration (toujours dans le sillage du modèle américain) de la santé, qui passe d'un droit du citoyen à un bien de consommation. Parmi les effets les plus regrettables, on peut citer la réduction drastique du personnel médical et infirmier, avec pour corollaire un ralentissement des délais d'intervention et un risque accru de mortalité pour les patients, devenus entre-temps des "consommateurs". Il ne faut pas non plus oublier que les crédits alloués à des maladies telles que le cancer et la réduction considérable des soins aux personnes handicapées et aux malades mentaux sont de plus en plus réduits.
Dans le second contexte, il est soutenu par l'émergence de la nouvelle figure de l'"entreprise de santé", qui remplace les anciens "hôpitaux" publics : plus généralement, le droit aux soins universellement reconnu pour chaque citoyen devient une marchandise disponible en fonction de la valeur d'échange, avec pour conséquence une croissance exponentielle à la fois dans le secteur de la santé de luxe de la chirurgie esthétique pour quelques-uns, et dans l'impossibilité, pour beaucoup, d'accéder à des traitements de base.
Diego Fusaro
Diego Fusaro (Turin, 1983) est professeur d'histoire de la philosophie à l'IASSP de Milan (Institute for Advanced Strategic and Political Studies) où il est également directeur scientifique. Il a obtenu son doctorat en philosophie de l'histoire à l'université Vita-Salute San Raffaele de Milan. Fusaro est un disciple du penseur marxiste italien Costanzo Preve et du célèbre Gianni Vattimo. Il est spécialiste de la philosophie de l'histoire, notamment de la pensée de Fichte, Hegel et Marx. Il s'intéresse à l'idéalisme allemand, à ses précurseurs (Spinoza) et à ses successeurs (Marx), avec un accent particulier sur la pensée italienne (Gramsci ou Gentile, entre autres). Il est éditorialiste pour La Stampa et Il Fatto Quotidiano. Il se définit comme un "disciple indépendant de Hegel et de Marx".
16:41 Publié dans Actualité, Ecole/Education, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, école, éducation, philosophie, économisme, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 06 avril 2023
Des héros et des saints

Des héros et des saints
par Pierre-Emile Blairon
Certains vont trouver incongru qu’un article traite de deux grandes figures humaines telles que notre civilisation « occidentale » n’en a plus engendrées depuis bien longtemps du fait de son pourrissement qui atteint de nos jours son apogée.
Ces deux personnages d’exception sont morts un mois de Mars ; on pourra toujours dire que c’est un hasard mais il s’agit de deux hommes qui avaient choisi le métier des armes ; c’est au mois qui porte son nom que le dieu de la guerre a choisi de les rappeler à lui ; aucun de ces deux militaires n’aurait voulu être placé sous sa tutelle : ils étaient l’un et l’autre profondément chrétiens ; l’un et l’autre sont morts en combattant contre un ennemi islamiste, en voulant préserver des Français d’un ennemi islamiste, même si l’un des deux est mort sous des balles françaises. Ils avaient encore un point commun : ils étaient tous deux colonels.
Ils s’appelaient Arnaud Beltrame et Jean-Marie Bastien-Thiry ; L’un a placé sa foi avant son devoir ; l’autre a placé son devoir avant sa foi. Lequel est le saint et lequel est le héros ?
Tout être humain vient sur Terre pour accomplir une mission ou, au moins, pour tenir un rôle qui dépasse la simple survie, dans ce grand théâtre de la vie ; dans la majorité des cas, il ne le sait pas ; chacun a un poste qui lui est dévolu et qu’il doit assumer ; le fait d’en être conscient expose l’individu plus lucide que les autres à une plus grande responsabilité et, souvent, à une plus grande souffrance. Le héros et le saint sont des êtres humains qui se distinguent des autres par leur sens de l’abnégation, du sacrifice, du dévouement. « Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer » : la devise de Guillaume d’Orange, qui évoque le sens du devoir, s’adapte fort bien à cette conduite, qui définit l’excellence de la condition humaine[1].
Les caractères du saint et du héros sont, sous certains aspects, très proches.

Le héros
Le héros ne se réfère habituellement pas à sa foi si tant est qu’il en ait une ; il se retrouve essentiellement dans la fonction guerrière ; le héros agit par devoir, parce qu’il possède au plus haut point le sens de la responsabilité, de l’honneur et du respect de la parole donnée ; il applique à la lettre les règles de chevalerie telles qu’elles ont été codifiées au Moyen-âge mais découvertes et respectées bien avant cette période dans toutes les sociétés traditionnelles[2]. Le héros est avant tout un aristocrate, ce mot pris dans son sens spirituel : noblesse des sentiments et des actions. Il est prêt à se sacrifier pour la cause qu’il défend si ce sacrifice est nécessaire à cette cause. Selon l’encyclopédie Universalis, « le héros se met au service d'une cause qui le dépasse et l'entraîne à se dépasser lui-même. Il se distingue par la force d’âme, c'est-à-dire l'énergie du caractère, mais aussi la grandeur, la noblesse dans le choix des visées. »
Les héros peuvent agir seuls ou en groupe. Seuls, ils sont légion, à commencer par les héros de l’Antiquité jusqu’à nos jours ; en groupe, on se souvient des volontaires parachutistes qui ont sauté sur Dien-Bien-Phu alors qu’ils savaient que tout était perdu et de la geste magnifique à Camerone de la Légion étrangère dont la devise est : honneur et fidélité.
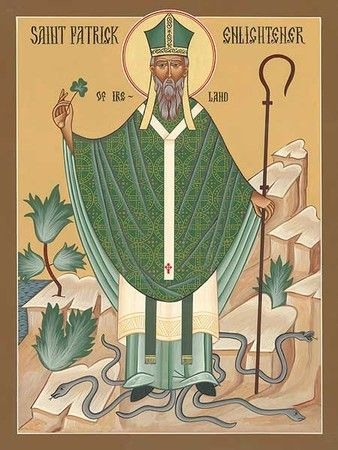
Le saint
Il faut revenir aux origines du christianisme pour comprendre que la démarche du saint va à l’inverse de celle du héros ; le saint ne se sacrifie pas pour sa foi et pour ses semblables en dernière extrémité, quand il ne reste plus d’autre solution ; au contraire, il recherche d’abord ce sacrifice pour accéder à la plénitude spirituelle ; les premiers saints ont été des martyrs et c’est ce martyre qui les a sanctifiés, puis c’est l’Eglise qui a légitimé cette sanctification ; le chrétien aspire à la rédemption en imitant le martyre du Christ ; en l’absence de véritable bourreau, c’est lui-même qui s’infligera des souffrances dans ce but. Par exemple, le port du cilice (tunique d’étoffe rude) ou de chaînes, couplé souvent avec une abstinence (le jeûne par exemple) permet mortification et pénitence.
Les deux personnages qui nous intéressent procédaient de l’une et de l’autre catégorie, à des degrés divers, selon la sensibilité de chacun, l’archétype de ce comportement, profondément ancré dans la légende française, restant Jeanne d’Arc.

Jean-Marie Bastien-Thiry
Le colonel Bastien-Thiry (10 octobre 1927-11 mars 1963) était l’héritier d’une très longue (trois cents ans) lignée de tradition militaire ; polytechnicien, il deviendra ingénieur militaire en chef de l’Air ; il aura conçu notamment le missile sol-sol SS.10 et 11. Marié, il a eu trois filles de Geneviève Lamirand ; il aura été le dernier condamné à mort fusillé en France à l’âge de 35 ans pour avoir organisé un attentat contre le chef de l’État sans faire de victimes ; De Gaulle créera une juridiction spéciale à sa botte, totalement illégale, dans le seul but de faire condamner à mort celui qui aura osé attenter à sa vie.
Nous n’allons pas refaire ici l’histoire de la guerre d’Algérie dont l’issue dramatique et les centaines de milliers de morts, souvent dans des conditions épouvantables, ont été causés uniquement par l’attitude déloyale de De Gaulle que les Pieds-Noirs avaient installé au pouvoir, croyant qu’il serait à même de combattre l’insurrection islamiste, dénommée FLN, parti à ce point minoritaire qu’il ne comptait prendre le pouvoir qu’en exerçant une terreur sans nom sur la grande majorité des musulmans fidèles à la France et sur le million d’Européens d’Algérie ; ces derniers, pour la plupart modestes travailleurs, vivaient chichement, mais heureux, sur une terre qu’ils avaient péniblement valorisée pendant les 130 années de leur présence et qu’ils aimaient passionnément. On pourra se reporter utilement au reportage en note ci-dessous[3].
L’engagement de Jean-Marie Bastien-Thiry contre le général De Gaulle tient à la personnalité de ce dernier et à ses revirements brutaux. De Gaulle se révèle rassembler tous les éléments de caractère qui vont exactement à l’encontre de toutes les valeurs dans lesquelles a été élevé Bastien-Thiry, pour lesquelles il s’est toujours battu et qui forment exactement le corpus du héros tel que nous l’avons défini plus haut.
Les Américains se sont intéressés très tôt à la guerre d’Algérie ; ils ne supportaient pas l’indécision constante des hommes politiques de la quatrième République française qui les empêchait, dans cette « zone », de mener à bien leur projet de remodelage permanent du monde à leur profit, qui est leur marque de fabrique. Ont-ils manœuvré pour placer à la tête de la France un homme « de poigne » qui correspondrait plus à leurs intérêts [4] ? De Gaulle savait-il déjà, à son accession au pouvoir, qu’il ne garderait pas l’Algérie à la France ?
De Gaulle montra, dans cette affaire algérienne, au fil des mois, son véritable visage : un homme imbu de sa personne, fourbe, machiavélique, menteur cynique et imposteur, plein de mépris pour ce petit peuple pied-noir qui l’avait porté au pouvoir, sans aucune empathie pour tous ces braves musulmans qui avaient cru en lui qui représentait la France, et qui allaient mourir par sa faute par dizaines de milliers dans des conditions atroces[5].
Il semble logique qu’un homme comme Bastien-Thiry ait tenté de supprimer un tel monstre. Le colonel Bastien-Thiry mourra comme un brave, dans la dignité, consacrant ses derniers moments au rituel de sa foi ; les témoins qui ont assisté à ses derniers instants ont laissé des pages bouleversantes[6].

L’exécution du dernier des justes de cette guerre qui ne voulut pas dire son nom ne souleva pas la moindre indignation des Français qui n’étaient plus concernés par le destin de leur pays, bien contents de s’être débarrassés de cette France pourtant pas si lointaine et de ceux qui l’habitaient ; d’une pierre, deux coups. Dans bien des cas, Ils accueillirent ces gens qui regagnaient ce qu’ils croyaient être la Mère patrie et qui se prétendaient Français - c’est-à-dire comme eux, quelle arrogance ! - avec une méchanceté qui n’eut d’égale que leur profonde bêtise.

Arnaud Beltrame
Le colonel Arnaud Beltrame (18 avril 1973-23 mars 2018). Il affirme sa vocation des armes en intégrant le lycée militaire de saint-Cyr-l’Ecole à l’âge de 18 ans.
Sa carrière le mènera au grade de lieutenant-colonel alors qu’il est confronté le 23 mars 2018 à une prise d’otages au Supermarché U de Trèbes, près de Carcassonne. Selon Gendinfo, l’organe de presse de la gendarmerie nationale, daté du 23 mars 2023, « Ce jour-là, alors officier adjoint commandement du groupement de gendarmerie départementale de l’Aude, ce dernier se projette sur les lieux afin de coordonner les opérations. Faisant preuve d’un sang-froid exceptionnel, il se substitue au dernier otage retenu dans le supermarché, permettant ainsi sa libération, avant d’être abattu de plusieurs balles par le terroriste. » C’est une version édulcorée des faits et un mensonge par omission. Selon La Dépêche du 25 mars 2018, « L’autopsie réalisée sur le corps d’Arnaud Beltrame a révélé "une plaie gravissime de la trachée et du larynx par arme blanche", qui a causé la mort du gendarme et des lésions par balles non létales. Son assassin, Radouane Lakdim, le djihadiste âgé de 25 ans auteur des attentats mortels de Trèbes, l’a donc poignardé avant de lui tirer dessus. »
Qu’est-ce qui a poussé Beltrame à se constituer prisonnier auprès du preneur d’otages ? Est-ce le rôle d’un officier de gendarmerie chargé de diriger une opération anti-terroriste ? N’a-t-il pas, de ce fait, mis en danger la vie de plusieurs personnes, en plus de celles des otages, se neutralisant lui-même volontairement au lieu de neutraliser l’islamiste ? Certaines voix se sont élevées alors pour dénoncer son attitude et l’unanimisme politico-médiatique qui en faisait un héros [7].
Quelques faits majeurs qui ont ponctué sa vie quelques temps avant son sacrifice peuvent être troublants, sans que nous puissions en conclure quelque motivation à son acte.
- Selon le prêtre qui devait le marier religieusement à sa femme Marielle (après le mariage civil), Beltrame était un nouveau converti au catholicisme à l’âge de 33 ans ( Le Figaro du 25 mars 2018).
- Dix ans auparavant, il devenait franc-maçon de la Grande Loge de France, élevé au grade de maître en avril 2012. Il n’avait pas rompu avec ses attaches maçonniques au moment de sa mort.
- Une semaine avant sa mort, il avait enterré son père, dont le corps avait été retrouvé dans un filet de pêche après son suicide. Il s’était jeté de son bateau au large de Port-Camargue.
De tout ce qu’il ressort, nous pouvons dire qu’Arnaud Beltrame pourrait être considéré comme un saint, tel que nous l’avons défini plus haut, plus que comme un héros ; il appartient donc à l’Église d’accréditer cette hypothèse.
Revenons sur cette curieuse omission concernant les circonstances dans lesquelles Beltrame fut occis : « une plaie gravissime de la trachée et du larynx par arme blanche » ; cette description n’est rien d’autre qu’un euphémisme alambiqué pour égorgement, perpétré en l’occurrence à l’aide d’un couteau de chasse ; cet euphémisme soi-disant pour ne pas se faire complice de l’un des buts recherchés par les terroristes qui est de marquer les opinions.
Occulter les actes de barbarie des terroristes ne revient-il pas à leur accorder des circonstances atténuantes ? Cette hypothèse est aggravée par le fait que, sur la plaque commémorative dédiée à Arnaud Beltrame dans le jardin qui porte son nom à Paris, est gravée cette expression pour le moins ambiguë : « Victime de son héroïsme ». Ne pas désigner l’ennemi ne revient-il pas à avouer son impuissance ?

Les Français ont-ils voulu en savoir plus ? Surtout pas ; comme dans le cas de la condamnation à mort de Bastien-Thiry, ils n’ont rien fait d’autre que de rester précautionneusement dans leur zone de confort et même grâce à l’action de ces deux êtres extraordinaires, s’acheter à bas prix une bonne conscience ; en quelque sorte, nous revenons au domaine religieux pour envisager la place que ces deux hommes ont tenu dans l’esprit des Français décadents : celle de bouc émissaire.
Du psychopathe De Gaulle au psychopathe Macron, de renoncement en renoncement, de lâcheté en lâcheté, les Français, repliés dans leur égoïsme forcené – après moi, le déluge -, continueront imperturbablement à voter pour des Présidents de plus en plus lamentables à chaque élection jusqu’au désastre actuel. Impossible n’est pas français, dit le dicton. On dit aussi que celui qui représente une nation est à l’image du peuple qu’il dirige. A moins d’un miracle, nous sommes assurés que le « génie » français saura, la prochaine fois, nous dénicher un Président encore plus catastrophique que celui actuellement en place.
L’ère des héros et des saints semble bien révolue. C’est le peuple français lui-même qui a décidé de leur disparition.
Pierre-Emile Blairon
Notes:
[1]. Cette devise est à rapprocher de celle de la franc-maçonnerie : Fais ce que dois, advienne que pourra ; nous verrons que ce rapprochement a son utilité en ce qui concerne le personnage d’Arnaud Beltrame.
[2]. Voir l’article Evola et la Tradition primordiale : une autre vision de l’Histoire sur ce même site.
[3]. https://www.lesalonbeige.fr/60e-anniversaire-de-lexecution-de-jean-bastien-thiry/
[4]. https://algeria-watch.org/?p=62483
[5]. http://www.psy-luxeuil.fr/2015/04/8-signes-pour-detecter-....
A la lecture de ce portrait, on peut penser à celui d’un autre Président de la République, tout aussi psychopathe, mais qui adopte un style bien différent, plus moderne, plus décadent.
[6]. https://www.bastien-thiry.fr/-Temoignages-
[7]. https://archive.org/details/youtube-DrK_HH8Az-Y
20:07 Publié dans Définitions, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-marie bastien-thierry, arnaud beltrame, héros, saints, héroïsme, sainteté, définitions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pasolini, Salo et l'incompréhension de la violence
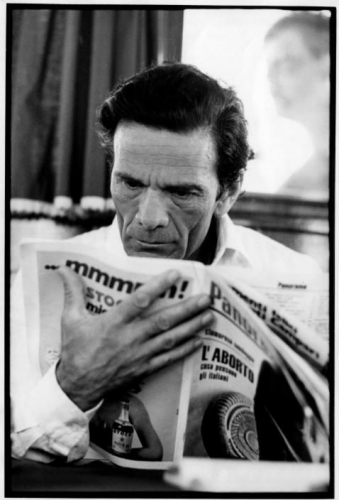
Pasolini, Salo et l'incompréhension de la violence
par Michele
Source: https://www.bloccostudentesco.org/2023/02/16/bs-pasolini-salo-e-l-incomprensione-della-violenza/
S'il est un intellectuel bon pour toutes les saisons, c'est bien Pier Paolo Pasolini. De tous et d'aucun, le Frioulan est un cas étrange de convenance irrégulière. Une somme de contradictions jamais résolues le rend attirant pour la plupart, mais sans le confiner dans un seul domaine. Pour certains, il va de soi qu'il appartient à une gauche idéale, au mouvement étudiant de 68 et aux manies de la liberté sexuelle. Le type parfait de l'intellectuel engagé avec ses fragments de critique sociale et son regard penché sur le dernier en date (qui n'est pourtant jamais le dernier). Au contraire, il y a ceux qui voudraient l'enrôler dans une sorte de droite souterraine et éternelle, prenant ses coups de gueule contre la société comme l'expression d'une authentique pensée antimoderne, soulignant son "catholicisme intime, profond, archaïque", et s'accrochant à chacun de ses mots lorsqu'il fait dire à un Orson Wells dans La ricotta, jouant presque le rôle de son alter ego et citant des lignes de Mamma Roma : "Je suis une force du passé. Mon amour n'est que dans la tradition".
Paradoxalement, le réactionnaire Pasolini est aimé pour la même raison que le progressiste. C'est finalement son provincialisme qui domine, c'est le sentiment de perte face à un monde rural et populaire fait de petites choses qui ne suit pas la marche de la modernité. Cela est vrai aussi bien si l'on considère cette dernière comme un mal du capital que comme une perversion des derniers temps.
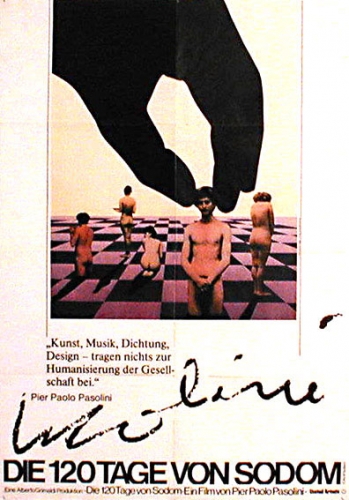
Et puis il y a le scandaleux Pasolini, ce qui le rend d'autant plus controversé et apparemment isolé qu'il est apprécié rétrospectivement. C'est le scandale de ses vexations profanatrices et de sa sexualité vécue presque comme une descente dans l'obscurité (pas tant que ça et pas seulement à cause de son homosexualité). Mais c'est aussi le scandale de certaines de ses prises de position, comme celle, célèbre, du poème Valle Giulia, où il défend les forces de l'ordre "parce que les policiers sont des enfants de pauvres" et reproche aux manifestants de n'être que des "enfants à papa". Cela témoigne d'ailleurs d'une ambivalence et d'une inconséquence généralisées de l'intelligentsia italienne à l'égard des angoisses révolutionnaires, comme en témoigne la Storia di un impiegato de De Andrè ("Pour ce que vous avez fait/Pour la façon dont vous l'avez renouvelé/Le pouvoir vous est reconnaissant", c'est ainsi que le jury s'exprime à l'égard du Bombarolo dans Sogno numero due).
En effet, le scandale est une dimension qu'il recherche consciemment : "Je pense que scandaliser est un droit, être scandalisé un plaisir. Celui qui refuse le plaisir d'être scandalisé est un moraliste, c'est le soi-disant moraliste". Et si l'on parle de scandale, le dernier film de Pasolini ne peut que venir à l'esprit : Salò ou les 120 jours de Sodome.
Le film a connu une histoire mouvementée: vol des bobines pendant la production, accusations d'obscénité, et surtout la mort de Pasolini lui-même peu avant la sortie du film. Basé sur le roman inachevé du Marquis de Sade intitulé Les 120 journées de Sodome, le film est probablement connu de la plupart des spectateurs comme une sorte de film maudit, difficile à regarder et à digérer, une épreuve de courage pour les plus sensibles, moins pour son contenu. Le principe: quatre personnages représentant grosso modo le pouvoir politique, religieux et judiciaire s'entendent pour donner libre cours à leurs vices et dépravations, kidnappent un nombre suffisant de jeunes hommes et de jeunes femmes, se réunissent dans un lieu caché et, inspirés par les récits scabreux de quatre narratrices, donnent libre cours à leurs perversions en violant leurs victimes.
Dans Sade, c'est une structure rigoureuse, géométrique, presque redondante, qui prévaut, où la trame du roman alterne avec les nombreux récits des narrateurs, d'abord avec une prose riche et surabondante, puis avec une énumération presque mécanique dans les parties restées inachevées par l'écrivain. Pasolini s'appuie plutôt sur une division dantesque en Antinferno, Girone delle manie, Girone della merda, et enfin Girone del sangue. Mais le changement le plus important concerne le décor: pour Sade, il s'agit d'un château dans la forêt à l'époque de Louis XIV, tandis que pour Pasolini, il s'agit de la République sociale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela confère au film un sous-texte politique particulier, ouvertement antifasciste. C'est là que réside toute l'incompréhension de Pasolini à l'égard de Sade, du fascisme et de la violence.

Avec l'œuvre de Sade en tête, celle de Pasolini semble être l'œuvre d'une écolière. Mais cette descente aux enfers ne se résume pas à une différence de degré. Il n'y a pas le ton intellectualiste de Pasolini. Au contraire, il y a une ironie marquée dans la subversion de la vertu par le vice, ce dernier n'étant qu'une pulsion naturelle. Avec un certain pessimisme, la finalité de la nature est la mort, la destruction, l'homme doit donc s'y adonner par le crime, le meurtre, l'écrasement du faible par le fort: "Vous devez comprendre, petite créature, que nous nous sommes amusés de votre personne, par la raison simple et naturelle qui porte la force à abuser de la faiblesse". Sade insiste sur la rationalité de cette logique de dissipation et de domination: "Hâtons-nous de nous revêtir du manteau de la philosophie: il sera bientôt celui de tous les vices".
Dans l'exagération et la répétition des horreurs, il y a quelque chose de comique, comme quelqu'un qui veut toujours s'amuser, ce qui correspond bien à Sade lui-même qui, emprisonné à Vincennes puis à la Bastille pour une broutille, joue l'imbécile, le pleurnichard, celui qui a été berné. En revenant au noyau conceptuel sadien, on s'aperçoit qu'il est en quelque sorte l'exaspération de certains thèmes des Lumières. Les personnages de Sade montrent jusqu'où peut aller l'individu livré à lui-même et libéré de tout dogme. Sans autres leviers que leur raison et leur égoïsme, ils trouvent dans la jouissance le seul but raisonnable, mais cela débouche sur le vice et l'oppression. En dehors de l'individu, il n'y a rien, l'autre n'est qu'un moyen.
Pasolini réduit tout cela à une critique du pouvoir. Son Salò décrit son horreur, son ambivalence en raison de la facilité avec laquelle nous le subissons mais y participons, et enfin son châtiment. Tout cela dans un mouvement cyclique et apparemment absurde. C'est la re-proposition, dans une tonalité décadente, de la dialectique hégélienne serviteur/maître. Dans cette sorte de rencontre a-historique dont parle le philosophe allemand dans la Phénoménologie de l'Esprit, nous avons deux hommes qui s'engagent dans une lutte mortelle, dont l'un cède et, par peur de la mort, se laisse réduire en esclavage. L'autre, contraint au travail par son maître, entretient un rapport plus authentique avec le monde, précisément parce qu'il agit sur lui par le biais du travail. C'est cette plus grande conscience de soi qui renverse les rapports de force et libère le serviteur.
L'inavouable, c'est que dans cette optique, toute relation d'homme à homme finit par se transformer en relation de pouvoir, donc de domination. La relation sujet/sujet est impossible, mais elle se donne toujours comme sujet/objet, mais l'autre, précisément en tant qu'objet qui ne se donne pas totalement au sujet et reste opaque, est ce qui objective le moi. À cet égard, le film de Pasolini est la réalisation du thème sartrien: "L'enfer, c'est les autres". Cela explique aussi sa représentation du pouvoir, si éloignée de la conception du pouvoir dans le fascisme, qu'elle devient une projection de Pasolini lui-même au point qu'il est capable d'y voir presque une forme de libération et dont il a une fascination secrète: "Rien n'est plus anarchique que le pouvoir. Le pouvoir fait pratiquement ce qu'il veut". Comme le note très justement Adriano Scianca dans Riprendersi tutto: "Le fasciste sadique, capricieux et oligarchique des films de Pasolini ne reflète rien d'autre que les fantômes intérieurs et les obsessions secrètes de ceux qui ont fait et applaudi ces films".
Ce qui manque dans cette dialectique avec l'autre de Pasolini, comme chez la plupart des intellectuels de son époque, c'est la dimension de la conflictualité. Il n'y a pas de reconnaissance de l'adversaire dans sa réciprocité, la dialectique serviteur/maître exclut toute égalité entre les deux prétendants. On retrouve ainsi la négation de la lutte. La peur de la mort ne fait que rendre possible un rapport de domination et d'exploitation qui s'établit comme une relation fondamentalement asymétrique. Il n'y a aucune trace de cette agonalité, de cet esprit chevaleresque, de ce penchant guerrier qui permet la confrontation et la reconnaissance mutuelle. La distance et l'incompréhension avec le fascisme, qui se fonde précisément sur cette dimension conflictuelle, ne sauraient être plus grandes. Nous pouvons citer à titre d'exemple l'ouvrage de Filippo Tommaso Marinetti, Necessità e bellezza della violenza (= Nécessité et beauté de la violence), qui nous offre une description parfaite: "Ce n'est que par la violence que l'on peut ramener l'idée de justice, non pas à celle, fatale, qui consiste dans le droit du plus fort, mais à celle, saine et hygiénique, qui consiste dans le droit du plus courageux et du plus désintéressé, c'est-à-dire dans l'héroïsme".
19:28 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : violene, pier paolo pasolini, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 29 mars 2023
C'est Popper qui l'a dit
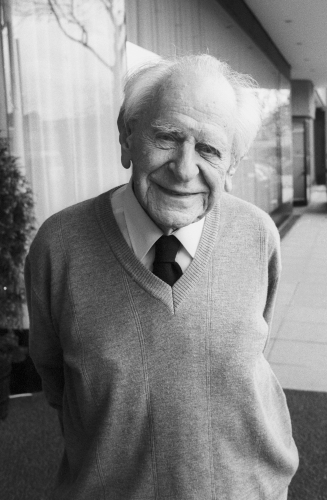
C'est Popper qui l'a dit
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/lo-dice-popper/
Je n'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour Karl Popper. Ma faute, bien sûr, est de ne rien comprendre à la philosophie des sciences. Et de m'être laissé conditionner (négativement, bien sûr) par toute cette gueule de bois poppérienne du début des années 1990. Quand, dans l'enthousiasme de la fin de l'histoire (vous vous souvenez du sublime idiot, de ce nouveau Dr Panglosse, de ce Fukuyama ?), tout le monde est soudain devenu libéral. Jusqu'à la veille, ils étaient léninistes, maoïstes, vétérans du stalinisme... en plus petit nombre ils étaient fascistes, vétérans du fascisme historique ou néo-fascistes, nationalistes, et tout le reste.... bref, même dans les années 80, en Italie, pour trouver un libéral, il fallait aller le chercher dans l'oasis protégée de Mondovì... où des animaux étranges comme Costa et Zanone se promenaient à Turin...
Et puis, soudain, Todos Caballeros ! Tous libéraux, au son du saxophone de l'ineffable Bill Clinton. Qu'il nous conduisait à vivre dans le meilleur des mondes possibles.... allez dire ça aux gens de Belgrade...
Et manifestement, tous ces libéraux néophytes ne juraient que par l'œuvre (non lue) de Karl Popper. Le seul penseur ayant droit de cité et d'autorité universelle... à la mer tous les autres, voire au bûcher. Même le bon Benedetto Croce, lui aussi libéral... mais hégélien... et donc trop difficile à comprendre.
Et au lieu de cela, Popper, avec son coup d'éclat sur la société ouverte qui doit se défendre contre ses ennemis, allait comme un gant à chacun de ces nouveaux libéraux. Et c'était suffisant pour justifier toute iniquité, tout abus de pouvoir que l'Occident, la Société Ouverte par excellence, a perpétré, et perpétrerait de plus en plus souvent au fil des ans, contre les autres. Tous les autres qui, pour une raison ou une autre, ne se conformaient pas à ce lit de Procuste qu'est le modèle "libéral démocratique". Bref, les ennemis. Les crapules....
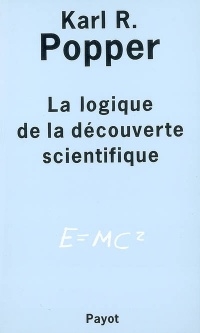 Cependant, il n'est pas non plus juste de jeter tout le blâme sur le pauvre Popper. D'autant que si, en tant que penseur politique, il est très contestable - finalement assez banal - en tant que philosophe des sciences, on dit (ceux qui savent) qu'il aurait écrit des choses remarquables. Preuve en est son œuvre majeure: Vérité et falsification".
Cependant, il n'est pas non plus juste de jeter tout le blâme sur le pauvre Popper. D'autant que si, en tant que penseur politique, il est très contestable - finalement assez banal - en tant que philosophe des sciences, on dit (ceux qui savent) qu'il aurait écrit des choses remarquables. Preuve en est son œuvre majeure: Vérité et falsification".
Il y explique ce qu'est la "méthode scientifique".
Maintenant, loin de moi l'idée d'entrer dans les méandres du débat des philosophes des sciences. Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour moi... et d'ailleurs, cela ne m'a jamais vraiment intéressé non plus. Je suis un vieux dinosaure du classicisme et, en fin de compte, je pense toujours que la philosophie, c'est Platon et Aristote. Tout ce qui est venu après n'est que commentaire....
Mais il y a une phrase de Popper qui m'a frappé. Et elle me revient souvent à l'esprit. Surtout en ces temps de tyrannie scientifique, de foi en la science, de comités techniques scientifiques et autres vilénies du même genre.
Voici ce qu'elle dit (et je m'excuse si la citation, comme toujours, est inexacte) :
La foi est liée à la religion. La science, c'est toujours... le doute.
En gros, rien de bien nouveau. Étant donné que Descartes, dans son Discours de la méthode, indique déjà clairement que, pour penser, il est toujours nécessaire de... douter. C'est-à-dire de tout remettre en question. Analyser tout ce qui nous est proposé sans préjugés. C'est-à-dire sans un jugement a priori qui sent toujours le... dogme. De quelque chose qui n'a rien à voir avec la raison, mais avec la foi.
Où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, cela me semble évident. Le paradoxe grotesque et tragique de notre époque réside précisément dans cette foi proclamée et non critique en la science et ses diktats. Comme l'ont démontré les absurdités de la longue saison de Co vid. D'ailleurs, elle n'est pas encore terminée. Pas pour tout le monde en tout cas, vu le nombre de ceux qui se promènent encore masqués, même seuls dans leur voiture. Et ceux qui s'empressent d'aller chercher leur quatrième dose de vaccin... et ceux.... mais passons. Inutile d'en parler. Et surtout de discuter avec eux. Ce sont simplement des idolâtres. Qui dansent autour d'idoles dont ils ne comprennent rien ou presque. Tandis que les "prêtres" ou les sorciers rusés de ces cultes exploitent leur obéissance. Aveugles, prêts, absolus... Les trinariciuti de Guareschi n'étaient rien en comparaison.
Je sais déjà que quelqu'un va commencer à s'énerver. À trouver des excuses. Et peut-être de vulgaires polémiques. Mais je suis désolé... ce fidéisme aveugle dans la soi-disant science a fait plus de mal à notre société et plus de victimes que le procès des sorcières de Salem...
Quelque chose qui ne peut pas et ne doit pas être oublié... de peur que cela ne persiste. Et se répète.
Je veux dire, si vous voulez vraiment un appui faisant autorité, dites: c'est Popper qui l'a dit.
Et maintenant, ne venez pas prétendre que Popper était aussi un vieux toqué.... Et que Speranza et Burioni sont meilleurs.
19:42 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : karl popper, société ouverte, libéralisme, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 25 mars 2023
La nécessité de redécouvrir des paradigmes identitaires au-delà des dichotomies anglo-saxonnes

La nécessité de redécouvrir des paradigmes identitaires au-delà des dichotomies anglo-saxonnes
L'agenda général sera fastidieusement biaisé sur l'axe conservateur/progressiste, jusqu'à la disparition complète d'un modèle social et culturel que l'on qualifierait, tout simplement, de civilisé.
par Giacomo Petrella
Source: https://www.barbadillo.it/108542-la-necessita-di-ritrovare-paradigmi-identitari-oltre-le-dicotomie-anglosassoni/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
Comment sortir de l'intellectualisme ? C'est une question qui nous ronge comme un ver depuis plusieurs années. Le champ de référence des batailles politiques que l'on définit comme celui de l'après-Nouvelle Droite semble en effet voué à un éternel destin de Cassandre. En bref, nous pouvons bien lire les chiffres de manière managériale, prendre acte de la stagnation de trente ans du PIB et des salaires, de la défaite totale, en termes de productivité à haute valeur ajoutée, de l'Italie dans la concurrence mondiale. Cela n'a guère d'importance. Nous resterons des cas isolés de lucidité mal dissimulée, tandis que l'agenda général sera fastidieusement déformé sur l'axe conservateur/progressiste, jusqu'à la disparition complète d'un modèle social et culturel que nous appellerions, tout simplement, civilisé.
Cette réflexion découle des paroles volées à Massimo Fini lors d'une de ses interviews sur Radio 24 : "Je suis socialiste, libertaire et réactionnaire".
Une synthèse extraordinaire qui, pour ceux qui viennent de certaines lectures, rappellera les analyses syncrétiques de Jean Thiriart. Mais qui, de manière plus réaliste, raconte simplement une Italie intellectuelle consciente de son propre modèle politique, fait de capitalisme d'État, de petites et moyennes entreprises, et d'une culture collective capable de rassembler tous les besoins, hauts et bas, de l'être humain.
Il s'agit essentiellement d'un programme politique de base. Mais c'est encore une plate-forme politique si on la compare au marketing politique désormais éculé qui voit la droite et la gauche non plus comme les faces d'une même pièce, mais plutôt comme des expressions vaniteuses de mécanismes ludiques et hobbystiques, de classes (non) dirigeantes engagées à vendre leur propre futilité adolescente, comme un filtre de réalisme politique mature.

La sortie de l'intellectualisme vers une proposition politique minimale servirait alors à éviter de tomber dans l'hyper-productivisme éditorial, dans la mise en place continue de mécanismes systémiques (conservateur vs woke) grâce auxquels le modèle anglo-saxon continue de se réitérer, transformant aujourd'hui Giorgia Meloni en une nouvelle Thatcher et Elly Schlein en une sorte d'Ocasio-Cortez. Ce qui signifierait aussi être devenus des lecteurs-militants ne craignant plus l'accusation ridicule de "velléitarisme" ; mais des groupes d'intérêts conscients qu'ils peuvent construire une réalité sociale pas forcément faite de darwinisme économico-social ou de redistribution technocratique de la dynamique de la dette.
Et puis il y a, en dehors d'ici, c'est-à-dire à partir d'un espace médiatique très restreint, une partie du monde multipolaire prête à s'engager dans des conflits lourds que l'on croyait oubliés, afin de réifier cette alternative ; si aujourd'hui le niveau de production des biens chinois dépasse à lui seul l'ensemble du PIB (finances, biens et services) des Etats-Unis et de l'UE réunis, il est clair que la construction de l'Etat mondial passera par un conflit qui n'est pas seulement militaire mais clairement anthropologique dans sa globalité.
Le fait qu'en Italie, ce débat d'époque n'existe pas, sauf dans les termes de phrases fonctionnelles/obsessionnelles ("nous sommes fidèles à l'alliance atlantique") est quelque chose d'effrayant. Surtout à une époque où les autocraties tant détestées montrent la naissance d'une nouvelle classe moyenne technico-universitaire structurée et fidèle à la voie des régimes de référence.
En bref : nous nous rendons compte que nous avons eu raison de parler de développement durable du tiers monde et non de blocus naval ; de nouvelles formes d'économies planifiées et non de bons d'achat et de tourisme ; de monnaie moderne et de plein emploi et non de chômage structurel et de déflation salariale.
Ces raisons n'ont pas trouvé de voie politique parce qu'il semblait que l'histoire était vraiment terminée ; peut-être serait-il bon de réaliser ici aussi, au-delà du rideau, que les choses changent, qu'elles sont à nouveau en mouvement.
18:53 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 17 mars 2023
Gerd Bergfleth (1936-2023) : adieu à un penseur inconfortable

Gerd Bergfleth (1936-2023) : adieu à un penseur inconfortable
Bernard Lindekens
Source: Nieuwsbrief Deltapers - No. 178, mars 2023
Le 20 janvier de cette année, Gerd Bergfleth est décédé à Tübingen. Cet événement n'a pas été l'occasion d'éloges funèbres, d'appels à l'action et d'in memoriam. Bien au contraire. Les médias ont fait ce en quoi ils excellent traditionnellement, à savoir le silence. Même son ancien éditeur, Matthes & Seitz, s'est montré très avare de commentaires. Mais qui était Gerd Bergfleth?
Né en 1936 à Dithmarschen, il a étudié la philosophie, la littérature et le grec à Kiel, Heidelberg et Tübingen de 1956 à 1964, où il s'est finalement installé. À partir de 1975, il devient éditeur, traducteur et interprète de l'œuvre théorique de l'écrivain, philosophe, poète et surréaliste dissident français Georges Bataille (1897-1962). Michael Krüger, de la Frankfurter Rundschau, a écrit à propos de son livre sur la "Théorie du gaspillage/del la dépense" de Bataille (1): "Une étude qui n'est pas seulement l'une des meilleures jamais écrites sur la théorie du gaspillage/de la dépense de Bataille, mais aussi un brillant morceau de philosophie indépendante : en se glissant virtuellement dans la peau de Georges Bataille, en devenant presque "identique" à lui, Bergfleth a eu l'occasion de pousser sa pensée plus loin, pour ainsi dire". Mais il ne s'est pas contenté de présenter une introduction ambitieuse à l'œuvre théorique de Bataille, il s'est aussi passionné pour d'autres auteurs peu visibles comme le Marquis de Sade, Maurice Blanchot, Pierre Klossowski ou Jean Baudrillard. Bergfleth s'intègre ainsi parfaitement dans le concept d'édition qu'avait pensé Axel Matthes et devient peu à peu le philosophe attitré de la toute jeune maison d'édition Matthes & Seitz.
L'enfant terrible
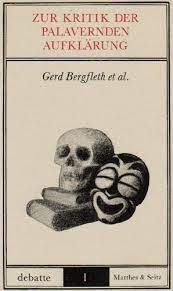 Après l'effondrement du Troisième Reich, lorsque l'Allemagne a connu sa "Stunde Null", son "Heure Zéro", certains philosophes et professeurs d'avant-guerre sont revenus en Allemagne. Les adeptes de l'Ecole de Francfort ne s'étaient jamais vraiment imposés dans le monde universitaire anglo-saxon et allaient bientôt installer leur hégémonie en Allemagne. Le moyen d'y parvenir sera la théorie critique. Des personnalités comme Theodor Adorno, Max Horkheimer et surtout Herbert Marcuse développent une approche critique de la philosophie axée sur la critique sociale et politique, et notamment du capitalisme. En faisant appel à la raison, elle permettait aussi indirectement de rejeter toute pensée qui n'était pas en accord avec elle en la qualifiant d'irrationnelle. Mais des dissonances ne tardent pas à apparaître. La revue conservatrice Criticon était peut-être de loin la plus connue à l'époque, à côté d'un certain nombre d'autres revues de droite. L'éditrice Claudia Gerhke, par exemple, a organisé des réunions de 1976 à 1980, au cours desquelles est née l'idée d'une revue politico-littéraire : le Konkursbuch (en réaction au Kursbuch, plutôt de gauche, de Hans Magnus Enzensberger 1929-2022). Le premier Konkursbuch est paru le 1er avril 1978 sur le thème "Raisonnabilité et émancipation" et Gerd Bergfleth s'y est illustré. Même lorsque Axel Matthes fonde le magazine maison Der Pfahl, Bergfleth est présent. Mais c'est avec son livre Zur Kritik der palavernden Aufklärung (2) qu'il établira sa réputation d'enfant terrible. Il s'agit d'une petite anthologie où l'on trouve, outre des textes de Bergfleth lui-même, des textes de Jean Baudrillard ("Die Fatalität der Moderne") et de George Bataille ("Nietzsche"), entre autres. Dans l'un de ses essais du livre, "Zehn Thesen zur Vernunftkritik"(= "Dix thèses pour une critique de la Raison), Bergfleth constate l'échec de la raison en tant qu'agence dominante de la philosophie et explique le clivage entre sa vision personnelle et les lumières de la gauche. Bergfleth s'insurge contre la pensée produite par le mouvement de la gauche - libérale - des années 1970 et pense pouvoir annoncer l'alliance entre la Raison, assortie de ses interdits, et le pouvoir porté par les technocrates. Le livre a aussi immédiatement provoqué un petit scandale lorsque, dans un autre essai de la même anthologie, il a subrepticement inversé la pensée de Walter Benjamin et en a cherché la clé dans la judéité de la Théorie critique. Les plaintes pour antisémitisme n'ont pas manqué de se manifester. Axel Matthes a cependant défendu son auteur avec ferveur. À juste titre d'ailleurs, car Bergfleth citait en fait une lettre de Walter Benjamin à Gershom Scholem. Malgré tout, Bergfleth sera qualifié par le journal Die Zeit de "Matthes & Seitz -Faschist".
Après l'effondrement du Troisième Reich, lorsque l'Allemagne a connu sa "Stunde Null", son "Heure Zéro", certains philosophes et professeurs d'avant-guerre sont revenus en Allemagne. Les adeptes de l'Ecole de Francfort ne s'étaient jamais vraiment imposés dans le monde universitaire anglo-saxon et allaient bientôt installer leur hégémonie en Allemagne. Le moyen d'y parvenir sera la théorie critique. Des personnalités comme Theodor Adorno, Max Horkheimer et surtout Herbert Marcuse développent une approche critique de la philosophie axée sur la critique sociale et politique, et notamment du capitalisme. En faisant appel à la raison, elle permettait aussi indirectement de rejeter toute pensée qui n'était pas en accord avec elle en la qualifiant d'irrationnelle. Mais des dissonances ne tardent pas à apparaître. La revue conservatrice Criticon était peut-être de loin la plus connue à l'époque, à côté d'un certain nombre d'autres revues de droite. L'éditrice Claudia Gerhke, par exemple, a organisé des réunions de 1976 à 1980, au cours desquelles est née l'idée d'une revue politico-littéraire : le Konkursbuch (en réaction au Kursbuch, plutôt de gauche, de Hans Magnus Enzensberger 1929-2022). Le premier Konkursbuch est paru le 1er avril 1978 sur le thème "Raisonnabilité et émancipation" et Gerd Bergfleth s'y est illustré. Même lorsque Axel Matthes fonde le magazine maison Der Pfahl, Bergfleth est présent. Mais c'est avec son livre Zur Kritik der palavernden Aufklärung (2) qu'il établira sa réputation d'enfant terrible. Il s'agit d'une petite anthologie où l'on trouve, outre des textes de Bergfleth lui-même, des textes de Jean Baudrillard ("Die Fatalität der Moderne") et de George Bataille ("Nietzsche"), entre autres. Dans l'un de ses essais du livre, "Zehn Thesen zur Vernunftkritik"(= "Dix thèses pour une critique de la Raison), Bergfleth constate l'échec de la raison en tant qu'agence dominante de la philosophie et explique le clivage entre sa vision personnelle et les lumières de la gauche. Bergfleth s'insurge contre la pensée produite par le mouvement de la gauche - libérale - des années 1970 et pense pouvoir annoncer l'alliance entre la Raison, assortie de ses interdits, et le pouvoir porté par les technocrates. Le livre a aussi immédiatement provoqué un petit scandale lorsque, dans un autre essai de la même anthologie, il a subrepticement inversé la pensée de Walter Benjamin et en a cherché la clé dans la judéité de la Théorie critique. Les plaintes pour antisémitisme n'ont pas manqué de se manifester. Axel Matthes a cependant défendu son auteur avec ferveur. À juste titre d'ailleurs, car Bergfleth citait en fait une lettre de Walter Benjamin à Gershom Scholem. Malgré tout, Bergfleth sera qualifié par le journal Die Zeit de "Matthes & Seitz -Faschist".
Le fait est que, malgré ce que certains appelleront sa francophilie, Bergfleth a réussi à révéler le fond allemand qui se cache derrière de nombreux textes français. Et c'est précisément grâce à sa connaissance pénétrante des styles de pensée avant-gardistes de Foucault, Derrida et Baudrillard qu'il a pu extraireet remettre en exergue les mondes mentaux de Nietzsche, Klages et Heidegger. Des mondes mentaux qui avaient été habilement enterrés dans la RFA d'alors au nom de l'"Aufklärung" ...
Le fait que l'esprit refoulé du soi-disant "pré-fascisme allemand" revienne par la porte dérobée de la pensée française du postmodernisme a déclenché toutes les sonnettes d'alarme parmi les disciples de Jürgen Habermas. Plus tard, il collaborera à la brillante revue Etappe et au journal Staatsbriefe. Il a également contribué à l'ouvrage pionnier Die selbstbewußte Nation. En dehors de l'Allemagne, il a également collaboré au numéro sur l'écologie de la revue française Krisis et est intervenu au 27e colloque du G.R.E.C.E. sur le même thème (3).
A l'occasion de son 80ème anniversaire, la revue allemande Sezession (4) écrivait que c'était le grand mérite de cet intrépide penseur non-conformiste d'avoir redécouvert cette autre Allemagne, plus sombre, à travers la France et d'avoir ainsi redonné à l'esprit allemand son pouvoir de séduction. Bergfleth appartenait à ce groupe de penseurs solitaires qui n'ont jamais fondé d'école, et c'est heureux. Bergfleth mérite d'être redécouvert. Le monde et la vie n'appartiennent pas à la seule raison.
Bernard Lindekens
Notes:
(1) Gerd Bergfleth, Theorie der Verschwendung. Einführung in das theoretische Werk von Georges Bataille, 1985, Matthes & Seitz, Berlin, 146 p. ISBN : 978-3-88221-359-1
(2) Gerd Bergfleth et al, Zur Kritik der palavernden Aufklärung, 1984, Matthes & Seitz, Berlin, 198 pp. ISBN : 978-3-88221-344-2 (dans la série "debatte")
(3) XXVIIe colloque national du GRECE, Les Enjeux de l'écologie, Paris, 28/11/1993
(4) Voir le site Internet : https://sezession.de/57200/gerd-bergfleth-zum-80-geburtstag
Sur Bergfleth, voir aussi : http://www.archiveseroe.eu/bergfleth-a48275783
14:34 Publié dans Hommages, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, gerd bergfleth, philosophie, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook