Propos recueillis par Romain Bouvier, Président du Club Roger Nimier
Juan Asensio, pouvez-vous, s’il vous plaît, vous présenter à nos lecteurs en quelques mots?
Je suis né en 1971 à Lyon, où j’ai passé les 30 premières années de ma vie. J’y ai suivi une formation, très classique, de lettres modernes et de philosophie, d’abord à l’externat Sainte-Marie jusqu’en classe de khâgne que j’ai cubée, ensuite à l’université Jean Moulin Lyon 3, y poursuivant ma formation jusqu’en thèse que j’ai abandonnée très vite. Mon directeur de l’époque, Monique Gosselin-Noat, ponte des études bernanosiennes ayant participé à la nouvelle édition des romans de Bernanos dans la collection de la Pléiade, m’avait en effet donné à traiter un sujet dont je ne voulais absolument pas (la figuration du diable dans les romans de Julien Green, François Mauriac et Georges Bernanos) et qui… avait déjà fait l’objet d’une thèse vieille d’à peine deux ou trois ans au moment où j’entamais mes propres recherches ! C’était, au mot près, le sujet qu’elle m’avait d’office demandé de traiter qui avait été disséqué en quelque deux énormes volumes. J’ai piqué une sacrée colère contre tant d’incompétence crasse, et ai écrit puis téléphoné à notre mandarine. Lorsque je lui ai fait part de ma découverte, elle m’a tout stupidement répondu que je n’avais qu’à prendre le contrepied exact de ladite thèse ! J’ai donc gardé, comme vous vous en doutez, une très piètre opinion des universitaires, censément des universitaires bernanosiens qui d’ailleurs me le rendent bien, puisqu’ils ne citent pas mes travaux dans cette nouvelle édition des romans de Bernanos. Que voulez-vous, la petitesse se venge toujours petitement… J’ai aussi passé une année, fort oubliable, au Celsa, afin de voir de l’intérieur si je puis dire à quoi ressemblait l’enseignement délivré en matière de journalisme et, ma foi, je n’ai pas été déçu quant à la médiocrité abyssale, forcément partisane (de gauche bien sûr) de cet enseignement. J’ai créé en mars 2004 Stalker, alors que je travaillais dans une salle des marchés et que Maurice G. Dantec se faisait traîner dans la boue par les journaux à prétentions humanistes habituels. Il s’agissait de trouver une façon de répondre aux invectives à moraline lui reprochant d’avoir osé échanger quelques messages avec le Bloc identitaire d’une poignée de journalistes aussi prestigieux qu’un certain Philippe Nassif (de Technikart je crois), et un de mes collègues de bureau, informaticien, me suggéra ainsi de créer un blog. Très vite, Stalker a fait des émules dans ce qui ne s’appelait pas encore la blogosphère, mais aucun de ces blogs nés en deux minutes n’a survécu plus de quelques mois, voire années pour les meilleurs. Depuis cette époque presque préhistorique à l’échelle de la Toile, mon blog est devenu riche de quelque 1 500 notes, pas toutes écrites par moi d’ailleurs, et est très lu, puisqu’il engrange entre 30 et 40 000 visiteurs uniques par mois, pour 100 à 200 000 pages vues par mois. J’ai donné la possibilité à mes lecteurs de me verser des dons via Paypal, ce qui me permet d’acheter la plupart des ouvrages que j’évoque sur mon blog, même si j’en reçois quelques-uns en service de presse, à condition que je les demande toutefois. Il s’apparente désormais à un véritable labyrinthe et c’est ainsi très vite que je l’ai surnommé la Zone, référence évidente à l’un des chefs-d’œuvre de Tarkovski. J’ai aussi réussi à publier quelques ouvrages de critique littéraire et un bouquin étrange sur Judas Iscariote, en 2010, aux éditions du Cerf. J’emploie à dessein le terme « réussi », car désormais tout le monde se fiche de la critique littéraire, à commencer par les éditeurs, puis par les journalistes, les libraires et, en bout de chaîne, le public. Il m’arrive de collaborer à quelques revues, dont Études, alors que j’ai publié des articles dans La Revue des Deux Mondes ou bien encore L’Atelier du roman. Je ne supporte plus toutefois le principe, très lourd et donc si peu rapide et agile, de ces revues, qui ne vous paient que fort rarement, et des sommes ridicules, alors qu’il faut bien souvent essuyer un refus par quelque couillon illettré appartenant, Sésame, ouvre-toi !, au sacro-saint comité de lecture.
 A la création de votre blog, Stalker, vous avez donc pris la défense de Maurice G. Dantec ? Serait-il un des rares auteurs contemporains qui puisse trouver grâce à vos yeux de critique acerbe ?
A la création de votre blog, Stalker, vous avez donc pris la défense de Maurice G. Dantec ? Serait-il un des rares auteurs contemporains qui puisse trouver grâce à vos yeux de critique acerbe ?
J’ai pris sa défense, oui, car les imbéciles qui l’attaquaient, et qui n’avaient probablement pas lu une seule ligne d’un seul de ses romans, ont pour habitude de chasser en meute, comme tous les lâches. J’ai beaucoup lu Dantec, quoique tardivement, n’y étant venu qu’avec réticence car alors (nous étions en 2003), il était un auteur polémique qui faisait beaucoup parler de lui. C’est après avoir fait paraître dans La Revue des Deux Mondes un long article sur Villa Vortex, un roman monstrueux ridiculisé en deux lignes stupides (dans la rubrique Sifflets, je crois, du Nouvel Observateur) par Jean-Louis Ezine qui n’avait à l’évidence pas lu ce livre, que Dantec et moi avons commencé à échanger. L’avait en effet frappé, dans l’article en question pour lequel il me félicita très chaleureusement, le fait que j’y annonçais sa conversion au catholicisme, qui avait eu lieu quelques mois après la parution de ce texte. J’ai continué à lire Dantec, mais mon intérêt pour ses textes (les excès divers et variés du personnage m’ayant toujours laissé de marbre) a décru assez vite. Je l’ai même défendu contre la poignée de crétins mononeuronaux qui, alors, l’entouraient, et derrière le ridicule rempart de laquelle il vitupérait, assez grossièrement, contre le monde tel qu’il ne va pas. Maurice G. Dantec n’est pas un styliste de la langue française, c’est le moins que l’on puisse dire, mais il y avait toujours, même dans le plus mauvais de ses romans, des traits de fulgurance, des intuitions métaphysiques mélangées à des facilités indignes d’une rédaction d’écolier de 13 ans. M’avait alors surtout frappé son aptitude, dans les deux premiers tomes de son Journal, à évoquer des auteurs (Dominique De Roux, Ernest Hello, Léon Bloy, etc.) dont plus personne ou presque n’osait parler, et cela me frappa. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts comme on dit, et je n’ai plus de nouvelles, ni d’ailleurs ne cherche à en prendre, pour être tout à fait honnête, de Dantec, qui est du reste à ce que j’en sais assez mal en point, même si sa santé a toujours été vacillante. La dernière fois que je l’ai vu, à Paris, il était méconnaissable, et m’a serré la main en pleurant, peut-être parce qu’il avait fini par comprendre que je l’avais défendu contre vents et marée, y compris contre son propre comportement destructeur et paranoïaque. C’est du passé. Je ne suis même pas parvenu à lire plus de quelques pages de son dernier roman, Les Résidents, resté totalement inaperçu, alors que la moindre de ses déclarations, bien souvent infantiles, déclenchait des spasmes le plus souvent ridicules sur beaucoup de sites, de forums et sur les blogs au début des années 2000. En tout cas, nul ne pourra jamais me reprocher de ne pas avoir pris Maurice G. Dantec, en tant qu’écrivain, au sérieux.
Je réponds à la seconde de vos questions : beaucoup d’auteurs vivants trouvent grâce à mes yeux, qu’ils soient Français (Marien Defalvard, Pierre Mari, Christian Guillet, Guy Dupré, Jean Védrines, Serge Rivron) ou bien étrangers et là, force est de constater que la liste est tout de même plus conséquente : Roberto Calasso, Claudio Magris, Jaume Cabré ou Javier Cercas même si m’enquiquine leur côté « habiles techniciens du roman », Cormac McCarthy dont la lecture a été un choc, le très singulier László Krasznahorkai ou, disparu il y a quelques années, le génial Roberto Bolaño.
En tant que critique littéraire (et lyonnais d’origine de surcroît), que pensez-vous de cette formule que l’on prête à François Mitterrand à propos de l’œuvre romanesque de Rebatet : « Il y a deux sortes d’hommes : ceux qui ont lu Les Deux Étendards, et les autres » ?
 Absolument tous les reproches, et les plus durs, peuvent être faits à François Mitterrand, mais enfin, c’était un assez bon lettré, aimant comme vous le savez passionnément l’œuvre d’Ernst Jünger, qu’il connaissait personnellement. Je me souviens d’avoir lu qu’il reprocha un jour à un certain Alain Juppé qui joue aujourd’hui les revenants arrogants, de ne pas connaître Paul Gadenne. S’il n’y avait qu’Alain Juppé qui ignorât l’auteur de La plage de Scheveningen, l’un des plus beaux et grands romans du siècle passé ! Qui connaît encore, hélas, le profond et tourmenté Paul Gadenne ? Certainement pas le crétin hollandais, dont on se demande même s’il a jamais entendu parler d’un mot aussi bizarre et incongru que celui de « littérature » ! Quoi qu’il en soit, j’ai lu Rebatet jeune, trop jeune peut-être et, comme tant d’autres auteurs, il me faut à présent le relire, alors qu’il semble jouir d’une certaine actualité, du moins éditoriale, qui ne s’est pas encore vraiment étendue à des auteurs comme Brasillach (évoqué par Gadenne, qui fut son condisciple en khâgne, dans le roman que j’ai indiqué, sous les traits d’un personnage du nom d’Hersent), Brasillach dont il faut lire Notre avant-guerre, ou bien le pestiféré Abel Bonnard, dont Les Modérés sont une radiographie de la France politique encore pertinente. Je me souviens en tout cas d’avoir estimé, du haut de mes 14 ou 15 ans, que Les Deux Étendards, roman au titre génial, disséquait la France de l’entre-deux guerres avec une profondeur spirituelle absente des romans de Céline, et ce seul souvenir me donne envie de relire ce roman qui avait la réputation, il n’y a pas si longtemps que cela, d’être maudit. Par ailleurs, j’allais, quelques années plus tard, retrouver le nom de Rebatet sous la plume de George Steiner, qui n’a jamais cessé de clamer son admiration pour ce roman, tout en traitant son auteur de salopard. J’ai d’ailleurs commencé ma relecture des Décombres qui vient d’être réédité, après avoir aussi relu le Rebatet de Pol Vandromme et en faisant un crochet par Les Réprouvés d’Ernst von Salomon, décrivant la nécessité d’une refondation de l’Allemagne humiliée par les sanctions des alliés et rongée par la gangrène communiste que les corps francs tentent de contenir, voire d’éradiquer. Il n’est donc pas étonnant que Lucien Rebatet, de même que d’autres qui ont décrit la complexité d’une époque où la France cherchait une forme de renaissance politique tout autant que sociale, voire spirituelle, intéresse et même fascine de nouveau, y compris les jeunes si on leur apprend encore à lire, maintenant que notre pays traverse une crise qui sera mortelle si aucun sursaut, de réelle profondeur et pas cosmétique, ne le sauve. Et puis, à tout prendre, je préfère un jeune gars un peu borné nourri au petit lait de Charles Maurras, mais qui aura au moins lu, et avec passion, Bloy, Bernanos, Jünger, Von Salomon, Rebatet, Brasillach, Hansum ou Pasolini et quelques autres encore sur lesquels planent de vilains soupçons, plutôt qu’un crétin ripoliné fraîchement hypokhâgneux qui n’aura sucé que les mamelles desséchées de Gérard Genette et de Roland Barthes, l’esprit tout farci des fadaises naturalistes sans style de Maupassant et de Zola, et qui finira sous-pigiste à Télérama ou aux Inrockuptibles, à saluer le gras loukoum à orientalisme germanopratin goncourisé d’un Mathias Enard. La passion, l’excès, le courage, plutôt que ces sépulcres déjà blanchis rêvant carrière et petite épouse sage rencontrée à l’école et qui finira comme eux professeur dans le meilleur des cas, à l’âge où Jean-René Huguenin savait qu’il n’égalerait jamais Rimbaud et Carlo Michelstaedter se tirait une balle dans la tête après avoir écrit le dernier mot de sa Persuasion et la rhétorique !
Absolument tous les reproches, et les plus durs, peuvent être faits à François Mitterrand, mais enfin, c’était un assez bon lettré, aimant comme vous le savez passionnément l’œuvre d’Ernst Jünger, qu’il connaissait personnellement. Je me souviens d’avoir lu qu’il reprocha un jour à un certain Alain Juppé qui joue aujourd’hui les revenants arrogants, de ne pas connaître Paul Gadenne. S’il n’y avait qu’Alain Juppé qui ignorât l’auteur de La plage de Scheveningen, l’un des plus beaux et grands romans du siècle passé ! Qui connaît encore, hélas, le profond et tourmenté Paul Gadenne ? Certainement pas le crétin hollandais, dont on se demande même s’il a jamais entendu parler d’un mot aussi bizarre et incongru que celui de « littérature » ! Quoi qu’il en soit, j’ai lu Rebatet jeune, trop jeune peut-être et, comme tant d’autres auteurs, il me faut à présent le relire, alors qu’il semble jouir d’une certaine actualité, du moins éditoriale, qui ne s’est pas encore vraiment étendue à des auteurs comme Brasillach (évoqué par Gadenne, qui fut son condisciple en khâgne, dans le roman que j’ai indiqué, sous les traits d’un personnage du nom d’Hersent), Brasillach dont il faut lire Notre avant-guerre, ou bien le pestiféré Abel Bonnard, dont Les Modérés sont une radiographie de la France politique encore pertinente. Je me souviens en tout cas d’avoir estimé, du haut de mes 14 ou 15 ans, que Les Deux Étendards, roman au titre génial, disséquait la France de l’entre-deux guerres avec une profondeur spirituelle absente des romans de Céline, et ce seul souvenir me donne envie de relire ce roman qui avait la réputation, il n’y a pas si longtemps que cela, d’être maudit. Par ailleurs, j’allais, quelques années plus tard, retrouver le nom de Rebatet sous la plume de George Steiner, qui n’a jamais cessé de clamer son admiration pour ce roman, tout en traitant son auteur de salopard. J’ai d’ailleurs commencé ma relecture des Décombres qui vient d’être réédité, après avoir aussi relu le Rebatet de Pol Vandromme et en faisant un crochet par Les Réprouvés d’Ernst von Salomon, décrivant la nécessité d’une refondation de l’Allemagne humiliée par les sanctions des alliés et rongée par la gangrène communiste que les corps francs tentent de contenir, voire d’éradiquer. Il n’est donc pas étonnant que Lucien Rebatet, de même que d’autres qui ont décrit la complexité d’une époque où la France cherchait une forme de renaissance politique tout autant que sociale, voire spirituelle, intéresse et même fascine de nouveau, y compris les jeunes si on leur apprend encore à lire, maintenant que notre pays traverse une crise qui sera mortelle si aucun sursaut, de réelle profondeur et pas cosmétique, ne le sauve. Et puis, à tout prendre, je préfère un jeune gars un peu borné nourri au petit lait de Charles Maurras, mais qui aura au moins lu, et avec passion, Bloy, Bernanos, Jünger, Von Salomon, Rebatet, Brasillach, Hansum ou Pasolini et quelques autres encore sur lesquels planent de vilains soupçons, plutôt qu’un crétin ripoliné fraîchement hypokhâgneux qui n’aura sucé que les mamelles desséchées de Gérard Genette et de Roland Barthes, l’esprit tout farci des fadaises naturalistes sans style de Maupassant et de Zola, et qui finira sous-pigiste à Télérama ou aux Inrockuptibles, à saluer le gras loukoum à orientalisme germanopratin goncourisé d’un Mathias Enard. La passion, l’excès, le courage, plutôt que ces sépulcres déjà blanchis rêvant carrière et petite épouse sage rencontrée à l’école et qui finira comme eux professeur dans le meilleur des cas, à l’âge où Jean-René Huguenin savait qu’il n’égalerait jamais Rimbaud et Carlo Michelstaedter se tirait une balle dans la tête après avoir écrit le dernier mot de sa Persuasion et la rhétorique !
Il n’en reste pas moins que François Mitterrand exagère quelque peu car enfin, il est tout autant possible d’affirmer qu’il y a deux sortes d’hommes : ceux qui ont lu La persuasion et la rhétorique justement, mais aussi ceux qui ont lu Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, Nostromo de Joseph Conrad, Absalon, Absalon ! de William Faulkner, ou encore Monsieur Ouine de Georges Bernanos ! Et je suis absolument certain que d’autres pourraient vous dire qu’ils ne sont plus les mêmes depuis qu’ils ont lu Shakespeare, Dostoïevski, Stevenson ou bien encore Melville, ce qui est par exemple mon cas ! Et, pour finir sur une méchanceté, je n’en suis pas moins sûr que de pauvres âmes seraient prêtes à jurer qu’elles ont été appelées à une nouvelle vie après avoir découvert les textes d’Amélie Nothomb, de Yannick Haenel ou de Virginie Despentes !
Quel regard portez-vous sur l’œuvre de Roger Nimier et plus généralement sur le courant dit des « Hussards », sur lesquels, pour reprendre vos mots, planent encore de vilains soupçons dans le petit monde germanopratin ?
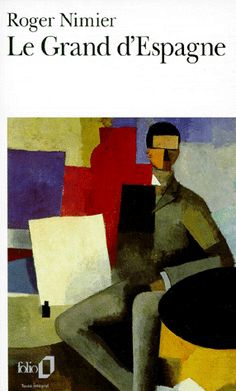 Les Hussards sont des auteurs que je connais finalement assez peu, n’ayant lu que quelques ouvrages de Chardonne, Laurent ou Nimier, bien sûr Les Épées mais aussi Le Grand d’Espagne, qui évoque Georges Bernanos. Comme bien d’autres (je songe ainsi à Péguy, transformé, par l’opération du Saint-Esprit sans doute, en auteur et même penseur de droite), ils ont été d’une certaine façon abâtardis, journalisés par tout un tas de leurs épigones plus ou moins inspirés, revendiqués ou pas. D’ici peu, Causeur leur consacrera un dossier, si ce n’est déjà fait, et c’est ainsi qu’ils seront happés et hachés menu, puis accrochés au plafond, au milieu d’autres andouilles d’appellation et d’origine contrôlées comme Philippe Muray, devenu le saint patron de la Réaction puérile à laquelle nous assistons. Très peu pour moi que cet eczéma purement journalistique, que quelques petits Mohicans attendant les Cosaques et une paire de jolies fesses, y compris celles du Saint-Esprit, gratteront en croyant découvrir des cavernes d’originalité. Il me semble, au cas où vous me poseriez cette question, que l’esprit des Hussards a survécu plus qu’il ne survit, car il semble désormais bien mort, le temps où une seule phrase, aiguisée comme le morfil d’une dague, pouvait d’un trait précis clouer une vieille chouette radoteuse. Le dernier rétiaire de ce genre, altier et redoutable, même s’il a parfois trop donné dans un hermétisme littéraire de pacotille, était Dominique de Roux, et un livre tel qu’Immédiatement, publié aujourd’hui, vaudrait à son auteur une bonne quinzaine de procès, et une chasse à l’homme en règle, qu’il eut d’ailleurs à subir de son vivant. Je songe aussi à l’exemple tragique et lumineux de Jean-René Huguenin, mort en 1962 comme Nimier, également dans un accident de voiture. Je songe encore à Guy Dupré, hélas si profondément méconnu voire ignoré par nos élites littéraires ou ce qui en tient lieu, lequel d’ailleurs a écrit un de ses textes si subtils et profondément littéraires sur Sunsiaré de Larcône (recueilli dans Les Manœuvres d’automne), une belle femme que tout Hussard a dû tour à tour envier et maudire au moins une fois !
Les Hussards sont des auteurs que je connais finalement assez peu, n’ayant lu que quelques ouvrages de Chardonne, Laurent ou Nimier, bien sûr Les Épées mais aussi Le Grand d’Espagne, qui évoque Georges Bernanos. Comme bien d’autres (je songe ainsi à Péguy, transformé, par l’opération du Saint-Esprit sans doute, en auteur et même penseur de droite), ils ont été d’une certaine façon abâtardis, journalisés par tout un tas de leurs épigones plus ou moins inspirés, revendiqués ou pas. D’ici peu, Causeur leur consacrera un dossier, si ce n’est déjà fait, et c’est ainsi qu’ils seront happés et hachés menu, puis accrochés au plafond, au milieu d’autres andouilles d’appellation et d’origine contrôlées comme Philippe Muray, devenu le saint patron de la Réaction puérile à laquelle nous assistons. Très peu pour moi que cet eczéma purement journalistique, que quelques petits Mohicans attendant les Cosaques et une paire de jolies fesses, y compris celles du Saint-Esprit, gratteront en croyant découvrir des cavernes d’originalité. Il me semble, au cas où vous me poseriez cette question, que l’esprit des Hussards a survécu plus qu’il ne survit, car il semble désormais bien mort, le temps où une seule phrase, aiguisée comme le morfil d’une dague, pouvait d’un trait précis clouer une vieille chouette radoteuse. Le dernier rétiaire de ce genre, altier et redoutable, même s’il a parfois trop donné dans un hermétisme littéraire de pacotille, était Dominique de Roux, et un livre tel qu’Immédiatement, publié aujourd’hui, vaudrait à son auteur une bonne quinzaine de procès, et une chasse à l’homme en règle, qu’il eut d’ailleurs à subir de son vivant. Je songe aussi à l’exemple tragique et lumineux de Jean-René Huguenin, mort en 1962 comme Nimier, également dans un accident de voiture. Je songe encore à Guy Dupré, hélas si profondément méconnu voire ignoré par nos élites littéraires ou ce qui en tient lieu, lequel d’ailleurs a écrit un de ses textes si subtils et profondément littéraires sur Sunsiaré de Larcône (recueilli dans Les Manœuvres d’automne), une belle femme que tout Hussard a dû tour à tour envier et maudire au moins une fois !
Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la figuration du démoniaque dans la littérature ?
Sous le soleil de Satan a-t-il été l’ouvrage amorçant votre intérêt pour ce thème et plus spécifiquement, pour l’œuvre complète de Georges Bernanos ?
J’ai découvert Georges Bernanos, comme beaucoup de lecteurs je suppose, via l’adaptation que Maurice Pialat avait réalisée du premier de ses romans. C’est dans mon cas assez étonnant car je ne savais jusqu’alors rien de celui que Nimier surnomma le Grand d’Espagne, alors même que je me trouvais dans un établissement catholique depuis ma classe de septième. Le film de Pialat fut un choc même si par la suite, lisant le roman en question, le relisant et lisant tout ce qu’avait écrit Bernanos et tout ce qui avait été écrit sur lui, je me rendis vite compte que cette adaptation était assez infidèle, à la lettre du roman bien sûr, mais, plus grave, à l’esprit même de l’écriture bernanosienne. Peu importe du reste, car Pialat s’est montré, pour le coup, authentiquement bernanosien en levant le poing, tout le monde se souvient de ce geste crâne, face aux connards qui le sifflaient.
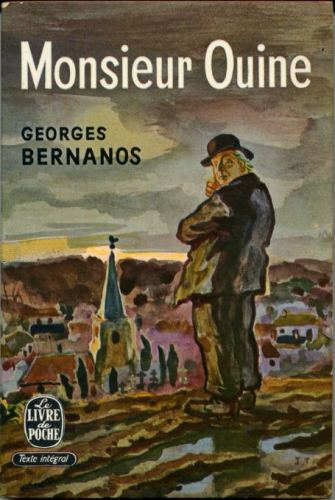 Mon intérêt pour la figuration littéraire du démoniaque n’a pu être que conforté par la découverte de l’œuvre romanesque de Georges Bernanos, qui devait culminer par la lecture de Monsieur Ouine, réputé, à juste titre, comme étant le roman le plus difficile de l’auteur et qui, du diable et du démoniaque, donne une peinture absolument fascinante. J’ai tenté d’éclairer de plusieurs façons ce roman, par exemple en le rapprochant de l’hermétisme démoniaque tel que le développe Kierkegaard ou bien en en proposant une lecture comparée avec Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, par le biais de l’étude de la voix des personnages principaux, Kurtz et l’ancien professeur de langues, tous deux maîtres d’un langage dévoyé. Bien évidemment, aucune mention de ces travaux (et d’autres, comme l’influence plus ou moins souterraine d’Arthur Machen sur Sous le soleil de Satan, par le biais de la si belle traduction que Paul-Jean Toulet donna du Grand Dieu Pan) dans la nouvelle édition des œuvres romanesques de Bernanos en Pléiade mais, comme c’est Monique Gosselin-Noat qui a été chargée par Max Milner de l’édition de Monsieur Ouine, il ne fallait certes pas s’attendre à ce qu’elle mentionne autre chose que ses petites fadaises universitaires !
Mon intérêt pour la figuration littéraire du démoniaque n’a pu être que conforté par la découverte de l’œuvre romanesque de Georges Bernanos, qui devait culminer par la lecture de Monsieur Ouine, réputé, à juste titre, comme étant le roman le plus difficile de l’auteur et qui, du diable et du démoniaque, donne une peinture absolument fascinante. J’ai tenté d’éclairer de plusieurs façons ce roman, par exemple en le rapprochant de l’hermétisme démoniaque tel que le développe Kierkegaard ou bien en en proposant une lecture comparée avec Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, par le biais de l’étude de la voix des personnages principaux, Kurtz et l’ancien professeur de langues, tous deux maîtres d’un langage dévoyé. Bien évidemment, aucune mention de ces travaux (et d’autres, comme l’influence plus ou moins souterraine d’Arthur Machen sur Sous le soleil de Satan, par le biais de la si belle traduction que Paul-Jean Toulet donna du Grand Dieu Pan) dans la nouvelle édition des œuvres romanesques de Bernanos en Pléiade mais, comme c’est Monique Gosselin-Noat qui a été chargée par Max Milner de l’édition de Monsieur Ouine, il ne fallait certes pas s’attendre à ce qu’elle mentionne autre chose que ses petites fadaises universitaires !
La découverte de l’œuvre de Bernanos puis, dans le foulée, de celles de Barbey, Bloy et Hello, mais aussi Huysmans et quelques autres décadents de moindre importance comme Jean Lorrain ou Remy de Gourmont, n’a pu que creuser mon questionnement sur le démoniaque en littérature, mais pas en être la source, qui doit plutôt remonter à ma découverte, assez jeune (en cinquième ou quatrième je pense) des romans de Dostoïevski, de Stevenson ou de Faulkner et, avant eux encore, de telle pièce indiciblement noire de Shakespeare, Macbeth, dont la dernière adaptation cinématographique m’a fait l’effet d’un joli clip aux lumières bien léchées. J’ajoute à ces quelques noms ceux de Rimbaud et de Baudelaire, que je n’ai jamais cessé de relire depuis que je les ai découverts.
C’est peu dire, en tout cas, que cette thématique m’a fasciné et me fascine encore, l’un des jalons de son approfondissement ayant été la lecture intensive et, je crois, intense, de Sören Kierkegaard en classe de terminale qui, vous le savez, a beaucoup médité et écrit, et puissamment comme il en va toujours avec cet horrible génie, sur le thème du démoniaque. Ensuite, puisqu’il me fallait remonter aux sources, j’ai lu tout ce que je pouvais lire concernant le démon, non seulement bien sûr les textes sacrés de la tradition judéo-chrétienne, écrits intertestamentaires et apocryphes inclus, mais tous les traités (du moins, ceux qui bénéficient d’une traduction française) de démonologie, comme le Malleus Maleficarum ou Marteau des sorcières d’Institoris et Sprenger ou encore le beau Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons de Pierre De Lancre. Je devais aussi rencontrer le Père Chossonnery, exorciste du diocèse de Lyon, avec lequel j’eus un long entretien.
C’est je crois cette plongée en eaux troubles qui m’a donné pour habitude d’établir des liens, que je crois la plupart du temps originaux, entre des romans qu’a priori rien ne rapproche et, en tout cas, qui me permet de lire des textes en comprenant, assez vite tout de même, leur profondeur, ou bien, a contrario, leur absence de profondeur. Un grand écrivain est d’abord un grand lecteur, certains cas, comme celui de Michel Houellebecq étant plus difficiles que d’autres à caractériser, car voici un grand lecteur qui n’est pas un grand écrivain, tout comme Dantec d’ailleurs, même si leurs styles respectifs sont fondamentalement différents. Quoi qu’il en soit, appelons cela mon péché mignon, je continue à lire tout ce qui paraît, à condition que les textes soient sérieux, sur le diable ou le démoniaque, et à relire les grandes œuvres romanesques d’un Dostoïevski ou d’un Melville, dont la grandeur même provient essentiellement du fait qu’elles proposent une vision du Mal.
Le grand lecteur que vous êtes a-t-il pour projet de devenir un jour écrivain, j’entends par là, en publiant un roman ?
Je n’ai aucun projet littéraire d’aucune sorte, surtout pas celui de devenir, comme tant d’ambitieux dont le talent est inversement proportionnel à la surface de léchage de leur langue, ceci ou cela. Publier un roman me dites-vous… Mais à quoi bon puisqu’il s’en publie plusieurs centaines lors de chaque rentrée dite littéraire et que, dans le meilleur des cas (c’est bien évidemment une hypothèse aussi loufoque qu’impossible !), je devrais accepter que mon roman soit lu, jugé même par une Virginie Despentes admise récemment au jury du Goncourt ? Je doute fort de jamais publier un roman en bonne et due forme, car je sais rester à ma place, et celle-ci est celle d’un critique littéraire. Or, la critique littéraire, naguère florissante, est un art aujourd’hui mourant, si ce n’est mort, du moins en France. Je ne parle certes pas de la critique universitaire, bien souvent totalement stérile et confidentielle, ou de la critique journalistique, résolument eunuque, consanguine et inculte, mais d’une critique d’auteur, passionnée, forcément partiale et qui, sans jamais copier les journalistes et les chercheurs, emprunte certaines de leurs techniques. Et, surtout, qui n’hésite jamais à appeler un chat un chat et une rinçure, selon le terme de Rimbaud, une rinçure, car, contrairement à nos amis journalistes, je ne dois rien à personne, je suis libre de chacun de mes propos, et je me moque des coteries qui font et défont les réputations, et même les carrières, du moins en matière d’édition et de journalisme.
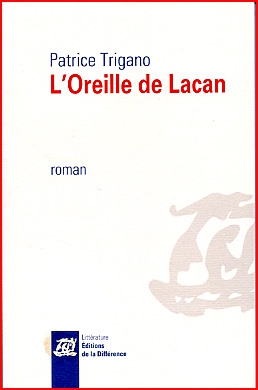 Tenez, j’ai récemment pointé, dans un long article fouillé, les très étranges coïncidences, selon le terme pudique employé par ces temps de judiciarisation de la vie française, entre Soumission de Michel Houellebecq et le roman d’un auteur bien moins connu que ce dernier, L’Oreille de Lacan de Patrice Trigano. Pas un seul, je répète, pas un seul de nos si valeureux journalistes, pourtant si friands de polémiques parfois inventées de toutes pièces, n’a repris l’information, ne serait-ce que pour refaire à son compte ma petite enquête, l’infirmer ou la confirmer. Or, n’ai-je pas été, en l’occurrence, une espèce de lanceur d’alerte, expression à la mode écologiste, dans cette affaire ? Rien, silence total, typiquement journalistique. Puis j’ai bien trop de respect pour les romanciers, du moins les vrais romanciers, pour que je tente de les parodier, à une époque où n’importe qui, même ma boulangère et Raoul sur sa tire, Virginie Despentes et Yann Moix, peuvent être et même sont, paraît-il, des romanciers, célébrés comme tels, accueillis par tous les journalistes qui, même s’ils osent critiquer du bout de leur clavier tel ou tel aspect de leurs nullités, ne s’en tiennent pas moins à carreau. Virginie Despentes, comme je l’ai dit, vient même de rentrer dans le jury du Prix Goncourt qui, il est vrai, a récompensé sans le moindre sentiment de honte et même avec fierté je le suppose, cette année et l’année passée, deux nullités, Pas pleurer de Lydie Salvayre et Boussole de Mathias Enard. Il est vrai qu’il ne faut s’attendre à strictement rien, avec Bernard Pivot et Pierre Assouline, mais enfin, nous aurions pu estimer qu’il leur restait, à tout le moins, le sentiment du ridicule ! Moi, à mon niveau, modestement mas pas moins résolument, je remplis le rôle d’office de vigie dont parlait Sainte-Beuve, mais c’est aux romanciers, s’il en reste vraiment en France plus qu’une toute minuscule poignée, d’écrire de bons romans, pas à moi !
Tenez, j’ai récemment pointé, dans un long article fouillé, les très étranges coïncidences, selon le terme pudique employé par ces temps de judiciarisation de la vie française, entre Soumission de Michel Houellebecq et le roman d’un auteur bien moins connu que ce dernier, L’Oreille de Lacan de Patrice Trigano. Pas un seul, je répète, pas un seul de nos si valeureux journalistes, pourtant si friands de polémiques parfois inventées de toutes pièces, n’a repris l’information, ne serait-ce que pour refaire à son compte ma petite enquête, l’infirmer ou la confirmer. Or, n’ai-je pas été, en l’occurrence, une espèce de lanceur d’alerte, expression à la mode écologiste, dans cette affaire ? Rien, silence total, typiquement journalistique. Puis j’ai bien trop de respect pour les romanciers, du moins les vrais romanciers, pour que je tente de les parodier, à une époque où n’importe qui, même ma boulangère et Raoul sur sa tire, Virginie Despentes et Yann Moix, peuvent être et même sont, paraît-il, des romanciers, célébrés comme tels, accueillis par tous les journalistes qui, même s’ils osent critiquer du bout de leur clavier tel ou tel aspect de leurs nullités, ne s’en tiennent pas moins à carreau. Virginie Despentes, comme je l’ai dit, vient même de rentrer dans le jury du Prix Goncourt qui, il est vrai, a récompensé sans le moindre sentiment de honte et même avec fierté je le suppose, cette année et l’année passée, deux nullités, Pas pleurer de Lydie Salvayre et Boussole de Mathias Enard. Il est vrai qu’il ne faut s’attendre à strictement rien, avec Bernard Pivot et Pierre Assouline, mais enfin, nous aurions pu estimer qu’il leur restait, à tout le moins, le sentiment du ridicule ! Moi, à mon niveau, modestement mas pas moins résolument, je remplis le rôle d’office de vigie dont parlait Sainte-Beuve, mais c’est aux romanciers, s’il en reste vraiment en France plus qu’une toute minuscule poignée, d’écrire de bons romans, pas à moi !
Parmi les auteurs vivants qui trouvent grâce à vos yeux, vous n’avez pas cité Marc-Édouard Nabe… Était-ce une omission volontaire de votre part ?
Bien sûr. Hormis Alain Zannini, aucun des textes de Nabe n’a trouvé grâce comme vous dites à mes yeux, et certainement pas celui par lequel les béjaunes ont parfois découvert Léon Bloy, Au Régal des vermines. Je ne lis plus Nabe, comme je ne lis plus Dantec, comme je ne lis plus Soral et comme je ne vais pas tarder à ne plus lire Houellebecq. J’ai en tout cas relu ce texte de gamin fort en thème ou plutôt, point trop mauvais en thème, il y a quelques années, et il m’a frappé par la remarquable platitude de ses harangues, de ses trouvailles, de ses envolées, de ses « analyses », de son commentaire de Léon Bloy. Tout pue la copie appliquée, écrite en tirant la langue, en plaçant au bon endroit les petites références incontournables de tout infréquentable qui se respecte. Nabe n’est pas grand-chose, sauf peut-être pour sa grouillante cohorte de lecteurs hystériques, qui veillent au ridicule de leur idole naine comme une vestale à la flamme d’allumette dont elle a reçu la garde mais, en tout cas, il n’est certainement pas comme il le prétend le plus fier sinon le seul continuateur de Léon Bloy, dont l’imprécation n’avait de sens que parce qu’elle indiquait une trame invisible sur laquelle elle se détachait comme un éclair de chaleur, vers laquelle elle faisait signe. Qui a poursuivi l’œuvre du Mendiant ingrat, en France ? Nabe clament en chœur les imbéciles, et même l’excellent Pierre Glaudes avec lequel je suis en désaccord total sur ce point. Le dernier continuateur de Bloy, qui a du moins compris les implications théologiques de son long cri de misère et de méchanceté, mais aussi de son formidable commentaire des textes sacrés et de leur application à l’histoire, c’est Louis Massignon bien sûr ! De sorte que Nabe n’est pas seulement un Léon Bloy pour crétin antisémite ou imbécile soralien, mais un surgeon nanométrique et excité comme une femelle en période de chaleur du Mendiant ingrat, débarrassé qui plus est de tout arrière-monde, comme disait Bonnefoy, transcendant. Enlevez à Léon Bloy sa constante ferveur religieuse, sa prodigieuse intuition exégétique, vous aurez Marc-Édouard Nabe, dont l’œuvre se situe quelque part entre les latrines et le boudoir.
Critiquer, c’est juger. D’où tenez-vous votre magistère ?
Belle question, la plus difficile sans doute. Je vous remercie pour commencer de poser une égalité entre la critique littéraire et le jugement, à une époque où plus personne n’ose juger un livre, et d’abord celles et ceux qui sont payés pour le faire, les journalistes. Cette question, il y a un siècle, aurait sans doute été évacuée d’un haussement de sourcil mais, aujourd’hui, à présent que l’autorité, comme l’aura selon Walter Benjamin, a fondu comme neige au soleil, le Christ lui-même, s’il revenait sur terre, aurait quelque mal à nous assurer qu’il détient la clé, c’est-à-dire la légitimité, de tout pouvoir. C’est du reste de son propre vivant que le Christ a été raillé, soupçonné, invectivé et pour fini crucifié, de la même façon que, quelques siècles plus tard, seront moqués, soupçonnés, invectivés et parfois, pour Louis XVI, guillotiné, les rois de France qui tenaient de Dieu leur pouvoir, leur légitimité. L’époque contemporaine est exactement concomitante avec une perte de la notion de légitimité, partant de magistère et d’autorité, comme nous l’enseignent les problématiques propres à la théologie politique, singulièrement les réflexions d’un Carl Schmitt, que nos penseurs et intellectuels contemporains feraient bien, et de toute urgence, de relire.
Revenons à mon très modeste cas : je ne suis pas plus que n’importe qui légitime pour dire de Mathias Enard que c’est un auteur sans intérêt, pour prétendre que les essais de Richard Millet ne valent rien, ou que Yannick Haenel n’a même pas le talent suffisant, c’est dire, pour tourner une seule page d’un livre inutile de Philippe Sollers. Je ne suis pas davantage légitime pour affirmer que ce qui est encensé par la presse, neuf fois sur dix, ne vaut strictement rien et que nos gloires journalistiques, par exemple un Pierre Assouline, se déshonorent en faisant d’une Virginie Despentes l’un des jurés du Prix Goncourt lequel, c’est vrai, ne sait plus rien du tout de l’honneur comme nous pouvons le constater par ses dernières récompenses. Tout autant, je ne suis pas moins légitime qu’un autre pour trier le bon grain de l’ivraie et assurer mon rôle, plutôt ingrat. Cette réversibilité est au moins le bon côté d’une époque comme la nôtre, qui nous autorise à être jésuite à si bon compte, et de renvoyer dos à dos les contempteurs et les thuriféraires de la légitimité, à vrai dire les thuriféraires et les contempteurs de n’importe quelle notion, puisque tout se vaut, une rinçure post-moderne traduite par l’ignoble traducteur et écrivain qu’est Christophe Claro et Absalon, Absalon ! de William Faulkner.
Je pourrais certes, après quelques minutes de recherche, multiplier les exemples historiques et montrer que tout critique littéraire digne de ce nom a au moins une fois été confronté à la problématique crucifiante de sa légitimité : qui es-tu donc, toi, pour oser critiquer un livre, mon livre ? Lisant votre question, cela a même été ma première tentation, mais je crois qu’il faut ici répondre franchement, comme je l’ai fait : rien ne m’autorise à prétendre que Faulkner, Conrad, Melville, Bloy, Bernanos, Gadenne, Sebald ou Broch sont de grands, parfois même de très grands écrivains et que tel ou tel est un nain dont les livres, pourtant salués par la presse consanguine, ne valent rien. Mais regardez un peu, maintenant que mon blog est vieux de 10 années, si je me suis beaucoup trompé sur la valeur des livres que j’ai évoqués ! Car c’est après tout la meilleure réponse que je puis vous donner : mon autorité, en matière de critique littéraire, s’appuie sur elle-même. Tautologie ? Non, car cette autorité, je l’ai cent fois, mille fois remise en jeu, dans chacune de mes notes, en prenant le risque de me tromper, en prenant le risque qu’un autre lecteur affirme, et prouve par-dessus le marché, que Richard Millet, lorsqu’il joue à l’essayiste martial ayant tutoyé le phalangiste chrétien durant la Guerre du Liban, n’est absolument pas ridicule et même convaincant sinon légitime, en affirmant par exemple, contre ce que j’en dis, qu’une virgule de Nabe vaut après tout une virgule de Bloy, ou que l’exotisme en carton-pâte de Mathias Enard n’est vraiment pas une plaisanterie pour attachée de presse germanopratine pensant que Moravagine est le nom d’un groupe de musique punk italien avant que d’être un magnifique roman de Blaise Cendrars.
Poursuivons. Tout bon lecteur se sera demandé pour quelle raison j’ai eu besoin d’invoquer le Christ en vous répondant. Orgueil démesuré ? Application des thèses, milles fois éventées désormais, de René Girard à ma petite personne sacrificielle ? J’ai évoqué l’exemple du Christ pour deux raisons. D’abord pour rattacher cette question extraordinairement complexe de la légitimité à son socle véritable qui implique, du moins pour un Occidental, un fondement surnaturel, un geste créateur qui commence la longue chaîne des causes entraînant les conséquences. Il faut bien, à un moment donné, que la concaténation soit brisée, sauf à devenir fou dans une vaine tentative de saisir la cause initiale, celle que rien n’explique et de laquelle tout provient. Cette cause est le Verbe, le Christ donc pour un chrétien. Le Christ s’est prétendu Dieu et Fils de Dieu, et c’est cette prétention inouïe, en fondant son magistère, qui lui a conféré une autorité à nulle autre pareille, dont le phénomène du leader charismatique analysé par le regretté Jean-Luc Evard n’est que le plus récent des surgeons, certes dévoyés.
Tout autant, ce même bon lecteur aura compris qu’il y a en somme, dans tout exercice honnête de critique littéraire, et à condition bien sûr qu’elle se sépare (sans du moins les ignorer) des petits jeux universitaires, de tout ce que Merleau-Ponty appelait les langages seconds, une dimension de risque, une « corne de taureau » à laquelle il faut s’exposer selon Michel Leiris. Pour le dire autrement, si le critique littéraire est un juge auquel il est impossible de demander d’être impartial, il est aussi celui qui assume sa responsabilité, qui prend sur lui, comme le dit cette merveilleuse expression, son propre jugement, le fonde par son autorité et son exemplarité et, d’une certaine façon point si imagée que cela, se sacrifie en fin de compte, un peu comme le héros de La Chute de Camus : juge, bourreau si l’on veut et sacrifié. Pourquoi diable se sacrifierait-il, ce critique que l’on jugera un peu trop pressé de faire partie de tous les raouts, du plus grand nombre de jurys possibles et qui, comble de l’entreléchage, écrira même des romans tout juste oubliables que ses confrères s’empresseront de saluer ? Parce que, avant de penser à lui-même, il pense à l’œuvre qu’il doit s’efforcer de servir. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le critique littéraire d’un peu de poids est celui qui jamais ne se sert en premier, mais qui sert les autres, en servant l’œuvre qu’il commente. Il s’oublie, alors que le moindre écrivaillon, aujourd’hui, oubliera sans problème ni remords la littérature depuis l’épopée de Gilgamesh, mais sera parfaitement incapable de jamais oublier ses petites souillures, sa petite personne. Le cri du monde contemporain est un immense MOI qui résonne sans fin dans le vide !
Critiquer, c’est juger bien sûr, et ce jugement s’appuie tout de même sur la lecture fine et attentive d’autant d’œuvres que possible, de toutes les œuvres qui comptent, ajouterait quelque fanatique de Borges qui aurait raison, au rebours de ce que les ânes contemporains imaginent être un véritable exercice de lecture, réduit dans leur esprit à la simple diffusion, de préférence conviviale et châtrée, d’une opinion qui, comme les goûts et les couleurs n’est-ce pas… Mais critiquer, c’est surtout s’exposer, sacrifier son petit confort intellectuel au risque d’être traité de tous les noms, et d’abord de celui d’envieux ou de raté. J’ai eu ma dose d’insultes, croyez-moi, des tombereaux de merde déversés par les thuriféraires de la clique sollersienne, de la clique nabienne, de la clique soralienne, de la clique camusienne et milletienne (c’est à peu de chose près une seule et même clique), de toutes les cliques dont j’ai ridiculisé quelque peu les prétentions littéraires et intellectuelles. J’en recevrais encore, des insultes, c’est une évidence. Cela n’est rien finalement, un peu d’abnégation contrainte et d’humilité bienvenue, versés comme un acide sur la plaie du nombrilisme et de la vanité qu’entretient si scrupuleusement notre époque, auxquels je n’échappe moi-même qu’en partie bien sûr. Ce qui compte, au travers même du mépris et des moqueries auxquels un critique pourra cependant être las de faire face (et que dire du silence auquel il s’expose, seule arme des lâches, mais ô combien redoutable !), c’est de faire découvrir à une poignée de lecteurs un Vincent La Soudière, un Robert Penn Warren, un Paul Gadenne, et de leur permettre de lire ou même relire de grands romans comme Au-dessous du volcan ou bien La Mort de Virgile. Cela seul compte. Et comptera.
Stalker : le blog de Juan Asensio





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
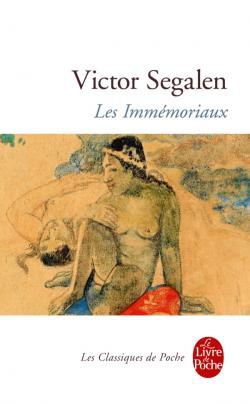 Mise en ligne par Arthur Yasmine, poète vivant.
Mise en ligne par Arthur Yasmine, poète vivant.


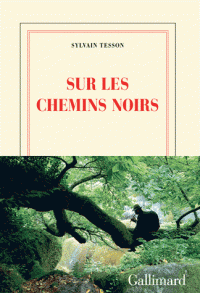 Pendant deux mois et demi, du 24 août au 8 novembre, Sylvain Tesson va parcourir ce qu'il nomme les chemins noirs, d'après le titre du livre de René Frégni,
Pendant deux mois et demi, du 24 août au 8 novembre, Sylvain Tesson va parcourir ce qu'il nomme les chemins noirs, d'après le titre du livre de René Frégni, 
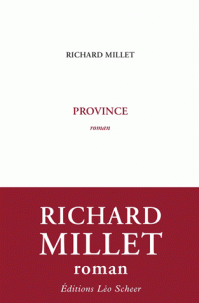 Cela n’a pas réussi à tarir sa production littéraire, ni à le priver de son talent. D’autres éditeurs à l’esprit libre, Pierre-Guillaume de Roux, Fata Morgana, Léo Scheer, L’Orient des livres, Les Provinciales, publient ses dernières oeuvres. Province, roman sur le délitement de la société française, est la dernière en date.
Cela n’a pas réussi à tarir sa production littéraire, ni à le priver de son talent. D’autres éditeurs à l’esprit libre, Pierre-Guillaume de Roux, Fata Morgana, Léo Scheer, L’Orient des livres, Les Provinciales, publient ses dernières oeuvres. Province, roman sur le délitement de la société française, est la dernière en date.
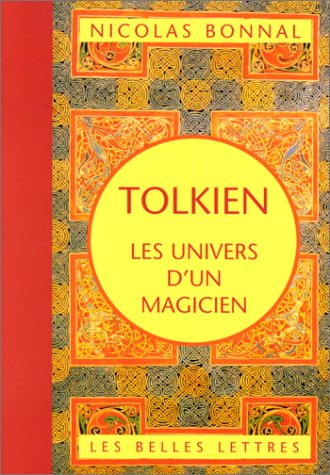 Question :
Question : 

 Absolument tous les reproches, et les plus durs, peuvent être faits à François Mitterrand, mais enfin, c’était un assez bon lettré, aimant comme vous le savez passionnément l’œuvre d’Ernst Jünger, qu’il connaissait personnellement. Je me souviens d’avoir lu qu’il reprocha un jour à un certain Alain Juppé qui joue aujourd’hui les revenants arrogants, de ne pas connaître Paul Gadenne. S’il n’y avait qu’Alain Juppé qui ignorât l’auteur de La plage de Scheveningen, l’un des plus beaux et grands romans du siècle passé ! Qui connaît encore, hélas, le profond et tourmenté Paul Gadenne ? Certainement pas le crétin hollandais, dont on se demande même s’il a jamais entendu parler d’un mot aussi bizarre et incongru que celui de « littérature » ! Quoi qu’il en soit, j’ai lu Rebatet jeune, trop jeune peut-être et, comme tant d’autres auteurs, il me faut à présent le relire, alors qu’il semble jouir d’une certaine actualité, du moins éditoriale, qui ne s’est pas encore vraiment étendue à des auteurs comme Brasillach (évoqué par Gadenne, qui fut son condisciple en khâgne, dans le roman que j’ai indiqué, sous les traits d’un personnage du nom d’Hersent), Brasillach dont il faut lire Notre avant-guerre, ou bien le pestiféré Abel Bonnard, dont Les Modérés sont une radiographie de la France politique encore pertinente. Je me souviens en tout cas d’avoir estimé, du haut de mes 14 ou 15 ans, que Les Deux Étendards, roman au titre génial, disséquait la France de l’entre-deux guerres avec une profondeur spirituelle absente des romans de Céline, et ce seul souvenir me donne envie de relire ce roman qui avait la réputation, il n’y a pas si longtemps que cela, d’être maudit. Par ailleurs, j’allais, quelques années plus tard, retrouver le nom de Rebatet sous la plume de George Steiner, qui n’a jamais cessé de clamer son admiration pour ce roman, tout en traitant son auteur de salopard. J’ai d’ailleurs commencé ma relecture des Décombres qui vient d’être réédité, après avoir aussi relu le Rebatet de Pol Vandromme et en faisant un crochet par Les Réprouvés d’Ernst von Salomon, décrivant la nécessité d’une refondation de l’Allemagne humiliée par les sanctions des alliés et rongée par la gangrène communiste que les corps francs tentent de contenir, voire d’éradiquer. Il n’est donc pas étonnant que Lucien Rebatet, de même que d’autres qui ont décrit la complexité d’une époque où la France cherchait une forme de renaissance politique tout autant que sociale, voire spirituelle, intéresse et même fascine de nouveau, y compris les jeunes si on leur apprend encore à lire, maintenant que notre pays traverse une crise qui sera mortelle si aucun sursaut, de réelle profondeur et pas cosmétique, ne le sauve. Et puis, à tout prendre, je préfère un jeune gars un peu borné nourri au petit lait de Charles Maurras, mais qui aura au moins lu, et avec passion, Bloy, Bernanos, Jünger, Von Salomon, Rebatet, Brasillach, Hansum ou Pasolini et quelques autres encore sur lesquels planent de vilains soupçons, plutôt qu’un crétin ripoliné fraîchement hypokhâgneux qui n’aura sucé que les mamelles desséchées de Gérard Genette et de Roland Barthes, l’esprit tout farci des fadaises naturalistes sans style de Maupassant et de Zola, et qui finira sous-pigiste à Télérama ou aux Inrockuptibles, à saluer le gras loukoum à orientalisme germanopratin goncourisé d’un Mathias Enard. La passion, l’excès, le courage, plutôt que ces sépulcres déjà blanchis rêvant carrière et petite épouse sage rencontrée à l’école et qui finira comme eux professeur dans le meilleur des cas, à l’âge où Jean-René Huguenin savait qu’il n’égalerait jamais Rimbaud et Carlo Michelstaedter se tirait une balle dans la tête après avoir écrit le dernier mot de sa Persuasion et la rhétorique !
Absolument tous les reproches, et les plus durs, peuvent être faits à François Mitterrand, mais enfin, c’était un assez bon lettré, aimant comme vous le savez passionnément l’œuvre d’Ernst Jünger, qu’il connaissait personnellement. Je me souviens d’avoir lu qu’il reprocha un jour à un certain Alain Juppé qui joue aujourd’hui les revenants arrogants, de ne pas connaître Paul Gadenne. S’il n’y avait qu’Alain Juppé qui ignorât l’auteur de La plage de Scheveningen, l’un des plus beaux et grands romans du siècle passé ! Qui connaît encore, hélas, le profond et tourmenté Paul Gadenne ? Certainement pas le crétin hollandais, dont on se demande même s’il a jamais entendu parler d’un mot aussi bizarre et incongru que celui de « littérature » ! Quoi qu’il en soit, j’ai lu Rebatet jeune, trop jeune peut-être et, comme tant d’autres auteurs, il me faut à présent le relire, alors qu’il semble jouir d’une certaine actualité, du moins éditoriale, qui ne s’est pas encore vraiment étendue à des auteurs comme Brasillach (évoqué par Gadenne, qui fut son condisciple en khâgne, dans le roman que j’ai indiqué, sous les traits d’un personnage du nom d’Hersent), Brasillach dont il faut lire Notre avant-guerre, ou bien le pestiféré Abel Bonnard, dont Les Modérés sont une radiographie de la France politique encore pertinente. Je me souviens en tout cas d’avoir estimé, du haut de mes 14 ou 15 ans, que Les Deux Étendards, roman au titre génial, disséquait la France de l’entre-deux guerres avec une profondeur spirituelle absente des romans de Céline, et ce seul souvenir me donne envie de relire ce roman qui avait la réputation, il n’y a pas si longtemps que cela, d’être maudit. Par ailleurs, j’allais, quelques années plus tard, retrouver le nom de Rebatet sous la plume de George Steiner, qui n’a jamais cessé de clamer son admiration pour ce roman, tout en traitant son auteur de salopard. J’ai d’ailleurs commencé ma relecture des Décombres qui vient d’être réédité, après avoir aussi relu le Rebatet de Pol Vandromme et en faisant un crochet par Les Réprouvés d’Ernst von Salomon, décrivant la nécessité d’une refondation de l’Allemagne humiliée par les sanctions des alliés et rongée par la gangrène communiste que les corps francs tentent de contenir, voire d’éradiquer. Il n’est donc pas étonnant que Lucien Rebatet, de même que d’autres qui ont décrit la complexité d’une époque où la France cherchait une forme de renaissance politique tout autant que sociale, voire spirituelle, intéresse et même fascine de nouveau, y compris les jeunes si on leur apprend encore à lire, maintenant que notre pays traverse une crise qui sera mortelle si aucun sursaut, de réelle profondeur et pas cosmétique, ne le sauve. Et puis, à tout prendre, je préfère un jeune gars un peu borné nourri au petit lait de Charles Maurras, mais qui aura au moins lu, et avec passion, Bloy, Bernanos, Jünger, Von Salomon, Rebatet, Brasillach, Hansum ou Pasolini et quelques autres encore sur lesquels planent de vilains soupçons, plutôt qu’un crétin ripoliné fraîchement hypokhâgneux qui n’aura sucé que les mamelles desséchées de Gérard Genette et de Roland Barthes, l’esprit tout farci des fadaises naturalistes sans style de Maupassant et de Zola, et qui finira sous-pigiste à Télérama ou aux Inrockuptibles, à saluer le gras loukoum à orientalisme germanopratin goncourisé d’un Mathias Enard. La passion, l’excès, le courage, plutôt que ces sépulcres déjà blanchis rêvant carrière et petite épouse sage rencontrée à l’école et qui finira comme eux professeur dans le meilleur des cas, à l’âge où Jean-René Huguenin savait qu’il n’égalerait jamais Rimbaud et Carlo Michelstaedter se tirait une balle dans la tête après avoir écrit le dernier mot de sa Persuasion et la rhétorique !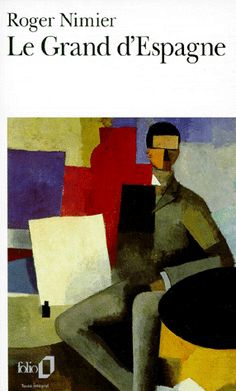 Les Hussards sont des auteurs que je connais finalement assez peu, n’ayant lu que quelques ouvrages de Chardonne, Laurent ou Nimier, bien sûr Les Épées mais aussi Le Grand d’Espagne, qui évoque Georges Bernanos. Comme bien d’autres (je songe ainsi à Péguy, transformé, par l’opération du Saint-Esprit sans doute, en auteur et même penseur de droite), ils ont été d’une certaine façon abâtardis, journalisés par tout un tas de leurs épigones plus ou moins inspirés, revendiqués ou pas. D’ici peu, Causeur leur consacrera un dossier, si ce n’est déjà fait, et c’est ainsi qu’ils seront happés et hachés menu, puis accrochés au plafond, au milieu d’autres andouilles d’appellation et d’origine contrôlées comme Philippe Muray, devenu le saint patron de la Réaction puérile à laquelle nous assistons. Très peu pour moi que cet eczéma purement journalistique, que quelques petits Mohicans attendant les Cosaques et une paire de jolies fesses, y compris celles du Saint-Esprit, gratteront en croyant découvrir des cavernes d’originalité. Il me semble, au cas où vous me poseriez cette question, que l’esprit des Hussards a survécu plus qu’il ne survit, car il semble désormais bien mort, le temps où une seule phrase, aiguisée comme le morfil d’une dague, pouvait d’un trait précis clouer une vieille chouette radoteuse. Le dernier rétiaire de ce genre, altier et redoutable, même s’il a parfois trop donné dans un hermétisme littéraire de pacotille, était Dominique de Roux, et un livre tel qu’Immédiatement, publié aujourd’hui, vaudrait à son auteur une bonne quinzaine de procès, et une chasse à l’homme en règle, qu’il eut d’ailleurs à subir de son vivant. Je songe aussi à l’exemple tragique et lumineux de Jean-René Huguenin, mort en 1962 comme Nimier, également dans un accident de voiture. Je songe encore à Guy Dupré, hélas si profondément méconnu voire ignoré par nos élites littéraires ou ce qui en tient lieu, lequel d’ailleurs a écrit un de ses textes si subtils et profondément littéraires sur Sunsiaré de Larcône (recueilli dans Les Manœuvres d’automne), une belle femme que tout Hussard a dû tour à tour envier et maudire au moins une fois !
Les Hussards sont des auteurs que je connais finalement assez peu, n’ayant lu que quelques ouvrages de Chardonne, Laurent ou Nimier, bien sûr Les Épées mais aussi Le Grand d’Espagne, qui évoque Georges Bernanos. Comme bien d’autres (je songe ainsi à Péguy, transformé, par l’opération du Saint-Esprit sans doute, en auteur et même penseur de droite), ils ont été d’une certaine façon abâtardis, journalisés par tout un tas de leurs épigones plus ou moins inspirés, revendiqués ou pas. D’ici peu, Causeur leur consacrera un dossier, si ce n’est déjà fait, et c’est ainsi qu’ils seront happés et hachés menu, puis accrochés au plafond, au milieu d’autres andouilles d’appellation et d’origine contrôlées comme Philippe Muray, devenu le saint patron de la Réaction puérile à laquelle nous assistons. Très peu pour moi que cet eczéma purement journalistique, que quelques petits Mohicans attendant les Cosaques et une paire de jolies fesses, y compris celles du Saint-Esprit, gratteront en croyant découvrir des cavernes d’originalité. Il me semble, au cas où vous me poseriez cette question, que l’esprit des Hussards a survécu plus qu’il ne survit, car il semble désormais bien mort, le temps où une seule phrase, aiguisée comme le morfil d’une dague, pouvait d’un trait précis clouer une vieille chouette radoteuse. Le dernier rétiaire de ce genre, altier et redoutable, même s’il a parfois trop donné dans un hermétisme littéraire de pacotille, était Dominique de Roux, et un livre tel qu’Immédiatement, publié aujourd’hui, vaudrait à son auteur une bonne quinzaine de procès, et une chasse à l’homme en règle, qu’il eut d’ailleurs à subir de son vivant. Je songe aussi à l’exemple tragique et lumineux de Jean-René Huguenin, mort en 1962 comme Nimier, également dans un accident de voiture. Je songe encore à Guy Dupré, hélas si profondément méconnu voire ignoré par nos élites littéraires ou ce qui en tient lieu, lequel d’ailleurs a écrit un de ses textes si subtils et profondément littéraires sur Sunsiaré de Larcône (recueilli dans Les Manœuvres d’automne), une belle femme que tout Hussard a dû tour à tour envier et maudire au moins une fois !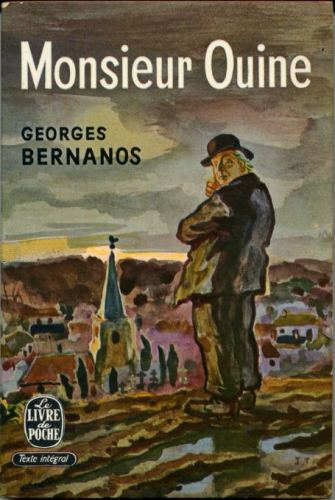 Mon intérêt pour la figuration littéraire du démoniaque n’a pu être que conforté par la découverte de l’œuvre romanesque de Georges Bernanos, qui devait culminer par la lecture de Monsieur Ouine, réputé, à juste titre, comme étant le roman le plus difficile de l’auteur et qui, du diable et du démoniaque, donne une peinture absolument fascinante. J’ai tenté d’éclairer de plusieurs façons ce roman, par exemple en le rapprochant de l’hermétisme démoniaque tel que le développe Kierkegaard ou bien en en proposant une lecture comparée avec Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, par le biais de l’étude de la voix des personnages principaux, Kurtz et l’ancien professeur de langues, tous deux maîtres d’un langage dévoyé. Bien évidemment, aucune mention de ces travaux (et d’autres, comme l’influence plus ou moins souterraine d’Arthur Machen sur Sous le soleil de Satan, par le biais de la si belle traduction que Paul-Jean Toulet donna du Grand Dieu Pan) dans la nouvelle édition des œuvres romanesques de Bernanos en Pléiade mais, comme c’est Monique Gosselin-Noat qui a été chargée par Max Milner de l’édition de Monsieur Ouine, il ne fallait certes pas s’attendre à ce qu’elle mentionne autre chose que ses petites fadaises universitaires !
Mon intérêt pour la figuration littéraire du démoniaque n’a pu être que conforté par la découverte de l’œuvre romanesque de Georges Bernanos, qui devait culminer par la lecture de Monsieur Ouine, réputé, à juste titre, comme étant le roman le plus difficile de l’auteur et qui, du diable et du démoniaque, donne une peinture absolument fascinante. J’ai tenté d’éclairer de plusieurs façons ce roman, par exemple en le rapprochant de l’hermétisme démoniaque tel que le développe Kierkegaard ou bien en en proposant une lecture comparée avec Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, par le biais de l’étude de la voix des personnages principaux, Kurtz et l’ancien professeur de langues, tous deux maîtres d’un langage dévoyé. Bien évidemment, aucune mention de ces travaux (et d’autres, comme l’influence plus ou moins souterraine d’Arthur Machen sur Sous le soleil de Satan, par le biais de la si belle traduction que Paul-Jean Toulet donna du Grand Dieu Pan) dans la nouvelle édition des œuvres romanesques de Bernanos en Pléiade mais, comme c’est Monique Gosselin-Noat qui a été chargée par Max Milner de l’édition de Monsieur Ouine, il ne fallait certes pas s’attendre à ce qu’elle mentionne autre chose que ses petites fadaises universitaires !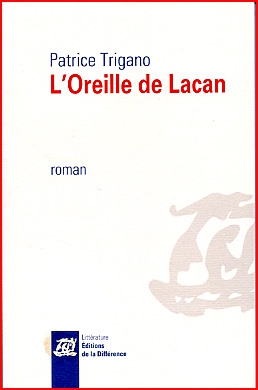 Tenez, j’ai récemment pointé, dans un long article fouillé, les très étranges coïncidences, selon le terme pudique employé par ces temps de judiciarisation de la vie française, entre Soumission de Michel Houellebecq et le roman d’un auteur bien moins connu que ce dernier,
Tenez, j’ai récemment pointé, dans un long article fouillé, les très étranges coïncidences, selon le terme pudique employé par ces temps de judiciarisation de la vie française, entre Soumission de Michel Houellebecq et le roman d’un auteur bien moins connu que ce dernier, 
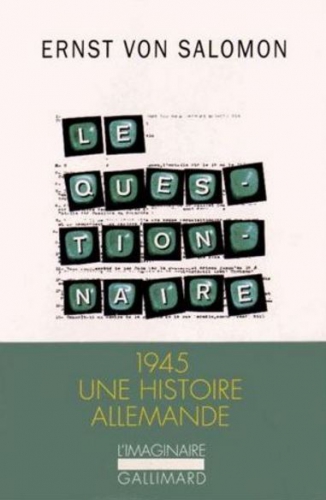 L’architecture générale du livre s’appuie sur les quelques 130 questions auxquelles les Américains demandèrent aux Allemands de répondre en 1945 afin d’organiser la dénazification du pays, mais en les détournant souvent et prenant à de nombreuses reprises le contre-pied des attentes des vainqueurs. A bien des égards, le livre est ainsi non seulement à contre-courant de la doxa habituelle, mais camoufle également bien des aspects d’une réalité que l’Allemagne de la fin des années 1940 refusait de reconnaître : « Ma conscience devenue très sensible me fait craindre de participer à un acte capable, dans ces circonstances incontrôlables, de nuire sur l’ordre de puissances étrangères à un pays et à un peuple dont je suis irrévocablement ». Certaines questions font l’objet de longs développements, mais presque systématiquement un humour grinçant y est présent, comme lorsqu’il s’agit simplement d’indiquer son lieu de naissance : « Je découvre avec étonnement que, grâce à mon lieu de naissance (Kiel), je peux me considérer comme un homme nordique, et l’idée qu’en comparaison avec ma situation les New-Yorkais doivent passer pour des Méridionaux pleins de tempérament m’amuse beaucoup ». Et à la même question, à propos des manifestations des SA dans la ville avant la prise du pouvoir par les nazis : « Certes, la couleur de leurs uniformes était affreuse, mais on ne regarde pas l’habit d’un homme, on regarde son coeur. On ne savait pas au juste ce que ces gens-là voulaient. Du moins semblaient-ils le vouloir avec fermeté … Ils avaient de l’élan, on était bien obligé de le reconnaître, et ils étaient merveilleusement organisés. Voilà ce qu’il nous fallait : élan et organisation ». Au fil des pages, il revient à plusieurs reprises sur son attachement à la Prusse traditionnelle, retrace l’histoire de sa famille, développe ses relations compliquées avec les religions et les Eglises, évoque des liens avec de nombreuses personnes juives (dont sa femme), donne de longues précisions sur ses motivations à l’époque de l’assassinat de Rathenau, sur son procès ultérieur et sur son séjour en prison. Suivant le fil des questions posées, il détaille son éducation, son cursus scolaire, son engagement dans les mouvements subversifs « secrets », retrace ses activités professionnelles successives avec un détachement qui parfois peu surprendre mais correspond à l’humour un peu grinçant qui irrigue le texte, comme lorsqu’il parle de son éditeur et ami Rowohlt. Il revient bien sûr longuement sur les corps francs entre 1919 et 1923, sur l’impossibilité à laquelle il se heurte au début de la Seconde guerre mondiale pour faire accepter son engagement volontaire, tout en racontant qu’il avait obtenu en 1919 la plus haute de ses neuf décorations en ayant rapporté à son commandant… « un pot de crème fraîche. Il avait tellement envie de manger un poulet à la crème ! ». Toujours ce côté décalé, ce deuxième degré que les Américains n’ont probablement pas compris. La première rencontre avec Hitler, le putsch de 1923, la place des élites bavaroises et leurs rapports avec l’armée de von Seeckt, la propagande électorale à la fin des années 1920, et après l’arrivée au pouvoir du NSDAP les actions (et les doutes) des associations d’anciens combattants et de la SA, sont autant de thèmes abordés au fil des pages, toujours en se présentant et en montrant la situation de l’époque avec détachement, presque éloignement, tout en étant semble-t-il hostile sur le fond et désabusé dans la forme. Les propos qu’il tient au sujet de la nuit des longs couteaux sont parfois étonnants, mais finalement « dans ces circonstances, chaque acte est un crime, la seule chose qui nous reste est l’inaction. C’est en tout cas la seule attitude décente ». Ce n’est finalement qu’en 1944 qu’il lui est demandé de prêter serment au Führer dans le cadre de la montée en puissance du Volkssturm, mais « l’homme qui me demandait le serment exigeait de moi que je défende la patrie. Mais je savais que ce même homme jugeait le peuple allemand indigne de survivre à sa défaite ». Conclusion : défendre la patrie « ne pouvait signifier autre chose que de la préserver de la destruction ». Toujours les paradoxes. Dans la dernière partie, le comportement des Américains vainqueurs est souvent présenté de manière négative, évoque les difficultés quotidiennes dans son petit village de haute Bavière : une façon de presque renvoyer dos-à-dos imbécilité nazie et bêtise alliée… et donc de s’exonérer soi-même.
L’architecture générale du livre s’appuie sur les quelques 130 questions auxquelles les Américains demandèrent aux Allemands de répondre en 1945 afin d’organiser la dénazification du pays, mais en les détournant souvent et prenant à de nombreuses reprises le contre-pied des attentes des vainqueurs. A bien des égards, le livre est ainsi non seulement à contre-courant de la doxa habituelle, mais camoufle également bien des aspects d’une réalité que l’Allemagne de la fin des années 1940 refusait de reconnaître : « Ma conscience devenue très sensible me fait craindre de participer à un acte capable, dans ces circonstances incontrôlables, de nuire sur l’ordre de puissances étrangères à un pays et à un peuple dont je suis irrévocablement ». Certaines questions font l’objet de longs développements, mais presque systématiquement un humour grinçant y est présent, comme lorsqu’il s’agit simplement d’indiquer son lieu de naissance : « Je découvre avec étonnement que, grâce à mon lieu de naissance (Kiel), je peux me considérer comme un homme nordique, et l’idée qu’en comparaison avec ma situation les New-Yorkais doivent passer pour des Méridionaux pleins de tempérament m’amuse beaucoup ». Et à la même question, à propos des manifestations des SA dans la ville avant la prise du pouvoir par les nazis : « Certes, la couleur de leurs uniformes était affreuse, mais on ne regarde pas l’habit d’un homme, on regarde son coeur. On ne savait pas au juste ce que ces gens-là voulaient. Du moins semblaient-ils le vouloir avec fermeté … Ils avaient de l’élan, on était bien obligé de le reconnaître, et ils étaient merveilleusement organisés. Voilà ce qu’il nous fallait : élan et organisation ». Au fil des pages, il revient à plusieurs reprises sur son attachement à la Prusse traditionnelle, retrace l’histoire de sa famille, développe ses relations compliquées avec les religions et les Eglises, évoque des liens avec de nombreuses personnes juives (dont sa femme), donne de longues précisions sur ses motivations à l’époque de l’assassinat de Rathenau, sur son procès ultérieur et sur son séjour en prison. Suivant le fil des questions posées, il détaille son éducation, son cursus scolaire, son engagement dans les mouvements subversifs « secrets », retrace ses activités professionnelles successives avec un détachement qui parfois peu surprendre mais correspond à l’humour un peu grinçant qui irrigue le texte, comme lorsqu’il parle de son éditeur et ami Rowohlt. Il revient bien sûr longuement sur les corps francs entre 1919 et 1923, sur l’impossibilité à laquelle il se heurte au début de la Seconde guerre mondiale pour faire accepter son engagement volontaire, tout en racontant qu’il avait obtenu en 1919 la plus haute de ses neuf décorations en ayant rapporté à son commandant… « un pot de crème fraîche. Il avait tellement envie de manger un poulet à la crème ! ». Toujours ce côté décalé, ce deuxième degré que les Américains n’ont probablement pas compris. La première rencontre avec Hitler, le putsch de 1923, la place des élites bavaroises et leurs rapports avec l’armée de von Seeckt, la propagande électorale à la fin des années 1920, et après l’arrivée au pouvoir du NSDAP les actions (et les doutes) des associations d’anciens combattants et de la SA, sont autant de thèmes abordés au fil des pages, toujours en se présentant et en montrant la situation de l’époque avec détachement, presque éloignement, tout en étant semble-t-il hostile sur le fond et désabusé dans la forme. Les propos qu’il tient au sujet de la nuit des longs couteaux sont parfois étonnants, mais finalement « dans ces circonstances, chaque acte est un crime, la seule chose qui nous reste est l’inaction. C’est en tout cas la seule attitude décente ». Ce n’est finalement qu’en 1944 qu’il lui est demandé de prêter serment au Führer dans le cadre de la montée en puissance du Volkssturm, mais « l’homme qui me demandait le serment exigeait de moi que je défende la patrie. Mais je savais que ce même homme jugeait le peuple allemand indigne de survivre à sa défaite ». Conclusion : défendre la patrie « ne pouvait signifier autre chose que de la préserver de la destruction ». Toujours les paradoxes. Dans la dernière partie, le comportement des Américains vainqueurs est souvent présenté de manière négative, évoque les difficultés quotidiennes dans son petit village de haute Bavière : une façon de presque renvoyer dos-à-dos imbécilité nazie et bêtise alliée… et donc de s’exonérer soi-même.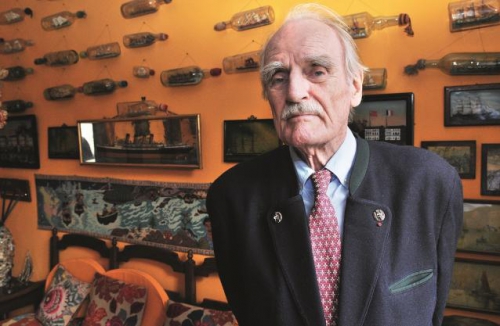
 De ces périples naquirent plusieurs recueils, notamment Secouons le cocotier, récit paradoxal de son séjour dans les îles des Caraïbes, Antilles françaises, îles néerlandaises et britanniques, îles indépendantes. Raspail s'y fit observateur et conteur d'une réalité souvent éteinte ou subsistant dans une forme dégénérée, comme chez les peuples blancs de ces îlots de la Guadeloupe, descendants des plus vieilles familles de France, vivant entre eux, reclus, pauvres parmi les pauvres depuis deux siècles. Cette évocation douloureuse prend aussi une coloration toute spéciale sous sa plume, celle de la fixité d'un temps arrêté au milieu de la course du monde. Tout en décrivant à plaisir l'irruption de la modernité aux Antilles, avec les premiers postes de télévision ou les retombées de « l'argent braguette » sur les modes de vie, il s'arrête sur ces survivances, ces témoignages de temps éteints, d'Antilles blanches révolues. C'est avec la même affection pleine d'amertume qu'il conclut son essai avec Haïti, seul pays des Caraïbes resté à peu près pur face à l'américanisation (rappelons que ce témoignage date du début des années 1960), pur face à l'occidentalisation, pur dans son africanité libérée depuis cent-soixante-dix ans alors. Mais comme cette pureté conduit l'île dans le mur, on ne peut s'empêcher de soupirer. Le temps mental des hommes de l'île s'est arrêté, pas le temps biologique, et la démographie galopante autant que la dégradation de l'habitat laissent songeur. En lisant le Raspail d'il y a cinquante ans, on se rend compte que Haïti n'a pas changé. Ici, la confrontation entre l'immobilité de l'esprit national haïtien et la marche du monde matériel haïtien rendent un résultat explosif.
De ces périples naquirent plusieurs recueils, notamment Secouons le cocotier, récit paradoxal de son séjour dans les îles des Caraïbes, Antilles françaises, îles néerlandaises et britanniques, îles indépendantes. Raspail s'y fit observateur et conteur d'une réalité souvent éteinte ou subsistant dans une forme dégénérée, comme chez les peuples blancs de ces îlots de la Guadeloupe, descendants des plus vieilles familles de France, vivant entre eux, reclus, pauvres parmi les pauvres depuis deux siècles. Cette évocation douloureuse prend aussi une coloration toute spéciale sous sa plume, celle de la fixité d'un temps arrêté au milieu de la course du monde. Tout en décrivant à plaisir l'irruption de la modernité aux Antilles, avec les premiers postes de télévision ou les retombées de « l'argent braguette » sur les modes de vie, il s'arrête sur ces survivances, ces témoignages de temps éteints, d'Antilles blanches révolues. C'est avec la même affection pleine d'amertume qu'il conclut son essai avec Haïti, seul pays des Caraïbes resté à peu près pur face à l'américanisation (rappelons que ce témoignage date du début des années 1960), pur face à l'occidentalisation, pur dans son africanité libérée depuis cent-soixante-dix ans alors. Mais comme cette pureté conduit l'île dans le mur, on ne peut s'empêcher de soupirer. Le temps mental des hommes de l'île s'est arrêté, pas le temps biologique, et la démographie galopante autant que la dégradation de l'habitat laissent songeur. En lisant le Raspail d'il y a cinquante ans, on se rend compte que Haïti n'a pas changé. Ici, la confrontation entre l'immobilité de l'esprit national haïtien et la marche du monde matériel haïtien rendent un résultat explosif.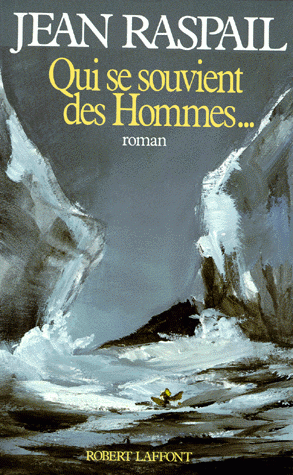 Ce souci de rendre témoignage de peuples lointains a trouvé, bien sûr, sa pleine expression en Patagonie. Dans Qui se souvient des Hommes ? Nous suivons pas à pas la destinée du peuple des Alakalufs, qui eux-mêmes s'appelaient les Kaweskars, les Hommes, car ils n'en connurent longtemps pas d'autres qu'eux-mêmes, dans cet univers liquide et glacé du détroit de Magellan. Les Kaweskars, Raspail en rencontra lui-même une famille dans un canot, alors qu'il naviguait sur un bateau de guerre chilien. Il est peut-être le dernier blanc à en avoir vu. Ce peuple, authentiquement disparu, non par extermination, mais par digestion au sein des autres peuples, n'a pas laissé de traces, que quelques photos, de rares vestiges archéologiques, une poussière. Digéré va bien pour qualifier la disparition de ce peuple, plus que l'assimilation, car il s'agit de tout un processus de dégradation et de déliquescence qui a frappé ces familles au fur et à mesure qu'elles rejoignirent les civilisés en Argentine et au Chili. Certains tombèrent en telle décadence physique et morale qu'ils en moururent de langueur au milieu des prévenances empressées de toutes les charités des missionnaires, généreux en médicaments, en nourriture, en bons lits et en cabanes chauffées mais qui n'avaient plus la saveur du pays. Les Alakalufs vivaient encore à l'âge de pierre lorsqu'ils furent brutalement projetés dans la modernité occidentale qui les maltraita d'abord avant de les protéger.
Ce souci de rendre témoignage de peuples lointains a trouvé, bien sûr, sa pleine expression en Patagonie. Dans Qui se souvient des Hommes ? Nous suivons pas à pas la destinée du peuple des Alakalufs, qui eux-mêmes s'appelaient les Kaweskars, les Hommes, car ils n'en connurent longtemps pas d'autres qu'eux-mêmes, dans cet univers liquide et glacé du détroit de Magellan. Les Kaweskars, Raspail en rencontra lui-même une famille dans un canot, alors qu'il naviguait sur un bateau de guerre chilien. Il est peut-être le dernier blanc à en avoir vu. Ce peuple, authentiquement disparu, non par extermination, mais par digestion au sein des autres peuples, n'a pas laissé de traces, que quelques photos, de rares vestiges archéologiques, une poussière. Digéré va bien pour qualifier la disparition de ce peuple, plus que l'assimilation, car il s'agit de tout un processus de dégradation et de déliquescence qui a frappé ces familles au fur et à mesure qu'elles rejoignirent les civilisés en Argentine et au Chili. Certains tombèrent en telle décadence physique et morale qu'ils en moururent de langueur au milieu des prévenances empressées de toutes les charités des missionnaires, généreux en médicaments, en nourriture, en bons lits et en cabanes chauffées mais qui n'avaient plus la saveur du pays. Les Alakalufs vivaient encore à l'âge de pierre lorsqu'ils furent brutalement projetés dans la modernité occidentale qui les maltraita d'abord avant de les protéger.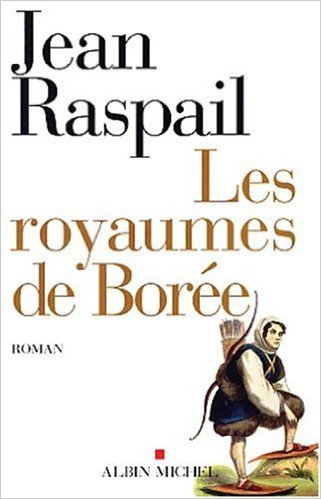 L'histoire des Kaweskars est éloquente ; ils sont en équilibre avec leur univers et paisibles tant que le monde les ignore et que leur société demeure statique. Mais que vienne le progrès et tout s'effondre. Raspail ne fait que constater. Mais ce constat amer de la confrontation malheureuse entre des civilisations par trop dissemblables il le transposa dans des œuvres, elles, de pure fiction ; Les Royaumes de Borée et Le Camp des saints. Dans le premier cas il s'agit de l'homme du petit peuple à la peau couleur d'écorce, vivant toujours comme au paléolithique, fuyant tout contact avec les hommes blancs, dont il connaît fort bien pourtant les agissements et dont il protège certains êtres choisis, les maîtres du bâton loup, des Pikkendorff. La raison de la protection se comprend bien d'ailleurs ; Pikkendorff respecte le petit homme et ne cherche pas à forcer ses retraites ou son territoire. Lorsqu'un des membres de la famille le tenta, il en mourut, mais d'épuisement, car cet univers n'était pas fait pour lui, et le petit homme lui donna sépulture. C'est la confrontation avec la modernité, le déboisement dans la principauté de Ragusa, puis la débandade des peuples baltiques devant les armées soviétiques en 1945 qui provoquèrent la disparition par annihilation silencieuse du petit peuple. Le dernier membre, à la recherche de ses origines, devait mourir incompris, laissant une descendance métisse ignorante des traditions que lui-même avait oubliées. Cette disparition des peuples fragiles confrontés à la modernité occidentale est un point effleuré également dans Septentrion et Le Son des tambours sur la neige.
L'histoire des Kaweskars est éloquente ; ils sont en équilibre avec leur univers et paisibles tant que le monde les ignore et que leur société demeure statique. Mais que vienne le progrès et tout s'effondre. Raspail ne fait que constater. Mais ce constat amer de la confrontation malheureuse entre des civilisations par trop dissemblables il le transposa dans des œuvres, elles, de pure fiction ; Les Royaumes de Borée et Le Camp des saints. Dans le premier cas il s'agit de l'homme du petit peuple à la peau couleur d'écorce, vivant toujours comme au paléolithique, fuyant tout contact avec les hommes blancs, dont il connaît fort bien pourtant les agissements et dont il protège certains êtres choisis, les maîtres du bâton loup, des Pikkendorff. La raison de la protection se comprend bien d'ailleurs ; Pikkendorff respecte le petit homme et ne cherche pas à forcer ses retraites ou son territoire. Lorsqu'un des membres de la famille le tenta, il en mourut, mais d'épuisement, car cet univers n'était pas fait pour lui, et le petit homme lui donna sépulture. C'est la confrontation avec la modernité, le déboisement dans la principauté de Ragusa, puis la débandade des peuples baltiques devant les armées soviétiques en 1945 qui provoquèrent la disparition par annihilation silencieuse du petit peuple. Le dernier membre, à la recherche de ses origines, devait mourir incompris, laissant une descendance métisse ignorante des traditions que lui-même avait oubliées. Cette disparition des peuples fragiles confrontés à la modernité occidentale est un point effleuré également dans Septentrion et Le Son des tambours sur la neige.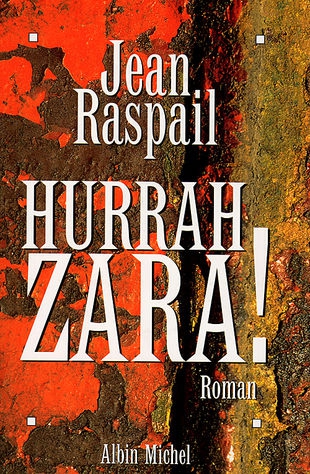 En parallèle, le monde européen idéal évoqué par Raspail est un univers de hiérarchies sociales strictes, d'honneurs chevaleresques, de discipline militaire, d'uniformes rutilants, de princes servis et obéis sans discuter, de vaillance conquérante, de traditions gaillardes, de cultes ancestraux païens perpétués par le truchement d'un catholicisme impeccable dans ses ornements liturgiques et son grégorien. C'est le monde de la principauté de Septentrion avant que ne commence la révolution, c'est l'univers idéal de l'enfance de Frédéric et Salvator dans Les Yeux d'Irène, c'est le panache du combat de Benoît dans L'Anneau du Pêcheur, c'est la dynastie des Pikkendorff dans Hurrah Zara !
En parallèle, le monde européen idéal évoqué par Raspail est un univers de hiérarchies sociales strictes, d'honneurs chevaleresques, de discipline militaire, d'uniformes rutilants, de princes servis et obéis sans discuter, de vaillance conquérante, de traditions gaillardes, de cultes ancestraux païens perpétués par le truchement d'un catholicisme impeccable dans ses ornements liturgiques et son grégorien. C'est le monde de la principauté de Septentrion avant que ne commence la révolution, c'est l'univers idéal de l'enfance de Frédéric et Salvator dans Les Yeux d'Irène, c'est le panache du combat de Benoît dans L'Anneau du Pêcheur, c'est la dynastie des Pikkendorff dans Hurrah Zara !
 Il a le sourire chafouin, les yeux cendrés au fond desquels un feu puissant s’accroche, une blancheur crue qui enchâsse la passion dans le corps. Lucien Rebatet publie Les Deux Étendards en 1952. Du même geste, il met la littérature de son temps à la remorque. Pavillon de mots troué par l’envie et la jeunesse, la musique et la littérature, l’œuvre s’empare dès son titre de la question religieuse comme un bloc épais et total liant l’amour charnel au renoncement chrétien, clouant la nervosité d’une foi véritable à un nietzschéisme libérateur. Car c’est bien un double tableau ignacien entre la Jérusalem promise et la plaine de Babylone qui charpente ce grand roman d’amour dans une tension vitale, « de deux étendards, l’un de Jésus-Christ, notre Chef suprême et Seigneur, l’autre de Lucifer, mortel ennemi de notre nature humaine ».
Il a le sourire chafouin, les yeux cendrés au fond desquels un feu puissant s’accroche, une blancheur crue qui enchâsse la passion dans le corps. Lucien Rebatet publie Les Deux Étendards en 1952. Du même geste, il met la littérature de son temps à la remorque. Pavillon de mots troué par l’envie et la jeunesse, la musique et la littérature, l’œuvre s’empare dès son titre de la question religieuse comme un bloc épais et total liant l’amour charnel au renoncement chrétien, clouant la nervosité d’une foi véritable à un nietzschéisme libérateur. Car c’est bien un double tableau ignacien entre la Jérusalem promise et la plaine de Babylone qui charpente ce grand roman d’amour dans une tension vitale, « de deux étendards, l’un de Jésus-Christ, notre Chef suprême et Seigneur, l’autre de Lucifer, mortel ennemi de notre nature humaine ».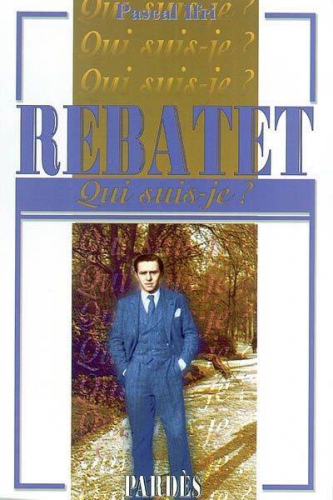 Rebatet propose donc une refondation du christianisme sur son nerf premier
Rebatet propose donc une refondation du christianisme sur son nerf premier 
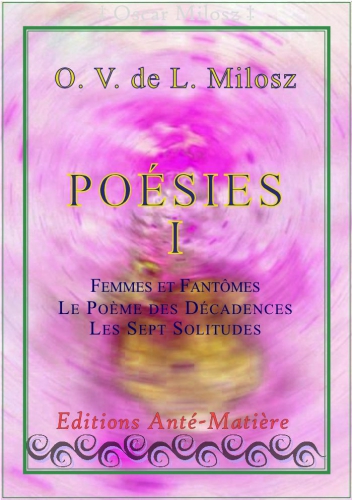 Si le propre des grands poètes est de demeurer longtemps méconnus avant de nous advenir en gloires et ensoleillements sans doute est-ce qu'ils entretiennent avec la profondeur du temps une relation privilégiée. Leurs œuvres venues de profond et de loin tardent à nous parvenir. Elles sont ce « Printemps revenu de ses lointains voyages », - revenu vers nous avec sa provende d'essences, d'ombres bleues, de pressentiments.
Si le propre des grands poètes est de demeurer longtemps méconnus avant de nous advenir en gloires et ensoleillements sans doute est-ce qu'ils entretiennent avec la profondeur du temps une relation privilégiée. Leurs œuvres venues de profond et de loin tardent à nous parvenir. Elles sont ce « Printemps revenu de ses lointains voyages », - revenu vers nous avec sa provende d'essences, d'ombres bleues, de pressentiments. 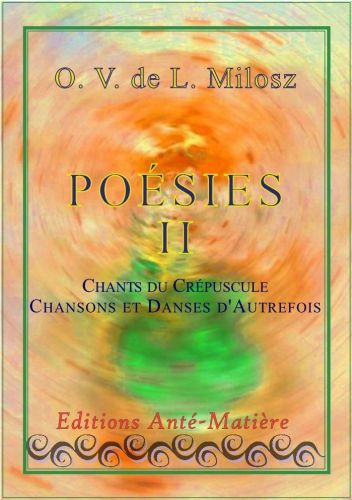 Ce temps n'est pas un temps linéaire, le temps de la succession, le temps historique mais le temps métahistorique, s'inscrivant dans une hiéro-histoire: c'est là tout le propos des Arcanes de Milosz. Ce savoir ne sera pas conquête arrogante, mais retour en nous de l'humilité, non pas savoir qui planifie, qui arraisonne le monde par outrecuidance, par outrance, mais retour à la simple dignité des êtres et des choses, des pierres, des feuillages, des océans, des oiseaux.
Ce temps n'est pas un temps linéaire, le temps de la succession, le temps historique mais le temps métahistorique, s'inscrivant dans une hiéro-histoire: c'est là tout le propos des Arcanes de Milosz. Ce savoir ne sera pas conquête arrogante, mais retour en nous de l'humilité, non pas savoir qui planifie, qui arraisonne le monde par outrecuidance, par outrance, mais retour à la simple dignité des êtres et des choses, des pierres, des feuillages, des océans, des oiseaux. 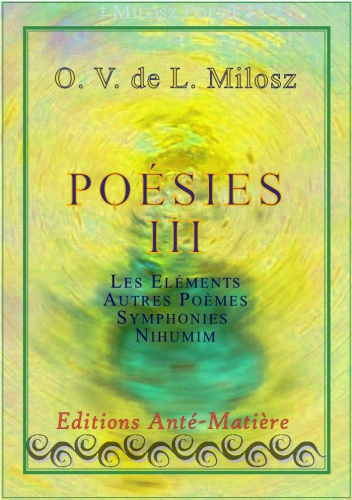 Certains hommes, plus que d'autres, par l'appartenance à une caste intérieure, sont prédisposés à entrer en relation avec le monde intermédiaire, là où apparaissent les Anges, les visions, les dieux. Ce mundus imaginalis, ce monde imaginal, fut la véritable patrie de Milosz comme elle fut celle de Gérard de Nerval ou de Ruzbéhân de Shîraz. Ce monde visionnaire n'a rien d'abstrus, de subjectif ni d'irréel. Il est, pour reprendre le paradoxe lumineux d'Henry Corbin « un suprasensible concret », - non pas la réalité, qui n'est jamais qu'une représentation, mais le réel, ensoleillé ou ténébreux, le réel en tant que mystère, source d'effroi, d'étonnement ou de ravissements sans fins.
Certains hommes, plus que d'autres, par l'appartenance à une caste intérieure, sont prédisposés à entrer en relation avec le monde intermédiaire, là où apparaissent les Anges, les visions, les dieux. Ce mundus imaginalis, ce monde imaginal, fut la véritable patrie de Milosz comme elle fut celle de Gérard de Nerval ou de Ruzbéhân de Shîraz. Ce monde visionnaire n'a rien d'abstrus, de subjectif ni d'irréel. Il est, pour reprendre le paradoxe lumineux d'Henry Corbin « un suprasensible concret », - non pas la réalité, qui n'est jamais qu'une représentation, mais le réel, ensoleillé ou ténébreux, le réel en tant que mystère, source d'effroi, d'étonnement ou de ravissements sans fins. 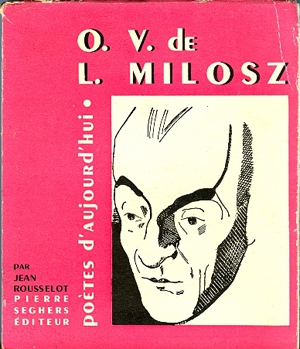 « Je regarde, écrit Milosz, et que vois-je ? La pureté surnage, le blanc et le bleu surnagent. L'esprit de jalousie, le maître de pollution, l'huile de rongement aveugle, lacrymale, plombée, dans la région basse est tombé. Lumière d'or chantée, tu te délivres. Viens épouse, venez enfants, nous allons vivre ! » A ce beau pressentiment répond, dans le même poème la voix de Béatrice: « Montjoie Saint-Denis, maître ! Les nôtres, rapides, rapides, ensoleillés ! Au maître des obscurs on fera rendre gorge. Vous George, Michel, claires têtes, saintes tempêtes d'ailes éployées, et toi si blanc d'amour sous l'argent et le lin... »
« Je regarde, écrit Milosz, et que vois-je ? La pureté surnage, le blanc et le bleu surnagent. L'esprit de jalousie, le maître de pollution, l'huile de rongement aveugle, lacrymale, plombée, dans la région basse est tombé. Lumière d'or chantée, tu te délivres. Viens épouse, venez enfants, nous allons vivre ! » A ce beau pressentiment répond, dans le même poème la voix de Béatrice: « Montjoie Saint-Denis, maître ! Les nôtres, rapides, rapides, ensoleillés ! Au maître des obscurs on fera rendre gorge. Vous George, Michel, claires têtes, saintes tempêtes d'ailes éployées, et toi si blanc d'amour sous l'argent et le lin... » 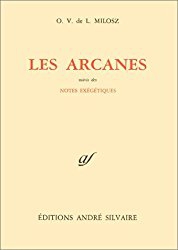 Contraires à l'œuvre et à la prière, de titanesques forces sont au travail pour nous distraire et nous soumettre. L'idéal guerroyant, chevaleresque, opposera au coup de force permanent du monde moderne, non pas une force contraire, qui serait son image inversée et sa caricature, mais une persistante douceur et d'infinies nuances.
Contraires à l'œuvre et à la prière, de titanesques forces sont au travail pour nous distraire et nous soumettre. L'idéal guerroyant, chevaleresque, opposera au coup de force permanent du monde moderne, non pas une force contraire, qui serait son image inversée et sa caricature, mais une persistante douceur et d'infinies nuances. 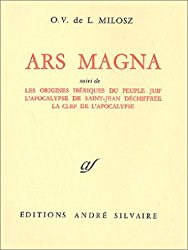 Le Noble Voyageur s'éloigne pour revenir. Il quitte la lettre pour cheminer vers l'aurore du sens, - qui viendra, en rosées alchimiques, se reposer sur la lettre pour l'enluminer. « Le monde, disaient les théologiens du Moyen-Age, est l'enluminure de l'écriture de Dieu ». Le voyage initiatique, la quête du Graal, qui n'est autre que la coupe du ciel retournée sur nos têtes, débute par l'expérience du trouble, de l'inquiétude, du vertige: « J'ai porté sur ma poitrine, écrit Milosz, le poids de la nuit, mon front a distillé une sueur de mur. J'ai tourné la roue d'épouvante de ceux qui partent et de ceux qui reviennent. Il ne reste de moi en maint endroit qu'un cercle d'or tombé dans une poignée de poussière. »
Le Noble Voyageur s'éloigne pour revenir. Il quitte la lettre pour cheminer vers l'aurore du sens, - qui viendra, en rosées alchimiques, se reposer sur la lettre pour l'enluminer. « Le monde, disaient les théologiens du Moyen-Age, est l'enluminure de l'écriture de Dieu ». Le voyage initiatique, la quête du Graal, qui n'est autre que la coupe du ciel retournée sur nos têtes, débute par l'expérience du trouble, de l'inquiétude, du vertige: « J'ai porté sur ma poitrine, écrit Milosz, le poids de la nuit, mon front a distillé une sueur de mur. J'ai tourné la roue d'épouvante de ceux qui partent et de ceux qui reviennent. Il ne reste de moi en maint endroit qu'un cercle d'or tombé dans une poignée de poussière. » 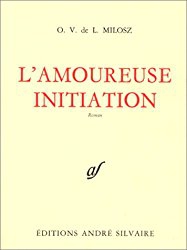 Le propre de la poésie est d'honorer le silence, - ce silence qui est en amont, antérieur, ce silence d'or qui tisse de ses fils toute musique, ce silence que les Muses savent écouter et qu'elles transmettent à leurs interprètes afin de faire entendre la vox cordis, la voix du cœur, qui vient de la profondeur du Temps.
Le propre de la poésie est d'honorer le silence, - ce silence qui est en amont, antérieur, ce silence d'or qui tisse de ses fils toute musique, ce silence que les Muses savent écouter et qu'elles transmettent à leurs interprètes afin de faire entendre la vox cordis, la voix du cœur, qui vient de la profondeur du Temps. 
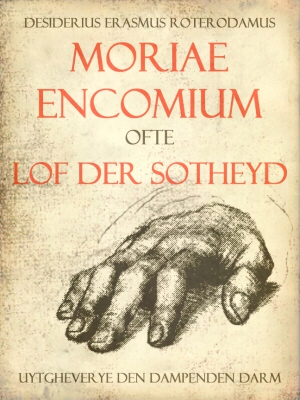 Lof der zotheid van Erasmus
Lof der zotheid van Erasmus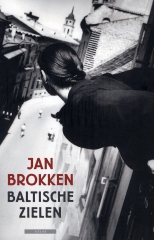 Baltische zielen van Jan Brokken
Baltische zielen van Jan Brokken Een heel leven voor zich van Romain Gary
Een heel leven voor zich van Romain Gary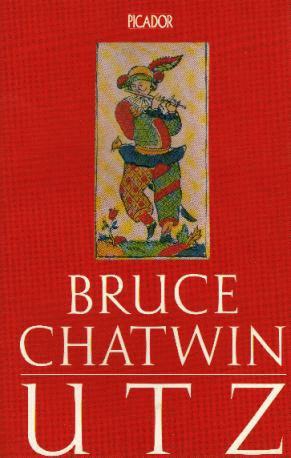 Utz van Bruce Chatwin
Utz van Bruce Chatwin Onderworpen van Michel Houellebecq
Onderworpen van Michel Houellebecq
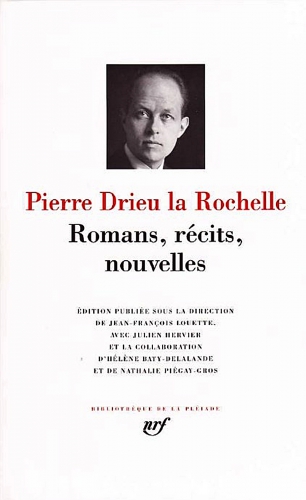 Jamais Drieu ne brigua de mandat électif – son antiparlementarisme l’en empêchait - mais son engagement politique est manifeste. Membre du
Jamais Drieu ne brigua de mandat électif – son antiparlementarisme l’en empêchait - mais son engagement politique est manifeste. Membre du 
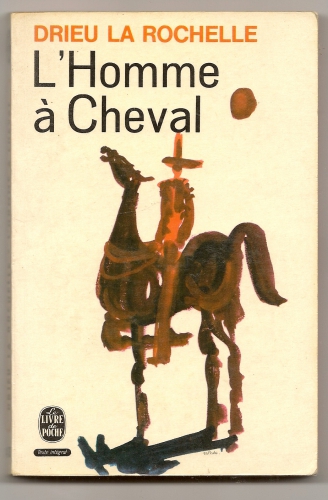 Stendhal, Balzac, Zola...: Drieu n’ignore pas le 19ème siècle mais de ces références il ne garde que des «lambeaux, et à la limite de la parodie». Pourtant, ce qui fait d’abord la force, l’attrait de ses textes, c’est qu’il s’agit de grands romans d’amour.
Stendhal, Balzac, Zola...: Drieu n’ignore pas le 19ème siècle mais de ces références il ne garde que des «lambeaux, et à la limite de la parodie». Pourtant, ce qui fait d’abord la force, l’attrait de ses textes, c’est qu’il s’agit de grands romans d’amour.
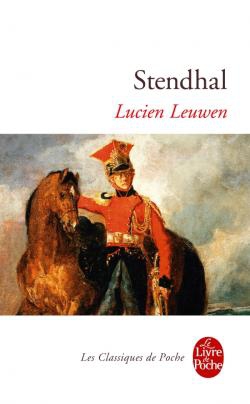

 Mais revenons à D’Ombres et de Flammes pour se pencher sur un texte brillamment écrit avec un style enflammé sans pour autant verser dans l’outrance ou l’excès de descriptions surfaites. Pierric Guittaut dépeint simplement l’environnement qui l’entoure avec une précision permettant au lecteur de s’immerger dans un contexte réaliste dépourvu d’effets outranciers. La nature n’est donc pas célébrée ou magnifiée dans de longs descriptifs superflus, souvent propres aux auteurs citadins, mais devient un décor envoutant distillant une atmosphère étrange et inquiétante. On ressent ainsi l’émotion et la passion de l’auteur pour cette région de la Sologne en dégageant une espéce de force tranquille qui transparaît tout au long du récit.
Mais revenons à D’Ombres et de Flammes pour se pencher sur un texte brillamment écrit avec un style enflammé sans pour autant verser dans l’outrance ou l’excès de descriptions surfaites. Pierric Guittaut dépeint simplement l’environnement qui l’entoure avec une précision permettant au lecteur de s’immerger dans un contexte réaliste dépourvu d’effets outranciers. La nature n’est donc pas célébrée ou magnifiée dans de longs descriptifs superflus, souvent propres aux auteurs citadins, mais devient un décor envoutant distillant une atmosphère étrange et inquiétante. On ressent ainsi l’émotion et la passion de l’auteur pour cette région de la Sologne en dégageant une espéce de force tranquille qui transparaît tout au long du récit. 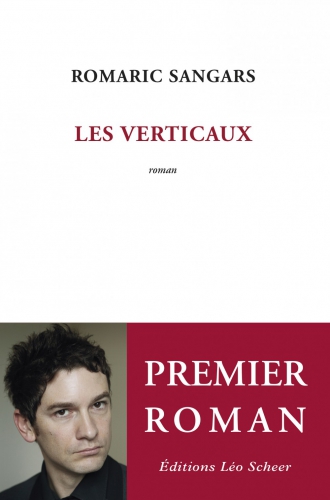 La rentrée littéraire a ceci de commun avec les foires au vin de la grande distribution, qu’en dehors de faire survivre une presse subventionnée, à bout de souffle, incapable de servir autre chose que des cépages surexploités, elle permet d’écouler à bon compte et sournoisement des infâmes piquettes, des vins bouchonnés, quelques vieux domaines madérisés, des jeunesses déjà séchées de platitudes et de noyer le chaland en recherche de grands crus sous le tsunami des références (pas moins de 590 livres en librairie pour cette rentrée 2016.)
La rentrée littéraire a ceci de commun avec les foires au vin de la grande distribution, qu’en dehors de faire survivre une presse subventionnée, à bout de souffle, incapable de servir autre chose que des cépages surexploités, elle permet d’écouler à bon compte et sournoisement des infâmes piquettes, des vins bouchonnés, quelques vieux domaines madérisés, des jeunesses déjà séchées de platitudes et de noyer le chaland en recherche de grands crus sous le tsunami des références (pas moins de 590 livres en librairie pour cette rentrée 2016.)
 Les Réprouvés s’ouvre sur une citation de Franz Schauweker : « Dans la vie, le sang et la connaissance doivent coïncider. Alors surgit l’esprit. » Là est toute la leçon de l’œuvre, qui oppose connaissance et expérience et finit par découvrir que ces deux opposés s’attirent inévitablement. Une question se pose alors : faut-il laisser ces deux attractions s’annuler, se percuter, se détruire et avec elles celui qui les éprouve ; ou bien faut-il résoudre la tension dans la création et la réflexion.
Les Réprouvés s’ouvre sur une citation de Franz Schauweker : « Dans la vie, le sang et la connaissance doivent coïncider. Alors surgit l’esprit. » Là est toute la leçon de l’œuvre, qui oppose connaissance et expérience et finit par découvrir que ces deux opposés s’attirent inévitablement. Une question se pose alors : faut-il laisser ces deux attractions s’annuler, se percuter, se détruire et avec elles celui qui les éprouve ; ou bien faut-il résoudre la tension dans la création et la réflexion.
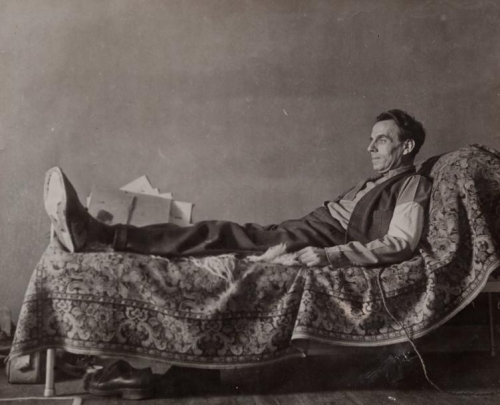

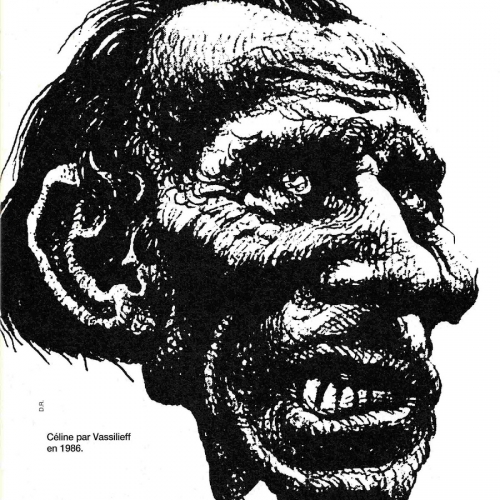

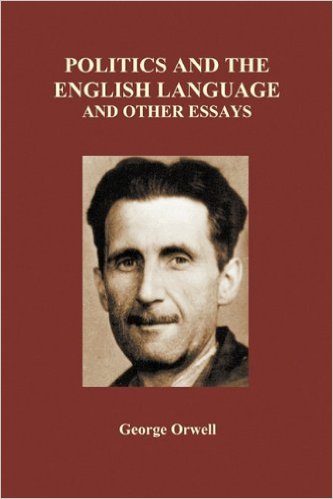 George Orwell’s classic essay “
George Orwell’s classic essay “




 Le comte nommé Allamistakéo, la momie donc, donne sa vision du progrès :
Le comte nommé Allamistakéo, la momie donc, donne sa vision du progrès :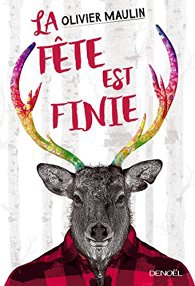 Romancier connu et apprécié, Olivier Maulin est aujourd’hui le plus beau représentant de la littérature picaresque dont l’oeuvre se situe dans la tradition de Rabelais, Marcel Aymé ou Michel Audiard.
Romancier connu et apprécié, Olivier Maulin est aujourd’hui le plus beau représentant de la littérature picaresque dont l’oeuvre se situe dans la tradition de Rabelais, Marcel Aymé ou Michel Audiard. 
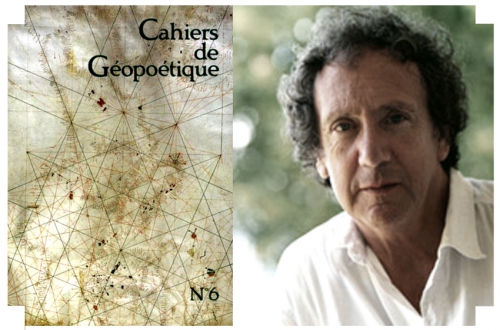
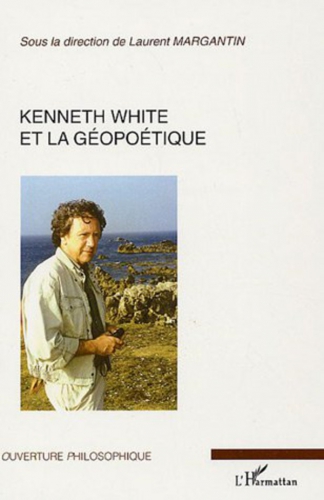 Pour White, à la base de toute culture, il y a une poétique, qui est une "pratique fondatrice". "Dans la culture grecque classique, si la politique est une préoccupation première, la culture n’existerait pas, ne respirerait pas sans la poésie océanique d’Homère : l’agora est baignée de ses vagues." Dans la culture chinoise, il y a le Livre des odes, et à côté de la pensée confucianiste centrée sur des questions éthiques, il y a l’espace poétique ouvert par des poètes errants inspirés par le bouddhisme et le taoïsme. Dans notre culture moderne toutefois, la poétique n’est qu’une "discipline" reléguée au fond des universités, et qui n’intéresse que les spécialistes du langage voire de la métrique.
Pour White, à la base de toute culture, il y a une poétique, qui est une "pratique fondatrice". "Dans la culture grecque classique, si la politique est une préoccupation première, la culture n’existerait pas, ne respirerait pas sans la poésie océanique d’Homère : l’agora est baignée de ses vagues." Dans la culture chinoise, il y a le Livre des odes, et à côté de la pensée confucianiste centrée sur des questions éthiques, il y a l’espace poétique ouvert par des poètes errants inspirés par le bouddhisme et le taoïsme. Dans notre culture moderne toutefois, la poétique n’est qu’une "discipline" reléguée au fond des universités, et qui n’intéresse que les spécialistes du langage voire de la métrique.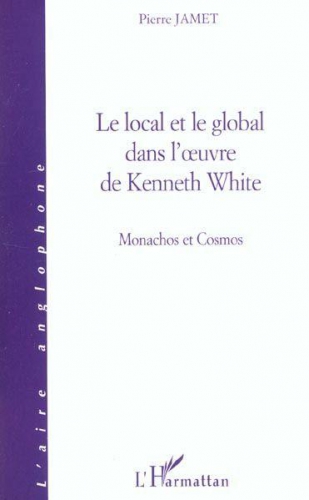 A dix-huit ans, White revient à Glasgow pour étudier. Mais très vite l’espace de prospection intellectuelle s’étend à un champ géographique plus vaste, comme en témoigne le parcours biographique et universitaire de White : après quelques années d’études à l’Université de Glasgow (littérature, philosophie et latin), il part pour l’Allemagne (Münich), où il découvre Jaspers, Husserl et surtout Heidegger. Puis il passe plusieurs années en France, où il s’installera (il vit actuellement en Bretagne).
A dix-huit ans, White revient à Glasgow pour étudier. Mais très vite l’espace de prospection intellectuelle s’étend à un champ géographique plus vaste, comme en témoigne le parcours biographique et universitaire de White : après quelques années d’études à l’Université de Glasgow (littérature, philosophie et latin), il part pour l’Allemagne (Münich), où il découvre Jaspers, Husserl et surtout Heidegger. Puis il passe plusieurs années en France, où il s’installera (il vit actuellement en Bretagne).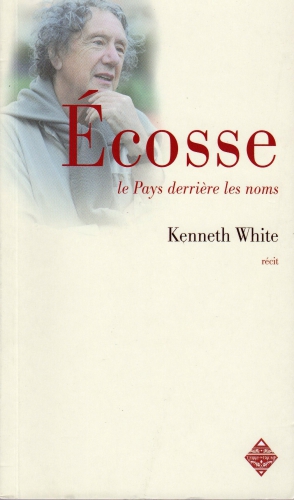 La géopoétique "dénote" donc dans un contexte culturel - surtout celui de la fin des années quatre-vingt - au sein duquel comptent avant tout les grands solipsistes et les contempteurs de la condition humaine que sont Beckett, Cioran ou bien Ionesco, auteurs qui, pour un certain milieu littéraire, sont indépassables. Se mettre à l’écart de ce courant intellectuel très coté - Valéry parlait non sans raison de "Bourse de l’Art" - était s’exclure soi-même du monde littéraire et de ses pratiques, ce qu’avait fait d’ailleurs White assez tôt.
La géopoétique "dénote" donc dans un contexte culturel - surtout celui de la fin des années quatre-vingt - au sein duquel comptent avant tout les grands solipsistes et les contempteurs de la condition humaine que sont Beckett, Cioran ou bien Ionesco, auteurs qui, pour un certain milieu littéraire, sont indépassables. Se mettre à l’écart de ce courant intellectuel très coté - Valéry parlait non sans raison de "Bourse de l’Art" - était s’exclure soi-même du monde littéraire et de ses pratiques, ce qu’avait fait d’ailleurs White assez tôt.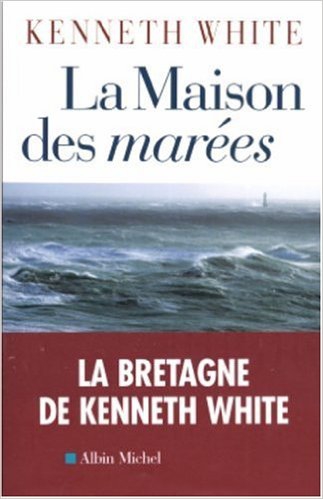 Qu’est-ce qui ne va pas, dans notre "culture" ? Dans un entretien, White dit, "pour parler rapidement", qu’il est parti de ce que Freud appelle le "malaise dans la civilisation" (das Unbehagen in der Kultur). Et il ajoute : "Ce malaise est toujours là, même si notre société essaie de le couvrir de bruits, même si on peut avoir l’impression que bientôt les esprits seront tellement "informatisés" qu’ils ne penseront plus rien. Moi, j’éprouvais un malaise, une angoisse, je me sentais étouffer dans un état de choses. J’ai essayé de sortir." Ce malaise culturel actuel, White en voit les sources dans deux grandes cultures - et en cela il est bien sûr nietzschéen : le christianisme et le rationalisme occidental. White critique ces systèmes de pensée de l’intérieur, puisqu’il a été plongé pendant toutes ses années d’enfance dans la culture chrétienne, et qu’il s’est intéressé de près à la philosophie européenne. La critique de la religion ne le conduit pas vers le nihilisme le plus "classique" (perte de toutes les valeurs, relativisation postmoderne de toutes les cultures), et d’un autre côté sa critique du rationalisme ne le mène pas vers un "irrationalisme" qui serait l’expression d’une nouvelle religion ou d’un lyrisme débridé. Bien au contraire. Il s’agit plutôt d’éviter tous les écueils rencontrés par une pensée qui s’opposerait ou "réagirait", pensée qui ne dure jamais parce qu’elle ne fonde rien.
Qu’est-ce qui ne va pas, dans notre "culture" ? Dans un entretien, White dit, "pour parler rapidement", qu’il est parti de ce que Freud appelle le "malaise dans la civilisation" (das Unbehagen in der Kultur). Et il ajoute : "Ce malaise est toujours là, même si notre société essaie de le couvrir de bruits, même si on peut avoir l’impression que bientôt les esprits seront tellement "informatisés" qu’ils ne penseront plus rien. Moi, j’éprouvais un malaise, une angoisse, je me sentais étouffer dans un état de choses. J’ai essayé de sortir." Ce malaise culturel actuel, White en voit les sources dans deux grandes cultures - et en cela il est bien sûr nietzschéen : le christianisme et le rationalisme occidental. White critique ces systèmes de pensée de l’intérieur, puisqu’il a été plongé pendant toutes ses années d’enfance dans la culture chrétienne, et qu’il s’est intéressé de près à la philosophie européenne. La critique de la religion ne le conduit pas vers le nihilisme le plus "classique" (perte de toutes les valeurs, relativisation postmoderne de toutes les cultures), et d’un autre côté sa critique du rationalisme ne le mène pas vers un "irrationalisme" qui serait l’expression d’une nouvelle religion ou d’un lyrisme débridé. Bien au contraire. Il s’agit plutôt d’éviter tous les écueils rencontrés par une pensée qui s’opposerait ou "réagirait", pensée qui ne dure jamais parce qu’elle ne fonde rien.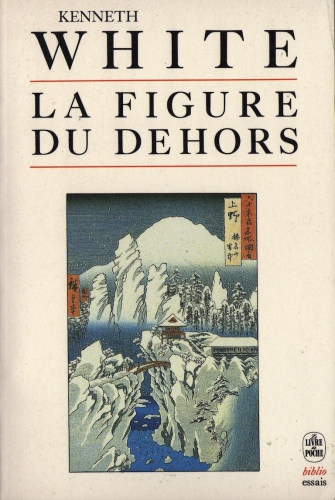 En 1987, Kenneth White a publié un livre intitulé L’esprit nomade, qui est son deuxième essai publié après La figure du dehors. Pendant plusieurs années, White avait surtout fait paraître des poèmes et des récits de voyage (ou ce qu’il appelle des way-books). Or, pendant les années 80, est parue une série d’essais rédigés par quelqu’un qui se définit comme un "poète-penseur". Dans ce livre, L’esprit nomade (une partie de sa thèse d’Etat sur le nomadisme intellectuel), la dernière partie est intitulée "Poétique du monde", et le dernier chapitre de cette section "Eléments de géopoétique ". Deux années plus tard, en 1989, White fonde l’Institut international de géopoétique. A beaucoup d’égards, "Eléments de géopoétique" peut être considéré comme le "programme" de l’Institut, ramassé, résumé dans le texte inaugural. Un autre ouvrage fondamental pour aborder ce que White appelle aussi la "poétique du monde" est Le plateau de l’albatros, introduction à la géopoétique paru en 1994.
En 1987, Kenneth White a publié un livre intitulé L’esprit nomade, qui est son deuxième essai publié après La figure du dehors. Pendant plusieurs années, White avait surtout fait paraître des poèmes et des récits de voyage (ou ce qu’il appelle des way-books). Or, pendant les années 80, est parue une série d’essais rédigés par quelqu’un qui se définit comme un "poète-penseur". Dans ce livre, L’esprit nomade (une partie de sa thèse d’Etat sur le nomadisme intellectuel), la dernière partie est intitulée "Poétique du monde", et le dernier chapitre de cette section "Eléments de géopoétique ". Deux années plus tard, en 1989, White fonde l’Institut international de géopoétique. A beaucoup d’égards, "Eléments de géopoétique" peut être considéré comme le "programme" de l’Institut, ramassé, résumé dans le texte inaugural. Un autre ouvrage fondamental pour aborder ce que White appelle aussi la "poétique du monde" est Le plateau de l’albatros, introduction à la géopoétique paru en 1994. Comment peut se déployer pour nous aujourd’hui un "monde poétique" ? White insiste sur l’activité nomade, "dérivante", de celui qui cherche un tel monde. Il doit y avoir déplacement, autant physique qu’intellectuel. Il ne suffit pas de bouger, de faire des voyages, il faut aussi que l’esprit migre, et accède à un espace d’énergies au-delà de tous les bavardages nationaux et de tout ce qui enferme l’esprit dans des limites étouffantes. "Habiter la terre en poète", selon l’expression de Hölderlin, c’est habiter un espace large et chargé d’énergies, où des rapprochements entre les cultures les plus diverses peuvent avoir lieu d’une manière parfois surprenante. La géopoétique est en effet un rapport à l’espace terrestre fluide, itinérant, jamais figé, d’où la notion si importante que l’on trouve développée chez White de "nomadisme intellectuel", et l’exercice personnel du voyage transposé littérairement dans l’écriture de way-books. Sans nomadisme, l’art s’appauvrit, finit par être emprisonné dans des cadres conceptuels et esthétiques trop étroits et trop rigides. L’art a besoin d’un rapport à l’espace qui soit à la fois riche et ouvert autant sur le plan conceptuel (ouverture à d’autres esthétiques, à d’autres formes) que sur le plan physique : l’esprit doit pouvoir vivre au milieu d’un monde de formes en mouvement, et en harmonie avec un univers sensible aussi large que possible et dont la carte est toujours à reprendre. La géopoétique est un concept opérateur, écrit White, indissociable d’une volonté de briser un espace circonscrit par les idéologies, les croyances, les politiques culturelles nationales, afin d’ouvrir l’esprit de chacun aux mouvements, aux métamorphoses du monde, de ce monde qui est pour l’homme ce qu’il y a de plus proche et ce dont il est le plus séparé.
Comment peut se déployer pour nous aujourd’hui un "monde poétique" ? White insiste sur l’activité nomade, "dérivante", de celui qui cherche un tel monde. Il doit y avoir déplacement, autant physique qu’intellectuel. Il ne suffit pas de bouger, de faire des voyages, il faut aussi que l’esprit migre, et accède à un espace d’énergies au-delà de tous les bavardages nationaux et de tout ce qui enferme l’esprit dans des limites étouffantes. "Habiter la terre en poète", selon l’expression de Hölderlin, c’est habiter un espace large et chargé d’énergies, où des rapprochements entre les cultures les plus diverses peuvent avoir lieu d’une manière parfois surprenante. La géopoétique est en effet un rapport à l’espace terrestre fluide, itinérant, jamais figé, d’où la notion si importante que l’on trouve développée chez White de "nomadisme intellectuel", et l’exercice personnel du voyage transposé littérairement dans l’écriture de way-books. Sans nomadisme, l’art s’appauvrit, finit par être emprisonné dans des cadres conceptuels et esthétiques trop étroits et trop rigides. L’art a besoin d’un rapport à l’espace qui soit à la fois riche et ouvert autant sur le plan conceptuel (ouverture à d’autres esthétiques, à d’autres formes) que sur le plan physique : l’esprit doit pouvoir vivre au milieu d’un monde de formes en mouvement, et en harmonie avec un univers sensible aussi large que possible et dont la carte est toujours à reprendre. La géopoétique est un concept opérateur, écrit White, indissociable d’une volonté de briser un espace circonscrit par les idéologies, les croyances, les politiques culturelles nationales, afin d’ouvrir l’esprit de chacun aux mouvements, aux métamorphoses du monde, de ce monde qui est pour l’homme ce qu’il y a de plus proche et ce dont il est le plus séparé.
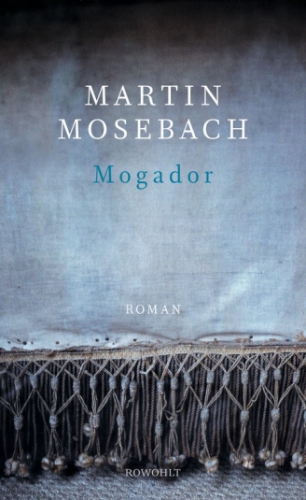 Bücher über die Finanzkrise hat es viele gegeben. Keines warnt so eindringlich vor der Flüchtigkeit des Hier und Jetzt wie Martin Mosebachs „Mogador“. Eine Rezension.
Bücher über die Finanzkrise hat es viele gegeben. Keines warnt so eindringlich vor der Flüchtigkeit des Hier und Jetzt wie Martin Mosebachs „Mogador“. Eine Rezension.