Ephémérides d'avril
AVRIL :
3 avril 1866 : Naissance à proximité de la ville de Wellington dans la Colonie du Cap de James Barry Munnik Hertzog, militaire et homme politique au service des Britanniques, qui devint Premier Ministre de l'Union Sud-Africaine entre 1924 et 1939. Face aux gouvernements de Londres, Hertzog a toujours défendu deux principes de base: primauté des intérêts sud-africains propres, même aux dépens de ceux de Londres, et la politique dite des “deux courants” (Two-Streams-Policy), où les deux communautés européennes d'Afrique du Sud, la Britannique et l'Afrikaander pourraient amorcer un développement séparé mais harmonieux, où ni la première ni la seconde ne domineraient l'autre de manière insupportable. Hertzog, juriste de formation, avait présidé la Haute Court de justice de l'Etat Libre d'Orange, pour ensuite devenir un organisateur hors pair de la guérilla des Boers contre les Britanniques. Après ce conflit sanglant, qui n'a certes pas doré le blason de l'Empire britannique, Hertzog fonde le "Orangia Unie Party", réclamant l'auto-détermination des colons de souche hollandaise, allemande et huguenote. Dans ce combat politique, il sauve de la disparition la langue afrikaander, en en faisant l'une des deux langues officielles de l'Union Sud-Africaine. En désaccord avec Louis Botha, il fonde en 1914, l'Afrikaander Nationalist Party, qui gagne rapidement le soutien de certaines strates de la population, parce qu'il s'oppose à la guerre contre l'Allemagne. Hertzog fait ensuite voter des lois pour protéger l'industrie sud-africaine contre la spéculation libérale et cosmopolite, dès qu'il accède au pouvoir en 1924, avec l'appui des travaillistes. Il oblige Londres à concéder la “Statut de Westminster” (1931), accordant aux républiques afrikaander le droit de faire sécession de l'Empire britannique. Il amorce également une politique équilibrée de “développement séparé” des Noirs et des Blancs, que dénonceront les extrémistes du “Purified Nationalist Party” de Daniel F. Malan, préconisant un apartheid pur et dur. En 1938, Hertzog triomphe aux élections et entend mener une politique de neutralité dans le conflit qui s'annonce en Europe. Mais Smuts, son allié, est pro-britannique et fait passer une motion qui condamne la neutralité; logique avec lui-même, Hertzog démissionne et devient le chef de file de l'opposition au nouveau gouvernement Smuts, allié aux extrémistes de Malan, qui, finalement, torpillent ses mesures de ségrégation tempérée. Il se retire, dégoûté, de la politique à la fin de l'année 1940. Il meurt à Pretoria le 21 novembre 1942.
4 avril 1949 : Les Etats-Unis, le Canada et dix pays européens signent à Paris le “Pacte Atlantique”, l’OTAN. En réalité, ce pacte ne représente nullement l’adhésion libre de pays souverains mais l’aliénation totale de la souveraineté des membres européens de ce pacte. Il n’a pas servi à contrer le communisme, comme le croient les naïfs et les traitres, mais à placer les pays européens sous un contrôle étroit, afin qu’ils soient incapables de développer une industrie militaire, aéronautique et navale autonome. En théorie, l’OTAN devait, en matière de développement de matériels militaires et de commerce des armements, être une “Two-Ways-Street”, une “voie à deux sens”. Les Américains ont intrigué, acheté de vils politiciens corrompus, des canailles souvent socialistes, pour que cette “voie à deux sens” devienne rapidement une “voie à un seul sens”, une “One-Way-Street”, où les Etats-Unis devenaient les principaux fournisseurs de matériels, surtout en aviation (on se rappelera du “contrat du siècle” de 1975, ayant servi à fourguer des F-16 sous-équipés au plein prix pour casser l’élan de Dassault et de Saab; l’opération s’est répétée récemment en Pologne). De Gaulle a tenté de réagir à cette inféodation dangereuse, car l’industrie militaire est presque toujours à l’origine de développements civils importants, mais sans les résultats escomptés à long terme. Dans un premier temps, la France a effectivement pu accroître ses industries aéronautiques, en vendre les produits, dont les Mirages III, dans le monde (Amérique Latine, Israël, Australie, Inde), mais la crise de mai 68, plus que probablement téléguidée depuis Washington, a chassé le vieux général du pouvoir et surtout privé ses collaborateurs, plus intelligents que lui, de tout soutien politique. Comme aiment à le dire les “vieux gaulliens”, la France est alors tombée aux mains des “comploteurs auvergnats” (Pompidou, Giscard, Mitterrand), qui ont détricoté les acquis de ce gaullisme offensif des années 60 et ramené bravement la France dans le giron atlantiste.
5 avril 1920 : En dépit des engouements pro-américains qui sévissent en Europe à la suite de l’intervention des troupes du Général Pershing en France en 1918, le journaliste de Paris-Midi, Maurice de Waleffe, fustige l’invasion des écrans français par les films américains. Il s’agit là d’un des tout premiers actes de résistance identitaire face à un fléau qui allait disloquer les fondements mêmes de l’identité européenne, soit l’invasion de fictions distrayantes dont l’objectif est de créer des loisirs artificiels déconnectés des traditions folkloriques et littéraires et de l’histoire réelle des peuples. Cette réaction de Maurice de Waleffe montre que l’intention américaine de coloniser le mental des peuples européens ne date pas seulement d’après la seconde guerre mondiale. Dès la fin de la première des “grandes conflagrations” fratricides d’Europe, l’industrie américaine du loisir avait planifié la mise au pas des peuples de notre continent, par le biais d’une technique nouvelle, celle de l’art cinématographique, qui en était à ses premiers balbutiements.
6 avril 1875 : Mort à Paris du socialiste et militant juif Moses Hess, fortement influencé dans ses démarches par sa lecture approfondie de Spinoza et de Hegel. Hess fonde une forme de socialisme libertaire, idéaliste, assorti de la création de groupes ouvriers de travail politique, auxquels participera également Karl Marx. Mais Marx se détachera rapidement de lui et l'insultera dans le “Manifeste Communiste”, qualifiant son système d'“utopique”. Moses Hess passera surtout à la postérité pour son ouvrage Rom und Jerusalem, qui aura un impact considérable sur des figures du sionisme comme Ahad Ha'am et Théodore Herzl : Hess y définit l'identité juive, considérée comme inassimilable dans toute autre nation. Il en déduit que les Juifs doivent avoir un sol quelque part dans le monde. Hess critique toutes les formes d'universalisme qu'adopte le judaïsme réformé, car elles abandonnent la spécificité juive pour se perdre dans des mirages sans consistance. La lecture d'Hess demeure des plus intéressantes aujourd'hui, dans la mesure où il plaide, au sein du judaïsme, pour une spécificité qu'il ne faut pas noyer dans des discours soi-disant universalistes (constat qui vaut évidemment pour toutes les nations, celles qui sont considérées par lui comme nomades, dont les Juifs, ou celles qui sont sédentaires). Ipso facto, ses démonstrations peuvent nous aider à lutter contre les discours universalistes médiatiques actuels, notamment en francophonie, où l'on assiste à cette curieuse collusion entre un certain discours prononcé par de vrais ou de faux Juifs sur un nomadisme qui serait universaliste et transcenderait toutes les appartenances, et l'idéologie ethnocidaire et arasante de la République, qui refuse de tenir compte des données anthropologiques naturelles et des idiosyncrasies individuelles ou communautaires.

8 avril 1946 : Juan Peron est élu président de la République argentine avec 1.527.231 voix, soit 55% des suffrages exprimés. La gauche avait déçu la classe ouvrière argentine en s’alliant avec des partis de droite, peu enclins à satisfaire ses aspirations sociales légitimes. Les vieux partis sont déconsidérés. Les schémas politiques traditionnels sont fracassés. Le peuple argentin a réussi une révolution en toute légalité. Il est intéressant de noter que lors de la campagne électorale, à l’instigation de l’ambassadeur des Etats-Unis, Braden, les services américains avaient composé de toutes pièces un “Livre Bleu”, qui attestait, soi-disant, de la collusion entre Peron et les nazis (pourtant vaincus depuis un an). Toute l’opposition à Péron reprenait à l’unisson ce thème du “nazisme” du Général et de son épouse. La classe ouvrière argentine n’a pas été dupe. Mais, sur fond de révolution orange en Ukraine et en Biélorussie aujourd’hui, on voit que les méthodes d’agit-prop n’ont pas changé, à la seule différence que les hitlériens ne sont plus guère invoqués, mais, en revanche, on agite à qui-mieux-mieux le croquemitaine du stalinisme... Dès le 22 février 1944, ce montage se dégonfle comme une baudruche: on peut prouver que le “Livre Bleu” est un montage fabriqué par Braden. L’objectif américain de déstabiliser l’Argentine et de la condamner à n’avoir que des gouvernements inefficaces s’inscrivait dans une logique géopolitique déjà ancienne. En 1933, le Pacte Roca-Runciman avait mis l’Argentine sous la coupe des Britanniques et arrêté ainsi toute pénétration américaine. Avec l’affaiblissement définitif de l’Angleterre à la suite de la deuxième guerre mondiale, les Américains ont tenté de remettre les pieds dans les pays du bassin du Rio de la Plata. Un pouvoir, tel celui qu’annonçait Peron, aurait bloqué ce retour. Voilà la raison pour laquelle, Péron était l’ennemi à abattre, le nouveau “nazi” de service. Ironie de l’histoire: les Britanniques ne manqueront pas de critiquer sévèrement les maladresses de Braden et de la politique étrangère américaine, vu que c’était eux qui étaient évincés du bassin du Rio de la Plata. Cependant, ni la tutelle britannique sur le commerce des viandes ni la tutelle américaine ne sont acceptables pour les peuples du Cône Sud de l’Amérique ibérique.
9 avril 1940 : Le chef du mouvement nationaliste norvégien “Nasjonal Samling”, Vidkun Quisling, forme un gouvernement qui annonce tout de go qu’il sera pro-allemand et mettra un terme à la politique traditionnellement pro-britannique de la Norvège. Les troupes allemandes entrent en Norvège, dans le but premier d’empêcher un débarquement britannique visant à couper à l’Allemagne la route du fer suédois. Quisling, qui n’avait jamais obtenu un seul mandat lors des législatives d’avant-guerre, devient chef d’un gouvernement sans assises populaires, comptant huit autres membres, tous issus du “Nasjonal Samling”. Les autorités allemandes dissolvent ce gouvernement le 15 avril 1940, vu son impopularité et son absence d’ancrage dans la population. Quisling est nommé par les autorités d’occupation “Haut Commissaire à la Démobilisation”. Le pays sera gouverné par l’ancien Gauleiter de Düsseldorf, Josef Terboven. Quisling s’engagera dans une collaboration totale avec l’occupant, bien que le tribunal qui le jugera et le condamnera à mort en 1945 ne retiendra pas l’accusation d’avoir favorisé l’invasion ennemie. La biographie de Quisling est cepandant plus intéressante avant la création de ses mouvements politiques dans les années 30, qui l’ont conduit à sa perte. Brillant étudiant au lycée puis à l’académie militaire norvégienne, il deviendra attaché militaire en Russie en 1917, au moment où éclate la révolution. Il sera à Moscou avec son compatriote Prytz (qui le rejoindra au “Nasjonal Samling” dans les années 30) et renseignera son gouvernement sur les événements tragiques qui secouèrent la Russie à l’époque. On s’étonnera d’apprendre, aujourd’hui, où son nom même désigne le “traitre” ou le “collaborateur” (des Allemands) en langue anglaise, qu’il a d’abord sympathisé avec la cause communiste et favorisé l’engagement de ses compatriotes dans l’armée rouge. En 1921, il accompagne Frithjof Nansen dans le cadre des activités de l’explorateur norvégien en Ukraine, au sein d’une “ONG” avant la lettre, le “Russian Relief Committee”. La situation épouvantable qu’il découvre en Ukraine, où la population connaît famines et massacres, l’oblige à prendre ses distances avec le communisme, qu’il avait trouvé dans un premier temps intéressant, rénovateur et prometteur. En 1925, toujours avec Nansen, il se rend en Arménie pour le compte de la SdN. Cette longue expérience soviétique fait de lui un anti-communiste convaincu. Il adhère aussi à certaines idées réformatrices de ce grand humaniste nordique que fut Frithjof Nansen (décédé en 1930). Dans son testament politique, Nansen avait appelé le peuple norvégien “à libérer la patrie de la lutte des classes et de la politique des partis et à lutter sur base de principes politiques et économiques sains pour l’unité nationale et la renaissance du pays”. Quisling reste donc fidèle à son ancien “patron”. Il n’abandonne pas pour autant sa vision d’un socialisme populaire: il écrit vouloir des “soviets sans communisme”. Les partis qu’il fonde dans les années 30 ne sont malheureusement qu’un simple calque du “grand frère” allemand. Toutefois, soucieux de maintenir la Scandinavie dans la paix, il adoptera des positions pacifistes dès les accords de Munich, entendra soustraire la Norvège à l’influence prépondérante de la Grande-Bretagne, et lancera en octobre 1939 un appel à la paix qu’il adressera au Premier Ministre britannique. Quand les troupes allemandes et leurs alliés entrent en Union Soviétique en 1941, Quisling, dont l’épouse est russe, lance un appel à la mansuétude des envahisseurs: il demande aux Allemands de rentrer dans les villes et les villages russes, biélorusses et ukrainiens en libérateurs, de donner l’autonomie aux peuples et de rendre la terre aux paysans. Il n’a guère été entendu.
10 avril 1864 : Maximilien d’Autriche devient empereur du Mexique, grâce au soutien de la France et de la Belgique. L’Europe profite par là de la Guerre de Sécession qui ravage les Etats-Unis pour reprendre pied dans le Nouveau Monde. Nommer un “empereur” dans cette région peu paraître désuet, et ce l’est, mais ce geste, qui nous apparaît maintenant comme un vaudeville à la fin tragique, demeure malgré tout la dernière tentative européenne de contenir les Etats-Unis, de les empêcher de faire main basse sur toute l’Amérique ibérique. Mais dès la fin de la guerre civile nord-américaine, les Etats-Unis, sans perdre de temps, font pression et obligent les Mexicains à demander le retrait des troupes françaises du Maréchal Bazaine, le 18 décembre 1866. Sans l’appui de ces troupes européennes, l’Empereur Maximilien est battu par les armées de Benito Juarez, qu’appuient les Etats-Unis. Maximilien est capturé et exécuté le 19 juin 1867. Juarez restaure la République et entame une répression féroce, éliminant physiquement toutes les notabilités liées à la tradition européenne. La barbarie, une fois de plus, s’est déclenchée sous le masque d’une “libération”, qui n’annonçait évidemment rien d’autre qu’une domination américaine.
11 avril 1818 : Naissance à Hsiangyin dans la province chinoise du Hunan de Kuo Sung-tao, qui fut le premier ambassadeur de Chine à l'étranger, en l'occurrence à Londres. Il prit ses fonctions dans la capitale anglaise en 1877. En observant la vie quotidienne de la capitale britannique et l'explosion économique de la métropole impériale, il écrit à son gouvernement qu'il faut d'urgence introduire en Chine une politique d'occidentalisation technique, c'est-à-dire construire des chemins de fer et introduire le télégraphe. Ce conseil a été très mal vu dans les milieux officiels chinois, si bien que son journal de voyage (“De Changhaï à Londres”) est interdit de parution. En 1878 déjà, il reçoit l'ordre de revenir à Pékin. Méfiant, il se retire dans son village natal, où il meurt en 1891. Kuo Sung-tao a voulu un Meiji chinois. Ceux qui ne l'ont pas écouté sont responsables du retard chinois. Ils en portent la responsabilité devant l'histoire.
12 avril 1931 : Les républicains espagnols remportent les élections municipales, couplées à un référendum sur la monarchie, confirmant de la sorte une nette majorité en faveur de l’instauration d’une république plus sociale, que l’Europe, y compris l’Italie mussolinienne, s’empresse de reconnaître. Cette victoire force le roi Alphonse XIII à quitter le pays. La 2ième République est proclamée. Le 9 décembre, elle se donnera une constitution. Le 6 septembre 1932, les Cortes accordent l’autonomie à la Catalogne. Une ère nouvelle faite de liberté et de modernité semble s’annoncer au Sud des Pyrénées. Mais en octobre 1934, la République ordonne de réprimer cruellement le soulèvement ouvrier de la “Commune des Asturies”. 3000 ouvriers sont massacrés. 40.000 personnes sont arrêtées. Cela conduit à une radicalisation de la gauche, contre la gauche modérée mais répressive, permettant au “Front Populaire” d’emporter une victoire électorale aux Cortes le 16 février 1936. Le 18 juillet 1936, l’armée se soulève, amorçant ainsi la terrible guerre civile que connaîtra le pays jusqu’en 1939. La gauche n’aime pas rappeler que ce sont justement les Républicains qui ont maté, de la manière la plus cruelle qui soit, le soulèvement ouvrier des Asturies. La guerre d’Espagne, à la lumière de ces faits, ne doit pas être jugée et analysée selon des schémas binaires et manichéens.
 13 avril 1890 : Naissance à Harbor Beach dans le Michigan de Frank Murphy, juriste américain, appointé près la Court Suprême des Etats-Unis. Plusieurs principes politiques ont animé sa carrière : la défense absolue des libertés individuelles et civiles, la volonté de faire triompher une justice se basant sur l'argumentation de fond (substantielle) contre le poids des techniques de droit. Maire de Détroit de 1930 à 1933, il luttera efficacement contre le chômage et, gouverneur du Michigan, en 1937-38, il refusera de faire usage de la troupe pour briser les grèves non violentes dans l'industrie automobile. Haut commissaire américain aux Philippines, il œuvrera pour la décolonisation et l'indépendance de l'archipel. En 1944, il dénonce comme racisme et injustice l'internement systématique des citoyens américains de souche japonaise.
13 avril 1890 : Naissance à Harbor Beach dans le Michigan de Frank Murphy, juriste américain, appointé près la Court Suprême des Etats-Unis. Plusieurs principes politiques ont animé sa carrière : la défense absolue des libertés individuelles et civiles, la volonté de faire triompher une justice se basant sur l'argumentation de fond (substantielle) contre le poids des techniques de droit. Maire de Détroit de 1930 à 1933, il luttera efficacement contre le chômage et, gouverneur du Michigan, en 1937-38, il refusera de faire usage de la troupe pour briser les grèves non violentes dans l'industrie automobile. Haut commissaire américain aux Philippines, il œuvrera pour la décolonisation et l'indépendance de l'archipel. En 1944, il dénonce comme racisme et injustice l'internement systématique des citoyens américains de souche japonaise.
14 avril 1971: Le Président des Etats-Unis, Richard Nixon, amorce sa politique de normalisation à l’égard de la Chine communiste, dans la mesure où, désormais, le commerce entre les deux Etats est libéralisé. Cette mesure prend la suite d’une autre, décidée un mois auparavant, le 15 mars 1971, et qui autorisait dorénavant les citoyens américains à voyager en Chine. La normalisation commence par un acte symbolique et sympathique, bien médiatisable: la visite de joueurs américains de ping-pong en Chine, où ils affronteront l’équipe nationale chinoise. L’objectif géopolitique, basé sur les principes de la diplomatie traditionnelle, est de parfaire, par le biais d’une normalisation des relations sino-américaines, l’encerclement de l’Union Soviétique, où la Chine de Mao jouerait le rôle de l’allié de revers. Après Nixon, avec Reagan, le mode d’approche des présidences républicaines ne sera plus diplomatique et traditionnel, mais basé sur un schéma manichéen, de lutte contre l’ “empire du mal”, qui sera encore renforcé sous les deux Bush, au point de devenir franchement caricatural. Les démocrates seront, eux aussi, atteint par cette maladie idéologique consistant à mêler diplomatie et théologie. Si Nixon était encore un Républicain classique, ses successeurs feront reculer les acquis de la diplomatie traditionnelle, donc de la civilisation et du principe du 18ième siècle, cher à Carl Schmitt, de la “guerre de formes”. Les guerres ne sont donc plus de “formes”, et, par voie de conséquence, limitées dans leurs objectifs et finalités, mais idéologisées et absoluisées, donc sans mesure ni modération, car, dans cette optique, l’ennemi n’est plus un Etat qui défend ses intérêts légitimes, mais l’incarnation du mal absolu, qu’il convient d’éradiquer. De telles postures sont susceptibles de déclencher des conflits sans fin, où la personnalité de l’ennemi n’est plus respectée comme telle. Aujourd’hui, les néo-conservateurs, anciens trotskistes reconvertis, qui ont investi et perverti le parti républicain américain, se moquent ouvertement des principes de la diplomatie, qu’ils considèrent comme des vieilleries bonnes à jeter aux orties, comme des oripeaux désuets d’un passé révolu, dont relève la “Vieille Europe”, centrée autour du binôme franco-allemand. La normalisation des rapports sino-américains, amorcée par Nixon et Kissinger au début des années 70 du 20ième siècle, portera bel et bien un premier coup dur à l’Union Soviétique, déjà en perte de vitesse. Ce coup de maître de la diplomatie nixonienne et kissingerienne scindera aussi définitivement le camp communiste en deux partis antagonistes, inféodés l’un à Moscou, l’autre à Pékin. Cela aura pour résultat que le Vietnam obtiendra le soutien de Moscou, le Cambodge celui de la Chine; les deux petites puissances du Sud-Est asiatique s’affronteront dans un combat sanglant, scellant définitivement la fin de l’unité dans le camp communiste. Dans la mouvance identitaire, l’ancien général italien Guido Giannettini, limogé et réprouvé parce qu’il n’était pas un béni-oui-oui atlantiste, sera le seul à avoir posé, à l’heure et à temps et de façon cohérente, une analyse méticuleuse de cette problématique, exhortant les européistes traditionalistes à soutenir la Russie dans ce combat planétaire. Le reste de la mouvance restant désespérément fidèle à un atlantisme délirant ou refusant, par myopie politique et désintérêt pour la marche du monde, d’analyser les clivages au sein des divers communismes (trotskistes pro-occidentaux, communistes fidèles à Moscou, maoïstes soudainement devenus pro-occidentaux, etc.). Si le mouvement identitaire barbote, empétré dans ses contradictions, et se retrouve à la traîne aujourd’hui, c’est faute d’avoir posé les bonnes analyses au début des années 70, dene pas avoir suivi les leçons du Général Giannettini.

15 avril 1927 : Pierre-Georges Latécoère, l’avioneur français, vend 93% de ses actions de la CGEA à Marcel Bouilloux-Lafont de la SUDAM, afin de pouvoir disposer d’une couverture financière plus solide pour assurer les liaisons, coûteuses et difficiles à l’époque, entre l’Europe et le continent sud-américain. De la fusion de ces énergies naîtra la fameuse “Aéropostale”, où s’illustreront Mermoz et Saint-Exupéry. Le 15 octobre, deux aviateurs, Costes et Le Brix réussisent pour la première fois à traverser l’Atlantique Sud au départ du Sénégal, sur un Bréguet 19, un appareil produit par la concurrence de Latécoère. Leur destination était Natal au Brésil. La France comptait exploiter ses atouts géopolitiques dans la conquête des lignes aériennes; possédant le Sénégal, elle est la plus proche du continent sud-américain. Les lignes longent l’Afrique du Nord en quelques escales, puis s’élancent vers le Brésil. C’est la réponse à un défi américain: en effet, au nom du “désarmement naval”, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont imposé à leurs alliés français et italiens de la première guerre mondiale, ainsi qu’aux Allemands vaincus, une réduction drastique du nombre de leurs bâtiments et de leur tonnage. Les Allemands sont condamnés à ne plus avoir de flotte. Les Européens tentent donc de remplacer les navires par une technique nouvelle, l’aviation, et pour les Allemands en particulier et en plus, par les dirigeables. L’objectif est aussi de renforcer les liens entre l’Europe et l’Amérique ibérique. Mais ils n’unissent pas leurs efforts, se font concurrence, et, après 1945, seront supplantés par les avioneurs américains. Airbus est une seconde tentative pour redonner à l’Europe une industrie aéronautique digne de ce nom: heureusement, cette fois, dans un esprit de coopération.
17 avril 1897 : L’Empire ottoman déclare la guerre à la Grèce, qu’il accuse d’avoir favorisé l’agitation de patriotes grecs-crétois, voulant libérer leur île du joug turc. La Grèce est écrasée par les armées ottomanes. Le 4 décembre 1897, le traité de Constantinople accorde toutefois l’autonomie à la Crète, que garantissent les grandes puissances européennes, mais elle reste sous suzeraineté ottomane. La Grèce conserve l’intégralité de son territoire, mais doit payer une lourde indemnité. Ce traité montre qu’il n’y a pas eu de solidarité européenne en faveur de la Grèce, alors qu’il aurait simplement suffi d’élever la voix pour faire reculer un empire ottoman aux abois. La maîtrise des grandes îles de la Méditerranée orientale est un atout stratégique majeur. La Turquie a du mal à y renoncer. Le scénario s’est répété en 1974 à Chypre. Pour justifier leur débarquement et leur conquête de la partie septentrionale de Chypre, les Turcs ont également accusé le gouvernement des colonels grecs d’avoir soutenu des milices hostiles aux Turcs et favorables à l’annexion de Chypre à la Grèce (l’ “Enosis”). Pour le mouvement identitaire, c’est une question de principe intangible: Chypre doit redevenir entièrement grecque.
18 avril 1912 : La marine italienne pénètre dans les Dardanelles et y bombarde des positions turques. A la suite de cette attaque surprise, dans le cadre de la guerre italo-ottomane dont l’enjeu premier était la Libye, les Turcs font fermer les Détroits. La guerre avait commencé en octobre 1911, par la volonté italienne de chasser toute présence turque hors de l’Adriatique, une menace ancienne, qui date du 15ième siècle. Ensuite, pour dégager les côtes africaines qui font face à la péninsule italique, l’armée de terre italienne envahit la Libye et en chasse les Turcs. Benito Mussolini est emprisonné pour avoir organisé des protestations violentes contre la conquête colonialiste de la Libye. En prison, il lira Nietzsche et abandonnera son socialisme eudémoniste, pour adopter l’idéologie plus belliciste et plus volontariste qui sera la sienne et donnera ultérieurement le fascisme. L’armée italienne, bien organisée, utilise de manière coordonnée et efficace sa marine, son aviation (avant toutes les autres puissances), ses fusiliers marins et son armée de terre. En février 1912, la marine italienne avait coulé deux contre-torpilleurs turcs dans le port de Beyrouth et bombardé la ville. Les troupes italiennes avaient débarqué dans les Iles du Dodécanèse en Mer Egée et en avaient fait des possessions italiennes, excellentes bases en Méditerranée orientale. Le 15 octobre 1912, la Turquie signe le Traité d’Ouchy (une petite ville suisse près de Lausanne), cède les Iles du Dodécanèse et la Libye aux Italiens. Au même moment, les petites nations balkaniques, avec l’appui de la Russie, déclenchent une guerre commune contre la présence ottomane résiduaire en Europe: Monténégrins, Serbes, Bulgares et Grecs pénètrent dans les territoires européens encore occupés par la Turquie et en chassent les armées ottomanes, qui s’enfuient en déroute, précédées par des flots de civils musulmans, autant de bourreaux détalant devant leurs victimes, qu’ils avaient oppressées pendant de longs siècles. L’armée bulgare campe même sur les rivages de la Mer de Marmara et menace directement Constantinople. Cet épisode montre que la solidarité entre Européens, quand ils mènent des actions communes, est invincible. Les victoires de 1912 seront toutefois réduites à néant par la zizanie entre pays balkaniques, qui déclenchera une seconde guerre des Balkans en 1913, une guerre fratricide entre Européens.
19 avril 1928 : Des troupes japonaises entrent en Chine pour prendre le contrôle de la ligne de chemin de fer de Pékin à Changhaï. C’est le début d’une volonté japonaise de mettre un terme à l’anarchie totale qui régnait en Chine, où les troupes du Kuo Min-Tang de Tchang Kaï-Tchek avaient noyé dans le sang une révolte communiste à Changhaï en avril 1927, et à amorcer ainsi le projet impérial de “sphère de co-prospérité est-asiatique”. Cette volonté se heurte aux vieux projets américains de conquérir et de se réserver le marché chinois en toute exclusivité. Le débarquement de 1928 conduira au conflit nippo-américain de 1941 à 1945. A l’occasion de ce débarquement de 5000 soldats nippons, les Etats-Unis mettront au point un arsenal juridique fallacieux, dont ils ont le secret, pour exciter l’opinion internationale contre l’Empire du Soleil Levant. Derrière un paravent de beaux principes de droit, se dissimule en réalité la volonté de bloquer et de ruiner un adversaire et de prendre sa place. Cette méthode de manipulation du droit sera par la suite appliquée à d’autres, jusqu’à nos jours, où elle sert contre l’Irak et l’Iran. Carl Schmitt, juriste allemand, dénoncera l’inanité de ce droit, en démontera les mécanismes et l’hypocrisie. L’Europe n’a pas retenu sa leçon...
20 avril 1792 : Sous la pression des Girondins, l’Assemblée républicaine française déclare la guerre “au Roi de Bohème et de Hongrie”, autrement dit au Saint-Empire, l’Empereur étant simultanément roi de Bohème et roi de Hongrie. La première cible des hordes de sans-culottes sera notre pays, et plus particulièrement Anvers et la rive occidentale du Rhin. Notre pays était directement, à l’époque dite “autrichienne”, sous la souveraineté de l’Empereur. Les puissances légitimes d’Europe centrale rassemblent leurs troupes et les Prussiens, mieux aguerris, reprennent les places fortes lorraines de Longwy et de Verdun, mais seront arrêtés à Valmy le 20 septembre. La retraite prussienne change le cours de la guerre: les sans-culottes marchent sur Mons et remportent la victoire de Jemmapes, le 6 novembre. La garnison hennuyère, dont le fer de lance est le Régiment du Feld-Marschall de Beaulieu n’est pas assez nombreuse pour contenir les centaines de milliers de baïonnettes, que l’on a recrutées de force dans les bas-fonds de Paris. Le pays est livré au pillage et les ancêtres idéologiques de notre crapulocratie politique socialiste et libérale participent à la curée, inaugurant une ère d’illégitimité fondamentale qui dure encore. L’année suivante, le retour de l’armée impériale, commandée par deux maréchaux impériaux wallons, un Hennuyer et un Namurois, de Beaulieu et de Clerfayt, emporte quelques victoires, libère une partie de la Flandre et du Hainaut arrachés aux Pays-Bas hispano-autrichiens par le “Roi-bandit” Louis XIV, mais, dès septembre 1793, les révolutionnaires, grâce à la pratique de la levée en masse, qui leur donne toujours une longueur d’avance face à des armées de métier au recrutement plus laborieux, finissent par battre la coalition à Hondschoote, en Flandre occupée, et à redresser la situation en leur faveur. Clausewitz, qui était à Valmy comme cadet à l’âge de douze ans, en tirera les conclusions et plaidera plus tard pour la levée en masse et la participation du peuple aux armées, dans ses mémoranda qui conduiront aux réformes prussiennes des années 1806-1815. Les “réformes prussiennes” visaient à moderniser la structure de l’Etat et de l’armée et surtout à les ouvrir aux classes populaires. Elles ont une connotation “nationale-révolutionnaire” évidente.
21 avril 1927 : En Italie, Mussolini promulgue la “Charte du Travail”, faisant de l’Italie fasciste un “Etat corporatiste”. Les industriels créatifs sont protégés contre tout débordement ouvrier (en fait: contre tout risque de grèves manipulées depuis l’étranger pour briser un élan innovateur national), les ouvriers, en revanche, reçoivent la garantie d’une protection sociale généralisée. Mais les industriels doivent obéir aux injonctions de l’Etat, qui coordonne ainsi le développement de l’industrie nationale. Cette Charte est proclamée dans un contexte international houleux. L’Italie venait de s’allier à la Hongrie de Horthy, de lui livrer des armes, ruinant ainsi les projets perfides de la France de créer un vide politique au centre de notre continent, au nom d’une haine viscérale à l’endroit de la légitimité continentale que représentait, avant 1918, l’Autriche-Hongrie. Par cette alliance avec la Hongrie, réduite et enclavée, Mussolini réduit à néant les manigances de Poincaré et Clemenceau; il réarme Budapest et fragilise les satellites de la France dans la région. En Libye, les Anglais ont soudoyé les Senoussistes de l’est du pays pour créer des manoeuvres de diversion et éloigner les Italiens d’Egypte: les généraux Graziani et Mezzeti mettent tous les moyens militaires en oeuvre pour mater cette rébellion d’intégristes musulmans se réclamant du wahhabitisme saoudien (l’alliance entre le wahhabitisme intégriste et les puissances anglo-saxonnes ne date pas d’hier...). Churchill, pourtant, lance un appel à Mussolini, pour tenter d’en faire un allié en Méditerranée. Cependant, Mussolini recule devant les protestations françaises à l’endroit de sa politique hongroise. Il refuse, épouvanté, les propositions du Comte Bethlen, ministre hongrois, qui souhaite forger un bloc italo-germano-austro-hongrois, sanctionnant de facto l’Anschluss, pour réduire à néant les effets du Traité de Versailles. Julius Evola était partisan, lui, de ce bloc traditionnel, opposé à l’Ouest, au jacobinisme français et à la ploutocratie anglaise. Notons que les propositions de Bethlen ont été formulées bien avant l’avènement de Hitler au pouvoir, quand l’Allemagne était sociale-démocrate. Les nécessités géopolitiques transcendent les clivages idéologiques.
22 avril 1836 : Défaite mexicaine à San Jacinto au Texas. Le président du Mexique, Santa Anna, est pris prisonnier par des soldats texans commandés par Samuel Houston. Les hostilités avaient commencé en novembre 1835, quand les colons américains refusèrent d’abolir l’esclavage et le fédéralisme qui donnait une certaine autonomie au Texas. Le leader des Texans était Stephen Austin. L’objectif était de contrôler un maximum de côtes du Golfe du Mexique au bénéfice des Etats-Unis, puissance émergeante. Cependant le Congrès refusera en août 1837 d’entériner l’admission de la nouvelle république dissidente du Texas au sein de l’Union, car ce Texas est constitutionnellement esclavagiste. Il faudra attendre le 28 mars 1845 pour que le Texas soit accepté dans l’Union, entraînant la rupture des relations diplomatiques entre les deux Etats. Le 13 mai 1846, à la suite d’un incident de frontière, les troupes américaines pénètrent sur le sol mexicain. En janvier 1847, la Californie est entièrement occupée. Les troupes américaines, commandée par Zachary Taylor débarquent à Veracruz. Le 20 septembre 1850, la Californie sera admise dans l’Union comme “Etat libre” (non esclavagiste), tandis que le Nouveau-Mexique et l’Utah le seront également, mais, eux, comme esclavagistes. On mesure toute l’hypocrisie de l’anti-esclavagisme de Washington, qui est, on le remarque, à la lumière de ces faits historiques, un “anti-esclavagisme à géométrie variable”, comme il y aura, plus tard, du “démocratisme” ou du “droit-de-l’hommisme” à géométrie variable. L’objectif stratégique réel de la guerre contre le Mexique était de créer un Etat bi-océanique, de l’Atlantique au Pacifique, de lui donner une dimension continentale et donc, à terme, un statut de grande puissance globale. La conclusion du Traité de Washington du 15 juin 1846, entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, fixe la frontière entre le Canada, possession britannique, et les Etats-Unis, au 49ième parallèle, assurant ainsi la domination américaine sur les territoires qui formeront les futurs Etats de Washington et de l’Oregon, riverains du Pacifique. L’élmination de la présence mexicaine du Texas à la côte californienne est donc l’étape suivante dans ce projet “bi-océanique”.
23 avril 1925 : Les troupes berbères rifaines d’Abd-el-Krim pénètrent dans le territoire marocain sous protectorat français. C’est le début de la guerre du Rif. Le conflit, qui avait commencé contre les Espagnols en 1921, durera, après l’invasion du protectorat, un an. Au bout de cette année, les insurgés berbères seront battus par une armée franco-espagnole de 250.000 hommes, commandée par le Maréchal Pétain. Abd-el-Krim est contraint de signer une capitulation inconditionnelle le 26 mai 1926. Issu de la tribu berbère du Rif, les Banu Uriaghel, Abd el-Krim avait reçu une éducation espagnole de haut niveau, était secrétaire au Bureau espagnol des affaires indigènes, puis juge musulman du district de Melilla. Insatisfait de la gestion par Madrid du Maroc septentrional, il soulèvera le Rif contre les dominations espagnole et française dès 1921, battant les troupes du Général espagnol Fernandez-Silvestre. En franchissant la frontière du protectorat français, il marche sur Fez/Fès, mais les troupes de Pétain s’emparent de la vallée de Wargha, d’où provenaient son approvisionnement et ses munitions. C’est la fin de l’insurrection. Il connaîtra l’exil à l’Ile de la Réunion, puis, à partir de 1947, en Egypte, où il dirigera le “Bureau maghrébin” en charge d’organiser la libération des pays d’Afrique du Nord-Ouest. Il meurt le 6 février 1963 au Caire. L’action d’Abd el-Krim est paradigmatique d’une guerre de libération menée par des partisans, enracinés dans leur sol. Il sera en cela l’inspirateur de Ho Chi Minh et de Giap, dans leur lutte pour la libération de l’Indochine contre les Français d’abord, contre les Américains ensuite.
24 avril 1877 : A la suite de répressions féroces perpétrées par la soldatesque turque en Bosnie-Herzégovine, après les interventions à l’issue malheureuse des Serbes et des Monténégrins en faveur des Bosniaques insurgés, les Russes, lassés de tant de violences à l’encontre des peuples slaves et orthodoxes, se décident à déclarer la guerre à l’Empire ottoman. Fortes contre des paysans faiblement armés, les hordes ottomanes ne font pas le poids devant les armées russes qui les écrasent sans pitié. Les malheureux peuples des Balkans sont vengés de la sauvagerie ottomane. Les Russes attaquent également dans le Caucase, libérant encore quelques portions du territoire caucasien de la présence turque. Le 9 mai 1877, les Roumains se déclarent indépendants, mobilisent leurs troupes et se joignent aux Russes et aux Serbes dans l’espoir de chasser définitivement la présence étrangère du sol européen. Les Anglais interviennent aux côtés des Turcs, comme en Crimée une vingtaine d’années auparavant. En échange de leur appui, ils exigent du Sultan qu’il leur abandonne Chypre. Le 3 mars 1878, le traité de San Stefano règle les nouvelles frontières dans les Balkans, mais sera révisé par le traité de Berlin du 13 juillet 1878, où l’Angleterre protège systématiquement les Ottomans, en voulant éviter la satellisation par la Russie de quelques puissances balkaniques, surtout la Bulgarie, ce qui lui donnerait un débouché sur l’Egée, donc sur le bassin oriental de la Méditerranée, que les Britanniques estiment être leur chasse gardée.
26 avril 1828 : Le Sultan turc déclare la guerre à la Russie. Les Grecs se soulèvent contre l’oppresseur, dans l’espoir de voir débouler les troupes du Tsar sur les rives de l’Egée. Le 11 octobre 1828, les Russes infligent aux Turcs une cuisante défaite à Varna en Bulgarie. Le 20 août 1829, ils prennent Andrinople (Edirne). Le Sultan doit signer la paix dans cette ville, le 14 septembre 1829: les Russes obtiennent le libre passage de leurs navires de commerce dans les Détroits; ils contrôlent désormais les bouches du Danube. Le Traité oblige les Turcs à accorder l’autonomie aux peuples balkaniques, soit à la Serbie, à la Moldavie et à la Valachie. La Grèce reste vassalle de l’Empire ottoman, en théorie, mais réussit à obtenir son indépendance, garantie par la France, la Grande-Bretagne et la Russie (protocole de Londres, 3 février 1830). Les armées russes ont permis une première libération (incomplète) des Balkans du joug étranger, extra-européen, qui pesait sur eux depuis la victoire des Ottomans au Champs des Merles (Kosovo) en 1389. Mais la Grande-Bretagne, obligée de composer en 1829-1830, voit d’un mauvais oeil cette avancée russe et slave en direction de la Méditerranée orientale. Elle reconnaît le fait accompli mais travaillera désormais à la ruine de la Russie dans la région. Les victoires russes contre l’ennemi héréditaire de l’Europe jetteront les bases d’un conflit ultérieur, la Guerre de Crimée, où la Russie perdra certains des atouts gagnés lors du Traité d’Andrinople de 1829. Londres ne cessera plus de soutenir l’Empire ottoman en pleine liquéfaction.
27 avril 1463 : Mort à Rome d'Isidore de Kiev, qui fut patriarche grec-orthodoxe en Russie, puis cardinal à Rome. Il a tenté de réunir les églises chrétiennes de l'Est et de l'Ouest devant la menace turque. L'Empereur byzantin Jean VIII Paléologue l'envoie en 1434 au Concile de Bâle, pour parfaire la réunification des églises. Byzance le nomme Patriarche de Kiev et de toutes les Russies. Après de nombreux avatars, il rédige, avec le Cardinal grec Jean Bessarion, le document de l'unification, proclamée le 5 juillet 1439, ce qui lui permet de devenir en même temps “Cardinal de Ruthénie” (= Ukraine). Kiev est donc “unie”, mais Moscou refuse la teneur du document d'unification. Le Pape Nicolas V renvoie Isidore à Constantinople en 1452. Il participe activement à la défense de la ville contre les Turcs; au cours du siège, il annonce aux Byzantins l'unification des deux églises au cours d'un prêche dans Sainte-Sophie, ce qui sied à la Cour et à la hiérarchie mais non au peuple, qui continue à proclamer sa haine de la papauté romaine. Isidore de Kiev et ses hommes prennent alors les armes et montent au créneau pour défendre la ville. Isidore y sera blessé, mais parviendra à fuir, vers la Crète d'abord, avant de rentrer à Rome en 1454, où il rédige un récit poignant de la chute de Constantinople, Epistula lugubris. Le Pape Pie II le nomme, à titre honorifique, “Patriarche Grec de Constantinople”.
27 avril 1959 : Décès à Talahassee en Floride du sociologue américain, professeur à la Columbia University et à l'Université de Chicago, William Fielding Ogburn, qui a forgé le concept de “cultural lag” (de sédiment culturel). Statisticien de premier ordre, il travaillera pendant de nombreuses années, au titre de directeur de recherches, auprès d'un institut fondé par le Président Herbert Hoover, chargé d'étudier les “tendances” (“trends”) de la société américaine. Pour Ogburn, les sociétés évoluent quand elles réussissent à combiner des éléments culturels déjà présents d'une manière nouvelle et originale. Cependant, les “sédiments culturels” ont la vie dure : ils résistent systématiquement à l'innovation, notamment sur le plan du droit. Les sédiments freinent l'avènement des novismes de tous ordres. Généralement, les sédiments culturels sont présents dans l'esprit des peuples de façon inconsciente, mais quand une innovation les menace, ils peuvent venir à la conscience de manière très aiguë, générer des désordres et faire courir le risque de la désintégration sociale. La sociologie d'Ogburn nous invite à innover sans toucher aux fondements quasi ontologiques d'une société, à adapter le rythme des changements nécessaires ou induits par la technique, afin de ne pas provoquer des désordres dangereux sur le moyen ou le long terme. Ogburn peut nous aider à combattre les prophètes anarchiques et délirants qui veulent à tout prix jeter aux orties les fondements anthropologiques de base de nos sociétés. On ne peut se débarrasser impunément des “cultural lags”. La folie de vouloir “intégrer”, de manière absoluisée et irréfléchie, des ressortissants de cultures possédant d'autres sédiments culturels conduit à la dislocation des sédiments autochtones et donc à l'implosion de la société, car ces sédiments ne sont pas des matières neutres, à la disposition des virtuoses de l'“ingénierie sociale”.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg


 13 avril 1890
13 avril 1890








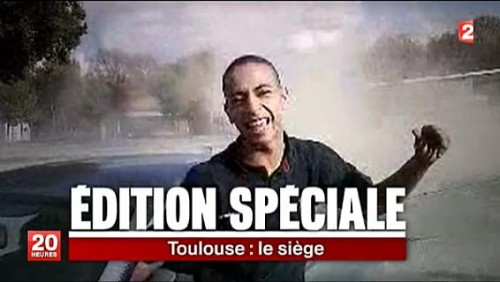

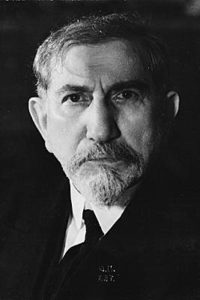
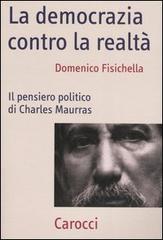






 Lente en van de Egyptische politiek. Ook al Qaradawi heeft heel wat aan Al Jazeera te danken en aan de media-aandacht die hij erdoor kreeg. Wekelijks was hij te zien en te horen in een uitzending “de sjaria en het leven”, waar hij vragen beantwoordde van toehoorders uit de ganse islamitische wereld.
Lente en van de Egyptische politiek. Ook al Qaradawi heeft heel wat aan Al Jazeera te danken en aan de media-aandacht die hij erdoor kreeg. Wekelijks was hij te zien en te horen in een uitzending “de sjaria en het leven”, waar hij vragen beantwoordde van toehoorders uit de ganse islamitische wereld. Neen, daarmee houdt het niet op, want ook in het conflict in Aghanistan is Qatar actief. Eerste zichtbare resultaat hiervan: de radikaal-islamitische Taliban opende in januari een officiële vertegenwoordiging in het emiraat. Via dit kantoor zouden vredesgesprekken op gang komen. En in die vredesgesprekken zouden ook de VSA en de EU kunnen worden betrokken. Kaboel houdt de boot voorlopig af en heeft aangedrongen op bilaterale gesprekken …met Qatar.
Neen, daarmee houdt het niet op, want ook in het conflict in Aghanistan is Qatar actief. Eerste zichtbare resultaat hiervan: de radikaal-islamitische Taliban opende in januari een officiële vertegenwoordiging in het emiraat. Via dit kantoor zouden vredesgesprekken op gang komen. En in die vredesgesprekken zouden ook de VSA en de EU kunnen worden betrokken. Kaboel houdt de boot voorlopig af en heeft aangedrongen op bilaterale gesprekken …met Qatar.