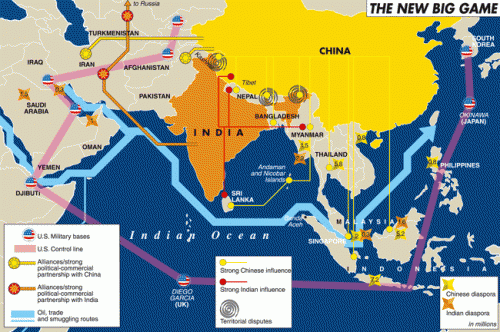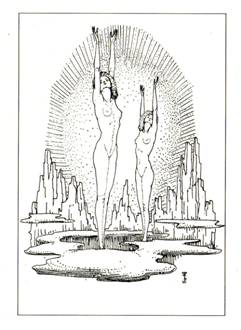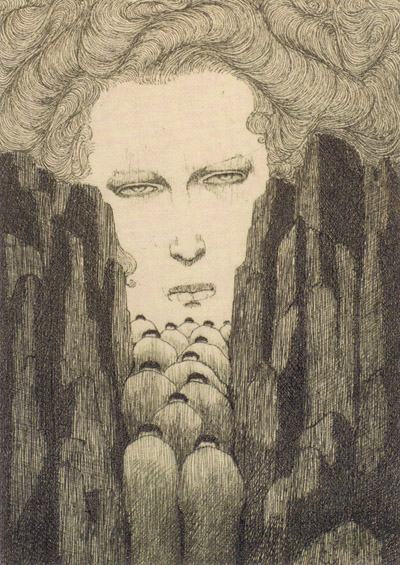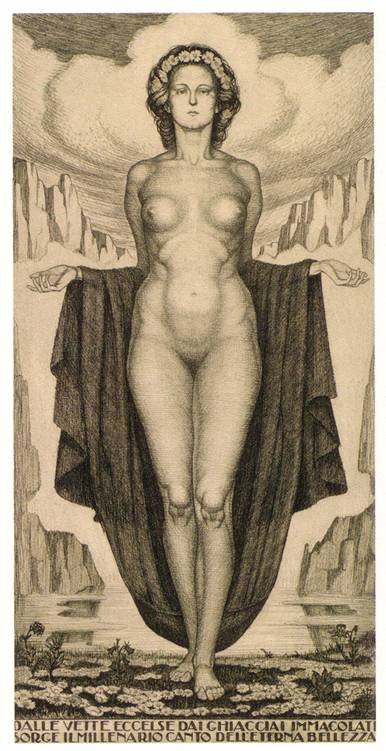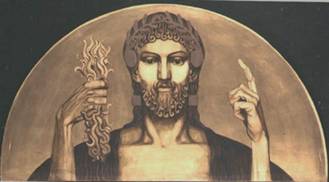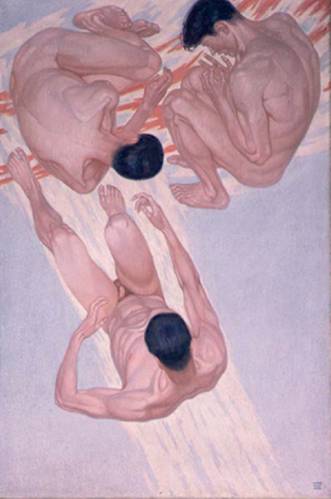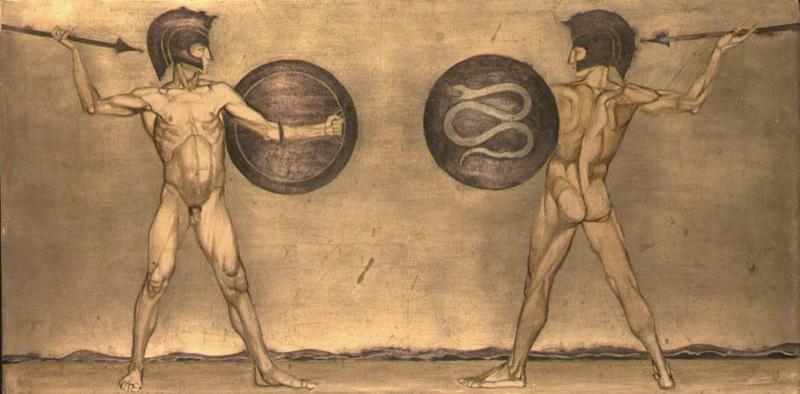vendredi, 30 décembre 2011
Céline contre le Spectacle
Céline contre le Spectacle par Stéphane Zagdanski
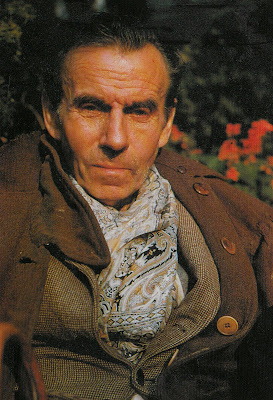 « Savez-vous ce que l'on demande d'abord à un fou lorsqu'il arrive à l'hôpital ? L'heure qu'il est et où il se trouve. L'heure, je peux vous la dire: onze heures du matin, et c'est aujourd'hui dimanche. Où je me trouve ? Eh bien ! dans un monde de cinglés où il faut vraiment faire un effort pour garder son bon sens, un effort de modestie, surtout ! Nous sommes au siècle de la publicité et la publicité compte désormais plus que l'objet. »
« Savez-vous ce que l'on demande d'abord à un fou lorsqu'il arrive à l'hôpital ? L'heure qu'il est et où il se trouve. L'heure, je peux vous la dire: onze heures du matin, et c'est aujourd'hui dimanche. Où je me trouve ? Eh bien ! dans un monde de cinglés où il faut vraiment faire un effort pour garder son bon sens, un effort de modestie, surtout ! Nous sommes au siècle de la publicité et la publicité compte désormais plus que l'objet. »Dès l’adolescence, Céline se montre angoissé par la mort – ce qui est commun –, et soucieux de ne pas noyer cette angoisse sous la parlotte – ce qui l’est moins. À quinze ans, étudiant en Angleterre tandis que sa tante Joséphine agonise, il écrit à ses parents : « Aussitôt que l'échéance finale sera arrivée, écris-moi un mot ou envoie-moi un télégramme. “Mort” suffit. En un mot, puisque tout espoir est perdu… »
« “Mort” suffit » ! Cette idée qu’en bavardant on masque la fatalité qui, en coulisses, fait de toute vie une « mort à crédit », Céline n’y renoncera jamais. C’est à partir d’elle qu’il fomentera son acerbe critique sociale, virulemment anarchiste, d’une perspicacité à toute épreuve tant que la paranoïa antisémite ne s’en mêle pas. Cette lucidité en fera un des rares précurseurs de la critique du Spectacle que Debord, par d’autres biais et selon un tout autre système de références, a poussée à son comble.
Les lecteurs de Voyage au bout de la nuit se souviennent de la déclaration de foi anarchiste de Bardamu qui ouvre le roman. Mais a-t-on remarqué que l’intervention primordiale d’Arthur Ganate est frappée au sceau du pessimisme le plus froid concernant la propagande du progrès : « Siècle de vitesse ! qu’ils disent. Où çà ? Grands changements ! qu’ils racontent. Comment çà ? Rien n’est changé en vérité. Ils continuent à s’admirer et c’est tout. » Tout Céline est déjà là, qui critiquera dans les années 50 la télévision, la radio et la publicité comme machines à abrutir en flattant la vanité humaine des « perruchelets paoniformes ».
La guerre de 14, bien sûr, appose un poinçon de sang au pessimisme substantiel de Céline. Il a, comme il l’écrit dans Voyage, « l’imagination de la mort », les autres non. Ce qui signifie qu’il ne se paye pas de mots, les autres si. À Joseph Garcin, qui a connu comme lui cet « enfer dont il ne faudrait pas revenir », il écrira le 1er septembre 1929 : « Vous avez saisi l'essentiel, le reste n'est que fatras de mots sans portée... ».
Dès 1916, dans une lettre à son père où il raconte avoir lu tous les journaux parus en France, il témoigne de son incroyance radicale en toute propagande, remarquant comme le mensonge s’appuie sur un certain style faisandé qu’il passera sa vie à vitupérer : L’« éloge pompeux de réformes qui s'imposent », s’accompagne « de phrases cascadeuses, ridicules de rhétorique empanachée ». Et 40 ans avant le « Ne travaillez jamais » de Debord, Céline avoue : « On prétend que le travail anoblit, je prétends qu'il avilit. »
En 1914, Céline n’a pas seulement côtoyé et étudié la mort, il a vu la déliquescence de toutes les vanités ; les hommes se sont révélés à lui comme autant d’écorchés de l’âme dans leurs petitesses sans fard. C’est aussi à cette déchéance, si peu conforme au mythe de l’Empire colonial, qu’il assistera en Afrique après la guerre, dont il rend également compte dans Voyage. « Sur la Meuse et dans le Nord et au Cameroun », écrit-il à Garcin en 1933, « j'ai bien vu cet effilochage atroce, gens et bêtes et lois et principes, tout au limon, un énorme enlisement… ». La même année, à son ami Élie Faure qui tente de le convaincre du bien-fondé du socialisme, Céline énonce le principe de son inconvertibilité idéologique, de ce qu’il nommera plus tard, concernant son anarchisme, sa « boussole personnelle, indéréglable » : « Crever pour le peuple oui – quand on voudra – où on voudra, mais pas pour cette tourbe haineuse, mesquine, pluridivisée, inconsciente, vaine, patriotarde alcoolique et fainéante mentalement jusqu'au délire. » C’est l’époque où Céline admire encore Bergson et Freud, dont le pessimisme structurel l’influence grandement. Céline écrit en 1933 à Albert Thibaudet : « L'énorme école freudienne est passée inaperçue. Toute la haine raciale n'est qu'un truc à élections. Le tourment esthétique n'est même pas murmurable. » Il demande à son amie juive viennoise Cillie Ambord de lui traduire Trauer und Melancholie, et lui écrit juste après l’accession d’Hitler au pouvoir : « Je suis bien content de vous savoir pour le moment en sécurité mais la folie hitler va finir par dominer l'Europe pendant des siècles encore. Mr Freud n'y peut rien. » Et en bon freudien, Céline se doute que nazisme et fascisme prospèrent sur la servitude volontaire : « Ici », écrit-il à Garcin le 15 février 1934, « c'est l'hystérie collective, voilà le fascisme en route, on attend l'homme à poigne avec ou sans moustaches. Les Français sont masochistes. Progrès ? où quand ? je ne vois qu'une vieille nation ratatinée. »
Ce qui caractérise la lucidité de Céline, c’est qu’il ne choisit aucun camp. Ni le socialisme ni le fascisme, ni l’URSS ni l’Amérique. Écoeuré par l’humain en soi, il rédige en 1934 Mea Culpa, un premier pamphlet, avant Bagatelles, qui reste un chef-d’oeuvre de clairvoyance concernant la servitude volontaire, une déclaration de guerre à toutes les utopies, tous les optimismes : « Il faudrait buter les flatteurs, c'est ça le grand opium du peuple... L'Homme il est humain à peu près autant que la poule vole. Quand elle prend un coup dur dans le pot, quand une auto la fait valser, elle s'enlève bien jusqu'au toit, mais elle repique tout de suite dans la bourbe, rebecqueter la fiente. C'est sa nature, son ambition. Pour nous, dans la société, c'est exactement du même. »
00:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Peder Jensen, alias “Fjordman”, inspirateur d’Anders Breivik?

Manfred KLEINE-HARTLAGE:
Peder Jensen, alias “Fjordman”, inspirateur d’Anders Breivik?
Immédiatement après le massacre perpétré à Oslo en juillet dernier, paraissait dans la presse norvégienne une photographie de l’homme censé avoir inspiré, par ses écrits, le tueur Anders Breivik. Ce soupçon était erroné mais le dévoilement de l’identité de “Fjordman” a surpris: l’écrivain préféré de Breivik ne ressemblait pas du tout à l’homme de droite ou d’extrême-droite telle que l’imaginent les médias de gauche. Peder Jensen, que le monde ne connaissait via internet que sous le pseudonyme de “Fjordman”, travaillait dans une institution sociale: les attentats et leur suite, qui l’ont forcé à dévoiler son identité, lui ont coûté son emploi.
Jensen, âgé de 36 ans, n’est pas né animé par des idées conservatrices: il les a acquises par l’étude. Il est issu d’une famille incarnant parfaitement l’établissement de gauche, qu’il n’a cessé de critiquer. Comme beaucoup de critiques de l’islamisme, que l’on peut ranger dans la catégorie des “contre-djihadistes”, il est un homme jadis socialisé à gauche de l’échiquier politique; il n’a révisé ses idées que fort tard, quand il a été confronté à l’islamisme. Le tournant dans son évolution date du 11 septembre 2001, une journée au cours son long séjour au Caire. Ce n’est pas tant le fait que dix-neuf musulmans auraient perpétré l’attentat qui l’ont fait changer d’avis sur l’islam alors qu’il apprenait la langue arabe dans la capitale égyptienne: c’est davantage le spectacle de millions de musulmans applaudissant au carnage qui l’a interpellé.
Depuis 2005, cet arabisant norvégien, à la vie tranquille, gèrait un blog sous le nom de “Fjordman” et, par le biais de ses articles bien argumentés, reposant sur les critères de cette discipline que les Allemands appellent la “Kulturkritik”, il touchait des centaines de milliers sinon des millions de lecteurs. L’impact de son travail est surtout dû au fait qu’il ne se contentait pas de critiquer l’islam ou l’islamisme. Il posait une question cruciale: pourquoi laisse-t-on l’islamisme se déployer? Fjordman, arabisant patenté, ne se bornait pas à disséquer la culture islamique mais se penchait de manière fort critique sur notre propre culture occidentale, où il repérait un masochisme suicidaire, des illusions infantiles et un oubli permanent de l’histoire. Il n’hésitait pas, sur base de ses diagnostics, à citer les noms des vecteurs européens, américains et occidentaux de cette déchéance intellectuelle.
Au fil des années, les essais de Fjordman devenaient de plus en plus sombres et pessimistes, parce que ses questions devenaient de plus en plus pertinentes et profondes. Fjordman a donc commencé sa carrière comme critique de l’islamisme mais, au fur et à mesure que sa quête progressait, il est devenu un fin critique des fondements de notre propre civilisation occidentale. Désormais, on peut suivre pas à pas cette évolution intellectuelle dans une première édition allemande de ses écrits, publiée fin novembre 2011.
Au départ, les positions de Fjordman étaient plutôt pro-américaines mais elles ont cédé la place à un anti-globalisme radical. La critique fjordmanienne du “globalisme” a ainsi reçu la priorité par rapport aux articles critiques sur l’islamisation de l’Europe. La crise de notre civilisation, conclut Jensen/Fjordman, dérive de l’acceptation a-critique de l’idéologie mondialiste (”One-World-Ideology”), que l’on considère aujourd’hui comme une évidence incontournable. C’est là que Jensen/Fjordman va plus loin qu’une simple critique de l’islamisme. Les élites occidentales font tout pour sacrifier à une utopie perverse les structures nées de l’histoire et les identités concrètes des peuples; or cette utopie mondialiste est inhumaine, elle relève d’une inhumanité qui ne se révèlera à tous que lorsqu’il sera trop tard...
Manfred KLEINE-HARTLAGE (*).
(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°49/2011; http://www.jungefreiheit.de ).
(*) Manfred Kleine-Hartlage est le co-éditeur du livre intitulé “Fjordman. Europa verteidigen. Zehn Texte” (Edition Antaios – http://www.antaios.de )
 |
Fjordman Europa verteidigen Zehn Texte ISBN: 978-3-935063-66-1 19,00 EUR incl. 7 % UST exkl. Versandkosten |
|
Als Internet-Publizist ist Fjordman seit einigen Jahren in der sogenannten Counterjihad-Szene ein Begriff: islamkritisch, multikultikritisch, liberalismuskritisch, ein belesener Essayist.
Die Herausgeber Martin Lichtmesz und Manfred Kleine-Hartlage haben zehn der besten Texte Fjordmans ausgewählt, die Übersetzungen bearbeitet und ein Buch zusammengestellt, das durch die Radikalität seines Tons provoziert und zugleich diese Radikalität rechtfertigt: Es geht um die Verteidigung des Eigenen. Dieses Eigene ist Europa. In einem flankierenden Essay nimmt Martin Lichtmesz den Fall des Attentäters von Oslo und Utoya unter die Lupe: Anders Breivik berief sich in einem Pamphlet mehrfach auf Fjordmans Analysen. Er hat damit geistiges Terrain vermint, das es nun wiederum freizuräumen gilt. Vorwort: Overtüre: Vorbereitung auf Ragnaräck I. Akt Islamkritik Warum wir uns nicht auf moderate Moslems verlassen können Was kostet Europa die islamische Zuwanderung? Vierzehn Jahrhunderte Krieg gegen die europäische Zivilisation II. Akt Kulturkritik Political Correctness - die Rache des Marxismus Die Wurzeln der Antidiskriminierung Sechster Text von Fjordman Westlicher Feminismus und das Bedürfnis nach Unterwerfung Siebter Text von Fjordman Die vaterlose Zivilisation Achter Text von Fjordman Die EU und die globalistische Allianz Wenn Verrat zur Norm wird Zehnter Text von Fjordman Nachwort Fjordman verteidigen Martin Lichtmesz Entwurf einer Europäischen Unabhängigkeitserklärung von Fjordman Anmerkungen |
|
00:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, norvège, scandinavie, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Immixtion américaine en Russie

Bernhard TOMASCHITZ:
Immixtion américaine en Russie
Après le vote pour la Douma, les Etats-Unis n’ont pas hésité à s’immiscer dans les affaires intérieures de la Russie
Les élections pour le parlement russe du 4 décembre ont suscité quelques turbulences politiques. Sous prétexte qu’il y aurait eu manipulations, les manifestations se multiplient à Moscou et à Saint Pétersbourg. L’Occident en profite pour tirer à boulets rouges sur les dirigeants russes. Pour ce motif, le premier Ministre russe Vladimir Poutine a annoncé que des mesures de rigueur seront prises contre ceux qui se mêlent de la politique russe “sur ordre de l’étranger”. “Nous sommes obligés de protéger notre souveraineté et nous nous sentons contraints d’y réfléchir”, a souligné Poutine, tout en reprochant à la ministre américaine des affaires étrangères Hillary Rodham Clinton d’avoir donné le signal pour que se déchaîne la vague de protestations et de manifestations. Ensuite, Poutine a ajouté, sur un ton très critique, “le travail actif a commencé avec le soutien du ministère américain des affaires étrangères”.
Tandis que bon nombre de commentateurs, dans les médias occidentaux inféodés au système, déclaraient que le premier ministre russe souffrait de paranoïa, nous pouvons tout de même objectivement constater que les reproches formulés par Poutine ne sont pas dénués de fondements. En effet, qui a joué un rôle-clef dans cette effervescence protestataire, tant avant qu’après le scrutin? Indubitablement, l’association “Golos” (= “La Voix”), soi-disant indépendante et posée comme “organisation non gouvernementale”. Ses “experts” (auto-proclamés) ont bénéficié de vastes colonnes dans les journaux occidentaux quelques jours avant les élections pour décrire le système semi-autoritaire de Poutine comme une abominable tyrannie obscurantiste. “Golos” a agité les esprits en Occident sous prétexte que des manifestants avaient été arrêtés.
En fait, “Golos” est tout autre chose qu’une ONG indépendante. Ainsi, on peut lire sur le site internet de l’“International Republican Institute”, une fondation du Parti Républicain: “Golos est une association qui a été fondée en 2000 pour protéger les droits des électeurs; elle reçoit des subsides des autorités américaines responsables du développement à l’échelle mondiale (USAID), du groupe ‘National Endowment for Democracy’ et de l’ambassade britannique. Le ‘National Democratic Institute’ offre la formation des cadres et l’International Republican Institute fournit une aide en offrant des vidéos d’information pour les électeurs”. Les autorités américaines de l’USAID sont directement inféodées au ministère américain des affaires étrangères et ont toujours joué un rôle prépondérant quand il s’est agi de s’immiscer dans les affaires intérieures de pays tiers. En règle générale, les subsides transitent par la NED (“National Endowment for Democracy”), considérée comme le bras civil de la CIA. La NED “sponsorise” soit directement des projets de “soutien à la démocratie” à l’étranger soit verse l’argent aux fondations des partis démocrate et républicain qui, à leur tour, apportent un soutien financier à des instances proches d’eux, émanant de la “société civile” du pays étranger placé dans le collimateur.
Le processus appliqué à la Russie pouvait se lire dans le “plan stratégique” de l’USAID pour les années de 2007 à 2012. Dans le texte de ce plan, les auteurs reprochent au Kremlin de court-circuiter les projets américains en Europe orientale, dans les Balkans et dans le Caucase, c’est-à-dire dans des régions qui doivent à terme être “ancrées” dans les structures euro-atlantistes. Washington s’insruge également contre la politique de Poutine au cours de ses deux premiers mandats: il a en effet visé et fait progresser l’indépendance économique et énergétique de son pays. Pour torpiller cette politique étrangère, économique et énergétique, il convient donc d’importer en Russie “les valeurs de la démocratie, des droits de l’homme et de la liberté”, tout en tentant d’imbriquer la vaste Fédération de Russie dans “l’économie mondiale”, c’est-à-dire dans l’ordre économique et dans le projet de globalisation ébauchés par la Maison Blanche et par Wall Street.
En 2009, la NED a versé 75.234 dollars à “Golos” pour organiser des “audits officiels” et des campagnes de signatures. En 2007, la NED avait déjà versé 49.500 dollars à l’association russe. Le CIMA, ou “Center for International Media Assistance”, une branche de la NED, joue un rôle de premier plan dans tout appui aux forces politiques visant à instaurer quelque part dans le monde la “démocratie libérale” de type américain: depuis des années, ce centre apporte son soutien à des journalistes pro-américains, en les formant ou en leur offrant des programmes d’échange.
Le NDI (“National Democratic Institute”) démontre l’importance des fondations des partis américains dans l’immixtion constante de Washington dans les affaires intérieures russes. La NDI déclare officiellement qu’elle est active en Russie depuis le début des années 90, afin d’y “renforcer les institutions démocratiques”, en déployant quantité d’incitants pour qu’à terme il y ait “une plus grande participation des citoyens aux processus décisionnels” et pour que certaines organisations civiles et certains partis politiques soient renforcés en Russie grâce à “des échanges internationaux d’expériences acquises”. “Golos”, dans ce vaste complexe d’opérations stratégiques”, est un partenaire importants de la NDI: l’association subversive russe coopère effectivement avec la NDI depuis le jour même de sa fondation. Aujourd’hui, “Golos” est en mesure d’aller observer les élections dans 48 régions de la Fédération de Russie.
Mutatis mutandis, la situation observable aujourd’hui en Russie ressemble à celle que l’on pouvait constater en Ukraine lors de la “révolution orange”, il y a sept ans. En Ukraine aussi, on a évoqué des “fraudes électorales” pour mettre le feu aux poudres et pour déclencher la révolte. Et une fois de plus, on a vu se pointer à l’horizon le spéculateur boursier Georges Sörös. L’organisation que ce personnage soutient, le “Human Rights Watch”, vient d’entamer une campagne de presse, où elle se plaint que “Golos” est victime d’une “campagne de dénigrement” orchestrée par les autorités russes...
Bernhard TOMASCHITZ.
(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°50/2011; http://www.zurzeit.at ).
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, manipulations médiatiques, russie, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Une grande transformation
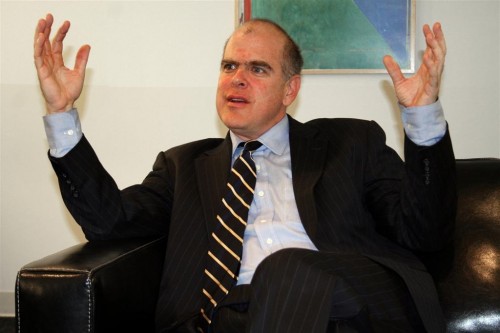
Une grande transformation
par Georges FELTIN-TRACOL
En 2009, le journaliste Christopher Caldwell faisait paraître Reflections on the revolution in Europe, clin d’œil appuyé à l’ouvrage contre-révolutionnaire du Whig Edmund Burke publié en 1790. Les Éditions du Toucan viennent de sortir sa traduction française sous le titre d’Une révolution sous nos yeux. Alors que les maisons d’éditions institutionnelles se gardent bien maintenant de traduire le moindre ouvrage qui irait à l’encontre de la pesante pensée dominante, saluons cette initiative qui permet au public francophone de découvrir un point de vue divergent bien éloigné de l’agencement ouaté des studios de radio et des plateaux de télévision.
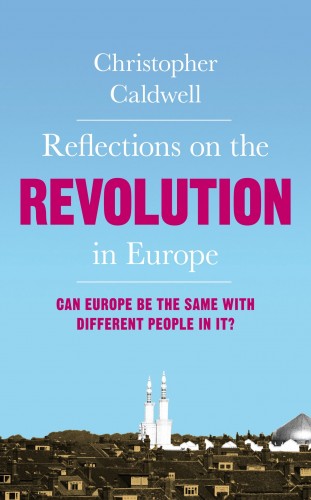 Éditorialiste au Financial Times (le journal officiel de la City) et rédacteur au Weekly Standard et au New York Times Magazine, Christopher Caldwell relève du courant néo-conservateur anglo-saxon. Il en remercie même William Kristol, qui en est l’une des têtes pensantes. L’édition française est préfacée par la démographe Michèle Tribalat qui, avec son compère Pierre-André Taguieff, semble ébaucher une sensibilité néo-conservatrice dans l’Hexagone plus charpentée que les guignols de la triste revue Le meilleur des mondes.
Éditorialiste au Financial Times (le journal officiel de la City) et rédacteur au Weekly Standard et au New York Times Magazine, Christopher Caldwell relève du courant néo-conservateur anglo-saxon. Il en remercie même William Kristol, qui en est l’une des têtes pensantes. L’édition française est préfacée par la démographe Michèle Tribalat qui, avec son compère Pierre-André Taguieff, semble ébaucher une sensibilité néo-conservatrice dans l’Hexagone plus charpentée que les guignols de la triste revue Le meilleur des mondes.
On pourrait supposer qu’Une révolution sous nos yeux est un lourd pensum ennuyeux à lire composé de douze chapitres réunis en trois parties respectivement intitulées « Immigration », « L’islam » et « L’Occident ». Nullement ! Comme la plupart des enquêtes journalistiques anglo-saxonnes, les faits précis et détaillés sont étayés et argumentés. Il faut avouer que le sujet abordé est risqué, surtout en France…
« Ce livre, avertit l’auteur, évitera l’alarmisme et la provocation vaine, mais il évitera aussi l’euphémisme et cette façon de se coucher (à titre préventif) qui caractérise tant d’écrits sur les questions relatives à l’ethnicité (p. 53). » Qu’aborde-t-il donc ? « Ce livre, répond Caldwell, traite de l’Europe, de comment et pourquoi l’immigration et les sociétés multi-ethniques qui en résultent marquent une rupture dans son histoire. Il est écrit avec un œil rivé sur les difficultés que l’immigration pose à la société européenne (p. 52).
Partant des déclarations prophétiques en avril 1968 du député conservateur Enoch Powell au Midland Hotel de Birmingham consacrées aux tensions raciales à venir, l’auteur estime que « l’immigration n’améliore pas, ne valorise pas la culture européenne; elle la supplante. L’Europe ne fait pas bon accueil à ses tout nouveaux habitants, elle leur cède la place (p. 47) ». Pourquoi ?
Les racines du mal
Avant de répondre, Christopher Caldwell rappelle que « l’immigration de masse a débuté dans la décennie postérieure à la Seconde Guerre mondiale. […] En Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas et en Scandinavie, l’industrie et le gouvernement ont mis en place des politiques de recrutement de main-d’œuvre étrangère pour leurs économies en plein boom (p. 25) ». Par conséquent, « l’Europe devint une destination d’immigration, suite à un consensus de ses élites politiques et commerciales (p. 25) ». Il insiste sur le jeu du patronat qui préfère employer une main-d’œuvre étrangère plutôt que locale afin de faire baisser les salaires… Il y a longtemps que l’immigration constitue l’arme favorite du capital (1). Or « les effets sociaux, spirituels et politiques de l’immigration sont considérables et durables, alors que ses effets économiques sont faibles et transitoires (pp. 69 – 70) ».
Il importe d’abandonner l’image du pauvre hère qui délaisse les siens pour survivre chez les nantis du Nord… « Pour Enoch Powell comme pour Jean Raspail, l’immigration de masse vers l’Europe n’était pas l’affaire d’individus “ à la recherche d’une vie meilleure ”, selon la formule consacrée. C’était l’affaire de masses organisées exigeant une vie meilleure, désir gros de conséquences politiques radicalement différentes (p. 31, souligné par l’auteur). » Dans cette « grande transformation » en cours, en raison du nombre élevé de pratiquants parmi les nouveaux venus, l’islam devient une question européenne ou, plus exactement, le redevient comme au temps du péril ottoman et des actes de piraterie maritime en Méditerranée jusqu’en 1830… Dorénavant, « l’immigration jou[e] un rôle aussi perturbateur que le nationalisme (p. 402) ».
Très informé de l’actualité des deux côtes de l’Atlantique, Christopher Caldwell n’hésite pas à comparer la situation de l’Europe occidentale à celle des États-Unis. Ainsi, les remarques politiques ne manquent pas. L’auteur estime par exemple que, pour gagner les électeurs, Nicolas Sarközy s’inspire nettement des méthodes de Richard Nixon en 1968 et en 1972.
À la différence de Qui sommes-nous ? de Samuel P. Huntington qui s’inquiétait de l’émergence d’une éventuelle Mexamérique, Caldwell pense que les Latinos, souvent catholiques et occidentalisés, peuvent renforcer et améliorer le modèle social étatsunien. L’auteur remarque même, assez justement, que « les Américains croient que l’Amérique, c’est la culture européenne plus l’entropie (p. 447) ». En revanche, l’Europe est confrontée à une immigration pour l’essentiel musulmane. L’Europe ne serait-elle pas dans le même état si l’immigration extra-européenne était principalement non-musulmane ? L’auteur n’y répond pas, mais gageons que les effets seraient semblables. Le problème majeur de l’Europe n’est pas son islamisation qui n’est qu’une conséquence, mais l’immigration de masse. Il serait temps que les Européens comprennent qu’ils deviennent la colonie de leurs anciennes colonies…
L’injonction morale multiculturaliste
Si cette prise de conscience tarde, c’est parce que « le multiculturalisme, qui demeure le principal outil de gestion de l’immigration de masse en Europe, impose le sacrifice des libertés que les autochtones européens tenaient naguère pour acquises (p. 38) ». L’imposture multiculturaliste (ou multiculturelle) – qui est en fait un monothéisme du marché et de la consommation – forme le soubassement fondamental de l’Union européenne et des « pays occidentaux [qui] sont censés être des démocraties (p. 435) ». Néanmoins, sans la moindre consultation électorale, sans aucun débat public véritable, « sans que personne ne l’ait vraiment décidé, l’Europe occidentale s’est changée en société multi-ethnique (p. 25) ».
À la suite d’Alexandre Zinoviev, d’Éric Werner et d’autres dissidents de l’Ouest, Christopher Caldwell observe la démocratie régresser en Occident avec l’adoption fulgurante de lois liberticides contre les hétérodoxies contemporaines. En effet, « l’Europe de l’après-guerre s’est bâtie sur l’intolérance de l’intolérance – un état d’esprit vanté pour son anti-racisme et son antifascisme, ou brocardé par son aspect politiquement correct (p. 128) ». Après la lutte contre l’antisémitisme, l’idéologie multiculturaliste de la tolérance obligatoire s’élargit aux autres minorités raciales et sexuelles et renforce la répression. Il devient désormais tout aussi grave, voire plus, de dénigrer un Noir, un musulman, un homo ou de nier des faits historiques récents que de violer une fillette ou d’assassiner un retraité ! « Peu à peu, les autochtones européens sont […] devenus moins francs ou plus craintifs dans l’expression publique de leur opposition à l’immigration (p. 38). » Rôdent autour d’eux de véritables hyènes, les ligues de petite vertu subventionnées grassement par le racket organisé sur les contribuables. Et garde aux « contrevenants » ! Dernièrement, une Londonienne, Emma West, excédée par l’immigration et qui l’exprima haut et fort dans un compartiment de transport public, a été arrêtée, accusée de trouble à l’ordre public et mise en détention préventive. « Le journal Metro puis un journaliste de la chaîne américaine C.N.N. ont lancé un appel à la délation sur Twitter (2) ». La police des transports a même appelé à la délation sur Internet pour connaître l’identité de cette terrible « délinquante » ! Sans cesse soumis à une propagande « anti-raciste » incessante, « les Européens ont commencé à se sentir méprisables, petits, vilains et asexués (p. 151) ». Citant Jules Monnerot et Renaud Camus, Caldwell voit à son tour l’antiracisme comme « le communisme du XXIe siècle » et considère que « le multiculturalisme est presque devenu une xénophobie envers soi-même (p. 154) », de l’ethno-masochisme ! Regrettons cependant que l’auteur juge le Front national de Jean-Marie Le Pen comme un parti « fasciste », doctrine disparue depuis 1945…
La mésaventure d’Emma West n’est pas surprenante, car « l’État-nation multiculturel est caractérisé par un monopole sur l’ordre moral (p. 413) ». Les racines de ce nouveau moralisme, de ce néo-puritanisme abject, proviennent du traumatisme de la dernière guerre mondiale et de l’antienne du « Plus jamais ça ! ». « Ces dernières années, l’Holocauste a été la pierre angulaire de l’ordre moral européen (p. 356) ». Il était alors inévitable que « le repentir post-Holocauste devient le modèle de régulation des affaires de toute minorité pouvant exiger de façon plausible d’un grave motif de contrariété (p. 357) ». Être victime est tendance, sauf quand celle-ci est blanche.
Dans cette perspective utopique d’harmonie interraciale, il paraît certain qu’aux yeux des tenants du politiquement correct et du multiculturalisme, « l’Islam serait tout simplement la dernière catégorie, après le sexe, les préférences sexuelles, l’âge et ainsi de suite, venue s’ajouter au langage très convenu qu’ont inventé les Américains pour évoquer leur problème racial au temps du mouvement des droits civiques (pp. 234 – 235) ». Pour Christopher Caldwell, c’est une grossière erreur, lui qui définit l’islam comme une « hyper-identité ».
Le défi musulman
Le choc entre l’islam et l’Occident est indéniable : le premier joue de son dynamisme démographique, de son nombre et de sa vigueur spirituel alors que le second se complaît dans la marchandise la plus indécente et la théocratie absconse des droits de l’homme, de la femme, du travelo et de l’inter… Les frictions sont inévitables entre la conception traditionnelle phallocratique musulmane et l’égalitarisme occidental moderne. Allemands et Scandinaves sont horrifiés par les « crimes d’honneur » contre des filles turques et kurdes « dévergondées » par le Système occidental. Les pratiques coutumières de l’excision, du mariage arrangé et de la polygamie choquent les belles âmes occidentales qui exigent leur interdiction pénale. Mais le musulman immigré n’est-il pas lui même outré par l’exposition de la nudité féminine sur les panneaux publicitaires ou de l’homoconjugalité (terme plus souhaitable que « mariage homosexuel ») ?
Caldwell rappelle que le Néerlandais Pim Fortuyn combattait l’islam au nom des valeurs multiculturalistes parce qu’il trouvait la religion de Mahomet trop monoculturelle et donc totalitaire. Des mouvements populistes européens (English Defence League, Vlaams Belang, Parti du Peuple danois, Parti de la Liberté de Geert Wilders, etc.) commettent l’erreur stratégique majeur de se rallier au désordre multiculturel ambiant et d’adopter un discours conservateur moderne (défense de l’égalité homme – femme, des gays, etc.) afin d’être bien vus de la mafia médiatique. Par cet alignement à la doxa dominante, ils deviennent les supplétifs d’un système pourri qui reste l’ennemi prioritaire à abattre.
Pour l’auteur d’Une révolution sous nos yeux, l’islam est dorénavant la première religion pratiquée en Europe qui connaît l’immense désaffection des églises. L’homme étant aussi un être en quête de sacré, il est logique que la foi mahométane remplit un vide résultant de décennies de politique laïciste démente. Et ce ne seront pas les tentatives désespérées de Benoît XVI pour réévangéliser le Vieux Continent qui éviteront cette incrustation exogène parce que Caldwell démontre – sans le vouloir – le caractère profondément moderniste du titulaire putatif du siège romain : l’ancien cardinal Ratzinger est depuis longtemps un rallié à la Modernité !
Dans ce paysage européen de l’Ouest en jachère spirituelle, « les musulmans se distinguent par leur refus de se soumettre à ce désarmement spirituel. Ils se détachent comme la seule source de résistance au multiculturalisme dans la sphère publique. Si l’ordre multiculturel devait s’écrouler, l’Islam serait le seul système de valeur à patienter en coulisse (p. 423) ». Doit-on par conséquent se résigner que notre avenir d’Européen soit de finir en dhimmi d’un quelconque califat universel ou bien en bouffeur de pop corn dans l’Amérique-monde ?
Puisque Caldwell souligne que « l’immigration, c’est l’américanisation (p. 446) », que « l’égalité des femmes constitu[e] un principe ferme et non négociable des sociétés européennes modernes (p. 317) » et que « vous pouvez être un Européen officiel (juridique) même si vous n’êtes pas un “ vrai ” Européen (culturel) (p. 408) », il est temps que, hors de l’impasse néo-conservatrice, le rebelle européen au Diktat multiculturel occidental promeuve une Alter-Europe fondée sur l’Orthodoxie traditionnelle ragaillardie, un archéo-catholicisme antétridentin redécouvert et des paganismes réactivés, une volonté de puissance restaurée et des identités fortes réenracinées. « L’adaptation des minorités non-européennes dépendra de la perception qu’auront de l’Europe les autochtones et les nouveaux arrivants – civilisation florissante ou civilisation décadente ? (p. 45) » Ni l’une ni l’autre; c’est la civilisation européenne qu’il faut dans l’urgence refonder !
Georges Feltin-Tracol
Notes
1 : Pour preuve supplémentaire, lire la chronique délirante d’Ariel Wizman, « Pourquoi les immigrés sont les meilleurs alliés du libéralisme », dans L’Express, 7 décembre 2011.
2 : Louise Couvelaire, dans M (le magazine du Monde), 10 décembre 2011. Pour soutenir au moins moralement Emma West, on peut lui envoyer une carte postale à :
Mrs Emma West
co HMP Bronzfield
Woodthorpe Road
Ashford
Middlesex TW15 3J2
England
• Christopher Caldwell, Une révolution sous nos yeux. Comment l’islam va transformer la France et l’Europe, préface de Michèle Tribalat, Éditions du Toucan (25, rue du général Foy, F – 75008 Paris), coll. « Enquête & Histoire », 2011, 539 p., 23 €.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2342
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, christopher caldwell, europe, affaires européennes, immigration, islam |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 29 décembre 2011
Concurrence géopolitique dans le Pacifique

Bernhard TOMASCHITZ:
Concurrence géopolitique dans le Pacifique
Les Etats-Unis veulent contrer la montée en puissance de la Chine: ils projettent d’encercler l’Empire du Milieu!
Dans les rapports bilatéraux entre les Etats-Unis et la Chine, la méfiance réciproque est désormais de mise. Lors de sa visite en Australie, le Président américain Obama a en effet déclaré: “J’ai pris une décision d’ordre stratégique: en tant qu’Etat riverain du Pacifique, les Etats-Unis joueront dans l’avenir un plus grand rôle dans la mise en valeur de cette région; c’est là une politique à mener sur le long terme”. De plus, les Etats-Unis entendent bâtir une base militaire à proximité de la ville de Darwin dans le Nord de l’Australie, où seront plus tard casernés 2500 soldats d’élite. Obama veut en plus créer une zone de libre-échange dans le Pacifique qui comprendrait l’Australie, le Japon, Singapour et le Vietnam, tandis qu’il n’y aurait aucune place pour la Chine dans ce projet.
Quand ils prennent acte de ces projets stratégiques, les Chinois craignent d’être encerclés par les Etats-Unis. Soupçon parfaitement justifié! Déjà en 2006, les Etats-Unis et l’Inde avaient signé un accord d’ampleur assez vaste par lequel la Nouvelle Delhi se voyait reconnaître au niveau international comme puissance nucléaire. Outre cet accord américano-indien, les Etats-Unis entretiennent des bases militaires au Japon et en Corée du Sud. Si dorénavant l’Axe liant les puissances d’Asie aux Etats-Unis se voit prolongé jusqu’en Australie, alors l’influence de la Chine restera limité à ses seules eaux côtières.
Les projets de Washington doivent se percevoir comme une tentative d’endiguer la Chine, tant que cela est encore possible. Car le développement économique de l’Empire du Milieu s’effectue à une vitesse de croissance inégalée, ce qui agace et inquiète les Etats-Unis, encore plus préoccupés par l’éveil d’une politique étrangère chinoise bien consciente des enjeux planétaires. Au Conseil de Sécurité de l’ONU, les Chinois ne cessent de torpiller les projets américains, comme, par exemple, quand il s’agit d’infliger à l’Iran des sanctions encore plus draconiennes. Dans la lutte pour la domination économique des Etats riches en matières premières, notamment en Afrique et en Asie centrale, Beijing et Washington sont devenus de véritables rivaux. A tout cela s’ajoute que le modèle chinois, couplant une économie libéralisée et un appareil d’Etat autoritaire, exerce une attraction de plus en plus évidente sur les pays en voie de développement et sur les pays émergents qui préfèrent opter pour un avenir politique différent de celui suggéré par la “démocratie libérale” de type américain. De ce fait, la Chine n’est plus seulement un concurrent économique des Etats-Unis mais elle les défie en agissant justement sur leur point le plus sensible: celui de vouloir incarner et propager de manière monopolistique la seule démocratie de facture occidentale, au détriment de toutes les autres formes possibles de gouvernance. Ce n’est donc pas un hasard si, un jour, Obama a déclaré, en s’adressant à la Chine d’un ton assez menaçant: “Nous continuerons à expliquer, y compris à Beijing, quelle est la signification pour nous du maintien des normes internationales et du respect des droits de l’homme pour le peuple chinois”.
Il y a plus: la modernisation des forces armées chinoises, et surtout de la marine de guerre de l’Empire du Milieu, montre que Beijing n’entend pas se contenter, dans l’espace pacifique, d’un rôle de “junior partner”, soumis à la volonté américaine. Le renforcement militaire chinois a pour effet que les frais d’entretien de l’empire américain doivent désormais être révisés à la hausse dans la région, notamment pour garantir la sécurité d’alliés comme le Japon ou la Corée du Sud et surtout Taiwan. Plusieurs incidents confirment ce nouvel état de choses: la marine chinoise s’attaque de plus en plus souvent à des navires de prospection vietnamiens ou philippins qui oeuvrent en Mer de Chine du Sud, espace marin dont les riverains se querellent à propos du tracé des frontières maritimes et, partant, sur la superficie de leur zone d’influence économique. Lors de ces escarmouches, ce ne sont pas tant les Vietnamiens ou les Philippins qui sont les destinataires des menaces chinoises mais avant tout les Etats-Unis.
Les Chinois, dans ce contexte, s’inquiètent surtout de l’amélioration constante des rapports américano-vietnamiens, en dépit du souvenir cuisant de la guerre du Vietnam. Le Vietnam communiste a certes libéralisé son économie en s’inspirant du modèle chinois et s’est ouvert aux investisseurs étrangers mais les relations avec le grand voisin du Nord n’en demeurent pas moins empreintes de méfiance pour des raisons historiques. Pendant des siècles, les Vietnamiens ont dû payer tribut aux empereurs de Chine et, pendant la seconde moitié du 20ème siècle, la Chine n’a jamais omis de toujours briser, avant qu’ils ne se concrétisent, les rêves vietnamiens de devenir une puissance régionale, en dépit de la “fraternité communiste” censée unir Hanoi à Beijing. Quant au Vietnam, le pays le plus densément peuplé de l’Indochine, il a toujours revêtu une signification particulière pour les Chinois: en effet, la puissance étrangère qui contrôlera ce pays limitera ipso facto et de manière considérable l’influence de Beijing dans la région et fera courir à la Chine le risque d’être encerclée.
Où l’affaire risque bien de devenir explosive, c’est quand les relations américano-vietnamiennes se trouvent renforcées par les activités du consortium pétrolier américain Exxon dans les eaux de la Mer de Chine du Sud. Fin octobre, l’Energy Delta Institute annonçait qu’Exxon avait découvert devant les côtes du Vietnam “des gisements de gaz d’une ampleur assez considérable” dans une région qui est également revendiquée par la Chine. La situation, déjà âprement concurrentielle, pourrait dès lors prendre une tournure plutôt dangereuse. Car, au même moment, le ministère de la défense américain travaillerait, selon le “Financial Times”, “à développer rapidement une nouvelle stratégie prévoyant une bataille aérienne et navale, afin d’acquérir à terme les moyens de contrer les plans chinois visant à empêcher les forces armées américaines de pénétrer dans les mers voisines de la Chine”.
Berhard TOMASCHITZ.
(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°48/2011; http://www.zurzeit.at ).
17:11 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, chine, etats-unis, asie, actualité, affaires asiatiques, océan pacifique, pacifique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Wie westliche Mächte und Medien in Russland die nächste Revolution inszenieren
Weltkrieg? Wie westliche Mächte und Medien in Russland die nächste Revolution inszenieren
Russland und der Welt stehen gefährliche Zeiten bevor. Die schweren Umwälzungen, die nach dem sogenannten »Arabischen Frühling« funktionierende Länder wie Ägypten, Tunesien und Libyen inzwischen völlig destabilisiert haben, könnten jetzt bald auch Moskau ereilen. Die Massenproteste der letzten Wochen, vor allem in der Hauptstadt und in Sankt Petersburg, sind nach Meinung unabhängiger Beobachter schwerwiegende Beweise einer generalstabsmäßig geplanten Revolution, mit der man vor allem eins erreichen will: Den erstarkenden Wladimir Putin wegzukriegen, bevor er im März an die Macht kommt! Ernste Sorge: Man werde auch vor dessen Tötung nicht zurückschrecken. Denn es geht um die Weltherrschaft des 21. Jahrhunderts! Partei für die westlichen Mächte hat jetzt auch Michail Gorbatschow ergriffen: Er forderte gestern Putins Rücktritt.

Im direkten Visier des Westens stehen aktuell also nicht nur Syrien und Iran, sondern vor allem auch Russland. So sei es ebenso nicht ausgeschlossen, dass die USA und Großbritannien vor einem Anschlag unter Falscher Flagge nicht zurückschrecken werden, so USA- Journalist Webster Tarpley. Denn Russland ist zur Existenzfrage der anglo-amerikanischen Pläne geworden, die nun einmal vorsehen, Macht über die ganze Welt zu erlangen.
Mehr: http://kopp-online.com/hintergruende/deutschland/redaktion/weltkrieg-wie-westliche-maechte-und-medien-in-russland-die-naechste-revolution-inszenieren.html
00:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, russie, manipulations médiatiques, soft power, révolution orange, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
China-US Relations: Washington's Asia Strategy Could Destabilize the Entire Asian Pacific Region
|
by Zhi Linfei and Ran Wei
Ex: http://www.globalresearch.ca/ and http://news.xinhuanet.com/
Obama administration’s Asia pivot strategy sows more seeds of suspicion than cooperation The U.S. shift of strategic focus is characterized by a more confrontational stance with China. Despite the U.S. public denial of containing China, there has been widespread suspicion that Washington has a hidden agenda behind the strategy, i.e., to counterbalance China’s growing influence in the Asia-Pacific region. “The United States is now signaling an intention to move back toward the pre-9/11 strategic focus on a rising China. That focus places a premium on explicitly balancing against and constraining Chinese power and influence across the region,” wrote Michael Swaine, a senior associate at the Carnegie Endowment for International Peace, in a recent article. STRATEGIC SHIFT COMES WITH TOUGH RHETORIC, PROVOCATIVE MOVES The Obama administration launched the strategic shift of pivoting to Asia with great fanfare in November when it was hosting the annual gathering of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). In a speech at the East-West Center in Hawaii ahead of the APEC summit, U.S. Secretary of State Hillary Clinton declared “The 21st century will be America’s Pacific century,” vowing that her country will stay in the region as a resident diplomatic, military and economic power. At the APEC summit, U.S. President Obama actively promoted the Trans-Pacific Partnership (TPP), a U.S.-championed free trade agreement and a potential trans-Pacific security architecture. The TPP, which pointedly excludes China, is widely seen as a thinly-disguised counterweight to free trade blocs in the region involving China and other Asian countries. In rare tough rhetoric, Obama also pointed a finger at China for not playing by the rules in trade and economic relations, pledging to “continue to speak out and bring action” on issues such as currency and intellectual property rights. Meanwhile, the United states has intensified its intervention in the territorial dispute over the South China Sea between China and several southeastern Asian countries, under the excuse of protecting freedom of navigation. Immediately following the APEC meeting, Obama traveled for the first time to Indonesia to attend the East Asia summit, where he encouraged the participating countries to seek a multilateral solution to the South China Sea issue despite opposition from China, which advocates settling it through bilateral negotiations. During his stay in Canberra, Obama signed a deal to station U.S. Marines in northwest Australia, with an eye on a potential contingency in the South China Sea. While celebrating the 60th anniversary of the signing of the U.S.-Philippine mutual defense treaty, Hillary Clinton reaffirmed in Manila the U.S. commitment to the security of the Philippines, in a move regarded as a U.S. show of support to Manila in its dispute with China. Furthermore, the U.S. government said it is considering plans to deploy advanced coastal combat ships in Singapore and perhaps the Philippines in the coming years to expand the U.S. military presence in the Asia-Pacific region. OBAMA AIMS FOR DOMESTIC, INTERNATIONAL GAINS U.S. experts believe that the U.S. strategic shift to Asia is driven not only by President Obama’s need to win the reelection in 2012, but also by the growing perception of an America in decline due to China’s fast rise. Apparently, Obama counts on increased trade with the Asia-Pacific, the most dynamic economic region at the time of a global downturn, to create more jobs back at home to bring down the high unemployment rate that threatens to cost his own job. This shift reflects “a recognition of the increasingly vital importance of that region for future American wealth, security and global influence,” Swaine wrote in the article posted on Dec. 7 on the website of the magazine The National Interest. Douglas Paal, vice president for studies at the Carnegie Endowment for International Peace, said the economic factor of Obama’s Pivot to Asia policy” is the justification because of the current need to restart the American economy and to deal with the stress on the defense budget.” Domestically, Obama also aims to refute the criticism from his Republican challengers who decry him for being too soft toward China, a convenient target for U.S. candidates in nearly every election year in the past decades. “Obama has taken a pretty positive agenda with China in 2009, and he was seen as weak…Given the upcoming election, the Republican candidates are fighting against China. Obama did not want to put himself at a position of defending China against his opponents,” Paal told Xinhua in an interview. Meanwhile, the U.S. strategic shift was also motivated by fears about China’s challenges to the U.S. status as the dominant power in the world, although China has made it clear that it has neither the strength nor intention to vie with the United States for dominance. The decade-long anti-terrorism campaign, which diverted U.S. attention and resources to the wars in Afghanistan and Iraq, has fueled the perception of U.S. decline as the sole superpower, especially when it is suffering from a prolonged economic downturn and a worsening debt crisis. U.S. MOVES HAVE POTENTIALLY DESTABILIZING EFFECTS Obviously, the U.S. Asia pivot strategy doesn’t bode well for China-U.S. relations, already soured in 2011 by a series of provocative U.S. moves, including its announcement of a massive arms sale package to China’s Taiwan in September. “We are going to have a distressful year” in 2012, Paal said. U.S. experts are critical of the Obama administration’s new posture in the Asia-Pacific region, especially its position on the South China Sea dispute, saying it has potentially destabilizing implications by emboldening certain countries to confront China. Swaine expressed worries that the Obama administration’s execution of this shift and China’s reaction “are combining to deepen mutual suspicion and potentially destabilize the entire area.” The words and deeds by officials of the Obama administration are creating the impression in some Asian capitals that Washington is now supporting their disputes with Beijing over maritime territories, Swaine said. Paal also criticized Hillary Clinton for her “inappropriate rhetoric” during her visit to Manila, where she referred to the South China Sea as the “West Philippine Sea,” a phrase used solely by the Filipinos. It “appeared in China’s eyes to be taking the Philippines’ position in a dispute where Clinton previously said the U.S. would not take sides,” he said. Analysts believe that as its economic and trade ties with China are becoming increasingly closer, United States [efforts] will only backfire if it still embraces the cold-war mentality and adopts policies to contain China. The U.S. move to station troops in Australia also stirred up concerns in some capitals in the Asia-Pacific region, with Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa warning on Nov. 18 that such arrangements would lead to misunderstanding and provoke a “vicious circle of tension and mistrust.” Noting widespread doubts within the international community about whether the United States can sustain its leadership and predominance in the Asia-Pacific, Swaine said “Washington must rethink its basic assumptions about its role in the region.” The United States should “reexamine how best to address and when to accommodate China’s most critical security concerns, especially along its maritime borders,” Swaine wrote in his article. |
|
Global Research Articles by Zhi Linfei |
|
Global Research Articles by Ran Wei |
00:06 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, obama, chine, asie, affairesasiatiques, océan pacifique, pacifique, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’Allemagne paiera !
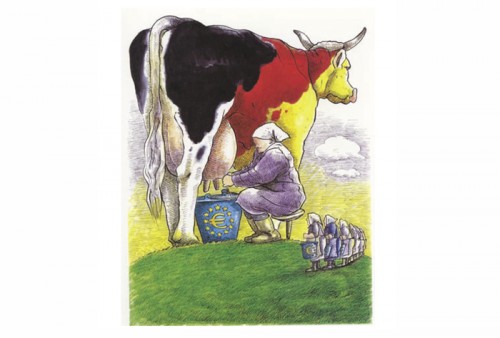
L’Allemagne paiera !
par Jacques GEORGES
On se croirait revenu en 1919 : l’Allemagne est coupable, la sale fourmi boche qui empêche de s’endetter en rond paiera !
Depuis qu’il y a une décennie l’Allemagne s’est imposé un Agenda 2010 à base d’efforts de compétitivité, de maîtrise de la dépense et des salaires, rien ne va plus. Confrontée au défi immense de la réunification, l’Allemagne a fait front avec responsabilité et sens du long terme, droite et gauche confondues. Cette attitude contraste avec celle de la quasi-totalité de ses voisins, cigales optimistes et légères trouvant leur bonheur grincheux qui dans l’inflation salariale, les 35 heures et la C.M.U., qui dans les profits faramineux et vite gagnés des activités de marché, qui dans l’immobilier à tout va, et tous dans la générosité à crédit avec l’immigrant et l’explosion joyeuse des salaires des footballeurs et présentateurs de télé. On en est d’ailleurs toujours là dans l’opinion française, puisque les politiciens irresponsables et incompétents des « Trente Piteuses » tiennent toujours le haut du pavé, préconisent la progression vers les 32 heures, et que les sondages attestent de records de popularité et d’amour envers politiciens et footballeurs dans le bon peuple qui regarde le 20 heures.
On comprend dans ces conditions la remontée des sentiments anti-boches : ces fourmis sans cœur ne prospèrent que sur notre dos, abusent de leur force injuste, voient conservateur, étroit et dogmatique, finissent par céder, mais toujours trop tard, bref sont responsables de ce qui nous arrive. Derrière ces critiques et ces insultes, on trouve les remugles anti-boches de notre Clémenceau national, la haine recuite des Bainville et maurrassiens de tout poil contre le « Boche », la nostalgie de Valmy, du Richelieu des traités de Westphalie ou de Louis XIV héros du Palatinat, bref tout un héritage de sentiments glorieux bidons qui portent tout leur poids de jalousie, de petitesse, de médiocrité et d’irréalisme pathétique. Seul contrepoids à ce sentiment d’exécration tourné vers la ligne bleue des Vosges, la sortie de la Grande-Bretagne de l’Accord européen à 26 laisse pantois et amène nos souverainistes à se gratter la tête : et si sortir de l’Europe signifiait se mettre totalement dans la main des marchés exécrés ? Ces Anglais sont utiles : ils nous montrent qu’il y a pire que les Boches !
La manière chaotique et éminemment discutable dont le couple à la Dubout franco-allemand gère la crise depuis la replongée des derniers mois n’ajoute certes pas une page glorieuse au livre si merveilleux et tragique de l’histoire de l’Europe. Beaucoup dans le vaste monde s’inquiètent et commencent à se dire que la crise de l’euro et de l’Europe est décidément une chose trop sérieuse pour être laissée entre les seules mains des Européens. La subvention permanente sur fonds publics faite aux banques au motif qu’elles sont le sang de notre économie, la reddition volontaire au F.M.I. et donc aux Américains pourtant plus atteints que nous, l’improvisation pagailleuse de sommets historiques devenus trimestriels, le constat que la crise approche inexorablement sans que nos Diafoirus de l’économie et de la politique y puissent mais, la multiplication des experts et petits maîtres plus ou moins démagos nés de la crise comme orties sur le fumier, tout ceci est préoccupant.
Pour nous, patriotes européens, plus les choses se compliquent, plus elles se simplifient. Dans la tempête qui vient, quelques idées fortes et élémentaires doivent s’imposer : priorité à tout ce qui va dans le sens des identités naturelles, régionales, nationales et européenne, et par-dessus tout priorité au Destin européen. Osons un gros mot pour les crétins que ce mot effarouche : la Fédération continentale européenne est notre ligne de mire pour les cent ans à venir. Caton, Drieu, Jünger, priez pour nous !
Jacques Georges
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2344
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, europe, affaires européennes, allemagne, dette, endettement, euro, crise financière, crise de l'euro, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’appel aux dieux: la phénoménologie de la présence divine
L’appel aux dieux:
la phénoménologie de la présence divine
par Collin Cleary
 Ex: http://www.counter-currents.com
Ex: http://www.counter-currents.com
1. Introduction
Le problème avec nos païens occidentaux modernes, c’est qu’ils ne croient pas vraiment en leurs dieux, ils croient seulement croire en eux.
Mes ancêtres croyaient, mais je ne sais pas de quelle manière ils croyaient. Je confesse que je ne sais pas à quoi cela ressemble de vivre dans un monde où il y a des dieux. De temps en temps j’aurai un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler, mais dans la vie quotidienne je vis dans un monde qui semble complètement humain et complètement profane. Cela ne sert à rien de me dire que le monde m’apparaît ainsi parce que j’ai été imprégné de scientisme et de matérialisme modernes. Savoir que c’est le cas ne m’ouvre pas forcément le monde d’une manière différente. Il est également inutile de me dire à quel point je me sentirais mieux (ainsi que le monde) si nous croyions encore aux dieux. Ceci est une approche purement intellectuelle et même idéologique qui ne marchera simplement pas.
Ainsi pourquoi, pourrait-on se demander, suis-je donc préoccupé par le « problème » de ne pas croire aux dieux ? Parce que je sais qu’il est vraiment peu plausible de penser que mes ancêtres soient simplement restés assis et aient « inventé » leurs dieux1[1]. La pensée me tenaille qu’ils possédaient une sorte de conscience différente, ou un certain sens particulier qui s’est maintenant atrophié en nous, qui permettait aux dieux de se manifester à eux. Et ensuite il y a aussi ma conviction que quelque chose de très important a été perdu pour nous dans le monde « post-païen ». J’ai tenté de penser mon chemin de retour à la croyance aux dieux ; me convaincre moi-même, intellectuellement, de leur existence. Je sais que cela ne marche pas, et je ne pense pas que cela marchera pour quiconque d’autre. Quelles sont donc nos autres options ?
Dans mon essai « Connaître les dieux », j’ai dit quelque chose dans le genre-là. J’ai rejeté l’approche moderne tentant d’« expliquer » ce que sont les dieux en les réduisant à quelque chose d’autre (par ex. à des « forces »). J’ai dit que l’« ouverture aux dieux » implique une ouverture à l’Etre en soi. En disant cela, je m’inspire bien sûr de la pensée de Heidegger. Pour celui-ci, ce qui fait la différence entre les anciens et les modernes est que les modernes voient la nature somme une simple « matière première » à transformer d’après les projets et les idéaux humains. En d’autres mots, pour les modernes, la nature n’a essentiellement pas d’Etre : elle attend que les humains lui confèrent une identité. D’après Heidegger, l’attitude des anciens était tout à fait différente. Il serait probablement excessif de dire que les anciens regardaient la nature (physis, en grec) avec « respect ». Cela ressemble beaucoup trop à l’attitude des citadins retrouvant la nature par hasard, après en avoir été séparés pendant longtemps ; ce n’est pas l’attitude de ceux qui vivent quotidiennement avec la nature. Pour utiliser le langage de Kant, on pourrait dire que les anciens regardaient les objets naturels comme des fins-en-soi, pas simplement comme des moyens pour des fins humaines.
Pour expliquer cette idée, j’utiliserai une analogie très simple. Il n’est pas inhabituel de voir des mariages dans lesquels le mari est la figure dominante – à tel point que la femme semble à peine avoir une présence. Le mari fait des grands discours sur une question quelconque, en compagnie d’amis, et lance un regard en coin à la femme : « Tu penses la même chose, n’est-ce pas ma chérie ? ». Et avant qu’elle puisse répondre il recommence à discourir sur autre chose. Même s’il lui donnait le temps de répondre, elle n’oserait jamais s’opposer à lui. Un tel homme a tendance à être très surpris quand, des années après, il découvre d’une manière ou d’une autre que sa femme est très mécontente de cet arrangement. Il a généralement un choc quand il découvre qu’elle a une vie intérieure bien à elle, et qu’en interdisant à cette vie intérieure de s’exprimer il s’est fait un très mauvais mariage. Cette situation est exactement analogue à la relation entre l’homme moderne et la nature. La nature, si elle est traitée comme une simple chose à laquelle l’homme impose sa volonté, se ferme. Elle devient silencieuse et cesse de révéler sa vie intérieure et ses secrets à l’homme. Pendant ce temps, bien sûr, l’homme pense qu’il a sondé les profondeurs de la nature, et qu’elle n’a plus beaucoup de secrets à révéler. Mais, comme l’a dit Héraclite, « la nature aime se cacher ».
L’homme occidental chrétien avait jadis cru que le monde était un objet créé par un Dieu omnipotent. L’homme moderne a rejeté Dieu, mais a conservé l’idée que la terre est un objet. Nos scientifiques s’efforcent de découvrir comment les objets naturels sont « construits » ou « assemblés ». Ils décomposent les choses en « parties » ou en « composantes ». Avec un objet, bien sûr, on peut le détruire et utiliser sa « matière » pour construire quelque chose d’autre – peut-être quelque chose de meilleur que ce qui existait à l’origine. C’est ainsi que l’homme moderne voit la nature : simplement comme une chose à transformer en une autre chose meilleure. Et la chose que nous fabriquons continue à s’améliorer sans cesse. Ou c’est ce que nous nous imaginons. Face à une humanité qui n’accepte plus l’existence même de la nature, aucune existence par elle-même, les dieux, semble-t-il, nous ont quittés. Comme l’a dit Heidegger : « sur la terre, sur toute sa surface, se produit un obscurcissement du monde. Les événements essentiels de cet obscurcissement sont : la fuite des dieux, la destruction de la terre, la réduction des êtres humains à une masse, la prépondérance du médiocre » [2].
En nous fermant à l’être de la nature, nous nous fermons simultanément à l’être des dieux. Ceci est une partie majeure de ce que j’ai dit dans « Connaître les dieux ». Les dieux et ce que nous appelons nature appartiennent au même domaine : le domaine du « en soi ainsi ». En chinois, « Nature » est tzu-jan. Cela s’écrit en utilisant deux pictogrammes, dont l’un peut être traduit par « en soi » et l’autre « ainsi ». Qu’est-ce que cela signifie ? Le « en soi ainsi » est ce qui est, ou ce qui est arrivé, indépendamment de l’action ou de l’intervention humaine consciente[3]. Il a approximativement le même sens que le grec physis.
J’étais un jour à une conférence, et j’eus l’occasion de parler de la « nature » à une universitaire. Elle me demanda ce que je voulais dire par ce mot. J’exprimai ma surprise qu’elle ne connaisse pas cela, sur quoi elle m’informa que la nature était une « construction sociale ». Nous étions assis à une table et je lui demandai de tendre le bras et de découvrir son poignet. Je pris son poignet dans ma main, et quand j’eus trouvé son pouls je lui dis de mettre son autre main dessus et de le sentir. « Voilà », dis-je. « C’est la nature. La société n’a pas construit cela. Ce n’est pas venu non plus par votre propre choix ou intention. Cela arrive simplement, que ça vous plaise ou non ». C’est le « en soi ainsi ».
Les êtres humains ont le choix de s’ouvrir au « en soi ainsi » ou de s’y fermer. L’homme moderne a choisi de s’y fermer. Mais bien que le « en soi ainsi » soit traduit par « nature », c’est une catégorie beaucoup plus large. En se fermant au « en soi ainsi », l’homme s’est fermé à tout ce qui est autre : à ce que nous appelons nature, et à tout ce qui existe de soi-même, en-dehors de l’humanité – incluant tout ce qui pourrait être « surnaturel ».
Le but de cet essai, que j’ai conçu comme une suite à « Connaître les dieux », est de demander spécifiquement comment nous pouvons restaurer l’ouverture au « en soi ainsi ». C’est la question que l’autre essai avait laissé largement sans réponse. Au cas où ce ne soit pas clair, laissez-moi dire encore une fois que je prends l’ouverture au « en soi ainsi » comme supposition. Je la prends comme un moyen de conscience et d’acceptation de ce qui a une existence en soi. Je prends la « nature » comme faisant partie de ce « en soi ainsi », avec ce qui a été désigné comme le « surnaturel » : les dieux, ainsi que le dieu-sait-quoi.
Avant tout, il faut comprendre que ce qui est le « en soi ainsi » fait aussi partie de nous. Le pouls qui bat dans nos poignets en est un exemple. Ainsi que la faim que l’on ressent quand un repas met longtemps à venir, ou le désir sexuel qui monte, sans aucune permission de l’intellect. Quand je dis que l’homme moderne s’est fermé à ce qui est autre, je ne veux pas dire qu’il s’est fermé à tout ce qui est à l’extérieur de sa peau. L’homme moderne s’est identifié à son intellect conscient seul. Il traite son corps de la manière qu’il traite tout autre objet naturel : comme quelque chose qui lui « appartient », et qui doit être maîtrisé, et même, comme nous disons souvent aujourd’hui, « converti ». Nous n’avons pas besoin de « sortir de nous-mêmes » pour rencontrer la nature ou le « en soi ainsi », à condition d’avoir une conception du moi qui englobe davantage que l’intellect conscient.
L’ouverture doit donc impliquer le rejet de l’idée que l’esprit est la seule chose qui compte pour l’identité de quelqu’un. Elle doit impliquer la reconnaissance qu’une grande partie du « moi » n’est pas consciemment choisie ou contrôlée. L’ouverture devient alors non pas tant l’ouverture d’un espace qui se remplira par la suite qu’une sorte de communion avec un autre qui, en un sens, n’est maintenant plus aussi autre.
Dans un essai surtout consacré à Benjamin Franklin, D. H. Lawrence offre sa propre « croyance », par opposition à la croyance « sensible » des Lumières qui était celle de Franklin. Il écrit qu’il croit
« Que je suis moi ».
« Que mon âme est une forêt obscure ».
« Que mon moi connu ne sera jamais plus qu’une petite clairière dans la forêt ».
« Que les dieux, les dieux étranges, sortent de la forêt pour entrer dans la clairière de mon moi connu, et ensuite repartent ».
« Que je dois avoir le courage de les laisser aller et venir ».
« Que je ne laisserai jamais l’humanité mettre quelque chose au-dessus de moi, mais que je tenterai toujours de reconnaître les dieux en moi et de m’y soumettre ainsi que pour les dieux dans les autres hommes et femmes » [4].
L’âme est en effet une forêt obscure. Comme l’a dit Héraclite : « Vous ne découvririez pas les limites de l’âme même si vous fouliez chaque chemin : elle a un logos si profond » [5]. Mais l’homme moderne s’est identifié à la petite clairière du Moi connu. En-dehors de cette clairière il y a une grande forêt obscure, et au-delà se trouve la grande nature sauvage qui est le monde lui-même. L’homme l’éclaire avec sa lampe de poche et s’imagine qu’en-dehors de son rayon il n’y a que le vide. Et « petit bois » est le mot ingénieux qu’il utilise pour décrire la minuscule partie qu’il éclaire.
2. Comment appeler les dieux
Arrêtons-nous et examinons à quels moments – à quelles occasions – nous avons le sentiment de la réalité de ce qui est autre. Les meilleurs exemples sont quand les choses tombent en panne ou trompent nos attentes d’une façon ou d’une autre. C’est ainsi que Heidegger approche la question. Nous montons dans notre voiture pour commencer une journée chargée, faire des affaires et faire les courses – et nous découvrons qu’elle ne démarre pas. Mon expérience de telles situations est qu’il y a d’abord un sentiment de quasi « irréalité ». Nous avons envie de dire (et nous disons souvent) : « Je ne peux pas y croire ». Et soudain l’être de cette concaténation de métal et de plastique nous confronte à toute sa facticité frustrante. Une situation encore pire survient quand le corps tombe malade, quand soudain il ne fonctionne pas comme nous l’attendons. Le corps nous semble alors être un simple autre. Ces deux situations, et toutes les autres comme elles, sont des occasions où une chose qui a été prise comme allant de soi semble soudain s’affirmer toute seule. Ce qui avait été regardé comme un simple instrument, comme une extension de la volonté humaine, devient un être en soi. Le résultat est de la frustration, de l’étonnement, de la fureur, et quelque chose comme du respect.
Mais, en termes religieux, ce que nous voulons ce n’est pas d’être intimidé par ceci ou cela, mais plutôt de finir par trouver le monde lui-même respectable dans son étrangeté. Faut-il que le monde « tombe en panne », comme une voiture, pour que nous connaissions cela ? Bien sûr, la réponse est qu’il ne le peut pas. Ce qui arrive très souvent c’est que nous tombons en panne et que le monde nous apparaît comme quelque chose qui pourrait être perdu pour nous à jamais. J’ai à l’esprit des situations où les êtres humains ont un contact avec la mort ou la folie, ou se retrouvent face à leur propre mortalité ou fragilité. Et j’ai souvent pensé que certains hommes prennent délibérément des risques – précipitent délibérément un contact avec la mort – simplement pour pouvoir ressentir un sentiment renouvelé de respect ou d’émerveillement face à l’existence. De tels hommes développent très souvent un « sentiment » non seulement de la bizarre étrangeté du monde, mais aussi une intuition « mystique » de quelque chose comme la divine providence agissant derrière la scène[6].
Heureusement, nous n’avons pas besoin de sauter d’un avion ou de gravir une montagne pour parvenir à l’ouverture du genre qui m’intéresse. Il nous suffit de poser une seule question et d’y réfléchir : pourquoi donc y a-t-il des êtres, plutôt que rien ? Ici encore, j’emprunte à Heidegger, mais pour aller dans une direction que Heidegger n’a pas vraiment explorée[7].
En Inde, il y a un exercice de méditation très simple souvent accompli par les chercheurs de sagesse. Il consiste à prendre n’importe quel objet si banal soit-il – ce peut être un caillou, ou un mégot de cigarette –, à le placer sur le sol, et à tracer un cercle autour de lui dans la poussière. L’effet est de prendre un objet qui normalement est considéré comme allant de soi, qui figure dans la vie comme un simple instrument ou comme quelque chose d’à peine remarqué, et de nous rendre conscients de son être. Disons que c’est un mégot de cigarette. Quand nous traçons un cercle autour, il devient un objet de méditation approprié. Ce sur quoi nous méditions, ce n’est pas sa grossière nature de mégot de cigarette, mais le fait de son être – le fait même qu’il existe. C’est une manière de s’habituer à la merveille de l’être.
Poser la question pourquoi donc y a-t-il des êtres, plutôt que rien ?, c’est tracer un cercle autour ce qui est, tel quel. C’est une manière par laquelle, en un clin d’œil, le monde entier dans lequel nous nous trouvons peut devenir un objet de méditation – et de respect et d’émerveillement.
Quand nous rencontrons l’être-en-soi comme un miracle, il est naturel (et inévitable) que nous nous demandions d’où il vient. La version infantile de cette question est : « Qui l’a fait ? ». La version plus sophistiquée ne s’interroge pas sur l’existence physique de l’univers considéré comme une totalité, mais sur la source de l’abondance qui se présente à nous dans l’univers. Nous nous émerveillons de l’inépuisable richesse de l’univers, de l’infinie multiplicité des types de choses, et des variations de ces types, et de l’infinie complexité de chaque chose, si banale soit-elle. Nous nous émerveillons du continuel réapprovisionnement des êtres – la continuelle parade des types donnant naissance à d’autres semblables à eux, et de la faculté des êtres à se régénérer et à se guérir eux-mêmes. Il est naturel de s’émerveiller de la source de tout ceci. C’est la « source de l’être » que cette question fondamentale, pourquoi donc y a-t-il des êtres, plutôt que rien ?, rend thématique.
Pensez un moment à l’origine d’une source. Où se termine la source et où l’origine commence-t-elle (ou vice-versa) ? A son origine, la source disparaît dans le sol. L’origine est-elle le trou dans le sol ? Assurément non. L’origine est-elle une quantité d’eau distincte de la source ? A nouveau, sûrement pas. La source et son origine se mêlent. L’origine du courant est invisible. Mais nous comprenons que la source s’écoule à partir de cette origine invisible. C’est exactement ainsi que les Grecs concevaient la physis, comme surgissant continuellement d’une origine ultime – archè, en grec. Cette compréhension est le sens des symboles anciens tels que la corne ou le chaudron d’abondance, et le Saint Graal. L’archè est le fondement infondé de toute l’abondance.
Le problème fondamental avec les êtres humains est qu’en fait ils veulent être eux-mêmes l’archè, la source de toutes choses. Toutes nos tentatives pour comprendre une chose quelconque impliquent de saisir comment l’être de la chose découle de certains principes que nous avons découverts. Nos tentatives pour comprendre sont des tentatives de comprendre du-dessous. Nous nous efforçons en effet de supprimer les bases d’un objet et d’en devenir le fondement en finissant par voir comment l’être de l’objet découle de nos idées. Quand le scientifique, par exemple, comprend les phénomènes, il souligne que les phénomènes découlent des principes qu’il instaure[8]. Mais quand nous tournons nos esprits vers l’archè ultime – dont nous venons nous-mêmes –, en dépit de toutes nos affirmations d’avoir conquis la nature, l’être se manifeste comme une donnée mystérieuse et miraculeuse. L’archè est le fond sur lequel la figure de l’être-en-soi se manifeste.
Cependant, comme l’indique l’exemple du cercle autour du mégot de cigarette, on peut trouver une merveille dans un être unique, aussi bien que dans l’être-en-soi. Et quand nous nous tournons, avec cette attitude d’émerveillement, vers les phénomènes individuels dans l’existence, une autre question fondamentale surgit. Nous pourrions nous demander à propos d’une chose quelconque, pourquoi cette chose particulière doit-elle être, et être de la manière qu’elle est ? Prenons le phénomène du sexe. Quand l’esprit tente de penser au sexe d’une manière dépassionnée, cela finit par ressembler à une activité plutôt absurde et grotesque. Pourquoi cela devrait-il être aussi fascinant ? Pourquoi cela devrait-il absorber autant de notre temps et être si important pour nous ? Et pourtant ça l’est. Et plus on tente d’y penser de cette manière, plus on craint de finir par tout gâcher ! Le résultat est que, intimidés par la pure et inexplicable réalité du sexe, nous continuons à nous en émerveiller et à le rechercher comme avant. En fait, c’est peut-être bien le seul domaine, dans la vie de beaucoup de gens, dans lequel le miracle arrive encore[9].
Mais tout le reste peut être approché avec cette attitude d’émerveillement. Un bel animal est aussi un objet d’émerveillement. Pourquoi cette chose particulière doit-elle être, et être de la manière qu’elle est ? Le fait du vent et de la pluie, du soleil et des étoiles, tout cela peut susciter l’émerveillement, et susciter ce questionnement. Et il n’y a pas besoin que ce soit une entité physique ou perceptible : ce peut être le fait de la naissance, ou de la mort, ou des cycles naturels, etc.
Maintenant, quand nous posons cette question, il peut sembler que nous demandons une sorte d’explication officielle et scientifique, mais ce n’est pas le cas. Aucun cours sur la sélection naturelle ne pourra supprimer mon émerveillement devant l’être de mon chat – mon émerveillement qu’une telle chose soit, et soit de la manière qu’elle est. Je n’ai aucune querelle avec l’explication scientifique. Mais l’explication scientifique ne peut pas supprimer cet émerveillement ultime et métaphysique devant la pure existence des choses. Je suis parfaitement prêt à accepter l’explication des scientifiques sur la manière dont les chats sont apparus – mais je regarde quand même mon chat et je me dis : « N’est-ce pas incroyable de vivre dans un monde où des choses aussi merveilleuses existent ? ».
Ma thèse est celle-ci : notre émerveillement devant l’être de choses particulières est l’intuition d’un dieu, ou d’un être divin.
Suis-je en train de dire que quand je regarde mon chat et que je connais ce sentiment d’émerveillement, j’ai l’intuition que mon chat est un dieu ? Oui et non. L’émerveillement que je connais vient de ce que des choses comme cela puissent simplement exister. Je peux tout aussi bien avoir cette expérience en contemplant le soleil, le vent, la pluie, l’océan, les montagnes, etc. Mon émerveillement devant l’être de ces choses est précisément une expérience de leur divinité. Ainsi, il y a des dieux du soleil, du vent, de la pluie, de l’océan, des montagnes, et aussi des chats (les Egyptiens comprenaient très bien cela). En vérité, toutes les choses rayonnent de divinité ; toutes les choses sont Dieu. Et il n’y a pas de contradiction entre cette affirmation et l’affirmation qu’il y a des dieux. Ce sont simplement deux manières différentes de regarder la même chose. Dans la mesure où la divinité des chats rayonne à travers mon chat, il est le dieu des chats.
Il y a un autre aspect dans cette expérience. Quand nous rencontrons les choses dans leur être, et que nous nous émerveillons que de telles choses puissent exister, notre perception du temps et de l’espace change. Quand une chose est regardée avec émerveillement, au sens que j’ai décrit, nous savons simultanément que son être s’étend au-delà du présent temporel. L’objet est donc devant nous, dans le présent, mais simultanément nous avons l’intuition d’un aspect d’éternité dans la chose. Quand je m’émerveille que des choses comme mon chat puissent simplement exister, ce dont je m’émerveille est en un sens le « fait de l’existence des chats » dans le monde. Comme Alan Watts l’a probablement dit, nous nous émerveillons devant le fait qu’il y ait production de chats, de chiens, de gens, de fleurs et de fruits dans ce monde. C’est l’aspect de la divinité qui rayonne à travers la chose, regardée d’une certaine manière.
Nous pourrions penser aux dieux comme à des « régions » de l’être. Il y a autant de dieux qu’il y a de régions de l’être[10]. Notre conscience des régions de l’être ne vient pas par l’analyse philosophique ou la construction de systèmes spéculatifs. Elle vient par l’expérience et l’intuition. Il y a autant de régions qu’il y a d’expériences d’émerveillement devant le fait que « des choses comme X » puissent exister. Et il y a des régions à l’intérieur des régions. C’est ainsi qu’avec un suprême bon sens les Indiens laissaient les choses dans le vague concernant le nombre de leurs dieux. Les récits hindous diffèrent. Certains disent qu’il y a 330.000.000 dieux. Un nombre aussi énorme n’est pas destiné à être un chiffre exact. Il est destiné à suggérer, en fait, l’infinité des dieux, une infinité fondée sur le fait qu’il y a d’infinies expériences possibles d’émerveillement devant les choses. Exactement de la même façon, les anciens auteurs chinois parlent des « dix mille choses », pas pour donner un chiffre précis, mais pour suggérer l’incompréhensible immensité de l’existence.
3. Objections et reponses
La position exposée ci-dessus est simple, mais susceptible de produire beaucoup de scepticisme. Et les sceptiques viendront de presque tous les « camps » établis : rationalistes, empiriques, théologiens, et même païens. Pour tenter de répondre à quelques-unes de leurs plaintes à l’avance, je présente la série suivante d’objections et de réponses, dans le style de St. Thomas d’Aquin.
Objection Un : J’ai dit que la question Pourquoi donc y a-t-il des êtres, plutôt que rien ? nous permet de « mettre en valeur » la totalité de l’existence et de la regarder avec émerveillement. J’ai dit ensuite que la question Pourquoi cette chose particulière doit-elle exister, et exister de la manière qu’elle est ? nous permet de connaître des objets de ce monde avec émerveillement, et que cet émerveillement devant le pur être des choses est une expérience du divin. Mais devons-nous croire que nos ancêtres se promenaient dans la forêt (ou ailleurs) en regardant les choses et en pensant, quel que soit la langue qui était la leur, « Pourquoi cette chose particulière doit-elle exister, et être de la manière qu’elle est ?
Réponse. Bien sûr que non. En fait, l’une de mes affirmations est que nos ancêtres avaient une capacité naturelle et spontanée à l’émerveillement, une capacité enfantine que nous les modernes (même les enfants modernes) avons en grande partie perdue. Les questions que je présente ici sont des tentatives pour formuler en mots l’attitude mentale tacite nécessaire pour permettre la manifestation de la divinité. Cependant, elles ne sont pas seulement descriptives, mais aussi prescriptives. Pour ceux d’entre nous qui ont perdu la capacité de l’émerveillement spontané, le fait de se poser consciemment ces questions peut être un chemin pour revenir à la mentalité de nos ancêtres.
Objection Deux : Une objection apparentée pourrait être exprimée ainsi : l’attitude mentale consistant à regarder les choses avec émerveillement est une sorte de réalisation de « second ordre » de la conscience. La plupart d’entre nous passent leur journée avec un but purement « terre-à-terre » : c’est-à-dire que nous nous intéressons aux choses elles-mêmes, pas à l’émerveillement devant leur « pur être ». De cela s’ensuivent deux problèmes. D’abord, il va sans dire que plus nous retournons loin en arrière dans le temps, plus le but de nos ancêtres devait être « terre-à-terre », étant donné la dureté de leurs conditions de vie. Ils devaient avoir peu d’occasions pour la « réflexion ». Et de ce problème découle un second : si je suis simplement en train de décrire « l’attitude mentale tacite nécessaire pour permettre la manifestation de la divinité », et si l’émerveillement n’est pas conscient ou délibéré, alors il doit être occasionné par certains événements. En d’autres mots, quelque chose devait « arriver » pour que l’homme se détourne d’un but terre-à-terre et passe à une attitude d’émerveillement. Qu’était-ce donc ?
Réponse : Concernant le premier problème, il se peut que la capacité de se détourner d’un but terre-à-terre pour passer à une attitude d’émerveillement soit ce qui rend les êtres humains uniques dans le royaume animal. A un certain moment de notre évolution, il devint possible de « changer d’attitude » envers le monde. Concernant ce qui occasionna ce saut extraordinaire dans les capacités mentales, je n’ai pas de théorie personnelle à proposer. Manifestement, cela n’a rien à voir avec l’établissement de l’agriculture, ou de la technologie, ou des villes, ou un accroissement du temps de loisir, puisque nous trouvons des expériences du divin dans les cultures d’agriculteurs aussi bien que dans les cultures de chasseurs, dans celles avec de la technologie et dans celles sans technologie, dans celles situées dans des villages et dans celles situées dans des villes. Mais un mot sur le loisir : les modernes tendent à exagérer le degré de « dureté » qui rendait la vie des anciens chaotique et périlleuse, avec peu de temps pour le repos, et encore moins pour la religion. En réalité les anciens, particulièrement dans les cultures de chasseurs-cueilleurs, avaient une formidable quantité de temps pour la réflexion, puisque la chasse implique surtout de s’assoir tranquillement et d’attendre (je tends aussi à penser que loin de nous libérer et de nous fournir plus de loisirs, la technologie a rendu la vie plus compliquée, et pénible). Ainsi, si nous supposons que la capacité de connaître l’émerveillement est apparue à un certain moment, il est raisonnable de supposer qu’il y avait largement assez de « temps libre » pour parvenir à cela.
Quant à la seconde objection – qu’est-ce qui a occasionné l’expérience de l’émerveillement ? –, je pense immédiatement à Vico, qui affirma dans La Science Nouvelle (1730/1744) que la conscience de la divinité commença au premier coup de tonnerre, quand nos ancêtres primitifs coururent se cacher dans leurs cavernes en criant « Jupiter ! » (le premier nom de Dieu). Il y a du vrai dans cette théorie, en dépit de sa naïveté. Comme je l’ai dit plus haut, ce qui nous détourne de l’approche terre-à-terre des choses et nous fait passer à une réflexion sur leur Etre doit être une sorte d’expérience saisissante. Il faut que les choses nous surprennent, nous frustrent, nous dépassent, d’une certaine manière (et cela ne doit pas forcément être un sentiment « négatif » de « dépassement » ou de « surprise »). Dans ma propre expérience, j’ai parfois un sentiment spontané d’émerveillement devant les choses, et très souvent je ne parviens pas à trouver ce qui l’a occasionné.
Objection Trois. Revenons un moment au mégot de cigarette mentionné plus haut. J’ai dit que l’on pouvait tracer un cercle (littéral ou figuratif) autour de n’importe quel objet et finir par s’émerveiller devant son être, même pour un caillou ou un mégot de cigarette. Existe-t-il un dieu des mégots de cigarette ? Y a-t-il des dieux des sacs poubelles, des tasses de café, des camions jouets, et des postes de TV ? Cela semble certainement absurde. Et si ma position nous oblige à déclarer, par besoin de cohérence, qu’il existe de tels dieux, alors cela en représente sûrement une simplification.
Réponse : Heureusement, ma position ne requiert pas cela. Avant tout, ce que j’ai dit avant tient toujours : il est parfaitement possible de s’émerveiller devant la pure existence de mégots de cigarettes et de postes TV. Ce sont des objets fabriqués : des objets créés par les êtres humains. Quand on s’émerveille devant des objets naturels, la racine de l’émerveillement, le sentiment de mystère qui ne peut pas être éliminé, se trouve dans la nature mystérieuse de la source ultime de leur être. Dans le cas des objets fabriqués, il n’y a aucun mystère concernant leur source : ce sont les êtres humains qui les ont créés[11]. Ainsi, quand nous nous émerveillons devant la facticité d’un objet fabriqué, ce dont nous nous émerveillons est l’être de l’homme lui-même, l’archè (ou architecte) de l’objet. L’homme est-il lui-même un dieu ? Bien sûr. Mais il n’y a pas de dieu de ses créations, pas de dieu de la machine[12]. C’est pourquoi l’idée même d’un dieu des mégots de cigarette nous semble immédiatement absurde, alors qu’il ne semble pas absurde du tout de s’émerveiller devant l’être de l’animal capable de créer de telles choses et, en particulier, toutes ces grandes choses comme les jets supersoniques, les symphonies, les ordinateurs, les poèmes épiques, les ponts suspendus, les navettes spatiales et les cathédrales. On pourrait dire que certaines de ces choses – peut-être même l’homme lui-même – sont un cancer pour la planète, mais l’on doit quand même être frappé de stupeur devant ce que l’homme peut accomplir, devant le fait qu’il existe un être possédant des pouvoirs aussi remarquables.
Mais si l’homme est un dieu, il est seulement un dieu parmi un nombre infini. Si les gens semblent aujourd’hui se comporter comme s’ils pensaient que l’homme est le seul dieu, c’est parfaitement explicable. Nous vivons dans un monde où ce sont les objets fabriqués, pas les objets naturels, qui sont les plus disponibles. Nous vivons en contact immédiat avec les mégots de cigarette, les sacs poubelle, les tasses de café, les postes TV, les jets supersoniques, les ordinateurs, les ponts suspendus et les navettes spatiales. Pour la plupart d’entre nous, notre contact avec des choses comme le vent, la pluie, l’océan, les montagnes, et la « nature » en général, se fait à travers des objets. Nos maisons et nos immeubles nous abritent du soleil, du vent, et de la pluie. La plupart d’entre nous, assez remarquablement, ont vu le monde entier : mais seulement à travers des livres de photographies, sur nos postes TV, et sur internet. Nos systèmes de climatisation nous protègent même des saisons : nous sommes agréablement au chaud en hiver et agréablement au frais en été. Certaines personnes vivent près de l’océan, mais très peu vivent de lui. Et leurs habitations les abritent de sa violence (la plupart du temps).
Si les objets fabriqués sont ce avec quoi nous entrons en contact de manière régulière, et si par et au moyen des objets le seul dieu dont nous avons l’intuition est nous-mêmes, est-ce vraiment surprenant que des « ismes » comme « humanisme », « scientisme » et « athéisme » règnent ? Est-ce vraiment surprenant que des gens modernes vivent leurs vies sur la supposition qu’ils sont les êtres les plus élevés de tous, et maîtres de tout ? Coupés du contact direct avec la nature, ils sont coupés de l’expérience de son prodige, qui est l’expérience de l’infinité des dieux. C’est la « fuite des dieux ». Les dieux ne se sont pas exactement enfuis. Nous sommes simplement devenus aveugles à eux, en érigeant un monde fabriqué qui a fait obstruction au monde réel.
Objection Quatre. Maintenant, on pourrait dire que la tentative ci-dessus pour rendre compte de l’expérience du divin constitue un abus de langage. J’ai dit que notre émerveillement devant l’être des choses est une intuition de la divinité. Ainsi, s’émerveiller qu’il existe une chose comme le vent est précisément l’expérience du « Dieu du vent ». Mais, peut dire le critique, ce n’est pas ce que nous avons à l’esprit quand nous pensons à un dieu. J’ai simplement substitué une compréhension entièrement différente de la divinité, qui n’a pas grand-chose à voir avec la compréhension traditionnelle (en tous cas c’est ce que dirait l’objection). Le dieu du vent est une personnalité. En Inde, c’est Vâyu. Il est décrit comme étant blanc, chevauchant un chevreuil, et portant un arc et des flèches. Les mythes impliquent les sentiments, les pensées, les discours et les actions de tels dieux. Bref, les dieux sont supposés être des êtres conscients qui se promènent aux alentours et font des choses.
Réponse : le problème avec cette manière de comprendre les choses est qu’elle confond les symboles avec leurs référents. Le dieu du vent est une personnalité parce que les êtres humains l’ont consciemment et délibérément personnifié. Et séparer le symbole personnifié de son référent est très difficile. Notez que j’ai parlé d’un dieu au masculin. J’aurais peut-être dû utiliser le genre neutre [= dans le texte anglais]. Mais quelque part cela sonne faux. Nous personnifions parce que nous avons besoin de personnifier pour garder le dieu à l’esprit. En fait, cela signifie que nous personnifions afin de garder à l’esprit le vent, pris non pas comme un « phénomène naturel » (comme le prendrait un scientifique) mais comme un noumenon, comme un être provoquant l’émerveillement. La tendance à personnifier est naturelle, et il se pourrait que certaines des manières concrètes par lesquelles nous personnifions soient aussi « construites » dans notre conscience. Les recherches de C.G. Jung et de ses étudiants semblent aussi confirmer cela. Mais il est difficile de savoir où placer la limite. Le fait que Ganesh soit décrit comme ayant la tête d’un éléphant est manifestement entièrement attribuable à l’accident historique qui fit que son symbolisme fut développé en Inde.
Le symbolisme d’un dieu, le sexe d’un dieu (mâle ou femelle), les attributs d’un dieu, et les mythes associés, servent tous à nous parler de la nature d’un certain phénomène pris dans son aspect numineux. Pour illustrer cela, il n’y a pas de meilleur symbolisme que celui de l’hindouisme. L’iconographie hindoue est extrêmement complexe, et chaque élément symbolise un certain pouvoir ou un certain aspect d’un dieu.
Dans toute religion, il y a des niveaux de compréhension. Il y a indubitablement des hindous dont la piété consiste en une confusion permanente entre le symbole et le référent. En d’autres mots, il y a indubitablement des hindous qui pensent que vraiment croire à Vâyu signifie croire qu’il est réellement un être entièrement blanc qui chevauche un chevreuil et porte un arc et des flèches. Nous tendons à supposer qu’une telle compréhension de « bas niveau » ou littérale est une caractéristique des « gens ordinaires », mais que les gens supérieurs (les prêtres, les brahmanes) comprennent mieux. Supposer cela est risqué, cependant. En Occident, par exemple, particulièrement en Amérique, confondre le symbole avec le référent n’est en aucune manière limité aux gens simples. C’est un trait de la croyance de la plupart des chrétiens, quel que soit leur niveau d’éducation. Les athées occidentaux confondent aussi le symbole et le référent, et pour cette raison ils déclarent que la religion est manifestement absurde. Les séminaristes comprennent qu’un symbole est un symbole, mais trouvent très difficile de croire en ce dont il est un symbole. C’est pourquoi ils déclarent que nous pouvons garder la religion, si nous comprenons qu’elle concerne en fait la « communauté religieuse », ou l’instruction morale, ou l’activisme social.
Il y a quelque temps j’ai regardé un documentaire britannique sur l’hindouisme, qui incluait le filmage d’un festival d’une durée d’une semaine en l’honneur d’une déesse (je crois que c’était Saraswati). La célébration impliquait de modeler et de peindre une figure d’argile élaborée de la déesse. Une nouvelle était créée chaque année, et à la fin du festival elle était joyeusement jetée dans le fleuve. Le visiteur britannique demanda à un brahmane si les gens adoraient la statue. Le brahmane sourit et dit qu’il doutait beaucoup qu’un seul des célébrants, même un simple d’esprit, pensait que la statue d’argile était réellement Saraswati. Après tout, ils devaient remarquer que chaque année il y avait une nouvelle statue ! En vérité, c’était ici le journaliste occidental qui était simple d’esprit. En fait, la manière typique dont nous Occidentaux comprenons le polythéisme (ou la religion soi-disant « primitive ») est, pour dire le moins, psychologiquement naïve.
Objection Cinq : En me référant à mon premier essai, « Connaître les dieux », je peux imaginer que quelqu’un critique le présent essai en disant : « Regardez, dans l’autre texte vous commencez par rejeter toute tentative d’expliquer ce que sont les dieux, ou d’expliquer l’expérience des dieux. Adopter un tel point de vue réfléchi, disiez-vous, c’est se distancer immédiatement du phénomène ; nous en couper d’une manière encore plus décisive. Mais dans ce texte vous faites précisément ce que vous dites qu’il ne faut pas faire : vous proposez une explication des dieux en disant que ‘les dieux’ sont ce qui se manifeste quand nous sommes frappés par l’être mystérieux d’un être ».
Réponse : En fait, je n’ai pas du tout expliqué les dieux, ou l’expérience des dieux. Expliquer un phénomène c’est le prendre comme un effet d’une cause quelconque, et ensuite découvrir la cause (par ex. l’explication de l’eau bouillante est qu’elle a été chauffée à la température de 212 degrés Fahrenheit). Mais ce n’est pas ce que j’ai fait. Ce que j’ai donné n’est pas une explication, mais une description phénoménologique. En d’autres mots, j’ai simplement décrit comment le divin « se manifeste » ou nous « apparaît ». J’ai décrit les circonstances dans lesquelles le divin se manifeste, l’attitude d’esprit nécessaire pour que l’homme « remarque » le divin, et comment il répond au divin dès que celui-ci se manifeste. Cela peut ressembler à une simplification excessive de ce que j’ai fait dans l’assez long texte qui précède, mais ça n’en est pas une. C’est simplement que dans ce cas, avec une matière aussi mystérieuse que celle-ci, une description phénoménologique est un peu plus difficile que, disons, celle de la manière dont une boîte aux lettres se manifeste à nous. Si le lecteur revient en arrière et repense à ce qui a été dit, il trouvera que la théorie que j’ai donnée concernant la manière dont le divin se manifeste est en fait très simple. Malheureusement, nous avons été conditionnés à penser au divin d’une manière tellement faussée que passer à la bonne description implique une grande quantité d’explications, d’exemples, de définitions de termes, d’étymologie (comme nous le verrons), et, d’une manière générale, de désapprentissage.
Finalement, Objection Six. C’est peut-être l’objection la plus grave de toutes. Mon discours ne « subjectivise »-t-il pas complètement les dieux ? Ne suis-je pas en train de dire que les dieux sont en quelque sorte des fonctions de la manière dont nous regardons les choses, et que sans nous, il n’y aurait pas de divin ? Toute l’approche phénoménologique néo-kantienne décrite ci-dessus semble suggérer cela très clairement.
Réponse : Je peux certainement comprendre pourquoi quelqu’un pourrait réagir de cette manière – spécialement étant donné mon appel à la phénoménologie, mais en fait l’objection représente une mauvaise compréhension de ma position (ainsi que de la phénoménologie et du kantisme, mais je ne peux pas approfondir ces points ici). Je n’ai rien dit qui approche même de l’idée que « le divin » serait une catégorie mentale subjective et que sans observateurs humains il n’y aurait pas de dieux. Je reconnais volontiers que sans une certaine « structure » cognitive (quoi qu’elle puisse être) nous ne pourrions pas être conscients des dieux, mais cela ne m’oblige pas au subjectivisme. Nous avons besoin d’oreilles pour remarquer les ondes sonores, mais personne ne pense que cela signifie que l’oreille « crée » les ondes sonores[13]. Encore une fois, pour citer ma première formulation, j’ai donné une description phénoménologique de « l’attitude d’esprit nécessaire pour que l’homme ‘remarque’ le divin ». Je n’ai pas dit « crée » le divin, j’ai dit remarque le divin. J’ai parlé de la manifestation du divin, pas de l’invention ou du « postulat » par les humains.
Cependant, quelqu’un pourrait dire ici : « Très bien, mais en-dehors de l’apparition des dieux pour nous, y a-t-il vraiment des dieux ici ? ». Exprimé en langage kantien, cela veut dire : à part l’apparition phénoménale des dieux, les dieux existent-ils par eux-mêmes ? Le mieux que je puisse faire pour répondre à cela est de paraphraser Kant lui-même : même si nous ne pouvons percevoir les choses comme elles sont par elles-mêmes (c.-à.-d. en dehors de la façon dont nous les percevons), nous devons au moins être capables de penser les mêmes objets comme des choses en soi, sinon nous tomberions dans la conséquence absurde de supposer qu’il peut y avoir apparence sans rien qui apparaît[14].
4. Précedents : Usener et Cassirer
La théorie précédente partage certains traits avec les idées de Hermann Usener, telles qu’exposées et développées par Ernst Cassirer. Dans Langage et mythe de Cassirer, celui-ci explique que Usener pensait que le plus ancien (et, dirais-je, le plus pur) stade d’expérience religieuse fut marqué par la « production » de ce qu’il appelait des déités momentanées[15]. Cassirer écrit :
Ces êtres ne personnifient aucune force de la nature, et ne représentent aucun aspect particulier de la vie humaine ; aucun trait ou valeur récurrent n’est conservé en eux et transformé en image mythico-religieuse ; c’est quelque chose de purement instantané, un contenu mental fugitif, émergeant et disparaissant, dont l’objectification et la projection extérieure produit l’image de la « déité momentanée ». Chaque impression que l’homme reçoit, chaque souhait qui naît en lui, chaque espoir qui le trompe, chaque danger qui le menace peut ainsi l’affecter religieusement. Que le sentiment spontané investisse l’objet devant lui, ou sa propre condition personnelle, ou quelque manifestation de puissance qui le surprend, avec un air de sainteté, et le dieu momentané a été connu et créé[16].
Or, comme je l’ai dit, cette théorie a certains traits en commun avec la mienne. Ce qui est vague dans l’exposé d’Usener-Cassirer, c’est qu’il prétend qu’un « sentiment spontané » investit un objet. Et qu’est-ce qu’un « air de sainteté » ? Ma propre théorie tente d’expliquer la manière spécifique dont un objet (ou une circonstance) pourrait être perçu d’une manière tellement inhabituelle qu’il pourrait produire en nous l’intuition d’un dieu. En d’autres mots, je tente de décrire spécifiquement ce que cela signifie de considérer une chose comme sainte.
De plus, je soutiens que si l’expérience de la « déité momentanée » n’est pas immédiatement celle d’un dieu personnifié, elle peut le devenir plus tard (sur ce point, je ne crois pas que Usener-Cassirer seraient d’un autre avis). Cassirer poursuit : « Usener a montré par des exemples de la littérature grecque combien ce sentiment religieux primitif était réel même chez les Grecs de la période classique, et combien il les motivait sans cesse »[17]. Et ensuite il cite Usener :
En raison de cette vivacité et de cette capacité de réaction de leur sentiment religieux, toute idée ou objet qui commande pendant un instant leur intérêt sans partage peut être élevé à un statut divin : Raison et Compréhension, Richesse, Chance, Apogée, Vin, Fête, ou le corps de la Bien-aimée. … Tout ce qui nous arrive soudainement comme un envoi du ciel, tout ce qui nous réjouit ou nous peine ou nous opprime, apparaît à la conscience religieuse comme un être divin. Aussi loin en arrière que nous pouvons rechercher chez les Grecs, ils subsument de telles expériences sous le nom générique de daimon.[18]
D’après Usener, après le stade des « dieux momentanés » vient le stade des « dieux particuliers ». Bien qu’Usener semble avoir ici à l’esprit, étroitement, des déités associées aux activités humaines (voir la note #12 à la page 35). Cependant, telles que rapportées par Cassirer, les idées d’Usener sont stimulantes, et recoupent les miennes :
Chaque département de l’activité humaine donne naissance à une déité particulière qui le représente. Ces déités aussi, qu’Usener appelle des « dieux particuliers » (Sondergötter), n’ont pas encore de fonction et de signification générales ; elles n’imprègnent pas l’existence dans toute sa profondeur et toute son ampleur, mais sont limitées à une simple section de celle-ci, un département étroitement circonscrit. Mais dans leurs sphères respectives elles ont atteint la permanence et un caractère déterminé, et avec cela une certaine généralité. Le dieu patron du hersage, par exemple, le dieu Occator, ne règne pas seulement sur le hersage d’une année, ou la culture d’un champ particulier, mais est aussi le dieu du hersage en général, qui est invoqué chaque année par toute la communauté comme son aide et protecteur pour la récurrence de cette pratique agricole. Il représente donc une activité rustique particulière et peut-être humble, mais il la représente dans sa généralité. [19]
Se basant sur l’œuvre d’Usener, Cassirer va jusqu’à affirmer dans Langage et mythe que le langage apparut essentiellement comme un moyen de fixer dans l’esprit ces déités momentanées (souvenez-vous qu’il les caractérise comme un « contenu mental fugitif, émergeant et disparaissant »). Ainsi sont nés des mots utilisés pour communiquer et retenir ces expériences (sur ce point, il y a un intéressant parallèle entre le lien fait par Cassirer entre « déités » et mots, et le lien, décrit plus loin, que je fais entre déités et Formes platoniques ; voir Section 6 plus loin). Les « dieux particuliers » sont des déités investies de noms particuliers. Finalement, ces noms se séparent de la divinité et restent seuls comme des « termes » désignant l’activité gouvernée par la divinité d’origine (ainsi, si dans une certaine langue le Mot X signifie « hersage », X peut avoir été à l’origine le nom approprié du dieu de cette activité).
Usener donne une multitude d’exemples de dieux « particuliers » et « fonctionnels », dont un grand nombre est tiré de l’ancienne religion romaine. La plus grande réalisation religieuse, d’après Usener, est le développement de « dieux personnels ». Cassirer écrit : « Les nombreux noms divins qui désignaient à l’origine un nombre équivalent de dieux particuliers fortement distingués fusionnent maintenant en une seule personnalité, qui est ainsi apparue ; ils deviennent les diverses appellations de cet Etre, exprimant des aspects divers de sa nature, de son pouvoir, et de sa portée » [20]. Il n’est pas très difficile de discerner un préjugé judéo-chrétien dans une telle théorie, qui interprète le monothéisme non seulement comme le telos de tout développement religieux, mais aussi comme son point culminant.
En vérité, il est possible, comme je l’ai suggéré précédemment, d’être à la fois monothéiste et polythéiste. Nous pouvons certainement regarder le monde comme l’expression d’une multiplicité de dieux individuels. Si nous voyons ces divinités comme étant, en un sens, des « régions de l’être », nous pouvons aussi les voir comme des manifestations ou des expressions différentes d’une unité sous-jacente. Ce sont simplement deux manières de voir la même chose. Il n’y a pas de contradiction à dire que le vrai Dieu est Brahman, et à dire simultanément qu’il y a 330.000.000 dieux. La plupart des religions ont totalisé l’une ou l’autre de ces approches, et la tendance historique, semble-t-il, va du polythéisme au monothéisme, et non l’inverse. La raison de cela est une question que je ne peux pas traiter ici[21].
5. Le langage du Divin
Si nous regardons l’étymologie des mots que nous utilisons pour parler du divin et y réfléchir, nous trouverons un autre appui à ma position. C’est important, car au plus profond de nous se trouve l’idée que le mot « dieu » doit simplement signifier un super-être personnel (en fait, je pense que c’est là-dessus que la première objection est fondée – celle disant que je ne parle pas du tout de ce que les gens ont voulu dire par « dieux »).
Le terme proto-indo-européen reconstruit pour divinité est *deiwos, et voici quelques-unes de ses formes :
Vieil-irlandais dîa
Vieux gallois duiu-tit
Latin deus
Vieux norrois Týr (pl. tívar, « dieux »)
Vieil-anglais Tîw
Vieux haut-allemand Zîo
Lithuanien dievas
Letton dìevs
Avestique daéva
Vieil-indien devá
Une source dit de *deiwos : « A l’origine un dérivatif thématique de *dyeu- ‘ciel, jour, soleil (dieu)’ signifiant lumineux, dieu (en général) »[22].
Or, si *deiwos ou Dieu signifie quelque chose comme « lumineux », il y a au moins deux ou trois manières très différentes pour expliquer cela. Puisque le mot est dérivé de *dyeu-, « ciel, jour, soleil », on suppose généralement que les dieux indo-européens originels (ou du moins l’échelon supérieur des dieux, par ex. les Aesir nordiques) sont des dieux du ciel. Ce phénomène consistant à rechercher la divinité dans les cieux n’est pas limité aux Indo-Européens, comme nous le savons tous depuis le catéchisme. Mais je me demande s’il n’y aurait pas un sens plus profond à l’idée que Dieu serait « le lumineux ». Comme je l’ai exposé ci-dessus, quand nous parvenons à la conscience de l’être merveilleux des choses individuelles, c’est comme si elles étaient soudain « éclairées ». Et je ne dis pas seulement cela au sens figuré. Très souvent l’expérience semble être littéralement un moment où les choses brillent d’une lumière nouvelle. Les descriptions d’expériences mystiques abondent de ce genre de langage. Nous disons que nous sommes « illuminés », ainsi que les choses. Pour revenir à un exemple précédent, quand je m’émerveille que des choses comme mon chat puissent exister, mon chat est « éclairé » pour moi d’une manière nouvelle, et la lumière qui rayonne à travers mon chat est la divinité, la divinité lumineuse.
Il est tout naturel que nos ancêtres aient associé l’expérience physique de l’impressionnant éclat du soleil à l’expérience psychique de l’impressionnante lumière de l’Etre rayonnant à travers les êtres. Ainsi, *deiwos signifiant « lumineux » est en fait une abstraction dérivée de tout ce qui est *dyeu-, ou de tout ce qui « brille », le « ciel », le « jour » et le « soleil » étant des exemples de brillance.
Si nous regardons en-dehors de la tradition indo-européenne, nous trouvons chez les Chinois ce qui semble être une conception similaire. Les plus anciens termes chinois pour désigner la divinité remontent à la Dynastie Tchang (vers 1751-1028 av. J.C.). Le dieu suprême est conçu comme céleste. Assez curieusement, il est appelé Ti (qui signifie simplement Seigneur) ou Tchang Ti (Seigneur d’en Haut) [23]. D’après Mircea Eliade, « Ti commande les rythmes cosmiques et les phénomènes naturels (pluie, vent, sécheresse, etc.) ; il accorde au roi la victoire et assure l’abondance des récoltes ou, au contraire, apporte les désastres et envoie les maladies et la mort » [24]. Il y a d’autres dieux (et les Chinois vénéraient aussi leurs ancêtres), mais ceux-ci sont subordonnés à Ti. Mais à la différence de Tyr dans la tradition germanique, Ti demeure quelque peu éloigné de la vie des croyants ordinaires, et devint finalement, en fait, un deus otiosus. Il serait fascinant de retracer l’étymologie de « Ti », mais je ne connais pas du tout le chinois, et je n’ai pas trouvé beaucoup de sources en anglais qui traitent de ce sujet.
Pour revenir aux Indo-Européens, examinons quelques autres termes désignant le divin. Dans un article originellement publié dans Rúna, Edred Thorsson analyse les termes germaniques désignant « le sacré » [25]. En proto-germanique, ce sont *wîhaz et *hailagaz, en vieil-anglais wîh et hâlig, en vieux haut-allemand wîh et heilig, en gothique weihs et hailags, en vieux norrois vé et heilagr. L’allemand moderne conserve les deux termes, dans weihen (consacrer) et heilig. L’anglais moderne conserve seulement le second, dans « holy ».
Comme Thorsson le remarque, *wîhaz dérive de la racine proto-indo-européenne *vîk, qui signifie « séparer ». L’idée de séparation implique un contexte religieux ou rituel. De *vîk vient le latin victima, animal sacrificiel[26]. Ainsi, ce qui dérive de *vîk signifie quelque chose de « séparé d’une manière ou d’une autre du quotidien » [27]. Le *wîhaz est ce qui a été extrait, en quelque sorte, de ce qui est à portée de la main, et investi d’une signification d’un genre très particulier.
Ce que Thorsson ne mentionne pas, toutefois, c’est que *vîk (parfois écrit *wîk) peut aussi signifier « apparaître », aussi bien que séparer (ou « consacrer »). Nous avons ainsi le vieil-anglais wîg ~ wîh ~ wêoh, « image, idole ». Le lithuanien į-vŷkti, signifiant « arriver, survenir ; devenir vrai, s’accomplir », semble originellement avoir signifié « venir à la vue » [28]. Le grec eikōn, signifiant « image, apparence », vient de la même racine. Platon oppose l’eikon à l’eidos, la Forme (voir Section 6 plus loin). Mais comment la même forme linguistique peut-elle signifier « séparer », « consacrer », et « apparaître » simultanément ? La réponse est qu’une chose apparaît d’elle-même seulement quand elle est séparée. Toute apparition implique une opposition entre la « figure » et le « fond ». Pour apparaître, un objet doit être d’une manière ou d’une autre « distingué » de son arrière-plan. Les objets « sacrés » sont des objets qui ont été séparés de l’espace profane (c.-à.d. placés à part des activités et des objets ordinaires) et du temps profane (c.-à.d. liés à ce qui est éternel).
Thorsson donne les significations suivantes pour la racine germanique *wîh- :
1. « un site pour l’activité cultuelle, un terrain sacré »
2. « un tumulus [funéraire] »
3. « un site où siège le tribunal »
4. « une idole, ou une image divine »
5. « un étendard ou un drapeau »[29]
Ce qu’elles ont toutes en commun, c’est qu’elles sont ordinairement « banales » : un morceau de terrain, un monticule de terre, une clairière, un morceau de bois gravé, un morceau de tissu. Mais elles peuvent toutes être regardées d’une manière spéciale et investies, par association, d’une signification (de quelque chose comme ce que les anthropologues appellent le « mana »)[30]. Quand la banalité des choses est niée de cette façon, elles sont rendues « sacrées », et ensuite naît une séparation dans le monde entre ce qui est sacré et ce qui est profane[31]. Ainsi que l’explique Thorsson, en vieux norrois il y a même un verbe qui désigne l’action d’extraire des objets du domaine du profane et de les rendre sacrés : wîhian. De ce qui est *wîh- vient l’un des plus importants noms nordiques pour la divinité : Vé, qui est l’un des trois frères divins décrits dans la cosmogonie nordique, Odin, Vili, et Vé. Le terme veár, venant de Vé, est aussi utilisé pour désigner les « dieux » pluriels en général[32].
Quant à la racine proto-germanique *hail-, une analyse des mots qui en dérivent dans les diverses langues germaniques indique la série de significations suivante :
1. « sacré »
2. « entier, sain » (par ex., anglais « hale and hearty »)
3. « santé, bonheur » (par ex., anglais « health »)
4. « chance, bonne augure »
5. « guérir » (par ex., anglais « heal »)
6. « saluer » (par ex., anglais « hail ! » et allemand « heil ! »)
7. « observer les signes et les augures »
8. « invoquer les esprits, enchanter »[33]
Thorsson écrit que *hail- « est ce qui participe de la qualité numineuse qui est bénie et entière, et qui évoque le sentiment d’‘entièreté’ ou d’‘unité’ dans le sujet religieux »[34].
Essentiellement, *hail- implique la participation du sujet humain au divin, alors que *wîh- désigne la présence divine elle-même. L’homme qui est « entier, sain » est l’homme qui est imprégné d’un état de justesse ou d’harmonie qui est considéré comme associé à l’être divin. Ceci est très proche du sens grec originel d’eudaimonia (assez mal rendu, dans les traductions d’Aristote, par « bonheur »), qui signifie littéralement quelque chose comme « bien pourvu en daimon » [35]. La « chance » est la faveur divine résidant dans un homme. « Guérir » signifie restaurer dans le corps ou l’esprit cette « justesse » d’orientation divine. Aujourd’hui, il est très rare d’entendre quelqu’un saluer en disant « hail ! » et on n’a jamais entendu (après la Seconde Guerre mondiale) de « heil ! ». Quand les gens se saluaient ainsi, saluaient-ils ou reconnaissaient-ils le divin dans l’autre personne ? Bref, « hail ! » était-il similaire au salut indien (toujours en usage aujourd’hui) namastē ?[36]. L’observation de signes et d’augures signifie être attentif à la manifestation du divin dans la vie quotidienne. Finalement, « enchanter » signifie placer quelqu’un sous l’influence d’un pouvoir divin.
Finalement, nous tournant vers le grec classique, on peut mentionner que le mot grec pour piété ou religion, eusebeia, vient du verbe sebein, signifiant « reculer devant quelque chose, par crainte respectueuse ».
6. Platon : Eidos vs. Theos
L’analyse précédente de l’expérience du divin jette une lumière spéciale sur la philosophie grecque, en particulier sur la relation entre la « doctrine des Formes » de Platon et la religion indo-européenne traditionnelle. Examiner ce lien semble aussi apporter un appui supplémentaire à la plausibilité de mon analyse. En fait, les lecteurs ont peut-être remarqué quelque chose de vaguement « platonique » dans ma description de l’expérience humaine de la divinité. J’affirme en effet que la philosophie de Platon a constitué une transformation de l’expérience religieuse grecque. Si j’ai raison, alors nous pourrions apprendre beaucoup de choses sur la nature de cette expérience en lisant Platon.
Je suis sûr que mes lecteurs ont une certaine connaissance des Formes de Platon. Platon pensait que le monde de l’expérience est, en un sens, irréel, et que ce qui est vraiment réel (ou, pourrait-on dire, ce qui est vraiment) ce sont les « Formes » ou les « natures » que les choses expriment. Ces formes sont non-physiques et, à la différence des individus qui les illustrent, elles durent. Le mot grec traduit par « Forme » est eidos (pluriel : eidē), et c’est pourquoi, un peu moins souvent, le terme est traduit par « idée » [37]. Mais la signification littérale d’eidos est « apparence ». L’eidos est l’« apparence » d’une chose. En allemand, le même concept est rendu par Schein, qui est bien sûr apparenté à l’anglais « shine ».
A première vue, il semble y avoir eu une complète transformation dans le sens de l’eidos grec. Ce qui signifiait originellement l’« apparence » d’une chose finit par signifier, chez Platon, sa nature intelligible, qui se manifeste non pas aux yeux mais à l’esprit. Mais après un examen plus attentif, un lien subtil entre les deux se révèle. Examinons d’abord comment Platon décrit la manière dont nous devenons conscients des Formes. Un exemple classique peut être trouvé dans le Symposium (210e). Dans un « flashback », Socrate se souvient de la manière dont il fut instruit de la nature du beau par la sage Diotime. Elle décrit une « échelle de beauté », et dit à Socrate qu’il parviendra à la conscience de la Beauté elle-même (la Forme de la Beauté) en examinant différentes choses considérées comme « belles » :
Tu vois, l’homme qui a été ainsi guidé loin dans les questions de l’Amour, qui a regardé les belles choses dans le bon ordre et correctement, parvient maintenant au but de l’Amour : d’un seul coup il apercevra quelque chose de merveilleusement beau dans sa nature [le « Beau lui-même »] ; cela, Socrate, est la raison de tous ses travaux précédents[38].
Un second exemple moins familier survient dans le dialogue ultérieur, le Parménide. Ici, Socrate, décrit comme un jeune homme, converse avec un autre de ses premiers maîtres, le philosophe Parménide. Au paragraphe 132a, son aîné met à l’épreuve la théorie des Formes (alors dans sa forme la plus précoce et la plus brute) de Socrate :
Je suppose que tu penses que chaque forme est une pour la raison suivante : dès qu’un certain nombre de choses te semble grand, peut-être semble-t-il y avoir quelque caractère commun, le même que tu vois à travers toutes, et de cela tu conclus que le tout est un. [39]
Ces deux descriptions phénoménologiques de la manière dont les Formes se manifestent à nous les décrivent comme apparaissant au penseur alors qu’il contemple les objets sensibles. Sans doute, ce n’est pas comme si la Forme surgit des choses et se présente comme un objet sensible séparé. On pourrait dire qu’elle apparait à l’« intellect », mais cela simplifie trop les choses. Ce qui semble se produire dans notre venue-à-la-conscience des Formes, c’est que les sens et l’intellect coopèrent d’une manière particulière et ineffable. Il semble y avoir une transformation littérale de l’expérience sensible quand la Forme « apparaît ». Nous voyons toujours la même chose sensible, mais nous en voyons maintenant une nouvelle dimension. Ce que je dis, c’est que si je parviens à la conscience de la « chatitude » en regardant mon chat, il semble juste de dire que l’« apparence » littérale du chat ne change pas – mais, dans un autre sens, l’apparence change vraiment. Je vois maintenant l’aspect atemporel du chat (sa nature, sa « chatitude ») à travers lui, et l’expérience sensible donne le sentiment qu’il a été transformé. Il est important de noter que le verbe eidenai (savoir), qui est apparenté à eidos, signifiait originellement « voir » ou « avoir un aperçu de ».
Je pense que c’est pour cette raison que Parménide semble forcer Socrate, dans la dernière partie du dialogue, à dépasser une conception où les Formes sont des choses « séparées » des choses sensibles, et à envisager l’idée que le sensible est précisément la Forme considérée dans son aspect immuable[40]. Dans les dialogues antérieurs, les choses sensibles sont traitées comme des « images » ou des « apparences » des Formes. Ceci est métaphorique, et n’est pas destiné à être pris à la lettre. Voir une peinture de quelqu’un que j’ai vu en personne est très différent de voir une peinture de quelqu’un que je n’ai jamais rencontré. Dans le premier cas, il y a une dimension additionnelle à l’expérience. Je vois la personne réelle dans, ou à travers la peinture. De la même manière, pour Platon, nous voyons la vraie nature d’une chose (par ex. la « chatitude ») rayonner à travers les choses individuelles (c.-à.-d. les chats).
Or, la même idée semble être exprimée, sous une forme plus sophistiquée, dans la dernière partie du Parménide, dans la série particulière des « déductions » qui y sont présentées. Les choses sensibles sont considérées comme des « apparences » des Formes. Le mot grec traduit par « apparences » est phainomena, qui n’a pas le sens de « simple apparence » ou d’« aspect » que notre mot « apparence » possède habituellement. Dans Etre et Temps, Heidegger tente de retrouver le sens grec originaire de phainomenon, qui survit dans notre langue, bien sûr, dans le mot « phénomène ». Heidegger écrit que phainomenon signifie ce qui se montre, le manifeste. … Ce qui se montre en soi-même, le manifeste. De même, les phainomena ou ‘phénomènes’ sont la totalité de ce qui se trouve dévoilé ou qui peut être dévoilé – ce que les Grecs identifiaient parfois simplement aux ta onta (êtres) »[41]. Heidegger continue en distinguant le « phénomène » de l’« apparence ». Par apparence, il veut dire quelque chose comme « image ». Une apparence peut être une illusion, une hallucination, ou une représentation, comme une peinture. Celles-ci ne sont aucunement des phenomena, au sens grec d’origine. Un phénomène n’est pas une image de quelque chose (et surtout pas une « apparence » trompeuse), c’est la chose qui se montre elle-même. Même notre mot « apparence » peut signifier cela. Si quelqu’un me dit que la Reine a « fait une apparition » en Ecosse, je n’en déduis pas que quelqu’un a vu une image d’elle à cet endroit. J’en déduis qu’elle s’y est montrée en personne » [42].
Or je pense qu’on peut facilement voir qu’il y a un parallèle entre la façon dont j’ai décrit l’expérience des dieux, et la façon dont Platon décrit l’expérience des Formes. Les dieux tout comme les Formes sont des phénomènes : ils rayonnent eux-mêmes à partir des choses, dans notre expérience. Quand la « chatitude » rayonne du chat, d’une certaine manière c’est comme si quelque chose d’autre rayonnait du chat, et d’une autre manière ça ne l’est pas. Il est clair qu’en voyant la « chatitude » du chat nous avons dans un certain sens « vu au-delà » de ce chat particulier, mais d’une autre manière nous avons vu ce qui est fondamental en ce qui concerne ce chat[43]. Les deux choses sont vraies, et illustrent l’aspect dual des Formes qui sont simultanément transcendantes et immanentes. Voir la divinité dans le chat, comme j’en ai décrit l’expérience, est pratiquement identique à cela. Dans une attitude d’émerveillement, frappant par le fait que des êtres comme les chats puissent simplement exister, un aspect jusqu’alors caché du chat se manifeste à nous : l’être miraculeux du chat. Et simultanément, nous avons le sentiment que cet émerveillement a émergé d’une source également miraculeuse, ce que j’ai appelé l’archè. La « divinité » du chat, comme je l’ai dit plus haut, est à la fois le chat lui-même, et quelque chose d’autre qui transcende ce chat particulier.
Dans la fameuse « allégorie de la caverne » de la République, la montée de l’ignorance à la sagesse est figurée par la montée depuis une caverne jusqu’à la lumière du jour, où la vraie nature des choses est « illuminée » (cf. 516a–b). Dans le Parménide, le jeune Socrate utilise une comparaison pour expliquer la relation des choses sensibles avec leur Forme. La Forme, dit-il, est « comme une journée unique. Ce qui est dans de nombreux lieux en même temps et qui n’est absolument pas séparé de soi-même. S’il en est ainsi, chacune des formes pourrait être, en même temps, unique dans tout » (131b)[44].
En dépit des similarités, il y a en fait une énorme différence entre la conscience de la divinité et la conscience des Formes de Platon. Ce qui a été banni de l’exposé de Platon, c’est l’émerveillement et le mystère. La divinité du chat qui rayonne en lui n’est plus la divinité, c’est simplement la « nature intelligible » de la chose. Le sens dans lequel la conscience de l’eidos, l’« apparence » de la chose, englobe le sensible et l’intellectuel, le sens dans lequel la conscience de l’eidos transforme la véritable expérience sensuelle de la chose, a été en grande partie perdu. Sans doute cet eidos est-il encore « surnaturel », « au-dessus » de la nature, et en-dehors de l’espace et du temps. Mais il est traité comme un modèle ou paradeigma (voir Parménide, 132d) et il est vu sous l’angle des mathématiques. Sous l’influence du pythagorisme, Platon développa un enseignement secret complet qui est seulement discrètement évoqué dans les dialogues, impliquant une conception mathématique de la réalité, issue de deux « principes » ultimes, le « Un » et la « Dyade indéfinie »[45]. Le projet de Platon et de ses étudiants était alors de comprendre les Formes en accord avec ce système mathématique. Les Formes peuvent être « mystérieuses » en étant tout à fait différentes des objets sensibles banals, mais elles sont en relation avec ces choses de la même façon qu’un plan est en relation avec une maison, et il n’y a rien d’intrinsèquement mystérieux (et encore moins de religieux) là-dedans[46].
Ma thèse est que Platon reprend l’expérience du divin, ainsi que le concept de divinité, et les remanie sous une forme philosophique et même « scientifique ». L’expérience religieuse ou mystique devient l’« idée » philosophique ou scientifique, et les dieux deviennent des « Formes » ou des modèles dans la nature. Platon développe cette approche en utilisant la philosophie mathématique des pythagoriciens, tout en conservant certains aspects « mystiques » du pythagorisme (en particulier la doctrine de la réincarnation ; voir le Phédon). Platon rend possible pour un homme d’être religieux et de prendre grand soin de son âme, tout en ne croyant pas aux « dieux »[47]. Le christianisme, comme l’a dit Nietzsche, a peut-être été du platonisme pour le peuple, mais le platonisme lui-même était du polythéisme pour les athées. Et même si la doctrine de la réincarnation dans le Phédon est défendue pour des raisons pratiques (voir le Phédon, 114d–e), le platonisme est du mysticisme sans mystère[48].
Platon est ouvert aux descriptions métaphoriques de l’Etre des choses, mais tout ce qui ressemble au genre d’iconographie religieuse exposé antérieurement est rejeté entièrement. Une telle imagerie, comme je l’ai dit, aide à fixer dans l’esprit et à contempler le mystère et le miracle des choses. Mais le but de Platon est la compréhension : c’est-à-dire l’analyse des êtres. Ainsi, en dépit de sa reconnaissance du statut surnaturel de l’Etre des êtres, ses Formes sont des « banalisations » de l’être. Avec Aristote, la banalisation est poussée encore plus loin. Aristote déclare que toute philosophie « commence dans l’émerveillement », mais que la philosophie a pour tâche la suppression ou l’annulation de l’émerveillement au moyen de l’explication scientifique. Il reprend la doctrine des Formes mais la modifie, et oppose la Forme à la « matière » (une opposition que Platon n’emploie pas réellement). Toute la réalité est conçue par Aristote sur le modèle des objets de fabrication humaine : la combinaison d’une matière quelconque et d’un plan ou d’un modèle.
Maintenant, on pourrait objecter que j’ai été déloyal envers Platon en affirmant qu’il veut prendre le surnaturel qui rayonne à travers les choses et le dénuer de prodige et de mystère. Après tout, Platon ne suggère-t-il pas très clairement (et très fameusement dans la République) que nous ne pouvons jamais connaître les Formes telles qu’elles sont en elles-mêmes, qu’elles transcendent toujours nos pouvoirs de les comprendre ?[49]. Cela est vrai, mais cette doctrine n’est pas présentée comme une occasion d’émerveillement, ou de nous ramener à la religion, mais comme un idéal régulateur à la Kant, comme dans les Idées de la Raison. Si la pure ou totale connaissance des formes est impossible, le but de la connaissance totale est un but que nous approchons par une asymptote. Connaître les Formes devient ainsi une tâche infinie, et motive nos enquêtes (scientifiques) sur la nature des choses.
7. Conclusion
Un problème important demeure. Comment exactement pouvons-nous retrouver la capacité de faire se manifester le divin, d’invoquer les dieux ? Pour revenir au commencement, il semble que nos ancêtres faisaient cela sans effort, mais que ce pouvoir se soit atrophié en nous. La raison de cela est le sujet principal de « Connaître les dieux ». Mais que pouvons-nous faire dans notre situation ?
Dans « Connaître les dieux », j’ai fait quelques suggestions concrètes, qui revenaient essentiellement à dire « revenez à la nature, débarrassez-vous de tous vos gadgets, et ne faites pas confiance à la science moderne ». Certains lecteurs ont trouvé cela peu satisfaisant – et l’auteur aussi, pourrais-je ajouter. Ce n’était pas grand-chose, mais cela me semblait être, incontestablement, une bonne manière de commencer (un lecteur m’accusa d’hypocrisie, puisque je vis dans un appartement et que j’écris des articles sur un ordinateur ! A cela, je plaide : no lo contendere). Je m’en tiens à ces suggestions, et finalement j’ai l’intention de les suivre moi-même. Cependant, je pense que je peux maintenant offrir davantage.
Le lecteur aura peut-être remarqué que l’expérience du divin décrite ici attribue à l’homme antique quelque chose qui ressemble beaucoup à la capacité d’un enfant à l’émerveillement. Il n’y a là rien de nouveau, mais dans le passé l’« émerveillement enfantin » de l’homme antique était considéré comme une marque de sa nature « primitive ». Il est cependant impossible de retrouver la capacité de répondre à la divinité du monde sans réveiller cette capacité à l’émerveillement.
En discutant ce sujet, je me rappelle de trois textes. Je vais surprendre mes lecteurs d’abord en citant le Nouveau Testament (Mathieu, chapitre 18, verset 3) : « En vérité, je vous le dis, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux ». Le second texte pourrait bien être considéré par certains comme l’antithèse du premier : il vient de du livre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra. Dans « Sur les trois métamorphoses », Zarathoustra nous raconte « comment l’esprit devient un chameau ; et le chameau, un lion ; et le lion, finalement, un enfant » [50]. En tant que chameau, l’esprit est une bête de somme, chargée de « Tu feras ». Dans « Dans le désert solitaire » (un lieu de transformation spirituelle, comme le savaient Moïse, Jésus et Mahomet), l’esprit rejette les « Tu feras » et devient un lion. Mais le lion est purement réactif : il frappe les « Tu feras » et passe sa vie à se révolter contre eux. Il ne peut pas créer de nouvelles valeurs. Cela doit être laissé à la troisième métamorphose, l’enfant. « L’enfant est innocence et oubli, un nouveau commencement, un jeu, une roue se mouvant elle-même, un premier mouvement, un ‘Oui’ sacré » [51].
Le troisième texte est rarement cité, sinon jamais. Il vient d’une merveilleuse lettre que D.H. Lawrence écrivit de Cornouailles à Bertrand Russel, le 19 février 1916. Lawrence écrit :
Il faut être un hors-la-loi ces jours-ci, pas un enseignant ou un prédicateur. Il faut se retirer du troupeau et ensuite lui envoyer des bombes. … Coupez-la – coupez votre volonté et laissez votre vieux Moi derrière. Même vos mathématiques ne sont que vérité morte : et aussi finement que vous hachez la viande morte, vous ne la ramènerez pas à la vie. Cessez complètement de travailler et d’écrire et devenez une créature au lieu d’être un instrument mécanique. Purifiez-vous de toute discipline sociale. Pour votre fierté même devenez un simple rien, une taupe, une créature qui sent les choses à sa manière et ne pense pas. Pour l’amour du ciel soyez un bébé, et plus un savant. Ne faites plus rien – mais pour l’amour du ciel commencez à être – commencez par le commencement et soyez un bébé parfait : au nom du courage. [52]
Quelqu’un pourrait dire qu’il est facile pour un enfant de connaître l’émerveillement, puisque le monde est tout nouveau pour lui. Mais dès que l’on s’est habitué au monde, il est naturel que l’émerveillement cesse, et même que le cynisme et la lassitude s’installent. Nous devons rejeter cela. L’émerveillement de l’enfant ne cesse pas simplement parce que les choses lui deviennent familières, mais parce que les adultes autour de lui piétinent avec joie son émerveillement, en lui « expliquant » tout d’une manière réductrice sous la forme d’un « Oh, X ? Pourquoi, stupide garçon, c’est seulement Y » (voir mes commentaires précédents sur la science et la pornographie).
Retrouver l’émerveillement implique un changement dans le sujet. Aucun changement dans l’objet n’est requis. Il y a essentiellement deux « chemins » qu’on peut suivre pour rechercher le changement, et ils correspondent à la vieille distinction taoïste entre alchimie « interne » et « externe » (ou neidan et waidan, respectivement). (Je me hâte d’ajouter que les deux chemins ne sont pas mutuellement exclusifs et peuvent, et doivent, se confondre.)
L’alchimie externe, pour les taoïstes, impliquait l’usage d’élixirs spécialement préparés et conçus pour produire une transformation dans le sujet (par ex. le rendre immortel). Ce dont nous avons besoin, c’est d’un élixir qui modifierait notre conscience du monde et rendrait tout, y compris ce qui nous apparaissait complètement banal, nouveau et merveilleux. Un tel élixir rendrait le profane sacré. Je fais allusion, bien sûr, aux drogues psychédéliques, qui sont un adjuvant utile au réveil spirituel, si elles sont utilisées sagement et avec le plus grand sérieux. J’utilise la phrase « réveil spirituel » parce qu’il faut toujours garder à l’esprit que nous ne tentons pas d’acquérir quelque nouvelle aptitude, mais de réveiller une aptitude qui a été en sommeil.
Ce qui suit est une analogie intéressante, qui peut nous aider à mieux comprendre notre situation, et ce qui est requis pour nous. Dans les années 1880 et 90 les chemins de fer étaient en train d’être posés d’une côte à l’autre, à travers les grandes plaines de l’Amérique. Deux obstacles se présentaient : les bisons, et les Indiens qui les chassaient. En envoyant des hommes pour massacrer les bisons, le gouvernement et l’industrie faisaient d’une pierre deux coups. Avec la disparition des bisons, les Indiens des plaines furent privés de leur principale source de nourriture, et obligés de vivre dans des réserves gouvernementales. Mais pour les Indiens, la perte du bison signifiait bien plus que la perte de leur source de nourriture. Le bison était la figure centrale dans leur religion. Leur mythologie était basée sur la relation entre les hommes et les bisons, qui (croyait-on) s’offraient eux-mêmes pour être chassés et mangés. Le résultat dévastateur du massacre massif des bisons, par conséquent, fut la destruction de la religion des Indiens des plaines en quelques brèves années. La réponse à ce désastre, cependant, survint rapidement sous la forme de petits boutons comestibles qui vinrent du Mexique et parvinrent jusqu’aux Indiens. Les Indiens des plaines commencèrent à consommer du peyotl. Avec des rituels d’une grande solennité, ils se réunissaient dans des loges pour consommer le peyotl, recherchant en eux-mêmes de nouveaux mythes pour remplir le vide créé par la destruction du culte du bison par l’homme blanc. Ironiquement, c’est à peu près dans la même situation que l’homme blanc se trouve aujourd’hui[53]. Et consommer du peyotl (ou quelque chose dans le genre-là) pourrait aussi faire partie de la réponse pour nous.
Les drogues psychédéliques provoquent l’émerveillement d’une manière immédiate et spectaculaire. Elles ne produisent pas des « hallucinations » ; elles ouvrent un canal par lequel nous pouvons voir le monde d’une manière entièrement différente. Mais faire de telles expériences de drogues au hasard est un sacrilège et peut se retourner contre l’utilisateur. Utilisées de manière appropriée, les drogues elles-mêmes peuvent produire une transformation personnelle immédiate et durable (comme les cas d’alcooliques qui furent guéris spontanément et complètement, après une seule dose de LSD). Cependant, je pense qu’elles sont largement sans valeur si l’on ne peut pas retenir ce que l’on a appris pendant le « trip », et traduire cela en une nouvelle manière de regarder les choses et, en général, d’être dans sa vie quotidienne.
Quant à cette vie quotidienne – par laquelle je veux surtout dire les longs intervalles entre les expériences psychédéliques – c’est là que l’« alchimie interne » a lieu. L’alchimie interne comprend toutes les activités dans lesquelles le moi s’engage (sans besoin d’élixirs) et qui ont pour but la transformation de la conscience. Lire cet article est un acte d’alchimie interne pour vous, tout autant que l’écrire l’a été pour moi. L’étude de soi, où l’illumination est le but, est de l’alchimie interne. Le yoga, avec là aussi pour but la transformation de la conscience, est de l’alchimie interne. Les chemins initiatiques, comme celui proposé par la Rune-Gild et d’autres organisations, sont une forme d’alchimie interne. Prendre la posture du zazen est de l’alchimie interne.
Le problème ici est de sélectionner une forme particulière d’alchimie interne, puisqu’on ne peut pas tout faire. Un premier pas est de poser réellement les questions que j’ai indiquées précédemment, comme des tentatives pour développer l’attitude pré-réflective de nos ancêtres : pourquoi donc y a-t-il des êtres, plutôt que rien ? Et pourquoi cette chose particulière devrait-elle être, et de la manière qu’elle est ? En d’autres mots, le premier pas est de commencer à connaître l’émerveillement dans la vie.
Mais laissez-moi dire brièvement quelque chose au sujet de la méditation et des pratiques yogiques. La description que j’ai donnée de l’expérience religieuse a beaucoup en commun avec les descriptions des expériences du satori dans le Zen. Le satori est généralement décrit comme une expérience d’« éveil », ou d’« illumination ». Le décrire est délicat, car aucune description ne peut vraiment exprimer à quoi cela ressemble de connaître le satori, mais il semble impliquer au moins deux composants. Le premier est l’intuition que ce qui est, est juste. Lorsqu’on connaît le satori, on sent que tout, exactement comme c’est maintenant, est fondamentalement juste, et que cela doit être de la manière que c’est. Le second, c’est que temps et espace semblent être annulés. L’expérience survient quand on a l’impression d’être dans une sorte d’« éternel présent ». Et le sentiment de séparation entre soi-même et l’objet est également supprimé. Ce n’est pas (ainsi qu’on le dit souvent) parce qu’on a le sentiment que le moi et l’objet sont le même. C’est plutôt parce que dans l’expérience du satori, l’ego disparaît, et l’on est complètement pris par l’expérience de l’autre. Mais, encore une fois, c’est une expérience très particulière de ce qui est « autre ». C’est l’autre connu d’une manière intemporelle, par laquelle nous l’acceptons, nous nous abandonnons à lui, et nous l’affirmons inconditionnellement.
Etant donné la relation étroite entre le satori et mon récit de l’expérience des dieux, il va sans dire que toute la tradition orientale des pratiques consacrées à atteindre le satori, le nirvana, ou tout ce que vous voulez, devrait être d’un grand intérêt pour nous. Mais cela ne restreint pas vraiment les choses, car l’Orient nous fournit autant de voies vers l’Illumination qu’il existe de types de personnes individuelles. Pour chacun, il y a son propre yoga. Ce que toutes ces méthodes ont en commun, cependant, c’est que ce sont des moyens de dépasser une attitude profane envers les choses. Les meilleures d’entre elles nous enseignent à reconnaître le sacré dans le profane, et ainsi à transformer le monde devant nos yeux.
Notes
Originellement publié dans TYR: Myth—Culture—Tradition, vol. 2, ed. Joshua Buckley and Michael Moynihan (Atlanta: Ultra, 2004), 25–64.
[1] Je suppose que mes lecteurs n’ont pas besoin que je les convainque de la naïveté de la vision du XIXe siècle, selon laquelle les mythes seraient des tentatives primitives d’explication scientifique. Lawrence J. Hatab traite cela très bien : « L’explication répond à la question pourquoi ou comment une chose est en découvrant une cause antérieure, en recherchant la cause d’une chose jusque dans une (autre) chose profane. Les mythes, d’autre part, doivent être vus pour dévoiler que quelque chose est, la première forme significative que prend un monde, et dont l’arrière-plan est caché. Le mythe n’est donc pas explication mais présentation de l’arrivée/retrait du sens existentiel. Le passage du dévoilement mythique à la pensée rationnelle et scientifique ne peut pas être vu comme une correction du mythe parce que ce fut un passage à une nouvelle intention – la réduction des êtres aux capacités explicatives de l’esprit humain ou des causes naturelles vérifiables. Voir le mythe comme une erreur (une explication fausse) est une incompréhension anachronique de la fonction du mythe ». Voir Lawrence J. Hatab, Myth and Philosophy: A Contest of Truths (LaSalle, Illinois: Open Court, 1990), 23. Voir aussi (en particulier) p. 26. Plus loin dans le même ouvrage, Hatab parle de la Théogonie d’Hésiode, remarquant qu’elle n’est pas, à proprement parler, une histoire de « création ». Les premiers dieux « simplement apparaissent ; on ne nous dit pas d’où [ils viennent] » (p. 64).
[2] Martin Heidegger, Introduction to Metaphysics, trans. Gregory Fried and Richard Polt (New Haven: Yale University Press, 2000), 47.
[3] Voir Alan W. Watts, Nature, Man and Woman (New York: Vintage Books, 1970), 10.
[4] D. H. Lawrence, Studies in Classic American Literature (New York: Penguin, 1991), 22. Italiques omises.
[5] Heraclitus, Fragment 104, trans. Richard D. McKirahan, in A Presocratics Reader, ed. Patricia Curd (Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing, 1996), 40.
[6] C’est essentiellement pour cette raison que la voie du guerrier est aussi un chemin vers la sagesse.
[7] Je souligne que bien que je doive beaucoup à Heidegger, je ne suis pas un heideggérien, et que cet essai n’est pas non plus un essai sur la philosophie heideggérienne. En particulier, je dois avertir le lecteur que mon usage des termes « être », « êtres » et « existence » n’est pas strictement en accord avec l’usage de Heidegger.
[8] Hatab dit ce qui suit : « Le chemin de la philosophie se détourne de l’imagerie sacrée du mythe pour se tourner vers des modèles de pensée empiriques et conceptuels. Ceci entraîne un passage du monde vécu existentiel à des représentations abstraites du monde. Maintenant le monde est mesuré selon des principes d’unité, d’universalité, et de constance, et l’esprit recherche des fondements empiriques et conceptuels qui permettent une sorte de certitude. Ainsi le dévoilement du monde passe d’un processus de divulgation à une sorte de fondationalisme, où la pensée est réduite à une forme et une structure connaissable et déterminée » (Hatab, Myth and Philosophy, 13).
[9] La plus grande partie de ce qu’on appelle « pornographie » constitue un effort concerté pour démystifier le sexe et pour nier ou détruire son miracle. L’ironie et l’irrespect envahissants de la pornographie et sa présentation (qui n’est absolument pas « sexy ») sont en effet une tentative de « moquer » l’effrayant mystère qu’est le sexe, et de le rendre non-menaçant pour les hommes modernes, dont le but est la destruction du mystère, et la réalisation du contrôle et de la connaissance parfaits de la réalité. Ce qui est perçu par les féministes comme la « misogynie » du porno a aussi son origine dans ceci : la femme, en tant que source du mystère, est brutalisée et ridiculisée précisément pour nier son mystère. Une grande partie de ce qu’on appelle « science » est en fait de la pornographie. Un scientifique qui dit à des jeunes : « Il est stupide de croire qu’il y a quelque chose de mystérieux dans la foudre : c’est simplement une décharge électrique atmosphérique » n’est pas moins pornographe qu’un Larry Flynt, qui dit aux même jeunes : « Il est stupide de croire qu’il y a quelque chose de mystérieux dans le vagin : c’est juste une chatte ».
[10] J’ai emprunté le terme de « région » à la phénoménologie d’Husserl, mais mon idée d’une région a peu en commun avec celle de Husserl. En réalité, le terme que Husserl utilise est « essences régionales ». Celles-ci représentent des divisions fondamentales dans la réalité elle-même. Leur caractère fondamental est démontré par le fait que les différences entre elles sont qualitatives, par opposition aux quantitatives (c’est-à-dire qu’elles diffèrent en genre, plutôt qu’en degré). Deux légumes – une laitue et un concombre, disons—ne diffèrent pas en genre, et appartiennent ainsi à la même « région ». Mais un chien et un concombre ne sont pas seulement très différents, elles sont d’un genre fondamentalement différent. Tout comme un concombre et un cristal de quartz. Ainsi, nous pouvons facilement identifier trois régions correspondant à une division traditionnelle, venant du sens commun : animal, végétal, et minéral. Mes régions sont aussi des « divisions » à l’intérieur de la réalité, mais mon concept d’une région est plus ouvert, comme cela deviendra rapidement apparent.
[11] Bien sûr, les matériels à partir desquels nous créons les objets sont, en fin de compte, naturels. Mais quand nous contemplons un objet en tant qu’objet, ce n’est pas la dimension de leur être qui nous est donnée.
[12] Cependant, il faut noter qu’il y a traditionnellement des dieux des activités humaines, par ex. des métiers humains. Il suffit de penser aux diverses divinités associées aux forgerons et au travail des métaux, comme le Goibniu irlandais, le Gofann gallois, le Vulcain latin, et le Héphaïstos grec. Dans la mythologie indienne nous rencontrons Tvástr et Vishvakaram (celui qui « accomplit tout »). Très souvent de telles divinités non seulement jouent un rôle dans la création, mais sont aussi les enseignants de savoir-faire à l’humanité. Le meilleur exemple d’une telle figure serait probablement l’Hermès grec. La « source » de ces déités semble donc être, du moins en partie, l’intuition du caractère merveilleux des arts par lesquels nous transformons la nature. Ils sont supposés requérir une origine transhumaine pour pouvoir être explicables.
[13] Cependant, comme je l’ai suggéré plus haut en mentionnant Jung, il peut y avoir certaines structures innées qui déterminent, à un degré quelconque, la manière dont nous personnifions ou décrivons les dieux. N.B.: Dans la réalité nous pouvons « remarquer » les ondes sonores sans les entendre. Leurs vibrations peuvent être vaguement perçues par le sens tactile. S’il existe quelque chose comme un « sens » par lequel nous devenons conscients du divin, la présence du divin pourrait-elle aussi enregistrée par les autres sens, même vaguement ? Je pense que c’est une possibilité et, à nouveau, le sens tactile semble être impliqué. Je pense à des phénomènes comme quand on a la « chair de poule », ou quand on sent ses cheveux se dresser sur sa tête. De telles choses arrivent quand les individus ont un contact avec l’« étrange », et souvent elles arrivent même en l’absence de toute conscience cognitive d’une présence surnaturelle.
[14] Cf. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. Werner S. Pluhar (Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing, 1996), 28 (Bxxvi–Bxxvii). Mon appel à Kant n’est pas destiné à suggérer qu’il aurait été en sympathie avec ma phénoménologie des dieux. Il ne l’aurait très certainement pas été. Kant divise la connaissance humaine en sensibilité (perception) et compréhension (pensée), et affirme que les « phénomènes » sont des objets tels que perçus par les cinq sens. Cependant, l’expérience du divin décrite ici ne semble appartenir ni à la sensibilité ni à la compréhension, mais semble plutôt être à cheval sur les deux. Ainsi, mes « apparitions phénoménales » des dieux ne doivent pas être comprises au sens kantien des perceptions sensorielles (ce que Kant appelle Anschauungen).
[15] L’ouvrage d’Usener sur lequel Cassirer se base principalement est Götternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung (Bonn, 1896).
[16] Ernst Cassirer, Language and Myth, trans. Susanne K. Langer (New York: Dover Books, 1953), 17–18.
[17] Cassirer, Language and Myth, 18.
[18] Usener, 290f. Cité dans Cassirer, Language and Myth, 18. La traduction est vraisemblablement celle de Langer. Notez le langage très problématique ici : « Tout ce qui nous arrive soudainement comme un envoi du ciel … apparaît à la conscience religieuse comme un être divin » (les italiques sont de moi). Je soutiens que tout ce qui est venu à l’homme de cette manière fut, pour lui, un être divin, un envoi du ciel. Usener parle comme s’il pensait que l’homme agit avec une idée déterminée de l’être divin, et regarde certains objets comme divins parce qu’ils lui ressemblent.
[19] Cassirer, Language and Myth, 19.
[20] Cassirer, Language and Myth, 21.
[21] Elle a été traitée, dans une certaine mesure, dans « Connaître les Dieux ».
[22] Encyclopedia of Indo-European Culture, ed. J. P. Mallory and D. Q. Adams (London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997), 230.
[23] Une autre chose curieuse est que le mot aztèque pour désigner dieu était Teo. Ces similarités linguistiques sont traitées par la plupart des spécialistes réputés comme une pure coïncidence, puisque l’aztèque et le chinois appartiennent à des groupes linguistiques qui se sont développés tout à fait indépendamment de l’indo-européen. Cependant, la coïncidence est frappante.
[24] Mircea Eliade, A History of Religious Ideas, Vol. II, trans. William R. Trask (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 7.
[25] Edred Thorsson, “The Holy,” in Green Rûna (Smithville, Tex.: Rûna-Raven Press, 1996), 41–45. Toutes les références sont faites par rapport à ce texte d’anthologie.
[26] Aussi, vieux norrois vîgja, « consacrer », et vieil-anglais wicca, « sorcière ».
[27] Thorsson, 41. Thorsson poursuit en disant que cela signifie qu’elle est « complètement autre », et s’inspire de Rudolf Otto qui dit que le mysterium tremendum est ce qui est totalement séparé du terrestre ou de l’existence humaine quotidienne. Je ne suis pas sûr de pouvoir le suivre dans cette identification, cependant, si j’ai bien compris la remarque de Thorsson. L’analyse d’Otto concernant l’expérience religieuse tend à avoir un fort préjugé en faveur de l’expérience judéo-chrétienne, dans laquelle le divin est en effet quelque chose de « complètement autre » au sens de transcendant absolument le monde.
[28] Encyclopedia of Indo-European Culture, 25. Cette définition doit être particulièrement excitante pour les heideggériens.
[29] Thorsson, Green Rûna, 42.
[30] La manière dont les objets associés aux divinités acquièrent cette propriété semblable au mana n’est pas une chose que je discute ici. Mon analyse concerne seulement la manière dont le divin est « remarqué » pour la première fois dans le monde. J’hésite à utiliser le terme « mana » à cause de son association avec la théorie anthropologique totalement laïque et réductrice, mais je ne connais pas de meilleur terme.
[31] Le latin profanum signifie littéralement « devant le sanctuaire ». Il désignait le sol ordinaire en-dehors de l’enclos d’un lieu sacré. Hatab écrit : « Pour l’esprit mythique . . . le profane est ce qui est dépourvu de signification, le sacré est ce qui possède une signification ». Hatab, 23.
[32] Thorsson, Green Rûna, 42.
[33] Thorsson, Green Rûna, 43.
[34] Thorsson, Green Rûna, 43.
[35] De la racine proto-indo-européenne *sakros (par ex., « sacré ») vient le tokharien A sâkär signifiant « merveilleux, heureux, de bon augure ». Le tokharien B sâkre signifie « merveilleux, heureux, béni, de bon augure ».
[36] Et, pourrais-je ajouter, le banal « hi ! » d’aujourd’hui ne vient-il pas de hail/heil ?
[37] La raison pour laquelle eidos est traduit par Forme plutôt que par le plus naturel « Idée » est simple. « Idée » suggère quelque chose de subjectif, alors que les Formes de Platon sont des entités objectives existant dans une dimension séparée, non-spatio-temporelle.
[38] Plato, Symposium, trans. Alexander Nehemas and Paul Woodruff, in Plato: Complete Works, ed. John M. Cooper (Indianapolis, Indiana: Hackett Publishing, 1997), 493.
[39] Plato, Parmenides, trans. Mary Louise Gill and Paul Ryan, in Plato: Complete Works, 366.
[40] Voir le livre de Mitchell H. Miller, Plato’s Parmenides: The Conversion of the Soul (University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1991), dans lequel cette thèse est developpée magistralement.
[41] Martin Heidegger, Being and Time, trans. John Macquarrie and Edward Robinson (New York: Harper and Row, 1961), 51.
[42] Le très récent usage de « phénomène » pour signifier « grosse affaire » (comme dans « le phénomène du hula hoop ») n’a évidemment pas grand-chose à voir avec le sens que je discute ici.
[43] Il y a fondamentalement quatre manières par lesquelles Platon décrit la relation entre les Formes et les sensibles : (a) mimesis ou imitation (les sensibles sont des « imitations » des Formes), (b) methexis ou « participation » (les sensibles « participent » des Formes), (c) koinonia ou communauté, et (d) parousia ou présence. A et B représentent plutôt des interprétations naïves et littérales de la relation, qui se révèlent inadéquates à l’analyse (le Parménide est consacré, en partie, à démontrer cela). Mais la koinonia et la parousia sont beaucoup plus intéressantes et défendables. Koinonia signifie que le sensible « communie avec » ou est « en communion avec » la Forme. Parousia indique que nous rencontrons la Forme comme « présente dans » le sensible ; ou, en jargon phénoménologique, la Forme « se rend présente » dans le sensible si le sensible est regardé d’une certaine manière.
[44] Plato, Parmenides, p. 365.
[45] Les principaux témoignages sur cela viennent d’Aristote. Voir la Physique (209b 13–6) et la Métaphysique (I.6). Il y a aussi un certain nombre de livres récents par des spécialistes de Platon et traitant de ce sujet. Voir Hans Joachim Kramer, Plato and the Foundations of Metaphysics, trans. John R. Catan (Albany: State University of New York Press, 1990) ; et Giovanni Reale, Toward a New Interpretation of Plato, trans. John R. Catan (Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 1997).
[46] La « divine figure » du Démiurge dans le Timée, qui crée le monde sur le modèle des Formes éternelles, était reconnue comme un simple procédé poétique, même par les membres de l’Académie de Platon.
[47] Et aussi, faut-il ajouter, en paraissant suffisamment religieux pour éviter le sort de Socrate. Celui-ci fut accusé de deux crimes : corrompre la jeunesse, et ne pas adorer les dieux de la cité.
[48] Néanmoins, il n’est pas sans mythe, comme le sait n’importe quel étudiant des dialogues. Platon interrompt très souvent la discussion dans un dialogue pour permettre à Socrate, ou à quelque autre personnage, de présenter un mythos. Mais les mythes de Platon cadrent tous avec la conception du XIXe siècle concernant la nature des mythes : c.-à.-d. qu’ils sont tous des « récits probables » qui ont une fonction explicative. Ce sont essentiellement des substituts à l’explication scientifique. Cela ne veut pas dire qu’ils n’expriment pas très souvent des vérités profondes, mais Platon emploie le mythe quand aucune réponse « rationnelle » n’est disponible.
[49] En réalité, dans la République, Socrate déclare explicitement que les Formes sont connaissables. Mais ceci est un exemple de l’ironie socratique. Au paragraphe 516b, son évadé de la caverne fixe directement le Soleil, mais il est impossible de faire cela longtemps sans être aveuglé. L’implication est que la Forme du Bien (symbolisé par le Soleil), n’est pas non plus connaissable directement ou pleinement. Ceci s’applique probablement aux autres Formes, comme cela est suggéré par certains des autres dialogues.
[50] Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, trans. Walter Kaufmann (New York: Penguin Books, 1978), 25.
[51] Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, 27.
[52] The Selected Letters of D. H. Lawrence, ed. Diana Trilling (New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1958), 129.
[53] Je dois cette analogie à Joseph Campbell, qui l’exprima dans un cours public au début des années 1970. A ma connaissance, le cours n’a été publié que sous forme de CD : « Confrontation de l’Orient et de l’Occident dans la religion » (Joseph Campbell Foundation, 1996).
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2011/12/l%e2%80%99appel-aux-dieux-la-phenomenologie-de-la-presence-divine/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/06/clearycover.jpg
00:05 Publié dans Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dieux, traditions, paganisme, panthéon, panthéisme, mythologie, divin |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Abécédaire « Céline »
 Le blog "Les 8 plumes" a décidé de rendre hommage à Céline sous la forme d'un abécédaire :
Le blog "Les 8 plumes" a décidé de rendre hommage à Céline sous la forme d'un abécédaire :Florilège passionné consacré à un auteur admiré. Les éditions Plon ont lancé avec succès, depuis de nombreuses années, la collection des Dictionnaires Amoureux et je rends hommage à cette initiative foisonnante. En cette fin d’année du cinquantenaire de la mort de Céline, que notre « courageux » Ministre de la Culture a refusé de célébrer (et pourtant l’ancien auteur d’Une Mauvaise Vie a rencontré aussi, plus modestement certes, avec sa plume, un cortège d’indignation…), je souhaitais rendre une inclination personnelle à mon auteur de prédilection, dont je connais et mesure en permanence les écarts insupportables inscrits dans les pamphlets de 1937/1942, mais qui occupe, pour moi et à jamais, une place éminente dans les Lettres Françaises assortie d’un itinéraire tellement hors norme que l’on ne peut approcher son œuvre et sa vie dans la simplification ou le jugement hâtif…
A
Lucette Almanzor : Le 20 juillet 2012, cette Grande Dame, atteindra son centenaire. Danseuse et chorégraphe, elle a accompagné Céline dans l’Allemagne en flamme et en son exil forcé au Danemark. Elle a épousé Céline en 1943 et elle l’a accompagné jusqu’à sa mort avec tendresse, bienveillance et acuité. Elle est la légatrice pugnace des oeuvres de Céline et elle a toujours défendu avec constance et autorité la mémoire du Reclus de Meudon et elle en a été aussi la Muse Inspirée, car le personnage de Lili, de la trilogie Allemande (D’un Château L’autre, Nord et Rigodon), pose en permanence son charme de pas chassé…
Respect absolu à Lucette et si les « 8 plumes » ont du mal à se retrouver en déplacement, rendre visite à Lucette à Meudon serait une initiative exceptionnelle !
Arletty : La « conscrite » de Courbevoie, née comme Céline en fin de dix-neuvième siècle, a aussi vécu « une fin d’Occupation » compliquée avec la justice de son pays : « Je ne suis pas très résistante et si mon coeur est à la France, mon cul est à moi ! » dira t-elle…Elle est toujours restée fidèle à la fougue et à l’indépendance de Céline et Henri Godard, dans sa biographie de 2011, a exhumé une jolie photographie où l’on découvre Céline, Arletty et Michel Simon, en joie, assistant aux répétitions des élèves de Lucette.
Marcel Aymé : Un homme de Montmartre fidèle à Céline, par intermittences certes, mais qui a reconnu son génie et son élan et qui rendait visite régulièrement à l’écrivain en ses dernières années, cela ne s’oublie pas. Relire Uranus nous rapproche de la Trilogie Allemande Célinienne.
B
Bardamu : Personnage central et flamboyant, quasi épique, de Voyage au bout de la Nuit, qui reste dans les mémoires de manière intacte et permanente et qui doit beaucoup, dans ses élans et doutes à Céline lui-même…
Bébert : chat emblématique de Céline et personnage à part entière de la Trilogie Allemande, que je recommande à Véronique (des 8 plumes), amoureuse également des câlins félins ; la tendresse de Lucette, qui recherche prioritairement à nourrir Bébert en Allemagne du Nord sous les bombes infernales, ne pourra laisser insensible notre organisatrice dynamique et structurante du blog.
Bulletin Célinien : Depuis trente ans, sans relâche et avec une passion continue alliée à une érudition méritoire et inlassable, le Bulletin Célinien et son Directeur : Marc Laudelout, à Bruxelles, analyse, décortique et modernise la connaissance de Céline. Abonnez-vous au Bulletin Célinien pour 11 numéros par an (50 euros au total) et vous réaliserez un investissement culturel intelligent pour Noël…
C
Elizabeth Craig : Danseuse, dédicataire de Voyage au bout de la nuit et passion enflammée de l’écrivain, qui a tenté de la retrouver aux Etats-Unis : exprimer un Amour aussi puissant pour le désenchanté misanthrope qu’est Céline signifie qu’Elizabeth se voyait vraiment inspirante et attendue…
D
Destouches : Louis Destouches, état civil réel de Céline, et que l’on retrouve dans les Carnets Intimes du Soldat Destouches, magnifiquement illustrés par Tardi (remarquable connaisseur de Céline), qui contribuent à dévoiler précisément et directement les désespoirs, détresses et douleurs du combattant poilu du front de 14. Céline a été gravement blessé en 1914, lors d’une mission pour laquelle il était volontaire et à 20 ans, sa vie sera fracturée à jamais. Qui ne comprend pas le drame de 14 ne peut lire et cerner les itinéraires Céliniens…
E
Essai médical (avec spéciale dédicace à Benoît, notre médecin littérateur des 8 plumes, qui apprécie Céline et qui a consacré une chronique percutante sur l’hommage rendu par Bukowski à Céline, ouvrage que j’ai eu plaisir à découvrir, merci à lui)…
Céline a consacré sa thèse de médecine, qu’il a préparée par la voie spéciale réservée aux anciens combattants, à Philippe Ignace Semmelweis, pionnier des médecins hygiénistes et qui a beaucoup influencé la construction future de la médecine du travail. Céline s’est toujours tenu à une morale rigoureuse sans alcool, sans tabac et sans café, considérant que l’ouvrier Français trouvait, avec le débit de boisson, un allié du patronat et il reprenait ainsi les théories de syndicalistes de l’époque (comme Jules Durand, le Havrais célèbre tombé dans la démence après avoir voulu freiner l’expansion des cafetiers…) pour lesquels les débits de boisson représentaient « l’Assommoir du Peuple », selon la formule de Zola…
F
Flaubert n’a jamais été à proprement parler un modèle pour Céline, mais il admirait sa volonté de création stylistique et de perfection. Il lui rend cependant hommage en déclarant qu’il a voulu, avec ses livres, « créer une petite musique reconnaissable et différente » ; pour qui lit et s’enivre de Céline, cette « musique là » se repère aisément.
Hervé, des 8 plumes, écrit avec un style pénétrant et riche et il ne tient qu’à lui (mais je suis certain que cela se concrétisera) de mettre en scène ce talent et que de futurs lecteurs apprécient sa veine inspirée…
G
Gaston Gallimard : un double G à l’époque du triple A : plus prosaïquement, les « engueulades et insultes » de Céline à Gaston participent de l’histoire littéraire. On y retrouve, au milieu d’injures trouvailles (qui ont inspiré selon les dernières réflexions Hergé pour les jurons d’un célèbre capitaine…), une affection sincère de Céline pour son deuxième éditeur (le Voyage avait été refusé par Gallimard puis fut édité par Denoël…) et une récompense réelle, reconnue par Céline, pour faire partie du cortège des auteurs à la couverture nrf.
Henri Godard, biographe accompli de Céline, accompagnateur investi des éditions des oeuvres complètes de Céline dans la Pléiade et surtout organisateur de la Correspondance intense de l’auteur, en cette même collection, qui constitue une référence de l’histoire littéraire et de l’histoire Européenne de la première moitié du XXème siècle. Surtout Henri Godard sait apprécier et admirer Céline sans oublier son parcours antisémite, et il donne des arguments fiables pour scinder le génie littéraire du parcours contestable, parfois même insoutenable, de l’auteur.
H
Milton Hindus : Américain, admirateur de Céline, qui va correspondre avec lui et le rencontrer en son exil au Danemark. Rencontrer un lecteur, juif de surcroît, représente pour Céline une forme de réhabilitation…La rencontre au Danemark se déroule cependant difficilement et le caractère d’imprécateur et entier de Céline n’aide pas à la confrontation, et, la découverte par Milton Hindus des pamphlets a certainement contribué à refroidir une affection naissante qui restera balbutiante… Milton Hindus a publié en 1950 un livre appelé « The Crippled Giant », traduit en France en 1951, sous le titre insipide de « Céline tel que je l’ai vu » aux éditions de l’Herne, par ailleurs éditeur de deux albums Céline admirables, que je vous recommande. « Cripple » se traduit en Français par handicapé, boiteux, infirme, rhumatisant, paralysé, et au sens propre comme en ironie, on imagine donc que l’image laissée ne fut pas celle que l’admirateur avait en perspective…
I
Erika Irrgang : Etudiante allemande que Céline a rencontrée en 1932, avant sa consécration littéraire due au « Voyage ». Comme Céline, Erika a connu la misère et a décidé d’en sortir à tous prix. Chez elle, selon Henri Godard, « le génie est une combinaison de folie et de roublardise » et pour Céline, il faut du vice, « de la roublardise », pour se libérer du romantisme… Autant dire que les rapports entre eux ont été simples, physiques, directs, mais Céline correspondra avec elle, sur une longue période, pour qu’elle conserve la maîtrise de son corps et il la pousse par exemple à utiliser le sexe « comme une arme et non comme un asservissement ». Céline devient hygiéniste, même en l’intimité…
J
Karen Marie Jensen : Danseuse de music-hall (ah les danseuses et Céline, cela mérite un chapitre à part où l’on partirait du plaisir magnifié des sens en mouvement pour aussi tomber, par instants, dans le fétichisme voyeur…), qui rencontre Céline au moment où sa carrière littéraire se construit et qui conservera avec lui des liens importants, notamment pour ses opérations de dépôt d’économies dans un coffre de banque à Copenhague, ce qui permet de cerner aussi les raisons personnelles qui ont conduit Céline, non sans courage dans les ruines Allemandes, à choisir le Danemark comme pays d’exil.
Ernst Jünger : Il faut lire les journaux de guerre d’Ernst Jünger parus dans la Pléiade, indispensables pour comprendre les relations franco-allemandes déchirées puis cicatrisées et devenues « référentes Européennes » au XXème siècle. Mais les deux hommes, anciens combattants de 14, ne se sont pas appréciés et Jünger, bien élevé, ne pouvait admettre les excès et les décalages incessants de Céline. Et pourtant ces deux là écrivent dans la même veine : celle du pessimisme sur le genre humain mais aussi sur la lucidité d’ouvrir en permanence des lueurs d’espoir. Je ne sais si Yves, des 8 plumes, a déjà lu Ernst Jünger, mais comme j’apprécie fortement ses chroniques toujours inventives et avides de nous faire découvrir de nouveaux talents, je recherche modestement ici à l’imiter…
K
Milan Kundera : L’auteur a proposé une définition de la sagesse dans le roman : « il y a dans l’essence de la fiction quelque chose qui empêche le romancier de réduire un personnage, sitôt qu’il prend quelque importance, à la caricature que ses préjugés lui en feraient faire dans un autre cadre ». Il n’y a pas de plus belle définition inspirante pour caractériser le romancier Céline.
L
Marc Laudelout : J’ai conversé par courriels avec cet homme de référence et que j’estime fortement, inlassable chercheur et découvreur de nouvelles réflexions et archives exhumées sur Céline ; son bulletin constitue une mine d’informations indispensable pour tout amateur éclairé.
Robert Le Vigan dit La Vigue : Acteur reconnu dans les Années Trente, il a, comme Céline, choisi des engagements contestables et il va traverser avec l’auteur, Lili et Bébert, l’Allemagne en flamme, dès 1944, et s’intégrer comme un personnage illustre et décalé dans la Trilogie Allemande. Dans Rigodon, on apprend que La Vigue s’isole et recherche la fuite individuelle plutôt que la solidarité avec le couple Destouches et Céline regrette et fustige cette fuite, son style ici devient sang… Mais l’affection perdurera… Le Vigan s’exilera en Argentine et sera appuyé financièrement par Arletty et Jean-Louis Barrault jusqu’à la fin de ses jours.
André Lwoff : Prix Nobel de Médecine avec Jacob et Monod, grand admirateur de Céline, qui a cependant reconnu que la thèse de médecine de l’écrivain comportait des insuffisances de rigueur biologique. Quand il entend le souffle sulfureux de Bagatelles pour un Massacre, où Céline établit de pseudo statistiques nauséabondes sur le nombre comparé de morts juifs et non juifs dans la guerre de 1914, cette absence de rigueur lui reviendra comme une lancinante habitude…
M
Curzio Malaparte : L’auteur de Kaputt, admirateur de Céline, que je relis en ce moment et que je chroniquerai en janvier, a décidé de mettre une partie de ses droits d’auteur à Céline, qu’il savait en difficulté financière lors de son emprisonnement au Danemark en 1946. Céline s’est dit touché par « ce geste chaleureux et fraternel » : ces moments là ne s’oublient pas.
Thorvald Mikkelsen : Avocat de Céline au Danemark : Céline lui doit sa non extradition en la France déchaînée par les excès de l’épuration, de 1945, où il aurait pu connaître le peloton d’exécution pour « intelligence avec l’ennemi » (ce qui est historiquement faux car Céline a toujours agi seul et sans aucun relais et il avait en haine tenace le genre humain en général, refusant avec excès souvent toute compromission). Mikkelsen lui a permis d’utiliser sa maison du Danemark du Jütland pour passer, après une année d’emprisonnement, un exil difficile et douloureux, mais bienveillant et surtout porteur de renouveau littéraire puisque germera en cette période les prémisses de la Trilogie Allemande.
N
Marc-Edouard Nabe : Un grand écrivain, d’abord et définitivement. Un admirateur de Céline inspiré, cultivé et profond. Un indépendant qui s’autoédite et dont on peut acheter les livres par internet ou dans des magasins alimentaires autour de son quartier Parisien, et un tel courage dans la réalité économique contemporaine force le respect. Un livre écrit en hommage à Lucette, affectif et reconnaissant. Un livre, pour moi le meilleur livre lu l’an dernier, et qui a été finaliste du Renaudot, L’homme qui arrêta d’écrire. Il n’aimerait pas les comparaisons mais son indépendance farouche, son parcours jugé souvent sulfureux, ses passions, son érudition, sa volonté permanente de tout sacrifier au style constituent pour moi des références Céliniennes majeures que je ne peux qu’admirer. Et en plus « bon sang ne saurait mentir », il vient filialement du grand jazz…Alors cet homme, je ne peux que l’aimer !
Roger Nimier : « Cavalier de deuxième classe Nimier », c’est ainsi qu’il se présentait à Céline, qu’il appelait le “Maréchal des Logis Destouches” : Roger Nimier, jeune auteur prometteur et de talent, contribuera fortement à réinsérer Céline dans l’actualité littéraire et surtout à crédibiliser son retour en France, alors que la critique le fustigeait et ne voyait en lui que l’auteur égaré des Pamphlets. Quand je relis Nimier, je retrouve la qualité corrosive et l’éclat dynamique et fougueux de la prose de Caroline, à qui j’adresse les pensées affectueuses d’un certain ex nommé Frédéric…
O
Jacques Offenbach : Céline ouvre pleinement ses sens à la chorégraphie, d’abord, puis à la musique ensuite. Il a passé son enfance passage Choiseul, quartier commerçant puis surtout quartier des théâtres lyriques. Précisément le théâtre des Bouffes Parisiens d’Offenbach dégage une entrée des artistes qui ouvre sur le passage même ; on peut donc imaginer que les rencontres fugaces et éphémères avec les danseurs et musiciens ont pu creuser l’inspiration de l’écrivain.
P
Gen Paul : Peintre Montmartrois, grand ami de Céline, qui même après sa rupture consommée avec l’artiste lui conservera toute sa vie une indéfectible fraternité. Ils ont fait ensemble les quatre cents coups et leur invitation à l’Ambassade d’Allemagne, en pleine Occupation, où Gen Paul va caricaturer Hitler est restée dans les annales. Gen Paul sera rebaptisé Jules dans le roman de Céline, Féerie (merci de dire Féerie et non Féérie comme cela est souvent employé à tort, féerie vient de fée…) et la figure négative donnée au personnage est apparue comme un acte d’hostilité. Devenir l’ami de Céline se méritait mais cette amitié ouvrait les portes au foisonnement culturel et à une ambiance inimitable ; la conserver nécessitait un soutien inébranlable, total et absolu (qui a dit manipulatoire ?…) Marie-Florence associe à la qualité de chroniques inspirées, le sens permanent de l’image : quand il y aura une rétrospective Gen Paul sur Montmartre, je suis certain qu’elle pourra suggérer en touches appropriées les soubresauts du Paris des Années Trente.
Evelyne Pollet : Lectrice avide et assidue du Voyage, elle entretient une correspondance émue avec l’auteur. Ils finissent par se rencontrer et comme le décrit Céline très directement « en vingt minutes il fut décidé que la jalousie était un sentiment honteux et l’amour un mythe, je la portais sur le lit et nous fûmes unis… ». Evelyne habitait à Anvers et ils visitent ensemble les musées de la Ville ; Céline est fasciné par les « Dulle Griet », les « figurations des violences de la guerre » de Bruegel, si vous me permettez cette traduction personnelle du néerlandais, et du coup il s’enflamme (sa grand-mère paternelle était originaire du Nord) : « Flamand par mon père et Brughelien par instinct, j’aurais du mal à ne pas délirer entièrement du côté du Nord… ».
Marcel Proust : Marc-Edouard Nabe admire Céline et Proust. Humblement je suis passionné de Céline, je n’ai pas encore la connaissance assouvie de Proust. Céline ne cachait pas son intérêt pour le Grand Marcel mais il a toujours pris soin de ne s’inféoder à personne. En exil au Danemark, il cite cependant l’auteur du Temps Retrouvé : « dure est la loi inévitable qui veut que l’on ne puisse s’imaginer que ce qui est absent ».
Pamphlets : Il n’est pas possible de parler de Céline sans avoir en permanence le reflet des pamphlets. J’ai déjà dit dans une chronique en octobre dernier, en notre cher blog, que je souhaitais enfin que l’on puisse parler de Céline sans se voir en permanence jugé « douteux » ou « intolérant ». J’écris souvent sur le sujet et cet abécédaire n’intègre que des fragments de réflexion… Il reste que les trois pamphlets chronologiquement écrits : Bagatelles pour un massacre ; L’école des cadavres et Les beaux draps, entre 1937 et 1942, constituent des îlots de racisme et des textes proches des publicistes anti-juifs de l’entre deux guerres. Si l’on se gardera d’un jugement définitif, car nous n’avons pas vécu la période, et que l’on considèrera certes que l’antisémitisme constituait une opinion alerte et récurrente en cette époque, je ne peux pas, nous ne pouvons pas, cautionner les atmosphères haineuses, assombries en permanence, délirantes souvent de ces brûlots où l’on trouve encore parfois des veines et flambées enivrantes d’écriture mais au service d’un « romantisme d’assainissement » comme disait Lucien Combelle, écrivain collaborationniste, dans cette expression terrifiante qui a développé toutes les douleurs de la shoah… Oui Céline a été antisémite et l’est certainement resté. Non il n’a jamais été milicien et n’a jamais participé aux compromissions abjectes des dénonciations. Est-ce suffisant pour l’exonérer, certes pas. Les pamphlets devront être un jour réédités au travers d’une édition de mise en perspective historique ; aujourd’hui ils sont trouvables sur les sites internet des groupuscules fascisants et cette exploitation se voit intolérable. J’ai acheté chez un bouquiniste Lyonnais en 2003 une édition originale de Bagatelles pour un massacre (pardon à mon épouse qui m’en a voulu un certain temps…) et cela fut une épreuve douloureuse : le livre associe méchanceté, approximations et haine directe. C’est en ce sens que le cinquantenaire de la mort de Céline aurait pu contribuer à une analyse sans faiblesse mais apaisée. Pour aller plus loin (vous connaissez ma marque de fabrique) sur ce sujet, je vous recommande vivement le livre d’André Derval : Accueil critique de Bagatelles pour un massacre, que l’on se procurer auprès du Bulletin Célinien à Bruxelles, remarquable synthèse critique sur la perception du livre en 1938 et qui nous permet de saisir les ambiances de l’époque sur l’antisémitisme très/trop facilement assimilé à une opinion comme une autre (réalité à méditer de nos jours où certains propos sont trop patiemment entretenus et où l’on ne fustige plus certains dérapages…).
Points de suspension : Vous l’avez remarqué, je vénère les points de suspension qui laissent le lecteur imaginer la suite et la fin et permettent de placer le débat en ouverture perpétuelle. Céline use et abuse des points de suspension jusqu’à déraciner le style classique, mais tout cela était voulu : il fallait désacraliser le style pour imposer « une nouvelle petite musique »… Et cette musique se savoure avec acuité et sensibilité, à l’image des chroniques de Cécile, toujours touchantes et pétries de tendresse.
Q
Raymond Queneau : Un des rares auteurs à avoir écrit dans les années cinquante, à une époque où il était de bon ton de dénigrer Céline, ce soutien apprécié : « malgré les difficultés de la vie publique et privée, Céline a continué son œuvre avec Féerie pour une autre fois, où l’on retrouve l’incontestable vigueur d’expression de ses premiers livres ».
R
Ludwig Rajchman : Directeur de la Section d’hygiène de la Société des Nations à Genève (l’ancêtre de l’ONU créé par le Traité de Versailles), c’est à lui que Céline doit une nomination dans une Institution Internationale qui lui permettra de parcourir le Monde et notamment de pénétrer les Etats-Unis (oh les pages sur les USA dans le Voyage, que de merveilles…). Il rapportera à son mentor et responsable des chroniques avisées sur les insuffisances ou éléments intéressants concernant la médecine préventive au travail et surtout sur la nécessité d’intégrer l’hygiène en permanence dans l’acte de travail pour prévenir épidémies et pandémies. De Rajchman, Céline a dit « il m’aimait comme un fils et il m’a fait voyager ». Comparaison n’est pas raison et même si la vie a créé des éloignements, Rajchman (de confession juive) n’a jamais renié son protégé et son fils spirituel a toujours été reconnaissant de son enseignement. Qui a dit que Céline était complexe et difficile à suivre ?
S
Jean-Paul Sartre dit « l’Agité du bocal » : J’ai passé le Bac Français en 1980, l’année de la mort de Sartre et l’année où tous les professeurs post soixante huitards vénéraient les réflexions de l’homme qui a soi-disant créé l’existentialisme, dont j’ai toujours eu du mal à cerner le sens, mais je suis certain qu’Hervé va m’apporter son éclairage. J’ai apprécié, quoique modestement, les romans de Sartre, notamment Les Mains sales, mais je n’ai jamais adhéré aux positions du philosophe ni apprécié ses engagements. Il s’est trompé en permanence et notamment sur le génocide Cambodgien (erreur la plus grave, même si la fin de sa vie l’a vu renouer avec la générosité d’accueil des « Boat People »), sur le terrorisme de la Bande à Baader, sur les dictatures communistes à qui il rendait visite avec enthousiasme… Mais je n’ai pas à juger le parcours de l’homme, sinon je ne serai pas cohérent avec ma position sur Céline. Ceci dit, Sartre va insulter Céline, en 1945, en considérant que les pamphlets ont été écrits par vénalité, par soucis de plaire aux Occupants et même pour se faire « payer » par eux… Ces âneries monumentales, qui ne résistent pas à l’examen d’un Céline toujours en refus de compromission et anticonformiste, valurent à Sartre une réponse cinglante de Céline intitulée : « à l’agité du bocal »… J’attends la position du Ministère de la Culture pour le cinquantenaire de la mort de Sartre…
T
Jean-Louis Tixier-Vignancour : Avocat au charisme reconnu et accompagnateur de la France Nationaliste, pleurant les Colonies perdues : il a été l’avocat des anciens de l’OAS et de l’Algérie Française, compagnon de route et mentor du naissant Jean-Marie Le Pen… Un pedigree d’avocat qui n’aide pas à rendre Céline sympathique qui l’a choisi comme défenseur… Céline, en fait, ne connaissait pas l’avocat, en son exil au Danemark, mais il lui doit le génie de l’illusion : Tixier a fait signer par le Ministre de la Justice une décision d’amnistie pour faits « d’indignité nationale » (cf. écriture des pamphlets) du fait de services rendus à la nation pour engagement lors du premier conflit mondial d’un certain Monsieur Louis Destouches, sans aucunement faire référence à Céline… Et voilà comment Céline a pu revenir en France, amnistié…
U
Général d’Urbal : Chef de section de Céline lors des premiers engagements de 14 et symbole du militaire généreux avec ses hommes et partageant leurs souffrances : une espèce rare pour Céline, farouchement devenu antimilitariste et qui – je l’ai déjà dit en octobre – préférait « tout sauf la guerre », ce fameux « tout » qui a bouleversé ses engagements…
V
Voyage au bout de Céline : Lisez ou relisez le Voyage mais lancez-vous dans la conquête de la Trilogie Allemande et notamment de Nord, pour moi le meilleur livre existant dans la littérature française du XXème siècle, plongez-vous dans la noirceur magnifiée et dans les délires ou élucubrations des personnages de Mort à Crédit et passez un moment bref comme intense en compagnie de la détresse des poilus avec Casse-Pipe.
W
Horace Walpole : Citation de cet auteur, un peu méconnu de nos jours (il me fallait bien trouver un « W », déjà que je n’ai pas trouvé de « X »…) : « le monde est une comédie pour ceux qui pensent et une tragédie pour ceux qui sentent ». Céline a toujours préféré sentir que penser et ses romans s’écrivent avec la présence de l’odeur du vécu et du sang et des larmes parcourus par l’âme humaine…
Y
Entretiens avec le Professeur Y : Petit opuscule plein de malice et de décalage de Céline, paru en Folio, et magnifié par un récent livre de Philippe Sollers.
Z
Antonio Zuloaga : Intime de Céline et membre de la fameuse bande de l’entre deux guerres, dite bande de Montmartre, avec Gen Paul et Céline en fers de lance.
Merci pour votre patience et merci pour votre écoute, en cette dédicace à l’adresse de mon écrivain de référence. Merci à Laurent Martinet de l’Express de considérer cette chronique comme décalée de nos obligations du respect des 2000 caractères…
Eric
http://blogs.lexpress.fr/les-8-plumes/, 13 décembre 2011.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 28 décembre 2011
Václav Havel: The “Inner Enemy”
Václav Havel: The “Inner Enemy”
By Kerry Bolton
Ex: http://www.counter-currents.com/
An inner enemy is more dangerous than an outer one, because while he seems to belong, he is actually a kind of alien. An inner enemy is dangerous in two respects: first because of his own activity, and second, because of his usefulness to the outer enemy. . . . After the War, the American occupation of Europe and the despoliation of Europe were made possible only by the Michel-stratum,[1] which hired itself out to the enemy to establish vassal-governments, churchill-regimes, in every province of Europe. During this period between the Second and Third World Wars,[2] the Michel as an American agent is more dangerous than he would otherwise be himself. The reason for this is the advance of History since the 19th century has rendered his whole world-outlook completely useless to him, even for purposes of sabotage, while to the Americans it is still useful as a means of control over Europe. Thus the Culture-diseases of Culture-retardation remains in the body of Europe only because of the American occupation. — Francis Parker Yockey[3]
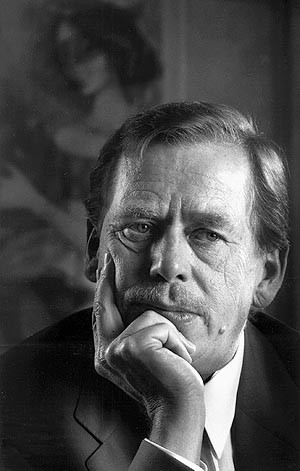 Václav Havel, the last president of Czechoslovakia and first president of the Czech Republic, died on December 18, 2011. His eulogies reveal him to be an excellent specimen for the study of the role of the “inner enemy” in the process of cultural pathology. In Havel we have a particularly devolved example of the Michel element that worked for the spiritual, political, cultural, and economic subjugation of the Western Cultural organism by the forces of cultural parasitism, distortion, and retardation. Indeed, the cultural pathologist can place him in the genus michelus along with such contemporaries such as Boris Yeltsin, Lech Wałęsa, and Mikhail Gorbachev.
Václav Havel, the last president of Czechoslovakia and first president of the Czech Republic, died on December 18, 2011. His eulogies reveal him to be an excellent specimen for the study of the role of the “inner enemy” in the process of cultural pathology. In Havel we have a particularly devolved example of the Michel element that worked for the spiritual, political, cultural, and economic subjugation of the Western Cultural organism by the forces of cultural parasitism, distortion, and retardation. Indeed, the cultural pathologist can place him in the genus michelus along with such contemporaries such as Boris Yeltsin, Lech Wałęsa, and Mikhail Gorbachev.
The most apparent symptoms in identifying an apparently normal human as a member of genus michelus are the accolades received from media pundits and political and plutocratic luminaries, and in particular those directly from the organs of the Culture-Distorter. In this instance, like the much-lauded Gorbachev,[4] Havel receives his acclaim for the role he played in dismantling the Soviet bloc.
That the collapse of the Warsaw Pact was greeted with such acclaim and is remembered as “inspirational” by the Right, from nazis to conservatives, is an indication of the banality of much of the “Right,” which remains oblivious to the Soviet bloc having been the only major force of conservatism in the world, and to the USA being the global harbinger of decay.[5] This American role was recognized not only by Yockey, but also — approvingly — by Trotskyites, many of whom became avid Cold Warriors,[6] and by necon strategists such as Ralph Peters.[7]
Given that the Warsaw Pact was the only geopolitical entity that constrained American global hegemony, Havel’s contribution to its demise is lauded as a great victory for “democracy” and “freedom.” However, those are words that are used by many regimes and systems, no matter what their character, and have been euphemisms since the time of Woodrow Wilson’s Fourteen Points for post-war international reconstruction in the image desired by the US for the subordination of all nations, peoples, and cultures to everything that is conjured by the word “America.”
Havel is said to have been an idealistic opponent of the consumerist ethic, yet what is one to think of an individual who allowed himself to be mentored and patronized by the likes of George Soros and flitted about among the luminaries of plutocracy? Solzhenitsyn did not allow himself to be used in such a manner by the forces of Culture Distortion nor did he succumb to their blandishments. Solzhenitsyn was a mystic, Havel, as will be shown, a seedy Zionist purveyor of cultural syphilis.
Havel’s critique of “The West,” like Solzhenitsyn’s was perceptive, stating: “There is no need at all for different people, religions and cultures to adapt or conform to one another. . . . I think we help one another best if we make no pretenses, remain ourselves, and simply respect and honor one another, just as we are.”[8]
Here was a cultural icon who obviously knew the processes of leveling that were taking place in the world, but who was nonetheless willing to let himself be used in their service, for the sake of nebulous sales pitches like “democracy” and “human rights.” Like the much lauded Gorbachev, Havel became an icon of manufactured dissent in the interests of international capital that pulls the strings behind the façade of “democracy,” and, as will be seen, of the Culture Distorters who had long been fearful of the directions being taken by the descendants of the Black Hundreds, and worried that the Warsaw Pact constituted a new Axis of the type predicted by Yockey in his final essay “The World In Flames.”
The “velvet revolutions” that were instigated, funded, and planned by the Soros network, National Endowment for Democracy, Freedom House, and dozens of others, were a prelude to the same types of revolt that continue to be inflicted upon the former Soviet bloc states and that are taking place under the mantle of the “Arab Spring.”[9]
“Rootless Cosmopolitanism”
The collapse of Czechoslovakia as part of the implosion of the Soviet bloc provides a special example of the role of Culture-Distortion. Other than Culture pathologists such as Yockey, the Soviet leadership following the ouster of Trotsky and the Old Bolsheviks, were fully aware of the destructive nature of cultural nihilism. Ironically, the Soviet bloc stood as the only significant bulwark against what Hitler had termed “cultural bolshevism.” While Yockey’s theory of Culture Pathology[10] shows that the presence of a foreign body in the cultural organism spontaneously creates the phenomena of Culture-distortion, Culture-retardation, and Culture-parasitism; these symptoms can also be consciously pressed into the service of politics.
Kulturkampf is a major part of the world offensives of both plutocracy and Zionism to the extent that at the very beginnings of the Cold War the CIA recruited sundry disaffected anti-Soviet socialists, and in particular Trotskyites, into the Congress for Cultural Freedom to try and subvert the Soviet bloc and impose “American” values over the world in the name of “freedom of artistic expression.” Their favored mediums were Abstract Expressionism and jazz.[11] The Congress was established under the figurehead of Professor Sidney Hook, a “lifelong Menshevik” who had organized a committee for the defense of Leon Trotsky at the time of the Moscow Trials, and a recipient of the Congressional Medal of Freedom from Ronald Reagan. Other Congress luminaries included Bertrand Russell, the pacifist CND guru who had sought a pre-emptive nuclear strike against the USSR in the interests of “peace.” The Congress promoted the type of art that had been exposed as subversive “rootless cosmopolitanism” by Stalin, et al., who correctly perceived it as part of a political offensive.[12]
The program of Kulturkampf against the Soviet bloc can be traced to Trotsky, always a very handy tool for international finance. In 1938 André Breton,[13] Mexican communist muralist Diego Rivera,[14] and Leon Trotsky issued a manifesto entitled: Towards a Free Revolutionary Art.[15] The manifesto was published in the Autumn 1938 issue of The Partisan Review, a magazine that was of significance in the Cold War-Trotskyite offensive. Trotsky, according to Breton, had actually written the Manifesto, which states:
Insofar as it originates with an individual, insofar as it brings into play subjective talents to create something which brings about an objective enriching of culture, any philosophical, sociological, scientific, or artistic discovery seems to be the fruit of a precious chance, that is to say, the manifestation, more or less spontaneous, of necessity. . . . Specifically, we cannot remain indifferent to the intellectual conditions under which creative activity takes place, nor should we fail to pay all respect to those particular laws that govern intellectual creation.
In the contemporary world we must recognize the ever more widespread destruction of those conditions under which intellectual creation is possible. . . . The regime of Hitler, now that it has rid Germany of all those artists whose work expressed the slightest sympathy for liberty, however superficial, has reduced those who still consent to take up pen or brush to the status of domestic servants of the regime. . . . If reports may be believed, it is the same in the Soviet Union. . . . True art, which is not content to play variations on ready-made models but rather insists on expressing the inner needs of man and of mankind in its time — true art is unable not to be revolutionary, not to aspire to a complete and radical reconstruction of society. . . . We recognize that only the social revolution can sweep clean the path for a new culture. If, however, we reject all solidarity with the bureaucracy now in control of the Soviet Union it is precisely because, in our eyes, it represents, not communism, but its most treacherous and dangerous enemy. . . .
The criterion for art given here by Trotsky seems more of the nature of the anarchism of Breton and of the future New Left than of the collectivist nature of Marxism. F. Chernov, whose important statement on the arts from a Stalinist viewpoint will be considered below, was to refer to such art as “nihilism.”
Given that the manifesto was published in The Partisan Review, which was later to receive subsidies from the CIA and the Tax-exempt Foundations as party to what became the “Cultural Cold War,” this Trotskyist art manifesto served as the basis for the art policy that was adopted after World War II by the CIA and the globalists as part of the Cold War offensive.[16] Trotsky wrote Towards a Free Revolutionary Art as a call for mobilization by artists throughout the world, to oppose on the cultural front Fascism and Stalinism, which to many Leftists and communists were synonymous:
We know very well that thousands on thousands of isolated thinkers and artists are today scattered throughout the world, their voices drowned out by the loud choruses of well-disciplined liars. Hundreds of small local magazines are trying to gather youthful forces about them, seeking new paths and not subsidies. Every progressive tendency in art is destroyed by fascism as “degenerate.” Every free creation is called “fascist” by the Stalinists. Independent revolutionary art must now gather its forces for the struggle against reactionary persecution.[17]
While the Congress for Cultural Freedom was established in 1949, and on a more formal basis in 1951, its origins go back to the defender of Trotsky, Professor Sidney Hook, who had established an embryonic movement of similar name in 1938, and who served as the figurehead for the Congress knowingly under the auspices of the CIA.
The Stalinists responded with a vigorous call not only to “Soviet patriotism” but also to the cultural legacy of the Russian people. If one were looking for a Marxist articulation of cultural theory, it would more likely be found coming from the official and semi-official agencies of the USA, rather than those of the Soviet bloc.
In 1949 a major article in the organ of the Central Committee of the Bolshevik party, Chernov condemned the infiltration of cosmopolitanism in Soviet arts, sciences, and history.[18] The article stands as a counter-manifesto not only to the Trotskyites and the “cultural cold war” of the time, but also as an enduring repudiation of modernism and rootless cosmopolitanism as it continues to manifest in the present age of chaos.
Chernov began by referring to articles appearing in Pravda and Kultura i Zhizn (“Culture and Life”), which “unmasked an unpatriotic group of theatre critics, of rootless cosmopolitans, who came out against Soviet patriotism, against the great cultural achievements of the Russian people and of other peoples in our country.” Chernov described this coterie as “rootless cosmopolitans” and “propagandists for decadent bourgeois culture,” while they were “defaming “Soviet culture.” The culture of the “West” is described as “emaciated and decayed,” a description with which any Spenglerian would concur. The “Soviet culture” referred to by Chernov is the classic “great culture of the Russian people” and should not be mistaken as a reference to the “communist culture” that one would have in mind when thinking of the mass and crass propaganda spectacles of Maoist China. By 1949 the highest Soviet authority, whose views Chernov must have been conveying, had perceived that the USSR was the target of broad-ranging cultural subversion: “Harmful and corrupting petty ideas of bourgeois cosmopolitanism were also carried over into the realms of Soviet literature, Soviet film, graphic arts, in the area of philosophy, history, economic and juridical law and so forth.”[19]
It seems that these “rootless cosmopolitans” were stupid enough to believe that they were in a State that was still pursuing Marxian ideas, despite the clear message that had been given during the Moscow Trials a decade previously,[20] along with the virtual extinction of the “Old Bolsheviks.” One, comrade Subotsky had, as presumably a good Marxist, sought to undermine the concept of nationality, and repudiate the idea of the heroic ethos that had become an essential ingredient of Soviet life and doctrine, especially since the “Great Patriotic War.” Hence Chernov wrote damningly of this “rootless cosmopolitan” whose views on culture seem suspiciously Trotskyite:
The rootless-cosmopolitan Subotsky tried with all his might to exterminate all nationality from Soviet literature. Foaming at the mouth this cosmopolitan propagandist hurls epithets towards those Soviet writers, who want “on the outside, in language, in details of character a positive hero to express his belonging to this or that nationality.”[21]
Chernov continued: “These cosmopolitan goals of Subotsky are directed against Soviet patriotism and against Party policy, which always has attached great significance to the national qualities and national traditions of peoples.” Chernov then described an “antipatriotic group” promoting “national nihilism” in theater criticism, this concept being, “a manifestation of the antipatriotic ideology of bourgeois cosmopolitanism, disrespect for the national pride and the national dignity of peoples.”
Chernov identified “rootless cosmopolitism” as part of a specific foreign agenda, which was certainly formalized that year – 1949 – with the founding of the Congress for Cultural Freedom:
In the calculation of our foreign enemies they should divert Soviet literature and culture and Soviet science from the service of the Socialist cause. They try to infect Soviet literature, science, and art with all kinds of putrid influences, to weaken in such a way these powerful linchpins of the political training of the people, the education of the Soviet people in the spirit of active service to the socialist fatherland, to communist construction.
Chernov warned with prescience of what is today called the “cultural cold war” as a part of the “ideological weapon” of encirclement:
The most poisonous ideological weapon of the hostile capitalist encirclement is bourgeois cosmopolitanism. Consisting in part of cringing before foreign things and servility before bourgeois culture, rootless-cosmopolitanism produces special dangers, because cosmopolitanism is the ideological banner of militant international reaction, the ideal weapon in its hands for the struggle against socialism and democracy. Therefore the struggle with the ideology of cosmopolitanism, its total and definitive unmasking and overcoming acquires in the present time particular acuity and urgency.
At the foundation of this “rootless cosmopolitanism” is the spirit of money. the worship of Mammon, and Chernov’s description is again prescient of the present nature of international capital:
The bourgeoisie preaches the principle that money does not have a homeland, and that, wherever one can “make money,” wherever one may “have a profitable business,” there is his homeland. Here is the villainy that bourgeois cosmopolitanism is called on to conceal, to disguise, “to ennoble” the antipatriotic ideology of the rootless bourgeois-businessman, the huckster and the traveling salesman.
Chernov cogently stated precisely the agenda of the “cultural cold warriors” that was about to emerge from the USA: “In the era of imperialism the ideology of cosmopolitanism is a weapon in the struggle of imperialist plunderers seeking world domination.” And so it remains, as will be outlined in the concluding paragraphs.
If any doubt remained as to what Chernov meant by nationalism as the bulwark against international capital, and that Stalinism was an explicit repudiation of Marxist notions of internationalism despite Chernov’s necessary ideological allusions to Lenin, Chernov makes it plain that it is precisely the type of nationalism condemned by Marx that was nonetheless the foundation of the Soviet State of the Great Russians:
National sovereignty, the struggle of oppressed nations for their liberation, the patriotic feelings of freedom-loving peoples, and above all the mighty patriotism of the Soviet people — these still serve as a serious obstacle for predatory imperialistic aspirations, they prevent the imperialists’ accomplishing their plans of establishing world-wide domination. Seeking to crush the peoples’ will for resistance, the imperialist bourgeoisie and their agents in the camp of Right-wing socialists preach that national sovereignty purportedly became obsolete and a thing past its time, they proclaim the fiction of the very notion of nation and state independence.[22]
Chernov showed that the USSR and the Soviet bloc considered their own historic mission not as the center for “world revolution,” the ideal of the Trotskyites, but as the bulwark against one-worldism, and condemned the USA as the homeland of internationalism:
In the guise of cosmopolitan phraseology, in false slogans about the struggle against “nationalist selfishness,” hides the brutal face of the inciters of a new war, trying to bring about the fantastic notion of American rule over the world. From the imperialist circles of the USA today issues propaganda of “world citizenship” and “universal government.”
The Role of Culture Distortion in Czechoslovakia: Charter 77, Plastic People of the Universe
This globalist Kulturkampf was directed with effect against the Soviet bloc. As can be seen from the seminal article by Chernov, the Soviet authorities knew precisely how this was being undertaken, and they remained conscious of it until overwhelmed by these forces. While the intelligentsia, the media, and their wire-pullers voiced their indignation and derision against the philistinism of the Soviet authorities, and their regressive character, and, like the Fascist aesthetic, the supposed “banality” of “socialist realism,” an examination of both the American sponsorship of cultural nihilism and the Soviet understanding of this, shows that the Soviets were correct in their suspicions.
The Czechoslovak Soviet authorities were regarded as ridiculous throwbacks for their actually rather lame efforts to keep their youth from the supposedly wonderful freedoms of their counterparts in the West. The Western liberal conception of art – which is the same as that formulated by Trotsky in his 1938 manifesto – is supposedly apolitical, harmless, a matter of individual taste and choice and other inanities typical of liberalism. However, leading strategists of American global hegemony to the present day are open in their lauding of the USA as both the leading revolutionary[23] state and the role of Culture-distortion in making a nation succumb to the blandishments of what Yockey termed the “ethical syphilis of Hollywood.”[24]
This globalist Kulturkampf in its present-day form has been described by neocon military strategist Ralph Peters, who worked at the Office of the Deputy Chief of Staff for Intelligence, and elsewhere, stating that, “We are entering a new American century, in which we will become still wealthier, culturally more lethal, and increasingly powerful.” Peters outlined a strategy for subverting nations and peoples reticent about entering the “new American century,” by way of Hollywood, pop icons, and the dazzle of technology,[25] imposing a type of soft servitude over the world of the type described in Huxley’s Brave New World.[26] As Peters and Huxley have perceived, youth in particular are unable to resist the temptation of the “soft” option, of ego-driven nihilism and what amounts s to “freedom” from responsibility, in comparison to the spartan regimentation of the Soviet bloc.
The “rootless cosmopolitanism” or Kulturkampf directed against Czechoslovakia centered around “pop” music. The Charter 77 manifesto was drafted and a movement formed after the imprisonment of fans of the rock band, “Plastic People of the Universe.” It is significant that this was catalyst for what became the “velvet revolution.”
The rot that was eating away within the Warsaw Pact was organizationally focused on groups such as Charter 77 in Czechoslovakia and Solidarity in Poland. These groups were instigated and funded by the network of currency speculator George Soros and an array of subversive, largely US-based and Government connected think tanks. When Charter 77 was co-founded by Havel in 1977, its manifesto was published by the Western media by pre-arrangement, in the Frankfurter Allgemeine Zeitung, Corriere della Sera, The Times of London, and Le Monde.[27]
Just how significant this Kulturkampf in the service of globalization is, and not merely as a matter of “free expression,” and individualistic “personal choice” or “taste,” etc., can be seen in the role the band Plastic People of the Universe (PPU) played in serving as a catalyst for the “velvet revolution.” The band is acknowledged as musically “unremarkable” yet its backers ensured that it became politically remarkable. Their origins go back to the Zionist-orchestrated revolt in Czechoslovakia in 1968.[28] The band obtained the assistance of Canadian music teacher Paul Wilson, then resident in Czechoslovakia. They became the “fathers of the Czech musical underground.”[29]
One commentator states that “an entire community of Czech dissidents sprung up around the band.” According to bassist and founding member Milan Hlavsa: “The Plastic People emerged just as dozens and hundreds of other bands — we just loved rock’n’roll and wanted to be famous. We were too young to have a clear artistic ambition. All we did was pure intuition: no political notions or ambitions at all.”[30]
Despite the expressions of naiveté by Hlavsa it was precisely the type of youthful nihilism that the CIA and plutocrats had been promoting in the West in the form of the “New Left” as a means of manipulating pseudo-dissent. It followed the formulae that had been prescribed by the Congress for Cultural Freedom, and which is still utilized.
Although the band’s professional license was revoked by the Government in 1970 they hedged around the regulations, and their music was released in the West. Lyrics for the “non-political” PPU were written by “Czech dissident poet Egon Bondy.”[31] What emerged around PPU was a so-called “Second Culture” or “Other Culture” which played at Music Festivals. There were arrests, but apart from a few, most were released due to “international protests.” Canadian Paul Wilson was expelled. The official indictment accused the bands of “extreme vulgarity with an anti-socialist and an anti-social impact, most of them extolling nihilism, decadence, and clericalism.”[32]
It was in support of this cultural nihilism that Charter 77 emerged as a movement, with Havel as the figurehead, Havel stating that PPU were defending “life’s intrinsic desire to express itself freely, in its own authentic and sovereign way.”[33] Havel began selecting lyrics for PPU. This supposedly “non-political,” innocent, artistic free expression has since been described by The New York Times as being “wild, angry, and incendiary,” and “darkly subversive.” The NY Times enthused that PPU “helped change the future direction of a nation,” stating:
Václav Havel, the music-loving former Czech president and dissident who championed the band’s cause when several members were imprisoned in 1976 for disturbing the peace, credits it with inspiring Charter 77, the manifesto demanding human rights that laid the groundwork for the 1989 revolution. “The case against a group of young people who simply wanted to live in their own way,” he recalled, “was an attack by the totalitarian system on life itself, on the very essence of human freedom.”[34]
It was, stated Bilefsky, “the ultimate rock ’n’ roll rebellion.”[35]
Paul Wilson reminisced that it was through music that the puerile ideals of manipulated Western youth were introduced to their Czechoslovak counterparts:
One of the things that was very marked in the 1960s was that although intellectuals found it very hard to get a hold of books it was very easy for kids to be right on top of things because records were brought in and the music was broadcast over Voice of America and other radio stations. So, there was a very current music scene here, with a lot of knock-off bands and a lot of fans of different groups just the way you’d find them in the West. The other thing, too, is that the Prague music scene, very early, attracted the attention of the western press, because for them the existence of rock bands in a communist country was a sign of change.[36]
Note that the Voice of America and other US agencies were promoting this movement.
Charter 77 & Soros
It was against this background that the Charter 77 Foundation was established in Stockholm. Soros relates that he had funded this since 1981. The movement “sprung into operation inside Czechoslovakia armed like Pallas Athena,” in 1989. Soros hastened to the country, and with Charter founder F. Janouch, set up committees in Prague, Brno, and Bratislava, and “I put $1 million at their disposal.” He then began paying the staffs of the Civic Forum party and the newspaper Lidove Noviny by currency speculation. Soros states that together with Prince Kari Schwarzenberg, a supporter of the Charter 77 Foundation, and acting President Marian Calfa, “we all agreed that it was imperative to have Vaclav Havel elected president by the current rubber-stamp parliament.”[37]
Havel, like Gorbachev, was duly recognized for services rendered. An exhibition in his honor was established at Columbia University in 2006, with support from luminaries such as Soros, George H. W. Bush, Bill Clinton, [38] Richard Holbrooke, et al.[39] Havel served on the Board of Directors of Soros’ Drug Policy Alliance, designed to liberalize laws on narcotics, which might be viewed as part of the Soros agenda for undermining the stability of societies that are targeted for globalization, as part of a “liberal” and “progressive” agenda. One is here again reminded of the use of a narcotic, “Soma,” to keep the citizens docile in Huxley’s Brave New World; another cause that can moreover be portrayed as “radical” and “anti-Establishment,” while serving the “Establishment.” Among members on the “US Honorary Board” are such “progressives” and “humanitarians” as Former Secretary of State George P. Schultz, and former Reserve Bank Chairman Paul Volcker. The “International Honorary Board” includes, apart from Havel, Richard Branson, Sting, and Ruth Dreifuss.[40]
Havel became a member of the globalist elite, in attendance at their international conclaves for reshaping the post-Soviet world. One of these is the Club of Madrid,[41] one of many globalist think tanks that are designed to arrive at consensus on global governance among the self-chosen rulers. The Club of Madrid is a grant-making foundation set up in 2004 to raise funds for causes that promote the plutocratic version of “democracy.”[42] As one would expect, the omnipresent Soros is among the Club’s “President’s Circle of Donors.”[43] Havel was also an “Honorary Chair” of Freedom Now, a globalist organization with a cross-over of membership with the US globalist think tank, the Council on Foreign Relations.[44]
National Endowment for Democracy
Of particular interest is Havel’s association with the Congressionally-funded National Endowment for Democracy (NED), established in 1983 by Act of Congress. Havel is esteemed by NED, an organization intended to take over the role of the CIA in sponsoring “regime change.” NED was conceived by veteran Trotskyites whose hatred of the USSR turned many — including Trotsky’s widow Sedova — into rabid Cold Warriors, and from there into the present clique of neocons. NED was the brainchild of Tom Kahn, International Affairs Director of the AFL-CIO. He was a veteran of the Shachtmanite faction of American Trotskyism, which pursued an avidly anti-Soviet line. He had joined the Young Socialist League, the youth wing of Max Shachtman’s Independent Socialist League,[45] and the Young People’s Socialist League, which he continued to support until his death in 1992. Kahn was impressed by the Shachtmanite opposition to the USSR as the primary obstacle to world socialism.[46] At the outset of the Cold War Max Shachtman set his course, declaring: “In spite of all the differences that still exist among them, the capitalist world under American imperialist leadership and drive is developing an increasingly solid front against Russian imperialism.”[47]
In 2004 Havel received the American Friends of the Czech Republic (AFCR) “Civil Society Vision Award,” and was on the occasion eulogized by NED’s founding President, veteran Social Democrat Carl Gershman. AFCR appears close to globalism. Its Officers include former US Government functionaries such as Thomas Dine, of Radio Free Europe. The Treasurer and co-Director, Hana Callaghan, is a former advisor to Goldman Sachs.[48] Zbigniew Brzezinski, the rabidly anti-Soviet and Russophobic former US National Security, presently with the Center for Strategic and International Studies, is an AFCR “adviser,” as is fellow Russophobe, former US Secretary of State Henry Kissinger. Another is Michal Novack of the neocon American Enterprise Institute.[49] Havel is listed as a sponsor of AFCR, along with George W Bush; former US Secretary of State Madeleine K. Albright; James D. Wolfensohn, of the World Bank; Colin L. Powell, former U.S. Secretary of State. On the AFCR “Wall of Honor,” along with Havel are many corporates, including American International Group; Goldman, Sachs & Co.; Citigroup; J.P. Morgan Chase & Co.; David Rockefeller.[50]
In 2007 Havel received NED’s “Democracy Service Medal.” [51]
NED, like Soros, had been a major factor in the “velvet revolutions” throughout the Warsaw Pact states. This is termed by NED as “cross-border work” and had its origins “in a conference that was sponsored by the Polish-Czech-Slovak Solidarity Foundation in Wroclaw in early November of 1989.” According to Gershman:
That conference was the culmination of collaborative meetings and joint activities of Solidarity and the Workers’ Defense Committee in Poland and the Charter 77 dissidents in Czechoslovakia that began in October 1981, shortly before the declaration of Martial Law, and continued throughout the 1980s with gatherings on the “green border” of Poland and Czechoslovakia in the Karkonosze Mountains. The purpose of the Wroclaw conference was to support from the base of the new Polish democracy the dissident movement in Czechoslovakia in the hope that a similar breakthrough could be achieved there. Vaclav Havel was later to credit the conference and the cultural festival that accompanied it with helping to inspire the Velvet Revolution that occurred less than two weeks later.[52]
Gershman alludes to NED’s role in sponsoring the subversion that spread from Poland to Czechoslovakia:
It became clear to me from the many discussions I had with Polish activists in the aftermath of 1989 that they had a very firm and clearly thought through determination to support democracy in Poland’s immediate neighborhood and in the larger geopolitical sphere that once constituted the Soviet Bloc. This determination was partly based on moral considerations, since these activists had received support in their struggle from the NED, the AFL-CIO and others in the U.S. and Europe and felt an obligation to extend similar support to those still striving for democracy.[53]
Gershman states that this “cross border work” continues, and reaches today throughout the former Soviet Union in providing training.
The Zionist Factor
The offensive against the Soviet bloc was multi-faceted, and the fantasies of many “Rightists” to the contrary, the Soviet bloc was not only a bulwark against American hegemony, but also against the international ramifications of Zionism. The USSR became the principal enemy of American hegemonic interests with Stalin’s repudiation of the United National World Government and of the “Baruch Plan.” This repudiation was the catalyst of the Cold War, as noted by Yockey in his previously cited 1952 essay.
However, the message was clear to Zionism with the purging of Zionists and Jews in 1952, that the Soviet bloc, which had armed Israel at an early stage as part of a geopolitical plan for the Middle East, considered Zionism a primary enemy. The battle lines were drawn in Prague. Yockey regarded the trial of Jewish elements from the Communist party hierarchy on charges of “treason” as a symbolic gesture to World Jewry, stating that the event would have “gigantic repercussions” on the world. This was an “unmistakable turning point” as part of an historical process,[54] although I believe that it was part of a process that began as soon as Stalin assumed authority and eliminated the Trotskyites in 1928,[55] and Yockey does state in his 1952 essay that the purge was “neither the beginning nor the end.” Yockey stated that “henceforth, all must perforce reorient their policy in view of the undeniable reshaping of the world situation . . .”[56] Of course, most did not “reorient their policy,” and Hitlerites such as Arnold Leese, Colin Jordan, and Rockwell, and most old-line anti-Semites maintained the policy that “Communism is Jewish,” no matter what the “historical process,” and they claimed that the supposed Soviet opposition to Zionism was part of a Jewish hoax.[57] Nonetheless, history proceeds anyway . . . The Zionists themselves went frenetic from this point, while the Soviet bloc established Governmental departments to examine Zionism, and some of the best material on the subject came from the Soviet presses. Moscow became what Lendvai termed the “center and exporter of anti-Semitism.”[58]
Hence, in 1968 Zionists were a major factor in the first strike against the Soviet regime in Czechoslovakia. Zionists acknowledge this. The 1967 Arab-Israeli war “became the catalytic agent” for the disruption of the Czechoslovak regime. The regime had launched an anti-Zionist campaign during the war and was the first Soviet state after the USSR to sever diplomatic relations with Israel in 1967, and the first to send high-level military delegations to Egypt and Syria.[59] As with the revolt led by Havel, the liberal-infected intelligentsia were behind the effort to establish “socialism with a human face.” Letters and articles by disaffected elements protested against the regime’s anti-Zionist campaign, and these were read at the Czechoslovak Writers’ Congress of June 26–29, 1967. Ladislav Mnacko, the country’s most successful playwright, defiantly visited Israel, and condemned the Czechoslovak regime for its opposition to Zionism, with allusions to the 1952 purge.
A familiar theme emerged: supposedly “spontaneous” student protests, held on May Day, where youth carried Israeli flags and banners reading “Let Israel Live.” Students and faculty at Prague’s Charles University issued a petition calling for diplomatic relations with Israel to be resumed. This was followed by an appeal in the youth paper, Student, which announced the formation of a “Union of the Friends of Israel.” Student riots occurred in Warsaw, Poland, and the Communist party in Yugoslavia also condemned the anti- Zionist position of the Czechoslovaks.[60]
It seems difficult to imagine that all this sudden Zionist agitation arose “spontaneously,” any more than the “velvet revolutions” today occur “spontaneously” despite the same claims. TASS reported, “Israel and international Zionism had watched developments in Czechoslovakia closely since January 1968. . . . Israel as well as Zionist organizations in the United States and the West European counties have allocated huge sums to finance internal opposition in Czechoslovakia.”[61]
The pattern is the same as the actions of Soros, the NED, et al. in Poland, Czechoslovakia, and elsewhere. The attempt by Dubcek to install “socialism with a human face” was aborted by the Soviet military. The reconstructed regime was more avidly opposed to Zionism than ever. The Slovak Minister of the Interior, General Pepich, referred to “thirty-two foreign centers organizing subversive activities against Czechoslovakia,” including Zionist organizations operating from Austria.[62] Lendvai states that the Soviet invasion and its aftermath put an end to hopes by the Jews that the celebration of the Jewish millennium would be held in Prague. Few Jews were left, and only one rabbi.[63]
The subversion of Czechoslovakia had been long in the making. In 1951, shortly before the “treason trial,” William Oatis, Associated Press correspondent, was sentenced to 10 years imprisonment for espionage. In September 1968, Newsweek mentioned that he had had extremely wide connections in Czechoslovakia among Zionists. In 1957, a Secretary at the Israeli Embassy, Moshe Katz, was expelled from the country.[64] While Zionist apologists such as Lendvai insist that the pro-Zionist activism in Czechoslovakia that prompted the Russian invasion in 1968 was a spontaneous opposition to anti-Semitism, even he admits broadly to the allegations of the Soviet press and regime. Yuri Ivanov, in possibly one of the best books on World Zionism, writes:
A leading role in the Zionist activities was to be played by the inconspicuous “Main Documentary Centre” tucked away in Vienna. On the eve of the events in Czechoslovakia the Centre created a “daughter enterprise,” the Committee for Czechoslovak Refugees. It is significant that almost simultaneously a Centre for the Co-ordination of Fighters for the Freedom of Czechoslovakia was set up in Israel (which must have seemed a rather strange move, surely, to the ordinary Israeli, for whom the main thing in 1968 was the Israeli-Arab conflict).[65]
The Tel Aviv Zionist newspaper Maariv revealed the nature of the Centre’s activities in a routine report of October 6, 1968.
Yesterday the Co-ordination Centre sent a group of young Czech intellectuals resident in Israel to various European countries. The group’s task is to establish contact with Czechoslovak citizens outside the country. They are also to investigate the possibility of establishing contact with various groups inside Czechoslovakia. Part of the group is to go to Prague.
“The Co-ordination Centre in Israel,” the paper went on to say, “is becoming a world center of fighters for the freedom of Czechoslovakia. . . . Those who meet material difficulties and have insufficient means for activities in or outside Czechoslovakia are given material support . . . The Co-ordination Centre has prepared a program for organizing the publication of Literarni Listy, a paper which is the voice of democracy in Czechoslovakia. Contributions for this purpose may be sent to: Discount Bank, account No. 450055, Tel Aviv.”[66]
Zionist apologists do not explain the Soviet documentation on Zionism but broadly refer to Soviet contentions as being without merit and lacking credible evidence. The reader is invited to read the entire Ivanov book, which has been put online by Australian Nationalists.[67]
Havel Feted by Zionists
Hence, given the history of relations between Zionism and the Soviet bloc, and in particular Czechoslovakia, Havel readily endeared himself to the Zionists, as did Gorbachev.[68] As can be seen by comparing the modus operandi between the recent and present “velvet revolutions” in the Warsaw Pact states and the machinations of Zionism in Czechoslovakia in 1967–1968, there are many parallels. Eulogies quickly appeared for Havel throughout the world Zionist press.
Jewish World reported that the European Jewish Congress, “mourning the death” of Havel, issued a statement that, “Havel was known as a great friend of the Jews and did much to confront anti-Semitism and teach the lessons of the dark chapter of the Holocaust during his two terms in office.”
EJC President Dr. Moshe Kantor, who was a colleague of Havel’s on the European Council on Tolerance and Reconciliation, said that he would be sadly missed. “He was a figure for a new and modern Europe to emulate. President Havel lived through communism and led the Czech Republic to a new era helping move his countrymen through a troubled past to a more open, free and tolerant future. “President Havel was a true and steadfast friend of the Jewish people and will be missed by European Jewry.”[69]
Israeli President Shimon Peres described Havel’s death as “a loss for the entire world.” “Peres said that Havel was both his personal friend and a friend of Israel.”[70] The Jewish newspaper Forward relates the occasion that Havel attended the 1990 Salzburg Music Festival where he delivered a speech pointedly aimed at former UN Secretary General Kurt Waldheim (albeit without naming him) who was being pilloried for having fought with Germany during World War II, like most Austrians. As related by Forward, World Jewry found Havel’s moralizing humbuggery as the finest of sentiments, Havel ending with “confession liberates.” It is perhaps indicative of how low Havel would stoop to curry favor with those of wealth and power, and one might ask how much moral fortitude it takes to merely join the clamor of a global lynch party? Forward comments: “It was a quintessentially Havel-esque performance: deeply moral and slightly mischievous at the same time.”[71] Kirchick in the Forward article alludes to Czechoslovakia’s special role in opposing World Zionism, and Havel’s having pledged on New Year’s Day 1990 to re-establish diplomatic relations with Israel, which was done the following month. Kirchick continues:
In April of that year, Havel became the first leader of a free former Soviet bloc country to visit Israel. It was his second foreign trip as president of Czechoslovakia. . . . As president, Havel opposed the sale of weapons to regimes hostile to Israel, like Syria, a controversial move considering that communist-era Czechoslovakia (and Slovakia in particular) was a major exporter of arms to Soviet clients. Today, according to Israeli Ambassador Yaakov Levy, “the Czech Republic is considered by Israel to be its best friend in Europe and the European Union.”
In the early years of Czechoslovak independence, when many in the West worried about a resurgence of nationalism across the newly independent nations of the Eastern Bloc, Havel spoke out forcefully against anti-Semitism. Because of this, he became an enduring enemy of the nationalist right. In 1993, following the “Velvet Divorce” from Slovakia, a far-right party tried to block Havel’s election as president of the Czech Republic with a parliamentary filibuster, accusing Havel of being paid off in “shekels” by outside forces.
Havel continued to speak out for Israel and against anti-Semitism well after his retirement, in 2003. Last year, he co-founded the Friends of Israel Initiative, aimed at combating delegitimization of Israel in the realm of international institutions. Earlier this year, he criticized a Czech education ministry official revealed to have ties with far right organizations and Holocaust denial. When the man’s defenders said that his views should not have any bearing on his ability to hold a government job, Havel replied that he was “struck . . . that quasi-fascist or quasi-anti-Semitic or similar opinions should be expressed in one’s spare time, or during vacation, but not at the office. Yes, that’s it exactly: After all, a certain house painter also founded his party in a pub in Munich, not at the workplace.”
The above shows just how far Havel believed in “freedom.” Like all such “liberals” his liberality only extended to those who agree with liberal views. Havel was apparently happy to see a Government official purged from his job on the basis that he did not share Havel’s sycophantic attitude towards Zionism and plutocracy.
The author of the Forward eulogy, Kirchick, is a Fellow with the Foundation for Defense of Democracies, yet another neocon Cold War II think tank founded after 9/11 to help ensure that “the new American century” comes to fruition. Funded by the likes of the Bronfmans, its “leadership council” includes a scabrous crew of neocon identities such as former CIA director James Woolsey, Steve Forbes of Forbes Magazine, Bill Kristol of The Weekly Standard, Sen. Joseph Lieberman, et al.[72] Its advisers include such familiar names as Charles Krauthammer and Richard Perle.[73] A founding Chair was Jean Kirkpatrick, veteran post-Trot neocon.[74]
According to FDD “Freedom Scholar,” neocon strategist Michael Ledeen,[75] he can’t watch a video of Havel’s funeral without “tearing up.” One might wonder whether he has the same reaction to footage of Palestinian children being shot by Israeli soldiers, of wars of destruction meted out by the USA on the civilians of Serbia, Iraq, and Libya? Tellingly Ledeen brings us back to a major theme of this article, writing of Havel:
Did I mention that he loved music? Both rock and jazz, because he recognized their subversive power. He loved Frank Zappa, and made him the Czech “cultural ambassador.” When Bill Clinton visited Prague in the mid-nineties, Havel took him to a seedy nightclub, where the American president played sax with the locals (and his wife, Dagmar, visited the club on a walking tour of the city shortly after Havel’s death) . . . Havel loved to write “absurdist” plays and poems. He was a true heir to Kafka. Like Kafka, he had an uncanny grasp of the dynamics and resulting horrors of bureaucracy. And, like Kafka, he was a Zionist.[76]
Havel, as the pundits enthuse, was a lackey of international capital and globalization. By Ledeen’s own account, Havel was a seedy Zionist. The neo-Trotskyite-Zionist-plutocratic network has “unfinished business,” ensuring that there is no resurgence of a Europe of the spirit, but only an edifice founded on Mammon, a Europe subordinated to NATO, of which Havel was an enthusiast, and the continuation of the policy of surrounding Russia, until that land also succumbs to the same forces that shaped and cultivated Havel.
Notes
[1] For a definition of the Michel element see Yockey, Imperium (Sausalito, Ca.: The Noontide Press, 1969), pp. 405–406.
[2] Ironically, in seeing an inevitable world conflict between the USA and the Soviet bloc, might Yockey not have been underestimating the power of the Culture-distorter to cause the implosion of the Soviets?
[3] F. P. Yockey, The Enemy of Europe (Reedy, W.Va.: Liberty Bell Publications, 1981), “The Inner Enemy of Europe,” p. 48.
[4] K. R. Bolton, “Mikhail Gorbachev: Globalist Super-Star,” Foreign Policy Journal, April 3, 2011, http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/04/03/mikhail-gorbachev-globalist-super-star/ [2]
[5] K. R. Bolton, “Origins of the Cold War and how Stalin Foiled a New World Order,” Foreign Policy Journal, May 31, 2010, http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/05/31/origins-of-the-cold-war-how-stalin-foild-a-new-world-order/all/1 [3]
[6] K. R. Bolton, “America’s ‘World Revolution’: Neo-Trotskyist Foundations of U.S. Foreign Policy,” Foreign Policy Journal, May 3, 2010, http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/05/03/americas-world-revolution-neo-trotskyist-foundations-of-u-s-foreign-policy/ [4]
[7] R. Peters, “Constant Conflict,” Parameters, Summer 1997, pp. 4–14. http://www.usamhi.army.mil/USAWC/Parameters/97summer/peters.htm [5]
[8] Philip K. Howard, “Vaclav Havel’s Critique of the West,” The Atlantic, December 20, 2011, http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/12/vaclav-havels-critique-of-the-west/250277/ [6]
[9] K. R. Bolton, “Egypt and Tunisia: Plutocracy Won,” Foreign Policy Journal, June 28, 2011, http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/06/28/egypt-and-tunisia-plutocracy-won/0/ [7]
[10] F. P. Yockey, Imperium, “Cultural Vitalism (B) Culture Pathology.”
[11] Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters (New York: The New Press, 1999).
Also see the CIA website: “Cultural Cold War: Origins of the Congress for Cultural Freedom, 1949-50”; https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/docs/v38i5a10p.htm#rft1 [8]
[12] F. Chernov, “Bourgeois Cosmopolitanism and its Reactionary Role,” Bolshevik: Theoretical and Political Magazine of the Central Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) ACP(B), Issue #5, March 15, 1949, pp. 30–41.
[13] Breton was the founding father of Surrealism. Joining the Communist Party in 1927, he was expelled in 1933 because of his association with Trotsky. Breton wrote of Surrealism in 1952: “It was in the black mirror of anarchism that surrealism first recognised itself.”
[14] In Mexico Trotsky lived with Diego Rivera and then with Diego’s wife, the artist Frida Kahlo, having reached Mexico in 1937, where he had his brain splattered by a Stalinist assassin in 1940.
[15] Leon Trotsky, André Breton, Diego Rivera, Towards a Free Revolutionary Art, July 25, 1938.
[16] The Cold War was precipitated by Stalin’s rejection of the United Nations as the basis for a world government. Stalin insisted that authority be vested in the Security Council with members’ power to veto, rather than the American proposal of authority being with the General Assembly where the Soviets would always be outvoted. Secondly, the Soviets perceived that the Baruch Plan for the “internationalization of atomic energy,” would mean US control. K. R. Bolton, “Origins of the Cold War: How Stalin Foiled a New World Order,” Foreign Policy Journal, May 31, 2010, http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/05/31/origins-of-the-cold-war-how-stalin-foild-a-new-world-order/all/1 [3]
Yockey recognized the significance of this rejectionism by Stalin, writing of it in his 1952 essay “What is Behind the Hanging of the Eleven Jews in Prague?”
[17] Trotsky, Breton, Rivera, Towards a Free Revolutionary Art.
[18] Chernov, “Bourgeois Cosmopolitanism and its Reactionary Role.”
[19] Chernov, “Bourgeois Cosmopolitanism and its Reactionary Role.”
[20] K. R. Bolton, “The Moscow Trials in Historical Context,” Foreign Policy Journal, April 22, 2011, http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/04/22/the-moscow-trials-in-historical-context/ [9]
[21] Bolton, “The Moscow Trials in Historical Context.”
[22] Chernov, “Bourgeois Cosmopolitanism and its Reactionary Role.”
[23] In a nihilistic sense, insofar as America does not represent any high Idea, but was founded as an anti-Traditional revolt against Europe and on the basis of the political and ideological excrescences of Europe at its most decadent.
[24] F. P. Yockey, “Program of the European Liberation Front,” London, 1949, Point 5.
[25] Ralph Peters, “Constant Conflict,” Parameters, Summer 1997, 4–14. http://www.usamhi.army.mil/USAWC/Parameters/97summer/peters.htm [5]
[26] K. R. Bolton, Revolution from Above: Manufacturing “Dissent” in the New World Order (London: Arktos, 2011), pp. 48–54.
[27] “Charter 77 After 30 Years,” The National Security Archive, The George Washington University, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB213/index.htm
[28] http://www.progarchives.com/artist.asp?id=2800
[29] http://www.progarchives.com/artist.asp?id=2800
[30] R. Unterberger, “The Plastic People of the Universe,” http://www.richieunterberger.com/ppu.html
[31] Unterberger, “The Plastic People of the Universe.”
[32] Unterberger, “The Plastic People of the Universe.”
[33] Unterberger, “The Plastic People of the Universe.”
[34] D. Bilefsky, “Czech’s Velvet Revolution Paved by Plastic People,” New York Times, November 15, 2009, http://www.nytimes.com/2009/11/16/world/europe/16iht-czech.html
[35] Bilefsky, “Czech’s Velvet Revolution Paved by Plastic People.”
[36] J. Velinger, “The Impact of the Plastic People on a Communist Universe,” Radio Praha, May 31, 2005, http://www.radio.cz/en/section/one-on-one/paul-wilson-the-impact-of-the-plastic-people-on-a-communist-universe
[37] G. Soros, Underwriting Democracy: Encouraging Free Enterprise & Democratic Reform Among the Soviets & in Eastern Europe (Jackson, Tenn.: Public Affairs, 2004), pp. 26–27.
[38] “Havel at Columbia,” http://havel.columbia.edu/about.html
[39] http://havel.columbia.edu/hostcommittee.html
[40] Drug Policy Alliance, http://www.drugpolicy.org/about-us/leadership/board-directors Dreifuss is a Swiss Social Democrat.
[41] Club of Madrid, Members, http://www.clubmadrid.org/en/estructura/members_1/letra:h
[42] http://www.clubmadrid.org/en/about
[43] “Partners & collaborators,” http://www.clubmadrid.org/en/partners_collaborators
[44] Freedom Now, Honorary co-Chairs, http://www.clubmadrid.org/en/partners_collaborators
[45] Rachelle Horowitz, “Tom Kahn and the Fight for Democracy: A Political Portrait and Personal Recollection,” Dissent Magazine, pp. 238–39. http://www.dissentmagazine.org/democratiya/article_pdfs/d11Horowitz.pdf
[46] Horowitz, “Tom Kahn and the Fight for Democracy,” p. 211.
[47] Max Shachtman, “Stalinism on the Decline: Tito versus Stalin, The Beginning of the End of the Russian Empire,” New International, vol. 14, no.6, August 1948, 172–78.
[48] AFCR, “Officers,” http://www.afocr.org/afocr-officers.html
[49] AFCR “Advisers,” http://www.afocr.org/afocr-advisors.html
[50] http://www.afocr.org/afocr-wall-of-honor.html
[51] http://www.ned.org/about/board/meet-our-president/archived-remarks-and-presentations/061704
[52] C. Gershman, “Giving Solidarity to the World,” symposium on Solidarity and the Future of Democratization, Georgetown University, Washington, D.C., May 19, 2009, http://www.ned.org/about/board/meet-our-president/archived-remarks-and-presentations/051909
[53] Gershman, “Giving Solidarity to the World.”
[54] F. P. Yockey, “What is behind the Hanging of Eleven Jews in Prague?”
[55] K. R. Bolton, “The Moscow Trials in Historical Context.” The canard that Stalin’s birth-name Dzhugashvili means “son of a Jew” in Georgian seems to be as etymologically sound as the British Israelite/Identity claim that Saxon means “Isaac’s Sons,” or the claim that Judah P. Benjamin was a “Rothschild relative.” A. Vaksberg, Stalin Against the Jews (New York: Alfred A. Knopf, 1994).
[56] F. P. Yockey, “What is behind the Hanging of Eleven Jews in Prague?”
[57] King Faisal of Saudi Arabia was a proponent of this theory, for example.
[58] P. Lendvai, Anti-Semitism in Eastern Europe (London: Macdonald & Co., 1971), p. 10.
[59] Lendvai, Anti-Semitism in Eastern Europe, pp. 260–61.
[60] Lendvai, Anti-Semitism in Eastern Europe, pp. 260–69.
[61] Lendvai, Anti-Semitism in Eastern Europe, pp. 290–91.
[62] Lendvai, Anti-Semitism in Eastern Europe, p. 294.
[63] Lendvai, Anti-Semitism in Eastern Europe, p. 296.
[64] Y. Ivanov, Caution, Zionism: Essays on the Ideology, Organization, and Practice of Zionism (Moscow: Progress Publishers, 1970), chapter 5, http://home.alphalink.com.au/~radnat/zionism/index.html
[65] Ivanov, Caution, Zionism, chapter 5.
[66] Ivanov, Caution, Zionism, chapter 5.
[67] Ivanov, Caution, Zionism, chapter 5.
[68] K. R. Bolton, “Mikhail Gorbachev: Globalist Superstar.”
[69] “EJC mourns death of Havel,” Jewish World, ynetnews.com, December 19, 2011, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4163744,00.html
[70] N. Mozgovaya, “Israel President: Vaclav Havels’ death loss for entire world,” Haaretz.com, December 18, 2011, http://www.haaretz.com/news/international/israel-president-vaclav-havel-s-death-a-loss-for-the-entire-world-1.402157
[71] J. Kirchick, “Havel was friend of Israel and Jews: Czech Playwright-Turned-President Led Region to Right Path, The Jewish Daily Forward, December 20, 2011, http://www.forward.com/articles/148247/
[72] FDD Team, Leadership Council, http://www.defenddemocracy.org/about-fdd/team-overview/category/leadership-council
[73] FDD Team, Board of Advisers, http://www.defenddemocracy.org/about-fdd/team-overview/category/board-of-advisors
[74] http://www.defenddemocracy.org/about-fdd/team-overview/dr-jeane-j-kirkpatrick/
[75] Former consultant to the National Security Department, Defense Dept., and State Dept., media pundit.
[76] M. Ledeen, “Havel, Kafka and Us,” FDD, December 21, 2011, http://www.defenddemocracy.org/media-hit/havel-kafka-and-us/
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2011/12/vaclav-havel-the-inner-enemy/
00:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vaclav havel, tchécoslovaquie, république tchèque, mitteleuropa, europe centrale, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Nel deserto dell’umano. Potenza e Machenschaft nel pensiero di Martin Heidegger
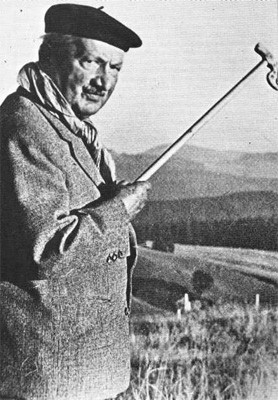 Nel deserto dell’umano.
Nel deserto dell’umano. Potenza e Machenschaft nel pensiero di Martin Heidegger
di Salvatore Spina
Fonte: recensionifilosofiche
Lo studio di Gorgone, Nel deserto dell’umano. Potenza e Machenschaft nel pensiero di Martin Heidegger, ha come argomento centrale l’assunzione della questione della Machenschaft come «il tema fondamentale attorno a cui ruotano le meditazioni successive alla Kehre intorno alla tecnica, al nichilismo e alla storia dell’essere» (p. 22). La questione della Machenschaft è rintracciabile soprattutto in quei testi di fine anni Trenta, che Heidegger tenne segreti fino alla propria morte, precisamente Beiträge zur Philosophie e Besinnung;
il termine, che in italiano viene reso – non senza problemi ermeneutici – come “macchinazione”, indica il modo in cui l’essere si dispiega nell’era della tecnica, ovvero nell’epoca del compimento della modernità. Il lavoro di Gorgone, prendendo come punto di partenza questi testi e muovendosi in modo trasversale all’interno della sterminata produzione heideggeriana, vuole essere un’analisi del pensiero del filosofo di Messkirch dopo la svolta, e nel contempo il tentativo di individuare nel concetto di Machenschaft la chiave di volta di tutta la riflessione heideggeriana, che, dopo il fallimento del progetto di Essere e tempo, subisce quella “svolta ontologica” che ne delinea i tratti caratteristici in maniera peculiare lungo tutto il percorso successivo.
il termine, che in italiano viene reso – non senza problemi ermeneutici – come “macchinazione”, indica il modo in cui l’essere si dispiega nell’era della tecnica, ovvero nell’epoca del compimento della modernità. Il lavoro di Gorgone, prendendo come punto di partenza questi testi e muovendosi in modo trasversale all’interno della sterminata produzione heideggeriana, vuole essere un’analisi del pensiero del filosofo di Messkirch dopo la svolta, e nel contempo il tentativo di individuare nel concetto di Machenschaft la chiave di volta di tutta la riflessione heideggeriana, che, dopo il fallimento del progetto di Essere e tempo, subisce quella “svolta ontologica” che ne delinea i tratti caratteristici in maniera peculiare lungo tutto il percorso successivo.
I testi in cui Heidegger tratta della questione della Machenschaft sono molto importanti sia da un punto di vista squisitamente teorico, in quanto rappresentano i primi testi in cui la Kehre viene espressamente “tematizzata”, ma anche da una prospettiva più strettamente storico-politica. Essi vengono redatti alla fine degli anni Trenta – i Beiträge zur Philosophie tra il 1936 e il 1938 mentre Besinnung nel biennio 1938-39 –, periodo in cui l’assetto geopolitico dell’Europa stava mutando in maniera radicale; questi mutamenti nell’arco di pochi anni avrebbero generato nel Vecchio Continente la più grande devastazione che la storia abbia mai conosciuto.
Dopo l’iniziale illusione di una possibilità rivoluzionaria propugnata dal nazionalsocialismo, Heidegger individua il nesso fondamentale che intercorre tra tecnica, nichilismo e totalitarismo; il nazionalsocialismo, così come ogni fascismo (ivi compreso l’americanismo – ed è questo forse l’aspetto più rivoluzionario e attuale del pensiero “politico” di Heidegger), appare agli occhi del filosofo la realizzazione esplicita della volontà di potenza e dominio tipica della tecnica, che ha come parola d’ordine l’efficienza del fare [machen]. Ma coinvolti nell’estremo dominio della volontà di potenza sono anche quegli aspetti della vita che a prima vista sembrerebbero estranei alla logica del fare: le esperienze vissute [Erlebnisse]. Il divertissement e l’esperienza vissuta rappresentano agli occhi di Heidegger la maschera più appropriata che la Machenschaft indossa per nascondere la sua intima essenza violentemente nichilistica ed apparire così meno aggressiva e pervasiva. Lungi dall’essere il luogo del disincantamento del mondo, la modernità tecno-scientifica è il tempo della mistificazione per eccellenza.
Come evidenzia Gorgone nel proprio studio, l’interpretazione del reale secondo le categorie della Machenschaft ha come suo sostrato filosofico la coeva riflessione di Ernst Jünger, il quale agli inizi degli anni Trenta nel saggio Der Arbeiter (1932), attraverso un’implacabile indagine della modernità, parla di metafisica del lavoro, ovvero di riduzione di tutto l’ente a materiale utilizzabile e fattibile, e di mobilitazione totale, sostenendo – sulla scorta dell’esperienza della Grande Guerra – il generale coinvolgimento di tutto l’essente in quel movimento impetuoso ed inarrestabile che caratterizza il mondo tecnico, tanto che anche il bambino nella culla «è minacciato come tutti gli altri, se non addirittura di più».
Quando nel 1945 Heidegger scrisse i Colloqui su un sentiero di campagna – testo decisivo all’interno del lavoro di Gorgone – le analisi della modernità e della tecnica non erano più mere profezie, ma erano diventate triste realtà con la scia di morte e distruzione che la Seconda guerra mondiale aveva lasciato dietro di sé. È proprio di fronte all’apocalittico scenario di una Germania in rovina e costretta alla resa che Heidegger individua nella metafora del deserto l’immagine più appropriata a descrivere la condizione dell’Europa devastata dal conflitto. Il deserto, eco di quel “debito impensato” che, come viene mostrato da Gorgone attraverso l’elaborazione di una “geofilosofia del deserto” (p. 157), legherebbe idealmente Heidegger alla tradizione ebraica, è da sempre il simbolo di morte e distruzione, ma anche e soprattutto dell’impossibilità della rinascita: non semplice disfacimento, secondo una ciclicità vita/morte/vita, ma più radicalmente annichilimento totale.
Ma desertica è anche l’essenza dell’uomo nell’era della Machenschaft: incapace di percepirsi come destinatario degli appelli dell’essere, l’uomo si fa trascinare dall’impetuoso fluire dell’impianto [Gestell] tecnico, correndo il massimo pericolo di essere ridotto ad ente tra gli altri enti, obliando così quella che è la sua massima dignità, ovvero essere il luogo di apertura dell’essere stesso. L’uomo ridotto ad una dimensione, quella tecnica, diventa così un mero impiegato (nel duplice senso del termine) dell’apparato tecnico, un esecutore funzionale della potenza della Machenschaft.
Machenschaft e desertificazione sono i due modi in cui l’essere si dona nell’epoca della tecnica dispiegata; a questi Heidegger contrappone – sebbene mai in maniera del tutto oppositiva, ma in una intima ed essenziale coappartenenza – da un lato la sovranità regale dell’essere [Herrschaft], cioè «la possibilità di fondazione non-violenta di ogni ente» (p. 28), un’im-potenza che precede (non cronologicamente, ma a livello ontologico) ed eccede ogni potere violento della metafisica e rivela quell’inesauribile ricchezza «di ciò che non può mai essere completamente dis-velato e che pure concede ogni possibilità di manifestazione» (p. 86); alla desertificazione, invece, fa da contraltare la vastità accogliente della radura [Weite], ovvero quel luogo aperto e libero «sottratto al fare e dis-fare della Machenschaft, in cui le cose e l’uomo possano essere raccolte nella semplicità della loro essenza» (p.163).
Il testo di Gorgone è diviso in quattro capitoli che, avendo una loro struttura compiuta, potrebbero sembrare a se stanti; tuttavia un’analisi più attenta rivela un’unitarietà di fondo che pervade l’intero lavoro dell’autore. Il primo capitolo è un’analisi della Machenschaft così come appare nei testi heideggeriani, ma anche il tentativo, ben compiuto, di individuare il sostrato filosofico di questo pensiero nella riflessione di Aristotele e nel dualismo classico dynamis-enérgheia. Il secondo capitolo, invece, identifica in Ernst Jünger il referente principale della riflessione heideggeriana intorno alla tecnica ed alla modernità, evidenziando anche la problematicità di questo rapporto ermeneutico che trova la sua forma “compiuta” nel volume 90 della Gesamtausgabe, testo ancora inedito in Italia e, per molti versi, poco conosciuto. Il terzo capitolo è il tentativo di trovare una concretizzazione storica del fenomeno della Machenschaft; attraverso l’esame di alcuni testi di Heidegger, come il famigerato Discorso al rettorato, Gorgone propone un’interpretazione disincantata e scevra da pregiudizi di quello che probabilmente è il problema più dibattuto tra gli studiosi heideggeriani: il rapporto tra Heidegger e il nazionalsocialismo. Giudicando l’adesione di Heidegger al partito nazionalsocialista una “colpa d’impazienza” (p. 131), l’autore vuole individuare le ragioni profonde che da un lato portarono Heidegger a intravedere nel movimento nazista un’autentica possibilità rivoluzionaria, e dall’altra lo convinsero, in seguito, dell’intimo carattere nichilistico del nazionalsocialismo stesso. L’ultimo capitolo, ripercorrendo alcuni dei temi trattati, individua un nesso essenziale tra la Machenschaft e quella condizione desertica, già profetizzata da Nietzsche, che caratterizza tanto la modernità nell’epoca del suo compimento quanto l’uomo che di quest’epoca è interprete; è proprio a partire da questa condizione di massima povertà e spaesamento che Heidegger propone delle strade alternative che non siano mere vie di fuga, quanto piuttosto dei percorsi di approfondimento che riaffermino quella che è la massima dignità dell’uomo: farsi portavoce del messaggio dell’essere.
Proprio in questo compito Gorgone individua quell’ “etica originaria” di cui parla Jean Luc Nancy a proposito del pensiero dell’essere di Heidegger; nell’introduzione al testo scrive Gorgone: «L’essenza dell’umanità a venire diviene, così, quel luogo primariamente etico di resistenza alle logiche totalitarie della macchinazione ed al contempo di corrispondenza al richiamo semplice ed essenziale della vastità desertica dell’essere, del suo inesauribile darsi-donarsi come senso nella storia» (p. 18).
Indice:
Introduzione
1. Potenza e mobilitazione
2. Machenschaft e metafisica del lavoro: Heidegger legge Jünger
3. Lo spirito e il totalitarismo
4. L’umanità nel deserto della Machenschaft
Milano, Mimesis, 2011, pp. 212, euro 18, ISBN 978-88-5750-454-4
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:14 Publié dans Livre, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, allemagne, faisabilité, philosophie, martin heidegger, révolution conservatrice, technique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
The March to War: Iran and the Strategic Encirclement of Syria and Lebanon
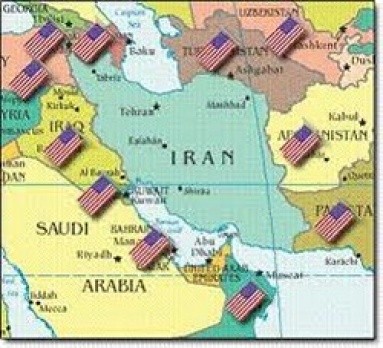
The March to War: Iran and the Strategic Encirclement of Syria and Lebanon
by Mahdi Darius Nazemroaya
Ex: http://www.globalresearch.ca/
The encirclement of Syria and Lebanon has long been in the works. Since 2001, Washington and NATO have started the process of cordoning off Lebanon and Syria. The permanent NATO presence in the Eastern Mediterranean and the Syrian Accountability Act are part of this initiative. It appears that this roadmap is based on a 1996 Israeli document aimed at controlling Syria. The document’s name is A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm.
The 1996 Israeli document, which included prominent U.S. policy figures as authors, calls for “rolling back Syria” in 2000 or afterward. The roadmap outlines pushing the Syrians out of Lebanon, diverting the attention of Damascus by using an anti-Syrian opposition in Lebanon, and then destabilizing Syria with the help of both Jordan and Turkey. This has all respectively occurred from 2005 to 2011. This is also why the anti-Syrian March 14 Alliance and the Special Tribunal for Lebanon (STL) were created in Lebanon.
As a first step towards all this the 1996 document even calls for the removal of President Saddam Hussein from power in Baghdad and even alludes to the balkanization of Iraq and forging a strategic regional alliance against Damascus that includes a Sunni Muslim Arab “Central Iraq.” The sectarian nature of this project is very obvious as are its ties to opposing a so-called “Shiite Crescent.” The roadmap seeks to foment sectarian divisions as a means of conquering Syria and creating a Shiite-Sunni rift that will oppose Iran and keep the Arab monarchs in power.
The U.S. has now initiated a naval build-up off the Syrian and Lebanese coasts. This is part of Washington’s standard scare tactics that it has used as a form of intimidation and psychological warfare against Iran, Syria, and the Resistance Bloc. While Washington is engaged in its naval build-up, the mainstream media networks controlled by the Saudis and Arab clients of the U.S. are focusing on the deployment of Russian naval vessels to Syria, which can be seen as a counter-move to NATO.
Al-Ramtha in Jordan is being used to launch attacks into Daraa and Syrian territory. The Jordanian Minister of State for Media Affairs and Communications, Rakan Al-Majali, has even publicly admitted this and dismissed it as weapons smuggling. For years, Jordanian forces have successfully prevented weapons from reaching the Palestinians in the Israeli-occupied West Bank from Jordanian territory. In reality, Amman is sending weapons into Syria and working to destabilize Syria. Jordanian forces work as a frontline to protect Israel and the Jordanian intelligence services are an extension of the C.I.A. and Mossad.
According to the Turkish media, France has sent its military trainers into Turkey and Lebanon to prepare conscripts against Syria. The Lebanese media also suggests the same. The so-called Free Syrian Army and other NATO-GCC front organizations are also using Turkish and Jordanian territory to stage raids into Syria. Lebanon is also being used to smuggle weapon shipments into Syria. Many of these weapons were actually arms that the Pentagon had secretly re-directed into Lebanon from Anglo-American occupied Iraq during the George W. Bush Jr. presidency.
The French Foreign Minister, Alain Juppé, has promised the Syrian National Council, that a so-called “humanitarian corridor” will be imposed on Syria. Once again, the Syrian National Council is not an independent entity and therefore Juppé did not really make a promise; he really made a declaration.
While foreign companies like Suncor Energy were forced to leave Libya, they have not left Syria. The reason that these companies have stayed has been presented as being humanitarian, because they provide domestic local services in Syria. For example, Suncor Energy helped produce oil for export from Libya, but in Syria produces energy for local consumption. In reality, hostile governments are letting these companies stay, because they siphon money out of Syria. They want to prevent any money from going in, while they want to also drain the local economy as a catalyst to internal implosion in Syria.
Along with the U.S. and its NATO allies, the Gulf Cooperation Council (GCC) is imposing sanctions that include an end to all flights to Syria. The GCC states and Turkey have joined the foreign ministries of NATO states in asking their citizens to leave Syria. Since the U.N. Security Council is no longer a viable route against Syria, the GCC may also try to impose a no-fly zone over Syria through the Arab League.
Turkey: NATO’s Trojan Horse and Gateway into the Middle East
Turkey was present at the Arab League meeting in Morocco, which demanded regime change in Damascus. Ankara has been playing a dirty game. Initially, during the start of NATO’s war against Libya, Ankara pretended to be neutral while it was helping the Transitional Council in Benghazi. The Turkish government does not care about the Syrian population. On the contrary, the demands that Turkish officials have made to the Syrians spell out that realpolitik is at play. In tune with the GCC, Turkey has demanded that Damascus re-orient its foreign policy and submit to Washington’s demands as a new satellite. Through a NATO initiative, the Turks have also been responsible for recruiting fighters against the Libyan and Syrian governments.
For several years Ankara has been silently trying to de-link Syria from Iran and to displace Iranian influence in the Middle East. Turkey has been working to promote itself and its image amongst the Arabs, but all along it has been a key component of the plans of Washington and NATO. At the same time, it has been upgrading its military capabilities in the Black Sea and on its borders with Iran and Syria. Its military research and development body, TUBITAK-SAGE, has also announced that Ankara will also start mass-production of cruise-missiles in 2012 that will be fitted for its navy and forthcoming deliveries of U.S. military jets that could be used in future regional wars. Turkey and NATO have also agreed to upgrade Turkish bases for NATO troops.
In September 2011, Ankara joined Washington’s missile shield project, which upset both Moscow and Tehran. The Kremlin has reserved the right to attack NATO’s missile shield facilities in Eastern Europe, while Tehran has reserved the right to attack NATO’s missile shield facilities in Turkey or in the case of a regional war. There have also been discussions about the Kremlin deploying Iskander missiles to Syria.
Since June 2011, Ankara has been talking about invading Syria. It has presented the invasion plans as a humanitarian mission to establish a “buffer zone” and “humanitarian corridor” under R2P, while it has also claimed that the protests in Syria are a regional issue and not a domestic issue. In July 2011, despite the close Irano-Turkish economic ties, the Iranian Revolutionary Guard made it clear that Tehran would support the Syrians and choose Damascus over Ankara. In August 2011, Ankara started deploying retired soldiers and its military reserve units to the Turkish-Syrian border. It is in this context, that the Russian military presence has also been beefing up in the port of Tartus.
From Damascus to Tehran
It is also no mere coincidence that Senator Joseph Lieberman started demanding at the start of 2011 that the Pentagon and NATO attack Syria and Iran. Nor is it a coincidence that Tehran has been included in the recent Obama Administration sanctions imposed against Damascus. Damascus is being targeted as a means of targeting Iran and, in broader terms, weakening Tehran, Moscow, and Beijing in the struggle for control over the Eurasian landmass. The U.S. and its remaining allies are about to reduce their forces in Iraq, but they do not want to leave the region or allow Iran to create a bridge between itself and the Eastern Mediterranean using Iraq.
Once the U.S. leaves Iraq, there will be a direct corridor between Lebanon and Syria with Iran. This will be a nightmare for Washington and Tel Aviv. It will entrench Iranian regional dominance and cement the Resistance Bloc, which will pin Iran, Syria, Iraq, Lebanon, and the Palestinians together. Israel and the U.S. will both be struck with major strategic blows.
The pressure on Syria is directly tied to this American withdrawal from Iraq and Washington’s efforts to block Tehran from making any further geo-political gains. By removing Damascus from the equation, Washington and its allies are hoping to create a geo-strategic setback for Iran.
Everything that Washington is doing is in preparation for the new geo-political reality and an attempt to preserve its regional standing. U.S. military forces from Iraq will actually be redeployed to the GCC countries in the Persian Gulf. Kuwait will host new combat units that have been designated to re-enter Iraq should security collapse, such as in the case of a regional war, or to confront Iran and its allies in a future conflict. The U.S. is now activating the so-called “Coalition of the Moderate” that it created under George W. Bush Jr. and directing it against Iran, Syria, and their regional allies.
On November 23, 2011 the Turks signed a military agreement with Britain to establish a strategic partnership and closer Anglo-Turkish military ties. During an important state visit by Abdullah Gül to London, the agreement was signed by Defence Secretary Phillip Hammond and the Deputy Chief of the Turkish General Staff, Hulusi Akar. The Anglo-Turkish agreement comes into play within the framework of the meetings that the British Chief of Defence Staff, General David Richards, and Liam Fox, the former scandal-ridden British defence minister, had with Israeli officials in Tel Aviv. After the visit of General Richards to Israel, Ehud Barak would visit Britain and later Canada for talks concerning Syria and its strategic ally Iran. Within this timeframe the British and Canadian governments would declare that they were prepared for war with both Syria and Iran.
London has announced that military plans were also drawn for war with Syria and Iran. On the other side of the Atlantic, Canada’s Defence Minister, Peter MacKay, created shockwaves in Canada when he made belligerent announcements about war with Syria and Iran. He also announced that Canada was buying a new series of military jets through a major arms purchase. Days later, both Canada and Britain would also cut their banking and financial ties with Iran. In reality, these steps have largely been symbolic, because Tehran was deliberately curbing it ties with Britain and Canada. For months the Iranians have also openly been evaluating cutting their ties with Britain and several other E.U. members.
The events surrounding Syria have much more to do with the geo-politics of the Middle East than just Syria alone. In the Israeli Knesset, the events in Syria were naturally tied to reducing Iranian power in the Middle East. Tel Aviv has been preparing itself for a major conflict for several years. This includes its long distance military flights to Greece that simulated an attack on Iran and its deployment of nuclear-armed submarines to the Persian Gulf. It has also conducted the “Turning Point” exercises, which seek to insure the continuation of the Israeli government through the evacuation and relocation of the Israeli cabinet and officials, including the Israeli finance ministry, to secret bunkers in the case of a war.
For half a decade Washington has been directing a military arms build-up in the Middle East aimed at Iran and the Resistance Bloc. It has sent massive arms shipments to Saudi Arabia. It has sent deliveries of bunker busters to the U.A.E. and Israel, amongst others, while it has upgraded its own deadly arsenal. U.S. officials have also started to openly discuss murdering Iranian leaders and military officials through covert operations. What the world is facing is a pathway towards possible military escalation that could go far beyond the boundaries of the Middle East and suck in Russia, China, and their allies. The Revolutionary Guard have also made it clear that if conflict is ignited with Iran that Lebanon, Iraq, and the Palestinians would all be drawn in as Iranian allies.
Mahdi Darius Nazemroaya is a Sociologist and award-winning author based in Ottawa. He is a Research Associate at the Centre for Research on Globalization (CRG), Montreal. He was a witness to the "Arab Spring" in action in North Africa. While on the ground in Libya during the NATO bombing campaign, he reported out of Tripoli for several media outlets. He was Special Correspondent for Global Research and Pacifica's investigative program Flashpoints, broadcast out of Berkeley, California. His writings have been published in more than ten languages.
00:10 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : syrie, iran, géopolitique, politique internationale, actualité, moyen orient, proche orient |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
A Arte de Dario Wolf
00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, dessin, graphisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Vient de paraître : Mea Culpa
Vient de paraître : Mea Culpa, version préparatoire et texte définitif
 Les éditions du Lérot publient une version préparatoire et le texte définitif de Mea Culpa de Louis-Ferdinand Céline. Une édition d’Henri Godard avec la reproduction intégrale du manuscrit. 104 pages, au format du manuscrit 21x27 cm. Tirage limité à 300 ex. numérotés, 50 euros. Nous reproduisons ci-dessous l'avant-propos d'Henri Godard.
Les éditions du Lérot publient une version préparatoire et le texte définitif de Mea Culpa de Louis-Ferdinand Céline. Une édition d’Henri Godard avec la reproduction intégrale du manuscrit. 104 pages, au format du manuscrit 21x27 cm. Tirage limité à 300 ex. numérotés, 50 euros. Nous reproduisons ci-dessous l'avant-propos d'Henri Godard.
Commande auprès de l'éditeur :
Tél. 05 45 31 71 56
du.lerot@wanadoofr
Du Lérot, éditeur
Les Usines Réunies
16140 Tusson
www.editionsdulerot.fr
 Les éditions du Lérot publient une version préparatoire et le texte définitif de Mea Culpa de Louis-Ferdinand Céline. Une édition d’Henri Godard avec la reproduction intégrale du manuscrit. 104 pages, au format du manuscrit 21x27 cm. Tirage limité à 300 ex. numérotés, 50 euros. Nous reproduisons ci-dessous l'avant-propos d'Henri Godard.
Les éditions du Lérot publient une version préparatoire et le texte définitif de Mea Culpa de Louis-Ferdinand Céline. Une édition d’Henri Godard avec la reproduction intégrale du manuscrit. 104 pages, au format du manuscrit 21x27 cm. Tirage limité à 300 ex. numérotés, 50 euros. Nous reproduisons ci-dessous l'avant-propos d'Henri Godard.Commande auprès de l'éditeur :
Tél. 05 45 31 71 56
du.lerot@wanadoofr
Du Lérot, éditeur
Les Usines Réunies
16140 Tusson
www.editionsdulerot.fr
Ex: http://lepetitcelinien.blogspot.com/
Avant-propos
L'ensemble de manuscrits de Mea culpa révélé ici grâce à la libéralité de son propriétaire offre l'occasion d'appréhender sur pièces la démarche d'écriture de Céline. Il se compose d'un premier jet paginé en continu de 1 à 32 et d'une série discontinue d'ajouts, pages isolées ou séries de pages, qui ont par la suite été intégrés au texte final. La brièveté du texte ayant exceptionnellement permis de les reproduire tous en fac-similé, on saisit ici visuellement à la fois, dans la graphie, la fièvre d'une écriture toujours improvisée dans l'instant et les états successifs, qui sont en l'occurrence au nombre d'au moins quatre. Le premier manuscrit en présente lui-même les deux premiers, par les modifications ou corrections immédiates apportées au premier jet. Les ajouts sur feuilles séparées en constituent un troisième. Mais une comparaison attentive avec le texte définitif montre que d'autres ajouts dont le manuscrit ne nous est pas parvenu sont intervenus après ce troisième. Ce texte définitif (1) est donc le résultat d'une quatrième reprise et peut-être davantage pour certaines pages. En dehors des ajouts réunis au premier manuscrit dans la même collection par le hasard de la dispersion et des ventes, quelques autres folios isolés ont pu être retrouvés.
Dans ce volume, tous les ajouts sont présentés à la place qu'ils occupent dans le texte définitif (une série de cinq folios isolés qui constituent en réalité non un ajout mais une variante est donnée en Appendice). Folio après folio, le fac-similé est accompagné en regard de sa transcription en haut de page et du passage correspondant du texte final en pied de page.
Dans son écriture, Céline procède toujours par additions, expansions et approfondissements. Aux diverses étapes, il s'emploie à nourrir le texte initial. Ses formules les plus fortes ou les plus drôles viennent souvent dans une reprise ultérieure. Ses ajouts sont des développements. Quand on a l'occasion de les isoler, ils mettent en évidence les idées auxquelles il tient le plus.
L'étude des états successifs intéresse d'autant plus ici qu'il s'agit de Mea culpa, texte capital qui fait le point sur l'anthropologie et la philosophie céliniennes à un moment critique de l'évolution de Céline. Celui-ci part des constats qu'il vient de faire en U.R.S.S., où la fin de l'exploitation capitaliste lui semble n'avoir pas plus amélioré les hommes que leur condition matérielle. Il en tire sur la nature humaine des conclusions dont la sévérité est celle des Pères de l'Église, auxquels il se réfère d'ailleurs explicitement. Ce credo très sombre, et même virulent, ne fait encore place à l'antisémitisme que sous la forme d'une brève mention (« Pourvu qu'on se sente un peu juif ça devient une "assurance-vie " »), dont l'effet est par la suite amoindri par une autre en sens contraire : « On deviendra "totalitaires". Avec les juif, sans les juifs. Tout ça n'a pas d'importance. » En revanche, ce pessimisme affiché n'exclut pas l'affirmation d'une « quatrième dimension » de l'existence humaine, celle du « sentiment fraternel ».
Ce premier pamphlet est bien différent de ceux qui le suivront. On est encore loin de Bagatelles pour un massacre, qui sera écrit peu après. Ce livre furieux n'est annoncé ici que de biais, en premier lieu par une allusion à la déception qu'a été pour Céline l'accueil médiocre fait à Mort à crédit (« Tout créateur au premier mot se trouve à présent écrasé de haines, concassé, vaporisé ») : le redoublement de cette déception avec le refus de ses ballets sera quelques mois plus tard l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Céline, d'autre part, avait encore beaucoup à dire sur l'U.R.S.S., on le pressent dans un ajout concernant les hôpitaux de Leningrad. Pour le reste, ce condensé de la vision célinienne de l'homme, en mal comme en bien, est une pièce essentielle du puzzle, que l'on peine parfois à assembler, de la figure dessinée par l'œuvre de Céline.
Henri GODARD
1. Publié en décembre 1936 par Denoël dans Mea culpa suivi de La Vie et l'ouvre de Semmelweis ; actuellement disponible dans le volume Céline et l'actualité (Cahiers de la NRF, Gallimard) ; reproduit ici avec l'aimable autorisation d'Antoine Gallimard.
00:05 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La France ne défendant plus les chrétiens d’Orient, la Russie a pris le relais
La France ne défendant plus les chrétiens d’Orient, la Russie a pris le relais
Ex: http://mbm.hautetfort.com/
Comme le montre sa politique en Syrie, la Russie place ses pions au Moyen-Orient en soutenant les chrétien d'Orient. Selon Antoine Sfeir, "à travers cette diplomatie parallèle, Moscou a réussi, en une décennie, à se réimplanter en Méditerranée orientale".

La Russie a fait de la chrétienté d'Orient une diplomatie parallèlle. Crédit Reuters
La Russie veut soutenir les chrétiens d’Orient dans leur ensemble, catholiques et orthodoxes réunis, devant ce qui semble être une posture incertaine de l’Église catholique. En effet, le patriarche d’Antioche et de tout l’Orient maronite, en tentant de donner du temps au régime syrien de Bachar el Assad, s’est fait attaquer par toutes les chancelleries occidentales, et notamment par le président français Nicolas Sarkozy lui-même. Il n’a pas reçu de véritable soutien du Vatican. La position du Vatican s’explique par beaucoup d’hésitations. Certains sont plutôt pour un engagement ferme des chrétiens d’Orient, de plus en plus de laïques devant l’attitude frileuse du Vatican, d’autres arguent qu’il est impossible de secourir le monde entier… Benoît XVI a évoqué ce sujet à plusieurs reprises, il était dans son rôle et n’a pas été repris par les médias. Moscou a voulu s’insérer dans la brèche, sachant que les chrétiens de Syrie craignent la chute du régime et l’arrivée au pouvoir des Frères musulmans à l’instar de ce qui s’est passé en Libye et qui pourrait également arriver en Tunisie. Malgré le fait qu’un dirigeant historique de l’opposition syrienne Michel Kilo soit lui-même chrétien, l’atomisation des partis d’opposition laïques en Syrie rend en effet les Frères musulmans maîtres du terrain.
Mais la Russie n’a pas attendu les événements de Syrie pour faire de la chrétienté d’Orient en général, et de l’orthodoxie en particulier, une diplomatie parallèle. Forts d’une communauté orthodoxe grecque majoritaire parmi les chrétiens en Syrie, et également fortement présente au Liban (13% environ), les Russes avaient déjà entamé depuis le début du troisième millénaire une approche communautaire de ces populations. Leur importance n’est pas à négliger, puisqu’il s’agit des notables des grandes îles du Proche-Orient, qui détiennent une bonne partie du pouvoir économique. De plus, la Russie a maintenu des contacts étroits avec les orthodoxes émigrés sous prétexte de judaïté en Israël. Ils disposent d’ailleurs d’une télévision ainsi que de deux quotidiens à Ashdod. Les Russes ont également des relations très étroites avec des orthodoxes grecs, naturellement, mais également chypriotes. A travers cette diplomatie parallèle, Moscou a réussi, en une décennie, à se réimplanter en Méditerranée orientale. De plus, l’existence d’une poche de gaz importante au large de la Palestine, d’Israël et du Liban, donne également l’occasion à la Russie, et particulièrement à son bras économique Gazprom, de s’installer durablement, à travers ses réseaux et ses contacts, dans cette partie du monde.
Pour toutes ces raisons, et également parce que le siège du patriarcat grec orthodoxe, d’Antioche et de tout l’Orient, se trouve à Damas, les Russes estiment qu’ils sont incontournables dans la défense des chrétiens d’Orient, d’autant que l’Occident, et notamment la France, à laquelle était naturellement dévolue ce rôle, semble y avoir renoncé : la France a libéré la Libye de Kadhafi pour la livrer au chaos tribal et régional, en défendant la population de Benghazi, mais en laissant massacrer celle de Syrte, laissant le chemin libre à l’Islamisme. Le départ du régime Assad, haï dans toute la région, entraînerait par ailleurs une communautarisation de la Syrie, ce qui ne manquerait pas d’avoir des conséquences directes au Liban, où la partition du pays des cèdres serait institutionnalisée.
A telle enseigne que la visite de l’ambassadeur de France aux communautés chrétiennes de Syrie s’est faite sous les drapeaux russes, ce qui montre à quel point la peur des chrétiens est réelle, et à quel point surtout ils sont prêts à tendre la main à quiconque prétend les protéger.
Le renoncement de la France semble s’être fait dans le cadre d’un choix plus tactique que stratégique, visant le pétrole de Libye et la reconstruction du pays, et espérant, à travers l’opposition syrienne, s’établir fortement dans le Proche-Orient. Les Etats-Unis, plus cyniques, -d’aucuns pragmatiques-, disent déjà à haute voix qu’il ne peut y avoir d’avenir pour les chrétiens en Orient et que ces derniers feraient bien d’émigrer vers les pays occidentaux. Leur pragmatisme est conforté par le fait que la majorité des chrétiens, notamment au Liban, disposent déjà d’une double nationalité, d’un double passeport. Mais certains dirigeants chrétiens, en Egypte, en Syrie et au Liban, ne cachent pas leur amertume devant l’attitude franco-américaine, et préfèrent rappeler ce qu’un ancien dignitaire religieux, le patriarche maronite Pierre-Antoine Arida, avait l’habitude de dire : "Notre destin de chrétien d’Orient n’est-il pas de vivre en permanence au bord du précipice, en luttant toute notre vie pour ne jamais y sombrer ?"
Nul ne peut jouer au prophète, surtout dans cette région du monde. Il serait donc maladroit de se risquer à parler d’avenir. Une chose demeure réelle : sans les chrétiens, la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine ou l’Egypte, ne seraient plus que des pays arabes comme les autres.
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, chrétiens d'orient, politique internatonale, russie, france, europe, affaires européennes, syrie, proche orient, asie mineure, méditerranée, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 27 décembre 2011
La riconquista della Libia e la putrefazione morale della sinistra europea
La riconquista della Libia e la putrefazione morale della sinistra europea
di Bahar Kimyonpur
Fonte: aurorasito.wordpress
 Come è possibile che il movimento contro la guerra abbia lasciato fare? Come è possibile che degli scaltri attivisti siano arrivati ad inghiottire tutto ciò che Sarkozy, TF1, Le Monde, France 24 e BBC hanno rovesciato su Gheddafi? Come è possibile che esseri dotati di coscienza e di acuta intelligenza non abbiano imparato la lezione della tragedia che tuttora si sta svolgendo sotto i loro occhi in Afghanistan e in Iraq? Come è possibile che l’estrema sinistra europea abbia potuto applaudire la coalizione militare più predatrice al mondo? Come è possibile che il linciaggio di un capo del terzo mondo, torturato a calci, pugni e calci di fucile, sodomizzato con un cacciavite; il supplizio di un nonno di 69 anni, che ha visto quasi tutta la sua famiglia spazzata via, compresi dei neonati, abbia riunito nel medesimo coro gli “Allah o Akbar” dei teppisti jihadisti, il “Mazel Tov” del filosofo Legion d’honore franco-israeliano Bernard-Henri Lévy, il cin-cin dei signori della NATO, l’esplosione di gioia cinica di Hillary Clinton sulla CBS e gli applausi dei pacifisti europei?
Come è possibile che il movimento contro la guerra abbia lasciato fare? Come è possibile che degli scaltri attivisti siano arrivati ad inghiottire tutto ciò che Sarkozy, TF1, Le Monde, France 24 e BBC hanno rovesciato su Gheddafi? Come è possibile che esseri dotati di coscienza e di acuta intelligenza non abbiano imparato la lezione della tragedia che tuttora si sta svolgendo sotto i loro occhi in Afghanistan e in Iraq? Come è possibile che l’estrema sinistra europea abbia potuto applaudire la coalizione militare più predatrice al mondo? Come è possibile che il linciaggio di un capo del terzo mondo, torturato a calci, pugni e calci di fucile, sodomizzato con un cacciavite; il supplizio di un nonno di 69 anni, che ha visto quasi tutta la sua famiglia spazzata via, compresi dei neonati, abbia riunito nel medesimo coro gli “Allah o Akbar” dei teppisti jihadisti, il “Mazel Tov” del filosofo Legion d’honore franco-israeliano Bernard-Henri Lévy, il cin-cin dei signori della NATO, l’esplosione di gioia cinica di Hillary Clinton sulla CBS e gli applausi dei pacifisti europei?
Ricordiamoci che per evitare l’invasione dell’Iraq, il cui regime era molto più dispotico di quello di Muammar Gheddafi, eravamo dieci milioni in tutto il mondo. Da Jakarta a New York, da Istanbul a Madrid, da Caracas a New Delhi, da Londra a Pretoria, avevamo messo da parte la nostra ostilità nei confronti della dittatura baathista, per fermare l’atto più irreparabile, più distruttivo, più vergognoso, più terroristico e barbaro, e cioè la guerra.
A parte le molte espressioni di sostegno alla Jamahiriya libica, organizzate nel continente africano e, in misura minore, in America Latina e in Asia, la solidarietà con il popolo libico è stata quasi inesistente. Questo popolo composto da una miriade di tribù, di costumi e di volti, questo popolo che ha commesso il crimine di amare il suo dirigente e “dittatore”, di appartenere alla parte sbagliata, alla tribù cattiva, alla zona sbagliata o al quartiere sbagliato, non ha ricevuto alcuna compassione.
I media allineati hanno ignorato l’esistenza di questo popolo che, il 1° luglio, di nuovo, era un milione per le strade di Tripoli a difendere la propria sovranità nazionale, la sua vera rivoluzione autentica, e questo in barba dei cacciabombardieri della NATO. Allo stesso tempo, un altro popolo, quasi identico a quello di Tripoli, un popolo altrettanto innocente, che non aveva raccolto più di poche decine di migliaia di manifestanti, anche con l’appoggio schiacciante dei commandos del Qatar [1], dei propagandisti della Jihad di Egitto, Siria e Giordania [2], anche con le ingannevoli tecniche di ripresa di al-Jazeera per amplificare l’effetto della folla, vennero scelti nel ruolo di “unico popolo.”
Questo popolo godette di ogni favori e attenzione. Anche di ogni armi e ogni impunità. L’umanesimo paternalistico e interessato della NATO verso questi poveracci, ha commosso i nostri sinistri, al punto di fargli dire: “Per una volta, la NATO ha fatto bene a intervenire”.
Non c’è dubbio che il miraggio degli sconvolgimenti sociali, chiamati abusivamente “Primavera araba”, ha contribuito a confondere le acque, probabilmente l’inversione di tendenza (in coincidenza con le dimissioni di molti giornalisti indipendenti), dei canali satellitari arabi come al-Jazeera, che ora sono i giocattoli delle monarchie del Golfo e degli strateghi statunitensi, ha creato confusione, non c’è dubbio che la guerra di propaganda questa volta era meglio preparata, probabilmente le farneticazioni di Muammar Gheddafi e del figlio Saif al-Islam, deliberatamente tradotte male dalle agenzie stampa internazionali, hanno aiutato la propaganda occidentale a rendere questi uomini odiosi. Tuttavia, questo può spiegare l’incredibile silenzio di approvazione dei movimenti alternativi europei, che sostenevano il cambiamento sociale.
Difendere i deboli contro i forti
Sin dagli albori dell’umanità, è una virtù che da sempre ha sollevato l’uomo, il senso della giustizia. Quando la giustizia è assente, a volte, gli uomini sono presi da una sete inestinguibile e lottano per essa, a costo della loro vita. Nel corso della storia, diversi movimenti filosofici e sociali hanno preso la causa della giustizia.
Oggi e nei nostri paesi, le donne e gli uomini che bruciano per Dame Themis, si dicono spesso di essere di sinistra. Hanno fatto della difesa dei deboli contro i potenti la loro lotta, a volte, il loro scopo. Rifiutano categoricamente la legge della giungla. Scrutando la storia, questi amanti della giustizia si pongono quasi per riflesso dalla parte degli Spartani contro le truppe del re persiano Serse, dalla parte dei Galli e dei Daci contro le legioni romane, dalla parte degli Aztechi o degli Incas contro i conquistadores di Pizarro o Cortes, o dalla parte dei Cheyenne contro la Cavalleria USA del colonnello Chivington o del Generale Custer [3].
Il giusto non si lascia ingannare. Sa che è in nome delle nobili cause come civiltà, modernità o diritti umani, che il colonizzatore ha ridotto i “barbari” in stato di schiavitù e distrutto quasi 80 milioni di indiani americani.
Sa anche che difendendo il diritto alla vita degli amerindi, ad esempio, indirettamente avvalla società che erano impegnate in conflitti fratricidi e in guerre di annessione, che praticavano sacrifici umani o lo scalpo. Il Giusto è consapevole che se si opponeva alla guerra in Iraq, riconosceva implicitamente la sovranità nazionale dell’Iraq e, quindi, la continuazione del potere di Saddam Hussein. Questo paradosso non ha impedito la giusta indignazione del trattamento da parte del regime iracheno baathista o dalla Jamahiriya libica, dei loro avversari. Ha giustamente denunciato l’abuso di potere e alcuni privilegi del sistema Gheddafi, a cominciare dalla Guida stessa, dalla sua famiglia e dal suo clan, torture e esecuzioni sommarie perpetrate dai servizi di sicurezza libici, le operazioni di seduzione che il regime aveva lanciato verso le potenze imperialiste corrompendone i capi di Stato.
Ma quando i dissidenti libici si sono compromessi coi peggiori nemici del genere umano, quando divennero dei volgari agenti dell’Impero e si sono a loro volta impegnati in tali atti barbarici contro i lealisti, le loro famiglie, i libici neri e i migranti sub-sahariani, i nostri giusti non hanno fatto marcia indietro. Non hanno denunciato l’impostura. Avrebbero potuto dire “piuttosto che fare la guerra in Libia, salviamo il Corno d’Africa sacrificato dai mercati finanziari“.
Distruggendo il paese più prospero e più solidale dell’Africa, mentre il Corno d’Africa muore di fame e di siccità, l’Impero ci ha dato un’opportunità unica per schiaffeggiarlo. Ma invece di richiamare la realtà crudele ma anche intelligibile e concreta di un semplice slogan di lotta, il nostro giusto si sono rifugiati nel silenzio, accontentandosi di rivangare gli stessi vecchi luoghi comuni sul regime libico, per sentirsi bene e giustificare la loro codardia.
Eppure il giusto non sta mai zitto con gli stolti, come non ulula mai con i lupi. Non accosta mai indietro il piccolo e il grande tiranno. Non che lui apprezzi il piccolo tiranno, ma sente che in un mondo in cui il Leviatano atlantista è caratterizzato da avidità, violenza e criminosità senza pari, sia indegno di unire le forze con esso per schiacciare il piccolo tirano, in questo caso Gheddafi.
Se la resistenza anti-regime, che ha avuto inizio in Cirenaica, roccaforte dei monarchici, dei salafiti e di altri funzionari filo-occidentali, avesse rilevato un qualche slogan anti-imperialista, se fosse un poco patriottico, progressista, onesto, coerente e organizzato, allora la questione del sostegno non si sarebbe postam perché con un tale programma e un tale profilo, non riuscendo a corromperla, la NATO avrebbe almeno cercato di sostenere l’altra parte, cioè quella di Gheddafi.
Ma dall’inizio della rivolta, era ovvio che la presenza al suo interno di alcuni intellettuali e cyber-dissidenti vuoti, ricevessero un eccezionale sostegno multimediale (anche se, ovviamente, non rappresentavano che se stessi e i loro protettori occidentali), non ne facevano un movimento democratico e rivoluzionario.
Pertanto, in Libia, il Giusto doveva difendere Gheddafi, nonostante Gheddafi. Doveva difenderlo non per simpatia per la sua ideologia o le sue pratiche, ma per realismo. Perché, nonostante alcuni aspetti discutibili delle sue manovre diplomatiche e del suo governo, in Libia, in Africa e nel Terzo Mondo, Gheddafi rappresentava con i suoi investimenti economici, programmi sociali, il suo sistema secolare, il tentativo (anche se senza successo) di creare una democrazia diretta garantita dalla Carta verde del 1988, la sua politica monetaria che sfidava la dittatura del franco CFA e, infine, le sue forze armate, l’unica alternativa reale e pratica al dominio coloniale, in assenza di qualcosa di meglio in una regione dominata da correnti oscurantiste e servili.
La stupidità del “né-né”
Né la NATO né Slobodan. Né Saddam né gli USA. Né gli Stati Uniti né i taliban. In ogni guerra, ci servono la stessa ricetta. Di fronte a un predatore che l’umanità non ha mai sperimentato prima, che ora controlla terra, mare e cielo, un nemico senza legge che ha giurato di mettere l’umanità in ginocchio e di far dominare il secolo americano, il loro motto è un vibrante “né-né”. Mentre il vaso di ferro ha polverizzato il vaso di coccio, ciò che trovano da dire è semplicemente un “né-né”. Questa posizione di apparente innocenza, serve solo a scoraggiare e a smobilitare le forze della democrazia e della pace. Offre quindi un assegno in bianco alle forze che dirigono le operazioni di conquista della Libia.
Tra i “né-né” alcuni intellettuali che si pretendono trotskisti come Gilbert Achcar, che ha tristemente applaudito la guerra di conquista della NATO. [4]
Altri, come il Nuovo Partito Anticapitalista (NPA), hanno adottato un atteggiamento schizofrenico, che va dalla critica “formale” della NATO (quando comunque non passano che per dei pro-imperialisti, in ogni caso) e l’approvazione delle sue missioni per eliminare Gheddafi. [5]
Altri attivisti vicini allo stesso movimento [6], sono giunti a chiedere di lanciare armamenti ai mercenari jihadisti al soldo della NATO, quegli stessi fanatici che vogliono combattere il nazionalismo di Gheddafi considerato una minaccia al loro progetto pan-islamico, bruciando il suo Libro Verde, tacciato di essere una “opera perversa”, “comunista e atea“, volta a “sostituire il Corano“.
Secondo alcuni membri di una IV Internazionale tanto ipotetica quanto inoffensiva, il CNT sarebbe malgrado tutto ancora una “forza rivoluzionaria”. Poco importa se il CNT è composto da ex torturatori di Gheddafi, da mafiosi e islamisti sgozzatori di “miscredenti laici”, poco importa che il CNT sia nostalgico del fascismo e del colonialismo italiano [7] e che desideri consegnare la Libia all’Impero su un piatto d’argento, se il CNT è finanziato e armato dalla CIA, dai commandos britannici delle SAS, dai regni del Qatar e dell’Arabia Saudita e anche dal presidente sudanese Omar al-Bashir, perseguito dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità, indipendentemente dal fatto che la NATO abbia commesso crimini contro la popolazione civile della Jamahiriya, i nostri amici trotzkisti hanno deciso: il CNT è l’avanguardia rivoluzionaria…
Nostalgici della guerra civile spagnola come sempre, alcuni di loro mi hanno detto che bisognava offrire ai ribelli libici delle nuove brigate internazionali. Senza dubbio erano contenti quando il bullo dei salotti, il grande amatore delle tirate anti-franchiste, il rinomato BHL li ha dato ascolto. Brandendo la clava della libertà che riflette la sua sacra immagine e con la bandiera fregiata con l’invincibile rosa dei venti, il Durruti miliardario ha sbaragliato le truppe di Gheddafi battendosi il suo petto glabro. Entrò a Tripoli senza fretta alla testa della sua Brigata Internazionale, a cavallo di un missile Tomahawk …
Non è forse alquanto ridicolo, per dei sinistri che non hanno mai toccato una pistola nella loro vita e che sputano su tutti i guerriglieri marxisti del mondo, perché sono stalinisti, fare campagna per la consegna di armi prodotti dalla fabbrica bellica belga FN di Herstal, destinate ai mercenari indigeni al soldo della nostra élite?
Compagni trotzkisti, diteci allora quante armi avete inviato ai “vostri” liberatori? Quanti brigatisti avete inviato sul campo di battaglia? Quanti corrieri avete reclutato? Onestamente, tra gli ausiliari barbuti della NATO e i soldati dell’esercito di Gheddafi arruolati sotto la bandiera del panafricanismo, chi assomiglia di più alle Brigate Internazionali? Come una tale cecità, un tale decadimento ideologico e morale si sono potuti verificare tra le forze che si pretendono radicali e progressiste?
Dopo averci scioccato e, a volte disgustato, per le sue scappatelle, il suo orgoglio e la sua eccentricità, Muammar Gheddafi, al termine della sua vita, ha almeno avuto il merito di riconnettersi con il suo passato rivoluzionario. Al momento più critico della sua vita, ha resistito alla NATO. E’ rimasto nel suo paese, sapendo che l’esito della battaglia sarebbe stato fatale. Ha visto i suoi figli e i suoi nipoti essere massacrati, e tuttavia non ha tradito le sue convinzioni e il suo popolo.
Possiamo sperare che un giorno un terzo del quarto del coraggio, dell’umiltà e della sincerità di Gheddafi, sia nei nostri compagni della sinistra europea, nella loro lotta contro il comune nemico del genere umano?
Note
[1] Su ammissione del generale Hamad bin Ali al-Attiya, Capo di Stato Maggiore del Qatar. Fonte: Libération, 26 ottobre 2011
[2] Ribelli “libici” che parlavano dialetti provenienti da diversi paesi arabi, sono stati regolarmente mostrati sui canali satellitari arabi.
[3] In tutti questi casi, tribù in lotta con i loro fratelli nemici hanno chiamato o si sono alleati con gli invasori. L’alleanza CNT-NATO è l’episodio finale della lunga storia di guerre di conquista supportate dai popoli indigeni.
[4] Intervista a Gilbert Achcar di Tom Mills sul sito britannico New Left Project, 26 agosto 2011. Versione in francese dell’intervista disponibile su Alencontre.org
[5] Comunicato della NPA del 21 agosto e 21 ottobre 2011.
[6] Lega Internazionale dei Lavoratori – Quarta Internazionale (VI Internazionale), Partito Operaio argentino…
[7] L’8 ottobre 2011, il Presidente del Consiglio nazionale di transizione (CNT) libico, Mustafa Abdel Jalil ha celebrato il centenario della colonizzazione italiana della Libia assieme al ministro della difesa italiano Ignazio La Russia, del Movimento sociale italiano (MSI), un partito neofascista. Questo periodo di deportazioni, esecuzioni e saccheggi per Abdel Jalil era l’”era dello sviluppo“. Fonte: Manlio Dinucci, Il Manifesto, 11 ottobre 2011
Traduzione di Alessandro Lattanzio – SitoAurora
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, libye, afrique, affaires africaines, mondearabe, monde arabo-musulman, méditerranée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La critica di Spengler a Marx è di non aver capito il capitalismo moderno
La critica di Spengler a Marx è di non aver capito il capitalismo moderno
di Francesco Lamendola
Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]

È quasi incredibile il fatto che neppure la crisi gravissima che le nostre società stanno attraversando abbia sollecitato negli ambienti culturali, oltre che in quelli economici, un serio dibattito sulle origini di essa e sui meccanismi della finanza che consentono di eludere il fisco e di spostare continuamente ingenti capitali al di fuori di qualsiasi controllo; meccanismi così capillari e pervasivi che perfino il più modesto cittadino, attraverso la trasformazione del risparmio in titoli azionari, diventa possessore teorico di proprietà delle quali non conosce assolutamente nulla se non il controvalore, sempre mutevole, in quotazioni borsistiche.
Questa arretratezza culturale quasi inconcepibile o, per dir meglio, questa assordante assenza di riflessione e di dibattito è, in larga misura, uno dei tanti effetti negativi che l’egemonia del marxismo ha avuto nella mentalità occidentale, anche fra coloro che lo hanno avversato e che lo hanno combattuto.
Una volta stabilito, in via definitiva, che Marx indiscutibilmente era un genio dell’economia politica, non restava che prendere per buona la sua analisi e attrezzarsi di conseguenza, sia che si auspicasse la rivoluzione comunista da lui propugnata, sia che la si paventasse; per cui non solo milioni di cittadini comuni, ma anche quasi tutta la schiera degli economisti e moltissimi filosofi dell’economia, sono rimasti letteralmente ipnotizzati dalle sue formule, dai suoi slogan e dai suoi mantra, ripetuti all’infinito con monotona ed esasperante insistenza.
Senonchè, Marx non era, forse, quel genio dell’economia che tutti affermano: la sua analisi dell’economia politica parte dalla realtà storica del 1848, ma vista - come osserva acutamente Oswald Spengler - con gli occhi di un liberale del 1789; in altre parole, le sue basi culturali erano quelle del diciottesimo secolo, e del capitalismo moderno egli aveva compreso poco o nulla, benché la rapida evoluzione di esso fosse proprio sotto i suoi occhi.
In particolare, Marx non si rese conto della crescente, inarrestabile trasformazione del capitale industriale in capitale finanziario e basò la sua riflessione su una figura quasi mitologica, quella del capitano d’industria che sfrutta gli operai della fabbrica, secondo il modello di Charles Dickens, mentre ben altri erano i meccanismi in movimento e ben altre le modalità di accumulazione capitalistica, assai più complesse e meno spettacolari.
E tuttavia, per quasi un secolo e mezzo, le masse occidentali sono rimaste affascinate e incantate da quella mitologia, da quello schema in bianco e nero, che presentava tutto come semplice e chiaro: di qua gli sfruttatori, alcuni loschi individui in cilindro e redingote, di là le masse sfruttate e sofferenti, gli onesti operai dalle mani callose, costretti a farsi schiavi delle macchine per impinguare i forzieri dei loro insaziabili padroni.
Lo stereotipo ingenuamente manicheo ha retto almeno fino al 1968, aiutato dal fatto, invero paradossale, che la cultura egemone in Italia, e in buona parte del mondo, fino a quella data e ancora oltre, è stata quella di matrice marxista, ma senza che praticamente nessuno di quanti la professavano si fosse dato in realtà la pena di leggere i ponderosi, noiosissimi volumi de «Il Capitale», e tanto meno di leggerli con un minimo di spirito critico. Non si legge un testo religioso con spirito critico, specialmente se si è degli apostoli zelanti: e tali si sentivano milioni di giovani e di meno giovai rivoluzionari” di sinistra, che facevano il tifo - oltre che per Marx - per Lenin, Stalin, Mao, Ho-chi-min e “Che” Guevara. I testi religiosi si citano come verità rivelata e si brandiscono come spade, magari per chiudere la bocca a qualche arrogante infedele.
L’immagine marxiana di una semplicistica contrapposizione fra “capitalista” e “proletario” è rimasta inalterata anche quando Engels, e soprattutto Lenin, hanno ripreso il discorso, riprendendolo là dove Marx di fatto lo aveva lasciato e sviluppando l’analisi del capitalismo finanziario, dei trust, dei cartelli e delle forme impersonali del capitale; ed è rimasta inalterata per la buona ragione che è molto più semplice creare un immaginario collettivo a sfondo mitologico, come ben sanno gli ideatori delle varie forme di pubblicità, specialmente televisiva, che non modificarlo o riequilibrarlo, una volta ch’esso si sia imposto.
Scriveva, dunque, Spengler ne «La rigenerazione del Reich» (titolo originale: «Neubau des Deutschen Reiches», Munchen, 1924; traduzione italiana di Carlo Sandrelli, Edizioni di Ar, Padova, 1992, pp. 92-95):
«L’ideale delle imposte dirette, calcolate in base ad una corretta valutazione fiscale dei propri redditi e pagate personalmente da ogni concittadino, oggi domina così incondizionatamente che la sua equità ed efficacia sembrano evidenti. La critica si rivolge ad aspetti particolari, non al principio in quanto tale. Eppure esso deriva non da considerazioni ed esperienze pratiche, ed ancor meno dalla preoccupazione di sostenere la vita economica, bensì DALLA FILOSOFIA DI ROUSSEAU. Ai crudi metodi degli appaltatori e degli esattori del 18° secolo, volti esclusivamente alla realizzazione di un profitto, esso contrappone il concetto dei diritti umani nati, fondato sulla rappresentazione dello Stato come frutto di un libero contratto sociale - figura, questa, che a sua volta viene contrapposta alle forme statali storicamente sviluppatesi. Secondo questa concezione, è dovere del singolo cittadino e rientra nella sua dignità umana stimare personalmente e pagare personalmente la propria partecipazione al pagamento dei carichi che gravano sull’intera società. Da questo momento la moderna politica fiscale si fonda, dapprima inconsapevolmente poi in modo sempre più chiaro, in corrispondenza con la crescente democratizzazione dell’opinione pubblica, su una Weltanschauung che cede ai sentimenti e agli stati d’animo politici, alla fine escludendo completamente un riflessione spregiudicata sull’adeguatezza dei procedimenti correnti. Quel concetto tuttavia era allora sostenibile. A quell’epoca, la struttura dell’economia era tale che i singoli redditi erano tutti palesi e facilmente accertabili. Essi derivavano dall’agricoltura, da un ufficio oppure dal commercio e dall’industria., dove, in virtù di un’organizzazione corporativa, ognuno poteva conoscere la situazione dell’altro. Non esistevano entrate maggiori da tener nascoste. Inoltre, allora i patrimoni erano un possesso immobile e visibile: terra e campi, case, aziende ed imprese che ognuno sapeva a chi appartenevano. Ma proprio con la fine de secolo è intervenuto nell’ambito economico un sovvertimento che ne ha interamente modificatola struttura interna, il ciclo ed il significato, e che risulta molto più importante di ciò che Marx intende per capitalismo”, ossia l’egemonia dei capitani d’industria. Proprio la dottrina di Marx, poiché parte da una segreta invidia e perciò può scorgere soltanto la superficie delle cose, per un secolo intero ha disegnato con linee false l’immagine riconosciuta dell’economia. L’influenza delle sue formule speciose è stata tanto maggiore in quanto essa ha rimosso i giudizi riferiti all’esperienza, soppiantandoli con i giudizi dettati dal sentimento. È stata così grande che nemmeno i suoi avversari vi si sono sottratti e che la normativa moderna sul lavoro poggia totalmente sui concetti fondamentali interamente marxisti di “prestatore di lavoro”e “datori di lavoro” (come se questi ultimi non lavorassero). Poiché queste formule si riferiscono agli operai delle grandi città, la dottrina rifletteva la svolta decisiva intervenuta verso la metà del XIX secolo con la rapida crescita della grande industria. Ma proprio nell’ambito della grande tecnica lo sviluppo era stato assai regolare. Un’industria meccanica esisteva già dal 18° secolo. Agisce piuttosto da fattore decisivo il progressivo svanire della proprietà intesa come qualità naturale delle cose possedute, con l’introduzione di certificati di valore, quali i crediti, le partecipazioni o le azioni. I patrimoni individuali diventano mobili, invisibili e inafferrabili Essi non CONSTANO più di cose visibili, giacché in queste ultime sono INVESTITI ed in ogni momento possono mutare il luogo e le modalità di investimento. Il PROPRIETARIO delle aziende si è contemporaneamente trasformato in POSSESSORE di azioni. Gli azionisti hanno perduto qualsiasi rapporto naturale, organico con le aziende. Essi nulla capiscono delle loro funzioni e capacità produttive, né se ne interessano: badano solo al profitto. Possono cambiare rapidamente, essere molti o pochi, e trovarsi in qualsiasi luogo; le quote di partecipazione possono essere riunite in poche mani, oppure disperse o addirittura finire all’stero. Nessuno sa a chi realmente appartenga un’azienda. Nessun proprietario conosce le cose che possiede. Conosce soltanto il valore monetario di questa proprietà secondo le quote di Borsa. Non si sa mai quante delle cose che si trovano entro i confini di un Paese appartengono ai suoi abitanti. Infatti, da quando esiste un servizio elettrico di trasmissione delle notizie - che con una semplice disposizione orale consente di cambiare anche la titolarità delle azioni oppure di trasferirle all’estero -, la partecipazioni di azionisti azionali in aziende del nostro Paese può aumentare o ridursi di quantità impressionanti in un’ora di Borsa, a seconda che gli stranieri cedano o acquistino pacchetti azionari, magari in un solo giorno. Oggi in tutte le Nazioni ad economia avanzata oltre la metà delle proprietà è diventata mobile ed i suoi mutevoli proprietari sono disseminati per tutta la terra, avendo perduto ogni interesse che non sia finanziario al lavoro effettivamente compiuto. Anche l’imprenditore è diventato sempre più un impiegato ed un oggetto di questi ambienti. Tutto questo non è riconoscibile nelle aziende medesime e non è accettabile con alcun metodo fiscale. Così però svanisce la possibilità di verificare l’assolvimento del dovere fiscale della singola persona, se il possessore di valori variabili non lo vuole. Lo stesso vale in misura crescente per i redditi. La mobilità, la libertà professionale, la soppressione delle corporazioni sottrae il singolo al controllo dei suoi compagni di lavoro. Da quando esistono ferrovie, piroscafi, giornali e telegrammi, la circolazione delle notizie ha assunto forme che liberano L’acquisto e la vendita dal limite del tempo e dello spazio. La vendita a distanza domina l’economia. Le transazioni a termine superano il semplice scambio tra produttori e consumatori. Il fabbisogno locale per il quale lavorava la corporazione viene ora soddisfatto dalla Borsa merci, che approfitta dei nessi tra la produzione, la distribuzione e il consumo di cose per realizzare guadagni speculativi. Per le banche, al posto delle operazioni di cambio del 18° secolo,la fonte principale di guadagno diventa l’erogazione di crediti, mentre la speculazione con i valori diventati mobili decide da un giorno all’altro nella Borsa valori sull’ammontare del patrimonio nazionale. Così anche i profitti commerciali e speculativi risultano sottratti a qualsiasi controllo ufficiale, alla fine rimangono soltanto i redditi medio-bassi che, come i salari e gli stipendi, sono così modesti che non è proprio possibile sbagliarsi sulla loro entità.»
Può essere una scoperta, per quanti hanno sempre considerato Spengler semplicemente come un filosofo della storia, scoprire in lui una tale acutezza nell’analisi dell’economia politica e una tale indipendenza di giudizio rispetto a un “mostro sacro” come Marx, del quale coglie tutta l’insufficienza speculativa, nonché i sotterranei meccanismi psicologici (la «segreta invidia» del piccolo borghese declassato rispetto ai ricchi imprenditori; salvo poi vivere senza alcun imbarazzo, si potrebbe aggiungere, sul portafoglio di quegli aborriti signori, tramite l’amico Engels che era, appunto, figlio di un capitano d’industria).
In effetti, la fama - positiva o negativa, questo non importa - de «Il tramonto dell’Occidente» ha messo alquanto in ombra le altre opere di questo filosofo e gli svariati e molteplici aspetti del suo itinerario speculativo.
Ma forse, vi è un’altra ragione per cui il cliché mitologico marxiano del capitalismo ha avuto tanto successo, nonostante la sua palese rozzezza e inverosimiglianza: il fatto che ampliare l’analisi dei meccanismi finanziari speculativi avrebbe recato un colpo decisivo all’immagine del proletario moralmente sano e antropologicamente differente dal bieco capitalista.
La verità è che, nella speculazione finanziaria, il cittadino comune è contemporaneamente vittima e carnefice: vittima, perché i suoi risparmi sono risucchiati in un mostruoso, anonimo meccanismo che li utilizza in modi a lui sconosciuti e, comunque, incomprensibili; carnefice, perché egli stesso si avvantaggia della legge della giungla che domina nelle Borse, e realizza margini di profitto ogni qualvolta si indeboliscono titoli e azioni detenuti da altri piccoli risparmiatori, simili a lui.
Tutto questo, naturalmente, non si accorda con il mito dell’operaio e del “lavoratore” senza macchia e senza paura, versione marxista del roussoiano “buon selvaggio”, perciò andava rimosso: le bandiere della rivoluzione andavano sventolate in omaggio a dei fantasmi ideologici, non alla realtà.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:08 Publié dans Economie, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, philosophie, oswald spengler, karl marx, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Chypre et Israël vs Turquie : de l’eau dans le gaz... et le pétrole !
Chypre et Israël vs Turquie : de l’eau dans le gaz... et le pétrole !
Traduit par Laurelou Piguet - ex: http://mbm.hautetfort.com/
Sur la Toile :
Leviathan serait le plus important gisement de gaz naturel offshore de Méditerranée, avec 481 milliards de m3, soit 16% de la production annuelle mondiale. Situé dans la mer méditerranée, à 130km au large d’Haïfa, ce gisement fait l’objet d’un important contentieux territorial entre Israël, le Liban et Chypre, les frontières maritimes n’ayant jamais été clairement définies dans le secteur - d’autant que la République turque de Chypre du nord n’entend pas renoncer à sa part...
 Mi septembre, la société américaine Noble Energy a commencé ses forages d’exploration à la recherche de gisements en gaz naturel ou en pétrole dans la Zone économique exclusive (ZEE) de la République de Chypre. Ankara a alors immédiatement réagi en annonçant l’accélération du processus de ses propres recherches en hydrocarbures au nord de Chypre.
Mi septembre, la société américaine Noble Energy a commencé ses forages d’exploration à la recherche de gisements en gaz naturel ou en pétrole dans la Zone économique exclusive (ZEE) de la République de Chypre. Ankara a alors immédiatement réagi en annonçant l’accélération du processus de ses propres recherches en hydrocarbures au nord de Chypre.
Vers un accord entre la République de Chypre et Israël
Le gisement concerné par la prospection de Noble Energy ne couvre pas toute la ZEE chypriote, mais passe aussi par la ZEE israélienne. Il faudra donc envisager une exploitation partagée. Dans le cas présent, Chypre procède à des forages sur la plateforme Aphrodite pour savoir s’il y a vraiment un gisement à exploiter, en quelle quantité et quelle qualité. S’ils s’avèrent positifs, Chypre ne pourra pas penser à l’exploiter seule et devra conclure un accord avec Israël, comme prévu à l’article 2 de la Convention sur les ZEE entre deux pays. Selon les précédents internationaux en la matière, une telle action est généralement suivie d’un accord-cadre conclu entre les deux sociétés mandatées par les deux pays concernés.
Selon le gouvernement de Nicosie, l’accord Chypre-Israël pour une exploitation partagée du gisement est d’une exceptionnelle importance stratégique car l’accord bilatéral se doublerait d’un accord de défense. Ainsi, si la Turquie frappe les forages de Noble Egery sur la plateforme Aphrodite, c’est comme si elle frappait Israël au coeur de ses intérêts puisqu’Israël serait un État partenaire dans l’exploitation du gisement. Etant donné que cette première phase de forage sera suivie d’une seconde qui devrait avoir lieu début 2012, l’accord d’exploitation partagée, qui se trouve déjà à un stade avancé d’élaboration, dépendra logiquement des résultats des forages de recherches actuellement en cours et sa signature devrait intervenir après janvier 2012.
La contre offensive d’Ankara
Selon les sources diplomatiques, Ankara est parfaitement au courant d’un possible accord entre Chypre et Israël pour l’exploitation de ce gisement. Conscient de l’importance stratégique de ce projet, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan a annoncé qu’Ankara avait décidé de procéder à des recherches sous-marines en accord avec les autorités de la partie turque de Chypre. Il a déclaré ne pas avoir l’intention de faire arrêter les forages au large de la partie grecque de l’île, mais de soutenir les recherches turques.
La Turquie a effectivement mis sur pied une mission d’exploration, escortée de navires militaires. La ministre gréco-chypriote des Affaires étrangères, Erato Kozakou-Markoulli, a minimisé le rôle et les capacités de cette mission. Il s’agit, selon elle, d’équipements obsolètes qui, s’ils avaient été opérationnels, n’auraient pas nécessité que la Turquie s’adjoigne l’aide d’une société norvégienne (qui a fourni un navire d’exploration à la demande de la Turquie il y a quelques mois).
Pour les autorités gréco-chypriotes, Ankara continue à jouer la carte du bras de fer. Ce qu’a démenti le vice-Président turc Bülent Arınç sur Euronews : « Nous n’avons ni l’intention ni le besoin de faire la guerre à qui que ce soit. J’espère que la partie adverse n’aura pas le front de forcer la Turquie à utiliser la force. Nous n’envoyons pas de bateaux militaires pour nous battre. Ils sont là pour protéger les recherches, mais ils sauront résister, en cas du moindre mouvement qui violerait le droit international. C’est un des moyens que nous aurons à utiliser pour défendre nos droits. »
Bülent Arınç a ensuite ajouté : « L’Union européenne doit se dépêcher de réparer une erreur, qui a été d’accepter le Sud de Chypre en son sein, comme si elle représentait toute l’île. C’est peut-être l’une des plus grandes erreurs historiques de l’UE. Si l’administration gréco-chypriote annonce qu’elle se lance dans ces activités au nom de toute l’île, alors l’UE devra y mettre fin. Il faut qu’elle dise aux Chypriotes grecs qu’ils n’en ont pas le droit. »
Un conflit qui se poursuit devant les Nations unies
À New York, au siège des Nations Unies, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan et le Président turco-chypriote Derviş Eroğlu ont signé fin septembre un accord définissant le statut du plateau continental entre la Turquie et la partie nord de l’île, méprisant ainsi le droit international, les votes de l’Onu sur Chypre, l’inexistence, pour la communauté internationale, d’une entité gouvernementale reconnue dans la partie de l’île occupée par les Turcs, mais aussi le soutien international et varié à la République de Chypre [1] dans sa politique de prospection d’hydrocarbures.
Recep Tayyip Erdoğan a en outre précisé que les sociétés qui collaboreraient avec les Gréco-chypriotes à des recherches sous-marines d’hydrocarbures serait automatiquement exclues de tout appel d’offre en Turquie. Entre temps, Nicosie a vu le doigt d’Ankara dans la réaction exprimée par le Liban concernant les sondages opérés par la partie grecque de Chypre. Le ministre de l’énergie libanais a en effet déclaré que « l’accord entre Chypre et Israël pour ces recherches représente une menace pour ses relations avec le Liban ».
Mais Moscou a apporté son soutien à Nicosie dans sa démarche. « Notre position s’appuie sur le droit international et en particulier sur la convention de 1982 sur le droit de la mer », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères. Les menaces turques contre Chypre ont aussi été au centre des discussions que le Président gréco-chypriote Christofias a eues avec le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki Mun, lequel a exprimé son inquiétude. Hillary Clinton a également répété le soutien des États-Unis à la politique énergétique de la République de Chypre.
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, méditerranée, chypre, israël, turquie, pétrole, hydrocarbures, géopolitique, énergie, nations-unies |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Qu'y a-t-il de social dans les réseaux sociaux ?

Qu'y a-t-il de social dans les réseaux sociaux ?
Ex: http://www.huyghe.fr/
L'expression "réseaux sociaux" connaît un incroyable effet de mode à la fois
- pour des raisons pratiques évidentes (nous sommes des millions à "y être" et une bonne part de nos relations avec des amis ou des gens avec qui nous partageons une forme quelconque d'intérêt passe par Facebook, Twitter, Viadeo)
- pour des raisons quasi idéologiques : leurs pouvoirs sont célébrés à la fois par le monde de l'entreprise qui se dit souvent elle-même "en réseaux" (il faut avoir son community manager défendre sa e-réputation par la e-influence et faire le buzz sur le hub pour ne pas être archaïque) et par celui de la politique (les réseaux sont crédités d'avoir "fait" les révolutions arabes et l'année électorale - en France ou aux USA - sera placée sous le signe de la Web-stratégie des candidats, mais aussi de la confrontation avec les protestataires utilisant médias sociaux et self médias..). On peut donc aussi bien évoquer les réseaux sociaux avec le sérieux du manager qu'avec les accents de révolte du libertaire.
De fait les travaux sur les réseaux en tant que systèmes reliant des groupes ou des individus exerçant des interactions et pratiquant des échanges (notamment des échanges d'information) datent de l'après-guerre. Le réseau au sens quotidien (les gens sur qui l'on peut compter pour rendre un service, donner un conseil, ou apporter une forme quelconque de convivialité ou d'intérêt affectif) préexiste, bien entendu à la banalisation des technologies de l'information et de la communication.
Et la notion de réseaux (souvent opposée à celle de pyramide et de hiérarchie) est vraiment entrée dans le Zeitgeist depuis déjà quelques temps. Du reste nous vivons à "L'ère des réseaux", titre d'un livre de Robert Castells date de 1998 et Patrice de Flichy dans "L'imaginaire d'Internet" fait remonter le discours sur les petites communautés fonctionnant démocratiquement grâce à de nouveaux outils de communication des années 70 et 80. Ajoutons que les techniques sur lesquelles reposent les plates-formes des réseaux étaient déjà là potentiellement depuis les débuts d'Internet : de la "page perso" au blog, des bases de données aux sites de partage type Flickr, des forums et réseaux de développement communautaire (BBS, Free Net, Fidonet et autres) aux réseaux au sens actuel, il n'y a pas eu de changement de paradigme.Et le premier "vrai" site de réseau social au sen moderne, sixdegrees.com, au départ sorte de club assez élitiste, date de 1997.
Mais il y a eu, bien entendu, une vraie révolution des usages accompagnée de facilités technologiques : facilités d'expression ou de production (pas besoin de gros budget ou de long apprentissage) et de connexion (s'agréger à un réseau, les faire interférer, beaucoup transmettre à haut débit, trouver des interlocuteurs ou des thèmes d'intérêt, recommander, indexer, commenter, le tout depuis un simple smartphone que l'on porte en permanence, tout cela aussi est devenu enfantin).
Le réseau social en ligne se reconnaît à plusieurs pratiques :
- l'inscription (avec pseudo, anonymement ou pas suivant le site, si invité ou librement),
- le "profil" plus ou moins public et élaboré,
- les listes d'accès, d'invités, de suiveurs et de suivis, de gens autorisés à commenter, modifier, répondre, etc., le contenu, bien sûr
- et la possibilité de lier tous ces éléments (et par exemple d'étendre théoriquement à l'infini son réseau et par le partage de données et par des systèmes de recherche de contenus et de futurs correspondants). Il existe de très fortes variations dans les pratiques ainsi des réseaux où la publicité est la règle et le privé l'exception, des systèmes d'acceptation ou d'exclusion, etc.
En somme un réseau permet deux choses principales :
- s'exprimer (au sens de dire et montrer quelque chose que l'on veut répandre, mais aussi présenter une image de soi dont on est censé avoir la maîtrise et qui peut être falsifiée). Cette expression peut d'ailleurs être purement commerciale : améliorer l'image de son entreprise ou de ses produits, se vendre soi même sur le marché du travail, se faire connaître des clients et prospects. Par ailleurs, le contenu de la communication peut être le réseau lui-même : on montre (publiquement ou de façon semi-publique) l'extension et les composantes de son réseau.
- se relier. Ce lien peut aller de la simple rencontre par écrans interposés de gens avec qui l'on partage un très vague intérêt pour un sujet très commun, jusqu'à un travail d'expertise mené en commun. Les réseaux sociaux ne servent pas seulement à partager de l'information - que ce soit pour sa valeur de connaissance nouvelle ou pour le sentiment communautaire que cela crée-. Ils servent aussi à évaluer en commun, à élaborer, à décider, à voter, à recommander, voire à lutter (organiser des manifestations dans la rue, résister à des tentatives de censure et d'interruption). Ils peuvent aussi s'étendre (et leur extension peut être un objectif en soi, comme pour les usagers de Twitter qui cherchent à se valoriser en ayant un maximum de "followers") : il y a d'ailleurs des dispositifs techniques qui permettent, en cherchant de profil en profil ou de liste en liste, d'étendre le réseaux à tous ceux que l'on vise, pourvu que l'on soit assez habile.
Le lien créé par les réseaux a donc une composante d'affinité (retrouver ceux qui, d'un certain point de vue, sont comme vous, soit parce que vous avez le même profil socioculturel, les mêmes convictions, etc, soit parce que vous avez une passion en commun, depuis le goût pour les vêtements à la mode jusqu'au désir de renverser une dictature et que vous vous découvrez ainsi).
Mais il y a aussi une composante d'intérêt et de réalisation : grâce aux réseaux, on fait et on reçoit.
On fait quelque chose dans la vraie vie ou l'on élabore des travaux en commun (par exemple un encyclopédie de type Wikipedia qui repose sur l'intelligence collective et la "sagesse des foules").
On reçoit quelque chose : il y a toujours un intérêt à être sur un réseau qui vous donne notamment des informations pratiques : conseils, bons tuyaux pour la consommation, bonnes adresses, liens intéressants, documentation précieuse que l'on trouve ainsi de façon bien plus ciblée qu'en recherchant classiquement dans une bibliothèque ou avec un moteur de recherche. Il se peut aussi que ce que l'on reçoit soit de l'ordre des satisfactions psychiques : sentiment d'appartenir à une élite, plaisir de se regrouper avec des gens qui pensent comme vous et vous confirment l'excellence de vos choix, plaisir du nouveau et de la découverte. Les satisfactions narcissiques ("j'ai tant de friends, de fans, de followers...") ne sont pas les plus négligeables
Il peut aussi y avoir des buts pratiques, entre faire et recevoir : trouver une épouse, jouer en ligne, monter un projet, avoir un entretien d'embauche, améliorer sa valeur professionnelle ou marchande, vendre...
Dans un réseau social, il y a un média social (un dispositif de communication) plus une médiation sociale (une communauté sociale à travers laquelle on atteint des objectifs, mais qui nous transforme en retour). Cela en fait un défi pour une réflexion stratégique ou médiologique que nous avons bien l'intention de poursuivre sur ce site.
00:05 Publié dans Actualité, Manipulations médiatiques, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, réseaux sociaux, internet, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Jünger et ses dieux...
Jünger et ses dieux...
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Les éditions Orizons ont publié en début d'année un essai de Michel Arouimi intitulé Jünger et ses dieux. Michel Arouimi est maître de conférence en littérature comparée à l'Université du Littoral de la région Nord-Pas-de-Calais.
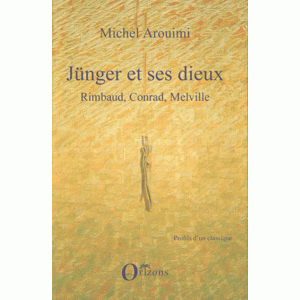
"Le sens du sacré, chez Ernst Jünger, s'est d'abord nourri de l'expérience de la guerre, ressentie comme une manifestation de la violence que le sacré, dans ses formes connues, semble conjurer. D'où le désir, toujours plus affirmé chez Jünger, d'une nouvelle transcendance. Mieux que dans ses pensées philosophiques, ces problèmes se poétisent dans ses grands romans, où revivent les mythes dits premiers. Or, ces romans sont encore le prétexte d'un questionnement des pouvoirs de l'art, pas seulement littéraire. Dans la maîtrise des formes qui lui est consubstantiel, l'art apparaît comme une réponse aux mêmes problèmes que s'efforce de résoudre le sacré. La réflexion de Jünger sur l'ambiguïté du sens de ces formes semble guidée par certains de ses modèles littéraires. Rimbaud a d'ailleurs laissé moins de traces dans son oeuvre que Joseph Conrad et surtout Herman Melville, dont le BillyBudd serait une source méconnue du Lance-pierres de Jünger. La fréquentation de ses " dieux littéraires ", parmi lesquels on peut compter Edgar Poe et Marcel Proust. a encore permis à Jünger d'affiner son intuition de l'ordre mystérieux qui s'illustre aussi bien dans la genèse de l'oeuvre écrite que dans un destin humain."
00:05 Publié dans Littérature, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, livre, révolution conservatrice, allemagne, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 décembre 2011
Generation Lovecraft: Die Flucht in den konservierten Raum
| Generation Lovecraft: Die Flucht in den konservierten Raum |
|
Geschrieben von: Dietrich Müller |
|
Ex: http://www.blauenarzisse.de/ |
|
Heute ist nichts mehr im Überfluss vorhanden. Das Wort Freizeit, vorher noch Gebot der Stunde, hat einen schalen Klang bekommen, sogar einen leicht despektierlichen. Von meinen Bekannten und Freunden gleichen Alters sind ungefähr ein Viertel durch Suizid abgetreten, ein großer Teil hat immerhin hart dorthin gearbeitet. |
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lovecraft, réflexions personnelles, philosophie, déclin, nihilisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'ombra di Washington su Papua
L'ombra di Washington su Papua
di Michele Paris
Fonte: Altrenotizie [scheda fonte]
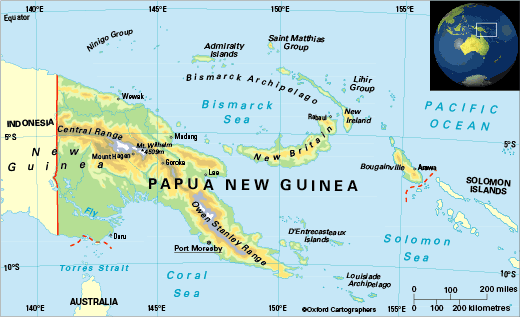
La crisi costituzionale che da poco più di una settimana sta tormentando la Papua Nuova Guinea sembra essersi finalmente avviata verso una conclusione. La disputa attorno alla carica di primo ministro tra i due più popolari uomini politici della ex colonia australiana si inserisce nel quadro delle rivalità crescenti in Estremo Oriente e nell’area del Pacifico tra la Cina da un lato e gli Stati Uniti e l’Australia dall’altro.
La crisi in Papua Nuova Guinea era esplosa in seguito alla prolungata permanenza del premier Michael Somare a Singapore, dove si era recato la scorsa primavera per ricevere cure mediche. Con Somare lontano dal paese, il presidente del Parlamento aveva allora dichiarato vacante la carica di primo ministro e, il 2 agosto, una larga maggioranza di deputati aveva proceduto ad eleggere Peter O’Neill a capo di un nuovo governo. La mossa del Parlamento era stata favorita anche dall’annuncio fatto dai familiari di Somare che quest’ultimo aveva intenzione di ritirarsi dalla politica, così come dal conseguente passaggio di molti suoi sostenitori nel campo del rivale O’Neill.
Tornato alla fine in patria, Somare - primo ministro dall’indipendenza nel 1975 al 1980, dal 1982 al 1985 e ancora dal 2002 fino alla sua rimozione qualche mese fa - aveva fatto appello alla Corte Suprema per cercare di riottenere la sua carica. Il 12 dicembre scorso, infatti, il più alto tribunale della Papua Nuova Guinea aveva dichiarato incostituzionale la nomina a premier di O’Neill, poiché il 75enne Somare non aveva rassegnato le proprie dimissioni né era stato formalmente dichiarato incapace a governare.
Anticipando la sentenza della Corte Suprema, Peter O’Neill pochi giorni prima aveva fatto però approvare una legge retroattiva che revocava il congedo temporaneo di Somare per recarsi a Singapore. Lo stesso 12 dicembre, poi, poco prima dell’emissione del verdetto della Corte, era arrivato un provvedimento che dichiarava decaduto qualsiasi membro del Parlamento che fosse rimasto al di fuori dei confini del paese per più di tre mesi. Un’ultima misura, infine, ha imposto il ritiro dalla carica di primo ministro al compimento del 72esimo anno di età.
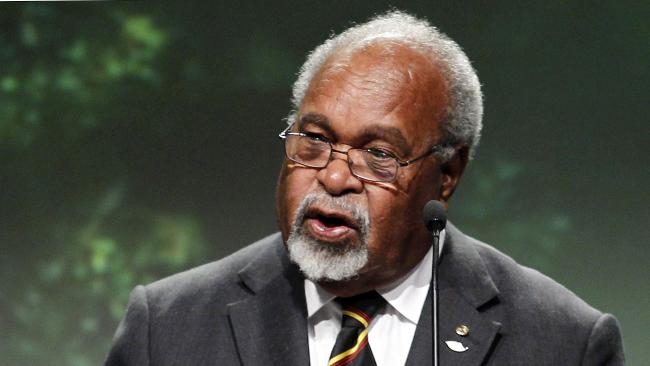 Somare e O’Neill settimana scorsa si erano così ritrovati a capo di due gabinetti ed entrambi avevano nominato un proprio capo della polizia. In questa situazione, le tensioni nel paese erano salite alle stelle, con l’esercito e le forze di polizia chiamate a presidiare le strade della capitale, Port Moresby, per timore di possibili disordini. Nella serata del 12 dicembre, le inquietudini avevano raggiunto il culmine, quando la polizia fedele a Somare aveva impedito a O’Neill l’accesso al palazzo del Governatore Generale, Michael Ogio.
Somare e O’Neill settimana scorsa si erano così ritrovati a capo di due gabinetti ed entrambi avevano nominato un proprio capo della polizia. In questa situazione, le tensioni nel paese erano salite alle stelle, con l’esercito e le forze di polizia chiamate a presidiare le strade della capitale, Port Moresby, per timore di possibili disordini. Nella serata del 12 dicembre, le inquietudini avevano raggiunto il culmine, quando la polizia fedele a Somare aveva impedito a O’Neill l’accesso al palazzo del Governatore Generale, Michael Ogio.
Proprio quest’ultima figura ha giocato un ruolo chiave nella crisi e nella sua risoluzione. Il Governatore Generale della Papua Nuova Guinea è il rappresentante del capo dello stato, la regina d’Inghilterra, e, pur essendo una carica in larga misura simbolica, secondo la Costituzione del 1975 ha la facoltà di dare l’assenso formale alla nomina di primo ministro. In base ai poteri assegnatigli, il 14 dicembre Ogio aveva fatto giurare i ministri scelti da Michael Somare, restituendogli di fatto la carica di capo del governo.
Per tutta risposta, il Parlamento aveva votato la sospensione dello stesso Governatore Generale, il quale è stato però reinsediato lunedì dopo una clamorosa inversione di rotta. In una lettera al Parlamento, il rappresentante della regina Elisabetta II in Papua Nuova Guinea ha infatti ritrattato la sua precedente presa di posizione, attribuendo il suo appoggio a Somare a cattivi consigli legali che gli sarebbero stati dati, riconoscendo invece la legittimità della nomina a primo ministro di Peter O’Neill.
Ciononostante, Somare non sembra ancora aver desistito dalla battaglia per riavere il suo incarico, anche se a questo punto appare estremamente improbabile che la vicenda possa avere un nuovo rovesciamento di fronte. Non solo perché negli ultimi giorni si sono moltiplicati all’interno del paese e nella comunità internazionale gli appelli ad una risoluzione rapida della crisi, per evitare ripercussioni negative sull’economia di un paese già afflitto da elevatissimi livelli di povertà, ma soprattutto perché a decidere gli esiti della crisi sono state forze esterne riconducibili alle potenze che si contendono l’egemonia nell’intera regione dell’Asia sud-orientale.
 A risultare decisiva per la sorte di Michael Somare è stata in particolare la sua politica filo-cinese, che in questi ultimi anni ha complicato non poco i suoi rapporti con l’ex potenza coloniale, l’Australia. Grazie alle aperture di Somare verso Pechino, la Cina ricopre oggi un ruolo importante nel redditizio settore minerario della Papua Nuova Guinea. Uno dei progetti più ambiziosi assegnati ai cinesi è quello da 1,6 miliardi di dollari, che prevede lo sfruttamento della miniera Ramu, dove si estrae nickel e cobalto.
A risultare decisiva per la sorte di Michael Somare è stata in particolare la sua politica filo-cinese, che in questi ultimi anni ha complicato non poco i suoi rapporti con l’ex potenza coloniale, l’Australia. Grazie alle aperture di Somare verso Pechino, la Cina ricopre oggi un ruolo importante nel redditizio settore minerario della Papua Nuova Guinea. Uno dei progetti più ambiziosi assegnati ai cinesi è quello da 1,6 miliardi di dollari, che prevede lo sfruttamento della miniera Ramu, dove si estrae nickel e cobalto.
Peter O’Neill, al contrario, appare invece decisamente più vicino all’Australia, come dimostra l’orientamento del suo governo in questi mesi. Lo scorso ottobre, ad esempio, O’Neill ha guidato una delegazione di nove ministri a Canberra dove è stato raggiunto con il governo laburista di Julia Gillard un accordo per far tornare sul territorio della Papua Nuova Guinea un certo numero di militari e poliziotti federali australiani. L’ultimo contingente di ufficiali australiani presenti nella ex colonia era stato allontanato proprio da Michael Somare nel 2005.
La crisi costituzionale in questo paese di 7 milioni di abitanti - situato in una posizione strategica tra Australia e Indonesia e con ingenti risorse naturali . si era sovrapposta all’importante visita dello scorso novembre nella regione da parte del presidente americano Obama, il quale aveva ribadito il ruolo aggressivo del suo paese in quest’area del globo in funzione anti-cinese. Solo qualche giorno prima, il Segretario di Stato, Hillary Clinton, aveva fatto visita proprio alla Papua Nuova Guinea durante un tour asiatico, segnalando l’interesse prioritario di Washington per un paese dove, tra l’altro, la texana ExxonMobil sta lavorando ad un progetto legato all’estrazione di gas naturale del valore di svariati miliardi di dollari.
Il disegno degli Stati Uniti in Asia sud-orientale e nel Pacifico è condiviso in pieno dal governo australiano, che non a caso nei fatti della Papua Nuova Guinea di questi mesi sembra aver giocato un ruolo decisivo. Con il beneplacito americano, Canberra si è infatti mossa attivamente dietro le quinte per assicurare l’instaurazione a Port Moresby di un governo più benevolo nei confronti degli interessi di USA e Australia, favorendo l’uscita di scena di un ormai ex primo ministro considerato troppo accomodante verso i rivali cinesi.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asie, affaires asiatiques, politique internationale, géopolitique, géostratégie, océan pacifique, pacifique, papouasie, etats-unis, océanie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Gare au clergé de l'idolâtrie financière !
Gare au clergé de l'idolâtrie financière !
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com/
Nous reproduisons ci-dessous un article du criminologue Xavier Raufer , cueilli sur le site du Nouvel Economiste et qui entend casser le discours uniforme et convenu produit par la caste des journalistes économiques et autres suppôts du libéralisme sur ces fameux marchés qui veulent imposer leur loi aux états...

Gare au clergé de l'idolâtrie financière!
“Les marchés par-ci… les marchés par-là…” : lisons, scrutons les médias – ou, devrait-on plutôt dire, suivons la grand-messe médiatique. “Les marchés” : la révérence prosternée de tant de journalistes, de droite ou de gauche d’ailleurs, tout pareil. Une foi d’autant plus brûlante que leur feuille de paye dépend quand même un peu de la ferveur des génuflexions, en un temps où, désormais, maints médias nationaux d’information appartiennent à des milliardaires.
Identique révérence, notons-le, chez nombre de politiciens. “Les marchés” en Dieu jaloux, en Sauveur suprême ! Leur gloire, leur terrible majesté… leur implacable justice. Tels sont, au quotidien, les élans d’une néo-bigoterie médiatique à faire rougir un curé intégriste. Mais au fait, ces fameux “marchés” sont-ils une force, au sens de la physique d’Aristote ? Rappel : on ne perçoit jamais une force, on ne voit que ses effets : le vent et les branches qui bougent, les courants marins et les épaves dérivant même par calme plat, etc.
Non, les marchés ne sont en rien une force : celle-ci est naturelle, indifférente à l’homme – on ne manipule pas un séisme, on ne spécule pas sur un ouragan. Les marchés sont bien plutôt – on rougit de devoir le rappeler – une pure quantité métaphysique, d’essence ni plus ni moins religieuse que “le bon Dieu” ou “la Révolution”. Un de ces phénomènes para-religieux qu’au XVIIIe siècle les libres-penseurs, marquis de Sade en tête, qualifiaient crûment de “dégoûtant fantôme” ou de “superstition gothique”. Or comme tout culte, secte ou religion, une abstraction de type “les marchés”, “le bon Dieu” ou “la Révolution” ne fonctionne que quand on y croit. En son temps, l’Inquisition parlait d’“acte de foi” (autodafé).
Croire, ici au sens d’une crédulité toujours attisée ici-bas par des intercesseurs, par un clergé qui parle aux dieux, interprète leurs décrets ou colporte leurs messages – mais surtout, qui sait les apaiser.
Et là, avertit le criminologue, attention aux brebis galeuses. Dans le champ du religieux, cela va du gourou escroc à l’imam fraudeur, en passant par le rabbin receleur ou le curé pédophile. Certes, des minorités parmi bien de braves gens – des saints, parfois. Mais assez nombreux ces temps-ci pour que cela fasse désordre.
Dans le champ de l’idolâtrie financière, gare au Veau d’or ! Gare à Wall Street, temple dans le genre coupe-gorge. Nous avons récemment abordé ce sujet ici et donc, n’y revenons pas. Au-delà, gare au culte de la DGSI (Davos-Goldman-Sachs-Idéologie) mais surtout, gare à son clergé. Attention, aussi bien à ses grands prêtres à la Madoff qu’à sa prêtraille financière ou médiatique, préposée aux conversions boursières ou à l’agit-prop-encensoir.
Dès 2007, ce clergé-DGSI a montré combien il savait commettre, ou couvrir, les pires fraudes. Depuis lors, la fiévreuse avidité qui ronge ces dangereux zombies n’a pas diminué, au contraire. Ni leur addiction au dollar, d’autant plus maniaque qu’elle est sans doute l’unique antidote à leur vacuité intérieure.
Avidité ? Incontrôlable déferlement ? Qu’on en juge, au vu des récents exploits des prédateurs de Wall Street :
- Encore et de plus belle (International Herald Tribune, novembre 2011) : suite à maintes acrobaties, la société de Bourse MF Global s’effondre ce mois-ci. Les syndics de faillite découvrent alors la “disparition” de 600 millions de dollars de dépôts de ses clients, du fait d’une comptabilité interne “bâclée”. Mais à quoi bon faire soigneux, quand la justice est aux abonnés absents ?
- Impunité (New York Review of Books, novembre 2011) : “Jusqu’à ce jour, les agences fédérales [de répression] n’ont sérieusement inquiété aucun des principaux acteurs de l’effondrement et nul dirigeant de grande banque n’a été inculpé pour fraude criminelle.”
- Incorrigibles (New York Times, novembre 2011) : ces 15 dernières années, 19 grands établissements de Wall Street (Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, plus une quinzaine d’autres) ont été condamnés pour malversations financières. Et ont dû jurer devant la justice qu’ils ne violeraient désormais plus les lois financières fédérales de leur pays. Ils ont juré avec effusion – pour copieusement récidiver dans la foulée, 51 serments suivis d’autant de fraudes, de 1995 à 2010.
- Nouveaux territoires de prédation. En novembre 2011 toujours, Paul Volcker, ancien ministre des Finances des Etats-Unis et ex-président de la Réserve fédérale, s’inquiète fort de l’existence d’un “soi-disant ‘système bancaire fantôme’, banques d’affaires, hedge funds, assureurs, marchés monétaires et autres entités peu ou pas réglementées, qui explose vers l’an 2000 et égale en taille, dès juin 2008, le système bancaire traditionnel”.
Cependant, en matière d’aveuglement financier, le pire survient en Europe. Où, alors que perdure la prédation de Wall Street, les dirigeants de Bruxelles décident de confier au loup-DGSI les clés de la bergerie.
Plutôt prudent en matière financière, Le Monde en vient à dénoncer une “franc-maçonnerie de relations” : “Le nouveau président de la Banque centrale européenne, le président du Conseil italien et le nouveau Premier ministre grec”, sont tous des “anciens de chez Goldman Sachs”. On apprend ainsi l’existence d’un “maillage serré, souterrain comme public” d’hommes-liges de la DGSI, qui “cachent cette affiliation quand ils doivent donner une interview ou mènent une mission officielle”. Entre deux entourloupes financières, les mêmes trouvent le temps de se coopter aux postes dirigeants de la “Trilatérale, un des plus prestigieux cénacles de l’élite internationale”.
Minables maniaques de la conspiration ! Pauvres collectionneurs de complots ! Aujourd’hui, en matière de finance pousse-au-crime, les paranoïaques les plus échevelés sont quand même largement au-dessous de la vérité, telle qu’elle s’étale chaque jour dans la presse.
Xavier Raufer (Le nouvel Economiste, 25 novembre 2011)
00:05 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, oligarchie, finances, économie, criminalité, criminalité en col blanc |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Carl Schmitt et la théologie politique...
Carl Schmitt et la théologie politique...
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Les éditions du Cerf viennent de publier un recueil comportant quatre essais inédits du juriste et philosophe politique allemand Carl Schmitt. Le volume est présenté par Bernard Bourdin, professeur de philosophie et de théologie à l'université de Metz, et préfacé par Jean-François Kervégan, auteur récent d'un essai intitulé Que faire de Carl Schmitt ? (Gallimard, 2011).
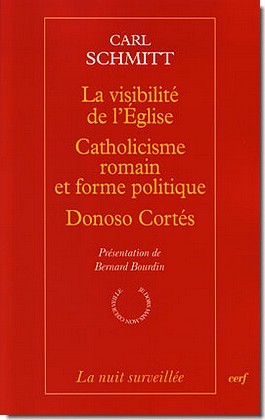
"L'expression « théologie politique » n'a jamais été utilisée en tant que telle par les théologiens chrétiens. Elle n'apparaît pour la première fois que dans le titre d'un ouvrage majeur de la philosophie du XVIIe siècle, le « Traité théologico-politique » de Spinoza. L'intention de son auteur était de conjoindre la souveraineté et la liberté de pensée, et par là même de régler le « problème théologico-politique ». Il faut attendre l'anarchiste Bakounine, au XIXe siècle, pour « réhabiliter » la théologie politique à des fins révolutionnaires, puis pour dénoncer le déisme de Mazzini.
En 1922, en rédigeant son premier texte sur la théologie politique, Carl Schmitt prend le contre-pied de l'anarchisme révolutionnaire. Avec le juriste rhénan, la théologie politique est désormais identifiée à la théorie de la souveraineté. C'est par une formule lapidaire, devenue célèbre, qu'il commence son essai : « Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle. » Dès la fin du IIe Reich, puis dans le context de la république de Weimar, tout le projet intellectuel de Schmitt est d'articuler sa théorie du droit et du politique à une structure de pensée théologico-politique. Le problème de la démocratie libérale est son incapacité à disposer dune véritable théorie de la représentation, en raison de l'individualisme inhérent à la pensée libérale. Face à cette impuissance, le catholicisme, par sa structure ecclésiologique, offre au contraire tous les critères de la représentation politique et de la décision.
Les textes que Bernard Bourdin présente dans ce volume, parus entre 1917 et 1944, sont des plus explicites s'agissant de ces aspects de la théorie schmittienne : institution visible de l'Église, forme représentative et décisionnisme. Ils mettent de surcroît en évidence la double ambivalence de la pensée de Schmitt dans son rapport au christianisme (catholique) et à la sécularisation. En raison de son homologie de structure entre Dieu, État et Église, la nécessité d'une transcendance théologico-politique plaide paradoxalement pour une autre approche d'une pensée politique séculière. Ambivalence qui ne sera pas non plus sans équivoque."
00:05 Publié dans Livre, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, révbolution conservatrice, catholicisme, théologie politique, théorie politique, politologie, philosophie, sciences politiques, droit, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook