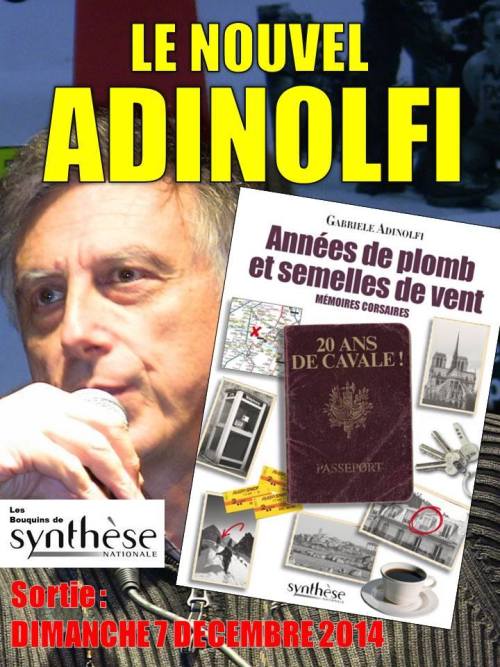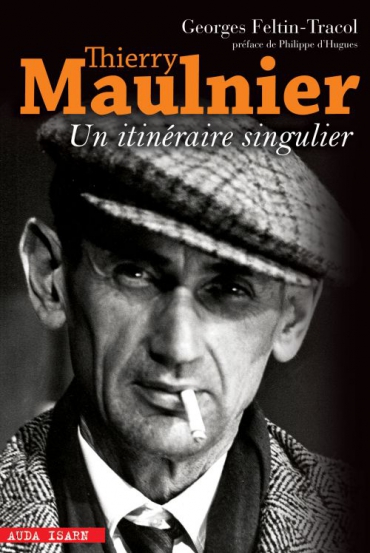vendredi, 19 décembre 2014
Des réponses décisives

Des réponses décisives
par Georges FELTIN-TRACOL
 Ancien responsable de l’excellente revue écologiste radicale Le recours aux forêts, Laurent Ozon est un penseur organique de belle facture. Président-fondateur de l’association Maison Commune, il a publié fin septembre 2014 un recueil d’entretiens intitulé France, les années décisives, puis lancé dans la foulée à Paris le Rassemblement pour un Mouvement de Remigration (R.M.R.). Ses réponses se révèlent pertinentes.
Ancien responsable de l’excellente revue écologiste radicale Le recours aux forêts, Laurent Ozon est un penseur organique de belle facture. Président-fondateur de l’association Maison Commune, il a publié fin septembre 2014 un recueil d’entretiens intitulé France, les années décisives, puis lancé dans la foulée à Paris le Rassemblement pour un Mouvement de Remigration (R.M.R.). Ses réponses se révèlent pertinentes.
Cependant, afin de ne pas verser dans la dithyrambe stérile et donc inutile, il convient au préalable d’émettre quelques critiques. De tous les chapitres qui organisent ce livre, le dernier « Engagements et style de vie », est le moins convaincant, car riche en paradoxes. Le premier repose sur cette déclaration : « Ne lisez pas trop, vivez, parlez, sentez, battez-vous. Tout est déjà en vous. Les livres ne vous apporteront pas ce qui vous manque (p. 97) » tout en éditant un livre ! L’esprit malicieux pourrait fort bien appliquer ce conseil en ne l’achetant pas… À rebours de l’auteur, soulignons que certains ouvrages peuvent combler des manques et ce, en particulier dans le domaine des connaissances. Concilier expériences pratiques et lectures livresques donne parfois à de bons résultats si la synthèse réalisée correspond bien sûr à l’idiosyncrasie du lecteur.
Plus grave est la seconde contradiction. En fondant le M.R.M., Laurent Ozon prévient qu’il n’aura aucune « implication électorale au moins jusqu’en 2017 (p. 93) ». L’auteur assure en outre qu’il « prône surtout un réalisme en politique (p. 93) ». Le champ politique électoral sur ce créneau spécifique est, pour l’instant, largement occupé par le F.N. Il y a donc de la sagesse dans ce retrait volontaire d’autant qu’« on n’entre pas en politique pour défendre des idées, prévient-il, mais pour prendre de la puissance et faire dominer dans la sphère sociale ses vues et sa capacité opérationnelle. Sinon on se trompe d’engagement (p. 93) ». Par conséquent, le M.R.M. se cantonne à une fonction, sinon « métapolitique », pour le moins d’influence et/ou d’agitation auprès de l’opinion publique comme le prouve l’excelente campagne sur Internet avec des affiches invitant les bien-pensants à enfin accueillir les fameux « sans-papiers ». Or a-t-il dès à présent l’audience et, surtout, les moyens d’aller au devant d’un public qui ignore tout de son auteur ? À moins que ce mouvement ne se contente d’un rôle ingrat en coulisse et de la fonction honorable de laboratoire d’idées, mais pour influencer qui ?
Culbuter les idées reçues !
Cette absence de méthode contraste lourdement avec les injonctions impérieuses de l’auteur pour qui « apprendre à bien faire les choses est aujourd’hui plus nécessaire à beaucoup, qu’apprendre à savoir pourquoi le faire. C’est un peu abrupt mais c’est ainsi. Si chacun donne son avis sur les finalités, les stratégies et la tactique, c’est aussi parce qu’il n’existait pas jusqu’ici de mouvement qui fasse autorité et inspire le respect. Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour que cela change. Nous verrons alors si les bavards peuvent trouver leur place et s’inscrire dans une action collective qui implique discipline, dévouement et sens des responsabilités (p. 98) ». Une telle exigence de discipline se comprend, s’exige et s’approuve dans le cadre du combat politique – électoral, certainement pas dans celui d’une association culturelle ou à visée métapolitique. Dans l’affrontement politico-électorale, le militant engagé espère recueillir des satisfactions matérielles, en particulier un mandat électif. Avec de pareilles injonctions, quel contentement le militant culturel peut-il retirer ? Laurent Ozon semble ici confondre les essences du politique et de l’économique. Il transpose dans le champ métapolitique des pratiques de gestion issues du monde de l’entreprise. De méchantes langues y verraient l’indice d’un comportement sectaire… En outre, ce sens de la discipline n’est possible que par temps de « passions chaudes », voire bouillantes. En dépit des manifestations de masse des « pépères en loden » contre le « mariage pour tous », force est de constater que les passions profondes restent froides.
On ne doit toutefois pas se focaliser sur ces quelques points litigieux. Avec le brio qu’on lui connaît, Laurent Ozon expose très clairement les moyens pour s’en sortir. Son message est révolutionnaire parce que « la situation actuelle est celle d’un pays ouvert aux quatre vents, crispé sur des choix économiques obsolètes et pris en otage par des lobbies d’intérêts. Il sera difficile de réformer ce système sans un sérieux coup de balai (p. 19) ». Il ne manie pas la langue de bois ou les sots éléments de langage châtré. Il détermine clairement l’ennemi aux différentes facettes. C’est « les Droits de l’Homme [qui] sont un élément du dispositif d’ingérence à prétention morale, de l’Occident américano-centré contre ses adversaires (p. 53) ». Leurs effets en sont calamiteux puisque « la plupart des Européens baignent dans une idéologie qu’on pourrait appeler l’idéologie du flux ou l’idéologie de l’échange. Idéologie qui nous fait considérer comme des agrégats aléatoires (p. 75) » et sont « atteints d’une sorte de sida mental, d’une forme de perte d’immunité dont la clé de notre capacité à nous penser nous-mêmes comme des groupes, des communautés, des peuples (pp. 65 – 66) ».
Oligarchie, Mégamachine, État ethnocidaire
Détaché de toute thèse conspirationniste, l’auteur en impute la responsabilité première au fait d’avoir « grandi dans une société-bulle nourrie par une économie incroyablement dynamique. Une méga-machine économique, technologique et culturelle (p. I) » alors que « certains savaient déjà que cette bulle était un mirage qui reposait sur un cycle d’exploitation énergétique limité, financé par des dettes contractées dans une monnaie discrétionnaire, sans autre valeur que celle du papier sur laquelle elle est imprimée; un système cynique et meurtrier contrôlé par des puissances financières colossales; doté d’une puissance militaire, médiatique et culturelle prête à écraser toute contradiction sous les bombes, les mensonges et la sidération produite par son industrie du divertissement (pp. I – II) ». Bref, « cette société n’est pas viable. Elle va donc se trouver dans les 20 années à venir en face de ses contradictions (p. 94) ».
Il observe en sociologue de l’immédiat aussi qu’« une oligarchie occidentale s’est constituée durant deux siècles. Cette oligarchie a prélevé dans les bourgeoisies nationales des pays dits occidentaux les meilleurs et les plus compétents dans tous les domaines pour former une “ superclasse ” dont les intérêts et les réseaux, les territoires d’influence, se sont mondialisés (p. 1) », ce qui a un impact considérable en France parce que « notre classe politique est le résultat sidérant de plus de quarante années de contre-sélection. […] Malgré quelques exceptions notables, notre classe politique est un ramassis d’opportunistes sans colonne vertébrale, de rusés nuisibles et incompétents. Ils appartiennent à une sociologie en formation, une oligarchie de gestion de notre affrontement. Les plus intelligents sont membres d’une superclasse mondialisée mentalement qui ne se sent plus de communauté de destin avec le peuple; et les moins intelligents sont les pantins d’intérêts qui les dépassent (pp. 4 – 5) ». Maître de l’appareil administratif, judiciaire, médiatique et financier, cette prétentieuse caste politicienne a transformé « l’État français [… en] office de colonisation de son propre territoire contre sa propre population (p. 63) » qui planifie et organise « une politique d’assassinat d’un peuple (p. 63) », les Français d’ethnie européenne. Il l’illustre par un exemple édifiant : « Le MEDEF et la F.N.S.E.A. sont les acteurs incontournables depuis 30 ans de la conversion de l’industrie agro-alimentaire et du paysannat en une activité industrielle à la botte des transnationales, activité qui fabrique du chômage, de la souffrance animale, de la pollution écologique et des denrées immondes, sans jamais évoquer le mal de vivre des agriculteurs (p. 33) ». Dans le même temps, il s’agit de briser tout sentiment de résistance populaire structurée. Ainsi, l’« utilisation extensive d’un vocabulaire principalement psychiatrique pour caractériser les réactions du corps social et, simultanément, la criminalisation par la loi des opinions ainsi désignées pour en faire des délits sont d’évidence liberticides et n’ont qu’un seul objectif : tuer le débat pour imposer (user de la force) des normes à la société et pour d’autres intérêts, provoquer de la polémique, de la colère et détourner l’attention de la population d’autres questions cruciales (pp. 47 – 48) ».
En macro-économie, il constate que « la crise de l’euro est le résultat d’une opération d’instabilisation menée par le monde financier et ce que l’on a coutume d’appeler “ l’État profond américain ” pour maintenir le statut du dollar comme monnaie de change internationale (p. 35) ». Laurent Ozon accuse « la sphère anglo-saxonne liée indéfectiblement aux intérêts de l’État profond américain [… de] cherche[r] à faire capoter cette puissance potentielle (la crise de l’euro, c’est la FED et la City) au profit, soit d’un État européen mollusque et d’un euro-croupion, soit des souverainismes-irrédentismes nationaux parfaitement instrumentalisables et qui ne pèseront rien s’ils sont divisés dans le jeu des puissances à venir (p. 39) ».
Penser la remigration
Fort heureusement, il voit que « cette oligarchie perd de sa cohésion, perd de ses compétences, augmente ses moyens sous l’effet de l’élargissement de ses terrains d’intervention. Elle se communautarise et relâche dans la nature […] des compétences et des talents qu’elle ne sait plus fixer sur ses projets et ses infrastructures (p. 3) ». Son analyse n’est pas pour autant optimiste. D’autres défis menacent la civilisation européenne. Pour lui, et les faits le prouvent chaque jour, seule sera vraiment souhaitable une « translation, c’est-à-dire la reformation d’un ordre économico-politique qui permettra de résoudre ce qui ne peut plus l’être dans le système actuel (p. 6) » dont la remigration constitue une donnée fondamentale. Pour ce néologisme, il désigne un « processus politique construit d’inversion des flux migratoires (p. 94) ».
La remigration est un anglicisme dont le terme français correct serait « ré-émigration ». Au-delà de la simple question de vocabulaire, ce concept, simple à comprendre, répond parfaitement aux défis de l’indéniable « Grand Remplacement ». L’histoire a déjà connu de tels phénomènes. Au XVIIe siècle, la très catholique espagne expulse les Morisques et ses juifs dans le respect des personnes. En 1962, en moins d’un trimestre, le million de Pieds-Noirs quitte l’Algérie sous les menaces du sanglant et tortionnaire F.L.N. qui hurlait : « La valise ou le cercueil ! » L’État islamique en Irak et au Levant pratique, lui aussi, la remigration en obligeant par la violence les minorités chrétiennes et yézidies présentes depuis toujours à abandonner leur terre natale. Cet même État islamique accueille des mahométans venus d’Europe pour faire le djihad et qui réalisent, eux aussi, une remigration. Que ces converties et ces volontaires restent au levant et s’y fassent sauter ou exploser par les bons soins des forces légitimes syriennes, irakiennes et kurdes… É moyen et long terme, les dix millions d’étrangers devront rentrer chez eux à la condition indispensable que cette remigration soit assortie d’une révision générale des naturalisations sur quatre décennies avec, crime contre les identités charnelles oblige, un indispensable effet rétroactif.
Laurent Ozon ne conçoit cependant pas les Européens comme un peuple unique. Il importe néanmoins de leur redonner la maîtrise effective de leur destin. Certes, s’il les définit « comme une substance, c’est-à-dire comme une nébuleuse de populations ayant des différences assez nettes. Un ensemble de populations faciles à identifier et possédant une variabilité intra-spécifique inégalée (p. 74) », il maintient que « nous sommes des Européens de civilisation française. Cette réalité est sensible, historique, civilisationnelle, morphogénétique, linguistique, etc. Nous sommes donc des autochtones en Europe (p. 73) ». Pour cette assertion, Laurent Ozon dépasse par le haut, anagogiquement aurait écrit Julius Evola, la seule problématique identitaire, car « l’identité n’est pas seulement, pour nous autres Européens, une affaire de racines (p. 25) ». Il rappelle implicitement l’importance de la polarité archaïque et ancestrale des racines et des origines.
Pour une écologie communautaire
Sa démarche percutante repose aussi sur l’apport crucial de l’écologie qui « est au départ une science qui étudie les rapports entre un être vivant et son milieu. C’est la science des communautés (p. 25) », c’est même « une science des contextes (p. 24) ». À ses yeux, la notion de communauté prend une valeur essentielle parce que c’« est la forme collective qui permettra à notre population de rompre avec l’individualisme et l’isolement (p. 88) ». Cette écologie communautaire, très éloignée du gauchisme libéral-capitaliste d’Europe Écologie – Les Verts, passe par la relocalisation nécessaire des biens, des personnes, des capitaux et des idées. Le moment est propice puisque « nous vivons déjà sans vraiment le mesurer, au milieu des ruines et dans le chantier des mondes à naître. C’est le moment d’y voir clair (p. III) ». « Relocaliser, c’est donner à chaque peuple la possibilité de subvenir à la part la plus importante possible de ses besoins par ses propres moyens. C’est favoriser les circuits économiques courts et ainsi assurer une autosubsistance relative capable de permettre au population de garder la maîtrise de leur destin (p. 9). »
Laurent Ozon approuve donc le localisme, « pierre angulaire de la décolonisation économique, condition indispensable de la souveraineté politique (p. 10) ». « Sorte de protectionnisme 2.0 (p. 10) », c’« est un souverainisme économique (p. 9) ». Il encourage « la transition localiste et écologiste dans une société protégée des flux de population et de marchandises, ayant recouvré les moyens de sa souveraineté monétaire, vivrière et militaire, adossé à une unité politique et territoriale capable de résister au bras de fer qui ne manquera pas d’avoir lieu si nous voulons briser les chaînes de l’usure (p. 7) » et affirme, avec raison, que « le localisme n’est absolument pas incompatible avec l’existence d’un État souverain et puissant, au contraire. Il est un facteur de densification territoriale, culturelle, économique et de stabilité (p. 11) », car « le localisme part de la base vers l’État par délégation de compétence, c’est ce que l’on nomme le principe de subsidiarité (p. 11) ».
Faut-il regretter qu’il n’aborde pas le thème, bientôt porteur, de la biorégion ? Intégrée dans une Europe revivifiée, désinstallée et faustienne, qui dompte et domine la Technique, la nation organique n’est souhaitable que si elle favorise la constitution d’authentiques biorégions.
Laurent Ozon prépare consciencieusement une révolution globale des âmes, ce qui rend ses réponses si décisives en ce début de XXIe siècle.
Georges Feltin-Tracol
• Laurent Ozon, France, les années décisives. Entretiens 2013 – 2014, Éditions Bios, 2014, 114 p., 15 €, à commander sur www.editionsbios.fr.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=4087
00:05 Publié dans Actualité, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, laurent ozon, livre, france, europe, affaires européennes, remigration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 décembre 2014
Handboek Nieuw-Rechts eindelijk ook in het Nederlands beschikbaar!
Onze zusterorganisatie Identiteit was een tijdje geleden op het briljante idee gekomen het Engelstalig handboek van Tomislav Sunic over Nieuw-Rechts in het Nederlands te vertalen.
Het resultaat ligt eindelijk voor in boekvorm, en het mag gezien worden.
Reden genoeg dus om de uitgevers van "Nieuw Rechts: voor een andere politieke cultuur" even aan de tand te voelen naar de reden om dit fundamentele boek ook in het Nederlands uit te geven, en naar hun toekomstplannen.
 Vanwaar kwam de idee om net dit boek te vertalen en uit te geven? Hoe kwam je op de naam van Tomislav Sunic?
Vanwaar kwam de idee om net dit boek te vertalen en uit te geven? Hoe kwam je op de naam van Tomislav Sunic?Kan je in 5 woorden de inhoud van dit boek aan de lezers meegeven (mag natuurlijk iets langer zijn)?
Het boek heeft een overzicht van de verschillende politieke denkers die Nieuw-Rechts beïnvloed hebben. Het is in feite de doctoraatsverhandeling van Tomislav Sunic, die in boekvorm verschijnt. Oorspronkelijk uitgegeven in het Engels is het ondertussen vertaald in het Kroatisch, Spaans en Frans. En nu in het Nederlands.
Waarom zou de lezer van deze elektronische Nieuwsbrief dit boek zéker moeten aanschaffen?
Het boek schetst hoe NR zich niet zo gemakkelijk in de klassieke links/rechtsschaal laat indelen. Het boek schenkt aandacht aan de historische cycli (in contrast met vooruitgangsmythe), de heidense vorm van spiritualiteit, de visie op democratie en kapitalisme. Het is het ideale boek om Nieuw Rechts beter te situeren en te leren kennen. Het boek sluit af met het manifest van Nieuw Rechts
Welke andere projecten staan er op stapel? Wordt eraan gedacht om een echte NR-reeks op te zetten? Welke boeken en welke auteurs heb je in gedachten?
Het is hopelijk het eerste boek van een reeks. Er zijn concrete plannen om ook andere boeken in vertaling uit te geven. Wat zit er momenteel in de pijplijn? Alain de Benoist met Critiques/Théoriques, Evola… maar ook onbekend Engelstalig werk van Jan De Vries.
Hoe wordt het boek verspreid? De traditionele verspreidingskanalen? Sociale media? Waarom werken jullie niet met voorinschrijvingen?
We verspreiden ons boek zeker via de klassieke kanalen (meetings, Ijzerwake). Anderzijds zullen we ook via mailings het boek proberen aan de man te brengen. Voorinschrijvingen is iets dat we bij de volgende uitgaven zullen overwegen, maar daar moeten we eerst onze nieuwsbrief voor rondkrijgen.
Kostprijs € 18€ (+ 4€ verzendingskosten)
Een ideaal nieuwjaarscadeau.
00:05 Publié dans Livre, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, tomislav sunic, livre, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 12 décembre 2014
ESSAIS SUR LA VIOLENCE DE MICHEL MAFFESOLI

Ex: http://metamag.fr
Une bien heureuse initiative que cette réédition le 2 octobre 2014 des « Essais sur la violence » de Michel Maffesoli. Ni son travail originel, ni sa préface postérieure ne semble, à l’auteur, nécessiter une quelconque actualisation tant la violence, telle qu’il l’expose, la détaille et l’analyse, est invariante.
Qu’aurait-il pu ajouter ou retrancher ?
Par son originalité, sa remarquable rigueur scientifique, cette étude ne souffre aucune critique ; surtout pas celle des idées primaires sur la violence du genre « café du commerce » ou « fin de repas familial », régurgitations de celles généralement véhiculées péremptoirement par la suffisance des médias ; encore moins celle du conformisme intellectuel soumis à la dictature du moralisme convenu comme convenable, pleine d’un fade « bon garçonnisme », bourrée d’une bien triste irénologie. Cette intelligente approche s’affirme rebelle sans ambages, tant elle répète qu’elle ignore volontairement le politiquement ou philosophiquement correct.
La totale liberté revendiquée permet d’appréhender la violence dans une acceptation particulièrement ouverte. Elle fait découvrir l’ambivalence de ses profonds aspects institutionnels comme sa dimension socialement fondatrice.
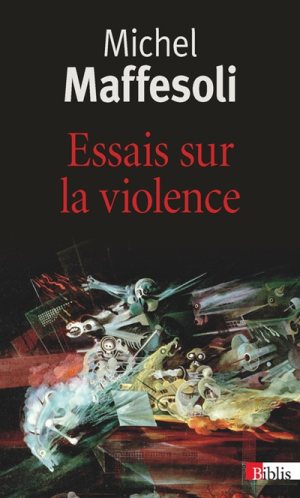 Sans jamais sombrer dans quelque facile solution unique réductrice, Michel Maffesoli expose la violence, tant sous ses expressions de simple opposition, d’affrontement plus ou moins évident, plus ou moins marqué, voire de débridement passionnel ou autre, individuel ou social. Il l’embrasse sous sa forme de dissidence, prise en son acceptation générale, comme sous celle de résistance dans toutes ses manifestations : politique ou tout simplement banale de la vie quotidienne.
Sans jamais sombrer dans quelque facile solution unique réductrice, Michel Maffesoli expose la violence, tant sous ses expressions de simple opposition, d’affrontement plus ou moins évident, plus ou moins marqué, voire de débridement passionnel ou autre, individuel ou social. Il l’embrasse sous sa forme de dissidence, prise en son acceptation générale, comme sous celle de résistance dans toutes ses manifestations : politique ou tout simplement banale de la vie quotidienne.
La magistrale analyse du phénomène de la violence utilise en prémisses, les travaux de Georg Simmel, Gilbert Durant, Julien Freund ou Max Wéber. Elle n’hésite jamais, parfois même abusivement, à s’étayer en citant ces géniaux précurseurs. Elle se réfère tout aussi complaisamment, ici à Montaigne pour son « hommerie » tant il est « vain et naïf de réduire à l’angéologie » l’humaine nature, là au « neikos » d’Empédocle, nécessaire pendant de la conciliante « philià » ; ou encore sollicite-t-elle Spinoza pour qui la violence est un incontournable structurant collectif. Machiavel, lui aussi est plusieurs fois référencé, tout comme J. Duvignaud qui nomme : « dialectique vivante de l’imaginaire et de l’institué » la duplicité de la dissidence. La notion d’ « hypercivilisation » chère à Durkeim, lui sert aussi pour illustrer la très étroite relation entre productivisme et détestable atomisation.
Tout le long de cette précieuse et productive démarche, se révèle, avec récurrence, la riche bipolarité de la violence. La complémentarité de contraires s’y exprimant, lui reconnaît partout une fonction d’équilibre. La bivalence lui permet de générer une bien réelle harmonie malgré son apparence de paradoxe. Le rôle de la violence dans la réalité de la société ne peut se contester : elle participe à sa fondation, elle l’aide à se bâtir, elle l’anime, lui donne vie et valeur, et s’y impose même en raison sine qua non.
A tant s’intéresser, de cette manière, à la violence, se gomme l’idée réflexe de mal absolu dont tout monde conditionné, aseptisé charge la violence. Aucune manifestation violente, prise parmi les plus outrancières, les plus détestables, ne peut totalement la diaboliser : elle n’est pas le grand Satan. Et même, qu’elle engendre la destruction, elle ne se réduit pas à ce seul effet. Elle semble alors tout autant porteuse d’utilité, tout du moins intégrée « dans un mécanisme productif dont elle est apparemment la négation ». Ainsi son aspect généralement angoissant se dissout puisque, sans cette destruction, point de reproduction sociale, tout comme en biologie. La violence fonde bien, sur cette ambigüité, son utilité d’agent d’équilibre structural, mais aussi sa destructivité. Toujours oppositions et antagonismes concourent à l’équilibre global.
Si à la forme violence, est intégrée la fête, dans son rituel de régénération sociale et individuelle se fait grand usage du langage non contenu ; alors la parole peut s’avérer dangereuse pour l’institué, plus d’ailleurs par l’échange qu’elle implique que dans son contenu : voilà la parole violence, révolte ; car la parole, souvent anodine, est difficilement contrôlable. Elle est néanmoins un élément important de la socialité même si le vrai rôle de la parole est subversif. La violence s’insère partout, même et surtout, à priori, elle semble étrangère, en totale incongruité. Ne peut-on la dénicher même dans rire ou sourire, dans la dérision, pleine d’humour, comme une forme de subversion en contestation travestie ? Certes, le rire parce que irrépressible est subversif ; il marque réaction et résistance ; le voilà contagieux, agrégatif.
Le rôle corrosif du rire, comme pour la parole, lui octroie d’être un important élément dans la dynamique de la violence. Tout cela s’exprime dans l’orgiasme de la tradition dionysiaque : le cocktail de parole libérée, de consumation outrancière, avec une forte dose de rire gras, explosif, résume techniquement les phénomènes d’effervescence sociale ; il canalise, exprime et limite le sacré, la part d’ombre qui pétrit tant l’individu que le social. « L’orgie joue donc de manière paroxystique le rapport à la dépense, à la déperdition, à la dissolution. ». Elle lie mort et vie dans une relation organique, vécue rituellement, parfois cruellement ou bien alors sereinement. L’orgiasme exige d’accepter le vertige et l’angoisse de la mort ou de l’altérité. Cela entraîne, par l’intégration à une globalité organique, à participer de l’éternité du monde.
Par cette pointilleuse investigation de la violence, traquée jusqu’en ses germes les plus diffus, insolites, improbables, Michel Maffesoli s’insurge que ne se retiennent trop souvent que ses aspects inquiétants, négatifs : alors, il s’efforce véhémentement de les compenser en détaillant tout ce que telles évidences occultent de positif, paradoxalement constructif et réformateur socialement. Il s’acharne à affirmer l’intérêt induit de chaque avènement du moindre soupçon d’expression violente. Celui-ci génère quasi systématiquement de notables transformations profitables, comme améliorations de comportements individuels, ou ajustements judicieux des structures sociales.
Au-delà de cette longue démarche captivante, profondément optimiste, par-delà l’intérêt stimulant de trouvailles clairement expliquées, se construit patiemment une grande leçon de sagesse intransigeante : elle ne se prive pas de fustiger, plus ou moins directement, toutes les indignités des pseudo-maîtres à penser, toutes les veuleries des suiveurs ou « metuentes », toutes les infamies des débats sémantiques, philosophiques, sociologiques, … toutes les vérités prétendues véhiculées par les traditions…
A l’unicité, l’uniformité, en général, il semble avoir un faible pour le polymorphisme et même le « polythéisme » qui disent l’aspect pluriel des choses, des êtres et des étants sociaux. Son goût pour la globalité, quand elle se conforte d’une complémentarité de contraires ajustés, ne doit pas faire oublier qu’en violence, l’auteur entend, sans le dire ouvertement : volonté de puissance.
« Essais sur la violence » de Michel Maffesoli (CNRS Editions, collection Biblis n°93) , 9.50€
00:05 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel maffesoli, livre, philosophie, philosophie politique, théorie politique, violence, violence totalitaire, sciences politiques, politologie, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 11 décembre 2014
Against the Armies of the Night: The Aurora Movements
Against the Armies of the Night: The Aurora Movements
By Michael O’Meara
Ex: http://neweuropeanconservative.wordpress.com
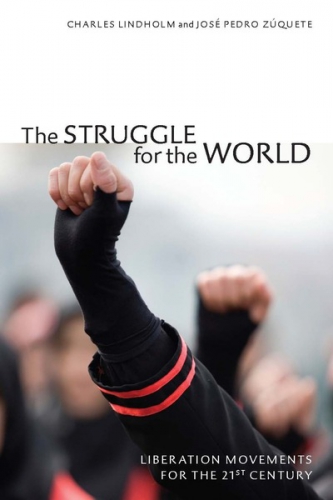 The single greatest force shaping our age is unquestionably globalization.
The single greatest force shaping our age is unquestionably globalization.
Based on the transnationalization of American capital and the worldwide imposition of American market relations combined with new technologies, globalization has not only reshaped the world’s national economies, it’s provoked a dizzying array of oppositional movements, on the right and the left, that, despite their divergent ideologies and goals, seek to defend native or traditional identities from the market’s ethnocidal effects.
In the vast literature on globalization and its various antiglobalist movements, Charles Lindholm’s and José Pedro Zúquete’s The Struggle for the World (Stanford University Press, 2010) is the first to look beyond the specific political designations of these different antiglobalist tendencies to emphasize the common redemptive, identitarian, and populist character they share.
The “left wing, right wing, and no wing” politics of these antiglobalists are by no means dismissed, only subordinated to what Lindholm and Zúquete see as their more prominent redemptive dimension. In this spirit, they refer to them as “aurora movements,” promising a liberating dawn from the nihilistic darkness that comes with the universalization of neoliberal market forms.
Focusing on the way antiglobalists imagine salvation from neoliberalism’s alleged evils, the authors refrain from judging the morality or validity of the different movements they examine — endeavoring, instead, to grasp the similarities “uniting” them.
They abstain thus from the present liberal consensus, which holds that history has come to an end and that the great ideological battles of the past have given way now to an order based entirely on the technoeconomic imperatives specific to the new global market system.
The result of this ideologically neutral approach is a work surprisingly impartial and sympathetic in its examination of European, Islamic, and Latin American antiliberalism.
Yet, at first glance, Mexico’s Zapartistas, Bin Laden’s al-Qaeda, Alain de Benoist’s Nouvelle Droite, Umberto Bossi’s Northern League, the incumbent governments of Bolivia and Venezuela, and European proponents of Slow Food and Slow Life appear to share very little other than their common opposition to globalism’s “mirage of progress.”
Lindholm and Zúquete (one an American anthropologist, the other a Portuguese political scientist) claim, though, that many antiglobalist movements, especially in Latin America, Europe, and the Middle East, “share a great deal structurally, ideologically, and experientially,” as they struggle, each in their own way, to redeem a world in ruins.
The two authors accordingly stress that these oppositional movements do not simply resist the destructurating onslaught of global capital.
Since “the global imaginary [has] become predominant, linking oppositional forces everywhere,” they claim antiglobal oppositionalists have adopted a grand narrative based on “a common ethical core and a common mental map.” For the “discourses, beliefs, and motives” of jihadists, Bolivarian revolutionaries, European new rightists, European national-populists, and European life-style rebels are strikingly similar in seeking to inaugurate the dawn of a new age — defined in opposition to global liberalism.
For all these antiglobalists, the transnational power elites (led by the United States) have shifted power away from the nation to multinational corporations, detached in loyalty from any culture or people, as they promote “hypergrowth, environmental exploitation, the privatization of public services, homogenization, consumerism, deregulation, corporate concentration,” etc.
The consequence is a world order (whose “divinities are currency, market, and capital, [whose] church is the stock market, and [whose] holy office is the IMF and WTO”) that seeks to turn everything into a commodity, as it “robs our lives of meaning [and sells] it back to us in the form of things.”
As the most transcendent values are compelled to prostrate themselves before the interests of capital, the global system disenchants the world — generating the discontent and alienation animating the antiglobal resistance.
From the point of view of the resistance, the power of money and markets is waging a scorched-earth campaign on humanity, as every country and every people are assaulted by “the American way of life,” whose suburban bourgeois principles aspire to universality.
* * *
In their struggle for the world, antiglobalists prophesy both doom and rebirth.
On the one hand, the Armies of the Night — the darkening forces of globalist homogenization, disenchantment, and debasement — are depicted as an “evil” — or, in political terms, as a life-threatening enemy.
Globalization, they claim, disrupts the equilibrium between humanity, society, and nature, stultifying man, emptying his world of meaning, and leaving him indifferent to the most important things in life.
In opposing a global order governed by a soulless market, these antiglobalists attempt to transcend its individualism, consumerism, and instrumental rationalism by reviving pre-modern values and institutions that challenge the reigning neoliberal consensus.
As one Zapartista manifesto puts it: “If the world does not have a place for us, then another world must be made. . . . What is missing is yet to come.”
At the same time, antiglobalists endeavor to revive threatened native or traditional identities, as they deconstruct modernist assaults on local culture that parade under the banner of progress and enlightenment. They privilege in this way their own authenticity and extol alternative, usually indigenous and traditional, forms of community and meaning rooted in archaic notions adapted to the challenges of the future. Even when seeking a return to specific communal ideals, these local struggles see themselves as engaging not just Amerindians or Muslims or Europeans, but all humanity — the world in effect.
Globalization, the authors conclude, may destroy national differences, but so too does resistance to globalization. The resistance’s principle, accordingly, is: “Nationalists of all countries, unite!” — to redeem “the world from the evils of globalization.”
* * *
If one accepts, with Lindholm and Zúquete, that a meaningful number of antiglobalization movements share a similar revolutionary-utopian narrative, the question then arises as to what these similarities might imply.
The first implication, in my view, affects globalist ideology — that is, the recognition that globalism is itself an ideology and not some historical inevitability.
As Carl Schmitt, among others, notes, liberalism is fundamentally antipolitical. Just as Cold War liberals tried to argue the “end of ideology” in the 1950s, neoliberal globalists since the Soviet collapse have argued that we today, following Fukuyama, have reached the end of history, where “worldwide ideological struggle that calls forth daring, courage, imagination and idealism” has become a thing of the past, replaced by the technoeconomic calculus of liberal-market societies, conceived as the culmination of human development.
In a word, liberal “endism” holds that there is no positive alternative to the status quo.
The strident ideologies and ideas of liberalism’s opponents have already dislodged this totalitarian fabrication — as The Struggle for the World, respectable university press publication that it is, testifies.
Lindholm and Zúquete also highlight globalization’s distinct ideological nature, as they contest its notion of history’s closure.
A second, related implication touches on the increasing dubiousness of right-left categories. These illusive designations allegedly defining the political antipodes of modernity have never meant much (see, e.g., the work of Marc Crapez) and have usually obscured more than they revealed.
Given the antiglobalists’ ideological diversity, right and left designations tell us far less about the major political struggles of our age than do categories like “globalist” and “antiglobalist,” “liberal” and “antiliberal,” “cosmopolitan” and “nationalist.”
Future political struggles seem likely, thus, to play out less and less along modernity’s left-right axis — and more and more in terms of a postmodern dialectic, in which universalism opposes and is opposed by particularism.
A third possible implication of Lindholm/Zúquete’s argument speaks to the fate of liberalism itself. Much of modern history follows the clash between the modernizing forces of liberalism and the conservative ones of antiliberalism. That the globalist agenda has now seized power nearly everywhere means that the “struggle for the world” has become largely a struggle about liberalism.
Given also that liberalism (or neoliberalism) ideologically undergirds the world system and that this system has been on life-support at least since the financial collapse of late 2008, it seems not unreasonable to suspect that the fate of liberalism and globalism are themselves now linked and that we may be approaching another axial age in which the established liberal ideologies and systems are forced to give way to the insurgence of new ones.
But perhaps the cruelest implication of all is the dilemma Lindholm/Zuqúete’s argument poses to U.S. rightists. For European new rightists, Islamic jihadists, and Bolivian revolutionaries alike, globalization is a form not only of liberalization but of “Americanization.”
And there’s no denying the justice of seeing the struggle against America as the main front in the worldwide antiglobalist struggle: for the United States was the world’s first and foremost liberal state and is the principal architect of the present global system.
At the same time, it’s also the case that native Americans — i.e., European Americans — have themselves fallen victim to what now goes for “Americanism” — in the form of unprotected borders, Third World colonization, de-industrialization, political correctness, multiculturalism, creedal identities, anti-Christianism, the media’s on-going spiritual colonization — and all the other degradations distinct to our age.
One wonders, then, if a right worthy of the designation will ever intersect an America willing to fight “Americanism” — and its shadow-casting Armies — in the name of some suppressed antiliberal impulse in the country’s European heritage.
————–
O’Meara, Michael. “Against the Armies of the Night: The Aurora Movements.” The Occidental Observer, 16 June 2010. <http://www.theoccidentalobserver.net/authors/O’meara-Globalization-Lindholm-Zuquete.html >.
00:05 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, globalisation, anti-globalistes, politique internationale, libéralisme, mondialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 06 décembre 2014
The Straussian Assault on America’s European Heritage
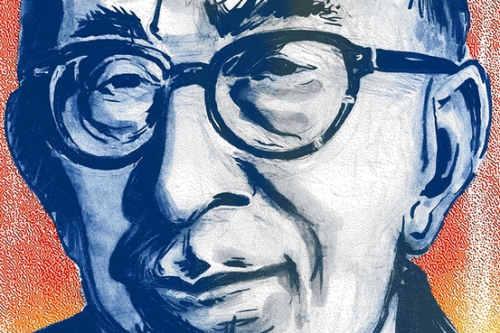
The Straussian Assault on America’s European Heritage
By Ricardo Duchesne
Ex: http://www.counter-current.com
Grant Havers
Leo Strauss and Anglo-American Democracy: A Conservative Critique [2]
Northern Illinois University Press, 2013
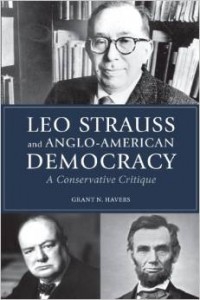 Amain pillar sustaining the practice of mass immigration is that Western nations are inherently characterized by a “civic” form of national membership. Western nations express the “natural” wishes of “man as man” for equal rights, rule of law, freedom of expression, and private property. Mainstream leftists and conservatives alike insist on the historical genuineness of this civic definition. This civic identity, they tell us, is what identifies the nations of Western civilization as unique and universal all at once. Unique because they are the only nations in which the idea of citizenship has been radically separated from any ethnic and religious background; and universal because these civic values are self-evident truths all humans want whenever they are given the opportunity to choose.
Amain pillar sustaining the practice of mass immigration is that Western nations are inherently characterized by a “civic” form of national membership. Western nations express the “natural” wishes of “man as man” for equal rights, rule of law, freedom of expression, and private property. Mainstream leftists and conservatives alike insist on the historical genuineness of this civic definition. This civic identity, they tell us, is what identifies the nations of Western civilization as unique and universal all at once. Unique because they are the only nations in which the idea of citizenship has been radically separated from any ethnic and religious background; and universal because these civic values are self-evident truths all humans want whenever they are given the opportunity to choose.
To include the criteria of ethnicity or religious ancestry in the concept of Western citizenship is manifestly illiberal. Even more, it is now taken for granted that if Western nations are to live up to their idea of civic citizenship they must relinquish any sense of European peoplehood and Christian ancestry. Welcoming immigrants from multiples ethnic and religious backgrounds is currently seen as a truer expression of the inherent character of Western nationality than remaining attached to any notion of European ethnicity and Christian historicity.
The reality that the liberal constitutions of Western nations were conceived and understood in ethnic and Christian terms (if only implicitly since the builders and founders of European nations never envisioned an age of mass migrations) has been conveniently overlooked by our mainstream elites. These elites are willfully downplaying the fact that the liberal nation states of Europe emerged within ethnolinguistic boundaries and majority identities. Those states possessing a high degree of ethnic homogeneity, where ancestors had lived for generations—England, France, Italy, Belgium, Holland, Sweden, Norway, Finland, and Denmark—were the ones with the strongest liberal traits, constitutions, and institutions. Those states (or empires like the Austro-Hungarian Empire) composed of multiple ethnic groups were the ones enraptured by illiberal forms of ethnic nationalism and intense rivalries over identities and political boundaries. In other words, the historical record shows that a high degree of ethnic homogeneity tends to produce liberal values, whereas countries or areas with a high number of diverse ethnic groups have tended to generate ethnic tensions, conflict, and illiberal institutions. As Jerry Muller has argued in “Us and Them” (Foreign Affairs: March/April 2008), “Liberal democracy and ethnic homogeneity are not only compatible; they can be complementary.”
Mainstream leftists and conservatives have differed in the way they have gone about redefining the historical roots of Western nationalism and abolishing the ethnic identities of Western nations. Eric Hobsbawm, the highly regarded apologist of the Great Terror [3] in the Soviet Union, persuaded most of the academic world, in his book, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality [4] (1989), that the nation states of Europe were not created by a people sharing a common historical memory, a sense of territorial belonging and habitation, similar dialects, and physical appearances; no, the nation-states of Europe were “socially constructed” entities, “invented traditions,” “imagined” by people perceiving themselves as part of a “mythological” group in an unknown past. Hobsbawm deliberately sought to discredit any sense of ethnic identity among Europeans by depicting their nation building practices as modern fairy-tales administered by capitalists and bureaucrats from above on a miscellaneous pre-modern population.
Leftists however have not been the only ones pushing for a purely civic interpretation of Western nationhood; mainstream conservatives, too, have been trying to root out Christianity and ethnicity from the historical experiences and founding principles of European nations. Their discursive strategy has not been one of dishonoring the past but of projecting backwards into European history a universal notion of Western citizenship that includes the human race. The most prominent school in the formulation of this view has come out of the writings of Leo Strauss. This is the way I read Grant Havers’s Leo Strauss and Anglo-American Democracy: A Conservative Critique (2013). In this heavily researched and always clear book, Havers goes about arguing in a calm but very effective way that Strauss was not the traditional conservative leftists have made him out to be; he was a firm believer in the principles of liberal equality and a unswerving opponent of any form of Western citizenship anchored in Christianity and ethnic identity.
 Strauss’s vehement opposition to communism coupled with his enthusiastic defense of American democracy, as it stood in the 1950s, created the erroneous impression that he was a “right wing conservative.” But, as Havers explains, Strauss was no less critical of “right wing extremists” (who valued forms of citizenship tied to the nationalist customs and historical memories of a particular people) than of the New Left. Strauss believed that America was a universal nation in being founded on principles that reflected the “natural” disposition of all humans for life, liberty, and happiness. These principles were discovered first by the ancient Greeks in a philosophical and rational manner, but they were not particular to the Greeks; rather, they were “eternal truths” apprehended by Greek philosophers in their writings against tyrannical regimes. While these principles were accessible to all humans as humans, only a few great philosophers and statesmen exhibited the intellectual and personal fortitude to fully grasp and actualize these principles. Nevertheless, most humans possessed enough mental equipment as reasoning beings to recognize these principles as “rights” intrinsic to their nature, so long as they were given the chance to deliberate on “the good” life.
Strauss’s vehement opposition to communism coupled with his enthusiastic defense of American democracy, as it stood in the 1950s, created the erroneous impression that he was a “right wing conservative.” But, as Havers explains, Strauss was no less critical of “right wing extremists” (who valued forms of citizenship tied to the nationalist customs and historical memories of a particular people) than of the New Left. Strauss believed that America was a universal nation in being founded on principles that reflected the “natural” disposition of all humans for life, liberty, and happiness. These principles were discovered first by the ancient Greeks in a philosophical and rational manner, but they were not particular to the Greeks; rather, they were “eternal truths” apprehended by Greek philosophers in their writings against tyrannical regimes. While these principles were accessible to all humans as humans, only a few great philosophers and statesmen exhibited the intellectual and personal fortitude to fully grasp and actualize these principles. Nevertheless, most humans possessed enough mental equipment as reasoning beings to recognize these principles as “rights” intrinsic to their nature, so long as they were given the chance to deliberate on “the good” life.
Havers’s “conservative critique” of Strauss consists essentially in emphasizing the uniquely Western and Christian origins of the foundational principles of Anglo-American democracy. While Havers’s traditional conservatism includes admiration for such classical liberal principles as the rule of law, constitutional government, and separation of church and state, his argument is that these liberal principles are rooted primarily in Christianity, particularly its ideal of charity. He takes for granted the reader’s familiarity with this ideal, which is unfortunate, since it is not well understood, but is generally taken to mean that Christianity encourages charitable activities, relief of poverty, and advancement of education. Havers has something more profound in mind. Christian charity from a political perspective is a state of being wherein one seeks a sympathetic understanding of ideas and beliefs that are different to one’s own. Charitable Christians seek to understand other viewpoints and are willing to engage alternative ideas and political proposals rather than oppose them without open dialogue. Havers argues that the principles of natural rights embodied in America’s founding cannot be separated from this charitable disposition; not only were the founders of America, the men who wrote the Federalist Papers, quite definite in voicing the view that they were acting as Christian believers in formulating America’s founding, they were also very critical of Greek slavery, militarism, and aristocratic license against the will of the people.
Throughout the book Havers debates the rather ahistorical way Strauss and his followers have gone about “downplaying or ignoring the role of Christianity in shaping the Anglo-American tradition” – when the historical record copiously shows that Christianity played a central role nurturing the ideals of individualism and tolerance, abolition of slavery and respect for the dignity of all humans. Havers debates and refutes the similarly perplexing ways in which Straussians have gone about highlighting the role of Greek philosophy in shaping the Anglo-American tradition – when the historical record amply shows that Greek philosophers were opponents of the natural equality of humans, defenders of slavery, proponents of a tragic view of history, the inevitability of war, and the rule of the mighty.
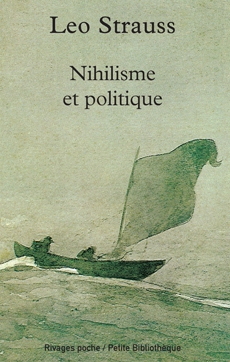 Havers also challenges the Straussian elevation of such figures as Lincoln, Churchill, Roosevelt, Hobbes, and Locke as proponents of an Anglo-American tradition founded on “timeless” Greek ideas. He shows that Christianity was the prevailing influence in the intellectual development and actions of all these men. Havers imparts on the readers a sense of disbelief as to how the Straussians ever managed to exert so much influence on American conservatism (to the point of transforming its original emphasis on traditions and communities into a call for the spread of universal values across the world), despite proposing views that were so blissfully indifferent to “readily available facts.”
Havers also challenges the Straussian elevation of such figures as Lincoln, Churchill, Roosevelt, Hobbes, and Locke as proponents of an Anglo-American tradition founded on “timeless” Greek ideas. He shows that Christianity was the prevailing influence in the intellectual development and actions of all these men. Havers imparts on the readers a sense of disbelief as to how the Straussians ever managed to exert so much influence on American conservatism (to the point of transforming its original emphasis on traditions and communities into a call for the spread of universal values across the world), despite proposing views that were so blissfully indifferent to “readily available facts.”
Basically, the Straussians were not worried about historical veracity as much as they were determined to argue that Western civilization (which they identified with the Anglo-American tradition) was philosophically conceived from its beginnings as a universal civilization. In this effort, Strauss and his followers genuinely believed that American liberalism had fallen prey to the “yoke” of German historicism and relativism, infusing the American principles of natural rights with the notion that these were merely valid for a particular people rather than based on Human Reason. German historicism – the idea that each culture exhibits a particular world view and that there is no such thing as a rational faculty standing above history – led to the belittlement of the principles of natural rights by limiting them a particular time and place. Worse than this — and the modern philosophers, Hobbes and Locke, were to be blamed as well — the principles of natural rights came to be separated from the ancient Greek idea that we can rank ways of life according to their degree of excellence and elevation of the human soul. The modern philosophy of natural right merely afforded individuals the right to choose their own lifestyle without any guidance as to what is “the good life.”
Strauss believed that this relativist liberalism would not be able to withstand challenges from other philosophical outlooks and illiberal ways of life, from Communism and Fascism, for example, unless it was rationally grounded on eternal principles. He thought the ancient Greeks had understood better than anyone else that some truths are deeply grounded in the actual nature of men, not relative to a particular time and culture, but essential to what is best for “man as man.” These truths were summoned up in the modern philosophy of natural rights, though in a flawed manner. The moderns tended to appeal to the lower instincts of humans, to a society that would merely ensure security and the pursuit of pleasure, in defending their ideals of liberty and happiness. But with a proper reading of the ancient texts, and a curriculum based on the “Great Books,” the soul of contemporaneous students could be elevated above a life of trivial pursuits.
This emphasis on absolute, universal, and “natural” standards attracted a number of prominent Christians to Strauss. The Canadian George Grant (1918-1988), for one, was drawn to the potential uses Strauss’s emphasis on eternal values might have to fight off the erosion of Christian conviction in the ever more secular, liberal, and consumerist Canada of his day. Grant, Havers explains, did not quite realize that Strauss was neither a conservative nor a Christian but a staunch proponent of a philosophically based liberalism bereft of any Christian identity. Grant relished the British and Protestant roots of the Anglo-American tradition, though there were certain affinities between him and Strauss; Grant was a firm believer in the superiority of Anglo-Saxon civilization and its rightful responsibility in bringing humanity to a higher cultural level. The difference is that Grant affirmed the religious and ethnic particularities of Anglo-Saxon civilization, whereas Strauss, though a Zionist who believed in a Jewish nation state, sought to portray Anglo-American civilization in a philosophical language cleansed of any Christian particularities and European ethnicity.
Strauss wanted a revised interpretation of Anglo-American citizenship standing above tribal identities and historical particularities. Strauss’s objective was to provide Anglo-American government with a political philosophy that would stand as a bulwark against “intolerable” challenges from the left and the right, which endangered liberalism itself. The West had to affirm the universal truthfulness of its way of life and be guarded against the tolerance of forms of expression that threaten this way of life. Havers observes that Strauss was particularly worried about the inability of liberal regimes, as was the case with the Weimar republic, to face up to illiberal challenges. He wanted a liberal order that would ensure the survival of the Jews, and the best assurance for this was a liberal order that spoke in a neutral and purely philosophical idiom without giving any preference to any religious faith and any historical and ethnic ancestries. He wanted a liberalism that would work to undermine any ancestral or traditionally conservative norms that gave preference to a particular people in the heritage of America’s founding, and thereby may discriminate against Jews. Only in a strictly universal civilization would the Jews feel safe while retaining their identity.
Havers brings up another old conservative, Willmore Kendall (1909-68), who was drawn to Straussian thought even though substantial aspects of his thought were incompatible with Strauss’s. Among these differences was the “majoritarian populism” of Kendall versus the aristocratic elitism of Strauss. The aristocrats Strauss had in mind were philosophers and statesmen who understood the eternal values of the West whereas the majoritarian people Kendall had in mind were Americans who were conservative by tradition and deeply attached to their ancestral roots in America, rather than believers in universal rights concocted by philosophers. While Kendall was drawn to Strauss’s scepticism over unlimited speech, what he feared was not the ways in which particular ethnic/religious groups might use free speech to protect their ancestral rights and thereby violate – from Strauss’s perspective – the universality of liberalism, but “the opposite of what Strauss fear[ed]”: that an open society unmindful of its actual historical roots, allowing unlimited questioning of its ancestral identities, against the natural wishes of the majority for their roots and traditions, would eventually destroy the Anglo-American tradition.
Havers brings up as well Kendall’s call for a restricted immigration policy consistent with majoritarian wishes. While Havers is primarily concerned with the Christian roots of Anglo-American democracy, he identifies this view by Kendall with conservatism proper. The Straussian view that America is an exceptional nation by virtue of being founded on the basis of philosophical propositions, which somehow have elevated this nation to be a model to the world, is, in Havers view, closer to the leftist dismissal of religious identities and traditions than it is to any true conservatism. Conservatives, or Paleo-Conservatives, believe that human identities are not mere private choices arbitrarily decided by abstract individuals in complete disregard of history and the natural dispositions of humans for social groupings with similar ethnic and religious identities.
These differences between the Straussians and old conservatives are all the more peculiar since, as Havers notes, Strauss was very mindful of the particular identities of Jewish people, criticizing those who called for a liberalized form of Jewish identity based on values alone. Jews, Strauss insisted, must maintain fidelity to their own nationality rather than to a “liberal theology,” otherwise they would end up destroying their particular historical identity.
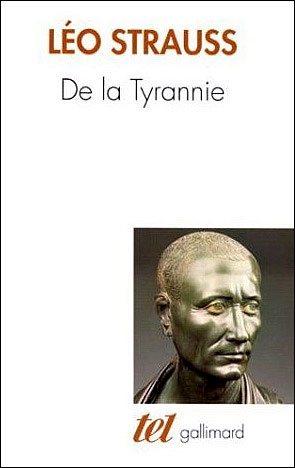 Now, Straussians could well respond that the Anglo-American identity is different, consciously dedicated to universal values, but, as Havers carefully shows, this emphasis on the philosophy of natural rights cannot be properly understood outside the religious ancestry of the founders, and (although Havers is less emphatic about this) outside the customs, institutions and ethnicity of the founders. As the Australian Frank Salter has written:
Now, Straussians could well respond that the Anglo-American identity is different, consciously dedicated to universal values, but, as Havers carefully shows, this emphasis on the philosophy of natural rights cannot be properly understood outside the religious ancestry of the founders, and (although Havers is less emphatic about this) outside the customs, institutions and ethnicity of the founders. As the Australian Frank Salter has written:
The United States began as an implicit ethnic state, whose Protestant European identity was taken for granted. As a result, the founding fathers made few remarks about ethnicity, but John Jay famously stated in 1787 that America was ‘one united people, a people descended from the same ancestors,’ a prominent statement in one of the republic’s founding philosophical documents that attracted no disagreement (230) [5].
This idea that Western nations are all propositional nations is not restricted to the United States, but has been applied to the settler nations of Canada and Australia, and the entire continent of Europe, under the supposition that, with the Enlightenment, the nations of Europe came to be redefined by such “universal” values as individual rights, separation of church and state, democracy. As a result, mainstream liberals and conservatives today regularly insist that Europe is inherently a “community of values,” not of ethnicity or religion, but of values that belong to humanity. Accordingly, the reasoning goes, if Europe is to be committed to these values it must embrace immigration as part of its identity. Multiculturalism is simply a means of facilitating the participation of immigrants into this universal culture, making them feel accepted by recognizing their particular traditions, while they are gradually nudge to think in a universal way. But, as Salter points out,
This is hardly a complete reading of Enlightenment ideas, which include the birth of modern nationalism, the democratic privileging of majority ethnicity, and the linking of minority emancipation to assimilation. The Enlightenment also celebrates empirical science including biology, which culminated in man’s fuller understanding of himself as part of nature (213).
Liberals in the 19th century were fervent supporters of nationalism and the essential importance of being part of a community with shared traditions and common ancestry. Eric Hobsbawm’s claim that Europeans nations were “ideological constructs” created without a substantial grounding in immemorial lands, folkways, and ethnos, should be contrasted to the ideas of such liberal nationalists as Camillo di Cavour (1810–1861), Max Weber [6] (1864–1920), and even John Stuart Mill (1806–1873). While these liberals emphasized a form of nationalism compatible with classical liberal values, they were firm supporters of national identities at a time when a “non-xenophobic nationalism” was meant to acknowledge the presence of what were essentially European ethnic minorities within European nations. None of these liberals ever envisioned the nations of Europe as mere places identified by liberal values belonging to everyone else and obligated to become “welcome” mats for the peoples of the world.
Moreover, Enlightenment thinkers were the progenitors of a science of ethnic differences [7], which has since been producing ever more empirical knowledge, and has today convincingly shown that ethnicity is not merely a social construct but also a biological substrate. As Edward O. Wilson, Pierre van den Berghe, and Salter have written, shared ethnicity is an expression of extended kinship at the genetic level; members of an ethnic group are biologically related in the same way that members of a family are related even though the genetic connection is not as strongly marked. Numerous papers – which I will reference below with links — are now coming out supporting the view that humans are ethnocentric and that such altruistic dispositions as sharing, loyalty, caring, and even motherly love, are exhibited primarily and intensively within in-groups rather than toward a universal “we” in disregard for one’s community. Strauss’s concern for the identity of Jews is consistent with this science.
The Straussian language about “natural rights” belonging to “man as man” is mostly gibberish devoid of any historical veracity and scientific support. Hegel long refuted the argument that humans were born with natural rights which they never enjoyed until a few philosophers discovered them and then went on to create ex nihilo Western civilization. Man “in his immediate and natural way of existence” was never the possessor of natural rights. The natural rights the founders spoke about, which were also in varying ways announced in the creation of the nations of Canada and Australia, and prescribed in the modern constitutions of European nations, were acquired and won only through a long historical movement, the origins of which may be traced back to ancient Greece, but which also included, as Havers insists, the history of Christianity and, I would add, the legal history of Rome, the Catholic Middle Ages [8], the Renaissance, Protestant Reformation, the Enlightenment, and the Bourgeois Revolutions.
The Straussians believe that the way to overcome the tendency of liberal societies to relativism or the celebration of pluralistic conceptions of life without any sense of ranking the lifestyle of citizens is to impart reverence and patriotic attachment for the Anglo-American tradition by emphasizing not the heterogeneous identity of this tradition but its foundation in the ancient philosophical commitment to “the good” and the “perfection of humanity.” But this effort to instill national commitment by teaching citizens about the classics of ancient Greece and the great statesmen of liberal freedom is doomed to failure and has been a failure. The problem of nihilism is nonexistent in societies with a strong sense of reverence for traditional practices, authoritative patriarchal figures, and a sense of peoplehood and homeland. The way out of the crisis of Western nihilism is to re-nationalize liberalism, throw away the cultural Marxist notion that freedom means liberation from all identities not chosen by the individual, and accentuate the historical and natural-ethnic basis of European identity.
Recent scientific papers on ethnocentrism and human nature:
Oxytocin promotes human ethnocentrism [9]
Perhaps goodwill is unlimited but oxytocin-induced goodwill is not [10]
Oxytocin Increases Generosity in Humans [11]
Oxytocin promotes group-serving dishonesty [12]
Source: http://www.eurocanadian.ca/2014/06/the-straussian-assault-on-americas.html [14]
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2014/12/the-straussian-assault-on-americas-european-heritage/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/12/Havers.jpg
[2] Leo Strauss and Anglo-American Democracy: A Conservative Critique: http://www.amazon.com/gp/product/0875804780/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0875804780&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=ZWUAQYNFHAR6IFWN
[3] apologist of the Great Terror: http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2013/03/eric-hobsbawm-keeping-the-red-faith/
[4] Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality: http://www.amazon.com/gp/product/1107604621/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=1107604621&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=SGA5FVCJO5LHXAKN
[5] (230): http://www.amazon.com/On-Genetic-Interests-Ethnicity-Migration/dp/1412805961
[6] Max Weber: http://www.jstor.org/discover/10.2307/3654673?uid=3739448&uid=2&uid=3737720&uid=4&sid=21104391042883
[7] science of ethnic differences: http://www.amazon.com/Cambridge-History-Eighteenth-Century-Philosophy-Haakonssen/dp/0521418542
[8] Catholic Middle Ages: http://www.amazon.com/Catholic-Church-Built-Western-Civilization/dp/1596983280
[9] Oxytocin promotes human ethnocentrism: http://www.pnas.org/content/108/4/1262.abstract?ijkey=b9ad2efdf008b041812724e617989f6f23ccae23&keytype2=tf_ipsecsha
[10] Perhaps goodwill is unlimited but oxytocin-induced goodwill is not: http://www.pnas.org/content/108/13/E46.full
[11] Oxytocin Increases Generosity in Humans: http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0001128
[12] Oxytocin promotes group-serving dishonesty: http://www.pnas.org/content/111/15/5503.abstract
[13] We Take Care of Our Own: http://pss.sagepub.com/content/early/2014/05/06/0956797614531439.abstract
[14] http://www.eurocanadian.ca/2014/06/the-straussian-assault-on-americas.html: http://www.eurocanadian.ca/2014/06/the-straussian-assault-on-americas.html
00:05 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, philosophie, philosophie politique, néo-conervatisme, états-unis, leo strauss, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 décembre 2014
Dr. Sunic: Voor een andere politieke cultuur
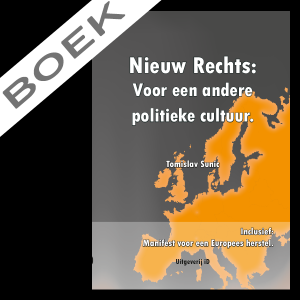
Voor een andere politieke cultuur
Dr. Sunic werd geboren in Zagreb (Kroatië). Hij studeerde in 1978 af aan de universiteit Zagreb als germanist en romanist. Van 1980 tot 1982 werkte hij in Algerije als tolk voor de Kroatische bouwfirma Ingra. Hij emigreerde naar de Verenigde Staten, waar hij eerst een masterdiploma behaalde aan de California State University (Sacramento). Daarna volgde een doctoraat in politieke wetenschappen aan de University of California, Santa Barbara.
Tijdens zijn studies in Amerika lobbyde hij actief voor Kroatische politieke gevangenen in communistisch Joegoslavië. Daarnaast schreef hij voor enkele buitenlandse Kroatische tijdschriften: het in Londen gevestigde Nova Hrvatska en in het Madrileense literaire tijschrift Hrvatska Revija. Van 1988 tot 1993 doceerde hij aan de California State University, de University of California en Juniata college in Pennsylvania. Tussen ’93 en 2001 was hij namens de Kroatische overheid actief op verschillende diplomatieke posten in Zagreb, Londen, Kopenhagen en Brussel.
Momenteel leeft hij met zijn gezin in Zagreb waar hij blijft werken als freelanceschrijver onder andere over communistisch totalitarisme en politieke semiologie (voor tijdschriften zoals Catholica, Chronicles, Elements…).
Nieuw Rechts. Voor een andere politieke cultuur
€18,00
Auteur: Tomislav Sunic
Uitgeverij: iD
Aantal pagina’s: 222
Verzending: 4 euro
OPGELET: Beschikbaar vanaf 1/12/2014
Om te bestellen:
http://pallieterke.net/product/nieuw-rechts-voor-een-andere-politieke-cultuur/
00:08 Publié dans Livre, Livre, Nouvelle Droite, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, livre, tomislav sunic, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 02 décembre 2014
Fractures périphériques
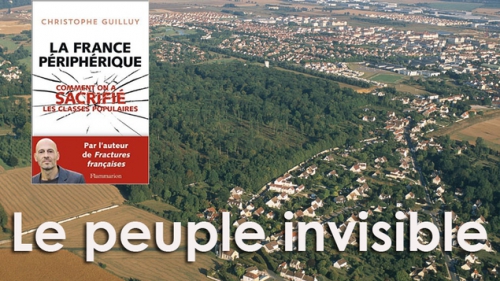
Fractures périphériques
par Georges FELTIN-TRACOL
La rentrée éditoriale 2014 assure à certains livres une belle renommée, de susciter des polémiques et de se vendre bien. Géographe de formation, auteur en 2010 de Fractures françaises qui annonçait la lente fragmentation de l’espace hexagonal, Christophe Guilluy offre son expertise socio-territoriale aux collectivités territoriales. Homme de terrain, il est à mille lieux de l’universitaire qu’il se refuse d’être et avec qui il a le bon sens de décliner tout débat. Cela n’a pas empêché un jury composé de Chantal Delsol, d’Éric Zémour, de l’académicien Jean Clair et des journalistes Bruno de Cessole, Jean Sévilla et François Taillandier, de lui décerner le Prix 2014 des Impertinents.
Plus court que son précédent ouvrage, La France périphérique en confirme et en approfondit les observations récoltées : la France est en train d’éclater parce que « la recomposition économique des grandes villes a entraîné une recomposition sociale de tous les territoires (p. 11) ». Les effets conjugués de la mondialisation et de la métropolisation des zones urbaines modifient à la fois la répartition territoriale et la société françaises. « Branko Milanovic, économiste de la Banque mondiale, montre qu’après vingt ans de globalisation, on assiste à un effondrement des classes moyennes des pays développés (p. 17). » Elles subissent de plein fouet une involution majeure. « En quelques décennies, l’économie des grandes villes s’est spécialisée vers les secteurs économiques les mieux intégrés à l’économie-monde et qui nécessitent le plus souvent l’emploi de personnel très qualifié (pp. 34 – 35) » si bien que « les nouvelles lignes de fracture se creusent d’abord entre des couches supérieures intégrées et des couches populaires (p. 75) ».
Postures et impostures hexagonales
En outre, « la mondialisation, fait économique et financier, est aussi une idéologie qui prône un “ individu-mobile ”, lequel ne se réfère plus ni à une classe sociale, ni à un territoire, ni à une histoire (p. 109) ». C’est donc fort logiquement que « dans le contexte de la mondialisation, la mobilité des hommes est perçue comme un fait global, une dynamique qui accompagne la logique libérale de circulation des capitaux et des marchandises (pp. 111 – 112) ». Or cette accessibilité au mouvement ne concerne qu’une minorité favorisée. La majorité se cantonne à une fixation contrainte sans comprendre que « la fin de la mobilité réactive mécaniquement les questions de la relocalisation et du réenracinement (p. 110) ». Un éloignement psychologique s’opère-t-il ? Difficile à dire. Certes, les études confirment qu’« après plusieurs décennies de recomposition des territoires, les catégories populaires vivent désormais sur les territoires les plus éloignés des zones d’emplois les plus actives et où le maillage en transports publics est le plus faible (p. 121) ». Les ménages populaires doivent par conséquent posséder deux véhicules et subir la hausse fiscale du prix des carburants, le flicage routier permanent et la perte de temps considérable dans les embouteillages, ce dont se moquent les bobos urbains à vélo, en rollers ou en trottinette. La faible mobilité des populations reléguées en périphérie s’accentue aussi en raison de l’impossibilité de vendre leurs biens immobiliers guère attractifs pour s’installer ensuite dans des zones urbaines prospères au loyer élevé. Christophe Guilluy remarque que « cette fracture territoriale dessine la confrontation à venir entre mobile et sédentaire. C’est cette France de la sédentarisation contrainte qui portera demain le modèle économique et politique alternatif (pp. 126 – 127) ».
Cette fragmentation réelle est occultée par des discours « républicains » illusoires. « La posture républicaine ne doit en effet pas tromper, la réalité est que nos classes dirigeantes sont pour l’essentiel acquises au modèle multiculturel et mondialisé (p. 9). » En outre, circonstance aggravante, « le nez collé aux banlieues, les classes dirigeantes n’ont pas vu que les nouvelles radicalités sociales et politiques ne viendraient pas des métropoles mondialisées, vitrines rassurantes de la mondialisation heureuse, mais de la “ France périphérique ”. Des territoires ruraux aux petites villes et des villes moyennes jusqu’aux DOM-TOM, ces territoires ont en commun d’être à l’écart des zones d’emplois les plus actives, des sites qui comptent dans la mondialisation (p. 13) ». Pourquoi ? Parce que cette « France périphérique » représente au moins 70 % de la population française concentrée dans les espaces ruraux, les petites villes, les villes moyennes et les zones périurbaines. L’auteur ne prétend pas verser dans l’habituelle et désuète dichotomie monde urbain/monde rural. « Nous sommes tous devenus urbains, que nous regardons le même journal télévisé et que nous fréquentons les mêmes grandes surfaces. L’opposition entre ville et campagne, entre urbain, périurbain et rural, ne dit plus rien des nouvelles dynamiques sociales. Les nouvelles fractures françaises ne recouvrent en rien une opposition entre une “ civilisation urbaine ” et une “ civilisation rurale ou campagnarde ”, en réalité la “ société des modes de vie ” s’est affranchie depuis longtemps de ce découpage suranné (p. 23) ».
Pour l’auteur, la « France périphérique » forme un « espace multiforme qui comprend les agglomérations plus modestes, notamment quelques capitales régionales, et surtout le réseau des villes petites et moyennes. Il comprend aussi l’ensemble des espaces ruraux et les communes multipolarisées (dépendantes en termes d’emploi de plusieurs pôles urbains) et les secteurs socialement fragilisés des couronnes périurbaines des 25 premières agglomérations (p. 27) ». Cette France « invisible » commence cependant à se manifester. Pis, elle « gronde (p. 51) », d’où la révolte des Bonnets rouges en Bretagne, la consolidation du vote Front national et le renforcement de l’abstention.
Christophe Guilluy contourne la vulgate consensuelle. Une féroce réalité impose maintenant sous la République une et indivisible trois France à terme antagonistes :
— un archipel métropolitain mondialisé peuplé de « bobos » progressistes qui se complaisent dans le libéralisme économique, la société ouverte, le multiculturalisme et les comportements libertaires marchands,
— un Hexagone maillé de banlieues de l’immigration nichées au cœur de la mondialisation libérale, mais dont les populations arrivantes gardent et célèbrent leurs valeurs traditionnelles,
— une France périphérique, populaire et déclassée constituée par des Français d’origine européenne relégués en zones rurales ou périurbaines en plein marasme économique.
Le futur cauchemar des métropoles
En examinant avec minutie les suffrages du FN depuis 2012, l’auteur démontre la polymorphie de ce vote qui ne recoupe pas ces trois Hexagones potentiellement conflictuels. Le « “ FN du Nord ” [s’inscrit dans] le contexte de la précarisation sociale (p. 63) » perceptible à Hénin-Beaumont, à Hayange et à Villiers-Cotterêts. Le « “ FN du Sud ” [bénéficie des] tensions identitaires (p. 64) », entre autochtones et immigrés, d’où les élections des députés Marion Maréchal – Le Pen dans le Vaucluse et Gilbert Collard dans le Gard, et des nouveaux sénateurs Stéphane Ravier dans les Bouches-du-Rhône, et David Rachline dans le Var. Quant au très jeune « “ FN de l’Ouest ” [il indique que] la “ France tranquille ” […] bascule (p. 66) ». Cet essor est à corréler avec de nouvelles dynamiques rurales, à savoir l’installation, plus ou moins lointaine, des ensembles urbains de ménages européens qui fuient une « volonté de créer une société multiculturelle dans laquelle “ l’homme nouveau ” ne reconnaîtrait aucune origine (p. 78) ». Il apparaît que, « plus encore que les banlieues, la France périphérique est le cauchemar des classes dirigeantes (p. 14) ».
En effet, « si les difficultés des banlieues sont réelles, elles sont d’abord liées à l’émergence d’une société multiculturelle et à la gestion des flux migratoires, mais en aucun cas aux retombées d’une économie mondialisée. Mieux, les banlieues sont des parties prenantes de cette économie. Pour l’essentiel situées au cœur des métropoles, elles sont parfaitement adaptées à la nouvelle donne économique et sociétale. Pourtant, depuis vingt ans, médias et politiques confondent la question des tensions culturelles et celles de l’intégration économique et sociale (pp. 13 – 14) ». Il en résulte « des banlieues intégrées et qui produisent des classes moyennes (p. 43) » d’origine immigrée : la « beurgeoisie » ainsi que d’autres heureux bénéficiaires, les commerçants asiatiques. « Miroir des dynamiques économiques et sociales, les métropoles viennent d’ailleurs conforter ce diagnostic. Vitrines de la mondialisation heureuse, ces dernières illustrent à merveille la société ouverte, déterritorialisée, où la mobilité des hommes et des marchandises est source de créations d’emplois, de richesses et de progrès social. Ces territoires produisent désormais l’essentiel des richesses françaises en générant près des deux tiers du PIB mondial. Le modèle “ libéral-mondialisé ” y est à son apogée (p. 8). » Il en découle par conséquent que « la gestion économique et sociale de la “ ville-monde ” passent inéluctablement par une adaptation aux normes économiques et sociales mondialisées, c’est sur ces territoires que l’on assiste à une mutation, voire à un effacement du modèle républicain. Politique de la ville, promotion d’un modèle communautariste, la gestion sociale de la ville-monde passe par une adaptation aux normes anglo-saxonnes. Globalement, et si on met de côté la question des émeutes urbaines, le modèle métropolitain est très efficace, il permet d’adopter en profondeur la société française aux normes du modèle économique et sociétal anglo-saxon et, par là même, d’opérer en douceur la refonte de l’État-providence (pp. 8 – 9) ». Dans ce contexte entièrement mouvant, hautement fluide, guère perçu par les banales certitudes médiatiques, « l’immigration apparaît non pas comme une solution économique pour les plus modestes mais d’abord comme une stratégie économique des catégories moyennes et supérieures qui ne se positionnent plus exclusivement sur un marché de l’emploi local mais international (p. 115) ». Serait-ce les signes avant-coureurs d’une guerre civile à venir ? À rebours de la doxa multiculturaliste (en fait monoculturelle de marché et multiraciste polémogène), Christophe Guilluy explique la fuite des classes populaires hors des métropoles par un refus tangible du conflit ethno-racial.
Ces stratégies d’évitement se retrouvent dans les métropoles parce que les catégories sociales et/ou privilégiées « sont aussi celles qui ont les moyens de la frontière avec l’autre, celles qui peuvent réaliser des choix résidentiels et scolaires qui leur permettent d’échapper au “ vivre véritablement ensemble ” (p. 138) ». Les populations périphériques ne cachent néanmoins pas leur rancœur envers l’État-providence dont les ultimes forces bénéficient en priorité aux primo-arrivants (les immigrés). Toutefois, elles pensent que « vivre ensemble séparé est aujourd’hui le prix à payer dans une société multiculturelle d’où la question sociale a été évacuée (p. 161) ». En revanche, « les représentations de la société française et du monde sont désormais irréconciliables, le consensus n’est plus envisageable (pp. 76 – 77) », d’autant « les catégories populaires, quelle que soit leur origine, savent que le rapport à l’autre est ambivalent : fraternel mais aussi conflictuel (p. 77) ».
Vers une géographie politique recomposée
Tout autant que géographiques, territoriales et sociologiques, les conséquences de cette séparation « à froid », silencieuse, indolore sont aussi électorales. « Le monde politique est aujourd’hui un champ de ruines (p. 71) ». Fort de ses analyses, Christophe Guilluy estime qu’« un parti = une sociologie + une géographie (p. 78) » au moment où « le champ politique n’est plus le lien du débat et de la confrontation des idées et des projets, mais une caisse de résonance de la rupture entre catégories populaires et, non seulement les élites, mais les catégories supérieures (p. 74) ».
Perdurent, hélas !, des légendes propagées par la caste journalistique. « Parce qu’ils [UMP et PS] sont les représentants historiques de la classe moyenne (actifs et/ou retraités issus de), les partis de gouvernement ont intérêt à faire vivre le mythe d’une classe moyenne majoritaire (p. 18) » alors qu’« en milieu populaire, la référence gauche – droite n’est plus opérante depuis au moins deux décennies (p. 72) ». Il est exact qu’« ouvriers, employés, femmes et hommes le plus souvent jeunes et actifs partagent désormais le même refus de la mondialisation et de la société multiculturelle (p. 87) ». Va-t-on cependant vers une révolution ? Il n’y croît pas. Mais, sur le terrain, « à bas bruit, une contre-société est en train de naître. Une contre-société qui contredit un modèle mondialisé “ hors sol ”; un meilleur des mondes, sans classes sociales, sans frontières, sans identité et sans conflits (pp. 130 – 131) ». « C’est sur ces territoires, par le bas, que la contre-société se structure en rompant peu à peu avec les représentations politiques et culturelles de la France d’hier (p. 11). » Comme quoi, le projet des B.A.D. (bases autonomes durables) dispose là d’un développement porteur considérable s’il est bien conduit, d’abord hors de toute publicité…
Cette lente et patiente rupture se répercute sur le plan électoral avec un « FN [qui bénéficie de] la dynamique des nouvelles classes populaires (p. 86) » à l’heure où il devient « inter-classiste » ou « post-classiste ». L’appréciation est à nuancer. Certes, « ce n’est pas le Front national qui est allé chercher les ouvriers, ce sont ces derniers qui ont utilisé le parti frontiste pour contester la mondialisation et s’inquiéter de l’intensification des flux migratoires (p. 79) ». L’auteur validerait-il la thèse du gaucho-lepénisme avancé dès 1995 par le politologue Pascal Perrineau ? Pas tout à fait, même s’il reconnaît « une “ sociologie de gauche ” qui contraint les dirigeants frontistes à abandonner un discours libéral pour défendre l’État-providence (p. 80) », car « les catégories populaires ne croient plus à la bipolarisation et n’adhèrent plus au projet d’une classe politique décrédibilisée par plusieurs décennies d’impuissance (p. 89) ».
On peut craindre que, dans ces conditions nouvelles, l’actuel programme social du néo-frontisme « mariniste » ne soit qu’un emballage populiste qui, à l’instar de nombreux précédents sud-américains, sera, une fois au pouvoir, renié pour mieux se conformer au Diktat de l’hyper-classe mondialiste et/ou jouir du faste des palais gouvernementaux tout en orchestrant une intense campagne sécuritaire de répression.
Christophe Guilluy prévoit-il le triomphe prochain du FN ? Nullement parce que « le vieillissement de la population demeure le rempart le plus efficace contre la montée du “ populisme ” (p. 91) ». En effet, « paradoxalement, c’est le vieillissement du corps électoral qui permet de maintenir artificiellement un système politique peu représentatif, les plus de 60 ans étant en effet ceux qui portent massivement leurs suffrages vers les partis de gouvernement (p. 72) ». La gérontocratie, stade suprême de la République hexagonale ? Eh oui ! « le socle électoral de la gauche est ainsi constitué d’une part de gagnants de la mondialisation (classes urbaines métropolitaines) et d’autre part de ceux qui en sont protégés (salariés de la fonction publique et une partie des retraités). De la même manière, l’UMP capte aussi une partie des gagnants de la mondialisation (catégories supérieures et aisées) et ceux qui en sont plus ou moins protégés (les retraités) (p. 80). » L’hétérogénéité des électorats du PS et de l’UMP prépare néanmoins des avenirs différents. Si « l’UMP [dispose d’]une dynamique démographique favorable (p. 84) », le PS peut disparaître, car c’« est le parti de la classe moyenne (p. 85) ». Par ailleurs, le PS se montre incapable de trancher entre des desseins contradictoires. « Le gauchisme culturel de la gauche bobos se heurte […] à l’attachement, d’ailleurs commun à l’ensemble des catégories populaires (d’origine française ou étrangère), des musulmans aux valeurs traditionnelles. Autrement dit, le projet sociétal de la gauche d’en haut s’oppose en tous points à celui de cet électorat de la gauche d’en bas (pp. 105 – 106). »
PS et UMP incarnent désormais deux pôles gémellaires autour desquelles s’agencent des majorités électorales momentanées. Il en ressort que « les stratégies électorales de Terra Nova pour le PS et de Patrick Buisson pour l’UMP apparaissent les plus pertinentes pour des partis désormais structurellement minoritaires dans un système tripartiste (p. 95) ». Les institutions de la Ve République s’adapteront-elles à cette nouvelle donne ?
Christophe Guilluy critique la réforme territoriale Hollande – Valls et s’élève contre la disparition programmée du département. Il conçoit plutôt cette collectivité comme le cadre adéquat d’« une France périphérique sédentaire et populaire (p. 121) ». On se surprend de lire en conclusion quelques allusions à une version atténuée de décroissance qui est en fait du localisme édulcoré. En tout cas, il est patent que « la question d’un modèle de développement économique alternatif sur ces territoires est désormais posée (p. 164) ». Cette contre-société en gestation partiellement dissidente et séparatiste évitera-t-elle tout antagonisme ? « Le risque est réel de voir les radicalités sociales et politiques se multiplier et le conflit monter vers une forme de “ guerre à basse tension ” (p. 179). » Et si la révolution de demain se lovait dès maintenant en périphérie des métropoles ?
Georges Feltin-Tracol
• Christophe Guilluy, La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires, Flammarion, Paris, 2014, 187 p., 18 €.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=4046
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, georges feltin-tracol, france, europe, affaires européennes, livre, géographie, christophe guilly |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 01 décembre 2014
Sur le "Palais des rêves" d'Ismail Kadaré
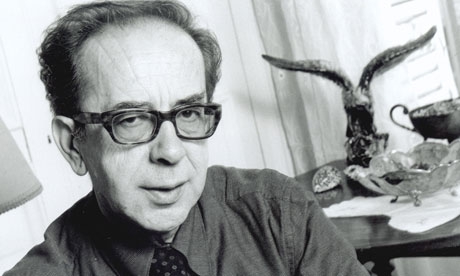
Sur le "Palais des rêves" d'Ismail Kadaré
Ex: http://www.calmeblog.com
traduit de l'albanais par Jusef Vrioni pour les éditions Fayard
"Peut-on jamais savoir le pourquoi des choses ici?"
"- L'heure est critique, reprit le Vizir. Le Maître-Rêve peut à nouveau frapper..."
Un immeuble labyrinthique aux portes innombrables et abritant des millions de dossiers: le Palais des rêves. Ismail Kadaré prenait quelques risques avec ce roman composé à Tirana de 1976 à 1981:celui de la parabole écrite dans l'ombre gigantesque de Kafka. Le risque politique faillit le mener à un drame semblable à celui qui conclut le roman comme le rappelle l'utile préface d’Éric Faye.
ENTRÉES
En deux chapitres (LE MATIN, LA SÉLECTION), Kadaré nous introduit à un destin, à un lieu de pouvoir étonnant ainsi qu'à l’histoire d’une très ancienne famille (les Quprili):nous voilà dans un passé (pas aussi lointain qu’on croit à première lecture) de l'Albanie (quand elle appartenait à l’empire Ottoman, immense domaine politique avec une partie asiatique et une autre, européenne).
Le héros se nomme Mark-Alem (Quprili, même si sa mère a préféré conserver son nom de jeune fille):au début du roman, il entre au Tabir Sarrail (ou Palais des rêves), un édifice impressionnant et fascinant, abritant des milliers de fonctionnaires gris et besogneux, uniquement occupés à lire et à constituer des dossiers qui répertorient tous les rêves des habitants, dûment collectés dans tout l’Empire pour l’information et le service du Sultan à qui on remet en grande pompe, chaque vendredi, le Maître-rêve ou l’Archirêve. Au début de son parcours, Mark-Alem est installé dans un étroit et sinistre bureau relevant du secteur de la Sélection, secteur important même s’il a moins de prestige que celui de l’Interprétation dont les éxécutants protestent quand on ose les rapprocher des spécialistes de la clef des songes. Mark-Alem est forcément vite tenté par l’Interprétation qu'il rejoindra à une vitesse exceptionnelle.
Ce Tabir Sarrail (l’institution la plus mystérieuse de l’Empire -son mystère faisant partie de son prestige et de son pouvoir (pouvoir du secret, secret du pouvoir, quitte à n'avoir aucun secret)) est un lieu de travail épuisant (et, paradoxalement envoûtant) et surtout un moyen inédit de gouverner qui, au moment du récit, a retrouvé une importance perdue depuis quelques décennies. Nous allons suivre Mark (son "identité" occidentale)-Alem (son "identité" orientale) dans ce monde du contôle et vivre avec lui des moments critiques et tragiques.(1)
Mark-Alem (vingt-huit ans quand il deviendra soudain puissant) appartient donc a une grande et antique famille qui refusa toujours d'écrire son nom selon l'orthographe ottomane et qui compte encore un Vizir parmi elle. Depuis toujours célèbre et enviée, son destin est pourtant étrange. Elle peut connaître la gloire (cinq de ses membres furent grands vizirs de l’Empire) mais aussi, de façon foudroyante, elle peut se retrouver frappée par de grands malheurs. On ne saurait exclure que le Souverain jalouse cette famille célébrée dans une chanson de geste qui a toujours troublé parce qu'elle est bosniaque et exprimée en serbe...: les rhapsodes capables de l'entonner seront présents au moment le plus sombre du livre : Kadaré leur consacrera de très belles pages, à leur voix en particulier.
COMPOSITION
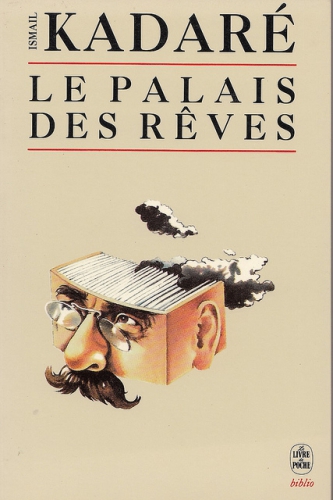 On suit l’initiation de Mark-Alem et les étapes sont aisément repérables malgré le mystère qu’entretient la machine infernale étatique. Deux réceptions (aux chapitres II et VI) se répondent (il y est beaucoup question de la famille Quprili, du Palais des Rêves vu de l’extérieur alors que les autres chapitres nous plongent dans l’antre de l’enfer) et accroissent l’angoisse du lecteur qui partage celle du héros.
On suit l’initiation de Mark-Alem et les étapes sont aisément repérables malgré le mystère qu’entretient la machine infernale étatique. Deux réceptions (aux chapitres II et VI) se répondent (il y est beaucoup question de la famille Quprili, du Palais des Rêves vu de l’extérieur alors que les autres chapitres nous plongent dans l’antre de l’enfer) et accroissent l’angoisse du lecteur qui partage celle du héros.
Singulier, le chapitre IV, central, nous montre combien est grand l’empire du Tabir Sarrail: Mark-Alem qui se plaint sans cesse de son nouveau lieu de travail ne supporte pourtant plus un jour de congé et la réalité commune de la vie quotidienne. Sa dépendance en paraît encore plus grande.
Le mouvement de lecture nous emporte dans un mouvement totalitaire follement centripète.
DU POUVOIR
Les apparatchiks albanais ne s’y trompèrent pas:cette collection des rêves de tous les sujets de l’Empire, leur acheminement à n’importe quel prix, le premier tri, le secteur de la Sélection puis celui de l’Interprétation, celui qui décide du Maître-Rêve, tout concourt à montrer les ressources et les moyens d’un pouvoir totalitaire inédit dans la mesure où l’inconscient est la chose du monde la mieux à partager par l'État total (“-Pour moi, reprit Kurt, c’est le seul organe de notre État par lequel la part de ténèbres dans la conscience de ses sujets entre directement en contact avec lui) où l’on donne l’illusion d’un pouvoir au peuple (“Certes poursuivit-il, les multitudes ne gouvernent pas, mais elles sont aussi dotées d’un mécanisme à travers lequel elles influent sur toutes les affaires, les vicissitudes et les crimes de l’État, et ce rouage n’est autre que le Tabir Sarrail. “) en échange d’un sentiment de culpabilité terrorisante (et d'inhibition):enfin, et surtout, le pouvoir de l’interprète est sans limite: ” Quiconque a la haute main sur le palais des Rêves détient les clés de l’État.” Son oncle le Vizir lui dit que “C’est un Maître-Rêve qui donna l’idée du grand massavre des chefs albanais à Monastir.(…). C’est également un Mâitre-Rêve qui entraîna la révision de la politique envers Napoléon et la chute du grand vizir Youssouf. Les cas de ce genre ne se comptent plus….”Il ajoute : “S’il [le directeur du Tabir, apparemment modeste et dépourvu de tout titre, passe pour rivaliser en puissance avec nous, les plus influents vizirs…(…), c’est qu’il dispose d’un redoutable pouvoir, celui qui ne se fonde pas sur les faits."(j'ai souligné). Il est même possible que certains Maîtres-Rêves soient falsifiés, ce qui exige tout un travail d'analyse par une section spéciale.
Les moments de terreur de Mark-Alem devant l’étendue et les risques de sa tâche permettent à Kadaré de nous faire entrer dans un système dément au charme de termitière que personne pourtant ne veut quitter et qui quadrille tout l’Empire en passant au crible (aux critères évolutifs) tout ce que le citoyen ne sait pas sur lui-même....
LE NOM ET LE RÊVE FATAL
Le nom de Quprili est rien d'autre "que la traduction du mot URA, le pont, venant lui-même d'un vieux pont à trois arches de l'Albanie centrale édifié à l'époque où les Albanais étaient encore chrétiens, et dans les fondations duquel avait été emmuré un homme.(...)Un de leurs aïeux prénommé Gjon, qui avait travaillé comme maçon sur ce pont, avait hérité après son achèvement, en même temps que des souvenirs du meurtre, du nom de Ura."(2)
Pendant son travail de Sélection Mark-Alem était tombé sur le texte d'un rêve qu'il avait travaillé avec hésitation:" Un terrain abandonné au pied d'un pont; une espèce de terrain vague, de ceux où l'on jette les détritus. Parmi les ordures, la poussière, les éclats de lavabos brisés, un vieil instrument de musique à l'espect insolite, qui jouait tout seul dans cette étendue déserte, et un taureau, apparemment mis en furie par ces sons, qui mugissait au pied du pont..."
Entre ces deux faits apparemment et réellement indépendants se joue l'épisode criminel du livre:Kurt Quprili en sera la victime sous les yeux de ses proches parents dont le Vizir et Mark-Alem qui avait laissé passer ce rêve...
ORIGINALITÉ
Il faut reconnaître que Kadaré soutient la comparaison (inévitable) avec d’illustres prédécesseurs:aussi bien dans son évocation de l’espace labyrinthique du Tabir Sarreil dans lequel s’égare souvent Mark-Alem (un mélange de désorientation et de lisse où fenêtres et portes ont un rôle vertigineux- le pouvoir annexe même votre errance) que dans la restitution de l’instabilité du héros passant de l’angoisse à l’euphorie (son psychisme est bouclé à double tour et ne connaît que deux affects) et parvenant, par dépendance , à nier la beauté du monde extérieur sauf à la dernière page, quand il est trop tard-il a oublié trop vite le genre humain. Si, avec ces copistes et ces copistes de copistes, il est impossible de ne pas penser à Kafka et même aux images hallucinées et injectées de vérité d’Orson Welles dans la gare d’Orsay (3), il reste que les étagements, les empilements de dossiers, les subtilités des catégories de classement, les hiérarchies entretenues entre les êtres sont remarquablement décrits comme sont rigoureusement mis en scène les moyens d’asservissement par l’inertie. Avec talent, Kadaré parvient à évoquer en même temps la crise et le fond de grise inertie répétitive et monotone d’où elle émerge. La solidarité des deux en est aveuglante. Systémique comme on ne disait pas à l'époque.
Kadaré élargit le domaine de réflexion sur la littérature de la répression et de la manipulation, sur les rouages de la machine paranoïaque (où tout est test, épreuve), sur la logique du sacrifice (la mort d’un parent étant le minimum requis par la machiavélique autorité) et sur celle de l’ambivalence dans le régime totalitaire.
La machine paranoïaque immatérielle, si elle a trouvé ses moyens techniques inédits, a-t-elle trouvé son Orwell, son Zinoviev, son Kadaré?
Rossini, le 13 juillet 2013
NOTES
(1) Il y a bien une Histoire du Tabar et les mots de Kadaré auront eu sans doute beaucoup d'échos :"Ce n'est un secret pour personne, dit-il, que le Tabar Sarrail se trouvait, voici quelques années, sous l'influence des banques et des propriétaires de mines de cuivre, alors que plus récemment, il s'est rapproché du clan du Cheikh ul-Islam."
(2) On sait que l'un des autres romans de Kadaré a pour titre LE PONT AUX TROIS ARCHES.
(3) Sur lequel il est de bon ton de cracher depuis toujours, surtout quand on a écrit une pitoyable adaptation de JACQUES LE FATALISTE..
00:05 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ismail kadaré, livre, littérature, lettres, lettres albanaise, albanie, littérature albanaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Adinolfi présente son livre à Paris
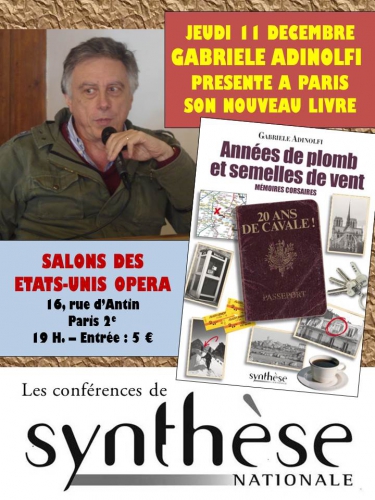
00:05 Publié dans Evénement, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, événement, gabriele adinolfi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 30 novembre 2014
Zbigniew Brzezinski, “Le vrai choix”
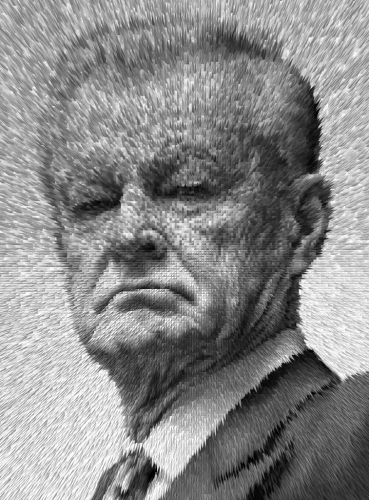
Zbigniew Brzezinski, “Le vrai choix”
par Vincent Satgé
Ex: http://fortune.fdesouche.com
Le vrai choix, L’Amérique et le reste du monde fut publié alors que les États-Unis étaient engagés dans l’opération Iraqi freedom. Au vu des tensions internationales qui ont accompagné cettecampagne militaire, on pouvait raisonnablement attendre de Zbigniew Brzezinski qu’il choisisse avec précaution les formules et les tournures à employer. Peine perdue car, dès l’introduction, ce dernier expose sa thèse crûment : « Notre choix ? Dominer le monde ou le conduire » [1].
Appelant de ses vœux une « communauté internationale d’intérêts partagés » sous supervision américaine, il se plaçait ainsi dans une position intermédiaire assez inconfortable, fustigeant les influents néoconservateurs comme les colombes libérales.
Zbigniew Brzezinski est habitué à être sous le feu des critiques. Détenteur d’un doctorat de l’Université d’Harvard, il s’est surtout fait connaître pour avoir été le principal conseiller des affaires étrangères de Jimmy Carter lors de la campagne présidentielle de 1976.
Une fois l’élection remportée, il fut de 1977 à 1981 son conseiller à la Sécurité nationale durant une période agitée (particulièrement lors de l’échec de l’opération Eagle Claw visant à libérer les diplomates américains pris en otage en Iran).
Depuis, il a notamment exercé la fonction de conseiller au Center for Stategic and International Studies (CSIS) ainsi que de professeur de relations internationales à la Johns Hopkins University à Washington D.C.
Quelles sont les options qui restent aux Etats-Unis s’ils souhaitent conserver leur rang mondial ?
S’il a publié de nombreux ouvrages (Illusion dans l’équilibre des puissances en 1977 ou L’Amérique face au monde co-écrit en 2008 avec Brent Scowcroft), Zbigniew Brzezinski est surtout connu pour Le grand échiquier (1997). Il y détaille notamment les alternatives dont disposaient les Etats-Unis pour maintenir leur influence sur l’Europe et l’Asie, clés du contrôle sur le reste du monde. Seul défaut de cet ouvrage qui fit date : il ne couvre pas la période postérieure au 11 septembre, évènement qui a considérablement réorienté la politique étrangère des Etats-Unis.
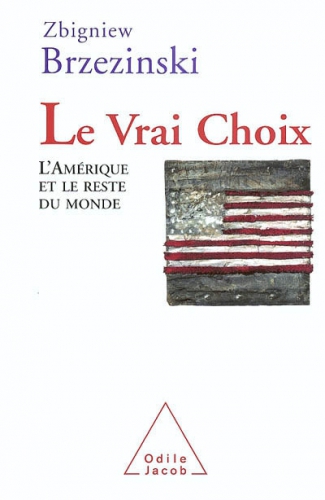 Le Vrai Choix, à l’inverse, nous livre un regard plus actuel sur les options qui restent aux Etats-Unis s’ils souhaitent conserver leur rang mondial.
Le Vrai Choix, à l’inverse, nous livre un regard plus actuel sur les options qui restent aux Etats-Unis s’ils souhaitent conserver leur rang mondial.
Le raisonnement de Zbigniew Brzezinski peut être dès lors décomposé en trois temps. Il constate tout d’abord que le choix de la domination n’est pas, à moyen ou long terme, possible ni même profitable aux États-Unis. Il va ensuite s’interroger sur la manière pratique d’exercer un leadership sur les affaires mondiales. Enfin, il pointe les faiblesses institutionnelles qui risquent de mettre à mal la mise en œuvre de la diplomatie américaine.
La guerre contre le terrorisme ainsi que l’unilatéralisme amoindrissent la sécurité des États-Unis
La position géographique privilégiée des États-Unis les a souvent amenés à considérer leur sécurité comme définitivement acquise. Encadrés par des voisins peu puissants, placés entre l’Océan Pacifique et l’Océan Atlantique, les États-Unis étaient quasiment en situation d’insularité jusqu’à la Guerre Froide. Une fois le rival soviétique disparu, le sentiment d’invulnérabilité repris le dessus jusqu’aux attentats du 11 septembre.
Le monde et les États-Unis prirent ainsi définitivement conscience que la mondialisation permet aux menaces de s’affranchir des distances, du fait de la prolifération des technologies ou du terrorisme le plus « artisanal » qui soit. Face à ce nouveau défi, la réaction politique des Américains ne fut, pour l’auteur, clairement pas à la hauteur. « L’insécurité peut être socialement désagréable, elle doit être politiquement gérable » [2].
Ainsi les pouvoirs publics ont-ils investi énormément sur des dispositifs tels que le bouclier anti-missile, oubliant que le type d’attaque que ce dernier prévient est rendu improbable par les représailles que courrait l’État agresseur. Un attentat terroriste, par contre, pourrait causer des dégâts matériels aussi importants tout en empêchant de répliquer et de neutraliser l’organisation responsable. Le meilleur moyen de se prémunir des attaques qui visent le territoire américain reste de renforcer les capacités des services de renseignement.
Par ailleurs, cette lutte contre le terrorisme doit être accompagnée d’un effort d’identification de la menace. Il apparaît en effet absurde de désigner le terrorisme comme l’ennemi en ce sens qu’il ne s’agit que d’une « technique meurtrière d’intimidation », utilisée par tous types de mouvements [3] (les attentats suicides, de 1981 à 2001, auraient ainsi majoritairement été menés par les Tigres Tamouls du Sri Lanka, marxistes donc s’opposant aux religions).
Derrière le terrorisme, c’est l’acte politique qu’il s’agit de comprendre. Or, sur ce point, « les États-Unis ont montré une extraordinaire réticence à prendre en compte la dimension politique du terrorisme et à restituer celui-ci dans son contexte politique » [4].
Outre la guerre contre le terrorisme, c’est bien les interventions unilatérales qui mettent en péril la sécurité des États-Unis. Le discours du Président G. W. Bush à l’académie de West Point le 1er juin 2002, a largement justifié le concept d’« attaque préemptive » (lorsqu’un acteur estime qu’un autre État est sur le point de mener une action offensive) à l’encontre d’« États voyous ».
Une telle attitude sur la scène mondiale ne peut qu’entraîner une détérioration des rapports avec les Européens et donner à penser que la guerre contre le terrorisme peut être réduite à une initiative exclusivement américaine aux fortes connotations anti-musulmanes.
Le « conflit des civilisations » de Samuel Huntington adviendrait alors à titre de prophétie auto-réalisatrice. Au final, la sécurité des États-Unis seraient encore moins garantie vu que « l’acquisition clandestines d’armes de destruction massive prendrait vite le rang de priorité parmi les États déterminés à ne pas se laisser intimider. Ils trouveraient là une incitation supplémentaire à soutenir les groupes terroristes, lesquels, animés par la soif de vengeance, seraient alors plus enclins que jamais à utiliser, de façon anonyme, ces armes contre l’Amérique » [5].
Bref, on passerait du paradigme MAD (mutual assured destruction) de la Guerre Froide à celui de SAD (solitary assured destruction) ce qui pour Zbigniew Brzezinski s’assimile à une « régression stratégique ».
Loin de poursuivre dans une posture dominatrice et isolante, les États-Unis doivent redéfinir leur position sur la scène internationale.
Le premier volet de cette redéfinition concerne l’identification des zones sensibles de la planète. La première est celle des « Balkans mondiaux » [6] qui, avec le Moyen-Orient en particulier, doit être traitée avec le plus grand soin sous peine de détériorer les relations entre les États-Unis et l’Europe et les États-Unis et le monde musulman. Vient ensuite l’Asie qui est « une réussite économique, un volcan social et une bombe politique » [7], constat plus que jamais d’actualité avec les rivalités économiques et territoriales exacerbées, sans parler de vieux contentieux historiques (colonisation du Japon et timide repentir pour ses crimes de guerre ; relations indo-chinoises ; conflit latent entre le Japon et la Russie à propos des îles Kouriles et Sakhaline ; le dossier nord-coréen ; Taïwan, « 23e province chinoise »).
Une approche régionale sur tous ces points chauds devrait permettre une résolution (et une prévention) des conflits qui y sévissent, surtout de ceux dont on parle peu. L’auteur pointe ainsi la question assez peu posée du Cachemire, occulté par le conflit israélo-arabe. Avec 1,2 milliards d’habitants, deux États nucléaires et des populations très sensibles aux rengaines nationalistes, la zone mérite plus d’attention que celle dont elle bénéficie actuellement.
Les États-Unis ont besoin d’alliés… et réciproquement
Une fois les situations à risques identifiées, les États-Unis ont besoin d’alliés pour y faire face. Selon Zbigniew Brzezinski, le seul partenaire digne de ce nom est, à la vue de son potentiel politique, militaire et économique, l’Union européenne. Leur association, au-delà de l’utilité pratique, permettrait de désamorcer les critiques d’unilatéralisme (ou au moins de les affaiblir).
Ensemble, Europe et États-Unis sont « le noyau de la stabilité mondiale ».
Cela ne veut pour autant pas dire que leur entente aille de soi. Deux menaces planent au-dessus de leur entente cordiale. Les questions de défense et le « partage du fardeau » sont primordiales. Les Américains se plaignent souvent du manque d’investissement des Européens dans leurs dépenses militaires, tandis que le Vieux Continent dénonce souvent sa tutelle américaine.
Toutefois l’un autant que l’autre sortent gagnant du statu quo. En effet, l’Europe ne doit sa cohésion interne qu’à la présence américaine tandis que la prééminence américaine ne pourrait s’accommoder d’une Europe militairement autonome.
L’observation se vérifie surtout dans des régions telles que le Moyen-Orient (qui accueillerait l’Europe à bras ouvert vu la détérioration des rapports avec les États-Unis) ou encore l’Amérique latine (qui a des liens historico-culturels importants avec l’Espagne, la France et le Portugal).
La seconde entrave à un rapprochement du couple Europe-Etats-Unis concerne la question des règles qui sous-tendent l’ordre mondial. Brzezinski le reconnaît sans détour : « c’est en fonction de son utilité ponctuelle que telle ou telle doctrine est mise en œuvre de façon sélective [...] Pour le monde extérieur, le message est clair : lorsqu’un accord international contredit l’hégémonie américaine et pourrait brider sa souveraineté, l’engagement des Etats-Unis en faveur de la mondialisation et du multilatéralisme atteint ses limites » [8]. Ainsi fut-ce le cas pour le protocole de Kyoto ou encore la Cour pénale internationale.
Pour parvenir à ses fins, l’Amérique doit s’évertuer à sauvegarder des institutions démocratiques et capables de produire du consensus sur la diplomatie à mener.
Selon Zbigniew Brzezinski, l’évolution de la composition ethnique des États-Unis risque, à terme, de compliquer la définition de la politique étrangère américaine. En effet, si le pays à longtemps été dominé par une majorité WASP (White Anglo-Saxon Protestant), la progression des communautés tierces qui réclament et qui obtiennent une reconnaissance politique est un phénomène tendant à s’amplifier.
Ainsi la victoire du Président J. F. Kennedy en 1960 (seul président catholique des États-Unis à ce jour), la nomination d’Henry Kissinger au poste de secrétaire d’État (réfugié juif d’origine allemande) en 1973, ou encore celle de Colin Powell au même poste en 2001 en sont divers exemples (la présidence Obama n’étant pas citée car postérieure à l’écriture de l’ouvrage).
La diplomatie américaine pourrait bien devenir un exercice de haute voltige politique compte tenu de l’évolution des composantes de la société.
Le bât blesse lorsque chaque communauté vise, à travers des groupes de pression, à faire prévaloir son influence sur celle des autres. Avec la banalisation de « groupes de veto ethniques », la diplomatie américaine pourrait bien devenir un exercice de haute voltige politique (voire impossible à réaliser).
Que ce soit par le vote d’amendements au Congrès, le financement de campagnes électorales ou encore la constitution de comités parlementaires autour d’intérêts ethniques, la politique étrangère des États-Unis est sensible aux revendications infra-nationales. La Maison Blanche pourrait être, hors campagne électorale, assez peu concernée : seulement, c’est bien le Congrès qui vote le budget (et l’affectation des aides financières internationales montre d’ailleurs assez fidèlement le poids de chaque groupe particulier).
Ainsi, plutôt que d’être une synthèse ne satisfaisant personne, la politique extérieure des États-Unis devrait s’efforcer de rester bâtie sur un compromis visant l’intérêt général de l’Amérique. D’aucuns avancent que la politique étrangère du Canada, rôdé à gérer une société multiculturelle, pourrait constituer un modèle à suivre pour les États-Unis. Seulement ces derniers, à l’inverse de leur voisin, exercent des responsabilités internationales d’une ampleur totalement différente.
En outre, le rôle de « nation indispensable » tenu par les États-Unis met en péril le caractère démocratique de leurs institutions. Lorsqu’ils ont accédé au statut de grande puissance au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un appareil administratif imposant s’est mis en place afin d’assumer les nouvelles responsabilités du pays à l’international (représentations diplomatiques, directions des forces et des bases à l’étranger, services de renseignement…).
Cette « bureaucratie impériale », sous la conduite de l’exécutif américain, est en principe contrebalancée par la surveillance du Congrès (qui vote ses crédits et organise des comités sur son activité). Seulement, dans des périodes politiquement troubles, il arrive que le Congrès lâche la bride de l’exécutif.
Ce fut le cas en 2002 lorsque les parlementaires abandonnèrent le droit de déclarer la guerre à l’Irak au Président des États-Unis. Cette procédure a, ponctuellement mais indiscutablement, brisé l’équilibre des pouvoirs constitutionnels américains. Le même constat peut être fait avec le Patriot Act du 26 octobre 2001 qui a réduit l’étendue du pouvoir judiciaire (en particulier les écoutes effectuées sur demande gouvernementale). Au final, l’hégémonie des États-Unis peut menacer leur propre démocratie autant que leur mixité sociale toujours plus hétérogène peut entraver leur capacité à décider et mettre en œuvre leur diplomatie.
Si Zbigniew Brzezinski défend le multilatéralisme à moyen-terme, il reconnaît la nécessité d’agir parfois de manière unilatérale.
Le vrai choix semble, de prime abord, assez révélateur de l’époque où il a été rédigé. Si Zbigniew Brzezinski défend le multilatéralisme à moyen-terme, il reconnaît la nécessité d’agir parfois de manière unilatérale. S’il reconnaît que les États-Unis ont un discours sur la mondialisation trop frappé de messianisme, il n’hésite pas à vilipender les élites russes et européennes qui seraient tout autant dans l’excès dans leurs critiques (on notera avec amusement que deux Français, Jean Baudrillard et Pierre Bourdieu pour ne pas les citer, sont particulièrement visés).
Enfin, la « destinée manifeste » est à ce point intégrée dans le raisonnement de l’auteur qu’il n’hésite pas à conclure sur ces quelques lignes qui ont de quoi faire hausser les sourcils : « « Laissez rayonner vos lumières devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres » [9]. Que rayonne l’Amérique. » [10]
Lorsque l’on a accepté ces nombreuses réserves, il nous reste un ouvrage très bien structuré aux raisonnements pertinents, documentés et toujours d’actualité. Pour ne rien gâcher, l’auteur a, avec l’arrivée au pouvoir de Barack Obama, gagné son pari.Les Etats-Unis ont, ces dernières années, favorisé le leadership au détriment de la domination unilatérale. Reste à savoir s’il s’agit d’un changement de doctrine définitif ou bien, comme l’avance Serge Sur, d’« une stratégie à plus long terme de reconfiguration de la puissance américaine et de reconstruction d’une hégémonie durable » .
___________________________________________________
Notes :
[1] « Le vrai choix », Zbigniew Brzezinski, Ed° Odile Jacob, mars 2004, p.12
[2] Ibid, p.34
[3] Robert Pape, “Dying to kill us”, New York Times, 22 septembre 2003
[4] « Le vrai choix », Zbigniew Brzezinski, Ed° Odile Jacob, mars 2004, P.53
[5] Ibid, p.57
[6] « Le grand échiquier », Zbigniew Brzezinski, Ed. Bayard Jeunesse, 1997 : “Région instable qui s’étend approxiamtivement du canal de Suez au Sinkiang et de la frontière russo-kazakh au Sri Lanka”.
[7] « Le vrai choix », Zbigniew Brzezinski, Ed° Odile Jacob, mars 2004, p.146
[8] Ibid, p.203
[9] Évangile selon Saint Matthieu, 5 : 14-16
[10] Serge Sur, « Les nouveaux défis américains », Questions internationales, n°64, novembre-décembre 2013
Le Vrai choix – L’Amérique et le reste du monde
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, livre, stratégie, géostratégie, politique internationale, zbigniew brzezinski, brzezinski, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 27 novembre 2014
Dominique Venner, soldat politique
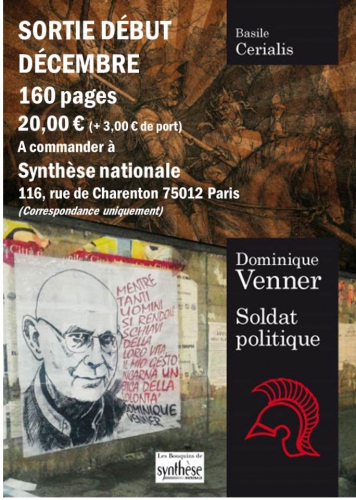
00:05 Publié dans Hommages, Livre, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, nouvelle droite, dominique venner, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 26 novembre 2014
Kafka: notre camarade-de-peuple
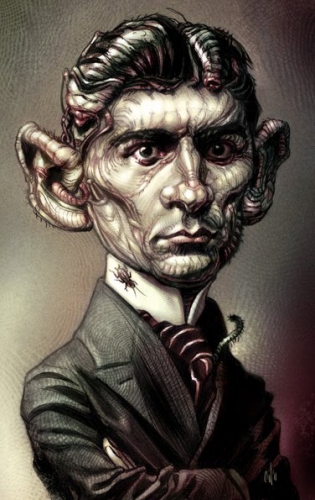
Kafka: notre camarade-de-peuple
par James J. O'Meara
Ex: http://www.counter-currents.com
English original here
James Hawes
Excavating Kafka [3]
London: Cuercus, 2008
US edition: Why You Should Read Kafka Before You Waste Your Life [4]
New York: St. Martin’s Press, 2008
« Il s’avère que Kafka était un citoyen allemand loyal, riche et amateur de porno. Qui le savait ? » — Un commentaire sur Amazon
Ce visage. Vous l’avez vu. Vous en avez par-dessus la tête de le voir. Le Prophète de l’Holocauste, du Goulag, et, pire que tout, des aspects orwéliens de l’Administration Bush/Obama. Le logo commercial de la Suprématie Culturelle judaïque, l’icône de l’Holochristianisme. L’emblème de tout ce que vous haïssez.
Vous voudriez le mettre en mille morceaux, puis le reconstituer et le briser à nouveau, encore et encore.
James Hawes a de bonnes nouvelles pour vous : c’est un faux. Un énorme bobard.
« …le symbole international de Prague … fut en fait emmené dans un magasin de Berlin … environ huit mois avant sa mort, alors qu’il savait logiquement qu’il était condamné. … Cet état d’esprit est … susceptible de vous donner un air profond.
Mais pas assez profond cependant. Au début des années 50 … les artistes de [la société] S. Fisher Co. retouchèrent cette image pour donner aux yeux de Kafka la brillance désirée. Le Prophétique Kafka est maintenant une icône aussi célèbre et aussi vague que le Saint Che Guevara. – et avec à peu près autant d’exactitude historique. »
Hawes hait la photo lui aussi, mais pour d’autres raisons. Pour lui, c’est l’icône beaucoup trop appropriée de ce qu’il appelle « le Mythe K » (utilisant « mythe » comme un libéral bien-pensant, signifiant « énorme bobard »). Le « Mythe K » est :
« L’idée d’un mystérieux génie, un Nostradamus solitaire d’Europe centrale, qui, presque ignoré de ses contemporains, sonda d’une manière ou d’une autre les profondeurs de sa psyché mystérieuse et quasi-sainte pour prédire l’Holocauste et le Goulag. »
En réalité,
Kafka était intégré non seulement sur le plan littéraire mais sur le plan social aussi, c’était un fils de millionnaire, un bon fonctionnaire bien payé de l’empire des Habsbourg, un membre de l’élite allemande de Prague qui voulait consciemment – et subconsciemment – que l’Allemagne et l’Autriche gagnent la Première Guerre mondiale. Un Juif parlant allemand et pensant allemand qui ne prévit les horreurs de l’Holocauste pas plus que quiconque d’autre. Un auteur qui, lorsqu’il lut pour la première fois à ses amis Le Procès, provoqua chez eux un « rire inextinguible » [1].
Oui, Ils vous ont menti depuis le début ; depuis avant le début, car comme nous le verrons, Kafka lui-même participa avec empressement aux premières parties de la mise en scène de sa carrière littéraire, comme tout jeune écrivain, bien qu’il aurait lui-même été pris d’un « rire inextinguible » s’il avait vu la croissance monstrueuse du « Mythe K ».
Hawes consacre la majeure partie de son livre à déconstruire le « Mythe K » pièce par pièce. D’abord, ce baratin sur le pauvre Kafka, travaillant de longues heures dans son bureau de travail étouffant, vivant avec ses parents, s’esquivant quelques heures pour écrire ses chef d’œuvres tard dans la nuit – le vrai Flemmard du Millénaire. « En réalité, Kafka était … un jeune cadre des années 80 ; ressemblant plus à Gordon Gekko qu’à Quentin Tarantino. Loin d’être seul et pauvre, il vivait avec sa famille dans le confort de la classe moyenne supérieure… » [2].
En fait, même cela est au-dessous de la vérité ; le père de Kafka (qui, comme nous le verrons, passionne beaucoup les créateurs du mythe) était un millionnaire, possédant non seulement un appartement à partager avec Franz mais un immeuble d’habitation entier (ressemblant plus à Proust qu’à Gregor Samsa) ainsi qu’une usine d’amiante ne fonctionnant pas très bien paraît-il.
Les logements gratuits sont particulièrement lucratifs, puisque Kafka, titulaire d’un doctorat en droit, avait trouvé un poste en or à l’Institut d’Assurance des Accidents des Travailleurs, lui rapportant l’équivalent moderne de 90.000 dollars par an pour une journée de six heures, passant la plus grande partie de son temps à discuter de Heine avec son patron [3].
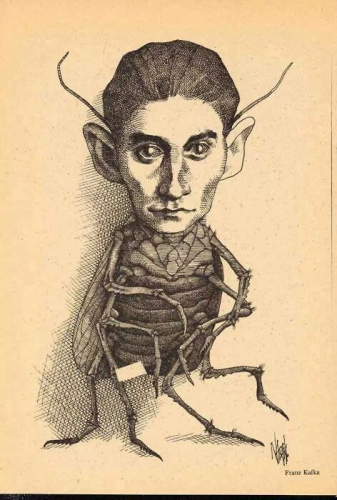 Kafka écrit seulement quelques heures par jour, surtout tard dans la nuit, mais seulement parce qu’il passe tout son temps libre, comme il le reconnaît joyeusement, dans les cafés et les bordels, et qu’il a du mal à s’en arracher. Bref, un jeune homme riche assez typique avec des ambitions littéraires, mais peu d’ambition ; vraiment pas un Genet gribouillant sur des sacs en papier en prison.
Kafka écrit seulement quelques heures par jour, surtout tard dans la nuit, mais seulement parce qu’il passe tout son temps libre, comme il le reconnaît joyeusement, dans les cafés et les bordels, et qu’il a du mal à s’en arracher. Bref, un jeune homme riche assez typique avec des ambitions littéraires, mais peu d’ambition ; vraiment pas un Genet gribouillant sur des sacs en papier en prison.
Maintenant, parlons de ses écrits. Tout ce temps passé avec les citadins fut sûrement utile. Avant de publier un seul mot, son copain Max Brod – « un réseauteur de littérature classique avec des doigts dans de nombreux gâteaux littéraires » – insère, dans une recension d’un auteur établi qu’il publie dans un important journal littéraire berlinois, l’observation que ce pote de Kafka semble être un grand styliste. L’auteur présenté, un certain Franz Blei, présente ensuite les premiers tout petits textes de Kafka, favorablement bien sûr ; plus tard, l’éditeur de Kafka organisera la publication hâtive d’une nouvelle en tant que chapitre indépendant d’un livre, afin de postuler – et de gagner – au prestigieux Prix Fontane (à peu près l’équivalent du National Book Award) – jugé, cette année-là, par Franz Blei.
Ce qui ne veut pas dire que l’ouvrage lui-même était indigne d’un tel jugement ; seulement que, en faisant ainsi patiemment rouler des rondins, comme le dirait une certaine tribu bien entraînée à cela, « ça aide à monter ».
Mais revenons à ce travail quotidien ; cela va fournir à Hawes quelques-unes de ses preuves les plus puissantes, ou du moins les plus controversées (et, comme Kafka, il connaît la valeur de la controverse sur le marché des paroles) concernant le « Mythe K ».
D’abord, bien que j’ai qualifié K de « jeune cadre » pour frapper le lecteur, en fait il ne partageait pas le même genre d’individualisme obstiné caractéristique du modèle de l’ère Reagan. Non, ce pote s’identifiait étroitement à ses camarades ethniques. Malheureusement pour le « Mythe K », ces camarades n’étaient pas les Juifs pauvres, opprimés et persécutés, mais l’élite germanophone de l’Empire des Habsbourg. Bref, Kafka était un patriote allemand.
Par exemple, Kafka investit une partie considérable de ses économies – souvenez-vous, même en comptant tous les kaffee mit schlag [cafés frappés] et les entraîneuses tchèques (l’équivalent praguois des « actrices-modèles » d’aujourd’hui), il gagnait 90.000 dollars par an, et ne payait pas de loyer – en Bons de Guerre autrichiens. C’est vrai, Kafka contribua à payer les baïonnettes sur lesquelles ces Huns empalaient paraît-il les bébés belges. Ils payaient à peu près 5% d’intérêts, garantis par l’Empire des Habsbourg, en faisant l’investissement le plus sûr du siècle. Ironiquement, cela se révéla être la chose la plus « kafkaïenne » qu’il fit jamais, un peu comme vendre les bijoux de famille en échange de monnaie confédérée, mais, comme dirait la tribu, qui le savait ? Et c’est le schlémil qui parvint soi-disant à prévoir l’Holocauste ?
Encore plus « accablant », cependant, fut son article du temps de guerre pour un appel en faveur d’un hôpital, destiné aux vétérans blessés germanophones – et seulement aux germanophones, aucune version ne fut imprimée pour la canaille tchèque ou yiddish. Je laisserai Hawes raconter l’histoire :
« Il y a eu d’innombrables tentatives pour présenter Kafka comme un crypto-socialiste, un ami des aspirations tchèques, et ainsi de suite. Le fait est que dans une proclamation publique de la fin de 1916 (pour réunir des fonds pour un hôpital exclusivement réservé aux soldats germanophones psychologiquement-choqués de l’armée multinationale de l’Empereur François-Joseph), Kafka parle explicitement en tant que « Camarade-de-peuple bohémien-allemand ». Sa pensée vis-à-vis de l’Empire des Habsbourg semble avoir été « non-politique ». Pas du tout dans un sens oppositionnel, simplement par conformisme avec la situation du moment. Comme Reiner Stach (que je fus très triste et très surpris de voir traîner mon livre dans la boue tout en reconnaissant ne pas l’avoir lu) dit des idées apparentes de Kafka sur la politique étrangère des Habsbourg : « l’aisance avec laquelle Kafka imitait le jargon officiel est déconcertant » [4].
Remarquons que Hawes tente d’insinuer que même François-Joseph (avec son armée « multinationale » anachronique) était plus en faveur de la « diversité » que le bourgeois Franz Kafka. « Déconcertant » pour la Tribu, peut-être, ou pour ceux qui « imitent » eux-mêmes la propagande de guerre britannique et la prennent pour de l’histoire [5].
Maintenant, si vous avez jeté un coup d’œil à mes notes de bas de page, vous avez remarqué les références à la « pornographie » et même à la « cachette porno de Kafka ». Oui, tout cela se ramène à une grosse bulle de scandale ; comme le dit un jour George Costanza, dans un moment plutôt kafkaïen, « La chose est comme un oignon : plus vous l’épluchez, plus ça pue ! » [6].
Car il apparaît que Kafka aimait dépenser une fraction de son salaire à s’abonner à un journal porno « artistique » assez cher. Et, comme le dit Hawes, tout en plaçant son livre ailleurs :
« …[L]’éditeur de ce porno en 1906 était le même homme qui, en 1908, devait justement devenir le premier éditeur de Kafka – et le même homme qui, en 1915, s’arrangerait pour que Kafka reçoive très publiquement les bénéfices du plus prestigieux prix littéraire allemand de l’année [7]. »
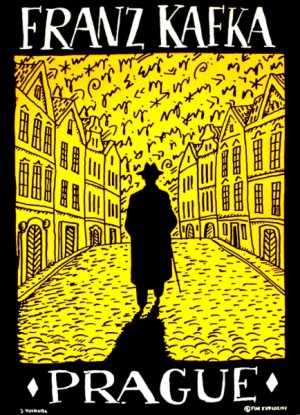 Même pour la Prague fin de siècle, le monde est vraiment petit !
Même pour la Prague fin de siècle, le monde est vraiment petit !
Quant au porno lui-même, Hawes tente d’en faire le plat principal, en quelque sorte ; mais s’il a raison de dire qu’en dépit des millions de livres, de thèses et d’articles sur Kafka, personne d’autre n’a jamais parlé de cela, c’est loin d’être aussi horriblement obscène qu’il l’affirme ; un peu comme les parties censurées des dessins de Beardsley [8]. Bien sûr, vous avez le droit d’avoir un avis différent [9].
Oui, un par un, Hawes brise tous les trépieds qui soutiennent le « Mythe K », jusqu’à ce que celui-ci, comme l’une de ces têtes de marionnettes géantes en papier mâché que les anarchistes utilisent lors de leurs manifestations, s’effondre sur le sol.
Ou plutôt, pour utiliser une métaphore plus littéraire, c’est comme un palimpseste, et après avoir enlevé la dernière couche de gribouillis, un classique perdu apparaît. Kafka, comme je l’ai insinué tout le long, le plus grand écrivain, certainement le plus grand écrivain européen du XXe siècle – est l’Un de Nous ! Un Blanc !
Mais vous ne devriez pas penser que Hawes est l’Un de Nous. Il hait le « vrai » Kafka, le jeune cadre riche, sexuellement actif et dépensier, et surtout le patriote allemand [10].
Il argumente contre le « Mythe K » parce qu’il pense que celui-ci déforme notre compréhension des écrits, nous distrait des textes eux-mêmes. Le mythe fait cela en créant un saint séculier maladif, d’un genre typiquement judaïque.
Nous aimons tous le mythe du grand génie méconnu romantique (pour des raisons douteuses sur lesquelles je vous laisse vous interroger, cher lecteur). Mais savoir qui Kafka était vraiment – et par conséquent celui qu’il n’était pas – est la seule manière pour que nous puissions toujours lire ses merveilleux écrits dans toute leur vraie gloire d’humour noir [11]. S’il faut un peu de thérapie de choc pour dissiper le mythe, alors qu’il en soit ainsi.
« Nous » ? Et quelles « raisons douteuses » sont derrière cela ?
Pour le combattre, il construit sa contre-figure supposément historiquement exacte, pas comme une nouvelle idole, mais pour nous dégoûter complètement de Kafka comme homme réel, individuel, ne nous laissant que ses ouvrages – les choses elles-mêmes, comme dirait Husserl, membre de la tribu contemporain de Kafka. En fait, on pourrait dire sans risque que Hawes méprise le « vrai » Kafka et veut le dissocier de l’Holocauste précisément parce qu’il est indigne d’être son saint patron [12].
Nous ayant supposément libérés du « Mythe K » qui déforme notre lecture des œuvres de Kafka elles-mêmes – il ne dirait pas, d’une manière typiquement judaïque – comme étant celles d’un exclu torturé et prophétique, Hawes, sous le prétexte de nous donner une lecture des « œuvres elles-mêmes » substitue simplement une nouvelle lecture, tout aussi judaïque bien que plus laïque, comme étant des œuvres d’« humour noir ».
Si le titre britannique d’origine, Excavating Kafka, reflète la première partie du programme, le titre américain ultérieur, Read Kafka Before You Ruin Your Life [Lisez Kafka avant de ruiner votre vie] (clairement destiné à exploiter le succès de textes culturels DIY [= Do It Yourself] comme celui d’Alain de Botton, How Proust Can Change Your Life), reflète la seconde partie plus insidieuse du programme : Kafka comme le prophète, non de l’Holocauste, mais du postmodernisme. Comme il le dit clairement à un autre endroit :
« Ce qui obsède Kafka, c’est notre aptitude suicidaire à croire les grands récits de rédemption et de certitude absolue, aussi délabrés et visiblement corrompus qu’ils puissent être. L’élément vital dans ses œuvres, qui est obscurci par le ‘Mythe K’, c’est que ses héros sont absolument complices de leur propre ‘piégeage’. Ce ne sont pas des histoires de gens innocents soudainement dévorés par des erreurs de la justice cosmique. De toutes les racines philosophiques de la pensée de Kafka, la plus importante est à mon avis le fameux et terrifiant aperçu de Nietzsche concernant le ‘nihilisme’ de l’homme moderne post-religieux (ma traduction est forcément libre) : ‘l’humanité préférerait désirer le néant plutôt que n’avoir rien à désirer’. Cette analyse nietzschéenne de la raison pour laquelle les modernes font ce qu’ils font pourrait bien s’appliquer aux tueurs du 11 Septembre tout comme aux tortionnaires au regard fixe, lubrique et vide d’Abou-Ghraïb. » [13]
Remarquez l’usage habile du trope porno pour « nous » attirer vers Kafka et les extrémistes musulmans – équivalence morale, comme diraient les néocons [= néoconservateurs]. Nous sommes tous – sauf Hawes et ses cohortes académiques vaguement marxistes – des zombies sous l’emprise des « grands récits », etc.
Et pourquoi lire Kafka aujourd’hui ? Parce que son analyse de la manière dont nous sommes si fatalement, suicidairement tentés par des visions d’un passé de l’âge d’or avec toutes ses supposées certitudes et sécurités, est aujourd’hui plus nécessaire que jamais. Ses œuvres sont un grand avertissement contre la tentation de croire aux grandes illusions, une grande exigence que si nous voulons vraiment vivre, nous devons grandir et regarder la vie dans les yeux [14].
Bien sûr, on pourrait suggérer que ce sont les pourvoyeurs de ce cliché postmoderne en quelque sorte simultanément béat et défraîchi qui ont besoin de « grandir » ou du moins de dépasser les années 60. Cependant, comme le montre la référence à Nietzsche, il y a du vrai là-dedans. Mais si nous voulons assimiler Kafka à Nietzsche et le considérer comme un « bon Européen », nous devons prendre notre Nietzsche comme le faisait le baron Evola ; utile comme dissolvant du libéralisme bourgeois, mais inutile – en fait, empoisonné – lorsqu’on le prend comme guide pour l’avenir [15].
Et parlant des postmodernistes académiques, les spécialistes « orthodoxes » de Kafka eurent une réaction rapide et prévisible ; oui, Max Brod était un créateur de mythes, mais nous le savions depuis des années, bla-bla-bla. Hawes, lui-même assez bon spécialiste de Kafka, pouvait avoir ses raisons de titiller les experts. Il a peut-être simplement choisi la mauvaise cible ; il se peut que « Walter Benjamin a explosé le mythe Kafka dans les années 30 » dans un morceau assez illisible de fange européenne (après tout, si Kafka n’était pas le plus grand génie judaïque, alors c’est Benjamin qui l’était, pas vrai ?), et après ? Si Kafka, comme Dickens et Orwell, est l’un des rares écrivains à avoir son propre adjectif, et nous savons tous ce que « kafkaïen » veut dire ; voilà la vraie cible de Hawes.
La réponse la plus stupide mais la plus symptomatique est peut-être celle du membre de la tribu Sander Gilman, sans doute agacé que Hawes néglige de mentionner sa propre biographie, modestement intitulée Kafka [16]. Gilman (apparenté à Lovecraft ?) trouble les eaux avec un boniment judaïque assez typique, passé en fraude par l’intermédiaire de Stanley Fish, en disant que « tous les biographes mentent », et ainsi, modestement, craintivement et poliment, il ne peut pas vraiment se plaindre que Hawes voit Kafka comme un type régulier, plutôt que comme un type « spécial » (c’est-à-dire un génie juif juivement obsédé par sa juivitude juive). Mais ce serait sûrement bon pour les Juifs si Hawes s’occupait d’autre chose :
« Hawes présente [Kafka] sous un faux jour – mais là encore, comme le pense Fish, c’est ce que font tous les biographes. On pourrait affirmer, par exemple, que j’avais besoin de Kafka pour être malade et anxieux et créatif afin d’étayer ma lecture de la situation des Juifs européens au tournant du siècle [Non ! Qui pourrait douter de toi, mon garçon ?]. Mais la majeure différence entre cet écrivain et James Hawes est que si nous avons tous des histoires que nous disons sur les vies que nous écrivons, certains d’entre nous sont plus concernés par les nuances des recherches que nous faisons et du monde que nous tentons de décrire [ce qui veut dire : est-ce bon pour les Juifs ?]. En fin de compte, cependant, c’est la capacité de ces mensonges à être crus par la plus grande communauté qui définit le bon biographe. Nous verrons si le temps sera bienveillant envers le comique gallois de Hawes [Gilman, en bon membre de la tribu, trouve drôle que Hawes enseigne au Pays de Galles], l’intellectuel littéraire Franz Kafka.
Oh, hou, hou. Si tous les biographes mentent, alors pourquoi devrais-je croire à vos mensonges ? Je dis : baratin, baratin complet ! Assez de toutes ces foutaises judaïques ! Gilman a raison ; les « nuances » dans le portrait de Kafka par Hawes sont préoccupantes – elles encouragent les goyim, bien que cela serait sûrement la « plus grande communauté » de toutes, pourrait-on dire. Voyons le véritable Kafka, Kafka tel qu’il était, Kafka tel qu’il se voyait lui-même, Kafka tel qu’il voulait être vu, quelle que soit la manière de le dire : un fier membre de la tradition littéraire et culturelle allemande.
Kafka : notre camarade-de-peuple !
Notes
- James Hawes, “Tumbling the author myth: Why such anger about my revelations of Kafka’s interest in pornography? His legacy could stand a little debunking” [« Renverser le mythe de l’écrivain : pourquoi une telle colère concernant mes révélations sur l’intérêt de Kafka pour la pornographie ? Son héritage pourrait supporter un peu de démythification »], The Guardian, Friday, August 29, 2008, ici [8].
- Louis Bayard, “How Kafka-esque is Kafka? The Czech writer has become the prophet of our absurd era, but a new book intends to strip the author of his saintly reputation” [“A quell point Kafka est-il kafkaïen ? L’écrivain tchèque est devenu le prophète de notre ère absurde, mais un nouveau livre entreprend de dépouiller l’auteur de sa réputation de sainteté », Salon, Friday, August 1, 2008, ici [9].
- Apparemment une occupation typiquement allemande, partagée par Dietrich Eckart ; voir ma recension de Hitler’s Mentor, ici [10].
- Scott Horton, “In Pursuit of Kafka’s Porn Cache: Six questions for James Hawes” [« A la recherche de la cachette porno de Kafka : six questions pour James Hawes »], par Harper’s, August 19, 2008, ici [11].
- Voir encore ma recension d’Eckart dans la note 3 ci-dessus.
- Seinfeld, Episode no. 136 “The Soul Mate” (Original air date 26 Sept 1996), here [12].
- “The Kafka Myth” here [13].
- En parlant de cela, le livre de Mark Anderson Kafka’s Clothes [14] [Les vêtements de Kafka] a un but similaire, mais en se limitant à révéler Kafka le Dandy, presque un métrosexuel.
- M’étant déjà moqué de l’« expression ouvertement sexuelle » d’Houellebecq (“The Sexual Anti-Utopia of Michel Houellebecq,” ici [15]), je ne suis peut-être pas la bonne personne à qui adresser cet appel.
- On a le sentiment, par-dessus le roulement de rondins, que Hawes souhaiterait que Kafka n’ait simplement pas écrit en allemand et que, comme les prisonniers supposément résignés d’Auschwitz, il soit entré volontairement dans le ghetto de la littérature tchèque. Ou peut-être yiddish – il cultivait un goût pour le théâtre yiddish – ou même, ose-t-on espérer, hébraïque – atténuant à l’avance ce fait ennuyeux que l’Etat Juif super-talentueux n’a jamais produit un seul écrivain – ni un seul artiste – d’une certaine distinction. Peut-être que Veblen avait raison, et que le Juif ne prospère que dans l’adversité ? Voir mon article “The Eternal Outsider: Veblen on The Gentleman and the Jew” [« L’Eternel Outsider : Veblen sur Le Gentleman et le Juif »] ici [16] et dans The Eldritch Evola.
- « Aucune autre œuvre d’auteur ne souffre de ce genre de préjugé », Oh ? Il y en a des douzaines qui me viennent à l’esprit : Hitler, Goebbels, Rosenberg . . .
- Hawes est un tel croyant de l’Eglise de l’Holochristianisme qu’il absout en fait l’Armée Rouge de « toutes les choses dont elle pourrait être coupable » en reconnaissance de sa « libération » des « camps de la mort ». Des millions de civils allemands et slaves « libérés » morts et vivants bien que brutalisés pourraient avoir un avis différent, mais je suppose que c’est un signe de progrès qu’il reconnaisse simplement « toutes les choses ».
- « A la recherche de la cachette porno de Kafka », note 4 ci-dessus.
- Ibid.
- Voir en particulier Ride the Tiger: A Survival Manual for the Aristocrats of the Soul [Chevaucher le tigre : un manuel de survie pour les aristocrates de l’âme] (Inner Traditions, 2001), spécialement la Partie 2 : « Dans le monde où Dieu est mort ». Il est intéressant qu’Evola reconnaît dans son autobiographie que deux de ses guides d’adolescence furent Nietzsche et Oscar Wilde, le second suggérant une connexion avec Kafka par sa cachette porno à la Beardsley ; voir The Path of Cinnabar [Le chemin du Cinabre] (Arktos, 2009), p. 8. Evola nomme aussi Otto Weininger, qui influença aussi grandement Kafka.
- Sander L. Gilman, “Everyman’s Kafka,” Azure: Ideas for the Jewish Nation, no. 35, Winter 5769/2009, here [17].
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2014/10/kafka-notre-camarade-de-peuple/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/07/Franz_Kafka_joven.jpg
[2] here: http://www.counter-currents.com/2014/07/kafka-our-folk-comrade/
[3] Excavating Kafka: http://www.amazon.com/gp/product/184916164X/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=184916164X&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=ISQOBNDP4GUMJIFS
[4] Why You Should Read Kafka Before You Waste Your Life: http://www.amazon.com/gp/product/B003156CO4/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B003156CO4&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=JFVYYOWFXDXKMGVW
[5] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/07/kafka1.jpg
[6] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/07/why-you-should-read-kafka.jpg
[7] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/07/jameshawes.jpg
[8] ici: http://www.theguardian.com/commentisfree/2008/aug/29/franzkafka.civilliberties
[9] ici: http://www.salon.com/2008/08/01/kafka/
[10] ici: http://www.counter-currents.com/2014/05/hitlers-mentor/
[11] ici: http://harpers.org/blog/2008/08/in-pursuit-of-kafkas-porn-cache-six-questions-for-james-hawes/
[12] here: http://www.seinfeldscripts.com/TheSoulMate.html
[13] here: http://www.readysteadybook.com/Article.aspx?page=kafkamyth
[14] Kafka’s Clothes: http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/LiteratureEnglish/WorldLiterature/Germany/?view=usa&ci=9780198159070
[15] ici: http://www.counter-currents.com/2014/06/michel-houellebecqs-sexual-anti-utopia/
[16] ici: http://www.counter-currents.com/2012/10/the-eternal-outsider-veblen-on-the-gentleman-and-the-jew/
[17] here: http://azure.org.il/include/print.php?id=487
00:05 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, livre, littérature, lettres, lettres allemandes, prague, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 20 novembre 2014
The Lovecraftian Fiction of Don Webb

Knowing All the Angles:
The Lovecraftian Fiction of Don Webb
By James J. O'Meara
Ex: http://www.counter-currents.com
Don Webb
Through Dark Angles: Works Inspired by H. P. Lovecraft [2]
New York: Hippocampus Press, 2014
“A firm rule must be imposed upon our nation before it destroys itself. The United States needs some theology and geometry, some taste and decency. I suspect that we are teetering on the edge of the abyss.” — John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces
“I don’t know if I am delivering cows to the slaughterhouse door or helping beautiful butterflies out of their cocoon. . . . I made simple diagrams showing all the angles. Humans picked up where they had stopped four thousand years ago.” — Don Webb, “The Megalith Plague”
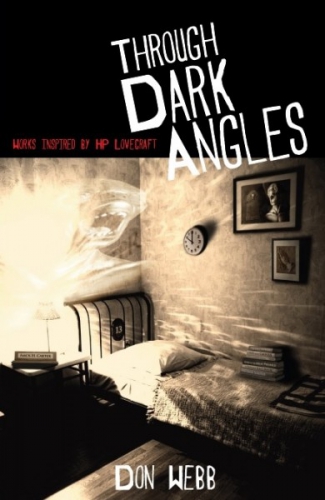 Don Webb has been writing short stories, and the occasional novel, since, as a rather indifferent undergraduate at Texas Tech, he took a supposedly easy-A class in “The Science Fiction Short Story” and discovered that unlike his fellow slackers, he’d rather take the write a story option than the term paper. The story itself was equally indifferent, but by then the hook was in, a writer born.
Don Webb has been writing short stories, and the occasional novel, since, as a rather indifferent undergraduate at Texas Tech, he took a supposedly easy-A class in “The Science Fiction Short Story” and discovered that unlike his fellow slackers, he’d rather take the write a story option than the term paper. The story itself was equally indifferent, but by then the hook was in, a writer born.
Earlier still, as a mere sprout growing up in Texas, Webb had discovered the chilly pleasures of weird fiction, and H. P. Lovecraft in particular. So, like so many others, it was natural that he should turn his hand to tales inspired by Lovecraft and his mythos. He’s now a professor of writing at the University of Texas, and this collection brings together about thirty years’ worth of his homages to the eldritch Master, each one also dedicated to another weird writer.
Now, before you saddle up and hit the trail, heading out the other direction, expecting the literary equivalent of a Star Trek convention,[1] well, just hold your horses, pardner[2] — you should know right away that these are no ordinary, all too ordinary, works of Lovecraft pastiche.
Apart from literary polish, what sets these tales apart from others and links them all together — or manifests itself within them — is Webb’s particular take on Lovecraft and the occult in general.
Reflecting perhaps his day job as an English professor, Webb distinguishes the tragic approach to Lovecraft — epitomized by such “miserablists” as Thomas Ligotti — and the comedic (as in the Divine Comedy) — well represented by August Derleth. For the one, knowledge brings disaster and, well, misery; for the other, the officially sanctioned dogmas of revealed religion assure us that all will be set right eventually.
Webb then announces a third approach, his own — the Epic. Lovecraft characters such as Randolph Carter or Joseph Curwen “rebel[s] against cosmic injustice,” and
Brave souls [who] seek to gain entrance into a heightened realm of perception and will do so by embracing the darkness — not the darkness of Sunday school “evil” but the darkness of the unknown.
For every hundred readers thinking how dreadful it would be to have one’s brains removed by the Fungi or one’s psyche trans-temporally transposed by the Great Race, there is one who secretly wishes for it to happen.
With these bold words Webb aligns himself with those Lovecraftians who affirm that whatever the old boy thought, Wisdom is Good.[3]
For example, in “Calling Cthulhu [3],”[4] esoteric journalist Erik Davis described the then-nascent cult of pop-Cthulhu, and noted that Lovecraft’s “dread” and “horror” seemed to belong to a 19th-century materialist confronting vast new vistas opened up by science, not unlike those opened by the ’60s drug culture, as he describes it in a later article on Cthulhu porn:
In this tangy bon-bon of nihilistic materialism, Lovecraft anticipates a peculiarly modern experience of dread, one conjured not by irrational fears of the dark but rather by the speculative realism of reason itself, staring into the cosmic void. . . . This terror before the empty and ultimately unknowable universe of scientific materialism is what gives the cosmic edge to the cosmic horror that Lovecraft, more than any other writer, injected into the modern imagination (though props must be given up as well to Arthur Machen, William Hope Hodgson, and, in the closing chapters of The Time Machine at least, H. G. Wells). While many secular people proclaim an almost childlike wonder at the mind-melting prospect of the incomprehensibly vast universe sketched out by astrophysics and bodied forth by doctored Hubble shots, Lovecraft would say that we have not really swallowed the implication of this inhuman immensity—that we have not, in other words, correlated our contents.[5]
As Webb says,
I write to create wonder, which can be ecstasy and fear or simple alienation. I write thus to heal my Gnostic soul, the alien man trapped in this world. Fortunately some others share my needs and have bought this little book. I hope I can abduct them from the workaday world into a place of weird realism.[6] I hope you won’t be quite the same when you return to your “real” life. Hail to the Ancient Dreams!
As words like ‘Gnostic’ and ‘epic’ clue us in, this is the Heroic or Dry Path of the Hermetic, or Magical, Tradition, as discussed by Baron Evola.[7] In these traditions, the pursuit of Knowledge is not a sinful urge subject to dreadful punishment, as in the Abrahamic religions Lovecraft, atheist that he is, is still influenced by,[8] but rather the essence of the Path itself.[9]
And so Webb himself is not only a teacher of writing but also a high priest of the Temple of Set, and a student of the great theorist of the Left Hand Path, Dr. Stephen A. Flowers (another Texan!).[10] His weird tales are kinda like “The Dunwich Horror” written from Wilbur’s point of view.[11]
The nature of that wisdom is also of interest. An adolescent reading of Derleth’s anthology Tales of the Cthulhu Mythos (my own first exposure to Lovecraftiana) acquainted him with
[T]he Bloch-Lovecraft sequence [of tales; i.e., Bloch‘s “The Shambler from the Stars” and Lovecraft’s response] that forever caught my mind with the Shining Trapezohedron. A gateway to “other spaces” — possibly one of the most effective symbols of cosmicism for itself. This image haunts both my fiction and my esoteric pursuits [my emphasis].
And so Webb eventually became a Knight of the Order of the Trapezoid, initiated by Dr. Stephen Flowers.
Now, the notion of the Secret being mathematics is certainly a notion Lovecraft uses as a prop in stories like “The Shambler from the Stars” and eminently in “The Dreams in the Witch House” (which features the bizarre notion of “non-Euclidean calculus”[12]. However, serious use of mathematics as a symbol, and even a method of enlightenment, goes back at least to Plato, up through Leibniz,[13] and most recently has been promoted by the endless stream of pseudepigraphical kindles from the so-called “Illuminati Conspiracy.”[14]
And it maps easily, I think, onto the Traditional metaphysics, the path of jnana, as outlined by René Guénon.[15]
So the picture that emerges is that both Webb’s take on Lovecraft, and his view of reality, are one, neither cosmic despair (Lovecraft, Ligotti, or Dawkins[16] nor blind Abrahamic “faith” (Derleth and millions of others) but optimistic enlightenment through mathematics (Guénon, The Illuminati Conspiracy, Webb).[17]
But make no mistake; these are well-written tales, not agitprop for the Illuminati; and they are delicious horror tales, with the protagonists usually meeting unfortunate ends:
Detective Sergeant Blick materialized almost a thousand feet above L.A. — “Looking Glass”
Or at the very least, they emerge with a new and uncomfortable awareness of once pleasant, ordinary things:
But I can’t quite believe in home any more. I wonder what Their thoughts are like, and some nights I wonder so long and hard that I think I might start to know.” — “Doc Corman’s Haunted Palace One Fourth of July”
I won‘t go through all 25 or so tales here, but rather suggest that you go out and buy the book and enjoy yourself; besides, there’s always the tricky thing about not revealing too much about stories that often depend on a gruesome surprise if not an outright “trick“ ending. But I will note some of my favorite tales here.
“Lovecraft’s Pillow” is perhaps intended as a bit of self-mockery, lest the author become too big for his britches. A hack horror writer (“What do you do when you have ideas for four novels and are writing your ninth?”) buys what purports to be Lovecraft’s pillow, half expecting to tap into the old boy’s dreams, but the actual transformation is very different and more substantial.
“From Mars to Providence” starts off as a Wells/Lovecraft mashup, but slowly become perhaps the best Lovecraft pastiche I’ve read — almost every line is a Lovecraft phrase, title or allusion, yet the narrative proceeds quite naturally to a twist ending that, in retrospect, is only what the title plainly promised.[18]
“The Codices” is a story I should have written at some point, taking off from the interesting fact that R. H. Barlow, one of Lovecraft’s youthful correspondents, is likely to have met William S. Burroughs when Barlow was teaching anthropology at Mexico City College while Burroughs was there studying the Mayan Codices.
Barlow couldn’t help but think about Burroughs’s ideas [“you orient yourself toward the future . . . by looking backward to . . . a time before death“] as reflecting the sort of thing that Lovecraft had written about.[19]
Alas, a private seminar with Burroughs and two of his “young, beautiful wild boys” does not end as pleasantly as they had anticipated.
Inevitably, not everything quite works. “Powers of Air and Darkness” is a sort of steam punk version of Lovecraft (itself a popular genre of Lovecraftianism these days) that despite some interesting ideas — using elements of Charles Fort (“It‘s all stockyards”), ancient astronauts and Operation Paperclip to re-vision Lovecraft’s horror of “progress” as the great parade of fin de siècle technology (“the difference engine, the X-ray, pneumatic limbs, dirigibles” etc.) being a plot by the “fungal fliers” of Pluto (see “The Whisperer in Darkness”) to exterminate mankind for their masters, the Elder Gods — is just too long and rather dull, somewhat like the Edwardian spooky tales it emulates.
But the repeated line about stockyards does tie up nicely with the next and final tale, “Casting Call” (“waiting with the other cattle,” itself an allusion to Hitchcock’s “treat them like cattle”), as well as the second tale, “The Megalith Plague,” as already quoted at the top.
In fact, there’s a nice bit linking up all the tales, as well as linking up Webb’s fiction and philosophy: just about every tale mentions angles; for while there are
. . . right angles that turn thinking into sleeping.
there are also:
Certain shapes — trapezoids in particular — obtuse angles that have a deleterious effect on mankind.
Indeed, like the narrator of zombie apocalypse “Sanctuary,”
“I guess I should have paid more attention in Mrs. Gamble’s geometry class.”
Back in “The Eldritch Evola,” I suggested that if Evola’s metaphysics sometimes sounds like Lovecraft, then rather than disparage Evola’s metaphysics we should take Lovecraft’s “fictions” more seriously. Don Webb is that rare bird, equally adept in hermetics and weird fiction, and this collection is recommended to anyone who isn’t afraid of either one.
Notes
1. Not that there’s anything wrong with that; see “Klingon Like Me” in Nomad Codes: Adventures in Modern Esoterica by Erik Davis (Verse Chorus Press, 2011).
2. You see, many stories take place in Texas, and, well . . . actually, no one talks that way, thank Yog Sothog. Webb’s Texas Arkham, Doublesign (as in “a town so small the “Welcome” and “Leaving” signs are on the same pole“) is full of colorful detail but none of the painful dialect attempts writers of Lovecraft’s generation indulged in. Texas is actually a pretty appropriate place for weird fiction, being, after all, the home of Lovecraft’s friend and fellow Weird Tales titan. Conan creator Robert E. Howard. Webb points out elsewhere that Texans love eccentrics and storytellers; I suspect that if Lovecraft had ever visited Howard, they would have taken to the oddball New Englander like the Colorado silver miners took to Oscar Wilde (see my “Wild Boys and Hard Men” in The Homo and the Negro [San Francisco: Counter Currents, 2012]). “Remember, Texas invented Buckminsterfullerene, which is the Texas state molecule, and Deep Fried Butter. It is hard NOT to write Weird fiction here.” — “Interview with author Don Webb” in Cthulhu Mythos Writers Sampler 2013 (s. l.).
3. To be distinguished from “Knowledge is Good,” the motto of Animal House’s Faber College.
4. “Calling Cthulhu: H. P. Lovecraft’s Magical Realism” in op. cit.
5. Erik Davis, “Cthulhu is not cute [4]!” Davis references the Cthulhu plushies, which turn up again in Webb’s tale “Plush Cthulhu.”
6. Referring, I assume to Graham Harman’s Weird Realism; see my review, “Lovecraft as a Heideggerian Event” here [5] and reprinted in The Eldritch Evola … & Others (San Francisco: Counter Currents, 2014).
7. In many places, but especially in The Hermetic Tradition (Inner Traditions, 1994) and Introduction to Magic (Inner Traditions, 2001).
8. For example, the original Faust tale, as opposed to Goethe’s Gnostic reworking. Webb’s tales allude to Faust a couple of times: the heroine of “Emily‘s Rose Window” muses “Dark knowledge and gold and women — who would have thought that Faust lived in the late twentieth century in Kingsport?” while a Mexican immigrant hopes to jump start his career by stealing a magical book from Forest Ackerman, thinking “All good Americans want Faust’s deal.”
9. Many have pointed out that the Dunwich tale is Lovecraft having some blasphemous fun parodying the Christ myth, but as always with blasphemy, the kick comes from the residual belief, as in the Black Mass. As I suggested in my essay “The Eldritch Evola” — here and reprinted in The Eldritch Evola … & Others — Lovecraft’s idea that our minds would be “blasted” if we ever dared to “correlate their contents” is “spooky” only on the assumption that our egoic mind is all we are; but what if the death of the ego is the birth of a new, higher consciousness, as the Hermetic or Heroic Tradition would have it?
10. His non-fiction books include Uncle Setnakt’s Guide to the Left Hand Path and The Seven Faces of Darkness.
11. In fact, Webb intersperses some of the first tales reprinted here with some blank verse poetry written by Wilbur, Lavinia, and other Dunwich characters, giving them the chance to tell their side of thing.
12. See Leslie Klinger’s discussion of what one scholar calls “Lovecraft’s pseudomathematics” in note 3 to the tale as printed in his New Annotated H. P. Lovecraft (New York: Liveright, 2014).
13. In the steam punk tale “Powers of Air and Darkness” the “difference engine” is an alien-inspired tool to fool mankind into thinking in 1/0, yes/no dualities, but this is itself a Gnostic idea that relies on the notion of a higher, salvific mathematics.
14. See it all laid out most conveniently — and free! — on their website, Armageddon conspiracy.co.uk; among their kindles, the best place to start seem The God Game (The God Series, Book 1) by one Mike Hockney. [6]
15. In such works as Man and His Becoming According to the Vedanta, Introduction to the Study of Hindu Doctrine, and above all, The Symbolism of the Cross. Guénon himself, of course, was trained as a mathematician, wrote books on calculus, and was disparaged by the more Abrahamic Traditionalists as being “an eye without a heart.”
16. Just as Evola make a three-part distinction between ordinary conscious experience, the picture unfolded by empirical science, and the higher-states of mind evoked by the Hermetic or Magical Path (see “The Nature of Initiatic Knowledge” in Introduction to Magic), so the illuminati distinguish their higher path of mathematics from both Abrahamic faith and Dawkins’ bumptious, veddy British empiricist dogma; see Richard Dawkins: The Pope of Unreason (The God Series, Book 16) by Mike Hockney.
17. “When we let the world become predictable we die a little, we become more of a machine. Conventional religion with easy explanations has the same effect as science — it removes that uncertainty that is the basis (the space if you will) that consciousness needs.” — “Author of the Week: Don Webb,” Lovecraft e-Zine, Sept. 28, 2014, here [7].
18. Those who responded with fear and loathing to my suggestion that the music of Wagner, however “beautiful” or “racially uplifting” is — judged by what might be called higher mathematical standards (metaphysics, music and mathematics being interchangeable) — spiritually enervating, might consider the Martian decadence described in this story as “the objective art of the past [such as the “mathematically perfect music of the Martians”] was increasingly replaced by an outrageous subjectivity.” Or, when reading “Emily’s Rose Window,” reflect on the trans-dimensional aliens who use the transmitted and magnified images of “beautiful” human women to torture captured enemies with their worst nightmares. The latter is also a bit of homage to Rod Serling, which also crops up when a character in “The Megalith Plague” imagines waking up in a hospital bed à la Twilight Zone‘s “Eye of the Beholder,” and become explicit in the last tale, “Casting Call,” a homage to Night Gallery.
19. Just as I have suggested that if Evola sounds like Lovecraft, we should therefore pay more attention to Lovecraft than less attention to Evola; see “The Eldritch Evola” here [8] and reprinted in The Eldritch Evola … & Others (Counter-Currents, 2014).
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2014/11/knowing-all-the-angles-the-lovecraftian-fiction-of-don-webb/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/11/donwebb.jpg
[2] Through Dark Angles: Works Inspired by H. P. Lovecraft: http://www.amazon.com/gp/product/1614980845/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=1614980845&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=ZNRUM2ICD7ZENGFP
[3] Calling Cthulhu: http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.techgnosis.com%2Fchunkshow-single.php%3Fchunk%3Dchunkfrom-2005-12-13-1057-0.txt&rct=j&q=erik%20davis%20cthulhu&ei=tvM5TdH7CsWblgeT643rBQ&usg=AFQjCNEN0cnIB67UuXUWCVPt9ODqzLI6Jg&cad=rja
[4] Cthulhu is not cute: http://techgnosis.com/chunkshow-single.php?chunk=chunkfrom-2010-05-03-1521-0.txt
[5] here: http://www.counter-currents.com/2013/02/lovecraft-as-heideggerian-event/
[6] Mike Hockney.: http://www.amazon.com/Mike-Hockney/e/B004KHR7DC/ref=ntt_athr_dp_pel_1
[7] here: http://lovecraftzine.com/2014/09/28/lovecraftian-weird-fiction-author-of-the-week-don-webb/
[8] here: http://www.counter-currents.com/2011/01/the-eldritch-evola/
00:05 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lovecraft, don webb, livre, littérature, lettres, lettres américaines, littérature américaine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le nouvel Adinolfi!
00:01 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gabriele adinolfi, livre, années de plomb, italie, nationalisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 18 novembre 2014
On Francis Fukuyama’s The Origins of Political Order
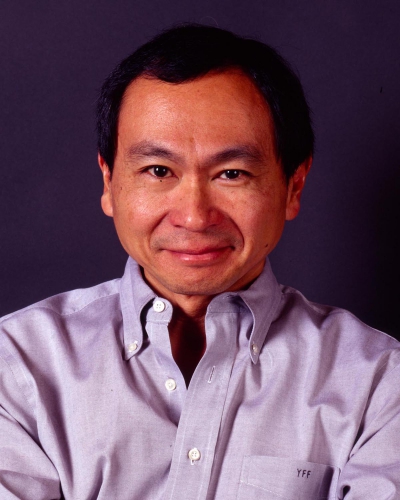
Cohesive Societies Check State Power:
On Francis Fukuyama’s The Origins of Political Order
By Jack Donovan
Ex: http://www.counter-currents.com
The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution [2]
New York: Farrar, Straus and Giroux, 2012
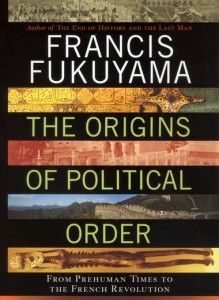 There’s so much meat in Francis Fukuyama’s The Origins of Political Order that someone could teach a college class on it, and someone should. It’s an expansive study of different political systems that attempts to develop a general theory of political development, and explain why different societies have formed different kinds of states — or none at all. The author also offers some explanations for why state-building efforts in the developing world have produced mixed results.
There’s so much meat in Francis Fukuyama’s The Origins of Political Order that someone could teach a college class on it, and someone should. It’s an expansive study of different political systems that attempts to develop a general theory of political development, and explain why different societies have formed different kinds of states — or none at all. The author also offers some explanations for why state-building efforts in the developing world have produced mixed results.
Fukuyama intended The Origins of Political Order to build on his mentor Samuel Huntington’s Political Order in Changing Societies, but it would be just as comfortable on a shelf beside Spengler’s Decline of the West or something like Toynbee’s A Study of History. It’s engagingly written and lacks the kind of obsessive moralizing or contemporary political obsessions that would make it tedious. Fukuyama does have the academic’s habit of giving us more than we need — probably to ward off academic critics. The Origins of Political Order has also been recently followed by second volume, Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy [3].
While clearly an advocate of modern liberal democracies — or what people call modern liberal democracies — Fukuyama is no chauvinist in this regard and does not present political development as a linear, inevitable path to the revelation of modern, liberal democracy. Rather, he sees modern political systems as having three main features — state formation, rule of law, and accountability — that may or may not be present in many reasonably successful political orders. He argues repeatedly that while China formed the first true state, the Chinese have never had true rule of law or downward accountability.
Fukuyama begins by looking at pre-state societies and addressing what he calls the “Hobbesian fallacy” — something I also touched on in The Way of Men. Humans have always lived in groups. We were not “primordially individualistic” creatures who evolved alone in a brutish world and then entered into society as the result of rational calculation at some later date — trading freedom for safety. We’ve always been social animals, and our pre-human ancestors were, too. Yet this idea of primordial individualism “underpins the understanding of rights contained in the American Declaration of Independence and thus of the democratic political community that springs from it.” To truly understand human political behavior, it’s important to correct mistaken notions about human nature and how the most basic political orders form.
The most basic human society, according to Fukuyama, is the “band.” A band society is a small collection of nuclear families, typically exogamous and patrilocal, meaning that, as with chimpanzees, females tend to marry outside the band and males tend to remain with their fathers, brothers, and cousins. This band — or perhaps, “gang” — is the default social order for humans, and the exogamous arrangement with women increases genetic diversity, encourages intergroup contact and trade, and even allows groups of men to resolve intergroup conflicts by simply trading women.
Band-level societies are also fairly egalitarian, and do a lot of sharing. Fukuyama adds that, “many of the moral rules in this type of society are not directed at individuals who steal each other’s property but rather against those who refuse to share food or other necessities.”
Leadership in this kind of society is not inherited — it is earned both through a combination of demonstrating strength, earning trust, and building a coalition of supporters. You can strong-arm a small group for a while, but sooner or later, someone’s gonna cut you down. A betrayal of trust or a stronger contender can elevate a new “alpha,” or “big man,” so decision-making in a band-level society tends to be consensus-based.
The natural tendency to return to band-level thinking is the basis for the phenomenon Fukuyama calls “patrimonialism,” defined as the preference for one’s kin or “friends.” The human tendency toward patrimonialism is fundamental to Fukuyama’s theory of political order, because he pits it against the kinds of systems that are purely meritocratic or impersonal, as modern states say they attempt to be. In a patrimonial society, “we” are more equal than “them,” and this results in the accumulation of wealth and power into fewer hands, as well as all sorts of favoritism and unearned privileges. In a modern state that is functioning more or less as it’s supposed to, everyone has to play by the same rules.
The majority of The Origins of Political Order is devoted to exploring the complicated ways in which elements of modern states developed to check patrimonialism, and how those checks can decay as circumstances change. As I mentioned, he covers a lot of ground — too much to cover here — so I’ll simply recommend the book and focus on a relevant point.
Fukuyama doesn’t say it in so many words, but modern, socially constructed identity groups seem able to replace kin-based groups in terms of inspiring this kind of favoritism. A member of the “party” or “union” or “community” is preferred over a pure outsider. Ideology has many features of religion, and religion is one of the factors that Fukuyama believes separates the tribal society from the band-level society. Religion and ideology create a broader understanding of family — of who is “us” and who is “them.”
In the final pages of The Origins of Political Order, Fukuyama concludes that the doctrine of universal recognition makes liberal democracies attractive because it is a throwback to the shared participation and shared decision-making common to early tribal and band-level societies. “Once the principle of equal respect or dignity is articulated,” he writes, “it is hard to prevent human beings from demanding it for themselves.”
However, he follows this evident truth by stating that, “successful liberal democracy requires both a state that is strong, unified, and able to enforce laws on its own territory, and a society that is strong and cohesive and able to impose accountability on the state.” This also seems reasonably true, but the idea of a “cohesive” society conflicts with the “diversity is strength” mantras of First World governments, global corporations, and globalist organizations like the United Nations. The cohesive societies with shared backgrounds, religious beliefs, and values that created liberal democracies have in recent history been consistently undermined by attempts by elites to import and integrate foreign groups and ideologies into their states — Muslims in Europe being a particularly corrosive example.
The promise of “intratribal” egalitarianism to everyone everywhere, and anyone anywhere, has in practice created opportunities for the development of what Fukuyama would have to characterize as the kinds of interest groups that engage in zero-sum rent-seeking.
In America, the triumph of this doctrine of absolute inclusiveness has created a social environment in which identity groups actually end up vilifying any kind of overall cohesiveness, homogeneity or social order. Instead of promoting a cohesive society that mobilizes to check the power of the state, Americans have broken themselves out into racial and sexual identity groups — including the 51% minority group known as “women” — that are increasingly focused on using power to secure rents, privileges, “affirmative actions,” hard quotas, soft quotas, special protections, and impunities from both the state and private businesses. And while — unlike [4] in Europe [5] — freedoms of speech and press remain more or less intact in the US, these racial and sexual identity groups are successfully using social media, traditional media, predatory legal challenges, and economic leverage (by harassing companies who hire even the most benign, milquetoast dissenters and questioners) to silence any discussion or criticism of their ideas or collective behaviors.
These social actors, along with the trade unions, business groups, student organizations, nongovernmental organizations and religious organizations that Fukuyama identifies, have created an increasingly stagnant, inflexible system that is failing to respond efficiently or effectively to new challenges. While he sees much to like about liberal democracy, he admits that, “If the institution fails to adapt, the society will face crisis or collapse, and may be forced to adopt another one. This is no less true of a liberal democracy than of a nondemocratic political system.”
Fukuyama doesn’t directly address the problem of social fragmentation in his conclusion to The Origins of Political Order, but it if a cohesive, mobilized society is required to impose accountability on the state, then it seems to follow that a fragmented society of rent and privilege-seeking special interest groups will be unable to impose that accountability effectively — and Americans will be left with a powerful, authoritarian bureaucracy accountable only to interest groups and the wealthy stakeholders who fund them.
Every so often I see this smug little infographic [6] about the superiority of public education in Nordic countries, and the failings of the American system. In the early chapters of The Origins of Political Order, Fukuyama calls the problem of modern state-building “getting to Denmark,” because, “for people in developed countries, ‘Denmark’ is a mythical place that is known to have good political and economic institutions: it is stable, democratic, peaceful, prosperous, inclusive, and has extremely low levels of political corruption.”
In addition to the unique factors Fukuyama identifies that made the development of European states possible, it also seems likely that the relative size and homogenous composition of these nations contributed to their mythical perfection. Denmark is less than one quarter of the size of the state of Oregon where I live, and Fukuyama points out early in the book that even the American Founding Fathers were aware that classical republicanism “did not scale well.” The democratic ideals of early Greece and Rome were developed by homogenous societies. In the case of Rome, expansion and growth eventually gave way to Caesarism, and the Greek city-states were eventually conquered by monarchies.
Part of the magic of Denmark is that it is small, and it was created by the Danes, for the Danes. Danish magic may only last as long as those things remain true, and there is clearly trouble in Denmark. Over half of the convicted rapists in Denmark are immigrants from Iran, Iraq, Turkey, or Somalia [7]. Many Danes are concerned [8] that their culture is being subverted by Muslim influence. Danish birth rates are so low (1.7) that the government recently sponsored a “Do it for Denmark [9]” ad campaign. Denmark without Danish culture and the Danish people will not be the Denmark that everyone else in the West is “trying to get to,” and it seems likely that their political order will decay.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2014/11/the-origins-of-political-order/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/11/FukuyamaOrder.jpg
[2] The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution: http://www.amazon.com/gp/product/0374533229/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0374533229&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=IX6KEZWALWOURG3Y
[3] Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy: http://www.amazon.com/gp/product/0374227357/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0374227357&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=C2E3VUHP33OFZLC2
[4] unlike: http://reason.com/archives/2014/11/08/britain-poised-to-silence-extremist-spee
[5] Europe: http://www.friatider.se/nya-lagen-nu-lattare-atala-svenskar2-for-att-forolampa-invandrare-och-myndighetesrepresentanter
[6] smug little infographic: http://owsposters.tumblr.com/post/25869010098/silhouette-man-wonders-wtf-is-wrong-with
[7] Over half of the convicted rapists in Denmark are immigrants from Iran, Iraq, Turkey, or Somalia: http://www.amren.com/news/2012/07/rape-jihad-in-denmark-more-than-half-of-all-convicted-rapists-have-immigrant-backgrounds/
[8] are concerned: http://cphpost.dk/news/danes-we-are-too-tolerant-of-muslims.7324.html
[9] Do it for Denmark: http://rt.com/news/denmark-low-birthrate-sex-425/
00:05 Publié dans Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis fukuyama, fukuyama, livre, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie politique, ordre politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 15 novembre 2014
Thierry Maulnier, l'insurgé
Thierry Maulnier, l'insurgé
par Robert Spieler
Ex: http://synthesenationale.hautetfort.com
Nous reprenons ici l'article de Robert Spieler publié dans Rivarol de la semaine dernière sur le remarquable livre que notre ami Georges Feltin-Tracol à consacré à Thierry Maulnier.
Il y a près de 25 ans, la dénomination d’un nouveau lycée d’enseignement général, construit dans la banlieue ouest de Nice, suscitait l’émoi chez les couineurs de gauche, d’extrême-gauche, et chez les émotionnés professionnels de l’antiracisme. Pensez… Le maire de Nice, qui était alors Jacques Médecin, voulait le baptiser ‘Lycée Thierry Maulnier’. Ce qui fut fait, au grand dam des indignés congénitaux. Qui était Thierry Maulnier ? Une biographie écrite par le prolifique Georges Feltin-Tracol, nous dévoile les arcanes de cet étonnant personnage, qui fut accusé d’être ‘fasciste’ et dont Mauriac dira : « Au lieu de (se) contenter de quelques articles au Figaro, (il) aurait pu être le Sartre de (sa) génération ». Mais Thierry Maulnier ne s’est, certes pas, contenté d’écrire « quelques » articles au Figaro…
Sa jeunesse
Thierry Maulnier est le pseudonyme de Jacques Louis André Talagrand. Il est né le 1er octobre 1909 à Alès, de parents agrégés de lettres. Son père, Joseph, est un farouche républicain et un anticlérical énervé. Accessoirement, il se comporte comme un parfait tyran domestique, et voue ses deux fils à se consacrer à l’étude permanente : pas à l’école républicaine, non, à la maison… Jacques finira tout de même par découvrir la vie lycéenne dans un établissement de Nice. Gare à lui s’il amène des notes autres qu’excellentes à la maison. Le « despote », c’est ainsi que les frères le surnomment, se déchaîne… Mais cette dure éducation a des vertus. Jacques est plus que brillant, plus que cultivé. Il aura droit à sa photo dans la presse locale niçoise pour avoir décroché le second prix au Concours général d’histoire. A l’automne 1924, précoce, il entre en classe de terminale au lycée Louis-le-Grand, à Paris. Il s’y fait vite une réputation certaine : sa haute taille, son exceptionnelle culture générale, et son m’en-foutisme affiché attirent les regards. Il fait le choix d’être un « cancre invétéré » qui sera cependant bachelier avec une mention « assez bien », en une époque où une telle mention avait de la signification. Le voici en hypokhâgne où il fait la connaissance des inséparables Maurice Bardèche et Robert Brasillach, avec qui il sympathise fortement. En deuxième année de Normale ’Sup, loin de s’amender pour ce qui concerne son indolence, tant naturelle que travaillée, il se singularise, une fois de plus. Le diplôme de fin d’études repose sur un mémoire que la plupart des étudiants préparent d’arrache-pied tout au long de l’année. Pas lui. Il entreprend d’écrire son mémoire consacré à « L’art dramatique chez Racine d’après ses préfaces », 48 heures avant l’échéance, et obtient la note de 18/20 ! Il épate évidemment Brasillach, Bardèche, et ses camarades. Mais la perspective de devenir professeur, comme ses parents, ne l’enchante absolument pas. Il sera journaliste.
Thierry Maulnier, journaliste
Il découvre Charles Maurras et L’Action française, adhère à l’AF et milite quelques temps aux Camelots du Roi. Ecrivant dans l’organe maurassien des étudiants L’Etudiant français, il prend le pseudonyme de Thierry Maulnier. Grâce à la qualité de ses articles, le nombre d’abonnements augmente. Il acquiert une certaine célébrité dans les milieux nationalistes. Il est âgé de vingt an ! Le service militairel’attend. Il en gardera un vif sentiment d’inutilité et un antimilitarisme sous-jacent. Sa vie sociale sera intense. Les sorties au théâtre, au cinéma et dans les bistrots s’enchaînent, aux côtés de ses amis Brasillach, Bardèche, Blond, Lupin, Kleber Haedens. Il plaît beaucoup aux femmes et fréquente assidument la Coupole, le Flore, Lipp quand lui et ses amis ne font pas le tour (à pied) de la capitale. Mais quand trouve-t-il le temps d’écrire ? Une anecdote qui décrit sa méthode : A un ami s’enquérant de son éditorial du mois, il répondit : ‘Il est prêt’, et alors que l’autre le lui demandait, il ajouta : ‘Il ne me reste plus qu’à l’écrire’… Claude Roy dira de lui : « Ce grand travailleur est aussi un grand paresseux ». Cela n’explique cependant pas tout de ses retards à ses rendez-vous. Il est amoureux de Dominique Aury, pseudonyme d’Anne Cécile Desclos, qui fréquenta la joyeuse équipe de Brasillach et de Bardèche. Elle sera, plus tard, en 1953, le célébrissime auteur, sous le pseudo de Pauline Réage, d’Histoire d’O, roman érotique qui eut quelques soucis avec la censure.
Thierry Maulnier et les anticonformistes des années 1930
Curieuse et fascinante période que celle des années 1930. Un vaste ensemble intellectuel se développa en France, dans lequel Thierry Maulnier joua un rôle majeur. On évoqua les « relèves des années trente », avec d’un côté d’anciens briandistes favorables à la construction européenne, les « fascistes » de Georges Valois et les « techniciens » de ceux qui constituèrent plus tard la célèbre Synarchie. Thierry Maulnier faisait partie d’une seconde tendance qui, avec Denis de Rougemont et Robert Aron, venus du maurrassisme, constituèrent la Jeune Droite. On ne peut évidemment pas s’empêcher de penser à la Révolution conservatrice allemande. Maulnier rédigea l’introduction de l’édition française du Troisième Reich d’Arthur Moeller van den Bruck, un des maîtres à penser de cette école de pensée. L’ouvrage n’a, faut-il le rappeler, rien à voir avec le Troisième Reich hitlérien. Thierry Maulnier écrit, et il écrit beaucoup. Paul Sérant dira de lui qu’il « fut considéré à une certaine époque comme le successeur possible de Maurras dans le domaine doctrinal ». Révolutionnaire, Maulnier l’est avec véhémence. Il dénonce les effets désastreux de la modernité. : « La machine moderne doit produire à tout prix : on ne produit plus pour consommer, on consomme pour produire. De là naît un esprit nouveau, esprit barbare, mépris devant ce que la civilisation a de plus précieux, mépris de l’homme en fin de compte ». Allant encore plus loin dans la révolte, il appelle à « mépriser les lois, violer les lois et les détruire ». Il méprise profondément les milieux politiques de droite. Il écrit cette phrase terrible, si terriblement juste : « Nous ne sommes pas les braves jeunes espérés, la milice sacrée que la droite traditionnelle espère voir surgir pour lui remettre le soin de prolonger le temps des équipages, de défendre la tradition, la Propriété, la Famille, la Morale, et de faire renaître, avec un peu de chance, l’époque où il y avait encore des domestiques ». Maulnier aborde les questions sociales sans craindre de scandaliser ses lecteurs d’esprit conservateur. Il prône une synthèse révolutionnaire-conservatrice et, à l’instar de Drieu La Rochelle, un « fascisme socialiste qui est aujourd’hui la seule forme encore vivante du socialisme ». Il se méfie cependant des étiquettes et refuse d’importer en France des modèles totalitaires étrangers. S’inspirant de Lénine, il écrit : « Une révolution dans son principe n’a pas été un mouvement de masse, les mouvements de masse naissent après les révolutions. La prise du pouvoir, par la ruse ou par la violence, ne demande qu’une minorité ardente, cohérente, convenablement fanatisée. »
Maulnier, trop extrémiste pour Brasillach et Rebatet
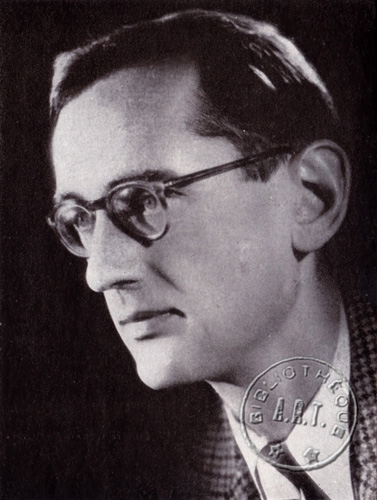 Il collabore, entre autres revues, à L’Insurgé, qui se réclamait à la fois de Jules Vallès et de Drumont, dont les orientations fascisantes et corporatives étaient connues. Curieusement, l’équipe de Je suis partout (auquel collabore aussi Maulnier), en particulier Lucien Rebatet et Robert Brasillach, montre une franche hostilité à une ligne éditoriale qu’ils jugent trop extrémiste… Pas étonnant que Maulnier se rapproche durant quelques temps de Jacques Doriot et du Parti populaire français. Il collaborera même à l’organe principal du PPF, L’Emancipation nationale. Il déteste toujours autant le conservatisme, écrivant : « Ce qui nous sépare aujourd’hui des conservateurs, c’est autre chose et beaucoup plus que leur lâcheté (Mon Dieu, qu’il a raison !) », ajoutant « Ce ne sont pas seulement les méthodes d’action conservatrices, ce sont les manières de penser conservatrices, ce sont les valeurs conservatrices qui nous sont odieuses. » Et il ajoute : « A bas l’Union sacrée ! Sous aucun prétexte, nous ne nous solidariserons avec la France d’aujourd’hui ! », concluant par ces mots : « C’est dans l’opposition, c’est dans le refus, c’est, le jour venu, dans la révolution, que réside notre seule dignité possible ». Il évoque cette « République démocratique (qui) ne peut être pour nous que la grande ennemie du peuple, le symbole de son oppression séculaire et des massacres qui l’ont assurée », ajoutant « Démocratie et capitalisme ne sont qu’un seul et même mal : on les abattra en même temps ». Et puis, ces mots (écrits, faut-il le préciser, avant la victoire allemande) : « La France est un pays envahi, un pays colonisé, un pays soumis à la domination étrangère ».
Il collabore, entre autres revues, à L’Insurgé, qui se réclamait à la fois de Jules Vallès et de Drumont, dont les orientations fascisantes et corporatives étaient connues. Curieusement, l’équipe de Je suis partout (auquel collabore aussi Maulnier), en particulier Lucien Rebatet et Robert Brasillach, montre une franche hostilité à une ligne éditoriale qu’ils jugent trop extrémiste… Pas étonnant que Maulnier se rapproche durant quelques temps de Jacques Doriot et du Parti populaire français. Il collaborera même à l’organe principal du PPF, L’Emancipation nationale. Il déteste toujours autant le conservatisme, écrivant : « Ce qui nous sépare aujourd’hui des conservateurs, c’est autre chose et beaucoup plus que leur lâcheté (Mon Dieu, qu’il a raison !) », ajoutant « Ce ne sont pas seulement les méthodes d’action conservatrices, ce sont les manières de penser conservatrices, ce sont les valeurs conservatrices qui nous sont odieuses. » Et il ajoute : « A bas l’Union sacrée ! Sous aucun prétexte, nous ne nous solidariserons avec la France d’aujourd’hui ! », concluant par ces mots : « C’est dans l’opposition, c’est dans le refus, c’est, le jour venu, dans la révolution, que réside notre seule dignité possible ». Il évoque cette « République démocratique (qui) ne peut être pour nous que la grande ennemie du peuple, le symbole de son oppression séculaire et des massacres qui l’ont assurée », ajoutant « Démocratie et capitalisme ne sont qu’un seul et même mal : on les abattra en même temps ». Et puis, ces mots (écrits, faut-il le préciser, avant la victoire allemande) : « La France est un pays envahi, un pays colonisé, un pays soumis à la domination étrangère ».
Thierry Maulnier pendant la guerre
Officier de réserve, jacques Talagrand est mobilisé et part en première ligne. L’avancée allemande le contraint à se réfugier chez Léon Daudet. Il appartiendra aux « vichysto-résistants », ce que n’apprécient guère ses anciens amis de Je suis partout, qui le qualifient de « gaulliste » et de « libéral anglais »à longueur d’articles incendiaires. Lucien Rebatet ira jusqu’à le qualifier, dans Les Décombres, d’ « agent inconscient de l’Intelligence Service » ! Il signe cependant, dans La Revue universelle, une série d’articles, développant des axes doctrinaux pour la Révolution nationale et adhère le 26 janvier 1941 au Comité de Rassemblement pour la Révolution nationale, aux côtés de Jean-Louis Tixier-Vignancour, Edouard Frédéric-Dupont (qui sera membre du groupe FN à l’Assemblée nationale, en 1986) et Antoine de Saint-Exupéry. Il s’écarte cependant de tout engagement politique et refuse toute collaboration avec l’occupant. Il écrit, en 1942, ces lignes : « C’est en-dehors des mythes démocratiques et des mythes totalitaires que se trouvent pour la France la seule renaissance, la seule existence possible ».
L’après-guerre
Le11 septembre 1944, Le Figaro, auquel Maulnier avait collaboré, reparaît. Son premier article concerne Les Réprouvés, allusion bien sûr au magnifique livre d’Ernst Von Salomon, et s’adresse aux soldats perdus de l’IIIème Reich. Il suscite la fureur de certains. Mais ses amis résistants se sont porté garants de lui. Il passe entre les mailles du filet. Ces cautions n’empêchent pas Maulnier de s’en prendre virulemment à la « Révolution rouge de 1944 »: Indignation de la presse résistancialiste … Il tonne contre une nouvelle « Terreur ». L’arrestation et la condamnation à mort de Robert Brasillach l’indignent. Avec Jacques Isorni, l’avocat de Brasillach, il rédige une pétition de demande de grâce à De Gaulle, et la fait signer par des artistes et des écrivains : entre autres, par François Mauriac, Jean Cocteau, Colette, Paul Valéry, Albert Camus, Roland Dorgelès. Hélas, Brasillach sera fusillé le 6 février 1945. Une ignominie que Maulnier ne pardonnera jamais à De Gaulle. Il continue à s’activer dans la défense des épurés. Il contribuera à obtenir la grâce de Rebatet, condamné à mort, qui l’avait pourtant copieusement invectivé. Rebatet saluera cet « homme de cœur d’une rare noblesse ». Il aidera aussi Maurice Bardèche à vivr, et même à survivre, l’aidant sur le plan professionnel.
Thierry Maulnier, un bourgeois arrivé à la consécration ?
Avec sa nouvelle épouse, Marcelle Tassencourt, avec qui il partage un amour immodéré pour les chats (ils en ont une dizaine), il s’investit dans la mise en scène et la dramaturgie. Il critique dans ses pièces le système communiste, ce qui ne lui attire pas franchement les sympathies des Sartriens et autres valets du Komintern. En juin 1959, l’Académie française le récompense par son Grand prix de littérature pour l’ensemble de son œuvre. Cinq ans plus tard, il sera élu Académicien, remplaçant Henry Bordeaux. Mais il continue à écrire au Figaro où il fournit un article ou un éditorial quotidien jusqu’en 1987. Au Figaro ou à La Table Ronde, maison d’édition dont il a « inventé » le nom, il combat frontalement le communisme et ses ‘idiots utiles’, lui qui connaît parfaitement l’œuvre de Karl Marx, qu’il a pu approfondir au temps de la Jeune Droite. Il dénonce avec virulence le totalitarisme rouge, lui qui avait écrit un essai au titre ‘signifiant’ : La face de méduse du communisme. Mais, curieusement, il prit fait et cause, comme le Pape et comme de multiples personnalité au niveau mondial pour les époux Rosenberg, condamnés à mort pour espionnage aux Etats-Unis. Ils avaient transmis aux Soviétiques les secrets de la bombe atomique et furent exécutés. Pourquoi le furent-ils, malgré cette mobilisation mondiale ? L’affaire mérite d’être racontée en quelques lignes. Les Américains avaient en fait réussi à décrypter les messages secrets que les Soviétiques envoyaient à leurs taupes américaines, dont les Rosenberg, et disposaient des preuves absolues de leur trahison. Mais pas question que les Soviétiques sachent que leurs codes avaient été décryptés. Le ministre de la Défense américain convoqua dans le plus grand secret les juges du tribunal, et leur présenta, sous le sceau de la discrétion la plus absolue, les preuves de la trahison des Rosenberg, qui furent en effet condamnés à mort et exécutés. Le supposé ‘recentrage’ politique de Maulnier suscita évidemment l’ironie et l’ire de Jacques Laurent, dans sa revue La Parisienne, et des maurassiens regroupés autour de Pierre Boutang. Maulnier était, à leurs yeux, coupable d’écrire dans un journal (Le Figaro), « aux opinions timorées ». Que diraient-ils aujourd’hui ? Mais Maulnier continue à s’engager, en faveur de l’Indochine française, en faveur de l’Algérie française. L’incurie politique de la IVème République l’exaspère tant qu’il en vient à soutenir le retour au pouvoir du général De Gaulle. Il en viendra même à condamner le putsch d’Alger. Maulnier, qui avait pourtant collaboré un temps à Défense de l’Occident de son vieil ami Bardèche, se rapprochera des thèses atlantistes tout en acquiesçant la politique étrangère de De Gaulle.
Mais, « fasciste un jour, fasciste toujours »
Les événements de mai 1968 le réveillent d’un (relatif) sommeil. Dominique Venner, qui le rencontra souvent, dira : « Qu’à bientôt soixante ans, l’écrivain fût différent du jeune homme qu’il avait été trente ans plus tôt, qui s’en étonnerait ? Mais je peux témoigner que le Thierry Maulnier de l’âge mûr, celui que j’ai connu, était beaucoup moins apprivoisé qu’on ne l’imagine, beaucoup moins changé qu’on ne l’a dit. » Thierry Maulnier présidera des colloques dont les invités furent Roland gaucher, Giorgio Locchi, Jean Dutourd, Paul Sérant ou Raymond Ruyer. L’académicien assista aussi à des colloques du GRECE et accepta de figurer dans le comité de patronage de Nouvelle Ecole, la remarquable revue de la Nouvelle Droite dirigée par Alain de Benoist et Pierre Vial. Et c’est ainsi que Thierry Maulnier transmit implicitement le flambeau du combat d’idées de la Jeune Droite et des non-conformistes des années trente auu non-conformistes des années 1970, regroupés autour du GRECE et de la « Nouvelle Droite »…
La mort de Thierry Maulnier
Celui que notre ami Rivarolien, Patrick Parment, avait qualifié, dans un numéro d’Eléments en 1988, de « Cioran sans amertume », et à qui Pierre Vial rendit hommage dans la même revue avec ce titre, « Thierry Maulnier l’insurgé », décède le samedi 9 janvier 1988 à Marne-la-Coquette.
Georges Feltin-Tracol, Thierry Maulnier, un itinéraire singulier, préface de Philippe d'Hugues, 18 euros (plus 3 de frais de port), Editions Auda Isarn, BP 90825 - 31008 Toulouse Cedex 6
00:05 Publié dans Histoire, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, histoire, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, non conformisme des années 30, années 30, années 40, années 50, années 60, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 13 novembre 2014
Zbigniew Brzezinski : "Le vrai choix"
Zbigniew Brzezinski : "Le vrai choix"
|
Vincent Satgé Ex: http://www.voxnr.com |
|
Le « Diploweb.com » développe cette rubrique, en synergie avec Les « Yeux du Monde.fr » : offrir une fiche de lecture synthétique d’un ouvrage classique qu’il faut savoir situer dans son contexte et dont il importe de connaître les grandes lignes... avant de le lire par soi même.
Pour ne pas manquer une fiche, le mieux est de s’abonner à notre compte twitter.com/diploweb.
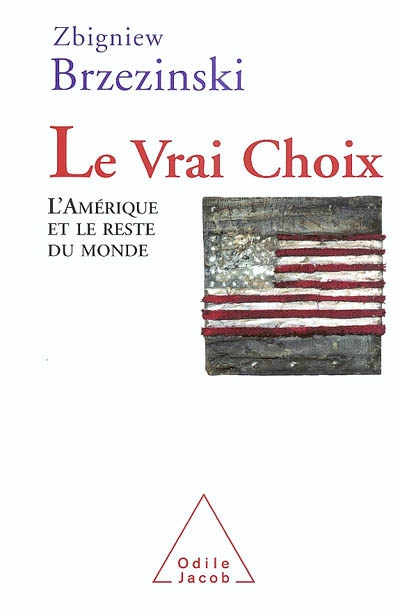
Le vrai choix, L’Amérique et le reste du monde fut publié alors que les Etats-Unis étaient engagés dans l’opération Iraqi freedom. Au vu des tensions internationales qui ont accompagné cette campagne militaire, on pouvait raisonnablement attendre de Zbigniew Brzezinski qu’il choisisse avec précaution les formules et les tournures à employer. Peine perdue car, dès l’introduction, ce dernier expose sa thèse crûment : « Notre choix ? Dominer le monde ou le conduire » [1]. Appelant de ses vœux une « communauté internationale d’intérêts partagés » sous supervision américaine, il se plaçait ainsi dans une position intermédiaire assez inconfortable, fustigeant les influents néoconservateurs comme les colombes libérales.
Zbigniew Brzezinski est habitué à être sous le feu des critiques. Détenteur d’un doctorat de l’Université d’Harvard, il s’est surtout fait connaître pour avoir été le principal conseiller des affaires étrangères de Jimmy Carter lors de la campagne présidentielle de 1976. Une fois l’élection remportée, il fut de 1977 à 1981 son conseiller à la Sécurité nationale durant une période agitée (particulièrement lors de l’échec de l’opération Eagle Claw visant à libérer les diplomates américains pris en otage en Iran). Depuis, il a notamment exercé la fonction de conseiller au Center for Stategic and International Studies (CSIS) ainsi que de professeur de relations internationales à la Johns Hopkins University à Washington D.C.
S’il a publié de nombreux ouvrages (Illusion dans l’équilibre des puissances en 1977 ou L’Amérique face au monde co-écrit en 2008 avec Brent Scowcroft), Zbigniew Brzezinski est surtout connu pour Le grand échiquier (1997). Il y détaille notamment les alternatives dont disposaient les Etats-Unis pour maintenir leur influence sur l’Europe et l’Asie, clés du contrôle sur le reste du monde. Seul défaut de cet ouvrage qui fit date : il ne couvre pas la période postérieure au 11 septembre, évènement qui a considérablement réorienté la politique étrangère des Etats-Unis.
Le Vrai Choix, à l’inverse, nous livre un regard plus actuel sur les options qui restent aux Etats-Unis s’ils souhaitent conserver leur rang mondial. Le raisonnement de Zbigniew Brzezinski peut être dès lors décomposé en trois temps. Il constate tout d’abord que le choix de la domination n’est pas, à moyen ou long terme, possible ni même profitable aux Etats-Unis. Il va ensuite s’interroger sur la manière pratique d’exercer un leadership sur les affaires mondiales. Enfin, il pointe les faiblesses institutionnelles qui risquent de mettre à mal la mise en œuvre de la diplomatie américaine.
La guerre contre le terrorisme ainsi que l’unilatéralisme amoindrissent la sécurité des Etats-Unis
La position géographique privilégiée des Etats-Unis les a souvent amenés à considérer leur sécurité comme définitivement acquise. Encadrés par des voisins peu puissants, placés entre l’Océan Pacifique et l’Océan Atlantique, les Etats-Unis étaient quasiment en situation d’insularité jusqu’à la Guerre Froide. Une fois le rival soviétique disparu, le sentiment d’invulnérabilité repris le dessus jusqu’aux attentats du 11 septembre. Le monde et les Etats-Unis prirent ainsi définitivement conscience que la mondialisation permet aux menaces de s’affranchir des distances, du fait de la prolifération des technologies ou du terrorisme le plus « artisanal » qui soit. Face à ce nouveau défi, la réaction politique des Américains ne fut, pour l’auteur, clairement pas à la hauteur. « L’insécurité peut être socialement désagréable, elle doit être politiquement gérable » [2]. Ainsi les pouvoirs publics ont-ils investi énormément sur des dispositifs tels que le bouclier anti-missile, oubliant que le type d’attaque que ce dernier prévient est rendu improbable par les représailles que courrait l’Etat agresseur. Un attentat terroriste, par contre, pourrait causer des dégâts matériels aussi importants tout en empêchant de répliquer et de neutraliser l’organisation responsable. Le meilleur moyen de se prémunir des attaques qui visent le territoire américain reste de renforcer les capacités des services de renseignement.
Par ailleurs, cette lutte contre le terrorisme doit être accompagnée d’un effort d’identification de la menace. Il apparaît en effet absurde de désigner le terrorisme comme l’ennemi en ce sens qu’il ne s’agit que d’une « technique meurtrière d’intimidation », utilisée par tous types de mouvements [3] (les attentats suicides, de 1981 à 2001, auraient ainsi majoritairement été menés par les Tigres Tamouls du Sri Lanka, marxistes donc s’opposant aux religions). Derrière le terrorisme, c’est l’acte politique qu’il s’agit de comprendre. Or, sur ce point, « les Etats-Unis ont montré une extraordinaire réticence à prendre en compte la dimension politique du terrorisme et à restituer celui-ci dans son contexte politique » [4].
Outre la guerre contre le terrorisme, c’est bien les interventions unilatérales qui mettent en péril la sécurité des Etats-Unis. Le discours du Président G. W. Bush à l’académie de West Point le 1er juin 2002, a largement justifié le concept d’« attaque préemptive » (lorsqu’un acteur estime qu’un autre Etat est sur le point de mener une action offensive) à l’encontre d’« Etats voyous ». Une telle attitude sur la scène mondiale ne peut qu’entraîner une détérioration des rapports avec les Européens et donner à penser que la guerre contre le terrorisme peut être réduite à une initiative exclusivement américaine aux fortes connotations antimusulmanes. Le « conflit des civilisations » de Samuel Huntington adviendrait alors à titre de prophétie auto-réalisatrice. Au final, la sécurité des Etats-Unis seraient encore moins garantie vu que « l’acquisition clandestines d’armes de destruction massive prendrait vite le rang de priorité parmi les Etats déterminés à ne pas se laisser intimider. Ils trouveraient là une incitation supplémentaire à soutenir les groupes terroristes, lesquels, animés par la soif de vengeance, seraient alors plus enclins que jamais à utiliser, de façon anonyme, ces armes contre l’Amérique » [5]. Bref, on passerait du paradigme MAD (mutual assured destruction) de la Guerre Froide à celui de SAD (solitary assured destruction) ce qui pour Zbigniew Brzezinski s’assimile à une « régression stratégique ».
Loin de poursuivre dans une posture dominatrice et isolante, les Etats-Unis doivent redéfinir leur position sur la scène internationale.
 Le premier volet de cette redéfinition concerne l’identification des zones sensibles de la planète. La première est celle des « Balkans mondiaux » [6] qui, avec le Moyen-Orient en particulier, doit être traitée avec le plus grand soin sous peine de détériorer les relations entre les Etats-Unis et l’Europe et les Etats-Unis et le monde musulman. Vient ensuite l’Asie qui est « une réussite économique, un volcan social et une bombe politique » [7], constat plus que jamais d’actualité avec les rivalités économiques et territoriales exacerbées, sans parler de vieux contentieux historiques (colonisation du Japon et timide repentir pour ses crimes de guerre ; relations indo-chinoises ; conflit latent entre le Japon et la Russie à propos des îles Kouriles et Sakhaline ; le dossier nord-coréen ; Taïwan, « 23e province chinoise »). Une approche régionale sur tous ces points chauds devrait permettre une résolution (et une prévention) des conflits qui y sévissent, surtout de ceux dont on parle peu. L’auteur pointe ainsi la question assez peu posée du Cachemire, occulté par le conflit israélo-arabe. Avec 1,2 milliards d’habitants, deux Etats nucléaires et des populations très sensibles aux rengaines nationalistes, la zone mérite plus d’attention que celle dont elle bénéficie actuellement.
Le premier volet de cette redéfinition concerne l’identification des zones sensibles de la planète. La première est celle des « Balkans mondiaux » [6] qui, avec le Moyen-Orient en particulier, doit être traitée avec le plus grand soin sous peine de détériorer les relations entre les Etats-Unis et l’Europe et les Etats-Unis et le monde musulman. Vient ensuite l’Asie qui est « une réussite économique, un volcan social et une bombe politique » [7], constat plus que jamais d’actualité avec les rivalités économiques et territoriales exacerbées, sans parler de vieux contentieux historiques (colonisation du Japon et timide repentir pour ses crimes de guerre ; relations indo-chinoises ; conflit latent entre le Japon et la Russie à propos des îles Kouriles et Sakhaline ; le dossier nord-coréen ; Taïwan, « 23e province chinoise »). Une approche régionale sur tous ces points chauds devrait permettre une résolution (et une prévention) des conflits qui y sévissent, surtout de ceux dont on parle peu. L’auteur pointe ainsi la question assez peu posée du Cachemire, occulté par le conflit israélo-arabe. Avec 1,2 milliards d’habitants, deux Etats nucléaires et des populations très sensibles aux rengaines nationalistes, la zone mérite plus d’attention que celle dont elle bénéficie actuellement.Une fois les situations à risques identifiées, les Etats-Unis ont besoin d’alliés pour y faire face. Selon Zbigniew Brzezinski, le seul partenaire digne de ce nom est, à la vue de son potentiel politique, militaire et économique, l’Union européenne. Leur association, au-delà de l’utilité pratique, permettrait de désamorcer les critiques d’unilatéralisme (ou au moins de les affaiblir). Ensemble, Europe et Etats-Unis sont « le noyau de la stabilité mondiale ».
Cela ne veut pour autant pas dire que leur entente aille de soi. Deux menaces planent au-dessus de leur entente cordiale. Les questions de défense et le « partage du fardeau » sont primordiales. Les Américains se plaignent souvent du manque d’investissement des Européens dans leurs dépenses militaires, tandis que le Vieux Continent dénonce souvent sa tutelle américaine. Toutefois l’un autant que l’autre sortent gagnant du statu quo. En effet, l’Europe ne doit sa cohésion interne qu’à la présence américaine tandis que la prééminence américaine ne pourrait s’accommoder d’une Europe militairement autonome. L’observation se vérifie surtout dans des régions telles que le Moyen-Orient (qui accueillerait l’Europe à bras ouvert vu la détérioration des rapports avec les Etats-Unis) ou encore l’Amérique latine (qui a des liens historico-culturels importants avec l’Espagne, la France et le Portugal). La seconde entrave à un rapprochement du couple Europe-Etats-Unis concerne la question des règles qui sous-tendent l’ordre mondial. Brzezinski le reconnaît sans détour : « c’est en fonction de son utilité ponctuelle que telle ou telle doctrine est mise en œuvre de façon sélective [...] Pour le monde extérieur, le message est clair : lorsqu’un accord international contredit l’hégémonie américaine et pourrait brider sa souveraineté, l’engagement des Etats-Unis en faveur de la mondialisation et du multilatéralisme atteint ses limites » [8]. Ainsi fut-ce le cas pour le protocole de Kyoto ou encore la Cour pénale internationale.
Pour parvenir à ses fins, l’Amérique doit s’évertuer à sauvegarder des institutions démocratiques et capables de produire du consensus sur la diplomatie à mener.
Selon Zbigniew Brzezinski, l’évolution de la composition ethnique des Etats-Unis risque, à terme, de compliquer la définition de la politique étrangère américaine. En effet, si le pays à longtemps été dominé par une majorité WASP (White Anglo-Saxon Protestant), la progression des communautés tierces qui réclament et qui obtiennent une reconnaissance politique est un phénomène tendant à s’amplifier. Ainsi la victoire du Président J. F. Kennedy en 1960 (seul président catholique des Etats-Unis à ce jour), la nomination d’Henry Kissinger au poste de secrétaire d’Etat (réfugié juif d’origine allemande) en 1973, ou encore celle de Colin Powell au même poste en 2001 en sont divers exemples (la présidence Obama n’étant pas citée car postérieure à l’écriture de l’ouvrage).
Le bât blesse lorsque chaque communauté vise, à travers des groupes de pression, à faire prévaloir son influence sur celle des autres. Avec la banalisation de « groupes de veto ethniques », la diplomatie américaine pourrait bien devenir un exercice de haute voltige politique (voire impossible à réaliser). Que ce soit par le vote d’amendements au Congrès, le financement de campagnes électorales ou encore la constitution de comités parlementaires autour d’intérêts ethniques, la politique étrangère des Etats-Unis est sensible aux revendications infra-nationales. La Maison Blanche pourrait être, hors campagne électorale, assez peu concernée : seulement, c’est bien le Congrès qui vote le budget (et l’affectation des aides financières internationales montre d’ailleurs assez fidèlement le poids de chaque groupe particulier). Ainsi, plutôt que d’être une synthèse ne satisfaisant personne, la politique extérieure des Etats-Unis devrait s’efforcer de rester bâtie sur un compromis visant l’intérêt général de l’Amérique. D’aucuns avancent que la politique étrangère du Canada, rôdé à gérer une société multiculturelle, pourrait constituer un modèle à suivre pour les Etats-Unis. Seulement ces derniers, à l’inverse de leur voisin, exercent des responsabilités internationales d’une ampleur totalement différente.
En outre, le rôle de « nation indispensable » tenu par les Etats-Unis met en péril le caractère démocratique de leurs institutions. Lorsqu’ils ont accédé au statut de grande puissance au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un appareil administratif imposant s’est mis en place afin d’assumer les nouvelles responsabilités du pays à l’international (représentations diplomatiques, directions des forces et des bases à l’étranger, services de renseignement...). Cette « bureaucratie impériale », sous la conduite de l’exécutif américain, est en principe contrebalancée par la surveillance du Congrès (qui vote ses crédits et organise des comités sur son activité). Seulement, dans des périodes politiquement troubles, il arrive que le Congrès lâche la bride de l’exécutif. Ce fut le cas en 2002 lorsque les parlementaires abandonnèrent le droit de déclarer la guerre à l’Irak au Président des Etats-Unis. Cette procédure a, ponctuellement mais indiscutablement, brisé l’équilibre des pouvoirs constitutionnels américains. Le même constat peut être fait avec le Patriot Act du 26 octobre 2001 qui a réduit l’étendue du pouvoir judiciaire (en particulier les écoutes effectuées sur demande gouvernementale). Au final, l’hégémonie des Etats-Unis peut menacer leur propre démocratie autant que leur mixité sociale toujours plus hétérogène peut entraver leur capacité à décider et mettre en œuvre leur diplomatie.
Le vrai choix semble, de prime abord, assez révélateur de l’époque où il a été rédigé. Si Zbigniew Brzezinski défend le multilatéralisme à moyen-terme, il reconnaît la nécessité d’agir parfois de manière unilatérale. S’il reconnaît que les Etats-Unis ont un discours sur la mondialisation trop frappé de messianisme, il n’hésite pas à vilipender les élites russes et européennes qui seraient tout autant dans l’excès dans leurs critiques (on notera avec amusement que deux Français, Jean Baudrillard et Pierre Bourdieu pour ne pas les citer, sont particulièrement visés). Enfin, la « destinée manifeste » est à ce point intégrée dans le raisonnement de l’auteur qu’il n’hésite pas à conclure sur ces quelques lignes qui ont de quoi faire hausser les sourcils : « « Laissez rayonner vos lumières devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres » [9]. Que rayonne l’Amérique. » [10]
Lorsque l’on a accepté ces nombreuses réserves, il nous reste un ouvrage très bien structuré aux raisonnements pertinents, documentés et toujours d’actualité. Pour ne rien gâcher, l’auteur a, avec l’arrivée au pouvoir de Barack Obama, gagné son pari.Les Etats-Unis ont, ces dernières années, favorisé le leadership au détriment de la domination unilatérale. Reste à savoir s’il s’agit d’un changement de doctrine définitif ou bien, comme l’avance Serge Sur, d’« une stratégie à plus long terme de reconfiguration de la puissance américaine et de reconstruction d’une hégémonie durable » .
|
notes |
|
Co-président du site Les Yeux du Monde.fr, site de géopolitique pour les étudiants, Vincent Satgé est en Master 2 de Sciences Politiques à l’Institut d’études politiques de Bordeaux. |
|
source |
Diploweb :: lien
00:06 Publié dans Actualité, Géopolitique, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, livre, zbigniew brzezinski, politique internationale, états-unis, impérialisme, impérialisme américain |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 09 novembre 2014
Attacke auf den Mainstream
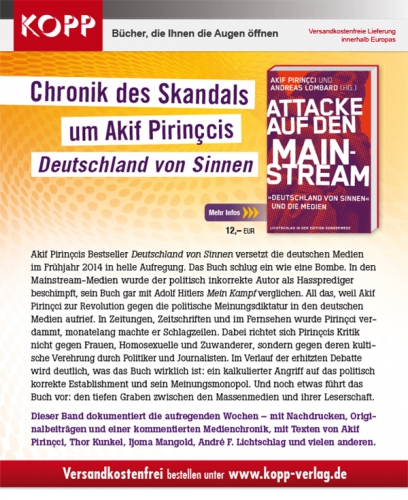
00:08 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
The Works of Stephen Mitford Goodson
Central Banking & Human Bondage: The Works of Stephen Mitford Goodson
By Kerry Bolton
Ex: http://www.counter-currents.com
Stephen Mitford Goodson
A History of Central Banking and the Enslavement of Mankind [2]
London: Black House Publishing, 2014
Stephen Mitford Goodson
Inside the South African Reserve Bank: Its Origins and Secrets Exposed [3]
London: Black House Publishing, 2014
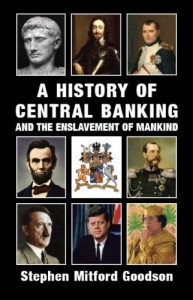 Originally intended as one book, Black House Publishing has brought out two volumes that, while of course companions, are self-contained.
Originally intended as one book, Black House Publishing has brought out two volumes that, while of course companions, are self-contained.
Immediately the perceptive reader will be aware of several promising features of these books: The author’s middle name is Mitford, indicating the likelihood of a propensity towards rebelliousness.[1] Next, the author’s dedication of A History of Central Banking to Knut Hamsun, “a beacon of light and hope of the natural world order;” the great Norwegian novelist being a man of honor who refused to bow before Talmudic vengeance upon the defeated of World War II. The next promising feature is a quote from Ezra Pound (a figure akin to Hamsun for his having fought the same malignant forces, defending the same heroic ideals, and having undergone great persecutions in the post-war era) which sets the tone for the book: “And you will never understand American history or the history of the Occident during the past 2000 years unless you look at one or two problems; namely, sheenies and usury. One or the other, or both. I should say both.”[2]
Another interesting feature that immediately faces the reader is that the lengthy preface is written by Prince Mangosuthu Buthelezi, Member of Parliament and long-time leader of the Inkatha Freedom Party. While Prince Buthelezi begins by stating that he “does not endorse the viewpoints” expressed in the book, he also points out that the book is “controversial” and will “engender strong reaction.” The remarks of caution by Buthelezi are presumably necessitated by Goodson, like his Mitford relatives, insisting on documenting certain heresies pertaining to the influence of Jews on politics and finance, and on the achievements of Axis states in overthrowing shylockcracy.
Despite opening with that qualification, Buthelezi nonetheless proceeds to support Goodson’s views on central baking and usury as the main cause of “profound and inhumane differences” within nations throughout the world. Buthelezi, declares himself an enemy of that system: “For this reason, for several years, my Party and I have argued that South Africa should reform its central banking and monetary system, even if that means placing our country out of step with iniquitous world standards.” Since that is the case, one suspects that Buthelezi also realizes that the resistance of the Axis states to just this system might have been the real cause of their placing themselves “out of step with iniquitous world standards,” which Goodson subsequently explains. The prince writes: “This work provides not only a broad sweep of the history of economics over almost three millennia, but insights into how the problems of usury have been confounding and enslaving mankind since civilized existence first began.”
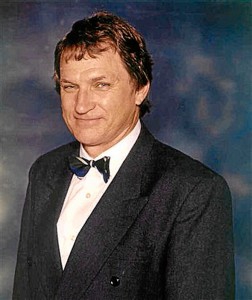 Goodson’s book is unique in this genre in several major ways: he traces the course of usury through history over thousands of years; something that has not usually been attempted since one of Ezra Pound’s favorite books, Brooks Adams’ Law of Civilization and Decay was published over a century ago.[3] Goodson also provides both a history of the usurers and those who opposed usury, plus technicalities on the finance system and how it can be fixed.
Goodson’s book is unique in this genre in several major ways: he traces the course of usury through history over thousands of years; something that has not usually been attempted since one of Ezra Pound’s favorite books, Brooks Adams’ Law of Civilization and Decay was published over a century ago.[3] Goodson also provides both a history of the usurers and those who opposed usury, plus technicalities on the finance system and how it can be fixed.
Goodson goes back to ancient Rome in seeking early examples of financial systems that have a bearing on the world today. He quotes Aristotle, from Politics, on what some would call the Traditionalist attitude[4] to such things but which are today called “respectable businessmen” and “good business practice”: “Men called bankers we shall hate, for they enrich themselves while doing nothing.” Aristotle thereby sums up the entirety of the case against orthodox banking. Goodson traces systems used in Rome such as the use of bronze pieces that were issued by the Roman state for the transaction of commerce, usury-free, an early example of fiat money; not to be confused with the present-day system of issuing fiat money via private banks, who receive their slice of usury, allowing this perverted “fiat money” to be condemned when it does not work.[5] Goodson draws on statistics to show that this was an era of great wealth and progress, at a time also when the Roman leaders lived by the austerity and honor of what it truly was to be “Roman.”
The system fell to ruin when Rome replaced these bronze ingots with silver, and the whole character of Rome was degraded. In other words, moral rot followed a change in banking. Usurers, including many Jews who had flocked to Rome during its epoch of decay, charged high interest on loans and destitution became widespread. As has often been the case in history, right up to our modern era, a heroic figure would arise to set matters aright, and this took the form of Julius Caesar, who knew fully of the situation. He issued cheap metal coins, and interest was heavily regulated. Goodson lists the measures undertaken in the socio-economic realm by Caesar, which are incredible; perhaps not to be repeated on such a scale until Mussolini, Hitler, and Michael Joseph Savage.[6] After Caesar’s death, Rome adopted the gold standard, and this was to have major negative consequences. It is an important example of the role “money power,” as we might call it, has played in the corruption and collapse of civilizations, the causes too often neglected by the Right which assigns this to the role of race in reductionist terms.[7]
Goodson begins the monetary history of England with King Offa of Mercia, during the 8th century, where again silver minted coins were used, and the pagan outlawing of usury was reintroduced. Under King Alfred the property of usurers was forfeited, while under Edward the Confessor usurers were declared outlaws. The rot set in when Jews arrived with the defeat of Harold II by William the conqueror in 1066, and these Jews were given privileged positions as usurers by William. England was ravished with debt, which spared nobody, either nobleman or workman. In 1215 the Magna Carta was forced on King John by his noblemen, the most important reason being to deal with usury.
During the Middle Ages usury was again abolished, and “tally sticks” were used. These were kept in use for 700 years, to some degree or other. Goodson records the system in some detail, and despite what we are told about the Middle Ages, the populace lived well, something that has been detailed by William Cobbett, in comparing the conditions of workers of Medieval times to those of the Industrial Revolution.[8] As in Rome, history repeated itself, with a series of ups and downs for the usurers over the centuries, and of course, as we now know, their eventual triumph, in this instance ushered in by the victory of Cromwell and the Puritan Revolution, shortly followed by the creation of the Bank of England, a privately owned consortium based on the Dutch model.[9] Goodson mentions that when the Bill that included the enacting of the Bank of England was passed, there were only 42 members of the House present, and all were Whigs; the Tories opposed the Bill. This is a further indication of my contention that the “true Right” is inherently anti-capitalist, while the Left, as Spengler pointed out, always acts in the interests of the “money party.”[10] From then on a pattern emerged, writes Goodson,
of attacking and enforcing the bankers’ system of usury [that] has been deployed widely in the modern era and includes the defeats of Imperial Russia in World War I, Germany, Italy and Japan in World War II and most recently Libya in 2011. These were all countries which had state banking systems, which distributed the wealth of their respective nations on an equitable basis and provided their populations with a standard of living far superior to that of their rivals and contemporaries.
Goodson points out that although the Labour Government nationalized the Bank of England in 1946 (i.e., over a decade after the New Zealand Labour Government had nationalized that country’s Reserve Bank in 1935, which had originally been created on the urging of the Bank of England’s globe-trotting adviser Sir Otto Niemeyer) it was mere window dressing as the Bank of England, like other “nationalized ” Reserve Banks, including New Zealand’s, remains within the global usury system, and they merely serve as conduits for borrowing from private international banks. What could be added is that when the New Zealand Labour Government nationalized the Reserve Bank, albeit at considerable public pressure to fulfill its election promises on state banking, led by maverick Labour MP and one-armed war veteran John A. Lee, its one great but enduing act was to issue 1% state credit for the iconic state housing project. This not only provided durable houses on quarter acre sections at low cost, but also solved, through this project of public works, 70% of the country’s unemployment during the midst of the world depression.[11]
Citing Harvard historian Carroll Quigley, Goodson shows that these central banks became part of a vast interlocking system of international finance, which has done nothing but expand ever since.
Other revolts against the banking system have included the American Colonies which financed their war against Britain with its own state money, as did both the Union and the Confederate states during the Civil War. Again a series of ups and downs followed as the usurers and their opponents vied for the enacting of their respective plans for banking, until when in 1913 the conflict was resolved with the Reserve Bank Act, passed again behind the façade that it would be a state bank that would bring “order” to finance, after three years of planning by the international bankers and their followers in politics.
Russia provides another example of a state that had an independent banking system, and is of particular interest insofar as – like the Axis states subsequently – the Czar has been pilloried as a tyrant whose overthrow was the result of popular revolution: a game plan which has been unfolding again in our own time over the past several decades via the so-called “colour revolutions” and “Arab Spring”, at the behest of the same types of people who instigated the “Russian” revolutions in 1917, and for the same reason, and prior to that the Cromwellian revolution and the French Revolution. (I would also add the “revolution from above” wrought by Henry VIII, which prominently involved another scabrous Cromwell).
Goodson states that after the defeat of Napoleon, Nathan Mayer Rothschild was active in pushing for a banking system that would secure the control of Europe. Czar Alexander I rejected any such plans and instead created a new Holy Alliance between Russia, Prussia, and Austria, who were to be pushed into cataclysmic conflict a few generations later. What was created in 1860 was a Russian state bank that served the people well for decades, with cheap loans, including low interest land loans for farmers, by the turn of the century most land being owned by the people who worked it. Taxes and debt were the lowest in Europe, and social and labour legislation among the best.
Goodson points out that the Bolsheviks brought this happy state to destruction. The details of this and the welcome international finance accorded the March 1917 Revolution, and bankers likewise supporting the Bolsheviks are documented in this reviewer’s books Revolution from Above[12] and The Banking Swindle. I will add here that much of the negative portrayal of the Czars, which continues to the present, was the result of American journalist George Kennan’s one-man propaganda offensive against Russia, Kennan being subsidised by Jacob Schiff of Kuhn, Loeb & Co., who also provided the wherewithal for Kennan to indoctrinate – according to Kennan – 52,000 Russian Prisoners of War in the aftermath of the Russo-Japanese War of 1904-1905, who returned to Russia to provide a revolutionary cadre that eventually overthrew the Czar.[13]
Inside the South African Reserve Bank: Its Origins and Secrets Exposed, features Goodson’s account of the way he was forced to resign prematurely before his term expired – albeit by only a short time – as a director of the South African Reserve Bank. Goodson, has an insider’s knowledge on the workings of debt-finance and reserve banks, and he is also the leader of the Abolition of Income Tax and Usury Party,[14] and has long been an economic consultant. It is this book that has apparently been the subject of threatened legal action from the South African state, which is very much interested in keeping Goodson mute as to his first-hand knowledge of corruption in the financial sector.
Goodson shows that South Africa was the first state after World War I to succumb to machinations in the creation of a central bank. This he places on the shoulders of General Smuts, Minister of Finance despite his lack of background in finance.[15] Like Senator Aldrich, whose so-called “Aldrich Plan” was enacted in 1913 to create the US Reserve Bank in 1914, Aldrich merely being the voice in Senate for Schiff, the Warburgs, Rockefellers, J. P. Morgan et al., the Smuts plan for a reserve bank was initiated and devised by his friend, the banker Sir Henry Strakosch, whose plan followed that of the US Federal Reserve Bank. The commission that was established from all Parliamentary parties provided strong criticism of the plan and expressed concern as to why it was being (like the “Aldrich Plan”) rushed through without proper debate. Colonel Creswell of the SA Labour Party proposed a state bank. The Parliamentary opposition to the Strakosch plan, and call for a state bank by the Labour Party, is of particular interest, and Goodson provides detail of the Parliamentary speeches.[16] In 1920 Parliament voted in favor of the Strakosch plan, while all 19 Labour members and three Nationalist members voting against. General Hertzog of the National Party had wanted the matter fully investigated over the course of two years, but was brushed aside. Strakosch was also instrumental in establishing the Reserve Bank of India in 1935. His role seems similar to that of Sir Otto Niemeyer of the Bank of England who at that time went about the British Commonwealth pushing for central banks to be created with private stockholders.
Furthermore, Strakosch paid the debts of Winston Churchill and from that moment the history of the world would embark on a tragic course: a world war in the service of international finance that would destroy the British and all other European empires, to be replaced by a money empire, while Roosevelt laid down the post-war conditions to the hapless Churchill for the dismantling of the British Empire.[17]
Goodson traces the origins of the Great Depression as an example of credit manipulation, and profiles those who sought an alternative: C. H. Douglas of social credit. Professor Irving Fisher. and Gottfried Feder, Germany’s primary banking reformer campaigner.[18] The innovative reforms undertaken by the Nazis were undermined by Hjalmar Schacht, president of the Reichsbank, an intimate of the international banking fraternity who was to be spared the fate of other high state officials at Nuremberg due to his connections, including particularly his friendship with Montague Norman, Governor of the Bank of England.
In 1939 Schacht issued an ultimatum to Hitler intended to revert Germany’s economy back to the old system, and was sacked. While the Hitler regime has been criticized for sidelining idealists such as Feder and even of serving international finance and not fully implementing its “socialistic” program, in fact, much was undertaken, and Goodson alludes to the “Schacht Plan” being replaced finally and decisively by the “Feder Plan” in 1939. Goodson contends that war was imposed on Hitler for the same reason as that faced by Napoleon, with Poland in this case as the bankers’ cat’s-paw. In one of many instances where Goodson places the banking system in the wider historical context, he relates what would now be called “ethnic cleansing” that was undertaken by the Polish authorities against ethnic Germans in Poland. Goodson places the German ethnic causalities in Poland at 58,000, culminating in the Bromberg Massacre of September 1939, in which 5,500 German ethnics were killed. Hitler’s peace plan was summarily rejected by the Polish Government due to the interference of Britain in guaranteeing Poland’s security.
Goodson proceeds to outline the many socio-economic achievements of the Hitler regime, such a low-interest loans for housing and the barter system that saw Germany capturing markets from Europe to South America, and undermining the system of international finance around the world, the rise in income, the great public works while, persistent claims to the contrary, expenditure on arms was relatively low.
While Germany flourished in the midst of a world depression, Fascist Italy had already embarked on a similar course a decade previously, with giant public works, and gradually adopted state banking. Japan, which readers might be surprised to learn, had since the 1920s had been widely attracted to the social credit theory of C. H. Douglas, followed such policies from 1932, and completed its reforms in 1942, based on German banking legislation. This established Japan as a great economic power and in 1940 she announced the Grater East Asia Co-Prosperity Sphere, which threatened the global economic system by creating an autarkic trading bloc. The pretext for action against Japan, Goodson states, started with her peaceful occupation of French Indo-China with the permission of France, to disrupt the supply routes of China. Economic sanctions from England, Holland and the USA followed. Japan’s repeated attempts at diplomacy and compromise were consistently rebuffed by the USA, culminating in an ultimatum from the USA for Japan’s withdrawal from China, followed by an economic blockade. With the US occupation of Japan, the banking system and corporate structure were demolished under the auspices of an American banker.
Towards the end of the war, however, South Africa was attempting to adopt a banking system similar to that of the Axis states, and some Commonwealth states, namely New Zealand and Australia’s, and a Bill was introduced by Hofmeyr, Minister of Finance, but like the latter countries also, this central bank has failed to embark on a course of state credit creation. It was the South African Labour Party that consistently demanded a state bank that would issue state credit. Indeed, the quotes cited by Goodson of the speeches made by Labour Party members in Parliament on credit creation are, like those of New Zealand Labour stalwart John A. Lee, very instructive.
Goodson then proceeds with an explanation of the New Zealand banking system of the time that was given by the South African advocates of state credit. However, I must add that the South African Labour Party belief that New Zealand’s Finance Minister, Walter Nash, was “one of the strongest advocates of the state banking system,” is an error. Nash was one of John A. Lee’s bitterest opponents in the latter’s efforts to keep the Labour Party to its 1934 election promises, which ultimately resulted in Lee’s expulsion from the party.[19]
After referring to the Australian banking system, South African Labour’s Senator Smith proceeded to describe in similar terms the National Socialist banking system seeing it correctly as analogous, although on a much grander scale, with those of New Zealand. Smith, pointing out that he was not a supporter of Hitler, nonetheless stated that things can be learned from others, including Hitler. This is sufficient today to destroy anyone’s reputation, at a time when scholarship and objectivity are regarded as heretical per se;[20] and we can say that Goodson himself is a present example of this.
Goodson proceeds with his own saga as a director on the SA Reserve Bank Board. In 2002 he attempted to show that the bank was a private entity, not a state institution. In 2003, with 71.1% of the vote of shareholders, Goodson was voted in as a non-executive director. The Board made no secret of its concern at the election of Goodson, who attempted to educate Board members on the nature of fractional reserve banking. The following year a covert campaign by the deputy governor of the Board, Gill Marcus, an ANC stalwart, to unseat the Governor, was noticed by Goodson, and Marcus was unceremoniously told to leave, only to return in 2009 as the state’s appointed new Governor. One of her new measures was to limit the term of non-executives directors, and these were asked to resign prior to the end of their terms. Amidst Goodson’s attempts in 2011 to have corruption and incompetence in the SA Bank Note Company and the SA Mint dealt with, the attitude of Marcus became increasingly antagonistic towards him. In February 2012 the Board moved against Goodson to have him silenced, and he was suspended. In tandem with these measures, Goodson was smeared by the Mail and Guardian the following month.[21] Goodson had made some heretical remarks about Germany in a radio interview with Deanna Spingola in 2011, which were used as a pretext to launch the campaign against him. Goodson provides a substantial list as to why he has adopted a skeptical approach in regard to the “Holocaust,” since the smears against Goodson focus on his “Holocaust” skepticism. Goodson was also damned for having appraised the financial policies of the Hitler regime, and cites luminaries of the day who had done likewise, quoting David Lloyd George, Winston Churchill, H.R.H. the Duke of Windsor, and economist J. K. Galbraith.
Goodson was called into a meeting in May 2012 to resolve his status, and a compensation agreement emerged that ended his position just a few months prior to the end of his term. He was expected no remain mute on the measures that had been taken against him by the Bank, but regards the exposure of financial malfeasance as being in the public inertest and as not being part of any undertaking.
Goodson concludes with an extended discussion on how the banking problems might be solved, citing a comprehensive report that he had submitted to Marcus Gill, who had not understood any of it, and who had forwarded it to an economist for review, who likewise knew nothing of the subject, as related in the ensuing discussion he had with Goodson. Hence the situation is brought up to the present, and Goodson explains the current global debt plight, including a lengthy and unexpected discussion on the adverse manner by which fertility rates are affected. This includes demographic impacts on the white countries, and on Japan and China (in the example of China, I must say: “here’s hoping”). He concludes with examples of community and state banking (North Dakota, Guernsey, Libya), ending with details on how South Africa’s banking system could be reorganized, along with appendices of draft Bills on the mechanics of banking reform.
Notes
1. “The Private Life of Stephen Goodson,” Money Web, August 31, 2003, http://www.moneyweb.co.za/moneyweb-historical-news-news/the-private-life-of-stephen-goodson?sn=Daily%20news%20detail [5]
The story seems balanced and provides an interesting profile.
2. For both Pound and Hamsun see: K. R. Bolton, Artists of the Right (San Francisco: Counter-Currents, 2012). Also: Stephen M. Goodson, “Knut Hamsun: The Soul of Norway,” Inconvenient History, Vol. 5, No. 2, http://inconvenienthistory.com/archive/2013/volume_5/number_2/knut_hamsun.php [6]
3. Brooks Adams, The Law of Civilization and Decay (London: MacMillan, 1896).
4. “Traditional societies,” whether of the Hindu, Muslim, or Christian varieties, etc., place commerce very low down on the pyramid of hierarchy, whereas what a Traditionalist would call a cycle of decay – such as the era of today’s “West” places the merchant at the top of an inverted hierarchy. See: Julius Evola, Revolt Against the Modern World, trans. Guido Stucco (Rochester, Vermont: Inner Traditions International, 1995), and Oswald Spengler on the rise of “money” in the decadent cycle of a civilisation in The Decline of The West (London: George Allen and Unwin, 1971), in particular Vol. II, Chapter XIII.
5. Russell Norman, Member of Parliament, and leader of the New Zealand Green Party, was recently roundly condemned and ridiculed for suggesting the use of “fiat money,” but did not have the knowledge or the fortitude to defend his position and was quickly silenced on the only sensible suggestion that has been offered in New Zealand since the 1930s Labour Government successfully issued state credit for housing.
6. M. J. Savage, iconic leader of the First New Zealand Labour Government.
7. For an alternative Rightist view on the role of money in the collapse of civilizations see: K. R. Bolton, “Oswald Spengler and Brooks Adams: The Economics of Cultural Decline,” in Troy Southgate, ed., Spengler: Thoughts and Perspectives, Vol. Ten (London: Black Front Press, 2012), 179–21.
8. William Cobbett, History of the Protestant Reformation in England and Ireland, 1826.
9. For the influence of Amsterdam Jews and Puritans on the Bank of England see: K R Bolton, The Banking Swindle (London: Black House Publications, 2013), 21–22.
10. On the Left-Right dichotomy and how it has been misunderstood, see: K R Bolton, “Reclaiming the ‘Right’: Origins of the Left Wing – Right Wing Dichotomy,” Ab Aeterno, Academy of Social & Political Research, Wellington, New Zealand, No. 16, July-September 2013.
11. K. R. Bolton, The Banking Swindle, 96–100.
12.K. R. Bolton, Revolution from Above (London: Arktos, 2011), 57–65.
13. K. R. Bolton, The Banking Swindle, op., cit., 145–47.
14. Abolition of Income Tax and Usury Party http://www.aitup.org.za/
15. Perhaps analogous to one recent Labour Government Minister of Finance, Dr Michael Cullen, whose academic specialty was history, and who, on enquiry from a member of the New Zealand Social Credit Institute, stated that credit is created from bank depositors’ savings accounts.
16. Goodson, Inside the Reserve Bank, 71-73.
17. See: K. R. Bolton, “The Geopolitics of White Dispossession,” Richard B. Spencer editor, Radix (Washington Summit Publishers), Vol. 1, 2012, 105–30. Also: K. R. Bolton, Babel Inc. (London: Black House Publishing, 2013), “Decolonization as the Prelude to Globalization.”
18. See: Gottfried Feder, Manifesto for the Breaking of the Financial Slavery of Interest (Surrey: Historical Review Press, 2013 [1919]) translated by Dr. Alexander Jacob. Also: G. Feder, The German State on a National and Socialist Foundation (Historical Review Press, 2013 [1932]), translated by Jacob. Feder would presumably receive more attention today among banking reformers had it not been for his influence on Nazi economics (as might the poet Ezra Pound, author of a series of incisive booklets on banking, had it not been for his support for Fascism).
19. Erik Olssen, John A. Lee (Dunedin, New Zealand: Otago University Press, 1977), passim.
20. K. R. Bolton, “Reductio ad Hitlerum as a Social Evil,” Inconvenient History, Vol. 15, No. 2, http://inconvenienthistory.com/archive/2013/volume_5/number_2/reductio_ad_hitlerum_as_a_social_evil.php [7]
21. Lisa Steyn, “Reserve Bank’s Holocaust Denier,” Mail and Guardian, April 13, 2012, http://mg.co.za/article/2012-04-13-reserve-banks-holocaust-denier [8]
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2014/11/central-banking-and-human-bondage/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/11/historyofcentralbanking.jpg
[2] A History of Central Banking and the Enslavement of Mankind: http://www.amazon.com/gp/product/0992736536/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0992736536&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=VJIEPMMQ26CPE523
[3] Inside the South African Reserve Bank: Its Origins and Secrets Exposed: http://www.amazon.com/gp/product/0992736587/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0992736587&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=E3MZ6PHINX5JZQEG
[4] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/11/Goodson.jpg
[5] http://www.moneyweb.co.za/moneyweb-historical-news-news/the-private-life-of-stephen-goodson?sn=Daily%20news%20detail: http://www.moneyweb.co.za/moneyweb-historical-news-news/the-private-life-of-stephen-goodson?sn=Daily%20news%20detail
[6] http://inconvenienthistory.com/archive/2013/volume_5/number_2/knut_hamsun.php: http://inconvenienthistory.com/archive/2013/volume_5/number_2/knut_hamsun.php
[7] http://inconvenienthistory.com/archive/2013/volume_5/number_2/reductio_ad_hitlerum_as_a_social_evil.php: http://inconvenienthistory.com/archive/2013/volume_5/number_2/reductio_ad_hitlerum_as_a_social_evil.php
[8] http://mg.co.za/article/2012-04-13-reserve-banks-holocaust-denier: http://mg.co.za/article/2012-04-13-reserve-banks-holocaust-denier
00:05 Publié dans Economie, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, banque, finances, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 07 novembre 2014
De la Servitude universelle...
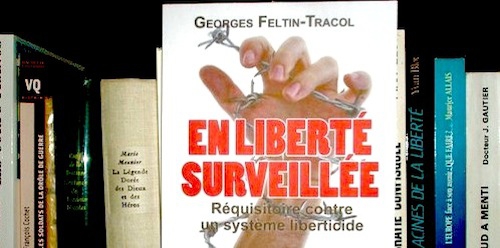
De la Servitude universelle...
Claude Bourrinet
Ex: http://synthesenationale.hautetfort.com
L'émergence, dans la France chloroformée par des lustres d'endoctrinement, de discours émollients, et de délires idéologiques, d'un mouvement contestataire protéiforme, qui se décline par des manifestations impressionnantes, des opérations spectaculaires de dénonciation, des actes de résistance, a encouragé la prise de parole de Français, longtemps tenus de se taire et de souffrir en silence. 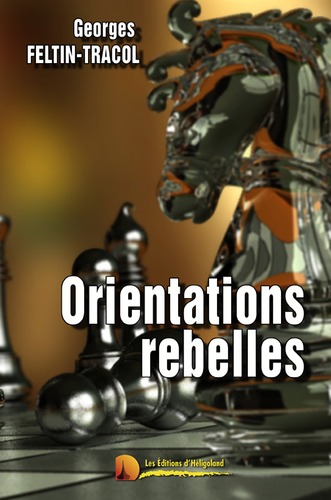 George Feltin-Tracol est l'un de ceux-là. Il nous propose régulièrement des analyses pertinentes sur notre monde, passe au peigne fin, si l'on ose dire, la question du contrôle de la société par les puissances étatiques, financières, médiatiques, dont l'objectif est d'instaurer un État mondial de tonalité totalitaire. Son ouvrage, En Liberté surveillée, remarquablement documenté, se veut, en même temps, une chronique des prémisses d'une « mise au pas » de la société française par un régime qui n'a plus aucune espèce d'inhibition « démocratique ». Les résistances multiformes, que tout le monde a en mémoire, et qui témoignent de la richesse plurielle (terme adéquat, cette fois!) de la lutte populaire, par exemple les manifestations contre les spectacles blasphématoires « Piss Christ », « Golgota picnic », l'affaire de Tarnac, le « cas » Dieudonné, la « Manif pour tous », ont pour réponses les emprisonnements politiques, la censure, la brutale répression policière, les manipulations. La sphère politique est empoisonnée par l'idéologie nihiliste, les « nouvelles sacralités », qui suscitent des « phobies », lesquelles arment le bras de la « Justice », sans compter la vidéo-survillance, qui contrôle les routes et les rues, la novlangue, qui formate les consciences, l'endoctrinement scolaire, le néo-puritanisme, expression extrême de la clitocratie triomphante, dont l’égérie est la Suède, matrice du totalitarisme postmoderne dévirilisant, infantilisant, Grande Nursery dont Big Mother est la maquerelle fouettarde. Ces liens tressés par des Lilliputiens doctrinaires, liens dont le plus puissant, en ce moment, est incarné par le communautarisme, pendant symétrique d'un individualisme consumériste, sont destinés à étouffer notre identité... Ainsi cette entreprise liberticide évoque-t-elle la mise en place d'un despotisme nouveau, plus complexe, plus subtil, plus savant que les anciennes tyrannies, qui n'étaient que des ateliers artisanaux à côté de lui.
George Feltin-Tracol est l'un de ceux-là. Il nous propose régulièrement des analyses pertinentes sur notre monde, passe au peigne fin, si l'on ose dire, la question du contrôle de la société par les puissances étatiques, financières, médiatiques, dont l'objectif est d'instaurer un État mondial de tonalité totalitaire. Son ouvrage, En Liberté surveillée, remarquablement documenté, se veut, en même temps, une chronique des prémisses d'une « mise au pas » de la société française par un régime qui n'a plus aucune espèce d'inhibition « démocratique ». Les résistances multiformes, que tout le monde a en mémoire, et qui témoignent de la richesse plurielle (terme adéquat, cette fois!) de la lutte populaire, par exemple les manifestations contre les spectacles blasphématoires « Piss Christ », « Golgota picnic », l'affaire de Tarnac, le « cas » Dieudonné, la « Manif pour tous », ont pour réponses les emprisonnements politiques, la censure, la brutale répression policière, les manipulations. La sphère politique est empoisonnée par l'idéologie nihiliste, les « nouvelles sacralités », qui suscitent des « phobies », lesquelles arment le bras de la « Justice », sans compter la vidéo-survillance, qui contrôle les routes et les rues, la novlangue, qui formate les consciences, l'endoctrinement scolaire, le néo-puritanisme, expression extrême de la clitocratie triomphante, dont l’égérie est la Suède, matrice du totalitarisme postmoderne dévirilisant, infantilisant, Grande Nursery dont Big Mother est la maquerelle fouettarde. Ces liens tressés par des Lilliputiens doctrinaires, liens dont le plus puissant, en ce moment, est incarné par le communautarisme, pendant symétrique d'un individualisme consumériste, sont destinés à étouffer notre identité... Ainsi cette entreprise liberticide évoque-t-elle la mise en place d'un despotisme nouveau, plus complexe, plus subtil, plus savant que les anciennes tyrannies, qui n'étaient que des ateliers artisanaux à côté de lui.
L'analyse ne se limite pas à une recension de notre servitude organisée, mais aussi à ses causes. La description de l' « État profond » est d'un intérêt capital : il s'agit en effet d'une « structure de gouvernement à la fois invisible et continue », qui gère réellement la société, tandis que les institutions apparentes, souvent élues, « représentatives », ne sont là que pour exécuter, ou amuser la galerie.
George Feltrin-Tracol, En liberté surveillée Réquisitoire contre un système liberticide, Éditions Les Bouquins de Synthèse nationale, 23€ - cliquez ici
00:05 Publié dans Livre, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges feltin-tracol, livre, nouvelle droite, liberté surveillée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 05 novembre 2014
EU-Staaten als Vasallen
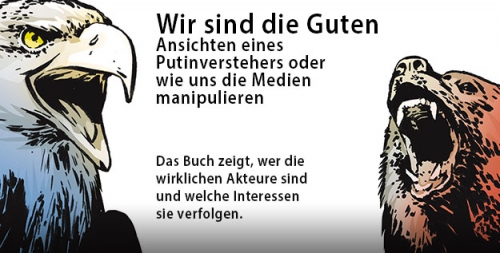
„Die Sanktionen gegen Russland dienen ausschließlich den US-Interessen“
Die US-Regierung hat die berechtigten Proteste der ukrainischen Bevölkerung gegen ihre korrupte Regierung verwendet, um einen gewalttätigen Regime-Wechsel in Kiew herbeizuführen. Die CIA operiert weltweit im Interesse der Wall Street, die Regierung in Washington ist offenbar längst nicht mehr Herr der Lage der Machtstrukturen im eigenen Land. Es ist völlig unverständlich, warum sich die EU und die Bundesregierung dem globalen Diktat der USA unterwerfen.
Mathias Bröckers und Paul Schreyer haben ein äußerst lesenswertes Buch geschrieben: „Wir sind die Guten. Ansichten eines Putinverstehers oder wie uns die Medien manipulieren“. In diesem Buch analysieren die beiden die Entwicklung in der Ukraine und erklären die Vorgänge als Teil einer globalen US-Strategie, Zugriff auf wichtige Rohstoffmärkte zu erhalten. Wladimir Putin ist den Amerikanern ein Dorn im Auge, weil er sich dem Einfluss der multinationalen Konzerne in Russland widersetzt. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten haben mit Mathias Bröckers gesprochen.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: In Ihrem Buch schreiben Sie, dass nicht die diskriminierenden homophoben Gesetze den Westen auf den Plan gerufen haben, sondern handfeste wirtschaftliche Interessen. Warum ist Putin dem Westen ein Dorn im Auge?
Mathias Bröckers: Unter Jelzin hatten die anglo-amerikanischen Konzerne Verträge über die Öl- und Gas-Exploration gemacht, die ihnen über Jahrzehnte sämtliche Profite und keinen Cent für die russische Staatskasse einbrachten. Dass Putin diese Ausbeutung stoppte und die russischen Ressourcen wieder unter nationale Kontrolle brachte, ist der eigentliche Grund, warum er im Westen zur Unperson wurde.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Sie schreiben, dass die USA und die CIA die „orangene Revolution“ vom Zaun gebrochen haben. Wie muss man sich das vorstellen?
Mathias Bröckers: Die USA haben nach Aussage ihrer Chefdiplomatin Nuland fünf Milliarden Dollar in die „Demokratieförderung“ der Ukraine investiert. Damit wurden regierungskritische Institutionen, NGOs und Medien gefördert – doch die absolut berechtigten Proteste der Bevölkerung gegen ihre korrupte Regierung wurden dabei nur als Trittbrett genutzt, um die Eliten auszuwechseln und eher amerikafreundliche Oligarchen ans Ruder zu bringen. Weder der Oligarchenwechsel 2004 noch der zehn Jahre später haben zu irgendeiner „Demokratisierung“ geführt.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Präsident Janukowitsch wurde, so schreiben Sie, „mit Unterstützung des Westens…weggeputscht“. Die Killer vom Maidan seien nicht von der damaligen ukrainischen Regierung oder von Russland angeheuert worden. Wer steckt hinter der Eskalation auf dem Maidan?
Mathias Bröckers: Dass der Massenmord auf dem Maidan bis heute nicht untersucht und aufgeklärt ist, spricht Bände. Diese Morde waren der Auslöser für die gewaltsame Vertreibung Janukowitschs, dessen Polizei sich wochenlang weitgehend defensiv verhalten und die Regierungsgebäude gegen die Demonstranten geschützt hatte. Weder er, noch die EU-Minister, mit denen er gerade einen Vertrag über seinen Rücktritt und Neuwahlen ausgearbeitet hatte, konnten irgendein Interesse an einer solchen Eskalation haben. Deshalb kann der unbekannte Auftraggeber der Scharfschützen nur aus Kreisen kommen, die keinen friedlichen Übergang, sondern eine Zuspitzung des Konflikts beabsichtigten.
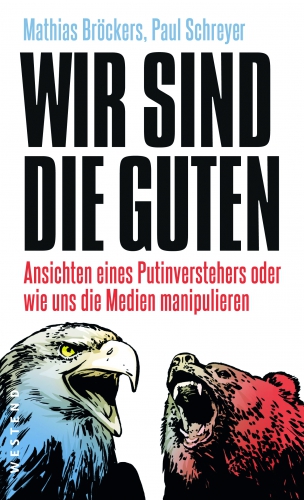 Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Sie schreiben, dass hinter der „Organisation dieses Bürgerkriegs“ auch private Truppen des US-Militärkonzerns Academi, vormals Blackwater, stecken. Welche Belege gibt es für deren Aktivitäten?
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Sie schreiben, dass hinter der „Organisation dieses Bürgerkriegs“ auch private Truppen des US-Militärkonzerns Academi, vormals Blackwater, stecken. Welche Belege gibt es für deren Aktivitäten?
Mathias Bröckers: Verschiedene große Medien haben darüber berichtet, die Firma selbst hat es dementiert, was aber nicht weiter überrascht. Berater der CIA und des FBI sind seit längerem in Kiew aktiv und der Einsatz solcher Söldner für die schmutzigen Jobs, ohne die „Regime Changes“ meist nicht zu bewerkstelligen sind, gehört zum üblichen Modus Operandi. Gäbe es nur den Hauch eines Beweises, dass Russland oder Janukowitsch für diese Morde verantwortlich waren, wäre er uns längst im Breitbandformat vorgeführt worden. Da das nicht geschehen ist, fällt der Verdacht eher auf die CIA, die auch dafür sorgte, dass einige Militante des „rechten Sektors“ in polnischen Lagern ausgebildet wurden.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Hat der deutsche Außenminister davon nicht das Geringste gewusst? War er ahnungslos, eine Marionette? Wie weit war die deutsche Bundesregierung oder der BND in den „Putsch“ involviert?
Mathias Bröckers: In dem geleakten „Fuck the EU“-Telefonat hatte Frau Nuland die von den USA vorgesehenen Marionetten der Regierung Jazenjuk ja schon benannt. Der von der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung geförderte Boxer Klitschko war da nur zweite Garnitur. Als neuer Bürgermeister von Kiew hat er gerade die letzten echten Demonstranten, die mehr als einen Oligarchenwechsel verlangen, vom Maidan entfernen lassen. Wenn der BND da involviert war, dann allenfalls im Windschatten der US-Geheimdienste. Ob die deutsche Regierung im Hintergrund Politik im Interesse ihrer Bevölkerung treibt, oder nur als Vasall der US-Politik agiert, ist schwer zu sagen. Die schwachsinnige Sanktionspolitik, mit der sich Deutschland und die EU ins eigene Knie schießen, folgt jedenfalls ausschließlich US-Interessen.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Sie schildern ausführlich, warum Putin ausdrücklich nicht die Wiederherstellung der UdSSR will. Kann man Putin trauen – immerhin ist er ein ausgebildeter KGB-Mann…
Mathias Bröckers: Russland ist das größte Flächenland der Erde und verfügt über ein Drittel aller bekannten Ressourcen (Öl, Gas, Mineralien). Wer so groß und so reich ist, muss keine Kolonien erobern. Weder die marode Ostukraine, noch die wirtschaftlich unbedeutende Krim. Über den strategisch unverzichtbaren Marinestützpunkt dort hatte Putin mit Janukowitsch den Pachtvertrag gerade über 30 Jahre verlängert – bei einem friedlichen Regierungsübergang in Kiew wäre ein Referendum und der Anschluss an Russland völlig unnötig gewesen. Als aber die rechten Milizen nach dem Putsch zum „Marsch auf die Krim“ aufriefen, musste Putin handeln. Dass ein feindliches Militärbündnis den wichtigsten Seehafen unter Kontrolle nimmt, kann keine Regierung der Welt dulden.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Warum ist Russland eine Weltmacht – und warum fürchten die Amerikaner, den Einfluss zu verlieren?
Mathias Bröckers: Amerika ist die militärische Supermacht und Russland ist der Rohstoffriese der Welt. Wer über ein Drittel aller Rohstoffe verfügt und wie Russland unter Putin in der Lage ist, sie selbst zu fördern und zu vermarkten, ist automatisch ein Player im Great Game. Und wer, wie die USA, die globale „Full Spectrum Dominance“ will, muss einen solchen Player unter Kontrolle bringen.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Kann es sein, dass die Amerikaner im Grunde wissen, dass mit Russland (Rohstoffe) und China (Wirtschaftsmacht) eine multipolare Welt nicht verhindert werden kann?
Mathias Bröckers: „Nur weil wir den größten Hammer haben verwandelt sich nicht jedes Problem in einen Nagel“ hat Obama neulich gesagt, was eine gewisse Einsicht anzudeuten scheint. Russland ist mit den BRICS-Staaten gerade dabei, sich vom Petrodollar abzukoppeln, sie gründen ihre eigenen Rating-Agenturen und eine Entwicklungsbank als Alternative zum IWF. Diese Entwicklung lässt sich einfach nicht verhindern.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Welche Rolle spielt die CIA in der Ukraine? Agiert sie im Auftrag der Regierung oder haben sich die Geheimdienstler verselbständigt – eine Argumentation, die wir ja im Zuge der NSA-Debatte auch schon gehört haben?
Mathias Bröckers: Die CIA hat schon immer in erster Linie für die Wall Street agiert und nicht für die Regierung. Das Konzept der „Peacetime Operations“, der verdeckten Operationen für Regimewechsel, das der „Vater“ der CIA, Allen Dulles – ein Wall Street Anwalt – entwickelte, diente stets den Geschäfts- und Konzerninteressen. Und so ist es auch jetzt wieder: Als erste Amtshandlung nach dem Putsch wurde der Sohn von Außenminister Biden als Vorstand der größten ukrainischen Gasgesellschaft installiert.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Sie schreiben, dass die Amerikaner „ihre imperiale Ambition hinter ökonomischer Effizienz“ verstecken. Haben die USA immer noch den Anspruch einer Weltherrschaft?
Mathias Bröckers: Wenn man den aktuellen Doktrinen des Pentagon folgt, durchaus – nur werden jetzt verstärkt „multilaterale“ Anstrengungen gefordert, weil der Spaß zu teuer wird und die USA maßlos überschuldet sind. Deshalb kommt jetzt zum Beispiel die Forderung auf, dass sich die Bundeswehr am Kampf gegen ISIS im Irak beteiligt. Selbst in ihrer eigenen Kolonie – und nichts anderes ist der Irak nach dem US-Überfall – will die einzige Weltmacht nicht mehr für Ordnung sorgen und andere dafür einspannen.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Sie legen in Ihrem Buch sehr umfassend dar, dass die Berichterstattung in den deutschen Medien von teilweise krasser Einseitigkeit gegen Russland getragen ist. Wir tun uns schwer mit der Vorstellung, dass dies auf eine direkte Manipulation „von oben“ zurückzuführen ist. Wie viel ist Gedankenlosigkeit, Unkenntnis – und wie viel wird gezielt manipuliert?
Mathias Bröckers: Da muss „von oben“ gar nicht viel kommen, der Herdentrieb funktioniert auch so. Was aus dem Ticker kommt, wird verbraten. Da macht zwei Tage die „russische Invasion“ weltweit Schlagzeilen – und dann meldet die Tagesschau kleinlaut auf ihrem Twitter-Account, dass es sich bei „Invasion“ um einen Übersetzungsfehler der Agentur Reuters gehandelt hätte.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Warum sind die öffentlich-rechtlichen Sender nicht besser? Gibt es eine Kommunikation zwischen den Eigentümervertretern (Politik) und den Chefredaktionen? Oder ist der Großteil nicht eher „vorauseilender Gehorsam“?
Mathias Bröckers: Eher letzteres. Wobei die Besetzung von Chefredaktionen und Ressortleitungen natürlich parteibuchmäßig läuft und freie Geister wenn überhaupt eher nur in den unteren Etagen zu finden sind.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Auch Putin setzt gewaltig auf Propaganda, in Russland wie auch im Westen. In Russland gibt es so gut wie keine freie Presse mehr. Viele „Putin-Versteher“ im Westen sind außerdem im Kern Verschwörungstheoretiker und haben zum Teil eine paranoide, selektive Wahrnehmung. Wie kann der Leser heute noch erkennen, wem er glauben kann?
Mathias Bröckers: „Putinversteher“ sind in meinen Augen eher Leute, die ihre Vernunft noch nicht an der Garderobe abgegeben haben, sondern die die Motive und Absichten des anderen analysieren. Verstehen heißt ja nicht verehren. Paranoide Verschwörungs-Theoretiker sind doch eher diejenigen, die permanent einen neuen Super-Bösen bezichtigen – wie etwa der Nato-Sprecher Rasmussen. Der hatte schon 2003 gesagt: „Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Das glauben wir nicht, das wissen wir.“ Und genauso weiß er auch jetzt wieder alles – wer diesem Herrn glaubt, ist nicht zu retten.
***
Was geht Deutschland die Ukraine an? Und wie kommt es, dass ein gescheitertes Abkommen mit der EU zu einer der gefährlichsten Krisen geführt hat, die Europa in den vergangenen Jahrzehnten erlebte? Alles Putins Schuld? Oder ist die Wahrheit hinter diesem Konflikt, der nun den Frieden eines ganzen Kontinents bedroht, doch komplexer? Und welche Rolle spielen eigentlich die Medien? Sind sie noch unabhängige Berichterstatter oder längst selbst zur Partei geworden? Mathias Bröckers und Paul Schreyer schauen hinter die Kulissen eines politischen Spiels, das tödlicher Ernst geworden ist.
Der Spiegel-Bestseller „Wir sind die Guten. Ansichten eines Putinverstehers oder wie uns die Medien manipulieren“ ist unter der ISBN 978-3-86489-080-2 im Buchhandel, direkt beim Verlag oder bei Amazon bei Amazon erhältlich (208 Seiten, 16,99 Euro).

Mathias Bröckers ist freier Journalist, der unter anderem für die taz und Telepolis schreibt. Er wurde 1954 in Limburg an der Lahn geboren. Ab 1973 studierte er an der FU Berlin Literaturwissenschaft, Linguistik und Politikwissenschaft (M.A.) Er gehörte zur Gründergeneration der taz und war dort bis 1991 Kultur- und Wissenschaftsredakteur. Danach war er für die Zeit und die Woche als Kolumnist sowie als Rundfunkautor tätig und fungierte als Mitglied der Sachbuch-Jury der Süddeutschen Zeitung. Neben Radiosendungen, Kabarettprogrammen und Beiträgen für Anthologien veröffentlichte Mathias Bröckers zahlreiche Bücher. Seine Werke “Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf” (1993) und “Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11.9.” (2002) wurden internationale Bestseller. (Foto: Bröckers)
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens, Géopolitique, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, entreiten, mathias bröckers, livre, politique internationale, russie, ukraine, europe, affaires européennes, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 04 novembre 2014
Kerry Bolton’s The Banking Swindle
Kerry Bolton’s The Banking Swindle
By Eugène Montsalvat
Ex: http://www.counter-currents.com
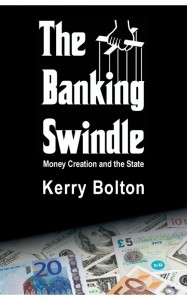 Kerry Bolton
Kerry Bolton
The Banking Swindle: Money Creation and the State [2]
Black House Publishing, 2013
Kerry Bolton’s The Banking Swindle is a great introduction to the economics of the true Right, which aligns itself against the forces of usury. The topic of economics is quite neglected in the discourse of the modern Right, especially in the Anglosphere. Concerns about race, immigration, multiculturalism, or historical revisionism consume far more ink than the question of money, however behind all of these issues lies money power. Indeed Bolton refers to its paramount importance:
No other policy of the Right, in whatever part of the world, is possible without the need to first secure the economic and financial sovereignty of the state, and this can only be achieved when the State or Crown assumes the prerogative over banking and credit creation. The bottom line is that no State- and hence people- are truly free while any decisions that are made can be undermined and wrecked by decisions made in the boardrooms of global corporations, by the fluctuations of the world stock market, and by the power of bankers to turn off the credit supply if a state pursues policies not in the interest of the plutocracy… All other issues, including the Right’s now usually be-all issue of race and immigration, are secondary, and no Rightist government could implement Rightist policies until the sovereignty of credit creation is achieved.
The system of interest finance allows bankers to create money out of nothing and loan it at interest, which must be repaid with real production. As Gottfried Feder and Dietrich Eckart stated in their pamphlet, To All Working People, “Interest has to come from somewhere after all, somewhere these billions and more billions have to be produced by hard labour! Who does this? You do it, nobody but you! That’s right, it is your money, hard earned through care and sorrow, which is as if magnetically drawn into the coffers of these insatiable people . . .” Thus entire nations can be bound by debt and their physical assets seized to pay off the creditors who created their debt. Hence we see nations like Greece enduring austerity regimes, where the services are cut and the nation’s assets sold, to ensure that the bondholders do not lose their money. Over and over again people are told to tighten their belts, cut spending, and do without, in order to keep the financial system afloat. Yet during the Great Depression, alternatives to this system were popular and were advocated by nationalist and anti-liberal movements. Bolton illuminates this forgotten chapter in economic history.
Before addressing the various alternatives to the debt finance system, Bolton briefly discusses its history. He notes that while usury dates back to Mesopotamian times, with Babylon’s loans of seed-corn, the modern system of international finance, based out of the city of London, yet loyal only to profit, emerged with the expansion of commerce Age of Exploration and the weakened position of the anti-usury Catholic Church following the Reformation. The victory of the mercantile forces of Oliver Cromwell over the agricultural, feudal interests of Charles I in the English Civil War paved the way for financial domination. Cromwell maintained good relations with Dutch, Sephardic Jewish, and Huguenot merchants, paving the way for London to become the major financial centre in Europe.
The so-called Glorious Revolution of 1688 sealed this result, with the Catholic King James II deposed and replaced with the Dutch Protestant William III, who had borrowed heavily from Amsterdam’s banks to fight his wars. Under William II the Bank of England was chartered, establishing a private bank with the purpose of lending the throne money at interest. From 1700 to 1815, the national debt of Britain grew from 12 million pounds to 850 million, funded by this bank.
The Rothschild family, originally from Frankfort and branching out to Paris, Naples, Vienna, and London, became involved in the English struggle against Napoleon under Nathan Rothschild, utilizing their international network to gather information. It is necessary to note that Napoleon’s economic system sought to achieve autarky and the Bank of France limited dividends and extended credit at low interest rates to aid manufacturers rather than leave them indebted. A victory for Napoleon would have meant a tremendous loss for the forces of finance. The victory of the British Empire and its global expansion allowed the Rothschild family to extend their influence.
Nathan’s grandson “Natty” Rothschild cultivated links with imperialist Cecil Rhodes. But Rothschild was not a British imperialist for the sake of Britain, indeed he extended loans to the anti-British Boer government in 1892, much to displeasure of Rhodes. Rothschild simply saw the British Empire as the safest means of supporting commerce. As colonial expansion slowed, they adopted an internationalist line, abandoning the antiquated Empire that now served as a barrier to free trade, forging links with New York and Tokyo following the Second World War.
In recent history, it was the events of the Great Depression awakened many to the flaws of the interest finance system. The Federal Reserve, the private bank that controls the United States’ money supply, called in the loans from its 12 regional branches, who in turn financed the various local banks of the country, at the end of this transaction the ordinary debtor was forced to pay or face foreclosure. In the midst of this crisis, farmers were ordered to destroy stockpiles of food that couldn’t be purchased for lack of funds, while people went hungry. Unlike today, the people and their political leaders did not blindly follow the solutions offered by the same people who caused the problem, rather they sought out alternatives to usury. The interrelated concepts of state credit and social credit found widespread popular support.
The idea of state credit pre-dates the concept of social credit, which was codified by Major C. H. Douglas in the 1920s and 1930s. In a state credit system, the state prints its own money and uses it to purchase goods and services or loans it to producers at zero or minimal interest, rather than borrowing money from creditors at interest and having the people of the state work to pay the interest on these outside loans.
One early example of state credit was seen in Quebec in 1685, when the colony failed to receive funding from the crown. The Intendant of the Province, Monsieur de Meulle, faced with the inability to pay his troops, and having no ability to borrow money nor a press to print it, simply collected playing cards, cut them up, and used them as currency in the place of outside funds. This action saved the French crown 13,000 livres. The cards acted as scrip: arbitrary objects such as paper or tokens that serve as legal tender.
Scrip was used on the British Isle of Guernsey in 1820, when the state could neither secure outside loans nor increase taxes to raise the funds need to maintain and improve the local infrastructure. To deal with the situation the state issued 6,000 pounds worth of State Notes, which were used to pay for needed improvements on the island. While the idea of a state printing its own money and using it to pay for goods and services directly is dismissed as “funny money,” the Isle of Guernsey subsequently prospered from the creation of debt free currency. The only difference between this alleged “funny money” and regular money was that it was not created at a usurious interest by a private bank.
In the turbulent years of the Weimar Republic, when hyperinflation effected the value of the Mark, the Wära, issued by the Wära Barter Company, was notable example of economically successful scrip. Following the Great Depression in 1929, the employees of Hebecker in the village of Schwanenkirchen were paid in Wära, which the villagers accepted as valid currency. The resulting success in Schwanenkirchen was described as miraculous in the press and eventually 2000 corporations accepted it until it was banned in 1931. In the Austrian town of Woergl a similar to the Wära was implemented, where the mayor’s Local Relief Commission issued stamps to serve as scrip, which paid for new public works programs, which dropped unemployment. The Woergl stamp scrip was outlawed in 1933.
In the English-speaking countries, the events of the Great Depression fuelled interest in alternatives to the debt finance system, particularly the Social Credit system of Canada’s Major C. H. Douglas. The basic premise of the system is that the amount of money in circulation is never equal to the amount needed to consume the whole of what is produced. This is demonstrated by the “A+B Theorem.” Let A be the amount a producer pays his employees, and let B be the amount a producer spends on outside payments. The minimum amount needed to sustain the producer is the sum, A+B, however only A has purchasing power. Thus B is really a shortfall of purchasing power. To address the shortfall in purchasing power, Douglas proposed a “National Dividend,” paid by the state to the people, issued not as debt to be repaid, but as the birthright of the citizen.
A prominent exponent of this idea was the American poet Ezra Pound, who saw Italian Fascism as a vehicle for Social Credit. In New Zealand the poet Rex Fairburn adopted the ideas of Social Credit as well. Douglas’ tour of New Zealand also inspired Campbell Begg’s New Zealand Legion, which at one timed amassed 20,000 members. In Great Britain, the Green Shirts, an organization descended from the Anglo-Saxon and Medieval inspired Kibbo Kift scouting movement, rallied the unemployed and hungry to the idea of Social Credit. In 1936, Green Shirts founder John Hargrave was appointed an advisor to a Social Credit government in Alberta, Canada. However, the central government foiled attempts at properly implementing the system. W. K. A. J. Chambers-Hunter supported Social Credit ideas in Oswald Mosley’s British Union of Fascists, under the premise that “British credit shall be used for British purposes.” In Canada, a Catholic organization called the Pilgrims of St. Michael, founded in 1935 by Louis Even and still extant, emphasized Social Credit as an alternative to the sinful usury based finance system.
Yet there was another Catholic crusader against usury that influenced the Pilgrims of St. Michael. In America, Canadian-born Father Charles Coughlin, the host of a popular Roman Catholic radio show for children, addressed their parents on broadcast on the issue of money, his well-received attack on usury lead to the creation of the Radio League of the Little Flower. By 1932 he had an audience of up to 45 million listeners. Originally a proponent of the New Deal, Coughlin broke with Roosevelt and created the National Union for Social Justice, which distributed his paper Social Justice. He demanded the abolition of private banking and returning the ability to print and regulate the money supply to Congress, in place of the Federal Reserve. However increasing opposition in the hierarchy of the Catholic Church and changes in radio regulations caused by the outbreak of World War II forced Coughlin to cease broadcasting in 1940 and in 1942 Social Justice was banned from the US mail.
While much of the popular outrage over the injustices of the debt-finance system died with World War II, it resulted in concrete political changes in several countries. Long before the Great Depression, the Australian Labour politician King O’Malley identified the banking system as the root of the common man’s misery stating, “The present banking system was founded on the idea that the many were created for the few to prey on. Debts are contracted for land, labour, products, and other commodities. When interest rises government bonds depreciate, holders sell to secure ready money to benefit by rise in interest. High rates of interest rapidly increase the indebtedness of the people.”
His proposed solution was the creation of a Commonwealth Bank that would serve as a national bank of the issue of currency without resorting to usury. Eventually, after much struggle, the Commonwealth Bank was instituted as a state-owned, but commercial bank, and it failed to issue state credit, however it’s first governor didn’t use private capital to fund the bank and was able to fund Australia’s government without imposing usurious interest upon the nation.
In the First World War, while other nations were paying 6% on their debt, the Commonwealth Bank only charged 1%, sparing Australia the ensuing economic turmoil. Until 1924, the Commonwealth Bank financed the construction of homes, roads, railways, and other forms of infrastructure at minimum charge, resulting in great prosperity. Yet in 1924, private interests took control of the governing directorate, and this came to an end.
Another political success in the Oceania was the New Zealand’s state housing program funded by the state credit from the Reserve Bank. This project reduced unemployment in the depths of the Great Depression. An initial 5 million pounds of state credit were issued, at minimal interest, without the backing of any other private financial institution. While the state housing project is widely lauded, the unorthodox method of its financing is barely commented upon in history books. The Banking Swindle does tremendous service to financial history by recounting the success of what is far too often dismissed as “funny money.”
The pivotal figure in the struggle for state credit in New Zealand was John A. Lee, a socialist influenced by the ideas of Social Credit, who outlined his vision in Money Power for the People. He stated, “that winning complete financial power as the first move toward a new social order,” realizing that state owned interests would be powerless if they depended upon private or foreign financing, which could be manipulated to produce detrimental effects on New Zealand’s people. This lesson has been lost upon many of the self-proclaimed socialist governments of the world, like Greece, whose socialist government borrowed millions from foreign investors only have austerity forced upon it by these usurers.
The principle of freedom from the chains of international finance appealed to the nationalists of the era as well, as noted by the BUF’s endorsement of “British Credit for British purposes.” One of the founding principles of the German Worker’s Party, which later become the National Socialist German Worker’s Party, was to break the bondage of interest. The primary economic mind behind them was Gottfried Feder, a founding member of the German Worker’s Party. Recognizing that interest gave money a power to reproduce itself at a cost to productive labour, Feder advocated the abolishment of income earned without physical or intellectual labour, a concept enshrined as the 11th point of the NSDAP. While the Marxists focused their ire on private property, Feder stated that “you never hear a word about, never a syllable, and there is nothing in the world which is such a curse on humanity! I mean loan capital!” Following the National Socialist assumption of power state credit was used to fund public works projects and the interest rates were limited by law. Hitler himself remarked:
All thoughts of gold reserves and foreign exchange fade before the industry and efficiency of well-planned national productive resources. We can smile today at an age when economists were seriously of the opinion that the value of currency was determined by the reserves of gold and foreign exchange lying in the vaults of the national banks and, above all, was guaranteed by them. Instead of that we have learned to realize that the value of a currency lies in a nation’s power of production, that an increasing volume of production sustains a currency, and could possibly raise its value, whereas a decreasing production must, sooner or later, lead to a compulsory devaluation.
In the realm of international trade, Germany directly bartered their surplus commodities for the commodities of other nations, avoiding the financial system’s commodity exchanges. Through a policy of economic self-sufficiency, above all avoiding the credit market’s snares, German was able to create full employment for its people. Henry C. K. Liu, a modern economist stated, “through an independent monetary policy of sovereign credit and a full-employment public works program, the Third Reich was able to turn a bankrupt Germany, stripped of overseas colonies it could exploit, into the strongest economy in Europe within four years, even before armament spending began . . . While this observation is not an endorsement for Nazi philosophy, the effectiveness of German economic policy in this period, some of which had been started during the last phase of the Weimar Republic, is undeniable.”
Furthermore, Germany’s Axis partners also pursued nationalist alternatives to the global financial system. In 1932 the Bank of Japan was reorganised as a state bank, issuing credit based solely on the needs of Japanese producers. From 1931–1941, Japanese industrial production rose 136% and the national income grew 241%. In Italy the state assumed control over the major banks through the Instituto Mobiliare Italiano in 1931. In 1936 Banking Law made the Bank of Italy the only bank for lending credit to other banks, removed limits on state borrowing, and removed Italy from the gold standard. Moreover it declared that the issuing of credit must serve the public. The Italian Social Republic took the ideas of profit sharing and worker co-management further during its short existence from 1943–1945, actively seeking to involve the common man in the control of industry with a program developed by former Communist Nicola Bombacci.
With the defeat of the Axis and the subsequent Cold War, Rightism, which had previously opposed liberalism in the economic as well as social spheres, became synonymous with Anglo-American free market policies, which played into the hands of debt finance. In regards to the origins of this supposed Capitalist versus Communist clash, Bolton also makes it clear that the Bolshevik revolution was welcomed by American financiers such as Jacob H. Schiff and John B. Young. Schiff himself financed The Friends of Russian Freedom, which spread revolutionary propaganda to Russian prisoners of war during the Russo-Japanese War.
The true reason for the financiers’ enmity against the Tsar was Russia’s refusal to cede sovereignty over its economy. The State Bank of the Russian Empire was under the control of the Ministry of Finance and it extended credit at minimal interest to Russian producers. Russia possessed large reserves of gold itself, so it had no need to borrow from the outside. For the most part the Tsarist economy was autarchic, beyond the grasp of international finance.
Against this false opposition between equally destructive ideologies of capitalism and communism, which have at their root atomized materialism, the real right stands for the superiority of spiritual values over profits. Bolton approvingly quotes Tsarist apologist George Knupffer, “We would feel certain that all of those who put the spirit above things material, duty above greed and love above hate and envy are in the camp of the Organic Right.” A fundamental premise of the economics of the true right must be the subordination of money to a higher cause, cultural good of a people. The people should not work to earn money to maintain their humdrum lives as cogs in the machinery of debt-finance, they should work for their greater glory. Communism and Capitalism are two sides of the same materialistic coin. As Spengler noted:
The concepts of Liberalism and Socialism are set in effective motion only by money. It was the Equites, the big-money party, which made Tiberius Gracchus’ popular movement possible at all; and as soon as that part of the reforms that were advantageous to themselves had been successfully legalized, they withdrew and the movement collapsed.
There is no proletarian, not even a communist, movement that has not operated in the interests of money, in the directions indicated by money, and for the time permitted by money — and that without the idealist amongst its leaders having the slightest suspicion of the fact.
Throughout the 19th and 20th centuries there were movements that fought both forms of materialism, as Bolton has chronicled in this book and others. While today’s Right devotes much time to issues of race and immigration, it is necessary to understand the economic origins of this increasingly rootless, atomized world we must fight. The Banking Swindle swerves as an excellent history of the movements that sought to break the bondage of interest and as primer on the true economics of the right. In this dark age of austerity, it illuminates a way forward for the nations under the heel of global finance, and one can only hope that it inspires the actions necessary for their liberation from these golden chains.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2014/10/kerry-boltons-the-banking-swindle/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/10/bankingswindle.jpg
[2] The Banking Swindle: Money Creation and the State: http://www.amazon.com/gp/product/1908476842/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=1908476842&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=5SQXNAMDU3B6GM3M
00:05 Publié dans Economie, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, banques, livre, kerry bolton |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 02 novembre 2014
Civilisation sensuelle: civilisation machinale

Civilisation sensuelle: civilisation machinale
par Michel Clouscard
Ex: http://www.diktacratie.com
Civilisation mondaine, civilisation sensuelle, de la fausse innocence, du potlatch de la plus-value : civilisation machinale.
Nous entendons par machinal la soumission à l’animation machinale. Une machination – une idéologie, une stratégie – récupère le machinisme. Le mal ne vient pas de la société industrielle en tant que telle, de la civilisation de la machine, mais de la perversion idéologique qui produit en série les animaux-machines.
Animation machinale : civilisation capitaliste. Elle témoigne d’un double complot : contre la machine et l’âme. Elle est récupération du progrès et corruption spirituelle. Et les deux sont en réciprocité. En une relation d’engendrement réciproque. La récupération du progrès est à l’origine de l’avilissement moral. De même que celui-ci peut se développer que par les moyens de la production capitaliste.
L’idéologie tendancieusement dominante – celle du libéralisme avancé qui vire à la social-démocratie libertaire a évidemment comme essentielle fonction de cacher cette structure de la civilisation capitaliste. Et même de l’inverser.Résumons ses thèses. Ce sont celles de l’ultime promotion de la civilisation capitaliste. Et formidable ironie de l’histoire, celles de l’opposition au système ! Celles de la nouvelle gauche (celle qui voudrait exclure le PC). Elles autoriseront aussi l’idéologie de la gestion de la crise.
Le progrès a trouvé ses limites : pollutions et nuisances. La machine a engendré la société technicienne. Celle-ci la technocratie (et son corollaire : la bureaucratie étatique). La soumission à cette situation permet l’accession à la société de consommation. Celle-ci est la récupération de la classe ouvrière, qui s’embourgeoise. Le système se clôt sur lui-même, sur le désespoir de l’honnête homme. Mais une opposition se développe, une nouvelle révolution se prépare. une doctrine révolutionnaire est née. C’est la révolte de la sensibilité contre cette rationalité étatisée et répressive. Le degré zéro de croissance, l’écologie, la lutte contre les centrales atomiques en sont les manifestations les plus récentes. L‘origine, de cette philosophie anti-système, est rappelons-le, le freudo-marxisme : la révolte de l’authenticité libidinale, ludique, marginale - instinctuelle, naturelle – contre la consommation de la production de série du système. Les rejetons-en révolte -des couches moyennes émanciperont les travailleurs. Par l’Eros.
Nous venons de proposer un modèle idéologique qui se module bien sûr selon la conjoncture et la tendance politique, du gauchisme à l’ultra-libéralisme, de celui-ci au PS. Mais pour autant que les variantes semblent s’éloigner de ce modèle, celui-ci reste la référence commune de la nouvelle gauche non (et anti) communiste. C’est l’idéologie qui tend à dominer les autres idéologies, en Occident. Même le giscardisme s’en est inspiré. partiellement : alibi de l’austérité.Nous avons essayé de dénoncer cette imposture. Il faut inverser les thèses qui fondent la civilisation capitaliste (celle de la gestion du libéralisme économique par la social-démocratie).
La machine est innocente et la fausse innocence est coupable. Cette dernière est la résultante de l’animation machinale. Sensualité et sensibilité se sont constituées par un certain usage - idéologique – de la machine et des objets qu’elle produit. Cette animation machinale est même devenue le machinal de l’inconscient (les archétypes). Et cette animation préside aux usages de masse. Le vitalisme (l’aspect sauvage, barbare, instinctuel du mondain) n’est que le reflet du mécanisme. La machine a inscrit dans la chair son fonctionnement. Comme la machine fonctionne, fonctionne l’usage mondain. C’est le même déroulement d’un « programme » commun à la mécanique et à la chair. C’est le mondain qui témoigne de la robotisation, du radical manque d’imagination de la nouvelle bourgeoisie. Tout le geste subversif et contestataire de l’étatisation technocratique n’est que jeu de machine. La statue dévide une bande, la programmation ludique, machinale, libidinale que le système propose en séries. C’est le grand renfermement du libéralisme monopoliste. Les animaux-machines vivent la vie machinale de l’animation machinale.
En un premier moment une machine a produit l’usage. Puis l’usage a produit une autre machine, plus perfectionnée. Si la machine fait aussi vite et aussi bien une sensibilité et si celle-ci fait aussi vite et aussi bien du machinal, n’est-ce pas la preuve que cette sensibilité est en ses origines et en ses fins, machinale ? Pure répétition d’un programme imposé. Cette sensibilité qui se prétend instinctuelle, pulsionnelle, contestataire n’est que la forme de la domestication idéologique. Cette soumission autorise la jouissance. Comme récompense. Sensibilité qui est la forme même de la technocratie, le haut lieu de la récupération du progrès. Le détournement d’usage par l’idéologie. Elle est le mode d’emploi de la technocratie.La gestion idéologique du système.
La machine est innocente, par contre, en son usage fonctionnel. Elle est l’objectivation du progrès. Et d’un progrès au service du collectif. Elle permet une extraordinaire gamme de biens d’équipements. A quatre niveaux : biens d’équipements collectifs (électricité, transports, biens d’équipements mi-collectifs – mi-des ménages (eau courante, etc.) ; biens manufacturés des ménages (cuisine électrique, frigo, machine à laver, etc.) ; biens spécifiques à la vie de relation de la famille (voiture) et à ses distractions (télévision). L’idéologie- essentiellement le freudo-marxisme – a cherché à faire croire que ces biens d’équipements étaient assimilables aux biens de consommation. (Pour prétendre que la classe ouvrière – qui en effet accède, relativement, à ce genre de biens- était intégrée dans le système). Mais ces biens ne témoignent, par eux-mêmes, d’aucun investissement libidinal. « Consomme » -·t-on le tout à l’égout ou la machine à laver comme les biens de l’usage ludique, marginal ? Comme le hasch ? N’est-il pas d‘ailleurs légitime que le travailleur accède à la possession des biens, des machines qu’il a produits? Ce sont des biens utiles, des instruments qui facilitent le travail. Le travail domestique (de la femme en particulier), les tâches ménagères. Ils permettent une vie meilleure, un certain bien-être (combien relatif) de la classe ouvrière. Sans autoriser pourtant une autre vie que la vie de subsistance. Niveau de vie et genre de vie restent radicalement de ceux de la consommation mondaine. (Différence de classe sociale). L’usage de ces biens ne déborde pas leur fonction. Leur vertu progressiste est dans leur fonctionnalité, que la sensibilité mondaine ne peut réellement investir. Bien qu’elle essaie, par la publicité, et l’usage idéologique des média.
Deux types de biens, deux types d’usages : ceux du mondain et ceux du progrès. Il est vrai que les deux systèmes sont des effets du machinisme. Et l’OS, l’homme-outil, l’homme devenu outil de la machine, en est devenu le symbole. Il est la forme extrême de l’aliénation. Mais il faut bien voir que cette situation n’est pas inhérente à la production industrielle, mais qu’elle est l’effet de l’exploitation capitaliste. La moderne gestion de l’économie capitaliste a imposé un nouvel ordre, structural du temps de travail et du temps libre, de la production et de la consommation. Les deux moments essentiels de cette civilisation machinale, de la machination qui récupère le machinisme.
Premier moment : l’industrialisation a autorisé une énorme libération du temps de travail. Dans Le Frivole et le Sérieux nous en avons proposé une mesure spectaculaire : au Moyen Age, il fallait 28 heures de travail abstrait pour une livre de pain. Maintenant, il suffit d’une demi-heure. L’industrialisation a libéré l’humanité de la terreur du manque. Elle garantit la vie de subsistance en libérant tout un temps de travail qui avant ne suffisait même pas à acquérir le nécessaire pour vivre.
Deuxième moment : cette libération par le temps de travail-abstrait a été récupérée par la nouvelle bourgeoisie, comme temps marginal concret. Comme marginalités, ludicités, libidinalités du mondain. (Le meilleur symbole de cette récupération est le hippie.) Alors que les travailleurs, eux, ont à peine profité de cette libération dont ils sont pourtant la cause.
Aussi peut-on dire que la nouvelle aliénation, par le machinisme, n’est que le corollaire, l’effet des nouvelles marginalités, ludicités, libidinalités, autorisées par le détournement d’usage de la machine. Au potlatch de la plus-value correspond la nouvelle exploitation du travailleur. L’autre face de la consommation mondaine, c’est le productivisme, l’inflation, le chômage. Et c’est la classe ouvrière qui en est l’essentielle victime. L’autre face du hippie, c’est le travailleur étranger. A l’idéologie de la Fête correspond l‘austérité sur les travailleurs. Au ministère du Temps libre, le chômage massif. Oui la machine est libératrice. Et la fausse innocence – qui profite du capitalisme en condamnant toute société industrielle – est coupable, aliénante.
D’un côté, la maîtrise de la technologie. En sa production et en son usage. Double maîtrise de la classe ouvrière. Double maîtrise du maître. (Celui que la psychanalyse ignore pour ne spéculer que sur son substitut, sa caricature : le père.) Double modalité du principe de réalité, en tant que réciprocité du procès de production et du procès de consommation.
De l’autre, la soumission à la technocratie : la consommation mondaine, la nouvelle sensibilité, la nouvelle bourgeoisie. Le principe de plaisir en tant que potlatch de la plus-value. Le parasitisme social camouflé sous les figures mondaines de la consommation plus ou moins transgressive. Le machinisme a deux effets : la rationalité fonctionnelle et la sensibilité mondaine. Le bon usage du progrès. Et l’usage de la récupération du progrès. Une machination s’oppose à une authentique libération.
En inversant les propositions du libéralisme, nous dirons qu’une société technicienne devient technocratique – et bureaucratique et étatique – lorsque la machine sert à la consommation libidinale, ludique, marginale. Et par contre, une société technicienne devient socialiste lorsqu’elle permet la libération des masses (par la nationalisation des fonctions productives) et la libération du corps de l’industrie du loisir et du divertissement. »Michel Clouscard (Le capitalisme de la séduction)
00:05 Publié dans Livre, Livre, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Deberes políticos de la juventud alemana y otros ensayos, de Oswald Spengler
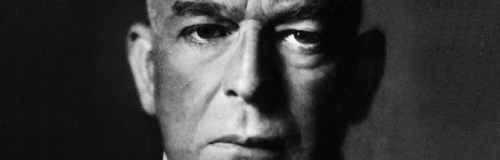
Novedad editorial:
Deberes políticos de la juventud alemana y otros ensayos, de Oswald Spengler
Índice
Prólogo de Carlos Martínez-Cava 7
Pensamientos acerca de la poesía lírica (1920) 11
¿Pesimismo? (1921) 21
Las dos caras de Rusia y el problema alemán del Este (1922) 37
Deberes políticos de la juventud alemana (1924) 55
Nietzsche y su siglo (1924) 81
Nuevos aspectos de la política mundial (1924) 95
La relación entre economía y política fiscal desde 1750 (1924) 117
La actual diferencia entre economía y política mundial (1924) 129
La antigüedad de las culturas americanas (1933) 153
El carro de combate y su significación
en el desarrollo de la historia universal (1934) 163
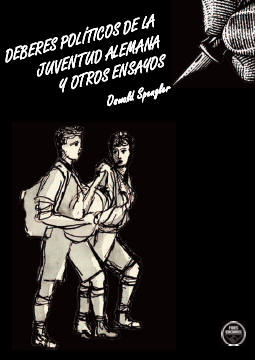 Orientaciones
Orientaciones
Decía Ortega y Gasset, que La Decadencia de Occidente de Spengler, era, sin disputa, la peripecia intelectual más estruendosa de los últimos años. En aquellas páginas quedó plasmada —a través de esa disciplina tan envolvente como es la Filosofía de la Historia—, la contemplación de Europa desde la atalaya que nos ofrecía. Todo un devenir en el tiempo donde nada podía ser ya lineal, por cuanto su concepción de la Cultura era orgánica. Con él, aprendimos a estudiar Occidente como un ser vivo que nacía, se desarrollaba y podía morir.
Spengler fue una lectura insoslayable en aquellos años treinta de entreguerras. Hoy es poco menos que una lectura inconfesable. No por lo pretérito de su pensamiento, sino por su incorrección política. Ya ha habido quien ha dicho que, el lector libre, ha de acercarse a sus obras liberándose de una suerte de preservativo mental.
Esa incorrección se explica en la feroz crítica que Spengler realiza a lo largo de toda su obra al parlamentarismo, al liberalismo y a la misma democracia. Pero no porque desdeñara esas formas en sí, sino porque para él impedían que el Pueblo cumpliera su deber y misión en la Historia.
[del prólogo de Carlos Martínez-Cava]
1ª edición, Tarragona, 2014.
21×15 cms., 168 págs.
Cubierta a todo color, con solapas y plastificada brillo.
PVP: 15 euros
Pedidos: edicionesfides@yahoo.es
Fuente: Ediciones Fides
00:05 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oswald spengler, spengler, révolution conservatrice, allemagne, jeunesse, philosophie, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Christophe Guilluy: La France périphérique
Christophe Guilluy:
"La France périphérique : comment on a sacrifié les classes populaires"
(Flammarion, 2014)
Ex: http://cerclenonconforme.hautetfort.com

Après Fractures françaises, qui avait déjà fait parler de lui, Christophe Guilluy nous propose ici un essai décapant sur notre pays. Géographe, l'approche de l'auteur est intéressante à plus d'un titre car elle se fonde sur une étude des hommes au sein de leur espace et de leurs territoires. Le vocabulaire employé est spécifique à la discipline et un glossaire à la fin de l'ouvrage permettra au lecteur d'y voir plus clair. Cependant d'autres notions ne s'y trouvent pas et nécessiteront pour les non initiés un dictionnaire récent. Passé le cap du vocabulaire spécifique à la discipline, nous remarquons d'emblée que l'essai de Christophe Guilluy s'appuie sur d'autres auteurs, géographes, sociologues ou démographes. Le raisonnement est étayé par un grand nombre de chiffres et illustré par des cartes en couleurs malheureusement trop petites. L'auteur n'hésite pas, en bon géographe, à changer d'échelle pour étudier des cas concrets. L'ouvrage m'a paru rigoureux sans pour autant être neutre. En effet l'auteur y défend une thèse selon laquelle la société française serait fracturée entre une France des métropoles, intégrée à la mondialisation et une France périphérique des petites et moyennes villes et des zones rurales éloignées des bassins d'emplois comme l'indique assez fidèlement la quatrième de couverture.
La France dans laquelle plonge Christophe Guilluy est la France des oubliés, dont la sociologie électorale se caractérise de plus en plus par l'abstention ou le vote FN. Il décrit une France laissée de côté par la mondialisation connaissant une insécurité sociale, économique ou identitaire. En effet 2/3 du PIB français provient des métropoles connectées au reste du monde. N'oublions pas, comme le rappelle Christophe Giulluy, à la suite d'Olivier Dollfus, que la mondialisation repose sur un « archipel métropolitain ». Par conséquent, l'organisation du territoire, son aménagement, ainsi que ses dynamiques, ont été profondément impactées par la mondialisation. Il démontre de façon convaincante que l'Etat-providence et le système républicain se sont effacés progressivement pour laisser place au modèle anglo-saxon communautariste et libéral. A ce titre il relaye la fameuse étude du non moins fameux « think-tank » du PS Terra Nova tout en notant de façon judicieuse que le projet sociétal du PS ne cadre pas avec la « clientèle » électorale immigrée. Il prévoit d'ailleurs à terme la disparition du PS et il explique clairement que nous ne faisons plus société.
Dans son étude, Christophe Guilluy soulève des remarques très pertinentes. Il remet en question les représentations qui entourent les populations issues de l'immigration. Par exemple, il considère que ce ne sont pas des banlieues que viendront les « révoltes populaires », mais des classes populaires et des classes moyennes « déclassées » françaises de la France périphérique comme l'illustre pour lui le mouvement des bonnets rouges, le mouvement des « nouvelles ruralités », le vote FN ou l'abstention. Il remarque comment les élites vivant dans les métropoles ont focalisé leur attention sur les banlieues alors que celles-ci sont bien moins impactées par la mondialisation puisqu'elles vivent dans métropoles connectées, aménagées et équipées. Il note aussi, sans nier la pauvreté qui y existe réellement, que l'ascenseur social fonctionne désormais uniquement pour les populations issues de l'immigration qui sont eu cœur des territoires producteurs de richesses et où se concentrent par exemple les universités alors, qu'à l'inverse, les milieux populaires de la France périphérique sont exclus en raison de l'impossibilité de loger leurs enfants dans les métropoles par exemple. Celles-ci concentrent ainsi des populations aisés dans les centre-villes gentrifiés et des populations issues de l'immigration. Elles se sont vidées des classes populaires et des classes moyennes paupérisées qui cherchent un environnement où elles peuvent se loger et se protéger des différentes formes d’insécurités évoquées précédemment.
Christophe Guilluy estime qu'il faut même « s'affranchir du concept de classe moyenne » (p.17) mais également des catégories de l'INSEE (p. 19) qui, pour lui, ne sont pas pertinentes et seraient une lecture essentiellement urbaine et économique du territoire qui n'interrogent pas l'intégration des classes populaires. Il n'y a pas selon l'auteur d'opposition entre une France urbaine et une France rurale. Il cite l'exemple de la Nièvre où les habitants définissent leur département comme « rural » tout en se définissant eux-mêmes comme des urbains (p.24). L'opposition ville/campagne ou urbain/rural n'est aujourd'hui plus pertinente en géographie. L'étude de Christophe Giulluy replace donc l'approche autour des notions de pôles, de périphérie et in fine, sans que cela soit vraiment évoqué, de marge. Ainsi le phénomène de métropolisation est en somme une polarisation des activités et des hommes dans les métropoles. La France périphérique s'organise donc à l'écart de ces pôles. Ce que Christophe Guilluy défini comme une périphérie ressemble parfois à une marge.
L'auteur explique assez longuement dans l'ouvrage les ressorts du vote FN en s'appuyant autant sur des dynamiques générales que sur des cas précis. Il en tire la conclusion que le vote FN est normal et repose sur une approche rationnelle de la part des exclus de la mondialisation et qui serait même universelle en démontrant que dans d'autres pays les réactions ne diffèrent pas face à des situations similaires. Il ne voit pas d'ailleurs ce qui arrêterait le processus en cours. Il tente de tordre le cou aux clichés entourant l'électeur FN : inculte, ayant peur de l'autre, de l'avenir, de la mondialisation, en démontrant qu'au fond, les représentations sont inversement proportionnelles à l’intégration dans la mondialisation. Ceux qui profitent de la mondialisation la voient positivement alors que ceux qui en sont victimes la voient négativement, ce qui est on ne peut plus logique. Pour Christophe Guilluy, la bourgeoisie n'a pas changé dans son regard sur les classes populaires, considérées comme des classes dangereuses. Il voit d'ailleurs dans le débat sur le mariage homo un conflit interne aux milieux bourgeois qui ne concerne qu'à la marge les milieux populaires. Il oppose, à la suite de Jean-Claude Michéa, la « gauche kérosène » et le « nomade attalien » dont le mode de vie serait impossible à généraliser aux processus de relocalisation et de réenracinement en cours dans la France périphérique. Il montre qu'une véritable « révolution par le bas » a débuté dans notre pays.
Un bémol cependant, l'auteur n'aborde pas le rôle des technologies numériques dans son tableau: le rôle de la télévision ou d'internet dans cette France périphérique et les effets de différents médias et technologies numériques sur les différents territoires.
Je vous laisse découvrir le reste de l'ouvrage et entrer dans les détails de son raisonnement. C'est d'après moi une lecture incontournable que devrait se procurer chaque militant pour savoir dans quel cadre géographique et sociologique il milite. Pour les non militants, c'est une très bonne approche pour mieux comprendre notre pays et les dynamiques en cours. L'ouvrage ne faisant « que » 179 pages, il se lit très rapidement et vous occupera utilement. A lire et à faire lire !
Jean/C.N.C
Note du C.N.C.: Toute reproduction éventuelle de ce contenu doit mentionner la source.
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique internationale, europe, affaire européennes, livre, christophe guilly |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook