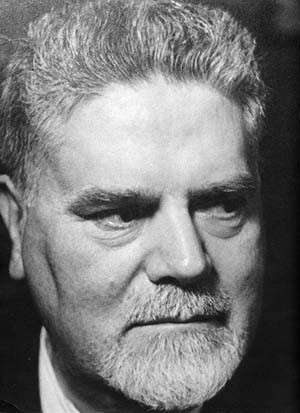lundi, 19 octobre 2009
The Anglo-US Drive into Eurasia and the Demonization of Russia
 The Anglo-US Drive into Eurasia and the Demonization of Russia The Anglo-US Drive into Eurasia and the Demonization of RussiaReframing the History of World War II By Mahdi Darius Nazemroaya | |
| Global Research, October 2, 2009 | |
| As tensions mount between the U.S. and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) on one side and Moscow and its allies on another, the history of the Second World War is being re-framed to demonize Russia, the legal successor state and largest former constituent republic (pars pro toto) of the Union of Soviet Socialist Republics (U.S.S.R.). In 2009, the U.S.S.R. and the Nazi government of Germany started being portrayed as the two forces that ignited the Second World War. The German-Soviet Non-Aggression Pact or the Ribeentrop-Molotov Pact caused shock waves in Europe and North America when it was signed. The German and Soviet governments were at odds with one another. This was more than just because of ideology; Germany and the Soviet Union were being played against one another in the events leading up to the Second World War, just as how previously Germany, the Russian Empire, and the Ottoman Empire were played against one another in Eastern Europe [3] British policy and the rationale for the non-aggression pact between the Soviets and Germans is described best by Carroll Quigley. Quigley, a top ranking U.S. professor of history, on the basis of the diplomatic agreements in Europe and insider information as an professor of the elites explains the strategic aims of British policy from 1920 to 1938 as:
It is because of this aim of nurturing Germany into a position of attacking the Soviets that British, Canadian, and American leaders had good rapports (which seem unexplained in standard history textbooks) with Adolph Hitler and the Nazis until the eve of the Second World War. In regards to appeasement under Prime Minister Neville Chamberlain and its beginning under the re-militarization of the industrial lands of the Rhineland, Quigley explains:
In regards to eventually creating a common German-Soviet, the French-led military alliance had to first be neutralized. The Locarno Pacts were fashioned by British foreign policy mandarins to prevent France from being able to militarily support Czechoslovakia and Poland in Eastern Europe and thus to intimidate Germany from halting any attempts at annexing both Eastern European states. Quigley writes:
The Anglo-German Naval Agreement of 1935 was also deliberately signed by Britain to prevent the Soviets from joining the neutralized military alliance between France, Czechoslovakia, and Poland. Quigley writes:
The Hoare-Laval Plan was also used to stir Germany eastward instead of southward towards the Eastern Mediterranean, which the British saw as the critical linchpin holding their empire together and connecting them through the Egyptian Suez Canal to India. Quigley explains:
Both the Soviet Union, under Joseph Stalin, and Germany, under Adolph Hitler, ultimately became aware of the designs for the planning of a German-Soviet war and because of this both Moscow and Berlin signed a non-aggression pact prior to the Second World War. The German-Soviet arrangement was largely a response to the Anglo-American stance. In the end it was because of Soviet and German distrust for one another that the Soviet-German alliance collapsed and the anticipated German-Soviet war came to fruition as the largest and deadliest war theatre in the Second World War, the Eastern Front. The Origins of the Russian Urge to Protect Eurasia | |
| | |
| | |
00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, histoire, grande-bretagne, empire britannique, etats-unis, russie, eurasie, eurasisme, asie, affaires asiatiques, affaires européennes, impérialisme, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 18 octobre 2009
Europa-Russia-Eurasia: una geopolitica "orizzontale"

EUROPA-RUSSIA-EURASIA:
UNA GEOPOLITICA "ORIZZONTALE"
di Carlo Terracciano / Ex: http://eurasiaunita.splinder.com/
"L'idea eurasiatica rappresenta una fondamentale revisione della storia politica, ideologica, etnica e religiosa dell'umanità; essa offre un nuovo sistema di classificazione e categorie che sostituiranno gli schemi usuali. Così l'eurasiatismo in questo contesto può essere definito come un progetto dell'integrazione strategica, geopolitica ed economica del continente eurasiatico settentrionale, considerato come la culla della storia e la matrice delle nazioni europee".
Aleksandr Dugin
Continenti e geopolitica
L'Eurasia è un continente "orizzontale", al contrario dell'America che è un continente "verticale". Cercheremo di approfondire poi questa perentoria affermazione analizzando la storia e soprattutto la geografia, in particolare eurasiatica. Terremo ben presente che in geopolitica la suddivisione dei continenti non corrisponde a quella accademica, ancor oggi insegnata nelle nostre scuole fin dalle elementari, e che, comunque, se un continente è "una massa di terre emerse e abitate, circondata da mari e/o oceani", è evidente che l'Europa, come continente a sé stante (assieme ad Asia, Africa, America e Australia), non risponde neanche ai requisiti della geografia scolastica. Ad est infatti essa è saldamente unita all'Asia propriamente detta. La linea verticale degli Urali, di modesta altezza e degradanti a sud, è stata posta ufficialmente come la demarcazione trai due continenti, prolungata fino al fiume Ural ed al Mar Caspio; ma non ha mai rappresentato un vero confine, un ostacolo riconosciuto rispetto all'immensa pianura che corre orizzontalmente dall'Atlantico al Pacifico. La nascita e l'espansione della Russia moderna verso est, fino ad occupare e popolare l'intera Siberia, non è altro che la naturale conseguenza militare e politica di un dato territoriale: la sostanziale unità geografica della parte settentrionale della massa eurasiatica, la grande pianura che corre dall'Atlantico al Pacifico, distinta a sud da deserti e catene montuose che segnano il vero confine con l'Asia profonda.
Nel suo libro Pekino tra Washington e Mosca (Volpe, Roma, 1972) Guido Giannettini affermava: "Riassumendo, dunque, il confine tra il mondo occidentale e quello orientale non sta negli Urali ma sugli Altai". Inseriva quindi anche la Russia con la Siberia in "occidente" e ne specificava di seguitole coordinate geografiche: "la penisola anatolica, i monti del Kurdistan, l'altopiano steppico del Khorassan, il Sinkiang, il Tchingai, la Mongolia, il Khingan, il Giappone". Semplificando possiamo dire che il vero confine orizzontale tra le due grandi aree geopolitiche della massa continentale genericamente eurasiatica è quello che separa l'Europa (con la penisola di Anatolia) più la Federazione Russa, con tutta la Siberia fino a Vladivostok, dal resto dell'Asia "gialla" (Cina, Corea Giappone); nonché dalle altre aree geopoliticamente omogenee (omogenee per ambiente, storia, cultura, religione ed economia) dell'Asia (Vicino Oriente arabo-islamico, mondo turanico, Islam indoeuropeo dal Kurdistan all'Indo, subcontinente indiano, Sudest asiatico peninsulare e insulare fino all'Indonesia). Più che di un confine di tipo moderno si potrebbe parlare, specie nell'Asia centrale, di un limes in senso romano, di una fascia confinaria più o meno ampia che separa popoli e tradizioni molto differenti. In termini politici, specie dopo la dissoluzione dell'URSS, potremmo comunque porre questo confine asiatico attorno al 50° parallelo, per poi proseguire con gli attuali confini di stato tra Federazione Russa a nord e Cina-Mongolia-Giappone.
Del resto, in questo XXI secolo dell'era volgare la nuova concezione eurasiatista delle aree geopolitiche e geoeconomiche omogenee supera le concezioni politiche veteronazionaliste otto-novecentesche, basate su confini ritagliati a linee rette con squadra e compasso. Al contrario si considerano "aree" che spesso si sovrappongono ed integrano, come una serie di anelli concatenati tra loro (tipo i cerchi colorati della bandiera olimpica): ad esempio, l'arca mediterranea è certamente un'unità geopolitica in un mare interno, quasi chiuso agli oceani, che, come dice il suo stesso nome, rappresenta la medianità, il baricentro, il ponte tra le terre prospicienti. Ciò non toglie che i paesi europei che si affacciano sul sistema marittimo Mediterraneo - Mar di Marinara - Mar Nero facciano certamente parte integrante dell'Europa, a sua volta prolungamento occidentale dell'Asia settentrionale, cioè dello spazio russo-siberiano.
Come si noterà, le varie unità omogenee della massa eurasiatica sono disposte tutte in senso orizzontale. La geografia del Mondo Antico, di tutta la massa che con un neologismo potremmo definire Eufrasia, penetrata da un sistema marittimo interno, va in questo senso: da ovest ad est (o viceversa), nel senso dei paralleli. È lo stesso senso di marcia seguito dai ReitervöIker, i "popoli cavalieri" che corsero l'intera Eurasia fin dai più remoti tempi preistorici, i tempi dei miti e delle saghe dell'origine. È lo stesso tragitto, da est a ovest, delle invasioni che dalle steppe dell'Asia centralesi rovesciarono sulla penisola occidentale europea in ondate successive: quelle che noi definiamo "invasioni barbariche", nel periodo della caduta dell' Impero Romano. Poi vennero Tamerlano e Gengiz-Khan; quindi i Turchi, dapprima in Anatolia e poi nei Balcani.
Siberia russa
"Precisamente del Sur de Siberia y de Mongolia provencan las oleadas de los llamados 'bárbaros' que, a través de las estepas que rodean el Caspio y el Mar Negro, llegaron a Europa y cambiaron tanto su faz durante los primeros siglos de nuestra Era" (Alexandr Dugin, Rusia. El misterio de Eurasia, Madrid, GL 88,1992, p. 127).
Precedentemente la grande epopea araba dell'Islam, conquistatala penisola arabica, si era espansa sia verso ovest - nel Sahara e in Spagna – sia verso est - nel Vicino Oriente e fino al centro dell'Asia. Con l'avvento dell'età moderna sarà proprio la Russia, liberatasi dal dominio dell'Orda d' Oro e riunificata attorno al Principato di Moscoviti, a percorrere la strada lineare da ovest ad est. "Jermak è il Pizarro della Russia, l'uomo che sottomise la Siberia e la donò allo zar Ivan il Terribile. E con lui la famiglia degli Stroganoff e in generale i Cosacchi" (Juri Semionov, La conquista della Siberia, Sonzogno, Piacenza, 1974). Nell'arco di appena un secolo, dalla salita al trono di Ivan IV il Terribile nel 1547 alla scoperta dello stretto di Bering nel 1648, la conquista della Siberia è un fatto compiuto. Un evento quasi sconosciuto nei nostri testi di storia, ma che rappresenta e sempre più rappresenterà in futuro un fattore determinante per gli equilibri planetari, come intuì anche il geopolitico inglese Mackinder all'inizio del secolo scorso.
Lo spazio è potenza, anche uno spazio vuoto. La Siberia, con la sua vastità ancora in massima parte intatta, con le sue risorse energetiche e minerali, con la sua posizione, rappresenta una potenzialità unica per l' Eurasia, cioè per l'Europa e la Russia insieme: la possibilità di una possibile autarchia da contrapporre alla globalizzazione mondialista americanocentrica. La Siberia rappresenta per tutta l'Europa fino agli Urali quello che fu il "Far West" per le tredici colonie dei nascenti Stati Uniti: è il nostro "Far East"! Ma HeartIand mackinderiano può essere difeso solo con il controllo di tutta la penisola Europa e delle sue coste atlantiche. Come ben sanno i Russi dal '700 in poi.
Dal XVIII al XX secolo la Russia fu mira dell'espansionismo da occidente. Svezia, Francia, Germania hanno tentato invano di conquistare da ovest ad est lo spazio vitale russo: sempre e comunque in linea orizzontale, seguendo la conformazione geografica del continente.
E, in senso inverso, sarà l'impero russo, oramai divenuto sovietico, a espandere verso ovest la propria influenza dopo la Seconda Guerra Mondiale (la "Grande Guerra Patriottica" per i Russi), mentre gli USA conquisteranno la parte occidentale, marittima e oceanica della penisola europea.
La NATO in marcia verso l’Heartland
All'inizio dell'ultimo decennio del secolo scorso, il crollo implosivo dell'URSS e l'avanzata ad est della NATO portano le truppe e i missili USA nei paesi dell'ex blocco sovietico, del Patto di Varsavia, e della stessa URSS (paesi baltici). La talassocrazia americana, già padrona incontrastata degli oceani mondiali, penetra a fondo nel cuore d'Eurasia, all'assalto degli ultimi bastioni di resistenza rappresentati dalle potenze terrestri russa e cinese.
Pensare che la Russia possa fare a meno dell'Europa peninsulare (e viceversa l'Europa della Russia) di fronte a questa avanzata finale è assolutamente contrario alla geostrategia quanto al semplice buon senso. Consideriamo innanzitutto che l'Europa di cui parliamo non è una libera e sovrana unità di stati indipendenti, se non formalmente. In realtà dal '45 in poi il continente è sotto l'egemonia statunitense, cioè della talassocrazia atlantica. Con qualche rara eccezione, come in parte la Francia erede del gollismo, e con la conferma della Gran Bretagna quale appendice americana in Europa.
La NATO, non a caso, dal 1949 fino al crollo dell'URSS si estendeva su tutti gli stati europei rivieraschi dell'Atlantico e del Mediterraneo, per chiudere al Patto di Varsavia ogni accesso marittimo, isolando l' URSS e strangolandola nella sua dimensione territoriale: tanto estesa quanto chiusa alle grandi acque oceaniche e ai mari caldi interni. Dopo il fallimento dell'avventura afgana, preliminare ad uno sbocco all'Oceano Indiano che spezzasse l'accerchiamento nella massa eurasiatica, il contraccolpo derivato dalla sconfitta e dal ripiegamento ha mandato in frantumi l'oramai artificiosa struttura dell'impero sovietico, demotivato anche ideologicamente e stremato economicamente da un apparato militare obsoleto e chiaramente inadatto alle sfide del presente.
Oggi poi l'Alleanza Atlantica, lungi dall'essersi dissolta per "cessato pericolo", si è estesa sempre più ad est, toccando nel Baltico i confini russi. L'Ucraina è già sulla via dell'integrazione occidentale, il Caucaso è in fiamme, la Georgia è saldamente in mano a Washington.
Non è certo con la sola, ipotetica, alleanza di medie potenze regionali asiatiche che Mosca può pensare di vincere la partita con Washington; partita mortale, esiziale per la sua stessa integrità territoriale e sopravvivenza come impero.
Quello a cui punta l'America di Bush, di Brzezinski (ebreo di origine polacca) e di tutti i loro sodali biblici è semplicemente l'annientamento della Russia come entità storico-politica. L'alternativa alla Federazione Russa attuale è il ritorno al Principato di Moscovia, tributario stavolta di un'altra "Orda d'Oro", ben peggiore: quella dei finanzieri di Wall Street.
Da un punto di vista geopolitico russocentrico, l'unica sicurezza per i secoli a venire non può esser rappresentata che dal controllo sotto qualsiasi forma delle coste della massa eurasiatica settentrionale, quelle coste che si affacciano sui due principali oceani mondiali, l'Atlantico e il Pacifico. E se Vladivostok è la "porta d'Oriente" (e tale può restare, in accordo e collaborazione con il colosso nascente cinese, indirizzando Pechino al Pacifico e appoggiandone le giuste rivendicazioni perla restituzione di Taiwan), è ad occidente che si giocherà la partita decisiva: quella della salvezza della Russia come della liberazione dell'Europa dal giogo americano. Fino alla Manica, al Portogallo, a Reykjavik. O l'Europa si integrerà in una sfera di cooperazione economica, politica e militare con Mosca (il famoso asse Parigi-Berlino-Mosca), o sarà usata nell'ambito NATO dagli americani come una pistola puntata su Mosca. L'esperienza del Kossovo e della guerra alla Serbia dovrebbe aver insegnato qualcosa.
L'unica sicurezza per una potenza continentale estesa come la Federazione Russa è il controllo delle coste, di isole e penisole della sua area geopolitica di interesse; in caso contrario, l'Europa sarebbe prima o poi usata come un ariete americano per sfondare le porte della Federazione e dissolverla nelle sue cento realtà etno-politico-religiose.
La tentazione di risolvere per sempre la "questione russa" (anticipando anche lo sviluppo della Cina come grande potenza economica e militare) è forte, specialmente oggi che Washington resta l'unica superpotenza dominante nel globo.
L'Heartland, il "Cuore della Terra", è a portata di mano. La talassocrazia USA ha occupato buona parte di quel Rimland, di quell"'Anello Marginale" eurasiatico che era stato individuato dal geopolitico americano Spykman già durante la Guerra Mondiale. E Russia e Cina sono gli ultimi reali ostacoli a quella conquista definitiva dell'Isola del Mondo, ossia dell'Eurasia, che concluderebbe la conquista americana del pianeta. Le truppe a stelle e strisce sono a Kabul e a Bagdad, ma con basi avanzate anche a Tiblisi, Taškent, Biškek. Iran e Siria, potenziali alleati, sono sotto il mirino delle armate americane e dei missili atomici di Israele. E anche se l'occupazione a stelle e strisce dell'Iraq non è andata secondo i piani del Pentagono, è certo che le truppe americane non lasceranno il paese, le sue basi militari, i suoi pozzi petroliferi, neanche molti anni dopo le elezioni farsa del 2005.
Oriente e Occidente
Certo l'integrazione di due realtà complesse e per molto tempo separate, come sono Europa e Russia, non sarà semplice e immediata; d'altronde non lo fu neanche la creazione di Stati nazionali quali la Spagna, la Francia e specialmente l'Italia. Eppure oriente e occidente sono destinati ad incontrarsi e fondersi. L'Europa Unita dei capitali, dei mercati, della tecnologia, ma sradicata dalle proprie tradizioni e valori, trova nella Russia dei grandi spazi siberiani, della potenza militare nucleare e delle materie prime, una Russia ancora in parte legata alle proprie tradizioni, il suo stesso naturale proseguimento geografico, politico, storico, culturale. Una parte possiede quel che manca all'altra.
A questo punto va inserita una precisazione sui concetti di "Oriente" e "Occidente" conforme alla prospettiva eurasiatista di Dugin e della scuola geopolitica russa in generale. In un testo dell'ottobre 2001, intitolato "La sfida della Russia e la ricerca dell'identità", Aleksandr Dugin affermava tra l'altro: "Gli eurasiatisti considerano tutta la situazione presente da una loro peculiare prospettiva [rispetto ai nazionalisti slavofili e ai neosovietisti]: nemico principale è la civiltà occidentale. Gli eurasiatisti fanno proprie tutte le tesi antioccidentali: geopolitiche, filosofiche, religiose, storiche, culturali, socioeconomiche, e sono pronti ad allearsi con tutti i patrioti e con tutti coloro che propugnano una 'politica di potere' (derzhavniki) - siano essi di destra o di sinistra – che miri a salvare la 'specificità russa' di fronte alla minaccia della globalizzazione e dell'atlantismo". E ancora: "Per noi eurasiatisti, l'Occidente è il regno dell' Anticristo, il "luogo maledetto". Ogni minaccia contro la Russia viene dall'Occidente e dai rappresentanti delle tendenze occidentaliste in Russia".
È ovvio che Dugin, pensatore formatosi sul pensiero tradizionale, sulla cultura europea di Nietzsche, Guénon, Evola ecc., non confonde affatto l'Europa con l'Occidente, tant'è vero che di seguito indica giustamente il nemico comune dell'Uomo nell'atlantismo, nel Nuovo Ordine Mondiale, nella globalizzazione americanocentrica, ecc. ecc. La contrapposizione tra Oriente e Occidente, specialmente se riferita all'Europa del XX secolo, è, in termini politici e geografici, un' invenzione della propaganda atlantista, dopo la spartizione dell'Europa stessa a Jalta.
Quale Europa?
Possiamo anche aggiungere che la stessa contrapposizione "razziale" tra euro-germanici e slavi, assimilati alla "congiura ebraica" sulla base dell'esperienza della rivoluzione bolscevica in Russia e non solo, fu uno dei grandi errori della Germania, la quale, proprio per questo, perse la guerra, l'integrità territoriale e l'indipendenza. Valida in parte nella prima fase rivoluzionaria, tale contrapposizione non tenne conto della svolta staliniana in politica interna, né del rovesciamento di prospettiva tra Rivoluzione e Russia attuata dal dittatore georgiano, considerato dai russi "l'ultimo zar" rosso del paese: non la Russia come strumento e trampolino di lancio della "rivoluzione permanente" trotzkista in Europa, ma al contrario il marxismo come strumento ideologico-politico di conquista per iI rinato impero russo-sovietico.
Riproporre questa contrapposizione tra Europei, a ruoli rovesciati, sarebbe esiziale per i Russi oggi quanto lo fu per i Tedeschi ieri. La scuola geopolitica tedesca di Haushofer, al contrario, aveva sempre auspicato un'alleanza geostrategica tra Germania e Russia, estesa fino all'estremo limite dell'Eurasia, all'Impero del Sol Levante, bastione oceanico contro l'ingerenza espansionistica dell' imperialismo USA nel Pacifico.
Per oltre mezzo secolo l' Europa è stata divisa dai vincitori tra un Est e un Ovest; la Germania, tra una Repubblica Federale ad ovest e la DDR a est; la sua capitale, cuore d'Europa, tra Berlino Est e Berlino Ovest. Su questo falso bipolarismo per conto terzi si è giocata, per quasi mezzo secolo, la "guerra fredda" delle due superpotenze. "Fredda" in Europa, ma ben "calda" nel resto del mondo, in Asia, Africa e America Latina, con guerre, rivoluzioni, decolonizzazione, colpi di stato, dittature militari, invasioni, blocchi economici, minacce nucleari e via elencando. L’antitesi tra un'Europa "occidentale", progredita e democratica ed un Est "slavo" aggressivo e minaccioso, retrogrado e inaffidabile, è il residuo politico del passato prossimo, un rottame della Guerra Fredda, ma anche uno strumento dell'attuale politica di Bush e soci per tenere a freno un'Europa avviata all'unità economica, affinché non riconosca nella Russia il naturale complemento del proprio spazio geoeconomico vitale, bensì vi veda un pericolo sempre incombente. Il caso Ucraina, con ancora una volta europei e americani schierati contro la Russia, è la cartina di tornasole di queste posizioni residuali sorte dagli esiti della Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Civile Europea per eccellenza.
Errore mortale quindi identificare Europa ed Occidente. Esiziale per l'Europa, ma soprattutto per la Russia e in ogni caso per l'Eurasia comunque intesa.
Certo l'Europa/Occidente a cui pensano gli eurasiatisti di Mosca è quella sorta dalla Rivoluzione francese, l'Europa degli "Immortali Principi" dell'89,dell'Illuminismo prima e del Positivismo poi, del modernismo e del materialismo estremo. Si tratta di quell'Occidente che ha tentato a più riprese di invadere lo spazio vitale russo, per poi attuare sul corpo vivo della Santa Russia ortodossa uno degli esperimenti politico-sociali più disastrosi della storia. Ebbene: questo "Occidente" ed i suoi falsi miti sono il nemico oggettivo anche dell'Europa, cioè della penisola eurasiatica d'occidente. L'Europa della tradizione, della vera cultura, della civiltà latina-germanica-slava. Alla fine del ciclo è l' antitradizione quella che coinvolge tutto il globo e travolge ogni distinzione, senza limiti né confini: a est, ad ovest, a nord, a sud. Sarebbe un errore, ripetiamolo, da pagare in futuro a caro prezzo, confondere le politiche dei singoli governi europei di oggi, o anche quella della UE in generale, con la realtà storica e geografica, con la geopolitica appunto, che vede Europa-Russia-Siberia come un unico blocco, una inscindibile unità geografica. Infatti essa ha prodotto per secoli e secoli una storia comune fatta sia di conflitti che di scambi, di reciproci imprestiti culturali, artistici, religiosi, economici, politici.
Russia vichinga, bizantina, tartara
Da un punto di vista etnico, la tendenza degli studi storici e geografici presso la scuola geopolitica russa contemporanea è quella di rivalutare la componente "orientale", in particolare l'influsso delle popolazioni nomadi dell'Asia centrale sulla formazione della Russia moscovita; influenza che avrebbe determinato una specificità "eurasiatica" dal Principato di Moscoviti all'Impero zarista, dalla Russia sovietica (in particolare nell'epoca staliniana) fino all'attuale Federazione Russa, che attraverso la C.S.I. (Comunità degli Stati Indipendenti) dovrebbe far recuperare a Mosca il ruolo egemone sui territori islamici dell'Asia Centrale: quelli, per inciso, che oggi sono sottoposti alla pressione statunitense, dopo l'invasione dell'Afghanistan e dell'Iraq. In questo contesto, la qualità "eurasiatica" non si riferirebbe tanto ad una realtà geopolitica unitaria da Reykjavik a Vladivostok, bensì ad una diversità tutta russa, rispetto sia alla parte occidentale sia all'Asia "gialla" vera e propria.
Gli autori citati da Dugin, Trubeckoj, Savickij, Florovskij e soprattutto Lev Gumilev (del quale è stato tradotto in italiano il fondamentale studio Gli Unni. Un impero di nomadi antagonista dell'antica Cina, Einaudi, Torino 1972) hanno rivalutato il ruolo, misconosciuto dai filoccidentalisti, della componente asiatica della Russia. L'influenza mongolo-tatara, il regno dell'Orda d'Oro che nel XIII secolo investì i territori russi e l'Europa orientale, arrivando fino a Cattaro sull'Adriatico, viene considerata determinante nella formazione della presunta specificità dell'"anima russa" e della corrispondente autocrazia politica e sociale. Quella che in passato rappresentava per gli studiosi occidentali e per i Russi occidentalizzati una macchia, un marchio per la Russia, è tradotto oggi dai neo-eurasiatisti in un dato positivo: si tratta di un fattore che segna la differenza nei confronti di un Occidente corrotto e corruttore, sicché le steppe d'Asia e la componente di sangue tataro vengono a recuperare le radici di un radicamento "altro", senza per questo confondersi con i popoli asiatici. In tal modo viene affermata una specificità eurasiatica differenziata, rispetto ai popoli d'occidente e a quelli d'oriente. Tutt'al più, la Russia è un ponte di passaggio, il "regno mediano" tra le due ali della massa eurasiatica genericamente intesa. Non europei, non asiatici, ma russi, cioè eurasiatici! In quanto tali, i Russi sono interessati ad una "sfera geopolitica" (potremmo definirla senza giri di parole con il termine geopolitico di spazio vitale?)che recuperi a Mosca le terre già sovietiche del centro dell'Asia, ed associ nuovi partner regionali fino al Golfo Persico e all'Oceano Indiano: Turchia, Iran, India.
Questo revisionismo storico dei neo-eurasiatisti russi del secolo appena trascorso e del XXI ineunte è certamente giusto e positivo rispetto allo sbilanciamento della proiezione, tutta occidentalista, iniziata da Pietro il Grande (di cui la capitale baltica, da lui voluta tre secoli or sono per proiettare il paese verso ovest e sui mari, è il simbolo più evidente) e proseguita con Caterina la Grande giù giù fino ai Romanov.
Ma, come sempre avviene, un' estremizzazione rischia di rovesciarsi nell'estremizzazione di segno contrario.
Aparte la devastante incursione del 1237 su Rjazan, Mosca e Vladimir, è al 1240 che si fa risalire il dominio del Canato dell'Orda d'Oro sulla Russia, cioè le conquiste occidentali di Batu, nipote di Temujin-Gengis Khan (1162-1227) e fondatore di questo regno gengiskhanide. Nello stesso anno tuttavia il principe Aleksandr, Duca di Novgorod e Granduca di Vladimir, combatteva contro gli Svedesi al fiume Neva (da cui il soprannome onorifico di Nevskij)e due anni dopo sconfiggeva l'Ordine Teutonico al lago Peipus (lo scontro reso celeberrimo anche dal film di Ejzenštein); poi faceva atto formale di sottomissione all'Orda. Così fece Mosca, che creò la propria fortuna quale tributaria dei Tartari presso le altre città russe.
Ma il dominio mongolo fu molto blando. Karakorum, capitale e baricentro dell'espansione, lontanissima. Un piccolo numero di baskaki (sorveglianti) furono insediati nelle città principali; ma solo la nobiltà e non il popolo ebbe un rapporto diretto, di vassallaggio, con i nuovi dominatori delle steppe, con l'istituzione dello jarlyk, cioè l'autorizzazione a governare. Già alla fine del XIII secolo il confine dell'Orda correva sotto la linea Viatka-Ni•nj Novgorod - Principato di Rjazan, mentre il Grande Principato di Mosca espandeva i suoi confini e iniziava la lunga marcia verso l'unificazione dei Russi. Con il Principato di Novgorod, di Tver, di Pskov, di Rjazan, Mosca era solo tributaria dell'Orda d'Oro. Nel 1480, con un semplice schieramento di eserciti sul fiume Ugra, senza quasi combattere, si poteva considerare finita la dominazione mongola sulla Moscovia e la Russia centro-settentrionale. Due secoli e mezzo.
A confronto di questi eventi nella formazione della Russia e dei Russi ci sono da ricordare i quattro secoli precedenti: in particolare influenza esercitata dalla popolazione vichinga dei Variaghi, pacificamente fusi con gli Slavi autoctoni, che li avevano chiamati a governarli. L'origine della Rus' è narrata in varie Cronache, la più nota delle quali è la Cronaca degli anni passati (1110-1120 circa, probabilmente ripresa da un manoscritto originale di sessanta anni prima). Dell'860 è l'attacco di Askold e Dir, sovrani di Kijev, a Costantinopoli. Poi vennero le imprese semi-leggendarie di Rjurik, dalla penisola scandinava a Novgorod, fondatore di una dinastia che regnerà fino al 1598. E poi Igor, "guerriero vichingo vagabondo e pagano, sebbene portasse un nome interamente slavo" (Robin Milney-Gulland e Nikolai Dejevsky, Atlante della Russia e dell'Unione Sovietica, Istituto Geografico De Agostani, Novara, 1991). E figlio Vladimir si convertirà al cristianesimo nel 988 d.C., trascinando la Russia alla fede ortodossa dipendente da Costantinopoli, ma soprattutto introducendola da allora in poi nel consesso della cultura e degli stati europei. Una conversione che a quei tempi comportava anche una nuova cultura, libri, architettura religiosa e civile e, in particolare, un nuovo assetto politico, modellato su quello del l'Impero Romano d' Oriente, del quale un giorno Mosca si proclamerà erede come "Terza Roma", ergendosi quindi a depositaria delle glorie di Roma antica e di Costantinopoli: cioè occidente e oriente dell'Europa. È evidente da tutto ciò, dalla storia, dalla geografia, dalla fede e dalla cultura, quale sia stato il peso dell'Europa (quella della Tradizione e non quella moderna dei Lumi),su tutta la Russia. Fu certo un peso preponderante, anche sotto l'aspetto etnico e culturale, rispetto a quello, pur importante, del successivo khanato mongolo; combattendo contro il quale, i Russi svilupparono nei secoli posteriori una coscienza nazionale. Dugin stesso è, nella sua figura, l'esempio nobile delle ascendenze nordico-vichinghe della Rus'.
Sarebbe dunque veramente assurdo contrapporre l'etnia slava (con la sua componente tatara) all'Europa germanica ed a quella latina, magari identificando l'Europa latino-germanica con l'occidente "atlantico" e con la mentalità razionalista, positivista e materialista propria degli ultimi secoli e resasi egemone particolarmente in America.
Le varie "famiglie" linguistiche europee hanno un'unica origine, un solo ceppo, radici comuni nell'Eurasia e nel Nord. E fanno parte a pieno titolo dell'Europa anche popoli come quelli ugrofinnici (Ungheresi, Finlandesi, Estoni), arrivati nella penisola continentale in epoche successive, da quel crocevia di popoli che fu il centro dell'Asia. E che dire dei Baschi o dei Sardi, popoli di origini controverse? Contrapporre le genti dell'est e dell'ovest dell'Europa, lo ripetiamo, sembra la riproposizione, fatta al contrario, di quella propaganda razziale che vedeva negli Slavi "razze inferiori" da sottomettere e utilizzare come manodopera servile. Fu una posizione ideologica che determinò in buona parte l'esito disastroso della Seconda Guerra Mondiale per chi si fece portatore non dell'indipendenza e unità dell'Eurasia, bensì di una visione razziale che comportava l'antagonismo tra gli Europei; una posizione condannata peraltro proprio dalla scuola geopolitica germanica di Haushofer, il quale vedeva giustamente nelle potenze talassocratiche anglofone il vero nemico comune di Tedeschi, Russi, Giapponesi: di tutta l'Eurasia, ad occidente come ad oriente.
Nord-Sud, Est-Ovest
I termini che Dugin pone in contrapposizione, oriente ed occidente, necessitano di un'ulteriore precisazione. Occidente non è una caratterizzazione geografica, più di quanto non lo sia oriente. L'occidente dell'America è l'Asia, la quale, a sua volta, ha nel continente americano il proprio oriente.
In realtà oggi "Occidente" e "Oriente" (ma, soprattutto dopo la fine del sistema dei blocchi contrapposti, "il Nord e il Sud del mondo") sono designazioni economiche, politiche, sociali di quelle potenze che rappresentano la parte industrialmente, finanziariamente e tecnologicamente avanzata del globo. E "G8", gli otto "grandi", è il club esclusivo che li raccoglie. Il Giappone è "Occidente" allo stesso titolo di USA e UE. La Cina si avvia a divenirlo, come la Russia che già lo è.
Allora, se ancora di Occidente ed Oriente si può e si deve parlare, la linea di demarcazione deve essere posta trai due emisferi, tra le due masse continentali separate dai grandi oceani: l'Occidente per antonomasia, la terra dell'occaso, del tramonto, la Terra Verde della morte è l'America, il Mondo "Nuovo" della fine del ciclo.
L'Oriente, o meglio il Mondo Antico, il mondo della Tradizione, sarà allora l'Europa, l'Asia, l'Africa; l'Eurasia in particolare, cioè l'intera Europa con la Russia e la Siberia, sarà la terra dell'alba radiosa di un nuovo cielo, ma anche la terra dell'origine dei popoli indoeuropei, la terra degli avi iperborei. Uno spazio vitale strategico peri destini mondiali, da riscoprire ritornando all'origine polare delle stirpi arie che, millenni e millenni or sono, la catastrofe climatica disperse dalla sede originaria del nord, verso est, sud, ovest, come semenze di quelle grandi civiltà che hanno fatto la storia e modellato la geografia del mondo antico. In questo contesto e solo in esso allora le collocazioni geografiche si armonizzano perfettamente con quelle della geografia sacra, della morfologia della storia, della tradizione ciclica, ma anche con la lotta di liberazione dell'intero continente dalla morsa mortale in cui lo costringe il blocco marittimo della talassocrazia imperialista USA.
Un mondo multipolare
Certo non ci nasconderemo che Europa, Russia, Asia hanno anche notevoli differenze tra loro. Lo ribadiamo: le civiltà d'Eurasia, pur traendo linfa vitale dall'unica matrice d'origine, hanno sviluppato nei secoli caratteristiche specifiche proprie: lingue, culture, legislazioni, arti e mestieri, fedi religiose, costumi e stili di vita, modelli di governo differenziati. È una ricchezza nella differenza, nella diversità, che rappresenta ora, alla fine dei tempi, il patrimonio forse più importante della nostra Eurasia, minacciata mortalmente dal monoculturalismo americano, da quell'American way of life che i selvaggi senza radici (le recisero approdando nel "Nuovo Mondo", nella "Seconda Israele") hanno imposto a tutti i popoli vinti e sottomessi o (quando fosse impossibile piegarli) sterminati. Il genocidio dopo l'etnocidio. Il più grande sterminio di massa dell'umanità: i 15 milioni di nativi amerindi trucidati dai "colonizzatori" yankee. Tutto questo come necessaria premessa per l'edificazione del loro Nuovo Ordine Mondiale, del Governo Unico Planetario, con sede ovviamente a Washington-Boston-New York, in attesa di esser portato a Sion!
"Gli eurasiatisti difendono logicamente il principio della multipolarità, opponendosi al mondialismo unipolare imposto dagli atlantisti. Come poli di questo nuovo mondo, non vi saranno più gli Stati tradizionali, ma un gran numero di nuove formazioni culturalmente integrate ('grandi aree'), unite in 'archi geoeconomici' ('zone geo-economiche')". Parole sacrosante di Dugin nel III capitolo del saggio intitolato La visione eurasiatista. Principi di base della piattaforma dottrinale eurasiatista.
Da discutere semmai, in termini geografici e storici, quindi geopolitici, sono proprio gli spazi privilegiati di queste grandi aree integrate. Geopoliticamente parlando, è indubbio che per Eurasia si debba intendere in primo luogo l'integrazione della grande pianura eurasiatica settentrionale dal canale della Manica allo stretto di Bering. Attorno a questo spazio vitale imperiale europeo, si affiancano in strati orizzontali successivi le altre realtà geopolitiche d'Asia e Africa, quelle sopra descritte, nel senso dei paralleli. L'Eurasia Unita sarà la garante della libertà, dell' indipendenza, dell' identità di queste altre realtà, di questi spazi vitali affiancati, contro l'egemonismo talassocratico delle stelle e strisce.
America o Americhe?
Ancor più. Bisognerà garantire che nei secoli futuri l'imperialismo mondialista dei fondamentalisti biblici della "Seconda Israele" non rialzi la testa e riprenda forza. Una forza che fin dall'inizio trasse energie, risorse, ricchezza dallo sfruttamento di tutto il resto del continente americano a sud del Rio Grande. L’America Latina, centrale-caraibica e meridionale, ha una propria storia, una propria cultura, un proprio spazio geopolitico e geoeconomico, che può svilupparsi liberamente e fruttuosamente solo se svincolato dal gigante a nord. Al contrario, oggi il pericolo più grande è che il NAFTA possa conglobare, oltre al Messico, tutto il Centro America e l'altra metà del continente.
Già nei tempi precolombiani le culture autoctone si erano completamente differenziate, pur traendo tutte origine dalle migrazioni siberiane, avvenute attraverso lo stretto di Bering tra i 40.000 e i 10.000 anni fa. Ma mentre nelle vaste pianure del Nord America i cacciatori nomadi seguivano i branchi di bisonti, divisi in tribù, con uno stile di vita e riti non molto dissimili da quelli dei cacciatori siberiani cultori dello sciamanesimo, nell'America Centrale e Meridionale fiorivano raffinate civiltà di coltivatori-allevatori, imponenti insediamenti urbani, religioni che riuscirono ad elaborare straordinari calendari con l'accurata osservazione astronomica, pittura, architettura, scultura, scienza, medicina che non temevano di rivaleggiare con le più avanzate civiltà d'Eurasia. Con la scoperta dell'America da parte di Colombo e con le successive invasioni europee (inglesi, francesi, olandesi a nord, ispano-lusitani al centro e al sud), le differenze si sono accentuate. Infatti, nonostante stragi, distruzioni culturali, malattie, schiavismo, imposizione della nuova religione, nella parte latina delle Americhe le popolazioni autoctone sono sopravvissute allo sterminio; nei nuovi stati, prima coloniali e poi nazionali, si sono venute a trovare in una posizione subordinata, a volte integrandosi e mischiandosi agli Europei. Dal Chiapas al Perù, dal Centro America alla Bolivia, passando per il Venezuela di Chavez, gli eredi degli antichi imperi meso-americani e andini oggi tornano alla ribalta, riprendono in mano le redini del proprio destino e, spesso, sono i più strenui difensori della diversità culturale latino-indio-americana contro l' influenza dei gringos nordisti e l'invadenza distruttiva delle loro multinazionali.
Vediamo dunque distintamente come l'America, diversamente dall'Eurasia e dall'Africa settentrionale, sia un "continente verticale". Da Nord a Sud, dallo stretto di Bering alla Terra del Fuoco, oltre diecimila anni or sono scesero le popolazioni siberiane: gli "indiani", i nativi americani poi sopraffatti e sterminati dall'invasione marittima da occidente. A loro volta gli Stati Uniti estenderanno la conquista ed egemonia da nord a sud: in Messico, nei Carabi e nell'America Centrale (il "cortile di casa" degli yankee), giù fino all'America meridionale, alla punta del Cile e all'Argentina. Dove peraltro, a smentire la Dottrina Monroe dell"'America agli Americani", l'Union Jack sventola ancora sulle Isole Malvinas argentine, anche grazie all'appoggio USA ai cugini inglesi. E dopo la conquista delle Americhe, seguendole indicazioni geopolitiche di Mahan gli Stati Uniti si lanciarono sul Pacifico e verso le coste dell'Asia. (Alfred Thayer Mahan, L'influenza del potere marittimo sulla storia. 1660-1783, Ufficio Storico della Marina Militare, Roma, 1994).
Dunque due "sensi", due direzioni opposte per le masse continentali dei due emisferi, rappresentanti ciascuno una diversa visione del mondo, ed assunti oggi a simboli dell'eterno scontro fra la Terra e il Mare, fra tellurocrazia e talassocrazia, ma anche tra mondo della tradizione e mondo moderno, tra identità dei popoli della terra e globalizzazione mondialista.
Ambigua quindi, quando non falsa e fuorviante, la distinzione tra Oriente ed Occidente. A questa caratterizzazione delle forze in campo tra Est e Ovest, possiamo aggiungere anche la suddivisione del pianeta in sfere d'influenza "verticali", praticamente da Polo a Polo: vi fa riferimento lo stesso Dugin sia nell' articolo sul primo numero di "Eurasia" (L'idea eurasiatista), sia in altri scritti più o meno recenti, come quelli raccolti e pubblicati in Italia dalle edizioni Nuove Idee, nel volume dal titolo Eurasia. La rivoluzione conservatrice in Russia.
Geopolitica "orizzontale" e geopolitica "verticale"
E qui veniamo ad affrontare il nodo centrale di queste chiose ai recenti articoli di Dugin, i quali potrebbero apparire come uno spostamento di prospettiva rispetto alle posizioni espresse dallo stesso autore dieci e più anni or sono, cioè al tempo del traumatico crollo dell'impero rosso, di cui Dugin (geopolitico moscovita di formazione tradizionale e traduttore di Evola) aveva ben compreso con largo anticipo l'irreversibile crisi.
Nell'articolo su "Eurasia" Dugin considera un ventaglio di possibilità per la realizzazione dell' "idea eurasiatista" dal punto di vista di Mosca, in particolare prospettando "l'Eurasia [dei] tre grandi spazi vitali, integrati secondo la latitudine": "tre cinture eurasiatiche" che si distendono in verticale sui continenti seguendone le meridiane. Ovviamente il nostro autore aveva premesso un "vettore orizzontale dell'integrazione, seguito da una direttrice verticale"; ma indubbiamente la seconda prospettiva sembra quella prevalente nel pensiero attuale di Dugin e, probabilmente, in quello degli strateghi dell'era Putin. Proprio nella pagina seguente si afferma a chiare lettere che "La struttura del mondo basata su zone meridiane è accettata dai maggiori geopolitici americani che mirano alla creazione del Nuovo Ordine Mondiale e alla globalizzazione unipolare" (!) L'unico "punto d'inciampo" sarebbe semmai rappresentato proprio dall'esistenza o meno di uno spazio geopolitico verticale, "meridiano", della Russia in Asia centrale, con la diramazione di tre assi principali: Mosca-Teheran, Mosca-Delhi, Mosca-Ankara. In quanto all'altro emisfero, l'egemonia USA, seguendo in questo caso la naturale disposizione geografica del continente (o due continenti, nord e sudamericano?) sarebbe assicurata dal Canada a Capo Horn. Proprio come recita la famigerata Dottrina Monroe: "l'America agli Americani", sottintendendo ovviamente ai nord-americani, i WASP statunitensi con il contorno di immigrati e neri integrati. L'attuale Amministrazione Bush è un tipico spaccato di questo assunto. Con l'aggiunta, semmai, che agli Americani del nord spetta sì tutta l' America, ma anche... il resto del mondo.
I loro geopolitici, passati e presenti, conoscono bene infatti la lezione mackinderiana sull'HeartIand, sul suo controllo per il dominio dell' intera Eurasia e quindi dell’"Isola del Mondo" e quindi delle "fasce marginali" (vedi lezione Afghanistan). In sintesi da Alfred T. Mahan a Spykman, passando per Mackinder, fino ai contemporanei Brzezinski, Huntington e ai vari neo-cons della lobby ebraico-sionista militante in Usa: i Perle, i Pipes, i Wolfowitz, i Cheney, i Kagan, i Kaplan, i Kristol, ma anche Ledeen e il e il vecchio Kissinger, pur con qualche differenza, e tanti altri. Consigliamo in proposito la lettura de I nuovi rivoluzionari. Il pensiero dei neoconservatori americani, a cura di Jim Lobe e Adele Oliveri (Feltrinelli, Milano, 2003).
Anche la suddivisione per sfere d'influenza verticale non è certo nuova, né tanto meno inventata da Dugin. Risale pari pari al grande padre della geopolitica tedesca ed europea, Karl Haushofer ed alle sue panidee: la Pan-America con guida USA, l'Eurafrica centrata sul III Reich con l'aggiunta del Vicino Oriente, la Pan-Russia estesa fino allo sbocco all'Oceano Indiano attraverso Iran e India, ma priva dello sbocco siberiano al Pacifico settentrionale, assegnato dal geopolitico monacense alla sfera di Coprosperità Asiatica ovviamente a guida nipponica.
La suddivisione duginiana segue lo stesso schema, ma con le modifiche dovute alla situazione politica internazionale attuale: la Pan-Eurasia a guida russa comprende tutti i territori ex-sovietici, il Vicino Oriente, l'Iran, il Pakistan, l'India, ma anche la Siberia fino a Vladivostok. La zona asiatica vera e propria si incentra oggi su Pechino. L'area americana comprende anche Islanda e isole britanniche (ma non la Groenlandia!) ecc...
Tanto per cominciare la suddivisione di Karl Haushofer è completamente superata, essendo propria ad un preciso periodo storico, cioè quello della Seconda Guerra Mondiale e del colonialismo europeo in Africa. Anche perché, in termini di geopolitica propriamente detta, l'Africa non è un' unità geopolitica unica, ma comprende almeno tre distinte unità. Il Nord-Africa, col Magreb, fa parte della più vasta unità geopolitica del Mediterraneo, di cui rappresenta la sponda sud. Poi c'è la vastissima fascia desertica del Sahara-Sahel, che rappresentala vera divisione, il "mare di sabbia" navigato soltanto dalle carovane di mercanti che importavano sale, spezie, schiavi. Infine, a sud, I'"Africa Nera", a sua volta composta di varie sottodivisioni. Come il cosiddetto "Corno d' Africa", una realtà sia geopolitica che etnica a sé stante.
Anche l'Asia odierna ha ben poco a che vedere con quella che Haushofer conosceva e tanto ammirava: specialmente il Giappone, o per dir meglio l'Impero Nipponico, oggi ridotto al rango di vassallo americano e base delle truppe, delle navi, dei missili USA puntati contro le coste orientali dell'Eurasia. L'Iran della Rivoluzione Islamica dell'Imam Khomeini ha rimescolato le carte di tutto il Vicino Oriente, dove, dal 1948, si èinstallato lo stato sionista di Israele, fidato baluardo invalicabile dell' imperialismo americano; piazzato proprio nel baricentro della massa eurasiatico-africana, a ridosso delle sue vie marittime interne, esso taglia a metà l'Umma islamica e la "Mezzaluna Fertile" del sistema potamico irriguo (Delta del Nilo - Giordano/Mar Morto - Tigri Eufrate).
Chi pensa che possa un domani esistere un "sionismo filo-eurasiatista" non ha evidentemente molto chiara la storia, la geografia e la stessa visione religioso-messianica che ha permesso all'entità sionista di installarsi proprio in quelle terre geostrategicamente così decisive per il controllo dell'intera massa eurasiatica e africana. Gli ebrei russi della diaspora tornati in Israele non sono russi: sono ebrei e israeliani a tutti gli effetti, e la Russia è il loro nemico storico, forse ancor più della Germania oramai domata.
È singolare poi, che parlando di Asia e di "sfere d'influenza e/o cooperazione" si tenda spesso a sminuire se non addirittura ignorare il ruolo decisivo della Cina. La storia da secoli e la geografia da sempre hanno delimitato lo spazio vitale del colosso asiatico (come anche è il caso dell' India). Russia e Cina sono destinate ad una stretta collaborazione che si basi sulla non ingerenza nelle rispettive sfere di appartenenza e nel riconoscimento di quella altrui.
È nell'interesse dell'imperialismo egemone statunitense metterei due colossi d'Asia l'uno contro l'altro; suo massimo danno è vederli alleati. Interesse della Russia è appoggiare la Cina nelle sue naturali rivendicazioni territoriali, a cominciare da Taiwan; ciò aprirebbe a Pechino lo sbocco al l'Oceano Pacifico, in aperta competizione con la talassocrazia USA in uno spazio marittimo che Washington considera un "lago americano", essendo propria di ogni potenza di questo tipo la spinta ad occupare entrambe le coste marittime su cui si affaccia.
Eurasia unita e lotta di liberazione
Alle pan-idee "verticali" haushoferiane, che interpretate alla luce dell'assetto internazionale attuale, assumono oggi vago sapore neocolonialista (l'esatto contrario delle posizioni anticoloniali del padre della geopolitica tedesca), noi sostituiamo la visione di una collaborazione paritaria e integrata fra realtà geopolitiche omogenee disposte a fasce orizzontali in Eurasia ed Africa.
Tale politica non esclude, ma semmai la allarga, la prospettiva dughiniana delle aree integrate verticali; essa infatti favorisce la creazione di una potenza "terrestre", quella nata dal l'unione di Europa e Federazione Russa, che allargherebbe al mondo la sua politica estera di collaborazione. Ciò permetterebbe a tutto il "Terzo Mondo" di sottrarsi al ricatto economico e finanziario nordamericano, riconoscendo nella grande potenza del Nord-Eurasia lo stato guida della lotta di liberazione mondiale antimondalista, la potenza veramente capace di contrastare l'egemonismo USA su tutte le aree geopolitiche della massa eurasiatica, delle "Afriche" e delle "Americhe".
A conclusione di queste brevi chiose all'intervento di Dugin, il cui contributo alla dottrina geopolitica e alla lotta di liberazione eurasiatica resta fondamentale, vogliamo riallacciarcialle stesse conclusioni del suo saggio L'idea eurasiatista.
La nuova Weltanschauung
L'eurasiatismo è una Weltanschauung (ecco il vero Dugin, formatosi alla cultura mitteleuropea!), una visione del mondo onnicomprensiva che, avendo come priorità la società tradizionale, "riconosce l'imperativo della modernizzazione tecnica e sociale". Il postmodernismo eurasiatico "promuove un'alleanza di tradizione e modernità come impulso energetico, costruttivo, ottimistico verso la creatività e la crescita". Come filosofia "aperta", l'eurasiatismo non potrà esser dogmatico e certo sarà differenziato nelle varie versioni nazionali: "Tuttavia, la struttura principale della filosofia rimarrà invariata". I valori della tradizione, il differenzialismo e pluralismo contro il monoculturalismo ideologizzante del liberal-capitalismo; la difesa delle culture, dei diritti delle nazioni e dei popoli, contro l'oro e l'egemonia neocoloniale del ricco Nord del mondo. "Equità sociale e solidarietà umana contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo". Verrebbe quasi da dire: il sangue (e il suolo) contro l'oro"!
Certo, la Terra contro il Mare: la terra degli avi contro il mare indifferenziato eppur sempre mutevole, percorso da moderni pirati, eredi di quei "corsari", che erano dotati dalla corona inglese di "lettere di corsa" per depredare ed uccidere in nome e a maggior gloria di Sua Maestà Britannica. Pirati odierni in giacca e cravatta, che con un tratto di penna fanno la fortuna o la disgrazia di popoli e continenti. E per chi non si piega alla logica del "libero mercato" imposta dalla moderna pirateria finanziaria internazionale, restano sempre gli "interventi umanitari", le "missioni di... pace (eterna), i "missili intelligenti". Come in Serbia, come in Afghanistan, come in Iraq, come ieri in Corea o in Vietnam, a Cuba, in America Latina, in Africa e ancor prima in Europa, in Giappone, ovunque. Forse domani in Iran, in Siria, in Sudan, di nuovo in Corea. Forse anche in Russia e in Cina.
Intanto le "rivoluzioni di velluto" sono arrivate a Kiev e a Tiblisi, circondando la Russia, insidiando la Cina, sottomettendo il Vicino Oriente, dove il progetto del "Grande Israele" è quasi cosa fatta. La Terza Guerra Mondiale (la quarta dopo quella "fredda", anch'essa vinta dagli Stati Uniti) è già cominciata, è in atto. Se dobbiamo porre una data ufficiale, scegliamo senza dubbio l'11 settembre 2001, il giorno in cui l'Amministrazione Bush ha ottenuto (sapremo mai come?) la sua Pearl Harbour, il suo 7 dicembre '41, cioè la giustificazione per un'aggressione mondiale preordinata nei mesi ed anni precedenti, specie approfittando del crollo dell'URSS di dieci anni prima. Proprio con l'Afghanistan come primo obiettivo.
La Russia è stata ingannata e condotta a collaborare con il suo nemico mortale sulla comune piattaforma della "lotta al terrorismo islamico"; è stata inchiodata alla guerra cecena, con il suo strascico di errori ed orrori da entrambe le parti, mentre la superpotenza USA si assicurava posizioni strategiche decisive nel cuore d'Eurasia.
Tsunami America
La talassocrazia americana opera come un devastante tsunami!
L'onda della potenza marittima nordamericana invade la terra in profondità e distrugge tutto quel che trova sul suo cammino: uomini, società, economie, culture, identità, storia, coscienza geopolitica, fedi, civiltà.
Dove passa, è morte, fame, distruzione, miseria, lacrime e sangue. È il Diluvio Universale del terzo millennio dell'Era Volgare.
Ma l'Eurasia è grande, troppo estesa e popolata anche per questo Leviatano moderno. E l'Eurasia propriamente detta, col suo retroterra logistico siberiano, l'Heartland di mackinderiana memoria è ancora abbastanza vasta e potenzialmente ricca in materie e uomini per resistere e respingere l'attacco del Rimland occupato dall'invasione marittima.
La volontà e la via
Cosa manca allora a tutt'oggi ?
La volontà, solo la volontà, nient'altro che la volontà. La volontà che è potere, che è fare, è quindi agire nello spazio vitale geopolitico assegnato dalla natura e dalla storia. La volontà di élites dirigenti rivoluzionarie d'Eurasia che, puntandolo sguardo ben oltre i ristretti limiti del veteronazionalismo sciovinista, sappia raccogliere la bandiera delle lotte di liberazione identitaria dei suoi popoli. Ma una simile volontà, scaturita da una fede indiscussa nei valori tradizionali, deve alimentarsi di una retta conoscenza dei fatti, della storia e della geografia, della geopolitica e delle sue leggi.
L'eurasiatismo sarà allora la bandiera, la spada e il libro di questa lotta titanica e veramente decisiva per i destini del pianeta nei prossimi secoli. Eurasiatismo come liberazione e unificazione statuale, imperiale, dell'unità geopolitica euro-siberiana, da Reykjavik a Vladivostok. Eurasiatismo come sistema di alleanze e sfere di cooperazione con tutti gli altri "spazi geopoliticamente omogenei" dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina. Quindi eurasiatismo come sacra alleanza di tutti gli sfruttati, di tutti i "diseredati della terra", come li definiva l'Imam Khomeini, contro tutti gli sfruttatori e i depredatori mondialisti delle multinazionali. Contro i corruttori dei popoli, contro gli apolidi del capitale, gli "eletti"... da nessuno che preparano l'avvento del Nemico dell'Uomo, la catastrofe dell'Armageddon, che pure li travolgerà. Eurasiatismo infine come contrapposizione, lotta senza quartiere tra civiltà e civilizzazione, tradizione e mondo moderno, terra e mare, imperium e imperialismo, comunitarismo e liberal-capitalismo.
Se un giorno la Russia (attraverso le sue élites politiche, militari, culturali, economiche e spirituali) saprà riconoscere il proprio ruolo guida, tradizionale e rivoluzionario, in questo "scontro dei continenti", lo dovrà essenzialmente ad una piena comprensione della geopolitica, dell'eurasiatismo, della Weltanschauung che esso rappresenta. E lo dovrà in massima parte a Dugin e a tutti quei geopolitica d'Eurasia che seppero indicare la via sulla quale indirizzare la volontà.
00:10 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, europe, affaires européennes, russie, eurasie, eurasisme, stratégie, géostratégie, histoire, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 13 octobre 2009
Der Hofgeismarkreis der Jungsozialisten
|
1923: Osterwoche der Jungsozialisten in Hofgeismar. Sozialdemokratische Antworten auf die nationale Frage
von Sascha Jung
Quelle: wir selbst 02/1998 und
„Uns ist die Nation kein Durchgangspunkt zu einem kulturlosen Menschenbrei, sondern die schicksalsgebundene Lebensform, in der wir an den übernationalen Zwecken der Menschheit allein mitarbeiten können und wollen.“ (Hermann Heller)
Als Oskar Lafontaine sich 1990 über die deutsche Einheit nicht freuen konnte und sie wohl auch nicht wollte (und mit dieser Haltung die Bundestagswahlen für die SPD vermasselte), grollten ihm die „DDR“-Deutschen und mit ihnen zahlreiche Sozialdemokraten. Ein sächsischer SPD-Bundestagsabgeordneter formulierte die Wirkung Lafontainescher Politik: Viele der neuen Bundesbürger kamen sich trotz vollzogener Vereinigung wieder ausgeladen vor.
Abkehr von den nationalen Wurzeln der SPD
Das Versagen der SPD im Falle der deutschen Einheit war das Ergebnis einer stetigen Entfernung von den nationalen Wurzeln der Partei und der gleichzeitigen Andienung etlicher Parteistrategen an das kommunistische SED-Regime in Ost-Berlin. Der Schumacherschen SPD der Nachkriegszeit haben die postnationalen 68er, die unter Willy Brandt in die Partei strebten und heute zumindest im Westen den wohlstandsgesättigten Funktionärskörper stellen, den Garaus gemacht. Unwidersprochen blieb das freilich nicht – so widmete Tilman Fechter, einst Mitglied des SDS, seiner Partei ein Buch zum Thema „Die SPD und die Nation“. Er skizzierte darin das Verhältnis vierer verantwortlicher Generationen der Nachkriegszeit zur Nation und forderte seine Partei auf, aus dem Desaster von 1990 zu lernen und sich zu einer wirklich gesamtdeutschen Volkspartei und Führungskraft in einer neuen Berliner Republik zu wandeln.
Zahlreiche andere Autoren boten in den 90ern hilfreiche Handreichungen für einen solchen Prozess, indem sie die verborgene und vergessene nationale Tradition der SPD freizulegen versuchten. Gefruchtet hat dies freilich alles nicht viel. Zwar scheint die SPD heute mit der Schwäche der CDU ihr historisches Tief überwunden zu haben, und die wohldurchdachten Entscheidungen des Kanzlerkandidaten peilen zielstrebig die Ablösung der Regierung Kohl an. Dass sich aber die SPD schon in ihrer Gesamtheit zu der handlungsfähigen, strategisch denkenden und moralisch integren Kraft entwickelt hätte, die dieses verwahrloste Land aus der Krise führen könnte, muss bezweifelt werden. Man mag von Gerhard Schröder noch einiges erwarten können – in der Partei dominieren nach wie vor die tief im Adenauerschen Weststaat verwurzelten 68er.
1923: Die Osterwoche in Hofgeismar
So wundert es auch nicht, dass die 75. Wiederkehr eines Treffens von Jungsozialisten, das in der SPD einst als die Geburtsstunde eines demokratischen staatsbejahenden Sozialismus angesehen wurde, an den Jungsozialisten und der heutigen SPD-Führung vorbeigegangen ist. Die Rede ist von einer Tagung, zu der sich auf Einladung von August Rathmann und Franz Osterroth 1923 über 100 Jungsozialisten im hessischen Hofgeismar eingefunden hatten. Ziel der Teilnehmer sollte es sein, so Rathmann in den „Jungsozialistischen Blättern“, „das in der sozialistischen Bewegung noch immer lebendige Misstrauen gegenüber unserem eigenen Staat und Volk zu überwinden und ein neues positives Volksbewusstsein, eine klar entschiedene Staatsgesinnung zu erarbeiten“. Die Tagung selbst sollte ebenso wie der daraus hervorgegangene Hofgeismarkreis schnell zu einem Mythos werden: Die Gegner der Hofgeismarer schildern das Treffen als eine Orgie an nationalistischem Hurrapatriotismus, vor allem die Veröffentlichungen seit den siebziger Jahren folgen diesem Tenor.
Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, wurde die jungsozialistische Bewegung stark beeinflusst von den Ausdrucksformen der bürgerlichen Jugendbewegung des Hohen Meißner von 1913 und des Wandervogels der Jahrhundertwende. Fügten sich die Angehörigen der Sozialistischen Arbeiterjugend vor dem Kriege noch sittsam der Leitung der politisch gereiften alten Genossen, so bestanden die jungsozialistischen Gruppen auf Autonomie. Man wollte mehr als die Alten, Sozialismus sollte auf jugendliche Weise erlebt werden, was ein „neues Gemeinschaftsgefühl, ein neues Kulturgefühl, ein neues Lebens- und Weltgefühl“ einschloss. Eine Schlüsselszene der Hofgeismartagung stellt sich dann auch so dar:
Zunächst behandelte der Arbeiterdichter Karl Bröger in einem Vortrag das Thema „Deutscher Mensch und deutscher Geist“. Nach einer aufwühlenden Diskussion trug er einen Gedichtzyklus „Deutschland“ vor, dessen letzte Verse lauteten:
Nichts kann uns rauben Liebe und Glauben zu diesem Land Es zu erhalten und zu gestalten sind wir gesandt.
Mögen wir sterben! Unseren Erben gilt dann die Pflicht: und zu gestalten. Deutschland stirbt nicht.
„Noch erregt von der Diskussion, unterwegs mit Liedern gegeneinander streitend, zogen die Tagungsteilnehmer in der Dämmerung auf den Schöneberg, wo ein Hamburger Voraustrupp bereits einen Holzstoß für das Osterfeuer geschichtet hatte. Die aufzüngelnde Flamme begrüßte ein Lied und Nietzsches Feuerspruch. Als die mit dem Gesicht zum besetzten Ruhr- und Rheinland gesprochene Feuerrede Osterroths in den Ruf ausmündete: `Es lebe Deutschland`, antwortete ein aufspringender Junger mit dem sich überstürzenden Gegenruf: `Es lebe die Internationale`.“
Die weiteren Referenten diskutierten die Begriffe Demokratie, Wirtschaft, Kultur, Volk, Staat und Nation, vor allem aber ihr Verhältnis zueinander. Höhepunkt der Veranstaltung war nach Osterroth aber das Schlussreferat von Prof. Hugo Sinzheimer, der mit seinen Thesen gleichsam die Zusammenfassung, das richtungsweisende Ergebnis der Tagung, formulierte. Sozialismus sei eine neue Ordnung und Ordnung gleichwohl immer nur Mittel. Für die deutsche sozialistische Bewegung seien Volk und Staat deshalb objektive Existenzformen, sie müsse diese deshalb nicht nur bejahen, sondern auch diejenigen Kräfte technischer und sittlicher Art aus sich heraus entwickeln, die beide zu tragen und fortzubilden fähig sind.
Zum Selbstverständnis des Hofgeismarkreises
Ausgehend von dem Treffen in Hofgeismar sollte sich ein lockerer Kreis von Jungsozialisten bilden, der als Hofgeismarkreis in den nächsten Jahren die Diskussion in den jungsozialistischen Gruppen prägte, bald aber auch von den marxistisch-orthodoxen Jungsozialisten, die sich zum Hannoveranerkreis zusammengeschlossen hatten, bekämpft wurde. Ein „Politischer Rundbrief“, von dem fünf Ausgaben erschienen sind, wurde herausgegeben, weitere Arbeitstagungen, u.a. zur deutschen Außenpolitik, wurden organisiert. Nicht an die „geistig zähflüssige Masse gewisser Parteibürokraten von rechts und links“, sondern „an alles, was jung und stark ist im Sozialismus und im deutschen Volk“, wandte sich der Leipziger Staatsrechtler Dr. Hermann Heller in seinem Buch „Sozialismus und Nation“, das schnell zu einem Grundtext der Hofgeismarer avancierte. Wie für Sinzheimer gehören für Heller „die nationale wie die soziale Volksgemeinschaft“ zusammen. Die Nation sei eine endgültige Lebensform, die durch den Sozialismus weder beseitigt werden könne noch beseitigt werden solle; Sozialismus bedeute nicht das Ende, sondern die Vollendung der nationalen Gemeinschaft. Nationales Bewusstsein und kapitalistische Wirtschaftsgesinnung waren für Heller geradezu ein sittlicher Widerspruch, und er sprach deshalb den rechten Gegnern die Berechtigung ab, sich auf nationale Interessen zu berufen und die Volksgemeinschaft zu beschwören. Andererseits griff Heller mit seiner Staatstheorie auch konsequent den zur bloßen Worthülse verkommenen Marxismus der verknöcherten Parteiführung an. Die Fixierung der sozialistischen Theorie auf die unpolitische Marx-Engelssche Formel vom Staat als Ausbeutungsinstrument verwarf er als unerträglich und stellte dem die Staatsidee Lassalles entgegen, für den der Staat Sicherung des menschlichen Zusammenwirkens, ja der archimedische Punkt über einer handlungsfähigen Gesellschaft sei: „Sozialismus ist nicht die Aufhebung, sondern die Veredelung des Staates.“ Wirkten solche Töne für zahlreiche sozialdemokratische Funktionäre der Weimarer Zeit schon befremdlich, so riefen sie erst recht den erbitterten Widerstand glühend marxistischer Jungsozialisten hervor. Diese sahen in der Diskussion der Hofgeismarer nichts anderes als den Versuch, die Klassengegensätze in der Weimarer Republik zu verschleiern: „Republik, das ist nicht viel, Sozialismus heißt das Ziel!“ hieß ein gängiges Motto. Der offene Krach zwischen beiden Juso-Strömungen ließ nicht auf sich warten. Nach hitzig geführter Debatte mussten die Hofgeismarer auf der Reichskonferenz Ostern 1925 in Jena eine bittere Abstimmungsniederlage hinnehmen. Die Mehrheit der Delegierten beschloss gegen die Stimmen der Hofgeismarer eine Erklärung, in der es unter anderem hieß, die derzeitige Demokratie verschleiere nur die Klassengegensätze: „Die Reichskonferenz ist sich daher darüber klar, dass das sozialistische Proletariat dem bürgerlichen Klassenstaat gegenüber keine staatspolitische Verantwortung übernehmen darf, wenn dies dem Interesse des internationalen Klassenkampfes widerspricht.“ Dass eine solche Erklärung von den Hofgeismarern nur als kommunistische Agitation angesehen werden konnte, hatte schon Theodor Haubach in seiner Gegenrede zu dem Antrag deutlich gemacht.
Die Niekisch-Debatte
Zwar versuchten die Hofgeismarer in den nächsten Monaten, zu einer Zusammenarbeit mit den Hannoveraner Jungsozialisten zu gelangen, indem sie beispielsweise anboten, ihre Arbeitstagungen und die dafür gespendeten Gelder dem Gesamtverband der Jungsozialisten zur Verfügung zu stellen. Ihre Anliegen wurden von der Mehrheit der inzwischen gekippten Reichsleitung aber brüsk abgelehnt. Zu einer weiteren Krise innerhalb des Verbandes kam es durch die Instrumentalisierung des Falles Ernst Niekisch durch die Hannoveraner. Einige Hofgeismarer waren an diesen sozialdemokratischen Gewerkschaftsfunktionär und früheren bayerischen Landtagsabgeordneten herangetreten, weil sie vor allem aus dessen Schrift „Der Weg der deutschen Arbeiterschaft zum Staat“ auf Gemeinsamkeiten schlossen. Niekisch wurde Gelegenheit gegeben, im „Politischen Rundbrief“ seine außenpolitischen Ansätze zu erläutern, und die gipfelten in einer radikalen Ablehnung der auf Ausgleich mit den Westmächten und schrittweiser Wiedergewinnung deutscher Geltung gerichteten Außenpolitik Stresemanns. Stattdessen forderte Niekisch einen revolutionären Nationalismus und eine Anlehnung an das bolschewistische Russland. Sicherlich faszinierten die konsequenten und mitreißenden Aussagen Niekischs manchen Hofgeismarer, gleichwohl entsprachen sie nicht im Geringsten den damaligen politischen Bedingungen. Revision der Versailler Grenzziehung und Überwindung der deutschen Ohnmacht, dafür traten in der damaligen Sozialdemokratie fast alle ein. Aber Ablehnung des Völkerbundes, Feindschaft mit England und Frankreich und dazu noch Anschluss an Russland – solche Thesen, wie Niekisch sie vertrat, mussten von einem nationalen Sozialismus zu einem sozialen Nationalismus und damit aus der SPD heraus führen. Entsprechend regte sich auch sofort Widerstand im Hofgeismarkreis. Während die Hannoveraner sich aber in ihrer Sichtweise des „jungsozialistischen Faschismus“ bestätigt fühlten und den Fall Niekisch zu weiterer aggressiver Propaganda gegen den Hofgeismarkreis nutzten, setzte bei den Hofgeismarern als Reaktion auf Niekischs Artikel im „Politischen Rundbrief“ eine heftige politische Debatte ein, in der die politische Differenzierung des Hofgeismarkreises deutlich wird. Als deren Ergebnis formulierte Gustav Warburg für die Mehrheit der Hofgeismarer: „Mir erscheint als Ziel deutscher Außenpolitik die Herstellung eines Zustandes, in dem Deutschland eine seiner Größe, Volkszahl und geistigen Bedeutung entsprechende Stellung einnimmt, frei von jeder Unterdrückung durch Versailler Fesseln, wo sein Wort wieder beachtet wird, wo seiner Leistungsfähigkeit keine Schranke gesetzt ist. Also kurz: ein Zustand, wo Deutschland unter keiner Unterdrückung leidet, aber wo es auch nicht unterdrückt.“
Treu geblieben waren die Hofgeismarer Jungsozialisten, nicht nur im Falle Niekischs, aber auch hier, der jungsozialistischen Tradition, stets aufgeschlossen für alles neue Denken, Streben und Gestalten zu sein und auch Kontakt zu anderen Gemeinschaften und Jugendbünden zu pflegen, was zur Beseitigung von mancherlei Vorurteilen und zum achtungsvollen Verstehen anderer Haltungen führte.
Da eine kameradschaftliche Diskussion der Gegensätze und eine Zusammenarbeit im Geiste der Jugendbewegung mit den übrigen Jungsozialisten nicht mehr möglich zu sein schien, beschlossen die Hofgeismarer Anfang 1926, die Organisation zu verlassen und ihren Kreis aufzulösen; die Zeit sei jetzt gekommen, von allen Angehörigen des Kreises in unmittelbarer Verantwortung die ausschließlich direkte Arbeit in Partei, Gewerkschaften und Reichsbanner im Geiste des Hofgeismarkreises zu fördern.
Anmerkung der Redaktion: Nur wenige Hofgeismarer folgten Ernst Niekisch in dessen Widerstandskreis (zu nennen ist hier wohl vor allem Benedikt Obermayr). August Rathmann redigierte die „Neuen Blätter für den Sozialismus“, die den Hofgeismarern am Ende der Weimarer Republik noch einmal ein viel beachtetes Forum gaben. Die meisten Hofgeismarer (Karl Bröger, Theodor Haubach, Franz Osterroth oder Carlo Mierendorff) verteidigten die Republik aktiv in den Reihen des Reichsbanners. Mitglieder des Kreises waren nach der NS-Machtergreifung in erheblichem Maße am Widerstand beteiligt, was viele mit Zuchthaus und Konzentrationslager büßten. Theodor Haubach war in den Putschversuch am 20. Juli 1944 verwickelt und wurde in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Hermann Heller musste emigrieren und starb im Exil.
1992: Anknüpfung auf Schloss Windischleuba
Mit dem Denken und Fühlen der Hofgeismarer konnten die 68er-Honoratioren des westdeutschen Wohlstandsgebietes natürlich nichts anfangen. Eine Nation hatte man dort nicht mehr nötig, als kluger deutscher Intellektueller hatte man aus den Schrecken und Miseren der deutschen Geschichte von 1871 bis 1945 gelernt, man rechnete es sich hoch an, keiner Nation mehr anzugehören – Europa, das war jetzt der Vaterland-Ersatz. Dass man also im sozialdemokratischen Westen buchstäblich aus den Latschen kippte, als zwei Dutzend junge Sozialdemokraten sich 1992 auf Schloss Windischleuba in Thüringen zusammenfanden und die Tradition des Hofgeismarkreises als Vorbild einer Erneuerung der Sozialdemokratie empfahlen, war eigentlich nicht verwunderlich. Dass die einsetzende empörte Presseberichterstattung zunächst nur zum Ruf nach raschem Ausschluss aus der SPD führte, war es ebenso wenig.
Gemeinschaftserleben, Demokratie und eine Kultur des Sozialismus
War der neu gegründete Hofgeismarkreis zunächst vor allem eine Protestantwort auf den verkorksten Dogmatismus der westdeutschen Jusos, die Zerrissenheit der westdeutschen Gesellschaft und die auch aus mangelndem historischen Bewusstsein fließende Unfähigkeit der Sozialdemokratie, sich zum Motor der deutschen Einheit zu entwickeln, so knüpfte man mit der Namensgebung doch auch ganz bewusst an eine 70 Jahre zurückliegende Diskussion innerhalb der SPD an. Die Frage, was man für die Zukunft eigentliche wollte und welche Anleihen der historische Hofgeismarkreis dafür liefern sollte, musste von ernstzunehmenden Kritikern gestellt werden. Das schlichte Postulat eines neuen Gemeinschaftsbewusstseins konnte auf Dauer nicht reichen.
Relativ schnell waren sich die neuen Hofgeismarer mit ihren Diskussionspartnern darüber einig geworden, dass der Hofgeismarkreis der Weimarer Zeit keinen nationalen Ausrutscher in der SPD-Geschichte darstellte, sondern an eine viel ältere Tradition, vor allem an die Zeit vor 1871, anknüpfte.
Wie aber sollten die Diskussionen des historischen Hofgeismarkreises für die heutige Zeit nutzbar gemacht werden? Franz Walter ist skeptisch: Was wolle man schon mit der ungemein poetischen und rauschenden Sprache eines Karl Bröger oder Paul Natorp anfangen, wenn man sich in die aktuelle Politik der SPD einmischen will? Walter mag insoweit Recht haben, dass sich politische Strategien daraus nicht ableiten lassen; rationale Politik ist aber auch nicht alles. Als inzwischen abgeklärter Rationalist vergisst Walter, dass gerade die Jugend, aber nicht nur sie, Sehnsucht nach in gewisser Weise romantischen Gemeinschaftserlebnissen hat. Das Irrationale ist im Menschen tief verwurzelt, und darin ist grundsätzlich auch nichts Negatives zu sehen. Die Frage ist, wer instrumentalisiert es und zu welchem Zweck. Den Nationalsozialisten ist im Gegensatz zur Weimarer SPD eine geschickte Instrumentalisierung des jugendbewegten Gemeinschaftserlebens gelungen, woraus sich ein Gutteil ihres Sieges über die alten Parteien begründen lässt. Fahrten, Lagerfeuer und Symbolfreude, das hat die jungen Leute damals begeistert.
Der einseitig rationalen Einstellung unserer Zeit antworten heute immer mehr Menschen mit der Flucht in Sekten und andere Gruppen. Die Esoterik-Literatur erlebt geradezu einen Boom. Die 68er flüchteten sich in ihre Hasch-Parties, von den Gemeinschaftserlebnissen randalierender Skinheads und Autonomer wollen wir gar nicht reden. Ob gemeinsame Fahrten, um Heimat und Welt kennen zu lernen, und Lagerfeuerromantik, bei der die eigene kulturelle Tradition vermittelt wird, da nicht pädagogisch sinnvoller sind? Dass die etablierten Parteien jedenfalls nicht in der Lage sind, die irrationalen Bedürfnisse im Menschen zu kultivieren, halte ich für politisch gefährlich.
Eine andere Frage, die sich der Hofgeismarkreis stellen lassen musste – und sie ist im Kern wesentlich politischer – war die, ob wir bereit seien, die Demokratie als Lebensform zu akzeptieren. Oberflächlich betrachtet erschien diese Frage suggestiv und konnte wohl eher dazu gedacht sein, uns die Möglichkeit zu geben, mit einem entschiedenen „Ja“ den Angriffen von ganz links außen die Grundlage zu entziehen. Sie leitet aber auch zu einer anderen hochinteressanten Diskussion über: Was heißt für uns heute eigentlich Demokratie? George Orwell schrieb bekanntlich, dass jeder, der eine Regierungsform verteidigt, sie, wie sie auch sein mag, für demokratisch erklärt. Sind Demokratien diejenigen, die nur einen Rechtsruck, nicht aber einen Linksruck fürchten oder sind es diejenigen, die nur einen Linksruck fürchten und nicht auch einen Rechtsruck? Demokraten wollen heute alle sein – ein bloßes Bekenntnis will also nicht viel heißen. Auch die willkürliche Festlegung (von wem auch immer), wer links und rechts noch dazu gehören darf, führt nicht weiter.
Da sich die traditionellen westlichen Demokratiemodelle, so auch in Deutschland, in einer tiefen Krise befinden, befürchtet mancher, dass auch sie nur die Probebühne für neue Diktaturen darstellen könnten. Ein sanfter Faschismus, ein sanfter Kommunismus oder auch die Diktatur der internationalen Konzerne könnten sich als erfolgreicher erweisen. Wer also die Demokratie als Volksherrschaft versteht und unsere grundlegenden Freiheiten erhalten will, muss die Frage nach den Unzulänglichkeiten unseres politischen Systems stellen. Die Demokratie muss von ihren Gegnern zur Rechten wie zur Linken lernen. Von den Rechten: offensive, aggressive, emotionale Vorwärtsverteidigung des uns Eigenen – Demokratie als positiver Mythos. Von den Linken: Kehrtwendung gegen den Brutal-Kapitalismus samt dessen Hauptprodukten Arbeitslosigkeit, Lohndrückerei und Sozialabbau.
Ernstzunehmende Verfassungsrechtler analysieren weiterhin, dass wir vor einer Auflösung unserer verfassungsrechtlichen Institutionen stehen, weil sich die politische Klasse verselbständig habe. Die Kontrolle durch das Volk funktioniert nicht mehr. Stimmt das, so ist es nur konsequent, wenn Hans Herbert von Arnim unser politisches System als Pseudodemokratie bezeichnet. Der Sozialdemokratie stünde es jedenfalls gut an, diese Debatte anzunehmen, zum ersten Verfechter des demokratischen Gedankens in Deutschland zu machen, anstatt einzelnen Vertretern zu gestatten, mit in anderen politischen Systemen entwickelten Verleumdungstechniken ihnen Unangenehme zu erledigen. Der Hofgeismarkreis hat die Debatte zum Wesen der Demokratie in Deutschland begonnen, sie harrt einer Fortsetzung.
Wie durch den historischen Hofgeismarkreis vorgezeichnet, gewinnen im Rahmen einer Demokratie-Debatte auch die Worte Nation bzw. Volk eine besondere Bedeutung. Das Volk ist nämlich in jeder Demokratie, die diesen Namen verdient, der Träger des Staates, der Souverän. Theoretisch kann man dieses Volk als Summe aller Einzelmenschen auffassen, die nichts als das Faktum, dass sie zufällig im gleichen Staatsgebiet leben, gemeinsam haben. Dies kann allerdings kein sozialdemokratischer Ansatz sein, wenn im Sinne Hellers Sozialismus als Kulturaufgabe zu verstehen und damit auch die immer feinere Ausprägung der einzelnen Nationen als kulturelle Bereicherung der Welt verbunden ist, ja wenn Demokratie nicht nur als formale Struktur begriffen, sondern auch gelebt werden soll.
Auf den Willen des Volkes müssen sich in einer Demokratie in ununterbrochener Legitimationskette alle politischen Entscheidungen zurückführen lassen. Da es ein europäisches Staatsvolk nicht gibt und es auch auf absehbare Zeit illusorisch ist, dass ein solches künstlich (durch Zusammenschluss der einzelnen Nationalstaaten zu einem neuen Bundesstaat) erschaffen wird, stellt sich die Frage nach der demokratischen Legitimation der mit immer mehr Kompetenz ausgestatteten europäischen Behörden. Darüber hinaus ist die Frage zu klären, wie die sozialdemokratische Linke sich eine für einen europäischen Parlamentarismus notwendige künstliche Verschmelzung von historisch gewachsenen Nationen überhaupt vorstellt und wie sie eine als Worthülse angebetete multikulturelle Gesellschaft demokratisch organisieren will. Um solche Fragen hat sich die Linke in der Sozialdemokratie zugunsten platter Lippenbekenntnisse bisher aus gutem Grund gedrückt. Hier warten interessante Probleme für eine Debatte des Hofgeismarkreises.
Deutschland erneuern
Mit Gerhard Schröder will die Sozialdemokratie in diesem Jahr wieder den Kanzler des Nationalstaates Deutschland stellen. Das Land, das dieser regieren will, ist industriell in die zweite Liga abgestiegen, es ist in keiner technologischen Schlüsselindustrie des 21. Jahrhunderts führend, die Arbeitslosenzahl liegt bei über vier Millionen, Innovationen fehlen; der Rückgang unserer Leistungsfähigkeit ist unübersehbar. Wie will eine regierende Sozialdemokratie dieses Land aus der Krise wieder an die Spitze der Welt führen (wenn sie das will), ohne einen letztendlich vom Volk getragenen nationalen Aufbruch? Wer von gemeinsamen Opfern spricht, kann von der Nation nicht schweigen.
Der Hofgeismarkreis hat in den letzten Jahren intensiv die Fragen der sozialdemokratischen Geschichte sowie der Aufarbeitung von kommunistischem und nationalsozialistischem Unrecht bearbeitet. Mit Hilfe von Friedrich-Ebert-Stiftung und Kurt-Schumacher-Gesellschaft hat diese Diskussion zu sehenswerten Ergebnissen geführt. Zur Deutschland erneuernden Kraft ist die SPD hingegen bisher nicht geworden. Es ist deshalb an der Zeit, nun verstärkt Lösungsmodelle für die Fragen unserer Zukunft zu erarbeiten, wie ich sie in den letzten Absätzen angedeutet habe. Dabei sollte uns der Grundsatz der Untrennbarkeit von nationalem und internationalem Gedankengut leiten, eine Verabsolutierung des nationalen Gedankens müssen wir vermeiden. Zurückgreifen sollten wir nicht nur auf die staatstheoretische Diskussion des historischen Hofgeismarkreises, sondern auch auf dessen Diskussionskultur. Geistige Freiheit müssen wir uns nehmen, obwohl mancher versuchen wird, uns daran zu hindern. Die westdeutsche antinationale Linke hat sich aus der politischen Debatte bis auf wenige Ausnahmen abgemeldet. Sie hat genug damit zu tun, ihren ideologischen Herrschaftsanspruch zu verteidigen. Gerade deshalb aber sollten wir uns mit allen unkonventionellen Gedanken, sollten sie sich nun als links, rechts oder überhaupt nicht in die herkömmliche Skala passend vorstellen, sorgfältig auseinandersetzen. Unsere Aufgabe könnte es sein, eine heute winzige nationale Linke zu stärken. Für die alte Rechte war die Nation im Zweifel nur Vorwand für die Durchsetzung egoistischer Gruppen- bzw. Klasseninteressen, die dann sogar zur Übersteigerung in einen aggressiven Nationalismus führen konnten. Nationales, untrennbar verbunden mit sozialem Denken und eine rechte Positionierung passen nicht zusammen. Dieses Land braucht eine nationale Linke, weil die Nation als einzige Grundlage, auf der Demokratie und Sozialstaat bestehen können, immer eine linke Angelegenheit gewesen ist.
Nachbemerkung der Redaktion: Unseres Wissens nach ist der „neue“ Hofgeismarkreis von 1992 mittlerweile sanft entschlafen. Die alte Kontaktadresse lautete auf Hofgeismarkreis, Postfach 10 11 33, 04011 Leipzig. Als nicht ganz uninteressante Publikation mit wichtigen Diskussionsbeiträgen zum Thema „nationale Sozialdemokratie“ sei der „Politische Rundbrief“ genannt, der von den Leipziger Genossen herausgegeben wurde.
Literaturhinweise (Auswahl):
Tilman Fichter: Die SPD und die Nation. Vier sozialdemokratische Generationen zwischen nationaler Selbstbestimmung und Zweistaatlichkeit, Berlin: Ullstein 1993 Peter Grasmann: Sozialdemokraten gegen Hitler 1933-1945, München: Olzog 1976 Hermann Heller: Sozialismus und Nation, Berlin: Arbeiterjugend-Verlag 1925 Peter Kratz: Rechte Genossen. Neokonservatismus in der SPD, Berlin: Elefanten Press 1995, kostenloser Download unter: http://home.snafu.de/bifff/buch3.htm Ernst Niekisch: Der Weg der deutschen Arbeiterschaft zum Staat, Mainz: Helios 1985 (Nachdruck der 1925 im Verlag der Neuen Gesellschaft, Berlin, erschienenen Schrift) Ernst Niekisch: Grundfragen deutscher Außenpolitik, in: Politischer Rundbrief des Hofgeismarkreises, April 1925 Ernst Niekisch: Locarno, in: Politischer Rundbrief des Hofgeismarkreises, Januar 1926 Franz Osterroth: Der Hofgeismarkreis der Jungsozialisten, in: Archiv für Sozialgeschichte 4/1964 Michael Rudloff (Hrsg.): Sozialdemokratie und Nation. Der Hofgeismarkreis in der Weimarer Republik und seine Nachwirkungen, Leipzig: Friedrich-Ebert-Stiftung 1995 Franz Walter: Nationale Romantik und revolutionärer Mythos. Politik und Lebensweisen im frühen Weimarer Jungsozialismus, Berlin: Europäische Perspektiven 1986 Heinrich August Winkler: Der Schein der Normalität. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1924 bis 1930, Berlin: Dietz 1988 |
| |
00:13 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, weimar, socialisme, années 20, social-démocratie, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 12 octobre 2009
L'exemple du héros
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
L'EXEMPLE DU HEROS
Dans la quatorzième livraison de la revue bimensuelle des Diipetes (Athènes, Grèce), un article de Thomas Mastakouri traite de la notion du Héros dans nos sociétés européennes antiques. Les idées développées par l'auteur, tout en étant discutables, ont cependant le mérite de nous interpeller et nous invitent à une profonde auto-réflexion critique.
Nous vivons à une époque de grande aliénation morale et il va de soi que de puissants intérêts économiques nous dirigent. Pour que ceux-ci puissent continuer à croître, ils n'ont besoin que d'une chose: transformer la masse des individus en troupeau, le citoyen devenant une unité docile, ne réagissant qu'en fonction de la volonté et des avantages des bergers. L'avilissement, la destruction de la personnalité sont à l'ordre du jour et la passivité a gagné la plupart des hommes. Qu'en est-il des réactions éventuelles? Qu'entend-t-on le plus souvent? “Laisse tomber”, “c'est un mauvais moment à passer”, “c'est nous qui allons sauver le monde?”, “il y a pire”, “on est bien comme ça”, etc... Et ceux qui tentent de réagir? Des mots creux, quelques insultes devant l'image du politicien qui apparaît sur le petit écran en attendant le jeu télévisé habituel avec ses cadeaux et ses starlettes.
La voie suivie aujourd'hui par l'humanité est celle du martyr; celui qui baisse la tête, parce qu'il a été ainsi éduqué par sa religion, ses gouvernants, son école, et ses parents. Mais est-ce que cela a toujours été ainsi et plus particulièrement dans nos contrées? Celui qui a quelques connaissances historiques et un peu d'esprit critique connaît la réponse. La civilisation qui, à une époque, a régné sur cette terre hellène ne se fondait pas sur l'exemple du martyr et de l'esclave mais sur celle du Héros qui, comme une flamme, se cache dans chacun d'entre nous et ne se transforme que rarement de nos jours en feu pour réchauffer, éclairer, brûler et se consumer.
L'hellénisme et la civilisation européenne en général ne se sont pas fondés sur la notion de masse comme d'autres civilisations antiques pour bâtir le monde contemporain mais au contraire sur celle de la personne.
Nos ancêtres adoraient les Héros comme des Dieux. Pour eux, il n'y avait pas de gouffre entre l'Homme et le Dieu et chaque Cité hellène honorait certains de ses morts comme des Déités. Ainsi, Athènes honorait Thésée et Cecrops, Sparte Castor et Pollux, les frères jumeaux d'Hélène et Clytemnestre, Thèbes Kadmos, la Théssalie Jason, l'Etolie Méléagre, la Crête Minos, Corinthe Belléphoron. Les Héros, mythiques ou historiques représentaient des exemples moraux et chaque Cité-Etat avait les siens exactement comme les saints patrons par la suite. Les Héros se réveillaient de leur profond sommeil et apparaissaient dans des circonstances de crise pour sauver leur cité chérie d'un danger qui les menaçait. Ainsi, Thésée apparut aux Athéniens avant la bataille de Marathon et la légende dit que les Galates furent mis en déroute à Delphes par le fantôme de Néoptolème, le fils d'Achille. Cet article n'a pas pour but de dresser la liste de tous les Héros du passé mais de mettre en valeur les caractéristiques essentielles de leur comportement qui servait de modèle à nos aïeux et a profondément transformé et relevé la civilisation hellène. Vivant, comme nous l'avons dit, à une époque de relachement et de dégénérescence des consciences, la mise en relief de ces particularités pourra sûrement nous fournir des armes qui nous permettraient de lutter contre l'aliénation qui menace de toutes parts.
Ainsi, le premier caractère du Héros est son individualité absolue. Il n'est jamais intégré dans la masse et ne suit ni ses réactions ni ses désirs. Sa volonté est exclusivement la sienne et, s'il devait être influencé par une quelconque obligation morale, il le fait sciemment, conscient des limites qu'il s'impose. L'héroïsme ne peut se développer au sein d'une société despotique que celle-ci soit théocratique ou absolutiste.
En second lieu, le Héros aime le changement. Sans évolution, quelque chose dort en nous et ne se réveille que rarement. Bien qu'il contribue à l'instauration de l'ordre au sein d'une société chaotique, lui-même préfère le désordre et l'incertitude. L'héroisme tel un aiguillon s'oppose aux acquis, refuse le compromis, secoue les fondements pourris d'une collectivité. Tout est en perpétuel mouvement, disait le grand philosophe Héraclite, et toute société figée, sans Héros pour la sortir de son marasme est, à plus ou moins long terme, vouée à disparaître. C'est ce qui est arrivé aux anciens Egyptiens. Pendant des millénaires, ils ont bâti une civilisation dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui. Cependant, leur système despotique et théocratique étouffait toute individualité. Qui peut nous citer un grand Héros égyptien? Quelqu'un —à l'exception des pharaons— qui, dans un éclat d'individualité ait fait évoluer l'Histoire?... Qu'en est-il advenu de cette brillante civilisation? Elle est enterrée sous les sables de l'Histoire, faute de Héros.
Les re'igions étrangères se sont abattues sur un empire romain décadent dont l'absolutisme démentiel s'était attelé à supprimer toute forme d'individualité et à niveler les membres de la société. Dès le début, le modèle du Héros fut remplacé par celui du martyr. Celui de l'individu qui se donne à une collectivité souveraine, un Dieu, un Gouvernement, un Empereur. L'exemple de celui qui vit et meurt sans se poser de questions, ne remet pas en cause les Dogmes qui lui sont imposés, croyant aveuglément et se remettant à d'autres pour son salut, sa protection et sa sécurité.
Certains confondent à tort Héros et martyr. Comme nous l'avons déjà dit, le Héros se bat jusqu'à son dernier souffle, ne rend jamais les armes, ne subit pas passivement son destin. Son principal souci consiste à valoriser l'immortalité de son âme, à la perfectionner au fil des luttes afin de gagner sa place parmi les Dieux et ce, sans l'aide de personne.
Il n'ignore pas que le combat est inhérent à la nature humaine, qu'il ne peut y avoir de progrès sans les contraires. Il ne s'avoue jamais vaincu même s'il sait que tout est perdu d'avance. Il place sa dignité et son honneur au-dessus des problèmes quotidiens. Ainsi, Achille était conscient de son destin funeste s'il devait venger la mort de Patrocle mais cela ne l'a pas empêché de le faire. Cucchulainn, le plus grand des Héros irlandais n'a pas hésité à prendre les armes alors même que son druide-instructeur lui avait prédit qu'il allait connaître la gloire et la grandeur mais qu'il allait en mourir avant que ne lui pousse un seul cheveu blanc sur la tête. Lorsque le dragon Fafnir, agonisant, menace Siegfried de sa malédiction, ce dernier lui répondit que bien que chacun voulut garder ses trésors pour toujours, l'heure de la mort arrivait pour tous. Ils sont tous Héros, c'est-à-dire des Hommes capables de défier leur destin et mêmes les Dieux s'ils pensent avoir raison où si une obligation morale le leur commande.
Il vient en aide aux faibles et aux veillards mais ne supporte ni les fainéants, ni les profiteurs et les voleurs. Il les considère comme des “fardeaux de la terre”, un poids pour la Terre-Mère. Il sait être courageux face au danger et patient devant les difflcultés de la vie quotidienne sans pour autant rechercher l'affliction et l'adversité. Il sait profiter des joies de la vie là où il les trouve, en écoutant une chanson, après un baiser, devant un endroit idyllique ou l'hilarité d'un enfant par ce qu'il sait que chaque instant est unique et qu'il ne se reproduira peut-être jamais. De plus, il n'est pas stupide. Il sait utiliser son intelligence chaque fois qu'il en a besoin. Il représente la supériorité de l'Homme face à l'animal. Il sait rire avec ses propres malheurs, car le rire est comme le vent qui chasse les nuages de la misère et du défaitisme. Il essaie de résoudre seul ses problèmes tout en respectant la Nature qu'il considère comme vivante et sacrée.
Les lectrices seront sans doute lasses d'entendre parler exclusivement de Héros masculins. En effet, les traditions européennes ne sont pas exemptes d'Héroïnes. Ainsi, la Béotienne Atalante tua les deux centaures qui avaient tenté de la violer, participa à l'expédition des Argonautes et fut la première à toucher le sanglier de Calydon au cours d'une chasse. La reine Kathe initia Cuchulainn à l'art de la guerre. La reine des Iceni de Grande-Bretagne, Boudicca (Bodicée), “la victorieuse” conduisit son armée contre l'envahisseur romain, mettant hors de combat de nombreuses légions. Tacite racontait que les femmes germaniques combattaient aux côtés de leurs hommes. Les Déesses étaient, dans l'antiquité, aussi nombreuses que les Dieux et étaient honorées et adorées avec la même ferveur. Cependant, le fait de tenir.une épée et de combattre comme un homme ne suffisait pas pour faire d'une femme une Héroïne. Antigone représente le modèle le plus significatif de l'Héroine qui ne renonça ni à son dévouement ni à sa grandeur d'âme pour lutter contre le pouvoir en place tout en sachant qu'elle allait connaître une fin atroce. Mais avec l'avènement d'un système patriarcal étranger à l'Europe, la femme allait bientôt être transformée en simple objet sexuel et de procréation.
Et aujourd'hui qui pourrait être considéré comme Héros? Citons quelques exemples: l'employé qui refuse de contribuer à s'enrichir sur le dos des autres tout en sachant qu'il risque de perdre son emploi, la mère qui élève seule son enfant et affronte avec fierté les ragots du voisinage, celui qui éteint sa télévision pour lire un livre ou écouter de la musique, la femme qui décide d'entreprendre des études dans une école qui n'admettait auparavant que des hommes. L'héroïsme se reconnaît à des milliers de petites et grandes choses de la vie quotidienne.
Les modèles de références de nos ancêtres étaient leurs propres Dieux. Les Olympiens, les Dieux des Celtes et ceux des Scandinaves étaient eux-mêmes des Héros, c'est-à-dire des êtres qui luttaient contre leur propre destinée, se battant comme les Hommes, avec leurs défauts et leurs qualités, à la recherche de leur propre éveil.
Les anciens Dieux n'étaient pas invincibles ni savants ni des modèles de bonté et cela les rapprochait des humains par rapport au Démiurge souverain, sans visage et inapprochable. Que cela n'en déplaise à certains, les anciens Dieux ne prodiguaient pas que des faveurs, ils ne considéraient pas tous les individus de la même façon. Ce n'est que grâce à son propre degré d'éveil que l'Homme pouvait atteindre l'Olympe, le Valhalla ou les Iles des Bienheureux. Les autres entamaient la descente dans le monde d'en bas dans l'attente de leur prochaine réincarnation et tenter à nouveau de se détacher de ce cycle infernal en accédant à la divination. Avec l'avènement de la nouvelle religion, le serviteur fut mis au même pied d'égalité que le maître et, pire encore, le Héros fut considéré comme un Homme ordinaire. Le régime totalitaire de l'ancienne et de la nouvelle Rome ne pouvait fonctionner autrement. Tous devaient être égaux sous la férule du Régime, de l'Empereur et de Dieu. Les conséquences ne se sont pas faites attendre. Chaque science ou philosophie contraires au dogmes ambiants étaient éradiquées. Toute recherche de la Beauté était considérée comme un tabou. Toute liberté de pensée et de choix fut condamnée. Ceux qui s'exprimaient différemment des normes établies étaient considérés comme hérétiques, jetés dans des geôles et brûlés vifs.
Les guerres des anciens fondées sur les mises en valeur individuelles et qui pouvaient être comparées à des scènes théâtrales ont cédé la place aux guerres d'intérêts ou de religions, inconnues jusqu'alors et qui ont tant fait couler de sang sur notre vieux continent. Le Héros guerrier a cédé la place au combattant sans volonté, simple pion au service d'un stratège qui, autrefois, dirigeait les combats sur le terrain, aujourd'hui, du fond d'une salle, entouré de spécialistes en guerres de tous genres, décide des batailles en se fondant sur des chiffres, des statistiques et des comparaisons. Le citoyen inconscient a, depuis fort longtemps, perdu son identité à l'exception d'un pseudo-droit ou obligation de voter de temps en temps pour ceux qui le dominent, sans pour autant qu'il puisse réellement s'exprimer sur la manière dont il est gouverné. L'agriculteur, l'artisan, le philosophe se sont mués en unités de consommation, qui doivent acheter de plus en plus en suivant les prescriptions de la publicité et du marché, indifférents à la catastrophe écologique qui se produit autour d'eux.
L'amour, ce cadeau des Dieux, cette communion des corps et des esprits, tel un feu ardent, a été transformé en péché, dépravation alors qu'au même moment il est utilisé de la façon la plus vile qui soit pour placer toutes sortes de produits auprès de récepteurs décérébrés jusqu'à leur dicter des modes de comportements. L'Homme sain qui était en contact permanent avec ses Dieux a, aujourd'hui, besoin d'intermédiaires, de “représentants de Dieu” sur Terre auto-proclamés, sous la menace permanente d'une damnation éternelle s'il lui venait à l'idée de douter ou de contester les dogmes en place. L'acception même de la notion de Héros a été déformée de la façon la plus ignoble qui soit, lorsqu'elle est utilisée de nos jours pour décrire des individus qui ne savent pas placer correctement trois mots mais se contentent simplement de planter quelques ballons dans des filets ou des paniers, vêtus comme des publicités ambulantes aux couleurs des généreux sponsors qui les financent. Les anciens Olympiens concouraient pour la gloire et un rameau d'olivier, les “héros” d'aujourd'hui pour la belle voiture que leur offrira le Président ainsi que les nouveaux et juteux contrats qui les attendent.
Un Homme censé ne peut qu'être affligé devant une telle situation. La voie du martyr, de l'individu aveuglé et passif qui confie son destin entre les mains de tierces personnes a conduit la société au bord du précipice. Que peut faire celui qui veut résister? Qui a la volonté de réagir différemment du bétail? La réponse est simple; il doit avoir du courage et continuer à être lui-même. S'il rencontre des compagnons qui partagent des points de vue identiques, entrer en contact avec eux sans pour autant abandonner son individualité. Le Héros n'a point besoin de maître ou de gourou car personne ne pourra le sauver à part lui-même.
Aussi, si vous ne craignez pas de vous promener dans des endroits sombres et affirmer que vous êtes dans le vrai; si vous croisez un enfant et que vous avez envie de jouer avec lui, de même que si vous rencontrez un vieillard et que vous voulez partager ses connaissances; si pour vous l'amour est un cadeau irremplaçable et non quelque chose dont vous avez honte; si chaque défi n'est pas pour vous ni trop difficile pour l'affronter ni trop facile pour l'ignorer; si vous permettez à chacun d'exprimer son opinion sans pour autant vous faire influencer; si vous voulez vider le verre de la vie jusqu'à la dernière goutte sans craindre les conséquences; si vous vous sentez ainsi, alors vous êtes sûrement sur le chemin du Héros. Et ceux qui regardent des cieux la destinée des Hommes doivent sûrement êtres fiers de vous.
Thomas MASTAKOURI.
(traduit en français par Nikiforos PERIKLIS).
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : grèce, grèce antique, antiquité, histoire, mythologie, paganisme, traditions, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 11 octobre 2009
L'Amiral Raphael Semmes, héros sudiste
 Klaus GRÖBIG:
Klaus GRÖBIG:
L’Amiral Raphael Semmes, héros sudiste
Il y a 200 ans naissait celui qui devriendra le “Requin de la Confédération”
Raphael Semmes est né le 27 septembre 1809 à Charles County dans le Maryland, l’Etat de l’Union dont le Parlement, par l’intervention musclée et autoritaire de Lincoln, n’a pas pu décider seul s’il allait ou non rejoindre la Confédération. En 1826, Raphael Semmes s’engage comme matelot dans l’US Navy et, plus tard, lors de la guerre contre le Mexique, il commandera le brick “USS Somers”. En avril 1861, Semmes met un bâtiment en service, pour le compte de la Confédération, le “CSS Sumter”. Il fut l’un des rares officiers de marine expérimentés qui s’engagea pour la cause sudiste. Il devint donc d’abord le capitaine de ce vapeur de commerce, transformé en croiseur, et emporta, avec lui, ses premiers succès, en coulant de nombreux navires de commerce du camp yankee. Finalement, le “CSS Sumter” mobilisa contre lui de nombreux bâtiments de guerre de l’Union, chargés de le repérer; ainsi, Semmes contribua à alléger le blocus des ports de la Confédération. Dans les Caraïbes, devant les côtes du Brésil et à proximité des Açores, Semmes lançait ses opérations avec son croiseur. En avril 1862, il dut voguer vers Gibraltar pour y parfaire des réparations; pendant le trajet, il avait rencontré trois navires de guerre de l’Union, qui entendaient bien couler le “CSS Sumter”. Ils l’attendent devant Gibraltar. En un trourne-main, Semmes vend alors le “CSS Sumter”, fort abîmé, à un armateur anglais, quitte le port de Gibraltar avec tout son équipage et se rend en Angleterre.
Là-bas, le croiseur auxiliaire “CSS Alabama” venait d’être achevé dans un chantier naval: Semmes le met en service le 24 août 1862 à proximité des Açores. L’équipage du nouveau croiseur était constitué d’un mélange bigarré d’Américains et d’Européens. Parmi les vingt-huit officiers du croiseur, il y avait deux sujets prussiens, un Irlandais, trois Britanniques et trois ressortissants d’Etats de l’Union. Les autres officiers venaient tous d’Etats de la Confédération. Dans l’équipage, on comptait également un homme de couleur, ce qui est difficile à faire comprendre aujourd’hui, à tous ceux qui sont prisonniers des schémas inamovibles et intangibles du “politiquement correct”. Les qualités de chef de Semmes étaient hors du commun, de même son charisme personnel. Le 5 septembre 1862, le “CSS Alabama” emporte sa première victoire. Il en remportera au total quatre-vingt contre les bâtiments ennemis (certaines sources disent qu’il n’en a remporté “que” soixante). Le 10 janvier 1863, Semmes est devant la côte du Texas pour tenter d’entamer le blocus yankee: il y rencontre le croiseur “Hatteras” de l’Union et le coule à coups de canon, en tout six coups au-dessus de la ligne de flottaison. Il sauve 118 marins de l’Hatteras, les prend à son bord et met le cap sur la Jamaïque, pour y faire réparer les dégâts encaissés lors du combat. Ensuite, partout, Semmes a laissé sa “carte de visite”: dans l’Atlantique Nord comme dans l’Atlantique Sud, au cap de Bonne Espérance et dans l’Océan Indien. Au printemps 1863, dans l’Atlantique Sud, il forme équipe avec deux croiseurs auxiliaires, les “CSS Florida” et “CSS Georgia”.
Le 11 juin 1864, le “Requin de la Confédération” mouille dans le port normand de Cherbourg. A l’arsenal bien équipé de la marine de guerre française, Semmes espère pouvoir faire exécuter tous les travaux de réparation nécessaires. Il estime que cela durera deux mois. Le sort de la guerre était à ce moment-là très défavorable pour les Sudistes. En Europe, tous escomptaient désormais la victoire de l’Union. Le Président Lincoln adressait des menaces aux Européens qui oseraient encore soutenir la Confédération. Les Français se révélèrent maîtres en matière de diplomatie. Le commandant du port de Cherbourg expliqua à Semmes que les installations du chantier naval étaient la propriété de la marine française et, de ce fait, réservées exclusivement aux navires de guerre français. Mais, ajouta-t-il, au Havre, il y avait un chantier naval privé, avec cale sèche, où il pouvait faire exécuter les travaux nécessaires. En attendant, le Capitaine John A. Winslows, du croiseur “USS Kearsarge”, venait d’arriver devant les côtes françaises. Le dimanche 19 juin 1864, très tôt le matin, le “CSS Alabama” quitte Cherbourg à toute vapeur. Le combat se termina en faveur des Nordistes et le “CSS Alabama” fut coulé. Au grand dam des Yankees, un yacht privé britannique, le “Deerhound”, prit à son bord Semmes, blessé, et quelques-uns de ses officiers. Entre-temps, le blocus yankee se faisait de plus en plus hermétique; pour rentrer au pays, Semmes dut faire le détour par un port mexicain.

Pour défendre Richmond, la capitale sudiste, on mit sur pied une flotille fluviale. Semmes fut promu amiral et obtint le commandement du “James River Squadron”. Après la chute de Richmond, Semmes fut contraint de couler ses bateaux. Ses matelots sont alors versés dans l’infanterie et Semmes, avec le grade de général de brigade, reçoit la mission de commander ses propres hommes devenus fantassins. Même après la capitulation de l’armée de Virginie du Nord, qui avait été commandée par le Général Lee, Semmes ne déposa pas les armes. Le 30 août 1865, l’armée du Général Joseph E. Johnston doit capituler à Raleigh.
Gideon Wells, le ministre de la marine de l’Union, qui ruminait vengeance, fit arrêter Semmes en décembre 1865. Quelques avocats marron, sous la houlette du Colonel US J. A. Bolles, furent chargés de collationner des faits ou des ragots pour construire de toutes pièces une accusation de “crime de guerre”. Mais rien de ce genre ne pouvait être reproché à Semmes. La volonté de fabriquer de tels “procès” démontre que la guerre civile américaine était, sur ce chapitre, une guerre bien “moderne”, car les crimes flagrants des Yankees, comme par exemple la marche en avant de Sherman, qui ravagea tout en Géorgie, n’a jamais fait l’objet d’une “enquête” similaire. Semmes eut toutefois plus de chance que d’autres généraux de la Confédération. Il fut libéré assez rapidement, devint professeur et connut le succès économique comme éditeur de journaux.
Semmes meurt le 30 août 1877. Il venait de rendre visite à sa fille, chez qui il avait mangé des scampis gâtés. Les médecins sont arrivés trop tard pour enrayer l’intoxication alimentaire. Semmes fut enterré dans le cimetière catholique de Mobile en Alabama, situé dans la Government Street, à côté de son épouse. On peut encore se recueillir sur sa tombe aujourd’hui.
Klaus GRÖBIG.
(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°40/2009; trad. franç. : Robert Steuckers).
Pour en savoir plus:
Lire le cahier n°146 de la série “Schiffe – Menschen – Schicksale” (= “Navire – Hommes – Destins”) qui paraît chez l’éditeur Rudolf Stade, à Kiel.
(ndt) : Ajoutons aussi l’excellente notive biographique sur Raphael Semmes dans Helmut Pemsel, “Biographisches Lexikon zur Seekriegsgeschichte”, Bernard & Graefe Verlag, Koblenz, 1985.
En français:
Se référer à l’ouvrage d’Indro Montanelli et Mario Cervi, “Les guerres américaines – la Sécession”, Ed. Atlas, Paris, 1985 (traduction française: Philippe Conrad); cf. le chapitre intitulé “Corsaires et sous-marins”, pp. 123 et ss.; lire également, Dominique Venner, “Gettysburg”, Ed. du Rocher, Paris, 1995; plus particulièrement: le chapitre intitulé “Une armée et une marine surgies de rien”, pp. 93 à 111.
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, etats-unis, confédérés, guerre de sécession, marines de guerre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 10 octobre 2009
M. van Creveld: un regard sur les causes des victoires et des défaites au 20ème siècle

Michael WIESBERG:
Martin van Creveld: un regard sur les causes des victoires et des défaites au 20ème siècle
Martin van Creveld est Israélien: il vit à Jérusalem et est historien militaire de réputation internationale. Dans les démonstrations de son ouvrage le plus récent, il reste fidèle à lui-même en analysant les conflits armés qui ont sévi sur la Terre depuis 1900. Etre fidèle à soi-même signifie, ici, conserver en toute conscience un argumentaire froid, dépourvu d’émotions, qui ne tient quasiment pas compte des habituels aspects “moralisateurs”, car ceux-ci ne s’avèrent jamais pertinents. Le point de départ de toute l’argumentation de van Creveld est uniquement celui de l’efficacité militaire, ce qui irritera à nouveau tous ceux qui ont pris l’habitude de poser l’histoire des conflits comme l’équivalente de l’histoire des crimes de guerre.
Ce point de départ conduit van Creveld à examiner l’armée impériale allemande et la Wehrmacht sur base de leurs seules vertus militaires et de leurs seules capacités à résister jusqu’au bout: il ne tient compte d’aucun autre critère. Ce n’est pas la première fois que l’on découvre une telle approche sous la plume de van Creveld: déjà, dans son livre intitulé “Kampfkraft” (= “Force combattive”), où il compare la Wehrmacht et l’US Army, il exprime son respect pour les forces allemandes parce qu’elles avaient une plus puissante “force combattive” que leurs adversaires, même lors de la phase finale du conflit. Dans son nouvel ouvrage, van Creveld n’évoque qu’en marge les conditions préalables à cette “force combattive”, notamment ce qu’il appelle “l’institutionalisation des hautes prestations militaires” par l’état-major général allemand et que l’historien militaire américain Trevor N. Dupuy avait dûment examiné dans son livre “Der Genius des Krieges” (= “Le génie de la guerre).
Le nouvel ouvrage de van Creveld tourne essentiellement autour d’une question: quelles sont les raisons décisives qui font que l’on gagne ou que l’on perd une guerre? Pour y répondre, van Creveld nous offre une promenade dans l’histoire militaire du 20ème siècle, partant de la Bataille de la Marne pour aboutir à l’invasion américaine de l’Irak. Au cours de cette promenade, il fait une pause et nous résume brièvement sa thèse pour la première moitié du 20ème siècle: “L’histoire de l’art de la guerre de 1914 à 1945 correspond (...) pour une bonne part à l’histoire de l’armée allemande, à ses manières de procéder et aux réactions de ses adversaires face à ses initiatives”.
Mais, alors, deuxième question, pourquoi l’armée impériale de Guillaume II et ensuite la Wehrmacht ont-elles finalement échoué? Martin van Creveld explique principalement cet échec par la situation géopolitique de l’Allemagne, une situation géopolitique difficile dont les sphères politiques, qui gouvernaient l’Allemagne, n’ont pas tenu suffisamment compte. A titre d’exemple contraire, notre auteur cite l’Angleterre: face à cette puissance, située en marge du continent européen mais ouverte sur toutes les mers du globe, les Allemands n’ont ni prévu ni mis en oeuvre une stratégie cohérente visant son élimination définitive, ni pendant la première guerre mondiale ni pendant la seconde. Pour y parvenir, les Allemands auraient dû déployer une stratégie globale, qui aurait mis l’Angleterre en échec sur le plan économique. Cette impéritie géopolitique allemande dérive certainement du fait que ni l’Allemagne impériale ni l’Allemagne hitlérienne ne voulaient au départ faire la guerre à l’Angleterre. Cette bienveillance allemande, poursuit van Creveld dans sa démonstration, n’excuse nullement l’impéritie, dont le Reich a fait preuve, deux fois consécutivement, car, en effet, les infléchissements de la politique allemande, juste avant 1914 et juste avant 1939, laissaient bel et bien prévoir un heurt avec l’Angleterre. Les Allemands n’ont donc pas, selon van Creveld, développé un programme politique et géopolitique cohérent, appelé à connaître le succès, pour l’éventualité d’une guerre contre l’Angleterre; c’est là qu’il faut voir l’une des raisons majeures de la défaite décisive subie par l’Allemagne lors des deux guerres mondiales.
Dans son livre, van Creveld démontre avec brio que le visage de la guerre s’est modifié rapidement au cours de la première moitié du 20ème siècle, vu les innovations techniques. Mais, en dépit de la nouvelle donne qu’elles constituent, les innovations techniques ne sont qu’une face de la médaille; l’autre face, c’est la puissance économique et la capacité à déployer une production de masse, qui y est liée. C’est ce que van Creveld appelle la “mobilisation des ressources”. C’est bien sûr cette capacité-là qui a fait la décision au cours des deux guerres mondiales. Les ingénieurs allemands ont peut-être été les plus créatifs mais le rouleau compresseur matériel des Alliés, surtout après l’entrée en guerre des Etats-Unis, s’est montré irrésistible. Martin van Creveld rappelle: “Du point de vue technique, les Allemands se sont montrés très inventifs. Et, de fait, nombreux sont ceux qui affirment que tous les systèmes d’armement qui ont été déployés de 1945 à 1991 (...) avaient déjà été ébauchés en 1944/1945 dans des bureaux d’étude allemands”.
Mais cette inventivité foisonnante avait aussi un revers: “Elle a eu pour résultat qu’un très grand nombre de modèles, types et versions différents de ces armements a été fabriqué”, ce qui a entraîné de fréquentes modifications dans les cycles de production et d’interminables problèmes d’entretien. Pour ne citer qu’un seul chiffre, rien que le groupe d’armées du Centre avait besoin, à la fin de l’année 1941, d’un million de pièces de rechange pour être à même de poursuivre le combat.
En outre, ce fut Erich Ludendorff, qui, très influent du côté allemand pendant la première guerre mondiale, avait prévu, de la manière la plus réaliste, la forme que prendrait bientôt la “guerre totale”. Les “visions” ludendorffiennes de la “seconde guerre mondiale” se sont parfaitement concrétisées. Le fait de citer ainsi Ludendorff prouve l’impartialité de van Creveld, car Ludendorff demeure encore et toujours une personnalité stigmatisée. Et van Creveld ne se borne pas à la citer mais, en plus, commente ses thèses de manière positive.
Aux Etats-Unis, cette mobilisation totale de toutes les ressources a débouché, en fin de compte, sur la bombe atomique dont l’utilisation, le 6 août 1945, représente, pour van Creveld, une mutation définitive dans l’histoire de la chose militaire. Après le lancement de cette première bombe nucléaire, il n’y a plus eu de confrontations directes entre grandes puissances militaires; on a assisté, tout au plus, à des “guerres par acteurs interposés”, dans les zones périphériques du monde. Lorsqu’une grande puissance militaire ou une superpuissance partait en guerre, c’était contre un adversaire qui, au mieux, était une puissance de second rang.
La seconde moitié du livre se penche, pour une bonne part, sur le phénomène de la “guerre asymétrique” et sur une question très actuelle: pourquoi les confrontations avec les groupes terroristes ou insurrectionnels ont-elles été perdues, malgré l’écrasante supériorité de leurs adversaires? Une raison: si ces conflits durent trop longtemps, alors intervient une phase d’usure et de démoralisation: les soldats les plus motivés sombrent alors dans la résignation, contre laquelle même la mobilisation la plus intense des armes de haute technologie ne peut rien faire.
Une telle situation doit s’éviter à tout prix. Pour tenter de nous expliquer comment y parvenir, van Creveld ne cite que deux exemples: d’abord, la stratégie adoptée par les Britanniques en Irlande du Nord contre l’IRA; ensuite, le procédé utilisé par le régime d’Assad en Syrie contre les frères musulmans locaux. Les Britanniques ont réussi, en renonçant consciemment à toutes armes lourdes, à reconquérir petit à petit la sympathie des Irlandais du Nord et de couper ainsi l’herbe sous les pieds de l’IRA. Le procédé utilisé par Assad contre la ville de Hama relève d’une stratégie toute différente: cette ville ayant été le centre névralgique des frères musulmans en Syrie, Assad l’a fait complètement raser, en exterminant bon nombre de ses habitants. Selon les critères de bienséance, nous avons affaire ici à un massacre pur et simple. Mais Assad a eu la paix et ce résultat lui donne raison a posteriori, constate sèchement van Creveld. On ne s’étonnera pas, dès lors, que le politologue berlinois Herfried Münkler, en lisant de telles thèses, écrit, dans une recension parue dans “Die Zeit” (Hambourg) qu’on peut certes tirer profit de la lecture du livre de van Creveld mais qu’elle s’avère aussi “accablante et irritante”.
Michael WIESBERG.
(recension parue dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°40/2009; trad. franç.: Robert Steuckers).
Références:
Martin van CREVELD, “Gesichter des Krieges – Der Wandel bewaffneter Konflikte von 1900 bis heute”, wjs-Verlag, Berlin, 2009, 352 p., 22,95 euro.
00:20 Publié dans Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : défense, guerres, militaria, histoire, 20ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 09 octobre 2009
G. Gentile: un filosofo en el combate
|
por Primo Siena ( http://www.arbil.org ) Asesinado en abril de 1944, en el clima de odio que envenenaba entonces a una Italia percutida por una trágica guerra civil, Giovanni Gentile, filosofo del "idealismo actual", ha recobrado un insospechado interés intelectual después de haber padecido de un largo olvido motivado por sectarias exclusiones. | |
| Una muerte anunciada En el verano bochornoso del 1943, Giovanni Gentile - encerrado en el pueblo campesino de Troghi, en los alrededores de Florencia, escribe en pocos meses Génesis y estructura de la sociedad, obra que lleva como subtítulo Ensayo de filosofía y que termina con un XIII° capítulo titulado La Sociedad trascendental, la muerte y la inmortalidad.Se trata de una conclusión impresionante, después de profundas reflexiones desarrolladas en los capítulos anteriores sobre el Estado, la Historia y la Política. En el último párrafo, hablando de la muerte el filósofo escribe: "La muerte es un hecho social. Quien muere, muere con respeto a alguien. Una absoluta soledad - que es algo imposible - non conoce la muerte, porque no realiza aquella sociedad de la que la muerte representa la disolución". Terminado el libro, Gentile regresa a Florencia en los primeros días de setiembre; y mostrando el manuscrito a un amigo antifascista (Mario Manlio Rossi, también filósofo) exclama: "Vuestros amigos ahora pueden matarme. Mi tarea en esta vida ha terminado". Palabras que suenan como un siniestro presagio de una muerte presentida y anunciada, que se cumplirá trágicamente pocos meses después. Un clima político sombrío, cargado de dramática incertidumbre, abrumaba la Italia de entonces, involucrada desde el año 1940 en la segunda guerra mundial. Mussolini, relevado del poder por un golpe palaciego autorizado por el rey Victor Emmanuel III° el 26 de julio, había sido reemplazado por el mariscal Pietro Badoglio, quien estaba solicitando un armisticio a los angloamericanos, anunciado públicamente el 8 de setiembre de 1943. Aquel armisticio, pedido sin previo aviso a la aliada Alemania - y definido sucesivamente por el propio general H.D.Eisenhower "un negocio sucio" - causó la partición de Italia en dos bandos: uno monárquico, encabezado por Badoglio con una coalición de seis partidos antifascistas en el sur de Italia bajo dominación militar angloamericana; el otro de signo republicano-fascista, denominado República Social Italiana (RSI) y liderado por Mussolini recién rescatado de prisión, bajo el alero militar alemán, en el resto de Italia. Todos estos acaecimientos impactan profundamente a Giovanni Gentile. Especialmente el armisticio, que él consideró más bien una rendición incondicional como era en verdad, lo inducía a preguntarse: "¿Por cual Italia podemos vivir, pensar, enseñar, escribir? ¡Cuando la patria desaparece, nos falta el aire, el aliento!" Después de un encuentro con Mussolini - en noviembre de 1943 - Giovanni Gentile asume la presidencia de la Academia de Italia en representación del gobierno de la RSI, mientras el territorio italiano es campo de batallas entre ejércitos extranjeros. En una carta a la hija Teresita, motiva su grave decisión escribiendo: "Hay que marchar como dicta la conciencia. Esto es lo que he predicado toda mi vida. No puedo desmentirme ahora, cuando estoy para terminar mi camino; rehusarse habría sido suprema cobardía y demolición de toda una vida". Coherente con esta postura, el 19 de marzo de 1944 - impulsado por el mismo sentimiento de piedad patriótica que lo había llevado a pronunciar un fuerte discurso en el Campidoglio de Roma el 24 de junio de 1943 - Gentile habla nuevamente a la nación italiana para celebrar el bicentenario del filósofo Juan Bautista Vico. Dejando de lado todo sofisma prudencial, él denuncia una vez más el peligro de una disolución espiritual que acabaría con pulverizar la unidad moral del pueblo logrando así un desastre social mucho más grave que las destrucciones materiales producidas por la guerra total que azota a la Italia entera. Concluye su magistral oración sobre el pensamiento de Vico con palabras que encierran un trágico sabor profético: "¡Oh, para esta Italia nosotros, ya ancianos hemos vivido…Por ella, si fuera necesario, queremos morir porque sin ella no sabríamos sobrevivir entre los escombros de su miserable naufragio!". Veintiséis días después (el 15 de abril), un grupo comunista de guerrilla urbana ultimaba a tiros el senador Giovanni Gentile al interior de su auto, frente a Villa Montaldo, su morada en las afueras de Florencia. Hora antes de caer asesinado, Gentile había abogado por la vida de algunos jóvenes antifascistas detenidos por los responsables de la seguridad interior del Estado. Recibiendo su "hermana muerte" en el remolino de la guerra civil, no en la quietud del hogar rodeado de afectos familiares, el filósofo del idealismo actual sellaba socráticamente su milicia cultural sustentada por la identificación entre el pensar y el obrar, el pensamiento y la acción como el modo más coherente de practicar la identidad entre filosofía y vida. Años después, el filósofo católico italiano Gustavo Bontadini, reflexionando sobre la trayectoria filosófica y existencial de Gentile, en el marco de actuación de sus últimas horas de vida, reconocerá en su muerte el cumplimiento perfecto del compromiso cultural y político de un filósofo quien había hecho de su vida una reductio artium ad tehologiam. La filosofía del "Idealismo actualista" La investigación filosófica de Giovanni Gentile reactualiza el idealismo de Hegel pero reformándolo según el siguiente principio básico: nada es ajeno al pensamiento. No existe una dialéctica de lo pensado, sino de lo pensante; por lo tanto es una grave equivocación hacer distinciones entre pensamiento práctico y pensamiento teorético, siendo el pensamiento la actividad creadora por excelencia, actividad que coincide con el acto de pensar en cuanto acto del espíritu. El autor de este acto del pensamiento es el sujeto siempre idéntico a sí mismo, mientras que el objeto existe sólo en tanto que es pensado: momento dialéctico necesario por el cual la multiciplicidad del pensamiento pensado se resuelve en la simultánea unidad del pensamiento pensante por medio del acto creador del Espíritu. De aquí arranca la filosofía del actualismo gentiliano que es también un espiritualismo. Gentile concibe el espíritu no como ser sino como actividad en la cual es inmanente toda realidad; por lo tanto nada existe que no pertenezca a la actividad del Espíritu como acto del puro pensar en su permanente y simultánea actividad. Este acto puro nunca es hecho porque siempre es acto que supera las barreras del tiempo y del espacio, creaciones del mismo Espíritu que no es estático sino dinámico en su permanente actuar. Dios, la naturaleza, el bien y el mal, el error y la verdad, el pasado y el futuro no subsisten fuera del acto de pensar en el que se identifican. Para Gentile entonces ser significa conocer y conocer es identificar. El Espíritu Absoluto, acto puro creador, se hace a sí mismo (autoctisi) en el proceso continuo del "acto de pensar en su actualidad", concepto expresado en italiano sintéticamente como "pensiero pensante"; y coincide con el proceso autocreativo del Yo Absoluto que se pone a sí mismo come objeto del pensamiento:"categoría única, lógica, y metafísica" a la vez; lo que no es un espejo de la realidad, son más bien el principio vivo, siempre actual del cual brota toda realidad. La experiencia de los cuerpos - escribió Giovanni Gentile en el Sumario de Pedagogía como ciencia filosófica (1913-14) - no es más que una modalidad de la experiencia del pensamiento. Algunos objetos del pensamientos son cuerpos, otros son ideas, otros más son números, pero todos pertenecen al acto del pensar, son ellos mismos pensamientos". En la filosofía gentiliana, los seres individuales caben como realizaciones empíricas y transitorias del Espíritu Absoluto donde el pasado siempre revive como presente y la historia misma, coincidiendo con el acto del puro pensar se identifica con la filosofía. La filosofía es, por lo tanto, la más alta y completa manifestación del Espíritu: auto síntesis cumbre del pensamiento que en Gentile como en Hegel es un proceso dialéctico de tres momentos, pero en la especulación filosófica gentiliana este proceso se realiza al interior del Espíritu mismo y no en la Idea que precede al Espíritu, como acaecía en Hegel. Se trata, según Gentile, de tres momentos de una única categoría y que constituyen un único proceso espiritual. El momento estético del Arte (tesis) es la expresión subjetiva que se manifiesta como "actividad pensante" en su esencia; el artista, libre y autónomo, crea un mundo que se identifica consigo mismo. El arte es moralidad que aporta serenidad quietud, catarsis purificadora de las pasiones. El momento de la Religión (antítesis) constituye la expresión objetiva del proceso dialéctico del Espíritu que, alejado de sí mismo, contempla a Dios como Objeto Absoluto. Finalmente la Filosofía constituye la síntesis del momento del Arte y del momento de la Religión: momento culminante del Espíritu que se realiza a sí mismo por el pensamiento y de tal modo afirma su identidad y unidad, sin pasado o futuro porque en sí mismo contiene todo el pasado y todo el futuro. La filosofía constituye entonces la conceptualización de la realidad, siendo que toda la realidad es pensamiento en acto. En ese sentido la historia es concebida siempre como historia contemporánea porque los hechos trascurridos están presentes en nosotros como hechos actuales; de aquí la definición de la filosofía de Giovanni Gentile como actualismo o idealismo actualista". La catolicidad controvertida del filósofo Gentile La reflexión filosófica de Giovanni Gentile - según comenta José Ferrater Mora - "es un pensar que trasciende toda mera subjetividad: es pensar trascendental y no sujeto que conoce, y meno aún sujeto psicológico". De este modo el actualismo gentiliano mediante el predominio del acto puro y absolutamente actual busca de resolver las contradicciones que plantea el pensamiento mismo (1). Pero una contradicción, por lo meno, permanece por cuanto concierne la cuestión religiosa, como bien observó en su tiempo el filósofo italiano Giuseppe Maggiore; quien, con respeto del filósofo Gentile, escribió: "El Cristianismo, refutado en las primeras rígidas posiciones del inmanentismo absoluto, penetró gradualmente en su pensamiento con una ansiedad insaciable, como una necesitad de liberación. Él pensó y vivió como hombre justo - vir iustus - en el sentido veraz del Cristianismo, lo cual enseña que para vivir dignamente hay que saber morir"(2). Con respeto del problema religioso, las polémicas hacia Gentile y su idealismo actualista no fueron pocas. A pesar de haber confesado públicamente su adhesión a la religión católica, su posición religiosa fue considerada cuanto menos heterodoxa. Un año antes de su trágica muerte, dictando en Florencia una conferencia titulada "Mi religión" Gentile proclamó: "Repito mi profesión de fe, guste o no guste a quien me está escuchando: yo soy cristiano porque creo en la religión del espíritu. Pero, para fugar todas dudas, quiero agregar: yo soy católico". Después de haber negado que la religión pueda ser un asunto privado, como sostienen los reformadores luteranos, Gentile destacaba el carácter jerárquico y social del catolicismo del cual aceptaba hasta las formulaciones dogmáticas: "Lo que la Iglesia Católica quiere enseñar es digno de ser recogido en todos sus dogmas por parte de cada espíritu cristiano, consciente de que la revolución obrada en el pensamiento y en la vida del hombre por el Evangelio, es un descubrimiento de la vida del Espíritu". Ahondando en su concepto de la religión afirmaba, mas adelante: "El acto del espíritu nunca será puro arte, ni pura religión, porque la sola religión que se da es aquella que se celebra en la efectiva vida del espíritu, donde todo su vigor se manifiesta en la síntesis del pensamiento. Por lo tanto la religión se alimenta y cultiva en la inteligencia, fuera de la cual se disuelve y desvanece (…). La religión crece, se expande, se consolida y vive en la filosofía que elabora sin cesar el contenido inmediato de la religión y lo introduce en la vida de la historia (…). Se quiera o no, la religión tiene que atravesar el fuego del pensamiento para no quemarse las alas que la sustentan en su vuelo hacia Dios". Esta confesión pública, más que una profesión incondicional de fe católica, en palabras de Gentile resultaba la confesión de fe en un catolicismo personal, propio en la medida en la que el filósofo lograba repensar por su cuenta los conceptos de la doctrina católica; lo que constituye la modalidad propia de la filosofía actualista de vivir una doctrina: esto es, pensarla para vivirla. Comentando el asesinato del filósofo, Armando Carlini, anotó: "Gentile, el gran defensor de la inmanencia y de la historicidad del espíritu, ha vivido toda su vida en una esfera de valores trascendentales, más allá del mundo pequeño, donde los hombres hacen la historia". Por otra parte, un antiguo alumno de Gentile, Mario Casotti, después de haber superado los limites del pensamiento actualista alcanzando las riberas de la filosofía aristotélico-tomista, había destacado como el idealismo moderno, a pesar de sus errores particulares, hubiera logrado asimilarse con el realismo ideal de la filosofía clásica por medio de la concepción gentiliana del Espíritu como Acto Puro, porque - había observado oportunamente Casotti - "el Acto sin mixtura de potencialidad" (esto es: Acto Puro), desde Aristóteles en adelante es el Ser Absoluto: es decir Dios". Giovanni Gentile representa la paradoja de una sincera fe católica conviviente con una filosofía poco compatible con la ortodoxia del catolicismo; pero compatible con el catolicismo (y con el espíritu italianísimo de Pio XII°, como bien anota Piero Vassallo, filosofo italiano de corte tomista) era la idea de pacificación política y civil profesada casi proféticamente en los tiempos últimos de su existencia: El hecho que muchos entre los más destacados discípulos de Gentile (pienso sobretodo en Armando Carlini y en Michele Federico Sciacca) hayan recorrido un itinerario filosófico que alcanzó un éxito católico, hace pensar en la existencia de un filón místico en Giovanni Gentile; lo que inducía al franciscano Padre Agostino Gemelli, rector de la Universidad católica de Milán, a escribir en la Rivista di Filosofia Neoscolastica (Junio de 1944), lo siguiente: "La barbara muerte ha truncado una posible evolución ulterior del pensamiento gentiliano, que en sus últimos años se había abierto más hacia una visión del Cristianismo auténtico" El controvertido catolicismo de Giovanni Gentile fue considerado, además, por el filosofo católico Gustavo Bontadini un testimonio de aquella reductio artium ad theologíam postulada por San Buenaventura y que aflora también en la dialéctica del idealismo actualista cuando postula el pasaje desde el filosofar hacia el vivir concebido como una plena participación a la vida del Espíritu que busca Dios - el Dios Uno y Trino - y se deleita en Él. Se trata de un ansia especulativa en la que se asoma el alma del creyente atraído por su voz interior y que anhela el privilegio de la sublime fulguración divina, perseguida durante toda una vida a lo largo de un interminable camino hacia Damasco, para alcanzar la luz de la revelación cristiana. Y por esa ansia fervorosa que acompañó a Giovanni Gentile en toda su vida, me atrevo a pensar que el bautismo cristiano en las aguas, recibido por él al nacer por elección de sus padres católicos, tuvo su misteriosa y providencial confirmación en el bautismo de la sangre al morir. El humanismo para los nuevos tiempos En su obra Reforma della scuola in Italia (1932), Giovannji Gentile afirma: "El cuerpo humano es a base de toda nuestra actividad espiritual porque el hombre es el único ser viviente capaz de desarrollar el acto puro de pensar". En el pensamiento reside entonces la misma realidad existencial del hombre, según la filosofía gentiliana interpretada sucesivamente como una expresión de un existencialismo positivo por Vito A.Bellezza y como un peculiar espiritualismo personalista por Francesco La Scala. Coherente con esta arquitectura especulativa, en su último ensayo de filosofía practica escribió: "La política es una actividad inmanente el espíritu human. Por lo tanto quien, sinceramente y conociendo el significado de la palabra, se propusiera de apartarse de toda política, debería renunciar a vivir". Pero la política debe nutrirse de una profunda moralidad, porque Gentile concibe la actividad política como expresión de una voluntad moral que obra en el hombre concebido como "Unidad dinámica de esencia y existencia, de cuerpo y alma, de sentimientos y pensamientos"; individuo que por ser personalidad humana dotada de experiencia concreta y de existencia histórica y social, es además voluntad universal que sustenta el reino del espíritu. Por consiguiente, la Sociedad y el Estado, según Gentile, no se manifiestan Inter homines sino In interiore homine. Para el filósofo del actualismo, en el individuo concreto se manifiesta la autoconciencia que resume en sí misma el espacio, el tiempo y la naturaleza. Por consiguiente en el individuo coincide la comunidad universal al interior de la cual el yo convive siempre con un alter, un socius que hace del yo un nosotros: términos inseparables y que borran todas diferencias entre ellos, porque yo y nosotros - afirma Gentile - somos unos mismos dentro del Sujeto Único y Absoluto que forma la sociedad ideal definida como Sociedad trascendental: síntesis espiritual de todos los moldes particulares y históricos de la vida asociada. El soporte socio-político de esta sociedad trascendental - dibujada en Génesis y estructura de la Sociedad - es el humanismo del trabajo definido como el humanismo de los nuevos tiempos que, después del humanismo literario y filosófico, se abre para abarcar toda forma de actividad del hombre, permitiendo que se le reconozca al trabajador la misma alta dignidad reconocida que el hombre intelectual había descubierto en el pensamiento: cumbre de su voluntad y libertad. "El ciudadano - escribió Gentile con un cautivante lirismo - no es el hombre abstracto de la clase dominante, porque más culta o más adinerada, ni es el hombre que para saber leer o escribir domina el instrumento de una ilimitada comunicación espiritual. El hombre real es el hombre que trabaja, porque en verdad el valor está en el trabajo; y por su trabajo, diferenciado según su calidad y cantidad, el hombre vale lo que vale". Aquí radica la diferencia abismal entre el humanismo gentiliano y el utopismo marxista, que siempre ha repudiado la división del trabajo social. Gentile, además, nunca ha admitido la escisión entre el interés particular y el interés común, siendo el hombre, según él, un ser entero y concreto, éticamente concebido. Con el humanismo del trabajo, Gentile perfecciona y sella su polémica juvenil con el marxismo abierta en su años mozos (1897) con un ensayo crítico sobre el materialismo histórico donde había destacado el error central de Karl Marx: haber postulado una revisión morfológica del hecho, donde sólo el hecho relativo sería cierto de forma absoluta. De este modo -observó Gentile - Marx había expulsado el absoluto de Hegel por carecer de la relatividad, olvidando que no es posible concebir un absoluto que carezca de algo. Además - comentaba aún Gentile - el hecho no puede ser objeto de especulación filosófica, come Marx pretendía, siendo el hecho algo pertinente solo a la experiencia, y por lo tanto pertinente a la historia pura que -como muchos saben - se ocupa sólo de lo que ha acaecido y que, por consiguiente, no cabe en la filosofía de la historia. Aquí - anotaba Gentile - Marx confundió la forma con el contenido, atribuyendo al segundo las características de la primera. En esta confusión reside el gravísimo error especulativo del pensamiento marxista. En la sociedad configurada por el humanismo del trabajo, Gentile ha dibujado un proyecto socio-político, donde la libertad no debe negar la autoridad, ni la autoridad desconocer a la libertad, siendo vital la síntesis de ambos valores para que el trabajador pueda elevarse a la dignidad ética del artífice; quien - con el propósito de desmaterializar a la materia - se hace, además de faber fortunae suae, también faber sui ipsius: fautor - esto es - no solamente de su suerte sino de sí mismo, según una lección de transparente raíces agustinianas. El filósofo destacaba así la exigencia de dignificar éticamente toda actividad humana para resolver, de una vez, las seculares divergencias entre teoría (cultura) y praxis (producción), capita y trabajo, capitalistas y proletarios, sociedad y Estado versus individuo. Aquí la filosofía de Gentile que, en sus inicio, se desarrolló centrándose principalmente entorno a la noción del acto puro, se concluye haciendo del hombre - protagonista del pensamiento pensante - el eje central de su arquitectura especulativa ; y desde esa audaz postura, él había osado declarar en el discurso del Campidoglio (junio de 1943) - anticipando su teoría sobre el humanismo del trabajo - que los comunistas de entonces no se daban cuentas de ser simplemente unos "corporativistas impacientes". ¡Ahora bien! Aquella atrevida afirmación - a la luz de los acontecimientos del último decenio del siglo veinte - resulta una profecía igualmente audaz y acertadamente inactual porque proyectada hacia un futuro cercano, en tiempos en los cuales una fiebre libremercadista, después del derrumbe catastrófico del marxismo leninismo está reemplazando a la utopía comunista en un mundo inquieto que anhela aún a una mayor justicia moral y social, en una sociedad del mañana sustentada en valores espirituales y afirmada en principios trascendentes y no en un pragmatismo socioeconómico satisfecho sólo por éxitos materiales. Vigencia y sentido del pensamiento gentiliano A pesar de haber redactado la parte filosófica del capítulo dedicado a la voz fascismo en la Enciclopedia Italiana, en conjunto con Mussolini autor de la parte histórico-programática, Giovanni Gentile no alcanzó la ambición de ser el filósofo oficial del régimen fascista italiano porque su poder se fue políticamente debilitando desde los años treinta hasta el dramático 1943. Sin embargo, el hecho de que fuese el filósofo más destacado de la Italia fascista de entonces y su gran organizador cultural, que hubiera permanecido al lado de Mussolini por toda la vida, constituyó siempre un problema inquietante para la cultura italiana antifascista y post-fascista: por esa misma razón el recuerdo de Gentile padeció por largo tiempo injustas y sectarias exclusiones. Preguntándose porque Giovanni Gentile fue fascista, Piero Melograni ya en el lejano 1984 observaba que la opción política del filósofo era implicita en todo su itinerario intelectual. A su vez, Aldo Lo Schiavo destacaba que postulando la identidad entre ley y libertad, individuo y Estado, Gentile encontró en el fascismo mussoliniano la última forma de un nulo concepto de libertad, hija del siglo diecinueve: Esta sería la razón por la cual el mismo Gentile consideraba la necesitad de la crítica y de la oposición como una necesitad dialéctica imprescindible también en el fascismo, que por lo tanto aparecía al filósofo no una ideología o un sistema cerrado, sino más bien un proceso histórico y un proyecto ideal en perpetuo desarrollo (3). Aquí cabría - más allá de la misma generosidad, que fue un dato peculiar de su persona - también la explicación intelectual de la actitud comprensiva y tolerante hacia sus adversarios políticos; sobre todo hacia destacados intelectuales israelitas víctimas - como él mismo confesó - de "una infeliz fatalidad política". Estas generosas actitudes personales todavía no absolvieron a Gentile del delito de haber sido un fascista; delito considerado imperdonable por parte de un sectarismo prepotente que arrinconó en poco reductos académicos la obra filosófica de Gentile, a lo largo de más de medio siglo, llegando al extremo de negar en la Escuela Normal Superior de Pisa el recuerdo de veinte años de intenso y proficuo magisterio gentiliano. Pero la paciencia de la historia ha ido despejando, de a poco, las nieblas envenenadas por las sectas ideológicas, permitiendo que se asomara paulatinamente la deuda conceptual que la cultura italiana y europea tiene con Giovanni Gentile. Desde 1994, cuando bajo el alero de una administración municipal de centro-izquierda, se celebró en el Campidoglio de Roma un congreso sobre el pensamiento del filósofo asesinado, la herencia de Gentile afloró como un patrimonio conceptual nada fácil, pero todavía vigoroso y merecedor por lo tanto de ser revisado por el sentido de conciencia crítica que empuja al hombre intelectual hacia la búsqueda de la verdad sub specie aeternitatis. Ilustres filósofos, incluidos varios de ellos discrepantes con las posturas del idealismo actualista, reconocieron en aquel congreso la vigencia de distintos aspectos del pensamiento gentiliano, destacando entre otros el concepto de organicidad: condición implícita en el pluralismo de las instituciones y en las articulaciones de los cuerpos intermedios, porque Gentile ha enseñado que en el pluralismo se hace efectiva la interrelación de los elementos heterogéneos con los elementos homogéneos, todos ellos asumidos en el acto del pensar. Se consideró vigente además el concepto de identidad como propuesta de conciliación dialéctica entre revolución y conservación, autoridad y libertad, libertad y deber, individuo y comunidad, Sociedad y Estado; y vigente resultó sobre todo la concepción moral de la sociedad política nutrida de valores ético-religiosos y que otorgan a la política el carácter peculiar de teología civil. Finalmente se destacó la permanente vigencia de la humanidad del hombre generoso que fue Giovanni Gentile, humanidad manifestada concretamente hacia los adversarios, y que a un paso de la muerte enfrentada socráticamente grabó el epitafio de su vida con esta palabras de bronce:"La fuerza del espíritu que está en todos nosotros, paulatinamente supera las divergencias, transforma las luchas en sendero de paz; y desde el odio - antes o después - brota el Amor". Recordando este impresionante testimonio, el gentiliano Fortunato Aloi ha justamente definido a Giovanni Gentile un "filósofo sin barreras (4); quien al franquear las barreras de la vida terrenal, victimado como Sócrates por cobarde furor humano, nos dejó in extremis la más honda lección moral. Una lección, frente a cual se inclina reverente también quien - como el suscrito - no asume la especulación filosófica del idealismo actualista pero reconoce en ella un profundo magisterio postfilosófico que concibe la vida como combate incesante, vocación de una milicia permanente que evoca aquella del legionario romano inmortalado por Spengler: estoicamente inmóvil, en la puerta de Pompeya, bajo la lluvia volcánica del Vesubio para no faltar a su consigna. •- •-• -••• •••-• Primo Siena Notas 1..J.FERRATER MORA, Diccionario de F filosofía. Tomo II° (E-J)"Gentile, Giovanni". Ed.Arial, Barcelona 1994, pp. 1453-55. 2..G. MAGGIORE, La filosofia del Diritto in G.Gentile (en G. Gentile, la vita e il pensiero) Ed. Sansoni, Firenze 1948, p. 244. 3..A. LO SCHIAVO, Introduzione a Gentile. Ed. Laterza, Bari 1974. 4..F.ALOI, Attualitá di Gentile. Ed Diaco, Bovalino 1992.
|
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, italie, fascisme, actualisme, années 20, années 30, années 40, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, histoire, politique, théorie politique, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 octobre 2009
Knut Hamsun and the Cause of Europe
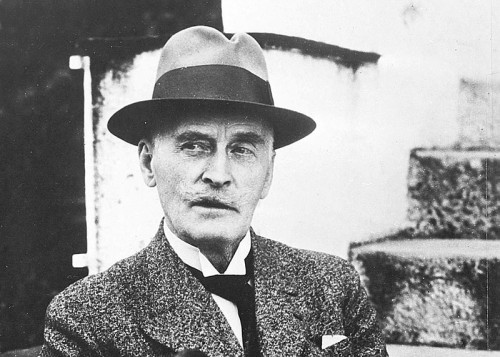
Knut Hamsun and the Cause of Europe
Mark Deavin / http://www.geocities.com/integral_tradition/
After fifty years of being confined to the Orwellian memory hole created by the Jews as part of their European "denazification" process, the work of the Norwegian author Knut Hamsun — who died in 1952 — is reemerging to take its place among the greatest European literature of the twentieth century. All of his major novels have undergone English-language reprints during the last two years, and even in his native Norway, where his post-1945 ostracism has been most severe, he is finally receiving a long-overdue recognition.
Of course, one debilitating question still remains for the great and good of the European liberal intelligentsia, ever eager to jump to Jewish sensitivities. As Hamsun's English biographer Robert Ferguson gloomily asked himself in 1987: "Could the sensitive, dreaming genius who had created beautiful love stories . . . really have been a Nazi?" Unfortunately for the faint hearts of these weak-kneed scribblers, the answer is a resounding "yes." Not only was Knut Hamsun a dedicated supporter of Adolf Hitler and the National Socialist New Order in Europe, but his best writings — many written at the tail end of the nineteenth century — flow with the essence of the National Socialist spirit and life philosophy.
Born Knud Pederson on August 4, 1859, Hamsun spent his early childhood in the far north of Norway, in the small town of Hamarøy. He later described this time as one of idyllic bliss where he and the other children lived in close harmony with the animals on the farm, and where they felt an indescribable oneness with Nature and the cosmos around and above them. Hamsun developed an early obsession to become a writer and showed a fanatical courage and endurance in pursuing his dream against tremendous obstacles. He was convinced of his own artistic awareness and sensitivity, and was imbued with a certainty that in attempting to achieve unprecedented levels of creativity and consciousness, he was acting in accordance with the higher purpose of Nature.
In January 1882 Hamsun's Faustian quest of self-discovery took him on the first of several trips to America. He was described by a friend at the time as ". . . tall, broad, lithe with the springing step of a panther and with muscles of steel. His yellow hair . . . drooped down upon his . . . clear-cut classical features."
These experiences consolidated in Hamsun a sense of racial identity as the bedrock of his perceived artistic and spiritual mission. A visit to an Indian encampment confirmed his belief in the inherent differences of the races and of the need to keep them separate, but he was perceptive enough to recognize that America carried the seeds of racial chaos and condemned the fact that cohabitation with Blacks was being forced upon American Whites.
Writing in his book On the Cultural Life of Modern America, published in March 1889, Hamsun warned that such a situation gave rise to the nightmare prospect of a "mulatto stud farm" being created in America. In his view, this had to be prevented at all costs with the repatriation of the "black half-apes" back to Africa being essential to secure America's future (cited in Robert Ferguson, Enigma: The Life of Knut Hamsun, London, 1987, p.105). Hamsun also developed an early awareness of the Jewish problem, believing that "anti-Semitism" inevitably existed in all lands where there were Jews — following Semitism "as the effect follows the cause." He also believed that the departure of the Jews from Europe and the White world was essential "so that the White races would avoid further mixture of the blood" (from Hamsun's 1925 article in Mikal Sylten's nationalist magazine Nationalt Tidsskrift). His experiences in America also strengthened Hamsun's antipathy to the so called "freedom" of democracy, which he realized merely leveled all higher things down to the lowest level and made financial materialism into the highest morality. Greatly influenced by the works of Friedrich Nietzsche, Hamsun saw himself as part of the vanguard of a European spiritual aristocracy which would reject these false values and search out Nature's hidden secrets — developing a higher morality and value system based on organic, natural law. In an essay entitled "From the Unconscious Life of the Mind," published in 1890, Hamsun laid out his belief:
An increasing number of people who lead mental lives of great intensity, people who are sensitive by nature, notice the steadily more frequent appearance in them of mental states of great strangeness . . . a wordless and irrational feeling of ecstasy; or a breath of psychic pain; a sense of being spoken to from afar, from the sky or the sea; an agonizingly developed sense of hearing which can cause one to wince at the murmuring of unseen atoms; an irrational staring into the heart of some closed kingdom suddenly and briefly revealed.
Hamsun expounded this philosophy in his first great novel Hunger, which attempted to show how the known territory of human consciousness could be expanded to achieve higher forms of creativity, and how through such a process the values of a society which Hamsun believed was increasingly sick and distorted could be redefined for the better. This theme was continued in his next book, Mysteries, and again in Pan, published in 1894, which was based upon Hamsun's own feeling of pantheistic identification with the cosmos and his conviction that the survival of Western man depended upon his re-establishing his ties with Nature and leading a more organic and wholesome way of life.
In 1911 Hamsun moved back to Hamarøy with his wife and bought a farm. A strong believer in the family and racial upbreeding, he was sickened by the hypocrisy and twisted morality of a modern Western society which tolerated and encouraged abortion and the abandonment of healthy children, while protecting and prolonging the existence of the criminal, crippled, and insane. He actively campaigned for the state funding of children's homes that could take in and look after unwanted children and freely admitted that he was motivated by a higher morality, which aimed to "clear away the lives which are hopeless for the benefit of those lives which might be of value."
In 1916 Hamsun began work on what became his greatest and most idealistic novel, Growth of the Soil, which won the Nobel Prize for Literature in 1921. It painted Hamsun's ideal of a solid, farm-based culture, where human values, instead of being fixed upon transitory artificialities which modern society had deemed fashionable, would be based upon the fixed wheel of the seasons in the safekeeping of an inviolable eternity where man and Nature existed in harmony:
They had the good fortune at Sellanraa that every spring and autumn they could see the grey geese sailing in fleets above that wilderness, and hear their chatter up in the air — delirious talk it was. And as if the world stood still for a moment, till the train of them had passed. And the human souls beneath, did they not feel a weakness gliding through them now? They went to their work again, but drawing breath first, for something had spoken to them, something from beyond.
Growth of the Soil
reflected Hamsun's belief that only when Western man fully accepted that he was intimately bound up with Nature's eternal law would he be able to fulfill himself and stride towards a higher level of existence. At the root of this, Hamsun made clear, was the need to place the procreation of the race back at the center of his existence:Generation to generation, breeding ever anew, and when you die the new stock goes on. That's the meaning of eternal life.
The main character in the book reflected Hamsun's faith in the coming man of Europe: a Nietzschean superman embodying the best racial type who, acting in accordance with Nature's higher purpose, would lead the race to unprecedented levels of greatness. In Hamsun's vision he was described thus:
A tiller of the ground, body and soul; a worker on the land without respite. A ghost risen out of the past to point to the future; a man from the earliest days of cultivation, a settler in the wilds, nine hundred years old, and withal, a man of the day.
Hamsun's philosophy echoed Nietzsche's belief that "from the future come winds with secret beat of wings and to sensitive ears comes good news" (cited in Alfred Rosenberg, The Myth of the Twentieth Century). And for Hamsun the "good news" of his lifetime was the rise of National Socialism in Germany under Adolf Hitler, whom he saw as the embodiment of the coming European man and a reflection of the spiritual striving of the "Germanic soul."
The leaders of the new movement in Germany were also aware of the essential National Socialist spirit and world view which underlay Hamsun's work, and he was much lauded, particularly by Joseph Goebbels and Alfred Rosenberg. Rosenberg paid tribute to Hamsun in his The Myth of the Twentieth Century, published in 1930, declaring that through a mysterious natural insight Knut Hamsun was able to describe the laws of the universe and of the Nordic soul like no other living artist. Growth of the Soil, he declared, was "the great present-day epic of the Nordic will in its eternal, primordial form."
Hamsun visited Germany on several occasions during the 1930s, accompanied by his equally enthusiastic wife, and was well impressed by what he saw. In 1934 he was awarded the prestigious Goethe Medal for his writings, but he handed back the 10,000 marks prize money as a gesture of friendship and as a contribution to the National Socialist process of social reconstruction. He developed close ties with the German-based Nordic Society, which promoted the Pan-Germanic ideal, and in January 1935 he sent a letter to its magazine supporting the return of the Saarland to Germany. He always received birthday greetings from Rosenberg and Goebbels, and on the occasion of his 80th birthday from Hitler himself.
Like Nietzsche's Zarathustra, Hamsun was not content merely to philosophize in an ivory tower; he was a man of the day, who, despite his age, strove to make his ideal into a reality and present it to his own people. Along with his entire family he became actively and publicly involved with Norway's growing National Socialist movement in the form of Vidkun Quisling's Nasjonal Samling (National Assembly). This had been founded in May 1933, and Hamsun willingly issued public endorsements and wrote articles for its magazine, promoting the National Socialist philosophy of life and condemning the anti-German propaganda that was being disseminated in Norway and throughout Europe. This, he pointed out, was inspired by the Jewish press and politicians of England and France who were determined to encircle Germany and bring about a European war to destroy Hitler and his idea.
With the outbreak of war Hamsun persistently warned against the Allied attempts to compromise Norwegian neutrality, and on April 2, 1940 — only a week before Hitler dramatically forestalled the Allied invasion of Norway — Hamsun wrote an article in the Nasjonal Samling newspaper calling for German protection of Norwegian neutrality against Anglo-Soviet designs. Hamsun was quick to point out in a further series of articles soon afterward, moreover, that it was no coincidence that C.J. Hambro, the president of the Norwegian Storting, who had conspired to push Norway into Allied hands and had then fled to Sweden, was a Jew. In his longest wartime article, which appeared in the Axis periodical Berlin-Tokyo-Rome in February 1942, he also identified Roosevelt as being in the pay of the Jews and the dominant figure in America's war for gold and Jewish power. Declaring his belief in the greatness of Adolf Hitler, Hamsun defiantly declared: "Europe does not want either the Jews or their gold."
Hamsun's loyalty to the National Socialist New Order in Europe was well appreciated in Berlin, and in May 1943 Hamsun and his wife were invited to visit Joseph Goebbels, a devoted fan of the writer. Both men were deeply moved by the meeting, and Hamsun was so affected that he sent Goebbels the medal which he had received for winning the Nobel Prize for idealistic literature in 1920, writing that he knew of no statesman who had so idealistically written and preached the cause of Europe. Goebbels in return considered the meeting to have been one of the most precious encounters of his life and wrote touchingly in his diary: "May fate permit the great poet to live to see us win victory! If anybody deserved it because of a high-minded espousal of our cause even under the most difficult circumstances, it is he." The following month Hamsun spoke at a conference in Vienna organized to protest against the destruction of European cultural treasures by the sadistic Allied terror-bombing raids. He praised Hitler as a crusader and a reformer who would create a new age and a new life. Then, three days later, on June 26, 1943, his loyalty was rewarded with a personal and highly emotional meeting with Hitler at the Berghof. As he left, the 84 year-old Hamsun told an adjutant to pass on one last message to his Leader: "Tell Adolf Hitler: we believe in you."
Hamsun never deviated from promoting the cause of National Socialist Europe, paying high-profile visits to Panzer divisions and German U-boats, writing articles and making speeches. Even when the war was clearly lost, and others found it expedient to keep silence or renounce their past allegiances, he remained loyal without regard to his personal safety. This was brought home most clearly after the official announcement of Hitler's death, when, with the German Army in Norway packing up and preparing to leave, Hamsun wrote a necrology for Hitler which was published in a leading newspaper:
Adolf Hitler: I am not worthy to speak his name out loud. Nor do his life and his deeds warrant any kind of sentimental discussion. He was a warrior, a warrior for mankind, and a prophet of the gospel for all nations. He was a reforming nature of the highest order, and his fate was to arise in a time of unparalleled barbarism, which finally felled him. Thus might the average western European regard Adolf Hitler. We, his closest supporters, now bow our heads at his death.
This was a tremendously brave thing for Hamsun to do, as the following day the war in Norway was over and Quisling was arrested.
Membership in Quisling's movement after April 8, 1940, had been made a criminal offense retroactively by the new Norwegian government, and the mass roundups of around 40,000 Nasjonal Samling members now began in earnest. Hamsun's sons Tore and Arild were picked up within a week, and on May 26 Hamsun and his wife were placed under house arrest. Committed to hospital because of his failing health, Hamsun was subject to months of interrogation designed to wear down and confuse him. As with Ezra Pound in the United States, the aim was to bring about a situation where Hamsun's sanity could be questioned: a much easier option for the Norwegian authorities than the public prosecution of an 85-year-old literary legend.
Unfortunately for them, Hamsun refused to crack and was more than a match for his interrogators. So, while his wife was handed a vicious three-year hard-labor sentence for her National Socialist activities, and his son Arild got four years for having the temerity to volunteer to fight Bolshevism on the Eastern Front, Hamsun received a 500,000-kroner fine and the censorship of his books. Even this did not stop him, however, and he continued to write, regretting nothing and making no apologies. Not until 1952, in his 92nd year, did he pass away, leaving us a wonderful legacy with which to carry on the fight which he so bravely fought to the end.
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, norvège, scandinavie, littérature, lettres, lettres norvégiennes, littérature norvégienne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 04 octobre 2009
Woodrow Wilson und das Selbstbestimmungsrecht
"...war is in fact the true nurse of executive aggrandizement. In war, a physical force is to be created; and it is the executive will, which is to direct it. In war, the public treasuries are to be unlocked; and it is the executive hand which is to dispose them." James Madison
Thomas Woodrow Wilson, geboren am 28.12.1856, gestorben am 03.02.1924, war von 1913 bis 1921 der 27. Präsident der USA. Wilson, seit 1890 Professor der Geschichte und Staatswissenschaften in Princeton, trat in seinen Reden und Schriften immer für hohe Ideale und edle Ziele ein. Sein Handeln stand aber in völligem Gegensatz dazu. Wir wollen hier untersuchen, wie es zu diesem Widerspruch zwischen Wort und Tat eines Politikers kommen konnte, der sich als humanitärer Vorkämpfer ausgab. Welche Motive hatte er für den von ihm so listenreich betriebenen Eintritt der USA in den 1. Weltkrieg?
Bei Ausbruch des 1. Weltkriegs ermahnte Wilson seine Landsleute, in Worten und sogar in Gedanken neutral zu bleiben. Er selbst hielt sich aber nicht an diese gute Empfehlung. Offizielle Politik der USA war eine unparteiische Neutralität gegenüber allen Konfliktparteien, tatsächlich erfolgte eine unverhohlene Parteinahme gegen Deutschland und Österreich-Ungarn.
Eine internationale Konferenz hatte 1909 die Deklaration von London verabschiedet, in der Regeln für die Kriegsführung auf See festgelegt wurden. Eine der zentralen Bestimmungen war, daß gegen die Zivilbevölkerung nicht Krieg geführt werden dürfe. Der britische Prime Minister, Lord Salisbury, hatte zu Beginn des Jahrhunderts die allgemein verbreitete Position zu dieser Frage so beschrieben: "Foodstuffs, with a hostile destination, can be considered contraband of war only if they are supplies for the enemy's forces. It is not sufficient that they are capable of being so used; it must be shown that this was in fact their destination at the time of the seizure."
Bei Kriegsausbruch erklärte die britische Regierung, daß sie sich nicht an Geist und Buchstaben der Deklaration von London halten werde, sondern für sich das Recht beansprucht, Nahrungsmittel auf See zu erbeuten und zu beschlagnahmen, auch wenn diese auf neutralen Schiffen zu neutralen Häfen transportiert werden. Der Vorwand für diesen Bruch des Völkerrechts war, daß die nicht ausdrücklich für britische Häfen bestimmten Güter letztendlich der deutschen Armee zugute kommen könnten. Der wahre Grund dieser staatlichen Piraterie lag in der Absicht "...to starve the whole population - men, women, and children, old and young, wounded and sound - into submission", wie Winston Churchill, damals Marineminister, offenherzig bekannte.
Auch die Handelsflotte der USA wurde Opfer der britischen Unterdrückung des freien Seeverkehrs. US-Schiffe wurden gekapert, ihre Ladung beschlagnahmt. Das war ein offener Bruch des Völkerrechts. Die USA hatten gegenüber ihren südlichen Nachbarn aus weitaus geringerem Anlaß Krieg geführt. In diesem Fall beschränkte sich die Regierung Wilsons darauf, eine formale Protestnote an die englische Regierung zu senden, vermied aber jede Sanktion gegen den Angreifer.
Im November 1914 erklärte die britische Kriegsmarine die gesamte Nordsee zur Kriegszone, die sofort vermint wurde. Schiffe, die unter der Flagge neutraler Staaten fuhren, konnten in der Nordsee ohne Vorwarnung das Ziel britischer Angriffe werden. Dieses Vorgehen der britischen Regierung verletzte geltendes Völkerrecht, darunter die Deklaration von Paris von 1856, die Britannien unterzeichnet hatte. Wilson lehnte es ab, sich dem Protest der neutralen skandinavischen Länder gegen die Sperrung der Nordsee anzuschließen. Als jedoch im Februar 1915 die deutsche Regierung dem schlechten britischen Beispiel folgte und ihrerseits die See um die britischen Inseln zur Kriegszone erklärte, reagierte Wilson völlig anders als im britischen Präzedenzfall. In einer Note ließ er Berlin wissen, daß Deutschland zur strikten Rechenschaft gezogen werde, falls US-Schiffe oder US-Bürger durch deutsche Kriegsschiffe zu Schaden kämen. Wilson nahm für sich überdies das Recht in Anspruch, US-Bürger auch dann zu schützen, wenn sie sich freiwillig auf einem Schiff aufhielten, daß die Flagge einer kriegsführenden Nation trug.
Am 07.05.1915 versenkte ein deutsches U-Boot in der Kriegszone vor Irland das englische Schiff Lusitania, wobei 1195 Menschen ums Leben kamen, darunter 124 Amerikaner. In einer Note an Berlin behielt sich Wilson jede Handlung vor, die notwendig sei, um seine "heilige Pflicht zur Aufrechterhaltung der Rechte der US" zu erfüllen. Die deutsche Regierung wies in ihrer Antwort darauf hin, daß:
- der U-Boot-Krieg eine Erwiderung auf die ungesetzliche Hungerblockade sei;
- die Lusitania Munition für Kriegszwecke befördert habe;
- die Lusitania als Hilfskreuzer für die britische Kriegsmarine eingetragen sei;
- britische Handelsschiffe angewiesen worden seien, auf auftauchende deutsche U-Boote zu schießen oder diese zu rammen;
- die Lusitania bewaffnet gewesen sei.
Die ersten vier Behauptungen der deutschen Regierung treffen zu, die fünfte ist zweifelhaft. Der Außenminister der USA, William Jennings Bryan, war ehrlich bestrebt, einen Kriegseintritt der USA zu verhindern. An Wilson gerichtet erklärte er: "Germany has a right to prevent contraband going to the Allies, and a ship carrying contraband should not rely upon passengers to protect her from attack - it would be like putting women and children in front of an army." Bryan gab auch zu bedenken: "Why be shocked by the drowning of a few people, if there is to be no objection to starving a nation?" Bryan machte den Kriegsparteien folgenden Kompromißvorschlag: Britannien sollte Nahrungsmittel nach Deutschland bringen lassen und Deutschland verzichtet nach Aufhebung der Hungerblockade auf den U-Boot-Krieg. Dieser Plan wurde von der deutschen Regierung angenommen, von den britischen Verantwortlichen jedoch abgelehnt. Als Bryan erkennen mußte, daß Wilson zum Krieg entschlossen war, trat er im Juni 1915 von seinem Amt zurück.
Der Nachfolger Bryans als Außenminister war Robert Lansing, der in aller Offenheit bekannte, daß das Ziel der britischen Hungerblockade sei, "...[to] destroy the morale of the German people by an economic isolation, which would cause them to lack the very necessaries of life." Zu den Protestnoten der US-Regierung an die britische Regierung, betreffend die Einschränkung des freien Seeverkehrs für US-Schiffe durch die britische Kriegsmarine, erklärte er: "...everything was submerged in verbiage. It was done with deliberate purpose. It...was necessary in order to leave this country free to act and even act illegally when it entered the war."
Im Februar 1916 kündigte die deutsche Regierung an, daß jedes feindliche bewaffnete Handelsschiff als Hilfskreuzer behandelt und ohne Vorwarnung angegriffen werde. Diesmal war Wilson empört und er verlangte in einer Deklaration, daß bewaffnete Handelsschiffe kriegsführender Staaten die Immunität friedlicher Schiffe genießen sollten, falls nicht "zwingende Beweise für aggressive Absichten" nachgewiesen werden könnten. Nach der Versenkung der ohne Flagge oder Markierungen fahrenden Sussex durch ein deutsches U-Boot, machte die deutsche Führung das Angebot, ihre Angriffe auf feindliche Schiffe in der Kriegszone einzustellen, wenn die Regierung der USA dafür eintrete, daß die britische Regierung fortan die Regeln des Völkerrechts einhält und ihre Hungerblockade beendet. Doch Wilson lehnte diesen Vorschlag ab, obwohl er wußte, daß ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der rechtswidrigen britischen Blockadepolitik und dem deutschen U-Boot-Krieg bestand. Gleichzeitig lehnte es Wilson ab, dem Wunsch des US-Parlaments entsprechend eine Warnung für alle US-Bürger auszusprechen, daß diese die Reise auf einem bewaffneten Handelsschiff auf eigene Gefahr unternehmen müßten. Wilson rechnete damit, daß jeder Amerikaner, der durch deutsche Kriegsschiffe zu Schaden kam, die Kriegsbereitschaft in den USA verstärken würde und er sollte sich in dieser Hinsicht nicht täuschen.
Wie von der britischen Regierung erhofft, erwies sich die Blockade Deutschlands als sehr wirkungsvoll. Bald war der Hunger in der deutschen Zivilbevölkerung weit verbreitet, die sich überwiegend von Schwarzbrot und einer Ration von drei Pfund Kartoffeln pro Woche ernährte. Als 1916 eine Mißernte bei Kartoffeln eintrat, verschärfte sich die Situation und wurde vor allem für Kinder kritisch. Steckrüben wurden zum Hauptnahrungsmittel und viele Stadtbewohner konnten täglich nur 1.000 Kalorien zu sich nehmen. Während des 1. Weltkriegs starben in Deutschland 700.000 Zivilisten an Unterernährung.
Unter offenem Bruch ihrer Neutralität lieferten die USA Waffen und Munition an Britannien. Am 31. Januar 1917 erklärte die deutsche Regierung den uneingeschränkten U-Boot-Krieg in der Kriegszone. Am 01.02.1917 brach Wilson die diplomatischen Beziehungen ab und erklärte am 06.04.1917 Deutschland den Krieg.
Warum traten die USA in den 1. Weltkrieg ein, obwohl sie in Europa keine Gebietsforderungen hatten und auch nicht in sonstige Streitigkeiten verwickelt waren? Die Gründerväter der USA hatten darauf bestanden, daß sich ihr Land gegenüber allen ausländischen Staaten strikt neutral verhalten sollte. George Washington hatte in seiner Abschiedsrede als Präsident 1797 gesagt: "The great rule of conduct for us, in regard to foreign Nations, is in extending our commercial relations to have with them as little political connection as possible...Why, by interweaving our destiny with that of any part of Europe, entangle our peace and prosperity in the toils of European Ambition, Rivalship, Interest, Humour or Caprice?" Thomas Jefferson gab in seiner Einführungsrede als Präsident folgende Richtlinie: "...peace, commerce, and honest friendship with all nations, entangling alliances with none."
Warum verriet Wilson die Ideale der Gründerväter? Koloniale Besitzansprüche können nicht der Grund für den Eintritt in den europäischen Krieg gewesen sein. Kolonien waren damals wohl begehrte Statussymbole für die großen Industriestaaten, aber ihr Besitz wurde nicht so geschätzt, daß man dafür bereit gewesen wäre, einen großen Krieg zu führen, wie die Marokko-Krise 1911 zeigte.
Auf der Suche nach den Motiven der jahrelangen Bemühungen Wilsons zur Herbeiführung eines Kriegs, wenden wir uns zuerst den Gründen zu, die er selbst für seinen Kriegseintritt nennt. Wilson erklärte bei Kriegsbeginn vor dem US-Parlament, die Kriegsziele seien: "...to fight for the ultimate peace of the world and for the liberation of its peoples, the German people included: for the rights of nations great and small and the privilege of men everywhere to choose their way of life and of obedience. The world must be made safe for democracy." Dreimal in seiner Kriegsbotschaft bekräftigte Wilson die Notwendigkeit, ohne Leidenschaft und Rachsucht zu kämpfen.
In seinem "Friedensprogramm" vom 08.01.1918 (14 Punkte) behauptete Wilson:
- die Beseitigung der "Autokratie";
- die Abschaffung des Militarismus;
- die Gewährung des Selbstbestimmungsrechtes der Völker;
seien die vordringlichen Kriegsziele. Des weiteren nannte er noch den Aufbau einer Weltregierung in Gestalt des Völkerbundes als einen zentralen Zweck des Kriegs.
Deutschland hatte Ende 1918 nicht bedingungslos kapituliert, sondern nur unter ganz bestimmten Bedingungen, die den endgültigen Friedensvertrag betrafen. Am 05.11.1918 versprach Wilson, daß die USA und ihre Verbündeten den deutschen Vorschlag annehmen würden. Die Grundlage einer abschließenden Regelung sollten die 14 Punkte Wilsons sein. In seiner "4 Grundsätze" Rede im Februar 1918 sagte er: "There shall be no contributions, no punitive damages. People are not to be handed about from one sovereignty to another by an international conference...National aspirations must be respected; peoples may now be dominated and governed only by their own consent. 'Self determination' is not a mere phrase."
Im Vertrauen auf diese Zusagen Wilsons entsprach die deutsche Regierung der Forderung ihrer Kriegsgegner nach Entwaffnung der deutschen Streitkräfte und übergab ihre Flotte einschließlich der U-Boote, 1.700 Flugzeuge, 5.000 Kanonen, 30.000 Maschinengewehre und anderes Kriegsgerät. Deutschland war nun wehrlos und konnte nur hoffen, daß Wilson und seine Verbündeten ihre Versprechungen einhielten.
Doch die Hungerblockade wurde fortgesetzt und sogar noch verschärft. Die britische Kriegsmarine beherrschte nun auch die Ostsee und nutzte dies, um die deutschen Ostseehäfen zu blockieren. Nicht einmal kleine Fischerboote durften auslaufen. Der Hunger erreichte ein für große Teile der deutschen Zivilbevölkerung lebensgefährliches Ausmaß. Erst im März 1919 wurde die Einfuhr von Nahrungsmitteln wieder zugelassen. Die Blockade von Rohstoffen hoben die Siegermächte erst nach Unterzeichnung des Vertrags von Versailles auf.
Die deutsche Verhandlungsdelegation in Versailles stellte bald fest, daß es für sie nichts zu verhandeln gab. Den deutschen Vertretern wurde die Teilnahme an den Beratungen untersagt. Die Siegermächte legten den deutschen Delegierten einen fertigen Text vor, den sie unter Androhung einer vollständigen Besetzung Deutschlands zu unterschreiben hatten. Unter diesen Bedingungen konnte man nicht von einem Friedensvertrag sprechen, sondern es handelte sich um ein Diktat des Stärkeren gegenüber dem Schwächeren.
Wilson hatte versprochen, daß die Selbstbestimmung der Völker die Grundlage einer neuen gerechten Weltordnung sein werde. Ganz im Gegensatz dazu die Bestimmungen der Friedensdiktate:
- Südtirol, das geschlossene Siedlungsgebiet einer Viertelmillion deutschsprachiger Österreicher, wurde an Italien gegeben;
- das Gebiet um die deutsche Stadt Memel ging an Litauen;
- die Schaffung eines polnischen Zugangs zur Ostsee (polnischer Korridor) und die Übereignung der "Freien Stadt" Danzig unter polnische Herrschaft zwang 1,5 Millionen Deutsche in den polnischen Staat;
- das Saarland wurde Frankreich übergeben;
- Österreich wurde die Vereinigung mit Deutschland untersagt, obwohl die österreichische verfassungsgebende Versammlung einstimmig dafür gestimmt hatte und Volksabstimmungen in Salzburg mit 98% und Tirol mit 95% sich dafür ausgesprochen hatten;
- das Sudetenland, das seit dem Mittelalter von Deutschsprachigen bewohnt war, wurde dem neu geschaffenen Staat Tschechoslowakei zugeschlagen, was dazu führte, daß die "Minderheit" der 3,3 Millionen Sudetendeutschen halb so groß war wie das Staatsvolk der Tschechen (6,5 Millionen);
- in Oberschlesien wurden die industriellen Zentren Kattowitz und Königshütte an Polen gegeben, obwohl in Volksabstimmungen dort 65% bzw. 75% für den Verbleib bei Deutschland gestimmt hatten;
- im Osten Polens wurden einige Millionen Ukrainer und Weißrussen Polen einverleibt;
- die Grenzen Ungarns wurden so gezogen, daß ein Drittel der Ungarn in fremde Staaten gezwungen wurde.
Die versprochenen Volksabstimmungen wurden nur durchgeführt, wenn zu erwarten war, daß sie zum Nachteil der Verliererstaaten ausgehen würden. Die Grenzen der Abstimmungsgebiete wurden so gezogen, daß deutschsprachige Mehrheiten an der Grenze von der anderssprachigen Bevölkerung des viel zu groß dimensionierten Abstimmungsgebietes majorisiert wurden. Den Tschechen wurde das Recht auf Sezession von Österreich-Ungarn gewährt, gleichzeitig aber den Sudetendeutschen das Recht auf Sezession von der Tschechoslowakei untersagt. Elsaß-Lothringen kam ohne Volksabstimmung wieder zu Frankreich, obwohl es damals durchaus ungewiß war, was die Bevölkerung dieser Region wünschte. Insgesamt wurde 13 Millionen Deutschsprachigen das Selbstbestimmungsrecht verweigert. Dazu kamen noch weitere Millionen Ungarn, Ukrainer, Weißrussen, die das gleiche Schicksal erlitten. Nach den neuen Grenzziehungen betrug der Anteil der Minoritäten an der Gesamtbevölkerung: Tschechoslowakei (ohne Slowaken) 35%, Polen 30%, Rumänien 25%, Jugoslawien 17%.
Auch die anderen Bestimmungen des Versailler Friedensdiktats weichen eklatant von den 14 Punkten Wilsons ab:
- Die deutsche Armee wurde auf 100.000 Mann beschränkt; Flugzeuge, Panzer und U-Boote völlig verboten. Die deutschen Gebiete links des Rheins durften "auf ewig" nicht mehr von deutschen Truppen betreten werden. Die Siegermächte verpflichteten sich jedoch zu keiner Abrüstungsmaßnahme, obwohl Punkt 4 dies vorsah.
- Punkt 5 von Wilson hatte vorgesehen, daß ein "...free, open-minded and absolutely impartial adjustment of all colonial claims" stattfinden sollte. Tatsächlich wurden einfach die Kolonien Deutschlands in Afrika und im Pazifik unter den Siegermächten aufgeteilt.
- Wilson hatte versprochen, "...no contributions or punitive damages" in den Friedensvertrag aufzunehmen. Im Gegensatz dazu enthielt das Versailler Friedensdiktat eine Reparationsforderung in noch zu bestimmender Höhe. Deutschland wurde die alleinige Kriegsschuld zugewiesen und zum Ausgleich aller Kriegsschäden verpflichtet, inklusive der Pensionen der Veteranen der Siegermächte. Schließlich wurde ein so hoher Betrag festgelegt, daß es dem wirtschaftlich geschwächten Deutschland unmöglich war, auch nur die ersten Teilzahlungen zu leisten.
Die Deutschland in Versailles aufgezwungenen Gebietsverluste wurden von allen deutschen Parteien entschieden abgelehnt. Der englische Premierminister Lloyd George sagte zu der in Versailles gezogenen deutschen Ostgrenze voraus: "...[it] must in my judgement lead sooner or later to a new war in the east of Europe." Das Diktat von Versailles sicherte nicht den Frieden, sondern schuf die Spannungen, die den nächsten Krieg auslösten. Dieser "Vertrag" wurde von dem selben Wilson durchgesetzt, der seinen Kriegseintritt damit rechtfertigte, daß der 1. Weltkrieg "the war to end all wars" sein werde.
Viele Historiker argumentieren, daß der angeblich gutwillige Wilson durch ungünstige gruppendynamische Prozesse bei den Friedensverhandlungen überwältigt worden sei und deshalb Bestimmungen zugestimmt habe, die seinen Ansichten nicht entsprachen. Diese Behauptung ist wenig glaubwürdig, denn es gab bei den Friedensverhandlungen durchaus Vertreter der Siegermächte, die sich entschieden gegen das ungerechte Diktat aussprachen. Ein prominentes Beispiel dafür ist John Maynard Keynes, der Mitglied der britischen Verhandlungsdelegation war und aus Protest gegen die inhumane Behandlung der Verliererstaaten von diesem Amt zurücktrat. Keynes schrieb unmittelbar danach das Buch: "The Economic Consequences of the Peace" (1920), in dem er die Politik der Siegerstaaten entschieden kritisierte.
Wilson hat mit der Durchsetzung der Pariser Friedensdiktate gezeigt, daß seine edlen Ziele und humanitären Absichten nur vorgetäuscht waren. Was waren die wahren Motive für seinen Kriegseintritt?
Wilson hatte 1916 den Wahlkampf für seinen Wiedereinzug ins Weiße Haus mit dem Slogan geführt: "He kept us out of war." Kurz nachdem er mit einer sehr knappen Mehrheit wiedergewählt worden war, tat er alles in seiner Macht stehende, um die USA in den Krieg zu führen. Dabei war ihm durchaus bewußt, daß die Beteiligung an einem großen Krieg in Europa in den USA äußerst unpopulär war. Die von Wilson angestrebte Kriegsführung im großen Stil erforderte eine riesige Armee. Die USA waren aber darauf nicht vorbereitet. Entsprechend der Neutralitätspolitik der Gründerväter waren die Streitkräfte des Landes nicht auf einen Krieg gegen europäische Großmächte eingerichtet.
Am 30.06.1916 verfügten die US-Streitkräfte über 179.000 Mann. Wilson hoffte, daß durch den Appell an patriotische Gefühle sich genügend Freiwillige für sein angestrebtes Millionenheer finden würden. Doch bald stellte sich heraus, daß bei vielen jungen Männern der Selbsterhaltungstrieb stärker ausgeprägt war als jede künstlich angeheizte kollektivistische Emotion. Trotz eines propagandistischen Trommelfeuers der Medien meldeten sich in den ersten 10 Tagen nach Kriegseintritt der USA nur 4.355 Männer freiwillig zum Militärdienst. Bis zum 24.04.1917 betrug die Zahl der Freiwilligen nur ein Sechstel von dem, was die Regierung erwartet hatte.
In dieser Situation zeigte Wilson, wie wendig er sein konnte. Er, der bisher die Wehrpflicht abgelehnt hatte, schlug genau dies dem US-Parlament vor. Damit war er nach Abraham Lincoln der 2. Präsident der USA, der diese weitgehende Aufhebung der persönlichen Freiheit durchsetzte. In der Öffentlichkeit und sogar im Parlament war der Widerstand gegen diese Maßnahme groß. Viele fragten sich, ob es glaubwürdig sei, den preußischen Militarismus zu bekämpfen, indem man sein wichtigstes Merkmal, die Wehrpflicht, übernimmt. Im Kongreß war der Widerstand besonders bei den Abgeordneten der Demokratischen Partei, die aus dem Süden und Westen des Landes kamen, anzutreffen. Die Wehrpflicht wurde in Reden als "involuntary servitude" und "another name for slavery" bezeichnet. Der Sprecher des Repräsentantenhauses Champ Clark sagte, daß "...little difference between a conscript and a convict" besteht. Die Gesetzesvorlage Wilsons wurde vom US-Parlament abgelehnt, aber später unter dem Eindruck der ersten Kriegshandlungen in veränderter Form angenommen. Am Ende des Krieges standen in den US-Streikräften 4 Millionen Mann unter Waffen.
Wilson nutzte die durch den Kriegseintritt erzeugte Krise, um die Macht der politischen Klasse massiv auszuweiten:
- Die Food Administration wurde im Mai 1917 gegründet. Durch den Lever Act vom 10.08.1917 bekam diese Behörde weitgehende Vollmachten. Sie vergab jene Lizenzen, ohne die ein Unternehmer, der mit Nahrungs-, Futter-, Düngemitteln und Treibstoffen zu tun hatte, sein Gewerbe nicht ausüben durfte. Sie setzte den Preis von Weizen und Kohle fest; konnte Nahrungsmittel und Treibstoffe einschließlich ihrer Produktionsanlagen beschlagnahmen; im eigenen Namen Geschäfte betreiben.
- Die Fuel Administration sollte vor allem die widerstrebenden Kohlebergwerke auf Regierungslinie bringen. Es war ihr erlaubt, Preise festzulegen und im Detail zu bestimmen, wer, was, wann, erhält. Dadurch geriet die Energieversorgung innerhalb kürzester Zeit so in Unordnung, daß die Gesamtwirtschaft zusammenzubrechen drohte. Die Schuld dafür gab Wilson dem Kapitalismus.
- Der War Industries Board wurde im Juli 1917 geschaffen. Er war eine Art oberster Planungsbehörde, sehr änlich dem, was wir aus der Kommandowirtschaft des real existierenden Sozialismus kennen. Bernard Baruch, der Leiter des WIB, sagte: "Instead of allowing prices to determine what would be produced and where it would go, we decided...how our resources would be employed."
- Die War Finance Corporation betätigte sich als Bank für jene Unternehmen, die auf dem privaten Kapitalmarkt keine Kredite erhielten, weil sie dort von den staatlichen Schuldenmachern verdrängt worden waren. Über ihre Kreditbedingungen konnte die WFC einen Großteil der privaten Wirtschaft kontrollieren.
- Die War Labor Administration war mit der Regulierung des Arbeitsmarktes beauftragt. Der Leiter ihres War Labor Policies Board, Felix Frankfurter, war ein bekannter "progressive", der seine Stellung nutzte, um gewerkschaftliche Forderungen durchzusetzen. Besonders schlagkräftig waren damals die Eisenbahnergewerkschaften, die die Gunst der Stunde nutzten, um drastische Lohnerhöhungen zu erzwingen.
- Die Railroad Administration übernahm die Eisenbahnen, die größte High-Tech-Branche der damaligen Zeit. Der Leiter dieser Behörde sagte von sich, daß er "...an authority that was...nearly absolute" besaß. Die RA erfüllte alle gewerkschaftlichen Forderungen. Zu ihrer Finanzierung erhöhte sie die Frachtraten um 28% und die Preise für Fahrgäste um 18%. Wirtschaft und Konsumenten wurden durch diese Preiserhöhungen hart getroffen. Doch diese reichten bei weitem nicht aus, um die enorm gestiegenen Kosten der Staatsbahnen zu decken, die fortan mit Steuergeldern subventioniert wurden.
Zum Zeitpunkt des Waffenstillstands hatte die Regierung übernommen: Eisenbahnen, Transport auf dem Meer, Telefon- und Telegraph-Kommunikation. Sie kommandierte hunderte Unternehmen im erzeugenden Gewerbe; betrieb große Unternehmen auf eigene Rechnung im Bereich Schiffsbau, Weizenhandel, Hochbau; betätigte sich als Großbankier; regulierte eine Vielzahl von Wirtschaftszweigen, legte die Preise einer großen Zahl wichtiger Güter fest, hob die Vertragsfreiheit auf dem Arbeitsmarkt auf.
Die Anzahl der zivilen Beschäftigten der Bundesregierung verdoppelte sich von 1916 bis 1918 auf 450.000. In den 20er Jahren gelang es unter der Präsidentschaft von Warren Harding den wuchernden Staatsapparat etwas zurückzudrängen. Doch selbst auf ihrem niedrigsten Stand in der Nachkriegszeit war die Zahl der Bundesbeschäftigten um 141.000 größer als vor dem Krieg. Hier liegt der Schlüssel zum Verständnis der Politik Wilsons. Die einzigen wahren Kriegsgewinnler sind die Intellektuellen aus dem "progressiven" Lager. Murray Rothbard stellte zu Recht fest: "Never before had so many intellectuals and academicians swarmed into government to help plan, regulate, and mobilize the economic system". Ohne Krieg wäre diese Systemveränderung nicht möglich gewesen. Der listenreiche Weg Wilsons in den Krieg entsprach dem Klasseninteresse der Staatsbürokraten.
Die Ausweitung des Staates mußte finanziert werden. Wilson erhöhte den niedrigsten Satz der Einkommensteuer von 1% (bis 20.000 $) in 1915 auf 6% (bis 4.000 $) in 1918. Der oberste Steuersatz wurde von 7% in 1915 auf 77% in 1918 erhöht. In 1916 gab es weniger als eine halbe Million Einkommensteuerpflichtige, in 1920 mußten 7.000.000 Millionen Bürger Einkommensteuer bezahlen. Auch andere Bundessteuern wurden erhöht. In den 20er Jahren gelang es Andrew Mellon, dem Secretary of Treasury von Warren Harding und Calvin Coolidge, die Einkommensteuersätze zu senken: den untersten Satz für Einkommen unter 4.000 $ auf 0,5%, für Einkommen von 4.000 $ bis 8.000 $ auf 2%, den höchsten Steuersatz auf 24%. Trotzdem waren die Steuereinnahmen des Bundes auf ihrem niedrigsten Stand in der Nachkriegszeit immer noch fünfmal höher als vor dem Krieg. Wilson bewirkte eine dauerhafte Veränderung in der Herkunft der Steuereinnahmen des Bundes: weg von den Konsumsteuern, hin zu Steuern auf Einkommen, Gewinn und Grundbesitz. Auch diese tiefgreifende Veränderung wäre ohne Krieg nicht durchsetzbar gewesen.
Wilson wird heute von der politischen Klasse als "großer" Mann verehrt, und das aus ihrer Sicht mit einigem Recht. Der Kriegssozialismus Wilsons erwies sich als dauerhafte Einrichtung. Er konnte nur teilweise zurückgeführt werden und er öffnete den Weg in den übermächtigen Staat heutiger Prägung. Einige Jahre später konnte ein anderer "großer" Präsident, F.D. Roosevelt, nahezu unverändert auf die "Errungenschaften" und auch das Personal Wilsons zurückgreifen. Wilson hat das "Verdienst", die Ideen der Gründerväter verraten und das Fundament des sozialistischen Wohlfahrtsstaates gelegt zu haben.
Für diese edlen Ziele war Wilson bereit, andere Menschen einen hohen Preis zahlen zu lassen. Im 1. Weltkrieg sind 117.000 US-Soldaten gefallen, 204.000 wurden verwundet. Wir wissen nicht, ob die Opfer unter der europäischen Bevölkerung überhaupt eine Rolle in seinem Kalkül gespielt haben.
"Every government is a scoundrel. In its relations with other governments it resorts to fraud and barbarities that were prohibited to private men by the Common Law of civilization so long ago as the reign of Hammurabi, and in its dealings with its own people it not only steals and wastes their property and plays a brutal and witless game with their natural rights, but regularly gambles with their very lives. Wars are seldom caused by spontaneous hatreds between people, for peoples in general are too ignorant of one another to have grievances and too indifferent to what goes on beyond their borders to plan conquests. They must be urged to the slaughter by politicians who know how to alarm them." H. L. Mencken
Literatur
Raico, Ralph: World War I: The Turning Point. In: Denson, John V. (Hg.), The Costs of War. America's Pyrrhic Victories. Transaction Publishers, New Brunswick and London, 2. Auflage, 2001.
Rothbard, Murray: World War I as Fulfillment: Power and the Intellectuals. In: Denson, John V. (Hg.), The Costs of War. Ebd.
Higgs, Robert: Crisis and Leviathan. Critical Episodes in the Growth of American Government. Oxford University Press, New York and Oxford, 1987.
Die Alternative
Warum führte Wilson Krieg?
Die Ergebnisse des Krieges
Die Ziele des Krieges
Der Weg in den Krieg
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : première guerre mondiale, etats-unis, histoire, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 03 octobre 2009
La mafia e lo sbarco alleato in Sicilia
Tra gli storici è ancora aperta la diatriba sul ruolo avuto dalla mafia siciliana nella preparazione dello sbarco alleato. Tale diatriba è certamente sostenuta dagli apparati mafiosi perché tendono ad assumersi un merito e un potere che in realtà non potevano ricoprire in quel lontano 1943. In Sicilia, grazie al Prefetto Mori, buona parte delle forze di mafia erano state confinate o incarcerate. Anche se i capi erano rimasti liberi, gran parte della manovalanza mafiosa era stata neutralizzata. A tal proposito molti studiosi tra i quali Francesco Renda e Salvatore Lupo sgomberano subito il campo da ogni possibile equivoco. Scrive il Lupo: “La storia di una mafia che aiutò militarmente gli angloamericani nello sbarco in Sicilia è soltanto una leggenda priva di qualsiasi riscontro, anzi esistono documenti inglesi e americani sulla preparazione dello sbarco che confutano questa teoria; la potenza militare degli alleati era tale da non avere bisogno di ricorrere a questi mezzi. Uno dei pochi episodi riscontrabili sul piano dei documenti è l’aiuto che Lucky Luciano propose ai Servizi Segreti della marina americana per far cessare alcuni sabotaggi, da lui stesso commissionati, nel porto di New York; ma tutto ciò ha un valore minimo dal punto di vista storico, e soprattutto non ha alcun nesso con l’operazione ‘Husky’. Lo sbarco in Sicilia non rappresenta nessun legame tra l’esercito americano e la mafia, ma certamente contribuì a rinsaldare i legami e le relazioni affaristiche di Cosa Nostra siciliana con i cugini d’oltreoceano”. Se l’ipotesi che gli “amici degli amici” abbiano avuto un ruolo decisivo nello sbarco angloamericano in Sicilia è da scartare (ne dubito fortemente, ndr), è tuttavia innegabile che gli alleati si servirono dell’aiuto di personaggi del calibro di Calogero Vizzini e Giuseppe Genco Russo per mantenere l’ordine nell’isola occupata. E’ fuori discussione anche il fatto che il boss americano Vito Genovese, nonostante fosse ricercato dalla polizia statunitense, divenne l’interprete di fiducia di Charles Poletti, il capo del comando militare alleato (AMGOT).
Le testimonianze e i racconti dei protagonisti hanno fatto emergere dati incontrovertibili sull’esistenza di tale accordo e su come la mafia americana sia stata determinante per garantire sia la sicurezza delle navi in partenza per l’Europa, sia la minuziosa ricerca di notizie in vista dell’occupazione della Sicilia”.
Fu così predisposta una fitta rete informativa che stabilì preziosi collegamenti con la Sicilia e mandò nell’isola un numero sempre maggiore di collaboratori e di informatori”.
Don Vito divenne il braccio destro indigeno del Governatore Poletti, ma una banda ai suoi ordini rubava autocarri militari nel porto di Napoli, li riempiva di farina e di zucchero (pure sottratti agli alleati) per poi venderli nelle città vicine. Altri mafiosi, meno noti, divennero interpreti o “uomini di fiducia” degli alleati, i neo padroni dell’isola sicula. L’atteggiamento del Governo militare fu ispirato a criteri utilitaristici; sta di fatto, però, che quest’apertura verso gli “amici degli amici” permise in breve alla mafia di riorganizzarsi, di riacquistare l’antica ed indiscussa influenza. Aveva sempre cercato l’alleanza con il potere (anche con quello fascista, agl’inizi), ma per la prima volta le veniva conferito un crisma di legalità e di ufficialità che le consentiva d’identificarsi con il potere. I “nuovi quadri” saldarono o ripresero solidi legami con la malavita americana, indirizzandosi verso il tipo di criminalità associata “industriale” caratteristico del gangsterismo Usa nel periodo tra le due guerre. Il seguito della vicenda dimostra come, grazie agli angloamericani, la seconda guerra mondiale rappresentò per la mafia l’occasione d’oro per una rigogliosa rinascita. I fatti l’hanno dimostrato ampiamente. Si suole dire oggi, da chi intende sminuirne il successo, che il fascismo non debellò la mafia, semplicemente la costrinse all’inazione, tant’è vero che poi si ridestò più forte di prima. Se fu poco, perché il regime attuale non perviene al medesimo risultato? Basterebbe. Senza più delitti ed attività criminale, la mafia si ridurrebbe ad una patetica, folcloristica conventicola segreta che non darebbe noia e non farebbe più paura a nessuno” (V. Martinelli. Il ritorno della mafia in Sicilia. Un regalo degli alleati. Volontà, n. 12, Dicembre, 1993).
|
00:18 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, etats-unis, mafia, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, europe, histoire, sicile |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Hiroshima: la décision fatale

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996
Hiroshima: la décision fatale selon Gar Alperovitz
Si on examine attentivement l'abondante littérature actuelle sur l'affrontement entre le Japon et les Etats-Unis au cours de la seconde guerre mondiale, on ne s'étonnera pas des thèses que vient d'émettre Gar Alperovitz, un historien américain. Son livre vaut vraiment la peine d'être lu dans sa nouvelle version allemande (ISBN 3-930908-21-2), surtout parce que la thématique de Hiroshima n'avait jamais encore été abordée de façon aussi détaillée. Alperovitz nous révèle une quantité de sources inexplorées, ce qui lui permet d'ouvrir des perspectives nouvelles.
Il est évidemment facile de dire, aujourd'hui, que le lancement de la première bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945 a été inutile. Mais les contemporains de l'événements pouvaient-ils voir les choses aussi clairement? Qu'en pensaient les responsables de l'époque? Que savait plus particulièrement le Président Truman qui a fini par donner l'ordre de la lancer? Alperovitz nous démontre, en s'appuyant sur de nombreuses sources, que les décideurs de l'époque savaient que le Japon était sur le point de capituler et que le lancement de la bombe n'aurait rien changé. Après la fin des hostilités en Europe, les Américains avaient parfaitement pu réorganiser leurs armées et Staline avait accepté d'entrer en guerre avec le Japon, trois mois après la capitulation de la Wehrmacht. Le prolongement de la guerre en Asie, comme cela avait été le cas en Europe, avait conduit les alliés occidentaux à exiger la “capitulation inconditionnelle”, plus difficilement acceptable encore au Japon car ce n'était pas le chef charismatique d'un parti qui était au pouvoir là-bas, mais un Tenno, officiellement incarnation d'une divinité qui gérait le destin de l'Etat et de la nation.
Alperovitz nous démontre clairement que la promesse de ne pas attenter à la personne physique du Tenno et la déclaration de guerre soviétique auraient suffi à faire fléchir les militaires japonais les plus entêtés et à leur faire accepter l'inéluctabilité de la défaite. Surtout à partir du moment où les premières attaques russes contre l'Armée de Kuang-Toung en Mandchourie enregistrent des succès considérables, alors que cette armée japonaise était considérée à l'unanimité comme la meilleure de l'Empire du Soleil Levant.
Pourquoi alors les Américains ont-ils décidé de lancer leur bombe atomique? Alperovitz cherche à prouver que le lancement de la bombe ne visait pas tant le Japon mais l'Union Soviétique. L'Amérique, après avoir vaincu l'Allemagne, devait montrer au monde entier qu'elle était la plus forte, afin de faire valoir sans concessions les points de vue les plus exigeants de Washington autour de la table de négociations et de tenir en échec les ambitions soviétiques.
Le physicien atomique Leo Szilard a conté ses souvenirs dans un livre paru en 1949, A Personal History of the Atomic Bomb; il se rappelle d'une visite de Byrnes, le Ministre américain des affaires étrangères de l'époque: «Monsieur Byrnes n'a avancé aucun argument pour dire qu'il était nécessaire de lancer la bombe atomique sur des villes japonaises afin de gagner la guerre... Monsieur Byrnes... était d'avis que les faits de posséder la bombe et de l'avoir utilisé auraient rendu les Russes et les Européens plus conciliants».
Quand on lui pose la question de savoir pourquoi il a fallu autant de temps pour que l'opinion publique américaine (ou du moins une partie de celle-ci) commence à s'intéresser à ce problème, Alperovitz répond que les premières approches critiques de certains journalistes du Washington Post ont été noyées dans les remous de la Guerre Froide. «Finalement», dit Alperovitz, «nous les Américains, nous n'aimons pas entendre dire que nous ne valons moralement pas mieux que les autres. Poser des questions sur Hiroshima, c'est, pour beaucoup d'Américains, remettre en question l'intégrité morale du pays et de ses dirigeants».
Le livre d'Alperovitz compte quelques 800 pages. Un résumé de ce travail est paru dans les Blätter für deutsche und internationale Politik (n°7/1995). Les points essentiels de la question y sont explicités clairement.
(note parue dans Mensch und Maß, n°7/1996; adresse: Verlag Hohe Warte, Tutzinger Straße 46, D-82.396 Pähl).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, armes nucléaires, armes atomiques, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, années 40, guerre, stratégie, crime de guerre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 septembre 2009
Pourquoi Patrick Buchanan a été si rapidement évincé...

ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1996
Pourquoi Patrick Buchanan a été si rapidement évincé...
Avant les primaires déjà, j'ai reçu une dépêche de Lucera, dans laquelle Siegfried Ostertag présentait une vision d'horreur: en Amérique, Patrick Buchanan pourrait bien rassembler sous sa bannière tant de nouveaux électeurs qu'en automne 1996, il deviendrait le concurrent républicain direct de Bill Clinton et chasserait peut-être celui-ci de son mandat.
En effet, lors des premières pré-élections, Buchanan a engrangé des résultats spectaculaires. Les intellectuels de la Côte Est se sont mis à hurler. Leurs satellites européens, avec les Allemands en tête, ont pâli. Josef Joffe appelle Buchanan “le marchand de peur” dans les colonnes de la Süddeutsche Zeitung, le 6 mars. Mais qui a peur dans le scénario? L'établissement d'Outre-Atlantique! Il a peur, grand'peur, de perdre ses pouvoirs.
Un flot d'injures s'est déversé sur Buchanan, flot qui n'a cessé de croître pour s'amplifier et devenir une véritable campagne diffamatoire. Hier on l'accusait d'être un “extrémiste de droite”; aujourd'hui, on le traite de “Jirinovski américain”. Ce qui est assurément plus sulfureux... A peine cette comparaison avait-elle été prononcée, que l'homme-qui-fait-un-malheur-à-Moscou la reprend à son compte et nomme Buchanan son “frère d'arme”. L'homme qui parodie la renaissance du nationalisme projette son ombre jusqu'au-delà de l'Atlantique... Et la campagne a continué: Buchanan est évidemment devenu un national-socialiste qui marchait dans les pas d'Adolf Hitler.
Le trouble-fête, d'élections anticipées en élections anticipées, a été systématiquement refoulé, battu, évincé. Mais les médias ont voulu être bien sûrs que cette éviction était définitive: même battu, Buchanan a encore été victime de manipulations savamment orchestrées. Dès les primaires de New York, le 7 mars, Buchanan avait des difficultés à se placer sur une liste. Son propre parti, qui prétend défendre la “vraie liberté américaine” face aux Démocrates, ne s'est pas géné pour faire passer le mot d'ordre bizarre “to stop Pat” avec des moyens totalitaires.
Cette attitude est pour le moins bizarre, car en stoppant Buchanan, les Républicains ont arrêté leur propre progression. Quelques jours après ces efforts pour éliminer leur candidat le plus populaire, plus aucun pronostic n'annonçait leur victoire. Mais ces prévisions pessimistes ne sont pas dues à l'absence de profil défini de Bob Dole, qui jouit apparemment de l'augmentation du nombre de ses électeurs et ne leur dit que des banalités: «Je ne suis pas un bavard. Je suis un homme d'action». Effectivement, Dole n'est pas un bavard, son discours ne reflète aucune verve, mais il n'est pas davantage l'homme d'action qu'il prétend être.
Les Républicains ont connu un succès retentissant il y a dix-huit mois en arrachant la majorité au Sénat et dans la Chambre des représentants: ce fut un séisme politique, mais il ne fut pas exploité car les Républicains ne sont pas parvenus à se faire entendre à l'assemblée et à exercer les pressions nécessaires sur l'établissement. Bob Dole et Newt Gingrich ont canalisé les flots protestataires émanant du peuple américain en direction de leur parti, mais ils les ont ensuite laissé stagner et mourir. Le porte-paroles le mieux profilé de cette protestation était Patrick Buchanan; aujourd'hui, réduit au silence, il ne pourra plus profiter des contestations et des protestations du peuple pour porter son parti au pouvoir.
Buchanan incarne aujourd'hui aux Etats-Unis un large front composé de mouvements de citoyens réagissant vigoureusement contre la décadence de l'Amérique, qui, le soir de la Saint-Sylvestre, a nommé, par la voix du Washington Post, Gengis Khan “homme du siècle”! L'impulsion fondamentale de cette profonde vague de protestation conservatrice est dirigée contre Wall Street et contre le pouvoir fédéral de Washington. Elle allie le “mouvement des culs-terreux” (les fermiers), d'une part, à celui des “Knights of Labor” (= “Les Chevaliers du Travail”) présents dans les grandes villes, d'autre part, dans un combat général contre les menaces que font peser la grande industrie et l'oligarchie financière sur la simple existence quotidienne de millions de citoyens modestes. A cette lutte contre la misère menaçante s'associe un autre combat, plus fondamental celui-là, contre l'abrutissement généralisé et la dépravation morale qu'apportent l'industrie des loisirs et les mass-media, ainsi qu'une lutte contre la libanisation du pays, due à la faillite totale du modèle multiculturel: aujourd'hui, effectivement, toutes les catégories sociales ou raciales de la population se sentent d'une façon ou d'une autre discriminées.
Cette Amérique frustrée lutte aujourd'hui pour avoir un accès direct à l'espace publique-médiatique, qui n'est finalement pas aussi solidement verrouillé qu'en Allemagne [et dans le reste de l'Europe]. Et cette Amérique frustrée est armée. Les “Sovereign Citizens” (= les Citoyens Souverains) s'exercent désormais à la résistance armée contre la violence “légale” de l'Etat.
Le mélange de frustration et de combativité qui s'observe actuellement aux Etats-Unis est explosif. Mais si Buchanan a voulu apporter des remèdes aux maux intérieurs de l'Amérique, il a également voulu changer sa politique extérieure, et de façon radicale. Le 19 février 1990, il avait publié un article sur la questions des frontières orientales de l'Allemagne dans le Washington Times (et 250 journaux américains et canadiens l'avait reproduit!); le 22 octobre 1990, dans les pages de The New Republic, il se rapprochait dangereusement des révisionnistes, en niant quelques aspects de la culpabilité allemande dans le génocide. Certes, l'objectif de Buchanan n'était pas de déployer une politique anti-polonaise ou d'intervenir dans les débats en faveur des révisionnistes, mais, plus précisément, de changer de stratégie planétaire, d'abandonner les anciens alliés russes, français et britanniques de la seconde guerre mondiale, et de renforcer considérablement les liens qui unissent Washington à ses “demi-alliés”, aux ennemis d'hier, l'Allemagne et le Japon. Peut-être se souvient-on subitement dans certains cercles politiques américains que les bons rapports entre les Etats-Unis et la Prusse, de Frédéric II à Bismarck, ont bénéficié aux deux partenaires.
Cette mutation potentielle des alliances a fait frémir les gardiens de l'ordre d'après 1945: ils ont conjugué tous leurs efforts pour bloquer l'ascension vertigineuse de Buchanan. Mais cela ne signifie pas pour autant que les forces innovatrices des Etats-Unis ont connu un échec durable. Le Parti Républicain n'a pas été capable de digérer les revendications de la base populaire, mais il est le seul à leur avoir donné momentanément une tribune. Aux dernières nouvelles, Buchanan songerait à se présenter comme candidat indépendant face à Dole et à Clinton. La rénovation de l'Amérique est retardée de quatre ans, sauf si le chaudron bouillonnant que sont devenus les States n'explose pas avant. Le XXIième siècle frappe à la porte...
Hans-Dieter SANDER.
(ex Staatsbriefe, Nr. 2-3/96).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, etats-unis, élections américaines, démocratie, conservatisme, amérique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 septembre 2009
Un livre sur l'Iran

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES – 1990
Un livre sur l’Iran
Recension: Shireen T. HUNTER, Iran and the World. Continuity in a Revolutionary Decade, Indiana University Press, Bloomington (Indiana 47.405), 1990, 256 p., $35.00 (cloth) ou $14,95 (paperback), ISBN 0-253-32877-2 (cl.) ou 0-253-20590-5 (pbk).
En février 1979, le triomphe des forces révolutionnaires islamiques, hostiles au pouvoir du Shah Mohammad Reza Pahlevi, met un terme à une tradition monarchique vieille de 2500 ans en Iran. La chute de la monarchie n'a pas installé d'emblée un régime islamique, bien que l'Ayatollah Rouhollah Khomeiny apparaissait très nettement comme le leader incontesté de la révolution. En théorie, pendant près d'un an, le pouvoir est demeuré entre les mains d'un gouvernement provisoire dirigé par le Premier Ministre Mehdi Bazargan, flanqué de ses collègues nationalistes et séculiers.
En fait, ce gouvernement provisoire ne contrôlait nullement la situation et le pays entra rapidement dans une phase d'incertitude chaotique. Les extrémistes islamiques ainsi qu'une flopée de mouvements hybrides, gauchistes/islamistes, défiaient le gouvernement de façon ininterrompue, tandis que le «Conseil de la Révolution» minait ses possibilités d'agir. Rapidement, le front de bataille s'est dessiné en toute limpidité: les trois groupements idéologiques majeurs (séculier-nationaliste, islamiste et gauchiste) avaient chacun une vision radicalement différente du futur de l'Iran.
Le livre de Shireen T. Hunter entend dégager plusieurs lignes de faîte:
1) démontrer qu'une variété de facteurs —et pas seulement l'Islam— a marqué le comportement de l'Iran sur la scène internationale et déterminé sa politique extérieure;
2) montrer que la vision du monde iranienne n'est ni purement islamique ni un phénomène réellement nouveau dans la pensée politique du tiers-monde;
3) expliquer que le comportement de l'Iran n'a pas été une rupture totale par rapport au comportement politique normal escompté dans le concert des Etats du globe; ce comportement est celui d'un Etat du tiers-monde à un stade révolutionnaire de son existence;
4) montrer qu'il y a continuité entre le comportement actuel et passé de l'Iran, y compris dans les stratégies diplomatiques;
5) fournir un panorama des relations extérieures de l'Iran au cours de la dernière décennie, en le replaçant dans son propre contexte historique;
6) enfin, tirer des conclusions des événements de la dernière décennie pour prévoir l'avenir de l'Iran, quel que soit le régime qui émergera après la mort de l'Ayatollah Khomeiny.
Les outils méthodologiques utilisés dans cet ouvrage, afin de mettre en lumière les lignes de faîte énoncées ci-dessus, sont ceux qui président généralement aux analyses classiques dans les domaines de la diplomatie, de l'histoire et de la politique étrangère. Le livre aborde de front les questions majeures de la géopolitique régionale, de l'histoire mouvementée de l'Iran, des ressources économiques du pays, des circonstances intérieures (les processus de décision), pour examiner dans la foulée leurs interactions multiples et leur résultat final, celui qui détermine en dernière instance le comportement (géo)politique de l'Iran. Un ouvrage capital pour comprendre les dynamiques à l'œuvre dans une région bouleversée, où se décide sans doute le sort de toute la masse continentale eurasienne.
00:10 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, iran, moyen orient, histoire, stratégie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 23 septembre 2009
Aspects économiques de la révolution française

Aspects économiques
de la Révolution Française
par Bernard NOTIN
«La Révolution fut provoquée par les abus d'une classe revenue de tout, même de ses privilèges, auxquels elle s'agrippait par automatisme, sans passion ni acharnement, car elle avait un faible ostensible pour les idées de ceux qui allaient l'anéantir. La complaisance pour l'adversaire est le signe distinctif de la débilité, c'est à dire de la tolérance, laquelle n'est en dernier ressort qu'une coquetterie d'agonisants».
Cioran, Ecartèlement, Gallimard, 1979, p. 30.
Tout découpage dans le déroulement continu du temps global peut paraître arbitraire, et plus arbitraire encore celui qui se désintéresse des dates "historiques". Le mouvement de la pensée nous offre l'ensemble du XVIIIième siècle pour comprendre la formation économique des révolutionnaires. La périodisation des faits ne peut s'appuyer sur le commencement de la Révolution, mais plutôt sur 1778, date à laquelle interviennent d'une part la guerre d'Amérique et les dépenses qu'elle occasionne, d'autre part la fermeture de certains marchés (surtout pour les vins), l'ouverture de la plupart des ports espagnols au commerce d'Amérique, ce qui vivifie l'activité économique de la péninsule ibérique. Tout cela contribue à expliquer la gêne économique française à la veille de 1789. De plus, les figures de proue disparaissent dans ce laps de temps: Rousseau (1712-1778), Voltaire (1694-1778), Diderot (1884). Après que la pièce eut été écrite, le spectacle pouvait commencer. On est aussi tenté de se référer à une trinité solide. Avant la Révolution, l'agriculture périclite: c'est une période de stagnation et de baisse des prix qui dure jusqu'en 1787. Le marasme unit les difficultés des rentiers et des entrepreneurs, des bourgeois et des petits propriétaires, aux misères de la masse (1). Ensuite, la Révolution qui perturbe les conditions générales de l'activité économique. Enfin, les lendemains qui chantent ou déchantent: ruine du grand commerce, stagnation du secteur agricole et... première phase de la révolution industrielle. La Révolution crée aussi un lien entre ceux qui ont traversé la même tourmente et rapproche la pensée d'hommes assez différents. La distance semble très grande entre les scolastiques, les mercantilistes, la "secte" physiocratique. Or, ce triple sceau marquera les consensus et dissensus économiques des révolutionnaires.
Le modèle newtonien
La Révolution, au sens le plus large, est d'abord dans l'esprit: elle est dans l'intelligibilité du monde à partir du modèle Newtonien et dans la méthode d'analyse des faits socio-économiques. Elle est aussi l'irruption et l'éruption de forces souterraines obscurément en travail, rassemblées dans la formule du "double corps" de l'Etat. Enfin, de près comme de loin, car c'est la même chose, le bilan matériel s'inscrira tout en nuance. Comme Fabrice del Dongo, nous n'y verrons ni victoire, ni défaite, mais, contrairement à lui, des laissés pour compte et des profiteurs.
I. Les principes de la pensée économique
Au milieu du XVIIIième siècle a été atteint un seuil critique: des idées qui flottaient dans l'espace mental atterrissent et s'imposent. La pensée théorique s'incarne de plus en plus dans la réalité concrète des hommes. L'originalité du siècle tient à cette tentative de faire déboucher la réflexion dans l'action, sous la direction de monarques "éclairés" par la lumière philosophique. Louis XVI en était lorsqu'il confia le pouvoir à Turgot, imbibé d'encyclopédie et de physiocratie. Les essais de réforme se heurtent aux privilégiés qui évoluent cependant au sein du même univers mental, le paradigme newtonien: les divergences ne s'étaleront qu'au moment d'articuler contenu politique et fonctionnement économique.
L'Europe des Lumières rassemble sans distinction de frontières un grand nombre d'esprits autour d'idées communes: l'invocation de Newton. G. Gusdorf insiste sur l'absence de Descartes qui ne compte que "quelques défenseurs au XVIIIième siècle, le plus souvent en dehors de monde scientifique" (2). Le développement du savoir privilégie la physique et la biologie car les mathématiques sont en retrait pour deux raisons: elles ne paraissent pas ouvrir la voie à la connaissance expérimentale et détournent des recherches sur l'origine de nos idées, traitées comme des évidences intrinsèques. Sur ce socle physico-biologique germera une nouvelle approche de la société, accordant à l'économie un grand rôle. Les intérêts sont rehaussés au niveau des passions et, ensemble, préoccupent le siècle, puis partagent les révolutionnaires selon une ligne inspirée de Quesnay d'un côté et de Rousseau et Necker d'autre part.
Consensus newtonien
La science newtonienne a été diffusée en France par Voltaire. L'Anglais John Locke, dont l'œuvre a si fortement influencé les révolutionnaires, était un ami de Newton. L'Ecossais David Hume, en 1739, dans son Traité de la nature humaine, affirmait que la science de l'homme serait une science au sens newtonien du terme. Or, Hume a eu un ascendant sur Condillac, Adam Smith, les "Idéologues" (ceux-ci traduiront l'œuvre d'Adam Smith excellemment résumée par Condorcet) (3). James Bentham (1748-1832) se proposait de devenir le Newton du monde moral. Tout ce petit monde, essentiel pour comprendre la formation intellectuelle des révolutionnaires, est donc newtonien. Il semble que ce dernier ait ouvert la voie au progrès de la connaissance en dégageant la physique de la simple imagination. Surtout, il a affirmé l'existence d'un monde composé de matière et de mouvement. Par l'attraction, une intelligibilité unique embrasse l'ensemble de réel. L'autorité de cette synthèse lui vaudra d'être utilisée à tout propos. Bon nombre d'auteurs en retiennent la distinction entre causes et lois, et la possibilité d'une expression mathématique sans fondements métaphysico-théologiques. Newton rend possible la recherche de formes d'intelligibilité hors de la transcendance et permet de fonder les sciences de l'homme sur le modèle de la science des choses. De manière très générale, la compréhension doit passer par les stades successifs de l'observation, de l'expérimentation, et de la théorie mathématique. La science expérimentale trouve ici droit de cité, jusqu'à devenir un véritable phénomène d'époque et à servir d'amusement à la veille de la Révolution. Le désir d'enseigner la physique expérimentale une fois les jésuites expulsés (1762), sera décisif dans la création des écoles techniques, où se formera une élite de la compétence, qui trouvera dans la Révolution un moyen d'exprimer ses capacités. Saint-Simon, prophète de l'aristocratie scientifique, fut un grand admirateur de Newton. En cette seconde partie du XVIIIième siècle, la cause est entendue: les règles de la vraie méthode ont été formulées une fois pour toutes. La question est alors de savoir s'il faut interpréter cette certitude au seul niveau de la connaissance du monde ou si elle s'étend à la réalité elle-même. Y-a-t-il dualité ou unité des causes physiques et des causes morales? Si Turgot admet la dualité, c'est parce que le domaine humain est soumis au progrès. Mais les physiocrates cherchent à déduire toute l'organisation économique et sociale d'un principe unique et A. Smith étudie et enseigne la "philosophie morale", véritable science des mœurs conçue sur le modèle de celle de la nature. Il n'est pas jusqu'à la franc-maçonnerie qui, pour se donner l'illusion de penser, publie sous la plume de son réformateur le plus illustre, Désaguliers (1683-1742), un dithyrambe newtonien en 1728. La philosophie de la nature (qui désigne alors la science) s'infiltrera aussi dans le rêve d'une "philosophie" de l'histoire, connaissance susceptible de permettre aux hommes la maîtrise de leur destinée. Les têtes pensantes de la Révolution en étaient imbibées.
Priorité des faits sur les idées
La conversion générale à la science incite, en tous domaines, à donner priorité aux faits sur les idées. La conséquence en est un découragement spéculatif et une priorité reconnue à l'analyse sur la synthèse. La notion de système doit donc subir une reformulation pour ne pas se discréditer. Turgot fournira les moyens lors de l'éloge de V. de Gournay, précurseur des physiocrates. Il existe un mauvais sens du mot système, "suppositions arbitraires par lesquelles on s'efforce d'expliquer tous les phénomènes, et qui, effectivement, les explique tous également, parce qu'ils n'en expliquent aucun" (4). Il y oppose un sens plus favorable, où "un système signifie une opinion adoptée mûrement, appuyée sur des preuves et suivie de ses conséquences". De contemplative, la science se fait opérative et technique: elle doit servir les utilités de l'homme et regrouper, pour être effective, les énergies. Peu à peu, la civilisation traditionnelle incarnée par la pensée scolastique et l'autorité royale tournée vers la puissance et la gloire se disloque, le paradigme newtonien œuvrant pour transformer le milieu. Pendant des siècles, l'univers mental avait reposé sur la subordination de l'Eglise à Dieu, du fidèle à l'Eglise, du citoyen au service de l'Etat. A la fin du XVIIIième siècle, cette perspective se trouve inversée. Les révolutionnaires légitimeront en droit un ordre social qui s'installe au cours du siècle, et dont la dimension économique ne prend de relief que dans le contexte global d'une nouvelle morale, d'une autre spiritualité, d'une anthropologie différente.
La triade pré-révolutionnaire
L'attitude caractéristique des philosophes du XVIIIième siècle est de traiter tous les docteurs scolastiques de "casuistes" avec le plus profond mépris. R. de Roover (5) précise que la doctrine de l'usure, en particulier, est fortement attaquée par Turgot, Condillac, les physiocrates. En France, la loi qui légalisera les clauses contractuelles autorisant le versement d'intérêts ne verra le jour que le 12 octobre 1789: la Révolution marquait la fin d'un monde.
Les scolastiques ne diabolisaient pas le commerce, mais lui préféraient l'agriculture car la tentation de succomber à l'usure y était moindre. Les mercantilistes avaient adopté le point de vue inverse: le commerce est la plus noble des professions. Alors que l'économie scolastique s'affirmait universelle en ce qu'elle cherchait les lois assurant la justice, les mercantilistes ne disposèrent jamais d'une doctrine ou d'une méthode unifiées. En France, le terme de colbertisme résume correctement la politique économique inspirée par l'idée d'une plus grande responsabilité du pouvoir dans la gestion du pays. Pourtant, cette action fut fermement critiquée par Vauban (1646-1714) et surtout son cousin Boisguillebert (1646-1714) dont la réflexion fiscale et la conception de l'économie comme système annoncent les physiocrates et la nouvelle perception de l'Etat. Boisguillebert écrit du point de vue souverain tout en critiquant les idées mercantilistes. Il existe donc, en ce début du XVIIIième, une possibilité de réflexion économique sans référence ni à l'univers scolastique ni au libre-échange et qui s'infiltrera dans les mentalités jusqu'à la fin du siècle.
L'idée d'ordre naturel relie la pensée scolastique aux hommes de la Révolution. "De concept éthico-juridique, la loi naturelle devient progressivement concept analytique" (6).
L'essor de la science expérimentale et de l'intelligibilité analytique autorise les physiocrates à proposer un schéma conforme à la nature. En même temps, l'économie acquiert une autonomie que lui déniait les docteurs scolastiques: elle cesse d'être partie d'un ensemble plus vaste pour devenir, avec les mercantilistes, une collection de règles pratiques d'enrichissement. Les fondements de l'intervention sur les prix, les critiques fiscales, s'inspirent tout autant de l'héritage intellectuel scolastique que d'une volonté de servir l'Etat. Incarné par son souverain depuis que la pensée politique s'est émancipée du religieux, promouvant dans le mouvement un nouveau concept de pouvoir. Selon Louis Dumont (7), il en est résulté l'idée d'une consistance des activités productives et commerciales, de sorte que la formation des équilibres et des déséquilibres de quantités ne devait plus s'expliquer par la volonté d'en haut, divine ou étatique, ni par le hasard, mais par des mécanismes qu'il fallait observer et analyser. Il a fallu la réunion de deux conditions: la dissociation du politique et de l'économique et la transition d'une attitude normative à une attitude positive. Au XVIIIième siècle, l'individu a suffisamment droit de cité pour rendre possible la théorie économique, mais à condition de rester subsumé dans un ensemble. On décèle dans la pensée économique l'émancipation de l'individu "tandis que réapparaît, sous une forme souvent anodine et déguisée, le point de vue de la totalité sociale" (8).
Cosmopolitisme contre
tradition scolastique
Ce tout réapparaît dans le débat sur la citoyenneté au cours duquel s'affrontent la version cosmopolite (des idées communes suffisent) et la tradition scolastique qui, à travers Thomas d'Aquin, perpétue l'univers latin: la religion est un patriotisme car elle n'appartient pas à la vertu théologale de la foi, mais à la vertu morale de la justice qui consiste à rendre à l'autre ce qui lui est dû. La religion est la justice si la dette ne peut être rendue, ce qui concerne les ancêtres et Dieu. Ainsi Thomas d'Aquin enseignait que le patriotisme est le culte des morts, c'est-à-dire une forme de la religion.
La présence simultanée d'individualisme et de holisme est frappante chez Quesnay, inspirateur de réformes fiscales, mais surtout figure exemplaire des futurs débats sur les fondements de l'intervention étatique en économie. Vincent de Gournay avait proposé de "laissez faire, laissez passer" affirmant l'autonomie économique. Quesnay, négligeant les sommes de réflexion sur la valeur développées dans deux directions, le travail ou l'utilité, s'en remet à la terre pour engendrer toute richesse. Un tel privilège ne s'explique, selon Dumont, que par la forme spéciale de propriété qui s'attache à la terre. La propriété immobilière subordonne l'économie à d'autres instances (politique, morale, religieuse) et ne sépare pas la relation aux choses de relations entre hommes. Quesnay appartient encore à l'idéologie holiste lorsqu'il confie le pouvoir politique aux propriétaires immobiliers qui payeront seuls les impôts, mais il récuse l'intervention de l'Etat dans l'activité économique, s'affirme anti-mercantiliste en défendant la liberté des échanges et la propriété privée. Soulignons aussi, en reprenant le commentaire de G. Haarscher (9), que Quesnay met l'accent sur la production, la création des valeurs, alors que les mercantilistes s'intéressaient à la circulation, au commerce. La préoccupation productive est en effet un trait général de l'époque: Condillac (1714-1780) accordait une attention particulière au travail, principale source de valeur car l'idéal d'une ascèse contemplative a cédé la place au désir d'affronter le monde pour le mettre en valeur. Le travail créateur à la façon de R. Crusoé est mis en honneur, même s'il en résulte des incompatibilités avec d'autres vertus.
La Fable des Abeilles de Mandeville
Le succès de la Fable des Abeilles (1705) de Bernard de Mandeville (1670-1733) fut lié au scandale et aux protestations qu'elle suscita. L'humanité est comparée à une ruche dans laquelle chaque homme a le droit et le devoir de poursuivre son intérêt car il contribuera le plus efficacement au bien commun, les "vices privés" devenant des "bienfaits publics". La pensée de Mandeville développe une psychologie qui sera celle des morales fondées sur l'intérêt, mais insiste surtout sur l'activité tout en opposant la simple diligence à l'esprit d'industrie défini par la soif de gagner et le désir infatigable d'améliorer notre condition. L'accent mis sur l'activité, de Mandeville à Quesnay, puis A. Smith instillera le discours révolutionnaire sur la pauvreté.
Dernière caractéristique des principes fondateurs de la pensée économiques pour l'époque révolutionnaire: le traitement de la composition des intérêts privés. Lorsque l'individu devient le sujet élémentaire, l'atome de la réflexion, la pensée économique doit réfléchir sur l'harmonisation des actes. La conscience d'une désagrégation se traduit chez Quesnay par un recours à l'ordre naturel qui soumet l'homme à la nature. Mais la notion d'individu ou d'agent (terme ultérieur) se spécifie au moyen d'attributs: les intérêts et les passions. La Révolution française, en effaçant les statuts d'une société d'ordres, définit la Nation comme l'ensemble des individus identiques sous l'angle du dénombrable et du législatif et résoud le problème d'agrégation par la volonté générale. G. Haarscher affirme que Necker et Rousseau sont les deux figures de l'opposition à Quesnay en ce qu'ils brident l'économie, à laquelle Quesnay aurait conféré une trop grande liberté pour la soumettre aux règles du pacte social, à la "volonté générale". Les deux instances (politique et économique), libérées de l'ordre religieux peuvent entrer en conflit virulent: l'économie autonomisée proteste contre l'interventionnisme étatique, tandis que le politique du contrat social récuse le mouvement autonome de l'économie.
Ainsi, le débat se situe-t-il tout entier à la charnière de deux mondes sur la ligne de partage du holisme et de l'individualisme. Les tenants de la théorie du contrat social plaident en faveur de l'individualisme politique et critiquent tout ce qu'il entrave: l'ordre naturel de Quesnay, élément traditionnel, mais aussi l'économie émancipée susceptible de déstabiliser l'univers contractuel. La position de Locke, dans la perspective de Dumont, est essentielle pour comprendre la suite. Locke affirme que la relation entretenue par l'individu avec les choses passe simplement par la propriété à condition d'être légitimée par le travail. En conséquence, le point de vue holiste pourra déclarer illégitime certaines formes de propriété: les révolutionnaires useront de l'argument. Dire que le travail doit constituer le critère de la propriété, c'est aussi affirmer que sa qualité mesure la valeur des biens et poursuivre avec Grotius, Hobbes, Pufendorf, une réflexion sur la valeur "objective". L'oubli des débouchés est révélateur: la marchandise doit trouver acheteur, répondre à une demande, quelle que soit la nature de cette dernière. Il appartiendra à Galiani (1728-1787), Condillac (1715-1780), Turgot, de développer la théorie "subjective" de la valeur empruntée aux scolastiques de l'école de Salamanque.
A l'aube de la Révolution, un creuset culturel avait façonné les acteurs, leur suggérant des interprétations et des solutions aux questions économiques. Ils disposaient de trois repères: la démarche de la physique et la méthode analytique, la nécessité d'agréger et de réguler les intérêts privés, la dévalorisation du passé, inutile lorsque tout repose sur le travail ou l'ordre naturel. Il faut donc soit en revenir à l'antique, soit créer des schémas abstraits dans lesquels la logique des origines se substitue à l'histoire des origines. Munis de ce bagage, ils s'efforceront de traiter deux questions fondamentales: le prix des subsistances et son corollaire, la pauvreté; le budget de la république qui suppose de choisir les dépenses et de justifier les ressources.
II. Le double corps
de l'Etat
Empruntée à P. Rosanvallon qui désigne ainsi l'œuvre de Boisguillebert, l'appelation décrit parfaitement le dilemme dans lequel nagera la Révolution: le tout et la partie. L'Etat, assimilé au Souverain, n'est qu'une partie du corps social et politique, ayant une fonction spécifique: défense et sûreté. En contre-partie, il perçoit l'impôt dont les caractéristiques sont à débattre. En même temps, l'Etat est l'ensemble du corps social; le souverain se confond avec ses peuples: il est le tout. L'Etat doit donc remplir un double rôle. En tant que simple partie, il offre la sécurité "extérieure". En tant que tout, il a deux devoirs: maintenir le corps social en bonne santé (la circulation des biens ou consommation), assurer la concorde intérieure ou paix sociale (maintenir le "corps uni"). En particulier "les pauvres, dans le corps de l'Etat sont les yeux et le crâne, et par conséquent les parties délicates et faibles"(9). La question des subsistances et de la pauvreté était donc à traiter en priorité.
La menace de l'indigence
La question sociale en 1789 renvoyait au problème de la pauvreté. La mauvaise récolte de 1788 avait fait bondir le prix du grain dans des proportions oubliées depuis 1709. Les premières enquêtes de la Révolution constatent que onze millions de Français sont dans l'indigence, souvent contraints d'errer à la recherche d'un moyen d'existence (12). De mai à juillet 1789, les émeutes de chômeurs se conjuguent aux pillages des convois de grains. Comment analyser la cherté du blé et que faire? La question est ancienne: depuis 1764, les économistes polémiquent sur le sujet. Convient-il de laisser agir vendeurs et acheteurs? Faut-il intervenir pour améliorer le ravitaillement? Le débat n'est pas futile car les milieux populaires consacrent en moyenne la moitié de leurs revenus à l'achat de pain, base de l'alimentation. F. Aftalion (13) cite les travaux de G. Rudé qui fixe à huit livres quotidiennes (de pain), la quantité nécessaire (en moyenne) à une famille de quatre personnes. Pour des rémunérations journalières de 20 à 50 sous, selon les activités, il ne fallait pas que le prix du pain de quatre livres montât au dessus de huit ou neuf sous. Necker avait publié en 1775 un ouvrage (Essai sur la législation et le commerce des grains) dans lequel il montrait une claire compréhension du phénomène, sans qu'il nous soit possible de préciser s'il connaissait l'étude de Gregory King (1648-1714), premier auteur à avoir relié les fluctuations du prix du blé au volume des récoltes. Turgot aussi préconisait la libre circulation des grains comme moyen d'assurer la compensation régionale des surplus et déficits. Condorcet, enfin, dans ses Réflexions sur le commerce des blés (1776) prend parti pour Turgot. Il existait donc de bonnes analyses des mouvements de prix, susceptibles de fonder une politique d'approvisionnement.
La politique de l'Ancien Régime reposait sur une réglementation des marchés, le stockage, et un système d'approvisionnement pour Paris. Une mauvaise récolte, en poussant les prix à la hausse, enrichit les producteurs qui peuvent attendre et spéculer: mais le résultat est le même en cas de stockage préventif. Les révolutionnaires n'ont pas su trancher: Robespierre utilise l'édit du maximum et adhère à la thèse des saboteurs et des accapareurs... Mais le débat économique était soumis aux pressions des sans-culottes, ensemble de salariés et de propriétaires dont les maîtres et compagnons formaient l'ossature: ils ont joué un grand rôle de l'été 1791 à l'été 1794. Leurs préoccupations, en matière d'économie, n'allaient pas au-delà d'une revendication en faveur d'un niveau de vie décent. Il existe plusieurs méthodes pour en arriver là. Or, les sans-culottes préféraient le contrôle des salaires, car ils raisonnaient dans le cadre d'une nature, en bute aux méchants riches: "Les pauvres étaient naturellement patriotes et vertueux, tandis que les riches, qui avaient été trop longtemps habitués à ne considérer que leurs propres intérêts, étaient incapables de générosité républicaine" (14). La nature fournit des aliments dont les prix ne montent qu'après spéculation. Cette perversion de la nature justifie un châtiment que les circonstances rendront exemplaire.
Que faire, alors, vis-à-vis des indigents? L'Assemblée Constituante a formulé des principes élaborés en projets de décrets par le comité de mendicité, qui sera transformé en Comité des Secours publics, par la Législative et la Convention. Ce comité de mendicité rassemble de nobles âmes: le Duc de La Rochefoucauld-Liancourt, le Comte de Virieu, Boncerf (auteur d'une brochure sur les inconvénients des droits féodaux), Barère, Guillotin. Il affirme le droit de chacun à sa subsistance et propose de substituer le secours public à l'aumône par des versements forfaitaires des départements.
«Les secours publics
sont une dette sacrée»
Dans le préambule de la Constitution de 1793, Robespierre réaffirme: «Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler» (15). Les lois qui se succèdent de mars 1793 à Floréal An II traitent des pauvres hors d'état de travailler et des pauvres sans travail, chômeurs ou "fainéants". Pour ces derniers, la Révolution se coulera dans l'esprit de l'Ancien Régime, ne changeant que les modalités. Adieu fouets, galères et vieux dépôts, place à l'incarcération dans une maison d'arrêt pour toute personne demandant de l'argent ou du pain sur la voie publique. Dans ce "lieu de vie", le travail est obligatoire, le salaire retenu aux 2/3 pour les frais de séjour. Ce n'est rien de plus que le traditionnel "renfermement". Une innovation cependant: les récidivistes «de niveau trois» partent peupler, huit années au moins, une colonie. Dans le même temps, la législation ne peut ignorer les anciens ateliers de charité. Elle les transforme en travaux publics ou grands travaux, payés les trois quarts du prix moyen de la journée de travail. La quintessence de la pensée révolutionnaire charitable s'exprime dans un texte de Barère, au moment de présenter la nouvelle loi sur proposition du Comité de salut public (22 floréal an II): «La mendicité est... une dénonciation vivante contre le gouvernement... Le tableau de la mendicité n'a été jusqu'à présent sur la terre que l'histoire de la conspiration des propriétaires contre les non-propriétaires... Si l'agriculture est la première et la véritable richesse d'un Etat, nous devons prouver aujourd'hui que l'intérêt du législateur est de favoriser les cultivateurs avant toutes les classes de la Société...». Responsabilité du gouvernement, dichotomie propriétaires/non-propriétaires, priorité à la pauvreté campagnarde: tous les ingrédients révolutionnaires sont rassemblés sans qu'une analyse nouvelle rompe avec les pratiques de l'Ancien Régime.
Recettes et dépenses
L'historiogaphie des finances à la fin du XVIIIième siècle met l'accent sur deux dimensions complémentaires: le point de vue budgétaire strict qui évalue les revenus et les dépenses, le rapport entre l'Etat et les milieux financiers. De façon générale, l'Etat doit satisfaire les besoins et désirs publics par opposition aux besoins personnels. Dans un article publié en 1918 (La crise de l'Etat fiscal), Joseph Schumpeter indiquait que «les finances publiques constituent l'un des meilleurs points de départ pour une étude approfondie de la société» (16). L'Etat fiscal apparut au XVIième siècle pour payer les dépenses de guerre. Le sociologue N. Elias affirme que la période axiale se situe au cours de la Guerre de Cent Ans, lorsque des prélèvements occasionnels destinés à des usages précis et bien déterminés se sont transformés en une institution permanente, puisque le Roi a toujours besoin d'argent pour mener à bien les conflits (17). En toutes hypothèses, il apparait que les dépenses passèrent avant les recettes puis, après que l'Etat eut acquis une solide structure, on leva des impôts pour des raisons qui étaient autres que la raison initiale. Jusqu'en 1788, où un édit crée le Trésor royal (naissance du principe d'un trésor public), les finances du Roi ne sont pas vraiment des finances publiques. Alain Guéry rappelle: «Les financiers qui sont chargés de leur gestion sont des officiers. Leurs revenus sont des gages et non des salaires. Ils ne gèrent pas des caisses publiques, mais leurs caisses privées, dans lesquelles les fonds qui appartiennent au Roi sont en compte, avec d'autres fonds d'origines diverses» (18). Les dépenses sont d'abord militaires quoiqu'il soit impossible de mener de longs conflits par insuffisance de ressources. L'endettement considérable limite l'effort qui, nécessairement, retombe. Les dépenses consacrées directement au commerce et à l'économie ne dépassent pas 1% du total des dépenses. Le dernier budget pour 1788 est assez bien connu et n'est pas considéré comme atypique: la dette absorbe plus de la moitié (50,5%), la guerre et la diplomatie 26,3% (guerre: 16,8%; marine et colonies: 7,2%; affaires étrangères: 2,3%), les dépenses civiles 23,2% (la cour: 5,7%; administration générale: 3%; secours: 2,8%; économie: 3,7%; instruction et assistance: 1,9%). La politique budgétaire est tournée exclusivement vers la recherche de l'argent nécessaire pour couvrir les dépenses engagées et "l'idée que les dépenses et les revenus de la cour puissent être utilisés dans le sens d'une action sur la vie économique et sociale du pays, échappe aux habitudes, aux attitudes et aux mentalités, non seulement des responsables de l'administration royale des finances, mais aussi des publicistes et économistes du temps" (19). Les révolutionnaires se préoccupèrent aussi de trouver des recettes, mais après qu'ils eurent mis à bas le système fiscal sans étudier sérieusement les effets du financement sur l'économie. Après les décisions et les débats théoriques, le personnel et ses réseaux.
La structure du financement
Le système fiscal jusqu'à la Révolution s'organisait autour de quatre prélèvements (20). Les droits d'origine féodale, qui n'étaient pas les plus insupportables: Alfred Cobban (21) a montré que l'attaque contre les droits seigneuriaux devaient s'interpréter comme une contestation de leur commercialisation croissante et que la révolte paysanne était tournée contre la bourgeoisie propriétaire de ces droits. La dîme d'Eglise, second prélèvement, était bien vivante: 10%. Les impôts indirects, perçus par la ferme générale, regroupaient la gabelle, les aides (frappant surtout les boissons), les traites (droits de douane). Enfin, les impôts directs: taille, capitation.
Ce système fiscal souffrait d'au moins deux tares: il était anti-économique et son recouvrement coûtait cher. Les états généraux, convoqués pour résoudre le problème financier, le contestèrent rapidement (13 juin), car il n'était point fondé sur le consentement national. Lorsque s'ouvre le grand débat, en mars 1790, les positions de l'assemblée oscillent, d'après R. Schnerb (22), entre la condamnation sans réserve des droits de consommation (chef de file: Roederer), et le compromis nécessaire à l'alimentation des caisses publiques. Dupont de Nemours, rapporteur du comité des impositions, s'inscrit dans le second courant. Le 11 mars 1790, il propose de supprimer la gabelle et les droits de marque sur les cuirs, les fers, les amidons, et suggère de relever les droits de douane, de maintenir le produit du tabac, ainsi que les droits sur les boissons. Il justifie ses propositions par la pensée physiocratique et affirme vouloir créer en faveur des propriétaires les conditions d'une meilleure rentabilité. Ultérieurement, pense-t-il, il sera possible de supprimer tous les impôts indirects.
Les adversaires sont "infatigables à rappeler que l'impôt indirect, volontaire, convient à l'homme libre" (23). En vain. Les impôts indirects succombèrent... temporairement. La Révolution n'est en fait qu'un accident au milieu d'une tendance à l'aménagement des impôts indirects. Calonne et Necker s'en étaient déjà préoccupés: les droits indirects comblaient 43 % des ressources budgétaires en 1788. En les supprimant, on posait le problème du fonctionnement normal de l'Etat. La béance budgétaire paniqua le groupe de la Montagne dont l'obsession devint la quête de ressources: les assignats y pourvoieront. La tentation pour les constituants était d'autant plus grande qu'ils raisonnaient selon la causalité angélique: un bon régime lève de bons impôts (i.e.: équitables) dont s'acquitteront avec allégresse tous les citoyens. "C'est pourquoi le système fiscal de la constituante est caractérisé par l'absence à peu près totale de moyens de contrainte (24). Les constituants ont créé trois contributions directes: la "foncière" sur le revenu de la terre; la "mobilière" sur les revenus industriels et les rentes; la "patente" pour le commerce. La contribution foncière, impôt de répartition, fut votée le 17 mars 1791 pour être perçue la même année. Pas de cadastre, des responsables départementaux sans formation, le résultat ne fut pas à la hauteur des besoins, alors que tout paraissait réglé depuis qu'une Trésorerie Nationale complétait le dispositif. Bilan de 1791, 100 millions de déficit. Augmenter les impôts? La pression fiscale épousait la norme pré-révolutionnaire. L'innovation financière s'imposait. Assignats... vous voilà...
Le personnel des finances
De l'Ancien Régime à l'Empire, le même personnel gère les finances (25). L'assemblée constituante avait innové sur trois points: réduire au maximum les fonctionnaires des finances et confier aux contribuables la collecte des impôts; cependant, il fallait du personnel pour centraliser les sommes, payer les dépenses, répartir les fonds. Trois catégories de fonctionnaires en naquirent: receveurs (par districts), payeurs généraux (un par département), commissaires du Trésor. Au nombre de six (recette, liste civile, dette publique, guerre, marine, comptabilité), ils examinaient les demandes des ministères et rendaient compte à un bureau de comptabilité composé de quinze membres nommés par le roi. Cette belle architecture va fonctionner selon une double logique: montée en puissance du pouvoir administratif d'un côté, affairisme de l'autre. L'instabilité ministérielle et l'obsession des réformes facilitent l'exercice du pouvoir par les hommes des bureaux. Citons pour l'exemple la situation de la trésorerie. Dans ces cadres, elle ressemble comme une sœur à l'ancien trésor royal. La diversité des attributions et la partition en six secteurs justifiaient une coordination minimale assurée par un secrétaire. Ce poste essentiel conserva le même titulaire de fin 1792 à... 1822. Les intitulés du poste changèrent, les régimes passèrent, le sieur Lefèvre demeura, trente années durant, inamovible.
La dimension affairiste décourage les tentatives de compréhension globale. Pour M. Bruguière, l'extrême complication de ces opérations variées rend illusoire un tel projet. Pourtant, "les activités financières conduites sous la convention avant et après le 9 thermidor représentent une expérience fort exceptionnelle de contrôle universel par l'Etat. Elles contiennent en outre la clé de nombreux destins individuels... C'est là, si l'on ose s'exprimer en termes peu élégants, que gît le "placard aux cadavres" de notre histoire contemporaine (26). La trésorerie, dès sa création en 1791, récupère une partie du personnel de l'Ancien Régime, puis une partie des commissaires nommés par Louis XVI resteront en place après sa disparition. En 1795, à la chute de Robespierre, quatre d'entre eux sont toujours en fonction. La Convention laissa carte blanche aux commissaires de la Trésorerie pour réaliser deux objectifs: approvisionner les armées; nourrir les populations civiles. La fonction remplie mettait à l'abri des vicissitudes politiques le personnel administratif. Le Directoire n'eut qu'un responsable financier: Ramel, qui, en conflit avec la trésorerie pour l'extinction des mandats territoriaux, sortit vainqueur à l'occasion du coup d'Etat du 4 septembre 1797 (18 fructidor). La Trésorerie nationale rentra alors dans le rang en obéissant mieux au responsable politique.
Par delà ce phénomène bureaucratique, la vraie Révolution, pour Sédillot (27), est dans le domaine financier: le passage de la primauté du sang à la primauté de l'argent. Aux nobles succèdent les notables et «les droits de la naissance ne pourront rien contre ceux de la finance» (28). Cette explosion du capitalisme se traduit par une promotion du banquier et du spéculateur. Les grands financiers de l'Ancien Régime n'étaient pas très populaires et certains payèrent même leur gloire passée de leur vie. Ils furent remplacés par de nouveaux spéculateurs, entretenant des liens étroits avec des nobles cupides et des responsables révolutionnaires. Pour Cobban, "les financiers constituaient le secteur de la société le moins engagé politiquement. Toutes les politiques et tous les gouvernements apportaient du grain à leur moulin" (29). Cela vaut certainement pour une classe de spéculateurs "modestes" car les circonstances sont propices à toutes sortes de trafics: "On monnaye l'élargissement d'un détenu, la délivrance de certificats de civisme, la mise aux enchères privilégiée des biens nationaux, le vote de certains décrets" (30). Mais l'appartenance à un réseau caractérise les plus grands corrupteurs et des corrompus: l'occultisme et la franc-maçonnerie émergent pour la première fois à côté d'autres réseaux plus traditionnels d'ordre géopolitique.
Robert Darnton a retracé l'ambiance intellectuelle de la fin du XVIIIième. Dans La fin des lumières (31), il expose le rôle du mesmérisme, frontière entre science et pseudo-science ou occultisme. Avant la Révolution, Marat se consacre à l'étude de la lumière, de la chaleur et rédige des traités complètement farfelus. La première apparition de Robespierre sur la scène nationale date de ses écrits sur la science et le paratonnerre en particulier. Mesmer recrute ses partisans chez les futurs chefs révolutionnaires: La Fayette, Brissot, Bergasse, Roland... Par l'intermédiaire de la "société de l'harmonie universelle", les esprits éclairés rencontrent les âmes sensibles et les hommes d'affaires. Bergasse est membre d'une riche famille de commerçants lyonnais. Kornmann vient des milieux bancaires strasbourgeois. Cette société, insiste Darnton, n'est pas une cellule révolutionnaire, mais un cercle pour gens riches et distingués où se côtoient bourgeoisie et aristocratie. Cet occultisme est compatible avec le thème du "pur amour", diffusé par le piétisme et les sociétés franc-maçonnes dont le développement fut très rapide à partir de 1773.
Le pouvoir financier, après le déclenchement de la Révolution, a été exercé pendant trente mois par des praticiens issus de l'administration précédente (ex.: Lambert). Les vingt-sept mois suivants sont dominés par les figures des banquiers protestants: Necker et Clavière. Pendant cinq ans et quatre mois, le groupe principal est lié au commerce, au bois, aux étoffes. C'est l'époque de Clavière, Ramel. Le Directoire remet en selle des spécialistes: Gaudin, Mollien, en vérifiant qu'ils entretiennent des accointances utiles (Mollien est lié à des agents de change). Durant onze années, un point commun transcende ces personnes: leur appartenance à la maçonnerie, seule association à s'étendre sur toute la France. Solidarités personnelles et géographiques renforcées par cette appartenance, voire carte de visite facilitant des contacts en Angleterre, en Belgique, on ne peut parler de complot "explicite". Mais nous suivrons l'appréciation de Bruguière qui conclut au triple rôle de ce mouvement: cadre commode et discret de filet protecteur ou d'échelle de corde. Le tout dans une atmosphère d'exaspération de l'occultisme qui déboucha, à la Révolution, sur "la transmutation du papier en or, ou de l'argent en domaines nationaux, bien plus sûrement que ne l'eût permis le Grand Œuvre" (32).
III. Décollage du
capitalisme en France
Au sortir de l'épopée napoléonienne se répand le sentiment de l'existence d'un retard français par rapport à l'Angleterre. F. Caron ouvre son histoire économique de la France (33) en rappelant que la traversée de la Manche était nécessaire pour s'initier aux techniques nouvelles, pour y embaucher des ouvriers. Le retard a donc un sens précis: l'écart technologique qui s'est creusé pendant la Révolution et l'Empire, "catastrophe nationale" d'après M. Lévy-Leboyer. Mais l'économie française a finalement progressé au XIXième siècle avant les Etats-Unis et l'Allemagne. Ne faut-il pas alors nuancer le qualificatif et en réévaluer d'autres aspects? D'abord parce que les démarrages sont inimitables; l'obsession du retard oublie que le comparatisme est un art délicat. Nous en montrerons les embûches. Ensuite, les transformations importantes ne sont pas souvent le résultat d'une action précise, mais résultent d'effets pervers. Nous relèverons ceux dont le rôle est incontestable.
Des démarrages inimitables
Le capitalisme n'est pas universel et n'émerge pas automatiquement par simple accumulation de capital. A. Caillé (34) insiste sur l'aplanissement nécessaire de trois disjonctions pour former le capitalisme indissociable du marché. La disjonction spatiale: le prix d'une denrée doit être identique sur les marchés villageois; disjonction temporelle: refus du crédit généralisé (avec le crédit apparait la dépendance des communautés par rapport à l'échange); disjonction entre grand commerce (réservé à l'Etat et aux groupes dominants) et commerce local. Le grand commerce (d'aventure, à longue distance) existe de tous temps un peu partout. Il procure des profits élevés, mais incertains. Par contraste, le capitalisme suppose un commerce de marchés, portant sur des biens courants reproductibles en grande quantité. Les prix se fixent alors sur ces marchés qui intéressent les classes moyennes, regroupement hétéroclite d'artisans, marchands, fonctionnaires, laboureurs à l'aise.
Dans l'histoire du développement, l'Angleterre a ouvert la voie par la réunion d'un ensemble de conditions non programmables a priori (35). Au début du XVIIième siècle, elle se tailla un empire dans le nouveau monde. La Révolution anglaise donna le pouvoir au parlement après 1688 et le Roi n'eut plus l'initiative fiscale. Les victoires contre les Hollandais lui ouvrirent le marché mondial. Enfin, les enclosures dégonflèrent peu à peu les actifs du secteur primaire qui, affluant dans les villes, engendrèrent des relations nouvelles entre producteurs ruraux et centres urbains. Tout cela n'était pas original et ne garantissait aucune supériorité définitive. Le basculement se produisit après 1780: l'innovation technique matérialisée par la machine à vapeur appliquée à l'industrie textile et à la métallurgie. L'accroissement de puissance fut tel que Manchester fabriqua des cotonnades à meilleur prix que les artisans de l'Inde (Madras, Calcutta). Les Français, comme les autres, ont été surpris par ce changement qui mettait le monde à la portée des Anglais, aptes à ruiner, à pastoraliser quelque pays que ce soit... Il fallait que ces marchés fussent libres d'accès, ce que la Révolution française, involontairement, a favorisé. Les auteurs français, frappés par l'industrilisation, négligent les éléments complémentaires. Pourtant, la technique est insuffisante à assurer un développement cumulatif. Il faut tout d'abord une structure de la population active, liée à l'organisation sociale et aux rendements agricoles, or il n'y a pas de "Révolution alimentaire" en France jusqu'en 1840, moment où les rendements des céréales s'accroissent sans retour (36). La Révolution de 1789 a provoqué une dégradation du niveau alimentaire, comme toutes crises de subsistance depuis des siècles. Rien d'original donc, si ce n'est, d'après Morineau, que les mauvaises récoltes ne donnent plus lieu à des envolées de prix aussi spectaculaires qu'au siècle précédent car l'approvisionnement s'est fluidifié. Deuxième ingrédient: les marchés extérieurs, dans plusieurs branches du commerce international.
La France avait su conquérir ou garder une excellente position. Domination des marchés d'Italie et du Levant; premier fournisseur de l'Espagne en articles manufacturés, extension du commerce d'entrepôt des denrées coloniales par Saint-Domingue (où la productivité des cultures de la canne et du café en autorisait la vente à vil prix). La France ne concurrençait pas réellement la Grande-Bretagne, car la part de l'industrie y était faible (2/5). L'essentiel portait sur le café, le sucre, le vin et, point faible que la Révolution balaiera, il dépendait étroitement de Saint-Domingue. Enfin, l'industrie; elle a montré beaucoup de vitalité au XVIIIième siècle, en particulier: la laine, les toiles, le coton, la soie. L'industrie minière a démarré (charbon) et, avec elle, la production de fonte.
Résumons encore, si cela est possible sans caricaturer. La Grande-Bretagne a moins de main-d'œuvre agricole, domine des marchés et a, la première, utilisé la technique pour produire des biens destinés à des classes moyennes. Elle n'est pas organisée selon le modèle royal français. La comparaison selon le seul critère industriel est insuffisante. L'appréciation doit porter sur une configuration de structures (sociales et économiques) dans un environnement où la guerre impose ses contraintes matérielles, ce que nous montrerons ci-dessous, après que les éléments peu liés au conflit eurent été envisagés.
Une main-d'œuvre surabondante qu'il faut orienter vers l'industrie et qui, vivant en ville, doit acquérir peu à peu de nouvelles normes de consommation. Ce premier passage obligé (dans le contexte socio-historique du XVIIIième siècle) dans la longue marche du développement s'était ouvert au milieu du siècle dans le grand mouvement en faveur de l'éducation. Le despotisme éclairé avait reçu l'assentiment de tous les penseurs français, à l'exception de Rousseau, pour mettre en œuvre une politique de réformes inspirées par la raison, en vue de bien commun. Il y eut donc des tentatives pour créer des établissements pilotes: école des Ponts et Chaussées (1744), école royale militaire (1751). De plus, certaines régions disposaient d'une population alphabétisée. Alors qu'en 1790, le taux moyen n'atteignait pas 50%, le Nord-Est de la France était alphabétisé à 68%. Enfin, il existait une tradition corporatiste qui formait des artisans dans les écoles techniques. La Révolution a accéléré l'introduction des sciences dans les études, œuvre couronnée par l'université napoléonienne. Mais l'idée d'instruction publique ou d'éducation nationale n'est pas "révolutionnaire" et la Révolution ne se dote pas des moyens nécessaires à la réalisation concrète de son slogan: l'instruction gratuite pour tous. Le développement économique de la France, fondé en partie sur une main-d'œuvre relativement qualifiée, ne sera pas affecté par la Révolution.
La montée des classes moyennes, deuxième verrou à débloquer pour permettre le capitalisme, est à l'évidence une conséquence du nouvel ordre des valeurs quoique la temporalité du processus soit très étalée. Tous les économistes s'accordent à reconnaître les nocivités d'une fiscalité trop lourde. La redistribution de la charge fiscale et les transferts de richesse engendrés par l'inflation des assignats ont modifié le jeu et favorisé ces classes moyennes. L'organisation d'Ancien Régime recelait aussi deux moyens efficaces pour étouffer l'esprit d'entreprise: la vente de charges, la hiérarchie de corps. Rappelons que "la monarchie absolue des XVIIième et XVIIIième siècles ne se différencie pas tellement de l'empire romain, dont l'essentiel des dépenses était militaire. L'Etat est incapable de mener une guerre longue sans s'endetter outre-mesure. Cette situatiion est celle de tous les pays européens (38). Ces difficultés financières incitent à vendre des charges pour éviter les remboursements ultérieurs massifs. Les "riches" les achètent et souscrivent aux emprunts d'Etat. Une fois la charge acquise, ils ne demandaient plus qu'à en jouir en toute tranquilité: les entreprises capitalistes étaient étouffées par cette pratique. Plus généralement, la montée en puissance de l'économie de marché a été possible en incitant les hommes de profit à investir ailleurs que dans les charges. Perception certes à nuancer car la mise en vente de multiples patrimoines (biens communaux, d'Eglises et de certains émigrés) a mobilisé des capitaux détournés ainsi de l'industrie; donc la Révolution, au lieu de régler le problème agraire, accéléra la tendance de l'histoire française à la conquête bourgeoise de la terre.
La disparition de la hiérarchie des corps eut d'autres conséquences plus fondamentales à moyen terme. La Révolution a affirmé que la souveraineté résidait dans les citoyens dont le travail sur la nature justifiait la propriété. Or, à cette époque, on désignait par le mot "industrie" la diligence ou l'assiduité (i.e.: le travail sur la nature). Avec la Révolution française, "le travail ou l'industrie n'était plus que cette vile activité reléguée exclusivement à ces groupes de la population jugés indignes de plus hautes fonctions; il représentait au contraire la substance même de l'existence humaine et se trouvait à l'origine de tout ordre social" (39). Une telle réévaluation de l'activité humaine signifiait que produire ou distribuer des richesses devenait un acte exemplaire pour la Nation. La nouvelle vertu attachée à la production couvrait aussi les formes d'organisation. Il n'était pas convenable, avant la Révolution, d'enfreindre à grande échelle les réglementations qui fixaient l'organisation du travail. Par exemple: la productivité de biens standardisés et de médiocre qualité, ou d'emploi d'ouvriers non qualifiés dans le métier, voire recourir à des sous-traitants, était interdit, ce qui en limitait la portée pratique. La fin des corporations et la redéfinition des droits de propriété ont autorisé ce qui avait été prohibé. Donc, au début du XIXième siècle, "l'organisation de la production artisanale fut autant la conséquence des changements de statuts juridique que connut l'industrie au cours de la révolution que d'un développement du marché" (40).
En définitive, aucun progrès spectaculaire n'a été accompli dans la formation de la main-d'œuvre ou dans l'émergence d'une classe moyenne. Inversément, rien n'a été entrepris qui put dissuader les nouveaux entrepreneurs. Les facteurs décisifs, industrie et commerce, ne prennent leur dimension que dans le contexte des conflits qui, vingt années durant, marquant l'histoire des pays européens.
Guerre et blocus
"Les guerres de la Révolution et de l'Empire (...) sont la plus longue période d'hostilités que l'Europe ait connue depuis le début du XVIIIième siècle; comme elles coïncidèrent avec une étape importante de son développement économique, alors que la Révolution industrielle venait de commencer en Angleterre et que ses premiers symptômes se manifestaient dans plusieurs régions du continent, leur facteurs principaux ont perturbé les économistes: le blocus maritime des Britanniques, l'autoblocus imposé au continent par Napoléon, le bouleversement de la carte politique de l'Europe.
Le traité de commerce franco-anglais de 1786, à vocation libre-échangiste, est rendu caduc fin 1792, par la prise d'Anvers. Une fois la guerre commencée, les navires marchands et le commerce maritime français ne sont plus protégés. La marine de guerre avait été inférieure à la Royal Navy au cours du siècle et la Révolution désorganise totalement l'institution. Des officiers émigrent et la discipline se relache. Comme après une première décision draconnienne, prescrivant de capturer les navires neutres en relations avec les colonies françaises, la Grande-Bretagne, sous l'influence américaine, se contente d'interdire le commerce des neutres en ligne directe France-Colonies, jusqu'en novembre 1807; le commerce colonial s'effondre en moins de quinze ans. On ne sait pas très bien ce que souhaitaient les révolutionnaires dans le domaine du commerce international. A. Cobban soutient que les factions proposaient des politiques différentes. La première vague, dite girondine (Brissot, Clavière) souhaitait une législation très ouverte, "libérale". La seconde vague, montagnarde, fit voter en octobre 1793, une loi sur la navigation. Le facteur décisif est donc la guerre qui produisit un effondrement irréversible et transforma durablement la géographie économique de la France. Les zones industrielles portuaires déclinèrent aussi et l'activité industrielle démarra sur le continent. Le type de produit qui enrichissait les ports atlantiques correspondait à la tradition du grand commerce, sans probabilité élevée de se transformer en commerce de biens de production ou de consommation pour un vaste marché. Ce déclin a été certainement bénéfique au développement de l'économie de marché en France.
L'effet sur l'industrie n'est pas dissociable de l'autoblocus imposé par l'Empereur. Les révolutionnaires étaient plutôt tournés vers la terre, apte à engendrer de bons citoyens, ou vers l'austérité du modèle spartiate, mais peu versés dans la technique ; et les hommes éclairés pratiquaient la physique amusante. La relève de l'élite traditionnelle par la nouvelle élite des promoteurs de la civilisation industrielle (que Saint-Simon appelle de ses vœux) sensibilise surtout Sieyès qui distingue nettement deux catégories de citoyens: les passifs, les actifs, car il assimile la nation à un groupement de producteurs. Mais les révolutionnaires, peu motivés, n'ont pas mis en place de politique spécifique. Les conséquences industrielles de la Révolution se ramènent à un effet de tenaille décrit dans un texte présenté et commenté par François Crouzet (42). La première pièce soude une forte rentabilité agricole (baisse du prix des terres) et une hausse des matières premières et des salaires à prix de vente bloqué. Ce "manche" joue le rôle d'une pompe à finances au détriment de l'industrie. La seconde pièce écrase les profits ou pousse les prix à la hausse réduisant la demande. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et H. Bonn affirme, par exemple, que l'esprit d'entreprise n'en fut qu'anesthésié car les fournitures aux armées donneront une impulsion à ceux qui avaient compris la nouvelle règle du jeu: être classé dans le groupe des travailleurs pour éviter les exactions. Si, en 1800, le niveau d'activité reste en deça de celui atteint en 1789, la poussée industrielle démarrera peu après avec l'auto-blocus du continent face aux Anglais, mesure protectionniste visant à remplacer les importations par des produits continentaux. Le résultat est probant dans le textile, principale filière industrialisante, où la filature mécanique connaît un essor spectaculaire. Ce dynamisme, suggère François Crouzet, s'apprécie par rapport aux deux données de base de l'Europe: la guerre et ses multiples contraintes (prix élevés des matières premières, taux d'intérêt élevés, pénurie de capital); la suprématie absolue de l'Angleterre qui pastoralisait les pays situés dans son orbite. Si l'Empire est une conséquence directe de la Révolution, l'industrialisation de la France en recevra une aide imprévue.
Les révolutions sont interminables. Quand s'arrête la Révolution française ? En 1791, comme le croyait Barnave? A la chute de Robespierre, selon les lamentations du léniniste moyen? Au Directoire, installation de la clique bourgeoise et des penseurs «troisième république»? Ne serait-ce pas plutôt Bonaparte qui y mit un terme, puisqu'il le dit? Ou la restauration au bourgeoisisme tonitruant? L'économie française en a finalement ressenti des effets tout au long du XIXième siècle, car la Révolution a rendu honorable le commerce et les affaires, a encouragé l'acquisition des richesses et enclenché, en liaison étroite avec les contraintes militaires, l'industrialisaton du continent.
Bernard NOTIN.
(1) Schéma d'Ernest Labrousse, résumé par Pierre Vilar, Or et monnaies dans l'histoire, Flammarion, champs, 1974, P.375.
(2) Georges Gusdorf, Les principes de la pensée au siècle des lumières, Payot, 1971, p.152.
(3) François Hincker, «Les révolutionnaires et l'économie», Les cahiers de Decta III, N° 4, 1989, pp. 43-61.
(4) Georges Gusdorf, op. cit. p. 266.
(5) Raymond de Roover, «Scolastic Economics: Survival and lasting influence from the sixteenth Century to Adam Smith», Quarterly Journal of Economics, mai 1955, 161-190.
(6) Gérard Cazenave-Gabriel, «Population, Mercantilisme et libre-échange: note sur un paradoxe apparent», Revue d'économie politique, N° 5, 1979, 606-622.
(7) Louis Dumont, Homo aequalis, Gallimard, 1977.
(8) Vincent Descombes, «Pour elle un Français doit mourir», Revue européenne des sciences sociales, XXII, 1984, N° 68, 67-94.
(9) Guy Haarscher, «Louis Dumont et la genèse de l'iudéologie moderne», Revue européenne des sciences sociales, XXI, 1984, N° 68, 127-148.
(10) Pierre Rosanvallon, «Boisguillebert et la genèse de l'Etat moderne», Esprit, janvier 1982, 32-52.
(11) Cité par Pierre Rosanvallon, op. cit., p.51, note 40.
(12) Cité par Pierre Vilar, Or et monnaies dans l'histoire, p. 375.
(13) Florin Aftalion, L'économie de la Révolution française, Hachette pluriel, 1987.
(14) William H. Sewell, Gens de métier et Révolutions, Aubier, 1983, p. 151.
(15) Cité par Ernest Labrousse, «Garantisme de la Révolution française et garantisme de Sismondi», dans Croissance, échange et monnaie en économie internationale. Mélanges en l'honneur de Jean Weiller, Economica, 1985, pp. 69-80.
(16) Cité par Daniel Bell, Les contradictions culturelles du capitalisme, Presses Universitaires de Rrance, 1979, p. 237.
(17) Norbert Elias, La dynamique de l'Occident, Calmann-Lévy, 1975 p. 160.
(18) Alain Guéry, «Les finances de la monarchie française sous l'ancien régime», in Les Annales, 1977, pp. 216-239.
(19) Alain Guéry, op.cit, 231.
(20) René Sédillot, Le coût de la Révolution française, Perrin, 1987.
(21) Alfred Cobban, Le sens de la Révolution française, Julliard, 1984.
(22) Robert Schnerb, «Les vicissitudes de l'impôt direct de la constituante à Napoléon», dans Jean Bouvier, Jacques Wolff (éd.), Deux siècles de fiscalité française, 19e-20e, histoire, économie, politique, Mouton, 1973, PP. 57-70.
(23) Robert Schnerb, op.cit, 63.
(24) Jacques Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, Presses Universitaires de France, 1985, p.163.
(25) Michel Bruguière, Gestionnaires et profiteurs de la Révolution, Olivier Orban, 1986.
(26) Michel Bruguière, op.cit, 74.
(27) René Sédillot, op.cit, 242.
(28) René Sédillot, op.cit, 243.
(29) Alfred Cobban, op.cit, 93.
(30) René Sédillot, op.cit, pp. 248-249.
(31) Robert Darnton, La fin des lumières: le mesmérisme et la Révolution, Perrin, 1984.
(32) Michel Bruguière, op.cit, 170.
(33) François Caron, Histoire économique de la France: XIXe-XXe siècles, Armand Colin, 1981.
(34) Alain Caillé, Splendeurs et misères des sciences sociales, Droz, 1986, chapitre 4, 2eme partie, pp. 172-200.
(35) Michel Morineau, «Des origines de l'inégalité de développement», dans Pour une histoire économique vraie, Presses Universitaires de Lille, 1985, pp.391-411.
(36) Michel Morineau, «Révolution agricole, révolution alimentaire, révolution démographique», dans Pour une histoire économique vraie, Presses Universitaires de Lille, 1985, pp.241-276.
(37) François Crouzet, De la supériorité de l'Angleterre sur la France, Perrin, 1985 chapitre 2, pp. 22-49.
(38) Jean Meyer, Le poids de l'Etat, Presses Universitaires de France, 1983, p.50.
(39) William H. Sewell, op.cit, 201.
(40) William H Sewell, op.cit, 219.
(41) François Crouzet, op. cit, 280.
(42) François Crouzet, op. cit, chapitre 10, «Les conséquences économiques de la Révolution française, vues de Londres».
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, économie, révolution française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 20 septembre 2009
"La conquista del Estado - El primer semanarion nacional-sindicalista espanol (1931)
"La conquista del Estado. El primer semanario nacional-sindicalista español (1931)»
Gabriela Viadero Carral

«La Conquista del Estado. El primer semanario nacional-sindicalista español (1931)»
Gabriela Viadero Carral
Orientaciones
«No estamos ante un libro cualquiera. Lo que el lector va a encontrar en esta obra es algo poco corriente: un estudio serio sobre una revista histórica y política, La Conquista del Estado. Si la historia es una de las disciplinas que se han abordado con mayor subjetividad, la historia política ha sido objeto de las más infames tergiversaciones. La figura de Ramiro Ledesma Ramos -como la de otros tantos ideólogos- ha sufrido todo tipo de interpretaciones, desde la muerte bibliográfica del silencio académico hasta las biografías apasionadas de sus detractores y sus supuestos partidarios.
El estudio que usted tiene en sus manos es de un gran valor cultural por dos motivos fundamentales. Primero, porque no es una obra literaria de un amante o detractor de La Conquista del Estado, donde se verían reflejadas más las filias y fobias del autor que el objeto estudiado, sino un trabajo universitario serio y responsable que ha pasado con solvencia los filtros de la corrección y calificación académica. Es decir, su calidad está avalada por expertos en la materia.
Segundo porque la autora, Gabriela Viadero Carral, no tenía ninguna opinión formada sobre Ramiro Ledesma Ramos o La Conquista del Estado antes de comenzar su investigación. Su aproximación, por lo tanto, ha estado libre de apasionamiento, lo que ha contribuido a la objetividad del trabajo. Esta mirada limpia y pura le ha permitido plasmar con magnificiencia y certera intuición la realidad del filósofo español y del “semanario de lucha y de información política” que él mismo impulsó.
Esto no quiere decir que la investigadora, desde el punto de vista humano, no fuese sintiendo un especial y sincero afecto por la figura de Ramiro Ledesma Ramos conforme desarrollaba su trabajo: viendo como aquel joven filósofo (discípulo de Ortega y Gasset y estudioso de Martin Heidegger, colaborador de La Gaceta Literaria y la Revista de Occidente) dejaba una prometedora y cómoda carrera intelectual para dedicarse de pleno a la lucha política radical en plena transición republicana, prescindiendo hasta de comer para poder pagar la impresión y distribución de su revista. Sin olvidar su triste pero heroica muerte. Una empatía sana y natural, nacida del estudio directo, que no ha restado ni un ápice la credibilidad de este trabajo.
¿Por qué era necesario un trabajo de investigación sobre esta publicación?
Pese a su temprana muerte -asesinado con poco más de treinta años-, Ramiro Ledesma Ramos encarnó los valores éticos, filosóficos y políticos de una generación europea que buscaba una alternativa a un mundo que se precipitaba al abismo entre el liberalismo y el marxismo. Esa alternativa, que conjugaba lo social y lo nacional, tuvo diversas manifestaciones a lo largo y ancho de Europa. La Conquista del Estado es, sobre el papel, la expresión española de esa corriente de vanguardia que, lamentablemente, ha sido poco y mal estudiada.
Además, como ya he comentado, su figura ha sido manipulada de tal modo que, en ocasiones, resulta irreconocible. Sus detractores le han presentado -cuando no silenciado- como un joven acartonado, fanático entusiasta del nacionalsocialismo y del fascismo -siempre de forma peyorativa- y sin ninguna originalidad o dimensión ideológica más allá de los prejuicios y clichés de los “bienpensantes”. Otros, supuestos seguidores, le han utilizado interesadamente para renovar su imagen y hacerla más atractiva, sin asumir los valores y postulados que él defendía. Estos ultraderechistas han construido un Ramiro Ledesma Ramos ficticio, valedor de causas que él combatió. Son estos últimos los que más daño han hecho a su recuerdo.
Así mismo, esta obra se hace imprescindible para comprender mejor aún una época, la de la II República, sobre la que mucho se habla y más se miente. Si bien es cierto que La Conquista del Estado -y las posteriores JONS- no tuvieron demasiada importancia en aquel momento, sí supusieron una vía política distinta. Vía que, en otros países, tuvo mucha fuerza y esperanzó a pueblos enteros. Tal vez la prematura muerte de la II República no permitió percibir el potencial de esta nueva alternativa, que podría haberse proyectado de otra forma si hubiese tenido más tiempo para difundirse.
En conclusión, era necesario, y por fin se ha hecho realidad, un trabajo que estudiara con claridad y transparencia no sólo los posicionamientos ideológicos de una época histórica concreta, sino una forma de ver y sentir la política que hoy en día sigue inspirando. Libre de prejuicios, heterodoxa, valiente y arriesgada… Así fue La Conquista del Estado, así fue Ramiro Ledesma Ramos.»
[Prólogo de Diego Urioste]
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : espagne, histoire, national-syndicalisme, syndicalisme, années 30, théorie politique, pensée politique, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 septembre 2009
Les espions de l'or noir
Les espions de l’or noir

Le pétrole, « maître du monde » ? Oui, mais comment en est-on arrivé là ? Des rivalités pour contrôler la route des Indes à l’émergence des Etats-Unis comme puissance mondiale, les pays anglo-saxons ont su étendre leur influence en Asie centrale, dans le Caucase et au Proche-Orient, avec, au final, leur mainmise sur les principales ressources pétrolières mondiales.
Gilles Munier remonte aux origines du Grand jeu et de la fièvre du pétrole pour raconter la saga des espions de l’or noir et la malédiction qui s’est abattue sur les peuples détenteurs de ces richesses. Il brosse les portraits des agents secrets de Napoléon 1er et de l’Intelligence Service, du Kaiser Guillaume II et d’Adolphe Hitler, des irréguliers du groupe Stern et du Shay – ancêtres du Mossad – ou de la CIA, dont les activités ont précédé ou accompagné les grands bains de sang du 19ème et du début du 20ème siècle.
Parmi d’autres, on croise les incontournables T.E Lawrence dit d’Arabie, Gertrude Bell, St John Philby et Kermit Roosevelt, mais aussi des personnages moins connus comme Sidney Reilly, William Shakespear, Wilhelm Wassmuss, Marguerite d’Andurain, John Eppler, Conrad Kilian. Puis, descendant dans le temps, Lady Stanhope, le Chevalier de Lascaris, William Palgrave, Arthur Conolly et David Urquhart.
« On dit que l’argent n’a pas d’odeur, le pétrole est là pour le démentir » a écrit Pierre Mac Orlan. « Au Proche-Orient et dans le Caucase », ajoute Gilles Munier, « il a une odeur de sang ». Lui qui a observé, sur le terrain, plusieurs conflits au Proche-Orient, montre que ces drames n’ont pas grand chose à voir avec l’instauration de la démocratie et le respect des droits de l’homme. Ils sont, comme la guerre d’Afghanistan et celles qui se profilent en Iran ou au Darfour, l’épilogue d’opérations clandestines organisées pour contrôler les puits et les routes du pétrole.
Contact : gilmunier@gmail.com [1]
* Editions Koutoubia – Groupe Alphée-Editplus, 11 rue Jean de Beauvais – 75005 PARIS
Source : http://espions-or.noir.over-blog.com/ [2]
Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info
URL to article: http://qc.novopress.info/6150/les-espions-de-l%e2%80%99or-noir/
URLs in this post:
[1] gilmunier@gmail.com: http://qc.novopress.infogilmunier@gmail.com
[2] http://espions-or.noir.over-blog.com/: http://espions-or.noir.over-blog.com/
00:10 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pétrole, hydrocarbures, histoire, espionnage, moyen orient, impérialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 13 septembre 2009
Gerbert l'Européen

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996
Gerbert l'Européen
En 1996, un colloque consacré à Gerbert, le pape de l'an Mil, Sylvestre II, a eu lieu à Aurillac. Les actes de ce colloque viennent d'être publiés sous le titre de Gerbert l'Européen. Pierre Riché écrit en introduction à propos de Gerbert, alors archevêque de Reims: «Il attire de nombreux élèves venus de toutes les régions de l'Europe. Son école rayonne même en Lotharingie, en Italie, en Germanie. Un écolâtre de Magdebourg étonné par ce succès, envoya un de ses étudiants saxons pour prendre des notes au cours de Gerbert à Reims. Malheureusement, il n'était pas compétent et fit à son maître un rapport inexact. Gerbert devait prouver sa supériorité à Ravenne en 981. Pour son élève Otton III, il écrivit un traité de logique. Ses connaissances sur l'astrolabe à partir de 983 sont l'objet de discussions mais sa lettre à Lobet de Barcelone, traducteur d'un traité arabe, prouve qu'il s'intéresse à la question. La construction de son abaque fait penser qu'il connaît l'existence des chiffres arabes. Sa science musicale est indéniable . Après sa mort, les disciples de Gerbert ont vanté ses mérites et de nombreux manuscrits contenant ses œuvres authentiques ou non ont été diffusés. Gerbert a si bien redonné vigueur à l'enseignement de la dialectique et des sciences qu'il inquiète les clercs de son époque. En cela, il rappelle Boèce qui était son modèle, et dont il connaît les œuvres. Comme lui, Gerbert est un homme de science, son Dieu n'est pas tellement celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais le Dieu des philosophes et des savants. Comme Boèce, il croit que Dieu est le Bien suprême, celui qui régit le monde, qui organise l'harmonie des sphères et détient les Idées; comme Boèce, la philosophie est sa consolation: “La philosophie est le seul remède que j'ai trouvé... J'ai préféré les loisirs de l'étude qui ne trompent jamais aux incertitudes et aux hasards de la guerre”. C'est à ses amis d'Aurillac qu'il écrit cette lettre à une époque de difficultés, car Gerbert l'Européen qui connaît la Catalogne, Rome, Reims, Ravenne, la Saxe, les pays slaves, est resté fidèle à son monastère d'Aurillac et trouve auprès de ses anciens maîtres un réconfort. C'est en pensant à ses maîtres d'Aurillac qu'il a écrit: “La gloire du maître, c'est la victoire du disciple”». Les actes regroupent vingt-trois interventions d'universitaires et chercheurs français et étrangers (JdB).
Gerbert l'Européen, Comité d'expansion économique du Cantal, Hôtel du Département , F-15.000 Aurillac. 364 pages. 195 FF.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, papes, catholicisme, christianisme, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 12 septembre 2009
La contribution à Il Regime Fascista de Friedrich Everling

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Robert Steuckers:
La contribution à Il Regime Fascista de Friedrich Everling
Ecrivain et théoricien monarchiste, Friedrich Everling, né en 1891 à Sankt-Goar et décédé en 1958 à Menton, est le fils du théologien protestant et homme politique Otto Everling. Juriste de formation, il embrasse d'abord la carrière diplomatique; mais fidèle à ses convictions monarchistes, il refuse de prêter serment à la République de Weimar et devient avocat. De 1924 à 1933, il est député deutschnationaler au Reichstag et y défend les thèses légitimistes les plus tranchées. A la même époque, il édite la revue Konservative Monatsschrift.
En 1933, sa carrière de député prend fin et il est nommé Conseiller supérieur au tribunal administratif de Berlin. Son œuvre comprend une définition de l'idéologie conservatrice, une prise de position dans la querelle des drapeaux (or-rouge-noir ou noir-blanc-rouge?), une défense du principe monarchique, des études sur les états (Stände) dans l'Etat post-républicain, la structuration organique du «Troisième Reich» (non entendu, au départ, dans le sens national-socialiste, bien qu'Everling fera son aggiornamento) qui prendra le relais du Second Reich défunt, etc.
La signature de Friedrich Everling apparaît le 18 avril 1934 dans Il regime fascista. Son article, intitulé «I Capi» (= Les Chefs), part d'une réflexion de Heinrich von Treitschke sur les personnalités fortes qui font l'histoire: «Ce sont les personnalités et les hommes qui font l'histoire, des hommes comme Luther, comme Frédéric le Grand et Bismarck. Cette grande vérité héroïque restera toujours vraie. Comment se fait-il que de tels hommes apparaissent, chacun dans la forme adaptée à son temps, voilà qui, pour nous mortels, demeurera toujours une énigme». Rappelant que cette phrase avait été écrite de la propre main de Mussolini sur un portrait du Duce offert à l'un de ses amis, Everling cherche à démontrer que ce ne sont pas les masses qui font l'histoire et forment les Etats, mais que l'idéal du Chef domine l'histoire. Se référant ensuite à Gustave Le Bon, auteur de La psychologie des foules, Everling rappelle que ces hommes qui font l'histoire sont des hommes de forte foi et de «long vouloir». Les Chefs ont pour moyens d'action l'affirmation, la répétition (l'unique mode rhétorique sérieux d'après Napoléon) et la volonté ou la capacité de transmettre quelque chose, une suggestion par exemple. A la base du pouvoir exercé par les Chefs, poursuit Everling dans son article d'Il Regime fascista, toujours en se référant à Le Bon, se trouve le prestige, mode de domination naturel qui paralyse les facultés critiques d'autrui, stupéfie, suscite le respect. Everling prouve ensuite qu'il est lecteur d'Evola, en citant cette phrase d'Imperialismo pagano, qui définit le Chef: «[Il est d'] une nature qui s'impose non par la violence, non par l'avidité ou par l'habilité à conduire des esclaves, mais en vertu du caractère irrésistible des formes qui transcendent la vie». Evoquant les études de Max Weber sur les figures charismatiques de la politique, Everling rejoint la critique du grand sociologue allemand qui parlait des «chefs par profession mais sans vocation»; Everling, lui, dit préférer parler des «chefs à salaire». En conclusion à cet article consacré à la nature et aux vertus du Chef, Everling écrit: «L'idéal du Chef ne peut être véritablement compris que par ceux qui, dans une certaine mesure, le portent déjà en eux. Reconnaître un tel idéal, pour un peuple, signifie un progrès pour le peuple entier. A la suite des nations qui marchent déjà dans ce sens —l'Allemagne et l'Italie— les autres embrayeront le pas».
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditon, traditionalisme, révolution conservatrice, allemagne, italie, années 30, philosophie, histoire, sciences politiques, politologie, théories politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 septembre 2009
Ecole des Cadres: revues à lire
SYNERGIES EUROPEENNES - Ecole des Cadres
Bruxelles/Liège/Namur - Septembre 2009
Revues d’histoire, de géopolitique et de stratégie à lire impérativement pour étoffer nos séminaires et conférences pour l’année académique 2009-2010. Toutes ces revues se trouvent en kiosque.

“Champs de bataille”
n°29 (septembre-octobre 2009)
Au sommaire:
Gautier LAMY
Histoire géostratégique de la Crimée
Pierre-Edouard COTE
La guerre d’Orient: la campagne de Crimée 1854-1856
Jean-Philippe LIARDET
Sébastopol et la Crimée pendant la Seconde Guerre Mondiale
Raphaël SCHNEIDER
La guerre italo-turque de 1911-1912: la conquête de la Libye
Etc.
“Ligne de Front”
n°19 (septembre-octobre 2009)
Au sommaire:
1939: la campagne de Pologne – Les débuts de la Blitzkrieg
DOSSIER PETROLE
Yann MAHE
Pétrole 1939-1945: le nerf de la guerre
Roumanie: la chasse gardée du III° Reich
1941: le Golfe s’embrase ! La rébellion irakienne
1941: l’Iran passe sous la coupe des Alliés
1941-1942: la campagne des Indes néerlandaises – Le pétrole, l’un des enjeux de la guerre du Pacifique
1942: Objectif Bakou – Coups de main dans le Caucase
1944: Red Ball Express Highway – Artère du ravitaillement allié
etc.
“Diplomatie”
n°40 (septembre-octobre 2009)
Géopolitique de l’Océan Indien
Alain GASCON
Les damnés de la mer: les pirates somaliens en Mer Rouge et dans l’Océan Indien
Houmi AHAMED-MIKIDACHE
Comores: microcosme de l’Afrique
André ORAISON
A propos du différend franco-comorien sur Mayotte au lendemain de la consultation populaire du 29 mars 2009 relative à la départementalisation de l’ “île hippocampe”
Hors dossier:
Entretien avec Richard STALLMAN: Logiciels libres: vers la fin de la colonisation numérique?
Ketevan GIORGOBIANI
Russie-Géorgie: un an après la guerre
Benoit de TREGLODE
Viêt Nam-Chine: nouvelle crise ou tournant géopolitique?
Etc.
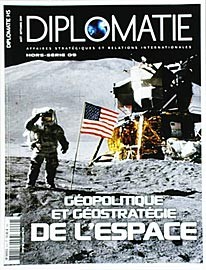
“Diplomatie”
Hors-Série n°9 – août-septembre 2009
Géopolitique et géostratégie de l’espace
Xavier PASCO
Les transformations du milieu spatial
Jacques VILLAIN
Une brève histoire de la conquête spatiale
Alexis BAUTZMANN
Les grandes divisions de l’espace
Jacques VILLAIN
La conquête de la Lune (1968-1969): le dénouement
Alain DUPAS
La “Guerre des étoiles”: un tournant décisif de la guerre froide
Entretien avec Mazlan OTHMAN
Les Nations Unies et l’espace
Entretien avec François-Xavier DENIAU
La France et l’espace
Entretien avec Alexandre ORLOV
Les enjeux de l’espace, vus de Russie
Philippe ACHILLEAS
Le statut juridique de la Lune
Sophie CLAIRET
A la conquête de Mars: qui a les moyens de ses ambitions?
Entretien avec Jacques VILLAIN
Espaces civil et militaire – Le jeu des puissances
Géraldine NAJA-CORBIN
Vers une politique spatiale européenne ambitieuse pour répondre aux défis du XXI° siècle
Entretien avec Thierry MICHAL
GRAVES: le Grand Réseau Adapté à la Veille Spatiale
Etc.

“Moyen-Orient”
n°1 (août-septembre 2009)
Entretien avec Olivier ROY sur le Moyen-Orient
Bernard HOURCADE
L’Iran face au défi de l’ouverture internationale
Entretien avec Fariba ABDELKAH
L’Iran aux urnes: quels enjeux?
Barthélémy COURMONT
La nouvelle politique iranienne de Washington: révolution ou simple changement de ton?
François NICOULLAUD
Iran nucléaire: le jeu des erreurs ou comment s’en sortir?
Mohammed EL OIFI
La couverture médiatique de la guerre de Gaza
Daniel MÖCKLI
Le conflit israélo-palestinien après la guerre de Gaza
Luis MARTINEZ
La rente pétrolière en Algérie: de Boumédiène à Bouteflika
Entretien avec Anouar HASSOUN
La finance islamique, une croissance mondiale?
Frédéric COSTE
Londres, centre européen de la finance islamique
Olivier PASTRE
La France et la finance islamique
Nadia HAMOUR
La mise en place de mandats au Moyen-Orient: une “malheureuse innovation de la paix”?
Etc.
15:07 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revues, géopolitique, géostratégie, histoire, guerre, polémologie, iran, pétrole, hydrocarbures, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, crimée, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Jean-Paul Roux nous a quittés

Jean-Paul Roux nous a quittés Compagnon de route de Clio depuis de nombreuses années, Jean-Paul Roux est décédé le 29 juin dernier, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Conférencier hors pair, cet historien du monde musulman, plus particulièrement spécialisé dans l'étude du domaine turc, faisait partie de ces rares érudits capables de se métamorphoser en vulgarisateurs de talent et le succès obtenu par ses livres a régulièrement confirmé l'écho rencontré par ses travaux dans le grand public cultivé. Né en 1925, il s'est formé à l'Ecole des Langues orientales et à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, avant d'exercer très jeune les fonctions de directeur de recherches au CNRS, qu'il a rejoint en 1952. Le cinquième centenaire de la prise de Constantinople par Mehmed II lui fournit, l'année suivante, l'occasion, à travers la publication d'une Histoire de la Turquie (Payot) de rencontrer des lecteurs qui lui demeureront toujours fidèles. Il mène dès lors de front, pendant plus d'un demi-siècle, travaux d'érudition et rédaction d'ouvrages plus généralistes dont une Histoire des Turcs, une Histoire de l'Iran et des Iraniens et une Histoire de l'Asie centrale (Fayard). Traversant les siècles, il reconstitue ainsi les différentes strates de l'Histoire centre-asiatique et proche-orientale, tout en valorisant – en un temps où ce n'était guère à la mode – le rôle joué par certains personnages d'exception tels que Gengis Khan, Tamerlan, Bâbur ou Shah Abbas. Il a ainsi contribué à populariser en France l'Histoire de pays ou de peuples le plus souvent méconnus, généralement abordés dans une perspective eurocentriste trop réductrice, qui n'était guère propice à une véritable intelligence des forces profondes qui commandent l'évolution des mondes turc ou iranien. Professeur, un quart de siècle durant, à l'Ecole du Louvre où il enseigne les arts de l'Islam, il est l'un des initiateurs de l'établissement du département spécialisé créé au sein du Musée dont les nouveaux espaces seront ouverts au public en 2011. Le Dictionnaire des arts de l'Islam publié en 2007 par les éditions Fayard constitue l'aboutissement de nombreuses années de recherches. Historien des religions du domaine turco-mongol, il a publié deux ans avant sa mort Un choc de religions. La longue guerre de l'Islam et de la Chrétienté, un ouvrage qui fournit une riche matière à réflexion, dans le contexte plus général du débat ouvert par Samuel Huntington à propos du « choc des civilisations ». Très proche de Clio, il a, au fil des années, rédigé pour la bibliothèque en ligne de très nombreux articles auxquels les internautes curieux d'Histoire et de civilisation musulmanes ont un accès immédiat. |
00:16 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turcologie, asie centrale, peuples turcs, peuples mongols, histoire, asie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La contribution à Il Regime Fascista de Wilhelm Stapel
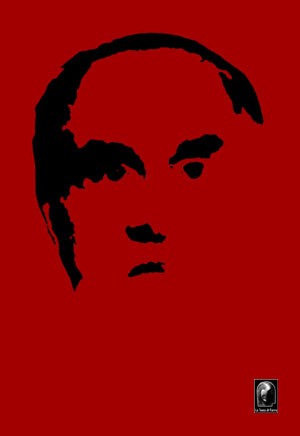
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Robert Steuckers:
La contribution à Il Regime Fascista de Wilhelm Stapel
Wilhelm Stapel (1882-1954) est l'une des figures-clé de la Révolution Conservatrice allemande. Fils d'un horloger, assistant de librairie, Stapel termine en 1910/11 des études d'histoire de l'art. En 1911, il collabore au journal libéral de gauche Der Beobachter (Stuttgart). En 1911, il adhère au Dürerbund (Association Dürer). De 1912 à 1916, il est rédacteur à la revue Kunstwart. En 1919, il fonde la revue Deutsches Volkstum qu'il dirigera jusqu'en 1938. Pour Armin Mohler (in Die konservative Revolution in Deutschland 1918-1932, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 3ième éd., 1989, pp. 410-411), Stapel est «un mélange curieux de systématiste et de polémiste; sa plume était l'une des plus craintes de la droite». Ses rapports avec les autorités du IIIième Reich ont été tendus. En 1938, il est mis au ban de l'univers journalistique; sa revue Deutsches Volkstum cesse de paraître. L'objectif de Stapel était de donner une ancrage théologique au conservatisme allemand. En témoigne son ouvrage principal: Der christliche Staatsmann. Eine Theologie des Nationalismus (Hanseatische Verlagsanstalt, Hambourg, 1932). Après la disparition de Deutsches Volkstum, Stapel, contraint et forcé, a dû adopter un profil bas et faire toutes les concessions d'usage à la langue de bois nationale-socialiste. Malgré cela, son ouvrage principal, après 1938, Die drei Stände. Versuch einer Morphologie des deutschen Volkes (Hanseatische Verlagsanstalt, Hambourg, 1941), fait montre d'une originalité profonde. Comme l'indique le titre, Stapel tente de dresser une typologie du peuple allemand, distinguant trois strates majeures: les paysans, les bourgeois et les ouvriers.
La contribution de Wilhelm Stapel à Il Regime fascista, intitulée «Nazione, Spirito, Impero» (16 mars 1934), est composée, presque dans sa totalité, d'extraits de Der christliche Staatsmann. Ce qui laisse à penser que c'est Evola lui-même qui a choisi, peut-être sans autorisation, des extraits du livre et les a juxtaposés dans un ordre cohérent.
Ce qui intéressait Evola dans la théologie conservatrice de Stapel (baptisée «théologie du nationalisme» pour cadrer avec les circonstances), c'était sa condamnation du nationalisme bourgeois, de facture jacobine, étayé de références naturalistes. Ce qui ne signifie pas que Stapel rejette toutes les doctrines qui se donnent l'étiquette de «nationaliste». Dans son article d'Il regime fascista, Stapel admet l'existence des nationalités (nous dirions aujourd'hui des «ethnies»), dans la ligne de Herder et du jeune Goethe. Il admet également la distinction, opérée par Fichte, entre «peuples originaires» (les Germains et les Slaves), non mélangés, et «peuples mélangés», dont l'existentialité est un produit récent, impur, mal stabilisé (les peuples latins). Pour Stapel, Fichte, en soulignant ce caractère «originaire», respecte la création de Dieu, qui a créé les uns et les autres de façon telle et non autre, et introduit un motif conservateur, c'est-à-dire métaphysique, dans le nationalisme, le rendant de la sorte acceptable. En clair, cela signifie que les nationalismes slaves et germaniques, à base ethnique, sont acceptables, tandis que les autres, qui sont l'œuvre des hommes et non de Dieu, sont inacceptables. Le nationalisme allemand, tel qu'il procède de Fichte, «demeure étranger à la sécularisation vulgaire advenue dans le sillage du naturalisme et du rationalisme; ainsi, au lieu d'être la phase crépusculaire d'un cycle de pensée, ce nationalisme peut apparaître comme le principe d'une pensée nouvelle» («Nazione, Spirito, Impero», art. cit.).
L'homme étant incapable de connaître tous les paramètres de l'univers, il doit s'orienter dans le monde par l'intermédiaire de «formes figurées». Le monde de l'inconnu, de l'incommensurable, est voisin du nôtre; le Chrétien, écrit Stapel, le désigne du terme de «Règne de Dieu»; ce règne est un ordre qui domine le monde: Dieu en est le Seigneur. Etre chrétien, dans cette théologie de Stapel, procède d'une «prise de position métaphysique», comme d'ailleurs toute acceptation ou toute récusation. Opter pour Dieu, c'est évidemment accomplir un acte métaphysique, qui revient à dire: «je veux appartenir à ce Règne». «Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que l'homme se subordonne au Seigneur des Troupes célestes. Il entre comme un combattant dans une armée métaphysique (...) [Dans ce choix], l'élément "humain" ne varie pas mais dans la substance, s'opère une mutation. Celui qui a juré par le Dieu des Chrétiens, doit Lui être obéissant. Il doit faire peu de cas de sa propre vie humaine et de sa propre personnalité. Il doit obéir à Dieu et diriger, risquer, sa vie pour son honneur. Et cela ne signifie pas fidélité dans la joie d'accèder à la "sainteté", qui peut déjà être momentanément goûtée, mais signifie plutôt obéissance et solidarité guerrière. Tout ce que Dieu, en tant que Seigneur, ordonne, il faut le faire. Cela transcende toute philosophie, toute convulsion sentimentale impure du «converti», toute préoccupation d'évolutionnisme moralisant. Le savoir phraseur, le zèle moraliste, le sentimentalisme imbu de soi, tout cela est duperie à l'égard de soi-même. Décide-toi et laisse le reste à Dieu» («Nazione, Spirito, Impero», art. cit.).
Cette théorisation radicale de l'engagement métaphysique pour le Règne de Dieu a séduit Evola, comme l'ont fasciné, sur le plan pratique, les mouvements du Roumain Codreanu, la Légion de l'Archange Michel et la Garde de Fer. La notion de «Milice de Dieu», également présente dans la Chevalerie médiévale et dans l'idée de Djihad en Islam, sont des éléments actifs et significatifs de la «Tradition Primordiale», selon Evola. Cette adhésion, cette milice, va toutefois au-delà des formes. De tradition luthérienne et prussienne, Stapel rejette le culte catholique des institutions et du formalisme; pour lui, la décision du sujet de devenir «milicien de Dieu», de Le servir dans l'obéissance, vient toute entière de l'intériorité; elle n'est en aucun cas une injonction dictée par un Etat ou un parti. Il est intéressant de noter que cette théologie de l'engagement total, qui séduit le traditionaliste Evola, vient en droite ligne d'une interprétation des écrits de Luther. Donc du protestantisme dans sa forme la plus pure et non d'un protestantisme de mouture anglo-saxonne, où l'éthique du service et de l'Etat est absente. Ceux qui, dans les pays latins, croient trouver en Evola une sorte de religiosité qui remplacerait leur catholicisme, ou qui ajoutent à leur catholicisme, caricatural ou ébranlé, des oripeaux évoliens, ne comprennent pas toute la pensée de leur maître: le protestantisme luthérien a sa place chez Evola. Le culte des institutions formelles est explicitement rejeté chez Stapel: «Il n'existe ni Etats chrétiens ni partis chrétiens. Mais il existe des Chrétiens. [Les Chrétiens peuvent être citoyens ou membres de partis]. Ce qui les distingue des autres, n'est pas perceptible en tant que sagesse ou moralité ou douceur, etc., particulières mais réside dans l'imperceptible, dans la substance. Ils ont juré fidélité à leur Dieu. Ils sont sous les ordres du Seigneur des Troupes célestes. Pour cette raison, ils pensent et agissent dans un espace plus grand que les autres hommes. Pour eux, il n'existe pas seulement ce monde, mais un autre monde derrière celui-ci. Ils n'agissent pas seulement sur la terre mais toujours à la fois "dans le ciel et sur la terre". C'est pourquoi leurs décisions sont toujours déterminées autrement que les décisions des autres. Ils peuvent s'engager plus à fond, au-delà de tout ce qui est terrestre, également au-delà des moralités de ce monde, dans le sens où ils font ce que Dieu leur a donné mission de faire. Le Chrétien est mandaté par les faits de sa nature propre [Geschaffenheit, dans le texte original; littéralement, cela signifie sa «créaturité»; Evola, ou le traducteur d'Il Regime fascista, traduit parnatura propria] et de sa vocation. S'il a été créé Allemand, alors il devra mettre toutes ses énergies au service de sa germanité et de son Reich allemand. S'il a été créé Anglais, alors il devra mettre ses énergies au service de son peuple et de son Etat. Comme tout cela peut-il se concilier? Il faut qu'il laisse à Dieu le soin d'y veiller».
Quant au rôle de Luther, Stapel l'a définit dans un article de Deutsches Volkstum (1933, p. 181; «Das Reich. Ein Schlußwort»): «Quand l'Eglise est devenue inféconde et quand Dieu est entré en colère en s'apercevant de l'absence de sérieux de ses serviteurs, il a fait s'éveiller parmi les Allemands, peuple sérieux, un combattant et un prophète: Martin Luther. C'est ainsi que le Pneuma et l'Eglise ont été mis entre les mains des Allemands. A partir de ce moment, le Reich et l'Eglise, comme jadis chez les Romains, se retrouvaient entre les mains d'un seul peuple. Le Reich s'étendait alors sur tout le globe: dans le Reich de Charles-Quint, le soleil ne se couchait jamais. Mais chez Charles-Quint, le sang allemand de Maximilien s'était estompé et l'esprit allemand s'était éteint. L'Empereur n'est pas resté fidèle au peuple de son père. A l'heure où sonnait le destin du monde, il a failli. Au lieu de protéger et de laisser se développer l'Eglise de l'esprit, au lieu d'ordonner le monde selon les principes du Reich, il s'est enlisé dans des querelles d'intérêts. C'est ainsi qu'il a perdu et sa couronne et le Reich; le dernier véritable empereur s'est retiré, fatigué, dans un monastère, après avoir abandonné sa fonction. Ce n'est pas la Réforme qui est la cause de l'interrègne, mais l'infidélité et la négligence de Charles-Quint. Il n'a pas reconnu la véritable Eglise et a oublié [ce que signifiait] le Reich». Plusieurs analystes de la «Révolution Conservatrice» allemande, comme Martin Greiffenhagen (Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland, R. Piper Verlag, München, 1977), Kurt Sontheimer (Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, DTV, 3ième éd., 1978) ou Klaus Breuning (Die Vision des Reiches. Deutscher Katholizismus zwischen Demokratie und Diktatur. 1929-1934, Hueber, München, 1969) ont mis en exergue l'importance capitale de l'œuvre et des articles polémiques de Stapel. Greiffenhagen, par exemple, montre qu'il n'y a aucune propension au «novisme» (à l'innovation pour l'innovation) chez Stapel, contrairement à tout ce qui est affirmé péremptoirement par le filon philosophique moderne; ce que les militants, ou les «miliciens de Dieu», doivent créer, parce que les circonstances l'exigent, n'est pas quelque chose de radicalement neuf, mais, au contraire, quelque chose d'original, de primordial, qu'il faut raviver, faire ré-advenir. Pour Stapel, c'est la notion de Reich qu'il faut rappeler à la vie. Dans Der christliche Staatsmann. Eine Theologie des Nationalismus, il écrit (p. 7-8): «Le Reich n'est pas un rêve, un désir; ce n'est pas une fuite dans une quelconque illusion, mais c'est une réalité politique archétypale (uralt) de nature métaphysique, à laquelle nous sommes devenus infidèles [...]. Lorsqu'Israël s'est détourné de Yahvé, Dieu a puni Israël, comme nous pouvons le lire dans l'Ancien Testament. Et lorsque nous nous détournons du Reich, Dieu nous punit, comme nous le montre l'histoire allemande. C'est cela le Testament Allemand».
Stapel et Evola se réfèrent donc tous deux à un archétype métaphysique, transcendant toute forme de «sécularité», et visent, comme l'écrit Stapel (Der christliche Staatsmann, op. cit., p. 6), à forger un «front antiséculier». Front anti-séculier qui sera également porté par un anti-intellectualisme conséquent et radical: «La croissance de l'intellect s'est effectuée au détriment de la substance humaine, prise dans sa totalité. Le sentiment est devenu plus prosaïque et incolore (nüchtern); l'imagination terne et schématique; la passion a perdu son élan; l'instinct s'est amenuisé, n'est plus sûr de lui; la faculté de pressentir s'étiole. Mais, l'intellect croît et cherche, par le calcul, par la réflexion, par l'ébauche de belles idées, etc., à remplacer la source vive des sentiments, la fantaisie, l'instinct et le pressentiment. Tandis que l'homme croît et se développe toujours davantage dans l'orbite de l'intellect, les racines de son existentialité s'assèchent. A la place de réactions immédiates, inconscientes —qui sont bonnes quand la substance est bonne, mauvaises quand la substance est mauvaise— survient une éthique du cerveau» (Der Christliche Staatsmann, op. cit., p. 195).
Comme chez Evola, Rohan et Everling, nous trouvons, chez Stapel, une définition du chef, en tant qu'homme d'Etat: «Le véritable homme d'Etat unit en lui la "paternalité" (Väterlichkeit), l'esprit guerrier et le charisme. Paternellement, il règne sur le peuple qui lui a été confié. Lorsque son peuple croît en nombre, il lui fournit de l'espace pour vivre, en rassemblant ses forces guerrières. Dieu le bénit, lui donne bonheur et gloire, si bien que le peuple l'honore et lui fait confiance. L'homme d'Etat pèse et soupèse la guerre et la paix tout en conversant avec Dieu. Ses réflexions humaines deviennent prières, deviennent décisions. Sa décision n'est pas le produit d'un calcul, d'une soustraction, effectué(e) dans son entendement mais reflète la plénitude totale des forces historiques. Ses victoires et ses défaites ne sont pas des hasards dus à des facteurs humains, mais des dispositions de la Providence. Le véritable homme d'Etat est à la fois souverain, guerrier et prêtre» (Der christliche..., op. cit., p. 190). Si Evola manie l'opposition tellurique/ouranien ou matrilinéaire/patrilinéaire, Stapel, penseur luthérien et prussien, nomme «Romains», ceux qui ont, dans l'histoire, le sens de l'Etat, sont imperméables à toute forme de libéralisme, en dépit des formes républicaines ou impériales qu'ils peuvent défendre. Les négateurs de l'idée d'Etat sont, pour Stapel, les misérables «Graeculi», qui ne pensent ni n'agissent jamais de manière politique et ne réagissent que sous la dictée et l'emprise d'affects privés. Pour Stapel, la dichotomie directrice distingue donc les «Romains» des «Graeculi». Le parallèle avec Steding, qui opposait les défenseurs du Reich aux «neutres», est évident.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, révolution conservatrice, allemagne, italie, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, histoire, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 10 septembre 2009
Snapshots of the Continent Entre Deux Guerres: Keyserling's Europe (1928) and Spengler's Hour of Decision (1934)
Snapshots Of The Continent Entre Deux Guerres:
Keyserling’s Europe (1928)
And
Spengler’s Hour Of Decision (1934)
Swiftly on beginning my graduate-student career in 1984 I observed that people calling themselves intellectuals – the kind of people whom one met in those days as fellows in graduate humanities programs – tended to be obsessed with topicality and immediacy. Some adhered explicitly to one or another ideology of the a-historical, identifying so strongly with a perceived avant-garde or “cutting edge” that yesterday struck them as contemptible, a thing to be denounced so as to make way for the reformation of existence. But the majority were (and I suppose are) conformists looking for cues about what effective poses they might strike or words employ to signify their being “with it.” To be “with it” in a comparative literature program in California in the mid-1980s meant to be conversant with “theory,” and “theory” in turn meant the latest oracular pronouncement by the Francophone philosophe du jour, as issued almost before the writer wrote it by the those beacons of scholastic responsibility, the university presses. First it was Michel Foucault, then Jacques Derrida, and then Jean-Michel Lyotard. As tomorrow swiftly became yesterday, one sensed a panic to keep up with the horizonless succession of “with-it” gurus in fear that one might appear to others, better informed, as clownishly derrière-garde.
Being reactionary by conviction, I decided on an opposite course: to ignore the avant-garde and to read backwards, as it were, into the archive of forgotten and marginal books that no one deemed respectable by the establishment was reading anymore, and sideways into the contemporarily unorthodox. Part of the providential harvest of that eccentric project, which became a habit, is my acquaintance with two quirky tomes that, despite their oddness, seem to me to stand out as notable achievements of the European mind in the decade before World War Two. One is Count Hermann Keyserling’s Europe (1928); the other is Oswald Spengler’s “other book,” The Hour of Decision (1934). Both speak to us, in the God-forsaken present moment, with no small critical alacrity.
I. Spengler has proved a more durable figure than Keyserling, but the reading audience during the early years of the Weimar Republic would have known Keyserling better than Spengler. People talked about Spengler, but they read Keyserling, whose style was the more accessible. Of Baltic Junker descent, Graf Hermann Alexander Keyserling (1880 – 1946) fared badly in the aftermath of the Great War. He lost title to Rayküll, the hereditary Keyserling estate in Junker-dominated Livonia, when the newly independent Estonian Republic, conspicuously failing to reverse erstwhile Bolshevik policy, expropriated (or rather re-expropriated) the fixed holdings of the German-speaking ex-aristocracy. Keyserling found himself stateless, dispossessed, and in search of a career, his sole remaining asset consisting in his education (higher studies at Dorpat, Heidelberg, and Vienna). Marriage to Otto von Bismarck’s granddaughter (1919) returned Keyserling to something like a station while the success of his first book, The Travel Diary of a Philosopher (1922), stabilized his finances. The Travel Diary, immediately translated into a half-dozen languages including English, remains readable, even fascinating. In 1914, before the outbreak of hostilities, Keyserling had undertaken a global circumnavigation, the lesson of which the Diary, a nation-by-nation account of the world at that moment, meditatively records.
The Diary bespeaks a cosmopolitan-liberal attitude, flavored by a pronounced mystical inclination. Europe, or Das Spektrum Europas in the original German, will strike readers by contrast as an apology (highly qualified) both for nationalism and for individualism. Keyserling’s “spectroscopic analyses” of the various European peoples, in their peculiar individualities as well as in their complex relation to one another, advances the argument that, if Europe ever were to forge administrative unity out of its querulous variety, it would only ever do so by granting full rights and legitimacy to the varieties.
Keyserling favors a modest pan-European government, whose chief function would be the mediation of disputes between the otherwise sovereign nation-states, but characteristically he supplies no details. Keyserling’s notion of a pan-European administration differs in its modesty from many being advanced at the time by such as H. G. Wells, whose speculative utopias – as for example in Men Like Gods – uniformly foresee the dissolution of the nation-state, not just into a pan-European arrangement, but, rather, into a World Republic. Of course, Wells assumes that English, not French or Mandarin, will be the singular unifying tongue of that Republic. The elites will educate people so that anything like a national identity disappears completely in the first captive generation. In the concluding chapter of Europe, in a discussion of national “style,” Keyserling insists on the contrast between his own sense of identity and the “international,” or specifically political type of identity, promulgated by the Communists and Socialists. In the case of the specifically political identity, the subject yields his individuality to merge with the ideological construction. Keyserling reacts to this as to a toxin. “When I analyze my own self-consciousness,” Keyserling poses, “what do I find myself to be?”
Keyserling answers: “First and foremost, I am myself; second, an aristocrat; third, a Keyserling; fourth, a Westerner; fifth, a European; sixth, a Balt; seventh, a German; eighth, a Russian; ninth, a Frenchman – yes, a Frenchman, for the years during which France was my teacher influenced my ego deeply.” We note that politics never enters into it. Reading the autobiographical passages of Europe, especially those in the chapter on “The Baltic States,” one gets the impression, incidentally, that belonging to Baltdom ranks as rather more important for Keyserling’s self-assessment than its place in his explicit hierarchy of identities would suggest.
Europe deploys a well-thought-out dialectic of individual and national character, whose subtleties Keyserling presents in his “Introduction.” In the same “Introduction,” the author also sets forth his case for the absolute legitimacy of judging nations and cultures against one another. Keyserling fixes over the whole of Europe an epigraph drawn from Paul to the Romans: “For all have sinned and come short of the glory of God.” His dialectic follows from his conviction of imperfectness both of the basic human nature and of human arrangements for the conduct of political existence.
Keyserling can note, by way of a widely applicable example, that the Latin subject’s sense of his status as “civis Romanus… awoke in him as an individual a profound sense of self-discipline and obligation”; Keyserling can also assert that, “The man who attempts to deduce his own worth from the fact that he is a member of a particular group is thinking askew, and, besides presenting an absurd spectacle, gets himself disliked.” The two statements imply, for Keyserling, no contradiction. In the spirit of Saint Paul, Keyserling indeed hazards the sweeping – and, to some, disturbing – rule that, “in not a single nation is the national element, as such, bound up with anything of worth” because “the gifts of every nation are balanced by complementary defects.” As Keyserling sees things, “the only value in the national spirit is that it may serve as the basic material, as the principle of form, for the individual.” In the ironic consequence, as Keyserling closes out his syllogism, “it is for this very reason that every nation instinctively measures its standing by the number and quality of world-important figures which it has produced.”
Whereas on the one hand in Keyserling’s epigrammatic judgment, “the individual and the unique are more than the nation, be it one’s own or another,” on the other hand “value and mass have absolutely nothing to do with each other.” Apropos of Keyserling’s disdain for the “mass,” he notes that, “Christ preached love of one’s neighbor just because he did not have in mind philanthropy and democracy.”
Invoking Hebrew theology and German music as examples, Keyserling argues that: “A nation can achieve significance for humanity only in certain respects; namely, those wherein its special aptitudes fit it to become the appointed organ for all humanity.” Thus to evoke “abstract considerations of justice” is for Keyserling a “useless” exercise flying in the face of a “cosmic truth.” Given the central role of the individual in Keyserling’s scheme, readers will register little surprise when, in Europe, the author insists that the individual not only possesses the right, but indeed lives under an ethical imperative, to render public judgment on collectivities, with reference to a metaphysical hierarchy of values. “Strength and beauty are higher, in the absolute sense, than weakness and ugliness; superiority is higher, too, in the absolute sense, than inferiority, and the aristocratic is higher than the plebieian.” Europe offers, among other pleasures, Keyserling’s giving himself “free rein” to articulate such judgments in a spirit of “inner liberation,” in which the cultured reader will surely participate, treating everyone with equal severity and irony.
Keyserling admits, “There are some who will have for this book nothing but resentment.” He hopes indeed that “all Pharisees, all Philistines, all nitwits, the bourgeois, the humorless, the thick-witted, will be deeply, thoroughly hurt.” These are words almost more apt – but certainly more apt, supremely apt – for Anno Domine 2009 than for 1928; but one nevertheless presupposes their legitimacy in context. Keyserling reminds his readers in advance that he will have imposed the same criteria in assessing “my own people,” meaning the Balts, as in assessing others.
II. One can only sample the wares, so to speak, in a summary of Europe, keeping in mind Keyserling’s warning that he must necessarily offend the easily offended. Readers will need to explore Europe on their own to discover what Keyserling has to say about Netherlanders, Hungarians, Romanians, Swedes, and Swiss. What follows makes reference only to the chapters on England, France, and Germany. Does the order of the chapters imply even the most modest of hierarchies, with the first chapter taking up the analysis of England? Keyserling must have recognized the importance of his Anglophone audience to his popularity. His treatment of the English, while unsparing in principle, does seem warmed somewhat by fondness. For Keyserling, that odd phenomenon of “Anglomania” (nowadays one would say “Anglophilia”) tells us something, by way of indirection, about its object. “One nation sees itself mirrored in the other, not as it is, but as it would like to be; just as, during the World War, every nation attributed to its enemy the worst features of its own unconscious.”
On England. With characteristic nakedness of statement, Keyserling credits the Anglo-Saxon, not with “intelligence” but rather with “instinct.” According to Keyserling, “the whole [English] nation… has an unconquerable prejudice against thinking, and, above all, against any insistence on intellectual problems.” Being creatures of instinct, Englishmen act with certitude or at least with the appearance of certitude. It is this certitude, translated pragmatically as the habit of taking bold action, which others so admire, even while misunderstanding it, in the Anglo-Saxon spirit. “The Englishman… is an animal-man”; and “at the lowest end of the scale he is the horse-man, with corresponding equine features.” The aversion to ratiocination explains the British Empire, which “simply grew up, with no intention on anybody’s part,” to be governed by the colonial-administrator type, who “rarely thinks of anything but food, drink, sport, and, if he is young, flirtations.”
More than God, whatever his sectarian dispensation, Keyserling’s Englishman worships “the rules of the game.” Thus his “loyalty to one’s land, one’s party, one’s class, one’s prejudices… the first law” so that “the question of absolute value is beside the point.” From these inclinations stem “British empiricism, so despised by the French, which enables the British successfully to anticipate the crises precipitated by the spirit of the times.” Yet if the Englishman were ungifted intellectually, he would be, in Keyserling’s estimate, “all the more gifted psychologically,” with the consequence that the Briton possesses “skill in handling human material [that] is extraordinary.” Nestling at the core of that gift is the principle, which Keyserling classifies as “primitive,” that one should “live and let live.” The English sense of individuality and of rights is likewise primitive, in the positive sense of being a reversion, against the modern tide, to the atheling-egotism of the Beowulf heroes and King Alfred. More than any other European nation, England has preserved medieval customs that might prove healthily anodyne to the deculturation inherent in modernity. Yet Keyserling fears that the English will fail to preserve custom and will plunge into “the Mass Age” more thoroughly than other nations, just as the offshoot American nation, in his judgment, had already done.
On France. Chortling Gallic readers need only to have turned the page to receive their own stinging dose of Keyserling’s patented forthrightness. It starts out flatteringly enough. Whereas the Englishman lives according to instinct, the Frenchman, taking him in the generality, behaves like a “universally intelligible life-form”; one sees in him a creature of “the conscious” and of “the intellect,” whose rationality has concocted, in the Gallic idiom, “a perfect language for itself.” So it is that “all Occidental ideology, whenever it can be expressed at all in French, finds in the body of that language its most intelligible expression.” Nevertheless, “however clear the intelligence of the Frenchman may be, his self-consciousness is emotional rather than intellectual,” being as such, “easily and violently aroused,” with the emotion itself its “own ultimate justification.” From Parisian emotiveness, from the esteem in which others regard France, and using the intellectual precision of the French language, comes the least attractive of Gallic qualities: “The Frenchman… has always seen in his opponent the enemy of civilization.” Just that inclination emerged in 1914, but the ferocity of the Jacobins showed its presence at the birth of the French Republic.
As Keyserling sees it, however, France is not a dynamic, but an essentially conservative, nation, which is what has enabled it to survive its endless cycle of revolutions. The real role of France after 1918 should not have been, as the French took it on themselves to do through the League of Nations, to “restore” – that is, to transform – Europe after some rational pattern; it should have been to conserve the precious vestiges of pre-Revolutionary culture. “The French are par excellence the culture nation of Europe.”
On Germany. On the topic of Germany, Keyserling begins by quoting his old friend Count Benckendorff, the Czar’s ambassador in London: “Ne dites pas les allemands; il n’y a que des allemands.” (“Speak not of the Germans; there are only Germans.”) According to Keyserling, “The German exists only from the viewpoint of others”; yet not quite, as one can make applicable generalizations. A German is an “object creature” whose “life-element lies, once and for all, in that which, externally, emerges most typically in the cult of the object.” A German is by nature therefore an expert, dedicated to his own expertise and to expertise qua itself as the principle of orderly existence. Keyserling avails himself of a standing joke: “If there were two gates, on the first of which was inscribed To Heaven, and on the other To Lectures about Heaven, all Germans would make for the second.” German interest in objects and objectives gives rise to German technical prodigality – the German primacy in precision Engineering and the mechanical systematization of everyday life. Despite its orientation to the objects, the German mentality suffers from “unreality.” How so?
“The personal element in man,” Keyserling remarks, “declines in direct proportion as his consciousness becomes centered in detached, externalized ideas; and for those who have to deal with him it really becomes impossible to know what they can expect and what they can rely on.” Keyserling does not foresee the collapse of the Weimar Republic and the catastrophe of the dictatorship, but he does, in the just-quoted sentence, see the cause of both.
The concluding chapter of Europe attempts a summing-up with a forecast. Keyserling writes: “Europe is emerging as a unity because, faced at closer range by an overwhelming non-European humanity, the things which Europeans have in common are becoming more significant than those which divide them, and thus new factors are beginning to predominate over old ones in the common consciousness.” But, in compliance with his dialectic, Keyserling issues a warning. The unification of the European nations as they confront the non-European must avoid the result of producing “frantic Pan-Europeans” who, forgetting the specificity of the constituent nationalities, “understand each other not better, but worse than before.” If that were to happen, Europe would have been effectively “Americanized.” Keyserling concludes on an ominous note: “More than one culture has died out before reaching full blossom. Atlantis, the Gondwana continent, went the way of death. Infinite is human stupidity, human slothfulness.”
III. Keyserling and Oswald Spengler (1880 – 1936) never exactly knew each other; rather, they lived in standoffish awareness of each other, with Keyserling playing the more extroverted and Spengler the more introverted role. In February 1922, Keyserling wrote to Spengler from Darmstadt, enclosing his review of The Decline of the West, and inviting Spengler to participate in a “School of Wisdom” seminar to be held at the Count’s Darmstadt house. (The “School of Wisdom” was Keyserling’s lecture-foundation, which operated from 1920 until the Nazi regime shut it down in 1933.) Spengler declined the invitation on the grounds that the audience was likely to be “young people stuffed with theoretical learning.” Spengler remarked to Keyserling in his reply, that, “by wisdom I understand something that one obtains after decades of hard practical work, quite apart from learning.” Spengler makes his adieu by promising to have his publisher send the new edition of The Decline to his correspondent. The tone of Keyserling’s invitation perhaps abraded Spengler’s sense of propriety; Keyserling does presume a willingness to cooperate that, to Spengler, might have seemed a bit too peremptory. Keyserling nevertheless rightly presupposed that he shared many judgments with Spengler – just not the judgment concerning the obligatory status of a social invitation from Keyserling.
The Hour of Decision, like everything that Spengler authored, is a rich mine of observation and insight, difficult to summarize, mainly because it communicates so thoroughly with the monumental Decline, to which it forms an epilogue. The core of The Hour is its diptych of concluding chapters on what Spengler calls “The White World-Revolution” and “The Coloured World-Revolution.” As in the case of Keyserling’s ironic forthrightness, only more so, Spengler’s plain speaking makes him consummately politically incorrect. The Hitlerian regime would suppress The Hour just as it suppressed Keyserling’s Darmstadt lecture-institute. Both were unforgivably heterodox in the totalitarian context. Spengler, writing in the onset of “die Nazizeit,” saw nothing particularly new in the dire developments of the day, only an intensification of the familiar Tendenz. The West’s terminal crisis had been in progress already for a hundred chaotic years; the great spectacle of disintegration would only continue, not merely in the external world of institutions and forms, but also in the internal world of spiritual integrity.
Conjuring the image of the modern megalopolis and echoing Ortega’s alarm over the masses, Spengler writes, “A pile of atoms is no more alive than a single one.” Crudely quantitative in its mental processes, the modern mass subject equates “the material product of economic activity” with “civilization and history.” Spengler insists that economics is merely a sleight-of-hand discourse for disguising the real nature of the “catastrophe” that has overcome the West, which is a failure of cultural nerve.
In The Hour, Spengler builds on notions he had developed in The Decline, particularly the idea that the West has ceased to be a “Culture,” a healthy, vital thing, and has entered into the moribund phase of its life, or what Spengler calls “Civilization.” Into the megalopolis, “this world of stone and petrifaction,” writes Spengler, “flock ever-growing crowds of peasant folk uprooted from the land, the ‘masses’ in the terrifying sense, formless human sand from which artificial and therefore fleeting figures can be kneaded.” Spengler stresses the formlessness of “Civilization,” in which “the instinct for the permanence of family and race” stands abolished. Where “Culture is growth,” and “an abundance of children,” “Civilization” is “cold intelligence… the mere intelligence of the day, of the daily papers, ephemeral literature, and national assemblies,” with no urge to prolong itself as settled custom, well-bred offspring, or a posterity that honors tradition. The “White World-Revolution” consists in the triumph of “the mob, the underworld in every sense.”
The mob, which sees everything from below, hates refinement and despises anything permanent. The masses want “liberation from all… bonds [and] from every kind of form and custom, from all the people whose mode of life they feel in their dull fury to be superior.” Hence the appeal of egalitarianism to the masses. But, as Spengler argues, egalitarianism is really only a slogan, a euphemism. The real trend is “Nihilism.”
The pattern of “Nihilism” emerged in the French Revolution, with its vocabulary of leveling, as in the radically politicizing etiquette of “citoyen” and in the supposedly universal demand for “Liberty, Equality, and Fraternity.” “The central demand of political liberalism,” writes Spengler, consists in “the desire to be free from the ethical restrictions of the Old Culture.” Yet as Spengler insists: “The demand was anything but universal; it was only called so by the ranters and writers who lived by it and sought to further private aims through this freedom.” We see this identical pattern today in the various concocted emergencies and so-called universal demands that the current thoroughly liberal-nihilistic regime in the United States trots out serially to justify its consolidation of power, whereby it ceaselessly attacks what remains in the American body-politic of form and custom. In Spengler’s aphorism: “Active liberalism progresses from Jacobinism to Bolshevism logically.”
In Spengler’s judgment, moreover, one would make a mistake in equating Bolshevism, as people would have done in the 1930s, uniquely with the Soviet Union. “Actually [Bolshevism] was born in Western Europe, and born indeed of logical necessity as the last phase of the liberal democracy of 1770 – which is to say, of the presumptuous intention to control living history by paper systems and ideals.”
When Spengler remarks on the theme of tolerance (so-called) in liberalism-nihilism, one thinks again of the existing situation in Europe and North America the first decade of the Twenty-First Century. Inherent to form is its rigorous exclusion of the formless. In its aggressive demand for inclusion of the rightly excluded, which belongs to its destructive impetus, the liberal-nihilistic regime works actively to de-stigmatize anti-social behavior. Thus under liberalism-nihilism “tolerance is extended,” by self-denominating representatives of the people, “to the destructive forces, not demanded by them.” Of course, the “destructive forces” do not refuse the extension. On historical analogy, Spengler refers to this as “the Gracchan method.” When once, as had already happened in Europe in Spengler’s time, “the concept of the proletariat [had] been accepted by the middle classes,” then the formula for cultural suicide had at last all of its ingredients in place. “I am aware,” writes Spengler, “that most people will refuse with horror to admit that this irrevocable crashing of everything that centuries have built up was intentional, the result of deliberate working to that end… But it is so.”
IV. Like another, later analyst of modernity in its agony, Eric Voegelin, Spengler sees at the root of Liberalism-Nihilism the perversion of a religious idea. “All Communist systems in the West are in fact derived from Christian theological thought: More’s Utopia, the Sun-State of the Dominica Campanella, the doctrines of Luther’s disciples Karlstadt and Thomas Münzer, and Fichte’s state-socialism… Christian theology is the grandmother of Bolshevism.” The materialism – which is again a type of nihilism – of Marxism and socialism never contradicts the case for liberalism-nihilism as a perversion of Gospel themes. “As soon as one mixes up the concepts of poverty, hunger, distress, work, and wages (with the moral undertone of rich and poor, right and wrong) and is led thereby to join in the social and economic demands of the proletarian sort – that is, money demands – one is a materialist.” But, this being Spengler’s point, one may have the belief-attitude with respect to one’s materialist doctrines that the fanatic of God has for his mental idol, with the concomitant fierceness and ruthlessness. The end of real Christianity is “renunciation.” With reference to the sentence of Adam, writes Spengler, the Gospel tells men, “do not regard this hard meaning of life as misery and seek to circumvent it by party politics.”
In a precise description of the modern, immigration-friendly, general-welfare state, Spengler remarks that “for proletarian election propaganda,” an opposite principle to the Gospel one is required: “The materialist prefers to eat the bread that others have earned in the sweat of their face.” When the Gracchan rabble dominates from below so that the demagogues might manipulate from above, then it will come to pass that “the parasitic egoism of inferior minds, who regard the economic life of other people, and that of the whole, as an object from which to squeeze with the least possible exertion the greatest possible enjoyment” will seek its bestial end in “panem et circenses.” Once the majority descends to vulgar consumption through extortion – and through a mere pretence of work under the welfare-umbrella of “the political wage” – then the society has doomed itself. It can only lurch in the direction of its inevitable demise. Even the keen-eyed will not want to confront reality. They will, as Spengler writes, “refuse in horror” to believe what they see. Spengler might have been thinking about a letter from his correspondent Roderich Schlubach dated 9 October 1931. Schlubach writes: “I frankly admit that much of what you prophesied [in The Decline] has taken place. The decline of the West seems to be at hand, and still I do not believe in an end of the world, only in an entire change in our circumstances.”
That is “The White World-Revolution” – the triumph of rabble-envy, the destruction of form, childlessness, and the childishness of mass entertainments. Indeed, “an entire change in our circumstances,” as Schlubach says, not grasping that his words mean the opposite of what he intends. What of “The Coloured World-Revolution”? Keyserling had admonished, in the concluding chapter of Europe, that Europe in its chafing unity would come under threat from the nearby non-European world. In Spengler’s historical theory, the threat of external barbarism always coincides with the passage of the “Culture” into its deliquescent rabble-stage – the stage that the Decline-author ironically calls “Civilization.” Earlier, in the robustness of the culture-stage, the ascendant people inevitably imposes itself on neighboring and foreign peoples whose levels of social complexity and technical sophistication are lower and who cannot effectively resist encroachment. Spengler emphasizes that it cannot be otherwise. The people of the less-developed society gradually grow conscious of a difference, which the emergent demagogue-class of the more-developed society in its liberal paroxysm swiftly encourages them to see as an injustice.
Thus, Spengler asserts, “the White Revolution since 1770 has been preparing the soil for the Coloured one.” The process has followed this course:
The literature of the English liberals like Mill and Spencer… supplied the “world outlook” to the higher schools of India. And thence the way to Marx was easy for the young reformers themselves to find. Sun Yat Sen, the leader of the Chinese Revolution, found it in America. And out of it all there arose a revolutionary literature of which the Radicalism puts that of Marx and Borodin to shame.
Spengler, who was consciously and deliberately distancing himself from the National Socialists, reminds his readers that he is not “speaking of race… in the sense in which it is the fashion among anti-Semites in Europe and America today.” He is simply comparing the attitude to life of existing peoples. The Western nations compete for dominance with non-Western nations whether they want to do so or not. The non-Western nations, like Japan, act in bold accord with ideologies that cast the West in a scapegoat role, and that are overtly racist. The West has enemies. It cannot choose not to be in enmity with them; they choose enmity peremptorily. The West can either stand up to its assailants or succumb. When Spengler turns to demography, to his tally of Western birth-replacement deficits and burgeoning populations elsewhere, his discourse strikes us, not as dated, but as entirely contemporary. “The women’s emancipation of Ibsen’s time wanted, not freedom from the husband, but freedom from the child, from the burden of children, just as men’s emancipation in the same period signified freedom from the duties towards family, nation, and State.”
The attitude of the European middle class, judging by its failure to oppose the vulgarization of society and again by its unwillingness to perpetuate itself in offspring, is one of abdication before the forces of nothingness – this is true whether it is 1934 or 2009. Like the proletariat, the bourgeoisie then and now hungers only for panem et circenses, or, as we so quaintly call it in present-day America, the consumer lifestyle. Spengler predicts, in The Hour, that the non-Western world will grow increasingly hostile and predatory towards the West, seeing the decadent nations as easy pickings and seeking opportunities to assault and humiliate the bitterly resented other. Spengler believes that the nihilistic tendency of Western revolutionaries will merge with the similar tendencies of their non-Western, colonial or ex-colonial counterparts and that the internal and external masses will cooperate in a common destructive project. What else was the bizarre alliance between the Nazi regime in Berlin and the Bushidoregime in Tokyo? Or between Heinrich Himmler and the Grand Mufti of Jerusalem? Just this intimate cooperation of homebred totalitarians with inassimilable fellah-collaborators seems today to be the case, for example, in Great Britain and Sweden – and to no little extent, not merely with respect to illegal Mexican immigration, in the United States as well.
The Hour of Decision remains a shocking book. It will shock even conservatives because they cannot have avoided being assimilated in some degree to the prevailing dogma about what one may or may not say. One can imagine the reaction of contemporary liberals to the book if only they knew anything about it: spitting, blood-shot indignation. Contemporary liberals have already banned almost the entirety of Spengler’s vocabulary under the strictures of self-abasing multiculturalist dhimmi-mentality. The Hour is also a radical book, not least in its notion, also present in both volumes of The Decline that, the crisis of the West, which began already in the Eighteenth Century, would likely play itself out right through the end of the Twentieth Century and beyond. The disquiet that comes across at the end of Keyserling’s Europe, which appeared as we recall in 1928, asserts itself as greatly heightened apprehension in the final chapter of The Hour, which appeared in German in 1934 and in English in 1936, after Goebbels had suppressed further publication of the German edition. The National Socialists, like modern liberals, could not bear to be identified by a strong voice, as who and what they actually were.
00:19 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, révolution conservatrice, oswald spengler, histoire, philosophie, années 30, national-socialisme, années 20, europe, conservatisme, droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les contributions à Il Regime Fascista du Prince Karl Anton Rohan

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Robert STEUCKERS:
Les contributions à Il Regime Fascista du Prince Karl Anton Rohan (1898-1975)
Le Prince Karl Anton Rohan, issu d'une très ancienne famille bretonne, émigrée à Vienne et devenue autrichienne, fonde en 1924 le Verband für kulturelle Zusammenarbeit (= Association pour la Coopération Culturelle) et édite à Berlin, de 1925 à 1936, la célèbre Europäische Revue, qui donne aux cercles conservateurs et conservateurs-révolutionnaires (dans l'optique jungkonservativ) une dimension européenne, supra-nationale, impériale (dans le sens de Reich). Huppés et mondains, les cercles regroupés autour de l'Europäische Revue influençaient les milieux diplomatiques. Après que le Prince Rohan ait passé le flambeau de rédacteur-en-chef au Dr. Joachim Moras, l'importance du Conseiller d'Etat prussien, le Prof. Dr. Baron Axel von Freytagh-Loringhoven, n'a cessé de croître dans la revue.
Le Prince Rohan, dans son ouvrage Schicksalstunde Europas. Erkenntnisse und Bekenntnisse, Wirklichkeiten und Möglichkeiten (Leykam-Verlag, Graz, 1937), a esquissé un bilan de l'histoire spirituelle et événémentielle de l'Europe, en abordant le problème central de la personnalité dans l'éthique qu'il qualifiait de «spécifiquement européenne», en amorçant une réflexion sur le matérialisme et le rationalisme, erreurs philosophiques et politiques du monde moderne, et en annonçant le retour à l'avant-plan d'idées et d'idéaux non révolutionnaires, voire contre-révolutionnaires, pour lesquels, croyait-il, le fascisme et le national-socialisme préparaient le terrain, parce qu'ils étaient des réactions radicalement anti-bourgeoises. Les aristocrates qui ont encore en eux les vieux réflexes constructeurs du politique reviendront tout naturellement au pouvoir; mais ceux qui sont épuisés dans leur vitalité et leur créativité devront se ressourcer dans le grand nombre: «les vieilles figures sont fissurées; elles devraient se replonger dans le nombre, de façon à ce que, au départ de cette immersion dans le nombre, de nouvelles figures puissent croître et remonter à la surface» (p.383).
«Tout comme la caste supérieure déterminée par le sang et constituée par l'aristocratie n'a pas pu inclure dans les structures du pouvoir de l'ancien régime les forces montantes de la révolution bourgeoise, les autorités éphémères du monde bourgeois du XIXième siècle ont échoué dans leur tentative de capter et de diriger sur des voies d'ordre la "révolte des masses", la révolution de l'anti-bourgeois. Dans le vaste processus historique qu'est la révolution sociale, les anciennes autorités ont été broyées, étrillées, et aucune autorité nouvelle n'est encore apparue. Pour être plus précis: les signes avant-coureurs d'une nouvelle et véritable autorité ne sont présents sur la scène que depuis peu de temps; cette autorité nouvelle doit mûrir et s'affirmer. Ceux qui constituaient l'élite sont désormais fatigués. La vision du monde de nos relativistes d'esprit et de morale n'était vraiment pas appropriée pour servir de plate-forme à une domination sur les masses, au sein desquels même les plus arriérés savent désormais lire et écrire. Et les pédérastes et demi-puceaux émanant de la "jeunesse dorée" des classes supérieures urbanisées ne pouvaient évidemment pas apparaître aux yeux de l'ouvrier comme l'élite de ses vœux, à laquelle il devrait se soumettre. Les classes supérieures et la masse se comportent dans l'histoire comme le conscient et l'inconscient dans l'homme. La santé, au sens social comme au sens psychologique, est cet état de choses, dans lequel le dessous et le dessus entretiennent un rapport d'échange constant et fructueux, où le dessus est reconnu par le dessous, où le dessous donne au dessus la direction (vox populi, vox dei), où le dessus comprend le dessous et où la répartition naturelle des rôles de l'un et de l'autre se maintient en harmonie. Ce qui signifie que le haut, et seul le haut, doit agir, toutefois en acceptant une responsabilité pour le tout; et ces strates supérieures doivent agir en concordance avec les aspirations de la masse et avec ses exigences qui sont évidemment générales et confuses. Si la masse veut agir immédiatement (sans intermédiaire), en révolte contre le haut, alors il arrive ce qui arrive à l'individu qui agit au moment où son subconscient oblitère sa conscience: il y a des pots cassés et notre homme obtient presque toujours le contraire de ce qu'il avait désiré. Car, de toute éternité, le rôle des classes supérieures, de la direction, ou, au niveau de l'individu, de la conscience, c'est d'adapter et de canaliser dans le réel les sombres émotions et pulsions de la masse ou de l'inconscient. Sans ce rôle de régulateur et de transformateur, surviennent immanquablement des catastrophes. Si cet équilibre normal et sain, cette oscillation entre le haut et le bas, sont interrompus, la conscience poursuit sa vie sans lien avec son socle fait d'inconscient, si elle plane dans les airs, alors nous voyons apparaître les premières manifestations de fatigue. Sont alors nécessaires le repos, la détente, la récréation, la distraction. Toute révolution n'est jamais autre chose, ne peut jamais être autre chose, que l'expulsion d'une élite dominante par une élite dominée qui aspire à exercer le pouvoir; or tout processus révolutionnaire commence au sein des élites. On y est fatigué, on ne croit plus à ses propres forces. On trouve que ceux d'en bas, que les adversaires, ont en fait raison dans ce qu'ils disent et revendiquent. On décide de ne pas résister et on est balayé. C'est ainsi qu'en 1918 les monarchies ont été abandonnées par les détenteurs du pouvoir, avant même qu'elles n'aient été réellement attaquées. Si l'élite fatiguée ne veut pas prendre connaissance de ses symptomes, elle vivra de sa propre substance; alors la masse inconsciente, qui a perdu toute relation normale avec l'élite, se fera plus critique et plus turbulente. On verra alors apparaître de véritables troubles qui iront en crescendo, jusqu'aux crises névrotiques, jusqu'aux dépressions nerveuses. Si l'élite, qui a perdu toute véritable autorité et donc toute légitimité, refuse de se retirer du pouvoir, elle s'en tiendra au droit positif contre le droit naturel et refusera de faire passer les réformes nécessaires; alors la révolution dégénère en guerre civile» (pp. 381-383) . «La première démarche à accomplir, pour forger de nouvelles figures, une nouvelle élite qui entretient un contact sain avec la base, c'est de vivifier les hiérarchies que la révolution et la contre-révolution ont constituées. Il s'agit ici de construire une communauté de volonté. Discipline sévère, inclusion dans un ordre, mais aussi travail sans relâche aux postes qui ont été assignés, exécution précise des ordres reçus, voilà les premisses. Mais pour monter plus haut dans la nouvelle hiérarchie, il faut adhérer à un mythe politique, il faut être intérieurement emporté par l'esprit d'une Weltanschauung. Derrière les slogans que sont la "révolution mondiale", l'Italianità et la Romanità, le Volkstum et la race nordique, se profile toute une construction doctrinale avec ses fondements d'ordre historique, sociologique, économique, scientifique et aussi moral: il faut les accepter sans conditions car ils sont les présupposés qui fondent la confiance au sein de la communauté de volonté, qui sont nécessaires à l'exercice des plus hautes fonctions» (pp. 383-384). A la lecture de ces extraits, on s'aperçoit que l'intérêt d'Evola pour Rohan (et vice-versa: Rohan cite Révolte contre le monde moderne en page 25 de Schicksalsstunde Europas, op. cit.) vient d'une volonté partagée entre les deux hommes de dépasser définitivement les limites étroites du bourgeoisisme, de reforger dans la «mobilisation totale» une nouvelle aristocratie européenne supra-nationale. Pour Rohan, le fascisme italien et le national-socialisme allemand sont des effervescences provisoires, brutales et violentes, qui s'avèrent nécessaires pendant le laps de temps où il n'y a plus de véritable autorité. Dès que la «domination des meilleurs» sera installée, «la crispation se détendra, la militarisation actuelle des peuples se relâchera. Car la violence ne doit s'exercer que là où manque une autorité véritable. Un pouvoir réel devra nécessairement octroyer davantage de liberté, sans pour autant craindre l'effondrement des peuples et des Etats ni une diminution de leur puissance de frappe en cas de guerre ou en temps de paix» (p. 386). «Le nouveau type dominant, anti-bourgeois, a fait appel aux masses, il les a politisées, il les a fusionnées en unités disciplinées sous le signe de mythes nouveaux» (p. 387).
Dans Il Regime fascista, Rohan aborde la problèmatique de l'«autre Europe», qui est, écrit-il, «notre Europe», c'est-à-dire celle de la nouvelle phalange anti-bourgeoise, regroupant des ressortissants des anciennes aristocraties (comme, par exemple, Evola et lui-même) et les élites nouvelles, fascistes ou nationales-socialistes, qui ont réussi la «mobilisation totale» des énergies populaires. Dans l'article intitulé «L'altra Europa, la "nostra" Europa» (16 février 1934), Rohan oppose sa conception de l'Europe à celle d'un autre aristocrate autrichien, le Comte Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, auteur, en 1924, d'un projet de «Paneurope», regroupant tous les Etats du continent à l'exclusion de l'Angleterre et de la Russie. Cette Paneurope, qui a enthousiasmé Briand et Stresemann, devait s'inscrire dans la tradition libérale-démocratique et en étendre les principes à l'ensemble du continent. Rohan et Evola sont «paneuropéens», mais à l'enseigne de valeurs diamétralement opposées au libéralisme et au démocratisme, nés dans le sillage de 1789 ou imités des modes anglo-saxonnes.
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, révolution conservatrice, allemagne, italie, histoire, années 30, conservatisme, idée européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 septembre 2009
Nouvelle revue d'histoire n°44
La Nouvelle Revue d’Histoire n° 44 : Violence et politique

Bientôt disponible dans les kiosques à journaux.
00:15 Publié dans Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, histoire, violence |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 06 septembre 2009
De Yalta à la réorganisation de la Mittleuropa

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Robert Steuckers:
De Yalta à la réorganisation de la Mitteleuropa
Si l'on passe en revue les événements qui ont secoué l'Europe depuis Yalta, on constate, dans les années 50, une atmosphère de guerre froide risquée, avec un conflit coréen sanglant, l'aventure de Suez, l'écrasement des révoltes de Berlin-Est, Plzen (Pilsen), Gdansk (Dantzig) et Budapest, et la révolution cubaine. La terreur nucléaire est partout présente. Les deux gros s'affrontent mais, en même temps, s'entendent contre l'émergence des non-alignés (Bandoung, 1955). Les années 60 sont, pour l'Occident, l'époque de l'ascension économique et le démarrage de la société de consommation. Les premières velléités d'indépendance se manifestent en Europe: De Gaulle quitte le commandement intégré de l'OTAN. Les années 70 connaissent un conformisme consumériste rigide, assorti, dans la foulée de 68, d'une contestation gauchiste inopérante, stérile, incapable d'imaginer et de créer des institutions nouvelles. Après 1975, quand l'idéologie de 68, version dure mais marginale, s'essoufle et que l'idéologie de 68, version molle, freudo-marxiste, hédoniste et narcissique, commence à faire sourire, le monde traverse une époque qui n'est ni chaire ni poisson. L'avènement de Reagan, après les élections d'octobre 1980, consacre la victoire idéologique d'un conservatisme néo-libéral, vulgaire et anti-intellectuel, contredit seulement par l'élection, en mai 1981, de François Mitterand, dernière victoire d'un conglomérat idéologique hétérogène alliant le paléo-socialisme d'un Maurois, psycho-rigide et étatiste, à la parousie gélatineuse du gauchisme, émanation de la déliquescence de la société libérale-bourgeoise. Ce conglomérat ne tiendra pas longtemps et le mitterandisme prendra sa vitesse de croisière avec un carburant idéologique très différent: une sorte de social-conservatisme, acceptable par l'idéologie néo-libérale dominante.
En 1982, quand l'aviation et les chars israëliens écrasent les avions et les tanks syriens lors de l'opération dite «Paix en Galilée», les observateurs militaires sérieux admettent, sans le crier sur tous les toits, que, désormais, la technologie occidentale est incontestablement supérieure à la technologie soviétique. Ce fait n'est pas dévoilé au grand public. L'anti-communisme doit encore fonctionner, en tant que discours manipulatoire, pour permettre à Reagan d'asseoir son programme économique. Mais les Soviétiques sont contraints de changer de stratégie, d'assouplir leurs positions et de lâcher du lest. Cette retraite a été camouflée sous les noms de perestroïka et de glasnost, dès qu'un chef plus jeune a accédé au pouvoir suprême au Kremlin. La défaite militaire, l'URSS la compensait par une belle offensive de propagande, qui n'était pas si fictive que cela, puisqu'il fallait bien réformer de fond en comble la société soviétique exsangue et improductive. Et cette société soviétique, dans quelle Europe évoluera-t-elle?
Première chose que l'on peut dire de l'Europe post-perestroïka, c'est qu'elle ne sera certainement pas administrée par les principes de l'idéologie marxiste. Deuxième chose, c'est qu'elle risque de basculer dans le libéralisme délétère de l'américanosphère. Mais qui dit risque ne dit pas certitude. Les privatisations en Pologne, en Hongrie, en Russie, provoquent déjà tant de dysfonctionnements qu'une application de l'économie de marché pure s'avère très problématique sinon impossible. Troisième facteur à prendre en compte: les réflexes nationaux/ethniques, réflexes collectifs et non individualistes; ils indiquent qu'une forme nouvelle de rapports sociaux doit voir le jour, qui préserve les personnalités culturelles, renforcent la solidarité sociale dans une économie florissante, qui relègue la précarité et la pénurie au dépotoir de l'histoire. Quatrième point: ce retour aux identités, cette soif de solidarité sociale et ce besoin d'une économie souple et efficace ne peut se faire sous l'égide d'un parti (communiste) monopolistique, fortement idéologisé, qui étouffe toutes les virtualités qui ne cadrent pas avec ses schémas.
L'autonomie culturelle
L'Europe de demain, et plus spécialement sa partie centrale (la Mitteleuropa), n'oubliera pas qu'elle est une mosaïque de spécificités inaliénables, où aucune frontière fixe n'est juste. Chacune de ses spécificités, qu'elle soit de nature purement ethnique/linguistique, religieuse ou idéologique, doit pouvoir exprimer ses virtualités, car elles sont forcément des enrichissements positifs dont bénéficiera l'ensemble du continent. Cela implique un mode souple de représentation, plus moderne et audacieux que la représentation conventionnelle au sein des Etats-Nations que nous connaissons aujourd'hui. Ces entités, héritées de la Révolution française et du calamiteux Traité de Versailles, ont contraint des régions entières à se couper de leur hinterland naturel et provoqué de la sorte de lamentables récessions culturelles et économiques.
Prenons quelques exemples: la Tchécoslovaquie de 1919, celle de Masaryk, était mue par un curieux mélange de panslavisme germanophobe et de messianisme laïc (maçonnique), qui a coupé et les liens naturels et séculaires de la Bohème avec la Saxe, l'Autriche et la Bavière, et ceux qu'entretenait la Slovaquie agraire avec la Hongrie et la Pologne. La République communiste de 1948 a accentué encore cette coupure catastrophique, contraignant les Tchèques à renoncer à leur tissu industriel spécifique pour poursuivre le mythe communiste de l'industrialisation lourde. Ce fut l'enlisement, contrecarré seulement par des mesures draconiennes, assorites de la mobilisation des détenus dans les secteurs de l'industrie lourde, déficitaires dans la conjoncture actuelle. L'économiste Ota Sik, l'actuel Président Vaclav Havel, ainsi que des groupes de dissidents installés à Paris, ont compris que ce «masarykisme communiste» ne pouvait durer. Aujourd'hui, la République communiste tchècoslovaque est devenue la «République fédérative des Tchèques et des Slovaques». Le fédéralisme régionaliste progresse, avec une Bohème industrielle tournée vers l'Allemagne (rappelons-nous que la première visite officielle de Havel s'effectua en Allemagne) et une Slovaquie agricole liée à la Hongrie. Les Hongrois de Transylvanie ont réclamé leur autonomie, sans exiger l'Anschluß avec la «mère-patrie» magyare. En Pologne, malgré les éructations nationalistes dépassées de ces dernières semaines, des voix réclament la décentralisation de l'Etat. En Yougoslavie, Slovènes et Croates acquièrent de plus en plus de liberté de mouvement.
Ce fédéralisme qui donne à l'Europe, à la «Maison Commune» européenne, une architecture nouvelle, sans relents de militarisme fanatique (seuls quelques résidus en Pologne et en Serbie), doit avancer à l'Ouest aussi: la Grande-Bretagne doit fait progresser sa «dévolution», la décentralisation espagnole est désormais un fait accompli. Les constitutions-modèles restent pour nous les constitutions ouest-allemande, autrichienne et helvétique. Le règlement des minorités en Europe orientale doit, à notre sens, se calquer sur les statuts des minorités allemandes au Danemark et danoise en RFA, sur le statut de la minorité germanophone en Belgique, lequel prévoit l'élection directe des mandataires de la «communauté germanophone» et un système scolaire très élaboré. Danois, Belges et Allemands estiment d'ailleurs que ces statuts devraient être appliqués ailleurs dans la CEE, là où il y a des minorités linguistiques. La France, la Grèce et la Suède conservent encore des institutions centralisatrices aujourd'hui obsolètes, qui arasent les spécificités et permettent de la sorte aux chimères mondialistes de toutes natures de proliférer et de désagréger la société.
La Solidarité sociale
La véritable solidarité sociale passe par la reconnaissance de la personnalité de tous les membres de la communauté populaire. C'est pourquoi, vu la diversification extrême du tissu social contemporain, le mode de représentation parlementaire doit être révisé et amélioré. Chaque circonscription électorale (qui devra représenter un territoire homogène sur tous les plans) devra élire ses représentants sur une base triple et non plus unique. S'il est anti-démocratique d'ôter aux grands partis d'opinion la possibilité d'être représentés, ce type de représentation ne saurait suffire à donner une image complète des desiderata du peuple. Le peuple n'est pas seulement un éventail d'opinions générales mais un kaléidoscope d'intérêts entrecroisés, classables en trois catégories au moins: les intérêts idéologiques non matériels (représentés par les partis), les intérêts professionnels concrets et les intérêts territoriaux (régionaux) d'ordre charnel. De ce fait, les chambres de l'avenir devront tenir compte de ce faisceau d'intérêts entrecroisés et être élues selon un système à trois vitesses qui, en bout de course, donnera une représentation populaire plus précise et plus juste. C'est là, en gros, l'idée du Sénat des régions et des professions qu'avait envisagé De Gaulle pour la France. Ce modèle doit servir d'exemple à l'Europe orientale en pleine effervescence.
Une telle représentation implique aussi une redistribution plus juste du revenu national. Cette redistribution doit viser deux objectifs: 1) éviter l'émergence d'une nouvelle pauvreté, comme celle qui est en train de miner et de déstabiliser la société polonaise. En Allemagne de l'Est et en Hongrie, le remaniement socio-économique doit justement esquiver ce terrible écueil. Le problème de la nouvelle pauvreté implique, soit dit en passant, un système d'allocations sélectif basé sur l'autochtonité. La lutte contre la précarité existentielle est impossible dans un système qui ouvre ses portes aux immigrations les plus diverses. On l'a vu en RFA avec l'afflux massif de réfugiés est-allemands, pourtant de même culture.
2) La redistribution ne doit pas étouffer les virtualités des éléments doués d'une société. La redistribution ne saurait se faire au détriment de la recherche universitaire en tous domaines, surtout dans les branches scientifiques et technologiques où l'Europe doit rattraper ses retards. Elle ne saurait s'effectuer non plus au détriment des investissements modernisateurs de l'outil industriel. La transparence, tant voulue par les gauches, passe par l'intéressement et la participation au sens gaullien des termes. Seuls l'intéressement et la participation responsabilisent et «conscientisent» le salariat qui sait alors quels sont ses droits (le montant de ses allocations et salaires) et ses devoirs (le montant du sacrifice à consentir pour la modernisation et l'entretien de l'outil, pour la recherche).
Représentation nouvelle, redistribution nouvelle, organisation ethnocentrée de nos peuples, voilà des défis révolutionnaires qui s'adressent à tous les Européens, de l'Est comme de l'Ouest. Ces idées donneront un visage nouveau à l'Europe en dépit des stratégies de retardement que ne manqueront pas de déployer l'établissement et les pseudo-rénovateurs.
Robert STEUCKERS,
avril 1990.
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : europe, europe centrale, mitteleuropa, affaires européennes, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook