mercredi, 08 septembre 2010
Armin Mohler: Réflexions sur les thèses de Zeev Sternhell
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1986
Armin MOHLER:
Réflexions sur les thèses de Zeev Sternhell
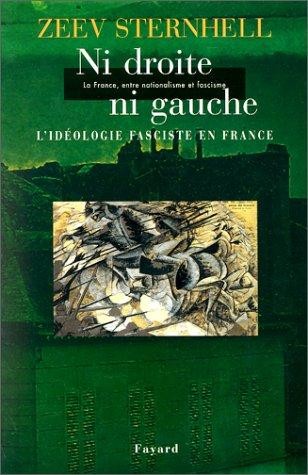 Un livre, paru à Paris en 1983, a complètement bouleversé l'historiographie du fascisme. Ce livre porte le titre de: Ni droite ni gauche. L'idéologie du fascisme en France. Gros de 412 pages, il est publié par les éditions du Seuil, maison pourtant connue pour ses tendances de gauche.
Un livre, paru à Paris en 1983, a complètement bouleversé l'historiographie du fascisme. Ce livre porte le titre de: Ni droite ni gauche. L'idéologie du fascisme en France. Gros de 412 pages, il est publié par les éditions du Seuil, maison pourtant connue pour ses tendances de gauche.
L'auteur, Zeev Sternhell, professeur de politologie à l'Université Hébraïque de Jérusalem, est né en Pologne en 1935. Il est actuellement le Directeur du "Centre d'Etudes Européennes" et, peu avant la parution de Ni droite ni gauche, il avait fondé le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Civilisation Française.
Son livre est très dense. Il abonde en outre de répétitions car, ce qui importe pour Sternhell, homme au tempérament fougueux, c'est d'inculquer au lecteur certains jugements inhabituels. Mais il serait erroné de lui reprocher l'emploi de "concepts vagues". A l'opposé du spécialiste jusqu'ici accrédité de l'étude du fascisme, Ernst Nolte, Sternhell n'a pas reçu de formation philosophique. Il est un authentique historien qui se préoccupe de recenser le passé. Pour lui, chaque réalité historique est "irisable", on ne peut la ramener à un seul concept, il faut en considérer les diverses facettes. Dès lors, contrairement à Nolte, Sternhell ne construit pas un schéma abstrait du fascisme, dans lequel il conviendra d'enserrer ensuite les phénomènes concrets. Il renvoie de préférence ces phénomènes à toute une variété de concepts qu'il puise toutefois dans le vocabulaire politique traditionnel, afin de les cerner et de les localiser.
S'il entre dans notre propos de résumer ici un ouvrage aussi complexe, notre exposé ne pourra cependant pas remplacer la lecture de ce livre. Il en est plutôt l'introduction.
1. Qui est Zeev Sternhell?
1.1. Indubitablement, il est un authentique homme de gauche. Le journal Le Monde (14.1.1983) déclare à son sujet: Sternhell entra en mai 1977, après la victoire électorale de Begin et la chute du Parti Travailliste, dans la vie politique israëlienne. Il créa le Club 77, un rassemblement d'intellectuels de l'aile d'extrême-gauche du Parti Travailliste. Ce Club s'engagea dans une politique de modération envers le monde arabe et milita pour l'évacuation de la Cisjordanie; en matière de politique interne, il chercha à favoriser une politique aussi "socialiste" que possible, c'est-à-dire accordant le maximum d'égalité. Au sein du Parti Travailliste, Sternhell fait partie d'une minorité, tout en étant membre du Comité Exécutif".
1.2. Sternhell est un "gramsciste". A l'instar de toute la gauche revendicatrice et contestatrice de sa génération, il s'est libéré de l'orthodoxie marxiste. Il rejette expressément la conception matérialiste de l'histoire (pp.18-19).
A la suite de Gramsci (et a fortiori de l'inspirateur de ce communiste italien, Georges Sorel), Sternhell se rallie à la conception historiographico-philosophique qui veut que les idées ne soient pas le reflet des réalités, mais l'inverse.
1.3. Le point de départ de la démarche de Sternhell: le révisionnisme. Le fait que Sternhell se soit consacré à l'étude du fascisme s'explique sans aucun doute par son intérêt pour la biographie des révisionnistes, ceux qui ont tenté de changer et de réformer le marxisme orthodoxe. De Ni droite ni gauche, il ressort que le révisionnisme de "droite" (p.35) ou révisionnisme "libéral" (p.81), qui mène à des alliances et des compromissions avec le libéralisme bourgeois et qu'incarne un Eduard Bernstein (en France, Jaurès) fascine moins Sternhell que le révisionnisme de "gauche" (p.290), mouvement amorcé par Sorel et les syndicalistes révolutionnaires qui refusaient les "ramollissements" du socialisme et passèrent ultérieurement au fascisme. Sternhell s'intéresse en particulier à un nouveau courant socialiste d'alors qui, dépassant l'opposition Sorel/Bernstein, vit le jour au lendemain de la Grande Guerre: le révisionnisme "planiste" ou "technocratique" (p.36) du socialiste belge Henri De Man et du néo-socialiste français Marcel Déat. Ce révisionnisme-là aboutit directement au fascisme.
1.4. Sternhell contre le fascisme de salon. L'orientation "socialiste", qui sous-tend l'étude de Sternhell sur la problématique du fascisme, se traduit par le peu d'intérêt marqué pour les formes de fascismes philosophiques ou littéraires. Trait caractéristique: Sternhell ne mentionne nulle part les deux écrivains les plus importants appartenant au fascisme, Céline et Rebatet. Et Sternhell néglige encore d'autres aspects du fascisme de salon, du fascisme des penseurs "qui finissent leur vie en habit vert" (p.22). Vu les multiples facettes du fascisme français (et européen)(p.21), Sternhell s'adjuge le droit de poser une analyse pars pro toto: il prétend se consacrer en ordre principal à l'étude de secteurs négligés jusqu'ici (p.9).
2. La France, modèle du fascisme?
2.1. Pourquoi la France? Le livre de Sternhell veut développer une définition du "fascisme" en se basant sur l'exemple français. Cette intention peut étonner. La France, en effet, si l'on excepte l'intermède de l'occupation allemande, n'a jamais connu un régime qualifiable de "fasciste". L'Italie, l'Allemagne voire l'Espagne seraient à cet égard de meilleurs exemples. Mais Sternhell, nous allons le voir, déploie de très sérieux arguments pour justifier son choix.
2.2. Les études antérieures de Sternhell. Ces arguments, pour nous, ne sauraient se déduire des travaux antérieurs de Sternhell, qui portaient tous sur la France. Dès le départ, il orienta son attention vers le fascisme, même s'il l'on peut supposer qu'un changement de perspective aurait pu se produire et lui faire choisir un autre territoire de recherches. Ce que Sternhell découvrit très tôt dans ces secteurs délaissés par la recherche qu'il se trouvait sur la bonne voie. Deux livres aussi copieux avait précédé Ni gauche ni droite. Le premier s'intitulait Maurice Barrès et le nationalisme français (1972). Le second, La droite révolutionnaire 1885-1914. Les origines françaises du fascisme (1978), traitait de la même époque historique, mais le grand thème de Sternhell, le fascisme, apparaissait pour la première fois dans le sous-titre. La recherche a imméditament considéré ces deux ouvrages comme des classiques. Les sujets de ces livres sont à la fois plus sectoriels et plus généraux que la thématique du troisième, que nous commentons ici. Dans Ni gauche ni droite, Sternhell cherche à forger un classification globale et détaillée du phénomène fasciste qu'il entend maîtriser conceptuellement.
2.3. La France a inventé le fascisme. Le premier argument de Sternhell, pour situer le champ de ses recherches en France, c'est que ce pays a vu naître le fascisme vingt ans avant les autres, notamment vers 1885 (p.41). Sternhell n'emploie qu'occasionnelle- ment le terme de "pré-fascisme" pour qualifier les événements entre 1885 et 1914 (p.21). Une figure comme celle de Maurice Barrès portait déjà en elle les germes de tout le fascisme ultérieur. Et quand j'ai énoncer la même hypothèse en 1958, je me suis heurté à une surprenante incompréhension de la part des experts français...
2.4. La France comme contre-modèle. Le second argument qu'avance Sternhell est plus complexe. Il contourne deux écueils. Parmi les grands pays de l'Europe continentale, la France est celui où la position dominante de l'idéologie et de la praxis politique du libéralisme a été la moins menacée, du moins jusqu'à la défaite militaire de 1940 (p.41). Sternhell souligne (p.42) le fait que la révolution libérale la plus importante et la plus exemplaire de l'histoire s'est déroulée dans ce pays et attire notre attention sur les phénomènes du "consensus républicain" (p.43) et du "consensus centriste" (p.52) qui sont les clés de voûte de l'histoire française contemporaine. C'est précisément à cause de ces inébranlables consensus que Sternhell opte pour la France comme champ d'investigation. Car le fascisme, en France, n'est jamais parvenu au pouvoir (p.293) et, écrit Sternhell, "le fascisme n'y a jamais dépassé le stade de la théorie et n'a jamais souffert des compromissions inévitables qui faussent toujours d'une façon ou d'une autre l'idéologie officielle d'un régime. Ainsi on pénètre sa signification profonde et, en saisissant l'idéologie fasciste à ses origines, dans son processus d'incubation, on aboutit à une perception plus fidèle des mentalités et des comportements. Et on comprend mieux, semble-t-il, la complexité des situations et l'ambiguïté des attitudes qui font le tissu des années trente". C'est là, de toute évidence, un principe heuristique, dérivé d'une option radicalement gramsciste qui pose le primat des idées et réfute celui des contraintes factuelles.
3. Les problèmes de "périodisation"
3.1. Impossibilité de poser des datations exactes. Comme doit le faire tout véritable historien, Sternhell fait varier légèrement les dates. Mis à part pour les événements ponctuels, il n'est pas aisé de fournir des dates précises, bien délimitées dans le temps, pour désigner l'émergeance ou l'assomption d'un courant d'idées politiques. C'est pourquoi Sternhell examine le phénomène "fasciste" dans l'espace d'un demi-siècle.
3.2. Continuité entre 1885 et 1940. Fait essentiel pour Sternhell: cette période est "dans l'histoire de l'Europe, une période véritablement révolutionnai- re". Et il poursuit: "En moins d'un demi-siècle, les réalités sociales, le mode de vie, le niveau technologique et, à beaucoup d'égards, la vision que se font les hommes d'eux-mêmes changent plus profondément qu'à aucun autre moment de l'histoire moderne" (p.45). Dès lors, cette période forme une unité, si toutefois l'on met entre parenthèses les quatre années de la Grande Guerre (pp.19 et 290). Et Sternhell l'écrit expressément: "Au cours de ce demi-siècle, les problèmes de fond n'ont guère varié" (p.60).
3.3. Trois générations. Bien qu'il soit conscient de cette continuité, Sternhell procède cenpendant à des subdivisions dans le temps; ainsi, par exemple, quand il parle des "fascistes de 1913" comme des fascistes d'un type particulier. Il distingue trois générations de fascistes (cf. pp. 30, 52 et 60): d'abord les boulangistes et les anti-dreyfusards de la fin des années 80; ensuite, avant 1914, ceux de la "deuxième génération", celle du mouvement des "Jaunes" dans le monde ouvrier et de l'Action Française de Maurras, qui atteint alors son apogée; en finale, il évoque, comme troisième génération, le "fascisme d'après-guerre".
3.4. Le poids d'une époque. Il est à remarquer que Sternhell accorde nettement plus de poids aux premières décennies de l'époque qu'il étudie. Pour lui, sur le plan qualitatif, les années qui précèdent la Grande Guerre revêtent davantage d'importance que les décennies qui les suivirent car, dans cette avant-guerre, tout ce qui est essentiel dans l'élaboration du fascisme doctrinal a été dit et mis en œuvre.
4. Prolégomènes du fascisme
4.1. Refus de prendre en considération les groupuscules excentriques. Sternhell s'intéresse aux "propagateurs d'idées". Il ne ressent aucune envie de perdre son temps à étudier ce fascisme folklorique de quelques illuminés qui jouent aux brigands, fascisme caricatural dont les médias font leurs choux gras. Il n'a que mépris pour ceux qui axent leurs recherches sur ce type de phénomènes marginaux (p.9): "A l'époque déjà, quand un groupe de la Solidarité française se fait photographier à l'entraînement au pistolet, toute la presse de gauche en parle pendant des semaines: un quelconque défilé de quelques dizaines de "chemises bleues" soulève alors beaucoup plus d'intérêt que le patient travail de sape d'un Thierry Maulnier ou d'un Bertrand de Jouvenel...".
4.2. Le fascisme, une idéologie comme les autres. Sternhell parle de la "banalité du fascisme" (p.296): "Dans les années trente, le fascisme constitue une idéologie politique comme les autres, une option politique légitime, un état d'esprit assez courant, bien au-delà des cercles restreints qui assument leur identité fasciste...". Selon Sternhell, le fascisme était "un phénomène possédant un degré propre d'autonomie, d'indépendance intellectuelle" (p.16). Il s'élève contre "le refus fondamental de voir dans le fascisme autre chose qu'un accident de l'histoire européenne" (p.18). Pour Sternhell donc, c'est une erreur de ne considérer le fascisme que comme "une simple aberration, un accident, sinon un accès de folie collective..." (p.18). A la fin de son ouvrage (p.296), Sternhell nous met en garde contre ceux qui propagent l'opinion que les fascistes n'étaient que des "marginaux". Nombreux sont les "fascistes" qui ont été jugés, par leurs contemporains, comme les "plus brillants représentants de leur génération" (Luchaire, Bergery, Marion, de Jouvenel).
4.3. Les courroies de transmission. "L'idéologie fasciste constitue, en France, un phénomène de loin plus diffus que le cadre restreint et finalement peu important des adhérents aux groupuscules qui s'affublent de ce titre" (p.310). Deux pages plus loin, Sternhell explique comment il s'est fait que "l'idée fasciste" ait pu se propager dans un milieu si prêt à recevoir son message: "Les fascistes purs furent toujours peu nombreux et leurs forces dispersées. Leur influence véritable s'exercera par une contribution continue à la cristallisation d'un certain climat intellectuel; par le jeu des courroies de transmissions secondaires: des hommes, des mouvements, des revues, des cercles d'études,..." (p.312).
4.4. Difficulté de situer sociologiquement le fascisme. Sternhell insiste sur le fait que le fascisme "prolifère aussi bien dans les grands centres industriels de l'Europe occidentale que dans les pays sous-développés d'Europe de l'Est" (p.17). Et il aime se moquer de ceux qui croient pouvoir ranger le fascisme dans des catégories sociales bien déterminées. Il est significatif que Sternhell attire notre attention sur une constante de l'histoire des fascismes: "le glissement à droite d'éléments socialement avancés mais fondamentalement opposés à la démocratie libérale" (p.29). Si cette remarque se vérifie, elle s'opposera à toutes les tentatives de rattacher l'idéologie fasciste à des groupes sociaux trop bien définis.
4.5. Pour expliquer le fascisme: ni crises économiques ni guerres. Ce qui m'a frappé aussi chez Sternhell, c'est l'insistance qu'il met à montrer la relative indépendance du fascisme vis-à-vis de la conjoncture (pp.18 et 290). Il ne croit pas que la naissance du fascisme soit due à la pression de crises économiques et, assez étonnamment, estime que la première Guerre mondiale (ou tout autre conflit) a eu peu d'influence sur l'émergence du phénomène. En ce sens, Sternhell s'oppose à la majorité des experts ès-fascisme (pp.96 et 101). C'est dans cette thèse, précisément, que se manifeste clairement l'option "gramsciste" de Sternhell, nonobstant le fait que jamais le nom de Gramsci n'apparaît dans l'œuvre du professeur israëlien. Sternhell ne prend les "crises" au sérieux que lorsqu'il s'agit de crises morales, de crises des valeurs ou de crise globale, affectant une civilisation dans son ensemble.
4.6. "Auschwitz" en tant qu'argument-massue n'apparaît nulle part. Sternhell fait preuve d'une étonnante objectivité, ce qui est particulièrement rare dans les études sur le fascisme. Mais une telle attitude semble apparemment plus facile à adopter en Israël qu'à New York ou à Zurich. Ainsi, Sternhell n'hésite pas à reconnaître au fascisme "une certaine fraîcheur contestataire, une certaine saveur de jeunesse" (p.80). Il renonce à toute pédagogie moralisatrice. Mais il est très conscient du "problème de la mémoire", mémoire réprimée et refoulée; il l'évoquera notamment à propos de certaines figures au passé fasciste ou fascisant qui, après 1945, ont opté pour la réinsertion en se faisant les porte-paroles du libéralisme: Bertrand de Jouvenel (p.11), Thierry Maulnier (p.12) et surtout le philosophe du personnalisme, fondateur de la revue Esprit , Emmanuel Mounier (pp 299 à 310).
5. La formule du fascisme chez Sternhell
5.1. Les carences du libéralisme et du marxisme. Après cette introduction, nous sommes désormais en mesure d'expliciter l'alchimie du fascisme selon Sternhell. Pour cet historien israëlien, le fascisme s'explique en fonction d'un préliminaire historique, sans lequel il serait incompréhensible: l'incapacité du libéralisme bourgeois et du marxisme à assumer les tâches imposées par le XXème siècle.Cette incapacité constitue une carence globale, affectant toute notre civilisation, notamment toutes les institutions, les idéologies, les convictions qu'elle doit au XVIIIème, siècle du rationalisme et du mécanicisme bourgeois. Libéralisme et marxisme sont pour Sternhell les deux faces d'une même médaille. Inlassablement, il souligne que la crise de l'ordre libéral a précédé le fascisme, que cette crise a créé un vide où le fascisme a pu se constituer. Fallait-il nécessairement que ce fascisme advienne? Sternhell ne se prononce pas, mais toute sa démonstration suggère que cette nécessité était inéluctable.
5.2. Révisionnistes de gauche et nationalistes déçus. Généralement, pour expliquer la naissance du fascisme, on évoque la présence préalable d'un nationalisme particulièrement radical et exacerbé. Sternhell, lui, trouve cette explication absurde. D'après le modèle explicatif qu'il nous suggère, l'origine du fascisme s'explique bien davantage par le fait qu'aux extrémités, tant à gauche qu'à droite, du spectre politique, des éléments se sont détachés pour se retrouver en dehors de ce spectre et former un troisième et nouvel élément qui n'est plus ni de gauche ni de droite. Dans la genèse du fascisme, Sternhell n'aperçoit aucun apport appréciable en provenance du centre libéral. D'après lui, le fascisme résulte de la collusion de radicaux de gauche, qui n'admettent pas les compromis des modérés de leur univers politique avec le centre mou libéral, et de radicaux de droite. Le fascisme est, par suite, un amalgame de désillusionnés de gauche et de désillusionnés de droite, de "révisionnistes" de gauche et de droite. Ce qui paraît important aux yeux de Sternhell, c'est que le fascisme se situe hors du réseau traditionnel gauche/centre/droite. Dans l'optique des fascistes, le capitalisme libéral et le socialisme marxiste ne s'affrontent qu'en apparence. En réalité, ils sont les deux faces d'une même médaille. L'opposition entre la "gauche" et la "droite" doit disparaître, afin qu'hommes de gauche et hommes de droite ne soient plus exploités comme chiens de garde des intérêts de la bourgeoisie libérale (p.33). C'est pourquoi la fin du XIXème siècle voit apparaître de plus en plus de notions apparemment paradoxales qui indiquent une fusion des oppositions en vigueur jusqu'alors. L'exemple le plus connu de cette fusion est la formule interchangeable: nationalisme social / socialisme national. Sternhell (p.291) insiste sur la volonté d'aller "au-delà", comme caractéristique du climat fasciste. Le terme "au-delà" se retrouve dans les titres de nombreux manifestes fascistes ou préfascistes: "Au-delà du nationalisme" (Thierry Maulnier), "Au-delà du marxisme" (Henri De Man), "Au-delà du capitalisme et du socialisme" (Arturo Labriola), "Au-delà de la démocratie" (Hubert Lagardelle). Ce dernier titre nous rappelle que le concept de "démocratie" recouvrait le concept de "libéralisme" jusque tard dans le XXème siècle. Chez Sternhell également, le concept de "capitalisme libéral" alterne avec "démocratie capitaliste" (p.27).
5.3. L'anti-ploutocratisme. L'homme de gauche qu'est Sternhell prend les manifestations sociales-révolutionnaires du fascisme plus au sérieux que la plupart des autres analystes, historiens et sociologues de son camp. Si Sternhell avait entrepris une étude plus poussée des courants philosophiques et littéraires de la fin du XIXème, il aurait découvert que la haine envers la "domination de l'argent", envers la ploutocratie, participait d'un vaste courant à l'époque, courant qui débordait largement le camp socialiste. Cette répulsion à l'encontre de la ploutocratie a été, bien sûr, un ferment très actif dans la gestation du fascisme. De nombreux groupes fascistes s'aperçurent que l'antisémitisme constituait une vulgarisation de cette répugnance, apte à ébranler les masses. L'antisémitisme, ainsi, offrait la possibilité de fusionner le double front fasciste, dirigé simultanément contre le libéralisme bourgeois et le socialisme marxiste, en une unique représentation de l'ennemi. Parallèlement, cette hostilité envers la ploutocratie pré-programmait très naturellement le conflit qui allait opposer fascistes et conservateurs.
5.4. La longue lutte entre conservateurs et fascistes. Vu la définition du fascisme qu'esquisse Sternhell, il n'est guère étonnant qu'il parle d'une "longue lutte entre la droite et le fascisme" (p.20) comme d'une caractéristique bien distincte, quoiqu'aujourd'hui méconnue, de l'époque et des situations qu'il décrit. Et il remarque: "Il en est d'ailleurs ainsi partout en Europe: les fascistes ne parviennent jamais à ébranler véritablement les assises de l'ordre bourgeois. A Paris comme à Vichy, à Rome comme à Vienne, à Bucarest, à Londres, à Oslo ou à Madrid, les conservateurs savent parfaitement bien ce qui les sépare des fascistes et ils ne sont pas dupes d'une propagande visant à les assimiler" (p.20). Aussi Sternhell s'oppose-t-il (p.40) clairement à la classification conventionnelle de la droite française, opérée par René Rémond, qui l'avait répartie en trois camps: les ultras, les libéraux-conservateurs et les bonapartistes. Il n'y a, en fait, jamais eu que deux camps de droite, les libéraux et les conservateurs, auxquels se sont opposés les révolutionnaires, les dissidents et les contestataires.
5.5. A la fois révolutionnaires et modernes. Avec ces deux termes, utilisés par Sternhell pour désigner le fascisme, l'historien israëlien a choqué ses collègues politologues. Pour lui, en effet, le fascisme est un phénomène réellement révolutionnaire et résolument moderne. "Une idéologie conçue comme l'antithèse du libéralisme et de l'individualisme est une idéologie révolutionnaire". Plus loin (p.35), Sternhell expose l'idée, d'après lui typiquement fasciste, selon laquelle le facteur révolutionnaire qui, en finale, annihile la démocratie libérale est non pas le prolétariat, mais la nation. Et il ajoute: "C'est ainsi que la nation devient l'agent privilégié de la révolution" (p.35). Les passages évoquant le modernisme du fascisme sont tout aussi surprenants. A propos d'un de ces passages (p.294), on pourrait remarquer que cette attribution de modernisme ne concerne que les fascismes italien et français:"Car le fascisme possède un côté moderniste très développé qui contribue à creuser le fossé avec le vieux monde conservateur. Un poème de Marinetti, une œuvre de Le Corbusier sont immédiatement adoptés par les fascistes, car, mieux qu'une dissertation littéraire, ils symbolisent tout ce qui sépare l'avenir révolutionnaire du passé bourgeois". Un autre passage s'adresse clairement au fascisme dans son ensemble: "L'histoire du fascisme est donc à beaucoup d'égard l'histoire d'une volonté de modernisation, de rajeunissement et d'adaptation de systèmes et de théories politiques hérités du siècle précédent aux nécessités et impératifs du monde moderne. Conséquence d'une crise générale dont les symptômes apparaissent clairement dès la fin du siècle dernier, le fascisme se structure à travers toute l'Europe. Les fascistes sont tous parfaitement convaincus du caractère universel du courant qui les guide, et leur confiance dans l'avenir est dès lors inébranlable".
6. Eléments particuliers de l'idéologie fasciste
6.1. L'anti-matérialisme. Puisque, pour Zeev Sternhell, le fascisme n'est pas simplement le produit d'une mode politique, mais une doctrine, il va lui attribuer certains contenus intellectuels. Mais comme ces contenus intellectuels se retrouvent également en dehors du fascisme, ce qui constitue concrètement le fascisme, c'est une concentration d'éléments souvent très hétérogènes en une unité efficace. Citons les principaux éléments de cette synthèse. Sternhelle met principalement l'accent sur l'anti-matérialisme (pp. 291 & 293): "Cette idéologie constitue avant tout un refus du matérialisme, c'est-à-dire de l'essentiel de l'héritage intellectuel sur lequel vit l'Europe depuis le XVIIème siècle. C'est bien cette révolte contre le matérialisme qui permet la convergence du nationalisme antilibéral et antibourgeois et de cette variante du socialisme qui, tout en rejetant le marxisme, reste révolutionnaire...Tout anti-matérialisme n'est pas fascisme, mais le fascisme constitue une variété d'anti-matérialisme et canalise tous les courants essentiels de l'anti-matérialisme du XXème siècle...". Sternhell cite également les autres éléments de l'héritage auquel s'oppose le fascisme: le rationalisme, l'individualisme, l'utilitarisme, le positivisme (p.40). Cette opposition indique que cet anti-matérialisme est dirigé contre toute hypothèse qui voudrait que l'homme soit conditionné par des données économiques. C'est quand Sternhell parle de la psychologie que l'on aperçoit le plus clairement cette opposition. Ainsi, il relève (p. 294) que les "moralistes" Sorel, Berth et Michels "rejettent le matérialisme historique qu'ils remplacent par une explication d'ordre psychologique". "Finalement", poursuit Sternhell, "ils aboutissent à un socialisme dont les rapports avec le prolétariat cessent d'être essentiels".Et il insiste: "Le socialisme commence ainsi, dès le début du siècle, à s'élargir pour devenir un socialisme pour tous, un socialisme pour la collectivité dans son ensemble,..." (p. 295). Plus explicite encore est un passage relatif au révisionnisme de Henri De Man, qui, lui, cherche la cause première de la lutte des classes "moins dans des oppositions d'ordre économique que dans des oppositions d'ordre psychologique".
6.2. Les déterminations. Il serait pourtant faux d'affirmer que, pour le fascisme, l'homme ne subit aucune espèce de détermination. Pour les intellectuels fascistes, ces déterminations ne sont tout simplement pas de nature "mécanique"; entendons par là, de nature "économique". Comme l'indique Sternhell, le fasciste ne considère pas l'homme comme un individu isolé, mais comme un être soumis à des contraintes d'ordres historique, psychologique et biologique. De là, la vision fasciste de la nation et du socialisme. La nation ne peut dès lors qu'être comprise comme "la grande force montante, dans toutes ses classes rassemblées" (p. 32). Quant au socialisme, le fasciste ne peut se le représenter que comme un "socialisme pour tous", un "socialisme éternel", un "socialisme pédagogique", un "socialisme de toujours", bref un socialisme qui ne se trouve plus lié à une structure sociale déterminée (Cf. pp. 32 & 295).
6.3. Le pessimisme. Sternhell considère comme traits les plus caractéristiques du fascisme "sa vision de l'homme comme mu par des forces inconscientes, sa conception pessimiste de l'immuabilité de la nature humaine, facteurs qui mènent à une saisie statique de l'histoire: étant donné que les motivations psychologiques restent les mêmes, la conduite de l'homme ne se modifie jamais". Pour appuyer cette considération, Sternhell cite la définition du pessimisme selon Sorel: "cette doctrine sans laquelle rien de très haut ne s'est fait dans le monde" (p. 93). Cette définition rappelle en quoi consiste le véritable paradoxe de l'existentialité selon les conservateurs: la perception qu'a l'homme de ses limites ne le paralyse pas, mais l'incite à l'action. L'optimisme, au contraire, en surestimant les potentialités de l'homme, semble laisser celui-ci s'enfoncer sans cesse dans l'apathie.
6.4. Volontarisme et décadence. Sternhell, qui n'est pas philosophe mais historien, n'est nullement conscient de ce "paradoxe du conservateur". Il constate simplement la présence, dans les fascismes, d'une "énergie tendue" (p. 50) et signale sans cesse cette volonté fasciste de dominer le destin (pp. 65 & 294). Sternhell constate que le problème de la décadence inquiète le fasciste au plus haut point. C'est la raison pour laquelle celui-ci veut créer un "homme nouveau", un homme porteur des vertus classiques anti-bourgeoises, des vertus héroïques, un homme à l'énergie toujours en éveil, qui a le sens du devoir et du sacrifice. Le souci de la décadence aboutit à l'acceptation de la primauté de la communauté sur l'individu. La qualité suprême, pour un fasciste, c'est d'avoir la foi dans la force de la volonté, d'une volonté capable de donner forme au monde de la matière et de briser sa résistance. Sternhell se livre à de pareilles constatations jusqu'à la dernière ligne de son ouvrage; ainsi, à la page 312: "Dans un monde en détresse, le fascisme apparaît aisément comme une volonté héroïque de dominer, une fois encore, la matière, de dompter, par un déploiement d'énergie, non seulement les forces de la nature, mais aussi celles de l'économie et de la société".
6.5. La question de la vérité. D'une part, le pessimisme; d'autre part, le volontarisme. Pour une pensée logique, ce ne pourrait être là qu'un paradoxe. Mais le fascisme se pose-t-il la question de la vérité? Voyons ce que Sternhell déclare à propos de l'un des "pères fondateurs" du fascisme: "Pour un Barrès par exemple, il ne s'agit plus de savoir quelle doctrine est juste, mais quelle force permet d'agir et de vaincre" (p. 50). Comme preuve du fait que le fascisme ne juge pas une doctrine selon sa "vérité", mais selon son utilité, Sternhell cite Sorel au sujet des "mythes" qui, pour l'auteur des Réflexions sur la violence, constituent le moteur de toute action: "...les mythes sont des "systèmes d'images" que l'on ne peut décomposer en leurs éléments, qu'il faut prendre en bloc comme des forces historiques... Quand on se place sur le terrain des mythes, on est à l'abri de toute réfutation..." (pp. 93 & 94).
En résumé...
Nous n'avons pu recenser le livre de Sternhell que dans ses lignes fondamentales. Nous avons dû négliger bien des points importants, tels son allusion à la "nouvelle liturgie" comme partie intégrante du fascisme (p. 51), à son anti-américanisme latent (même avant 1914) (p. 290); nous n'avons pas approfondi sa remarque signalant que, pour le fascisme, la lutte contre le libéralisme intérieur a toujours été plus importante que la lutte menée contre celui-ci pas certains dictateurs... (p. 34). En tant que recenseur, je me permets deux remarques, pouvant s'avérer utiles pour le lecteur allemand. D'abord, l'Allemagne n'est que peu évoquée chez Sternhell. En fait de bibliographie allemande, il ne cite que les livres de Nolte traduits en français; on peut dès lors supposer qu'il ne maîtrise pas la langue de Goethe. Ma seconde remarquer sera de rappeler au lecteur allemand ma tentative de redonner une consistance au concept de "fascisme", en le limitant à un certain nombre de phénomènes historiques (Cf. Der faschistische Stil, 1973; trad.franç.: Le "style" fasciste, in Nouvelle Ecole, n°42, été 1985). Sternhell, pour sa part, a donné au terme "fascisme" une ampleur énorme. Son effort est justifiable, dans la mesure où sa vaste définition du "fascisme", au fond, correspond à ce que je désignais sous l'étiquette de "révolution conservatrice". Bref, on peut dire du livre de Sternhell qu'il a envoyé au rebut la plupart des travaux consacrés jusqu'ici à l'étude du fascisme...
Armin MOHLER.
(recension tirée de la revue Criticón, Munich, n°76, mars-avril 1983; traduction française d'Elfrieda Popelier).
00:05 Publié dans Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, sciences politiques, politologie, fascisme, france, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 29 août 2010
Jean Mabire: La maîtrise des mers
La maîtrise des mers
 L’Angleterre l’avait compris. La possession de colonies et la liaison avec l’Amérique supposent la maîtrise des mers, donc une puissante marine. Avec ses Normands, ses Bretons ou ses Basques, la France ne manquait pas de marins. Mais les marins ne font pas une marine.
L’Angleterre l’avait compris. La possession de colonies et la liaison avec l’Amérique supposent la maîtrise des mers, donc une puissante marine. Avec ses Normands, ses Bretons ou ses Basques, la France ne manquait pas de marins. Mais les marins ne font pas une marine.
La traversée de l’Atlantique pour rejoindre “les Amériques” fut longtemps une grande aventure. Les histoires de la marine, en privilégiant la Royale, c’est-à-dire la flotte de guerre, restent assez lacunaires – une fois passée la période des grandes explorations – sur les bâtiments armés pour le commerce ou la pêche. Pourtant l’épopée de Terre-Neuve est demeurée très présente dans l’imaginaire des gens de nos côtes jusqu’au début de ce siècle.
Pour se rendre outre-Atlantique, il fallait donc des bâtiments, des capitaines, des équipages.
Une fois les grandes lignes maritimes inaugurées, un mouvement continuel de navires devait amener sur les terres du Nouveau Monde des soldats, des missionnaires, des négociants et aussi des émigrants, hommes et femmes.
L’histoire océanique de la France américaine est étroitement liée à l’évolution de ce qu’on appellera un jour notre empire colonial, dont les possessions canadiennes ou acadiennes sont sans doute moins pittoresques que les multiples comptoirs antillais, avec leur arrière-plan de flibuste, de violence et de plaisirs.
L’époque des grandes explorations, qui va tant marquer le XVI siècle européen, voit la France occuper une place singulière. Elle arrive après les Espagnols, certes, mais elle précède les Britanniques et les Hollandais. Sur la façade maritime du royaume, de Dieppe à Bayonne, on retrouve les héritiers de ces populations dont la naissance et l’activité sont étroitement liées au monde maritime: au nord, les Normands qui n’ont jamais coupé tout à fait les liens avec les Vikings; en proue avancée du continent, les Bretons qui se souviennent d’être arrivés outre-Manche; ensuite, au-delà de la Loire, vers le sud, les Poitevins, qui furent à la fois gens de terre et gens de mer, navigateurs et colonisateurs; enfin les Basques qui, même dans leurs expéditions lointaines, gardent quelque chose de mystérieux toujours lié à leur énigmatique identité.
Mais il n’est pas de tradition navale sans construction navale. Une flotte, ce n’est pas seulement le désir de l’aventure, appel irrésistible vers quelque inconnu situé au-delà de l’horizon. C’est aussi et c’est d’abord un chantier naval.
La technique prime et impose sa loi. Les historiens expliquent avant tout l’épopée viking par ces longs serpents à proue et poupe identiques et dont les bordés sont assemblés “à clin”. Ce sera une révolution du même genre – en sens exactement contraire – qui va imposer, dès la fin du XV, siècle, le bordage “à carvel”.
 Quant au nombre de mâts, il passe d’un seul à deux et même, plus souvent, à trois. Un “château” à l’avant, un autre à l’arrière. Entre les deux, s’étagent les ponts où l’on trouve parfois des canons. La voilure se complique. On commence à jouer habilement d’une garde-robe fournie où voiles triangulaires et voiles carrées s’harmonisent pour régler l’allure de navires auxquels on demande, autant que possible, de remonter au vent, même si cela tient encore de l’acrobatie.
Quant au nombre de mâts, il passe d’un seul à deux et même, plus souvent, à trois. Un “château” à l’avant, un autre à l’arrière. Entre les deux, s’étagent les ponts où l’on trouve parfois des canons. La voilure se complique. On commence à jouer habilement d’une garde-robe fournie où voiles triangulaires et voiles carrées s’harmonisent pour régler l’allure de navires auxquels on demande, autant que possible, de remonter au vent, même si cela tient encore de l’acrobatie.
Ces navires du XVIe siècle, à l’heure des grandes navigations transocéaniques sont encore de petite taille. Armés pour la guerre, le commerce ou la pêche, ils ne dépassent guère une centaine de tonneaux. Peu à peu, ce tonnage va monter en puissance. On verra même au Havre-de-Grâce, fondé par François Ier à l’embouchure de la Seine, des vaisseaux de mille tonneaux et même davantage.
En remontant la Seine, on arrive à Rouen et on découvre, sur les berges du grand fleuve, un des plus singuliers hauts-lieux de la technique marine: le “Clos des galées” , chantier de construction à l’inlassable activité. Il s’agit de construire les bâtiments qui partiront des ports voisins de Fécamp ou de Honfleur pour tenter l’aventure au Nouveau Monde.
Quelques hectares de bois pour construire un navire
Les Bretons, bien entendu, ne sont pas en reste sur les Normands. Mais ils construisent et utilisent des bâtiments d’une taille généralement inférieure à ceux de leurs voisins d’outre-Couesnon. Ces navires y gagnent en maniabilité et un plus faible tirant d’eau va leur permettre de remonter profondément les fleuves américains sans crainte d’échouage. Après viendra l’emploi des canots, sur le modèle des légères embarcations indigènes.
Un chantier ce n’est pas seulement des scieries qui débitent les troncs abattus dans la région ou venus des pays du Nord, ce sont aussi des voileries, des corderies, des entrepôts, des magasins. A Rouen, le fameux Clos occupe toute une partie des berges de la Seine. En Bretagne, les chantiers se dispersent, au hasard des abers, en de petites entreprises vivantes et familiales où la tradition s’accompagne de ces multiples initiatives auxquelles se reconnaît la main du maître charpentier.
Tout cela coûte cher. D’où l’importance des armateurs qui constituent de véritables dynasties et qu’on verra, les poches pleines, s’intéresser à la course… comme au commerce du “bois d’ébène”.
Les écoles d’hydrographie, à commencer par celle de Dieppe, où enseigne le fameux abbé astronome Descellers, forment les pilotes à la navigation hauturière. La science de la navigation ne fait que s’affiner et arrive en renfort d’un sens marin que rien ne saurait remplacer. Du grand explorateur au moindre patron de pêche qui ose affronter l’océan, la qualité des maîtres des navires s’affirme.
Encore faut-il des équipages pour mener leurs bâtiments. Le recrutement obéit à certaines règles, souvent empiriques. Ainsi l’historien Philippe Bonnichon précise: “Un homme par tonneau, c’est un ordre de grandeur, variable du simple à la moitié et loin d’être une règle fixe. Mousses et novices embarquent jeunes, souvent avec des parents, pour se former, devenir mariniers et servir jusqu’à la cinquantaine. Communautés de famille et de paroisse se retrouvent à bord et, de retour, travaillent la terre après avoir bourlingué. Les salaires sont peu élevés, proportionnels à la compétence technique”.
Malgré les expéditions des Normands, des Bretons, des Poitevins ou des Basques, le royaume de France n’en reste pas moins une puissance terrienne, peu tournée vers la mer, malgré l’extraordinaire variété de ses côtes. C’est un handicap qui ne va guère cesser tout au long de son histoire.
La liaison avec l’Amérique suppose ce qu’on nommera un jour “la maîtrise des mers”. Faute d’être soutenues par une imposante flotte de guerre, bien des aventures coloniales sont vouées au dépérissement et à l’échec.
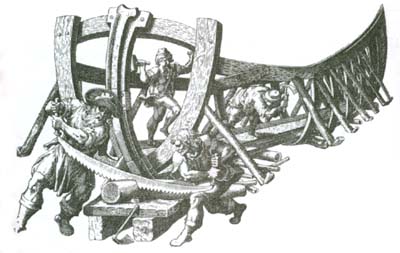
- Construction d’un navire pour la navigation en haute mer au XVIe siècle
Finalement, les périodes favorables aux entreprises maritimes d’envergure sont rares. On cite la première moitié du XVIe siècle, la première moitié du règne de Louis XIV, la fin du règne de Louis XV et le règne de Louis XVI.
Faute de soutien de l’État, les entreprises lointaines sont souvent individuelles ou pour le moins privées. D’où le rôle des fameuses “compagnies”. Mais que peut le commerce seul sans le renfort de la Royale et de ses canons?
Ce royaume qui tourne le dos à la mer et a toujours considéré comme “étrangers” les peuples maritimes qu’il devait subjuguer, à commencer par les Normands et les Bretons, eut la chance de posséder quelques grands hommes d’État qui comprirent que les rivages du nord-ouest de l’Hexagone n’étaient pas des limites mais au contraire des aires d’envol d’où allaient partir caravelles et vaisseaux. Trois grands noms: Richelieu, Colbert et Choiseul.
Au lendemain des guerres de religion, une patrie réconciliée pouvait renaître outre-mer. Sur la terre d’Amérique, la Nouvelle-France devenait plus vaste et plus jeune que celle du Vieux Monde. Ainsi vit-on les étendards fleur de lysés battre au Canada et en Acadie, aux Antilles ou en Guyane.
Techniciens dieppois, malouins et olonnais
Les grands ministres qui furent, de leur bureau continental, de véritables “seigneurs de la mer” n’hésitèrent pas à s’inspirer des expériences septentrionales en matière de construction navale. Des ingénieurs et des ouvriers furent même recrutés en Hollande et au Danemark, en Courlande ou en Suède.
Ces remarquables techniciens, aidés par le vieux savoir-faire des Dieppois, des Malouins ou des Olonnais amenèrent le bâtiment de ligne à une quasi-perfection technique. On n’avait pas vu une telle science nautique depuis les “esnèques” scandinaves du Haut Moyen Age!
Claude Farrère, qui fut aussi bon historien de la mer qu’il fut bon romancier, a laissé une belle description de la construction d’un vaisseau aux temps les plus splendides de la marine à voile.
“Un vaisseau, au temps de Louis XIV, est d’ores et déjà l’un des chefs-d’œuvre de l’industrie humaine. Voyons un peu ce qu’est un vaisseau. Cela peut mesurer quelque soixante ou soixante-dix mètres de long, sur quinze ou vingt mètres de large. Cela déplace de mille à cinq mille tonneaux. La coque comporte une quille, laquelle joint l’étrave à l’étambot, c’est-à-dire la proue à la poupe, -puis des couples, c’est-à-dire de robustes côtes taillées en plein cœur de chêne, et courbées comme il faut; ces couples prennent appui de part et d’autre sur cette façon d’épine dorsale qu’est la quille, et montent du plus profond de la bâtisse jusqu’au plus haut, jusqu’au tillac, dit aussi pont des gaillards. Une charpente horizontale, – les lisses, des préceintes, doublées d’un bordé, qu’on assemble à clins ou à franc-bord, – lie les couples entre eux. Et les ponts et les faux-ponts, régnant de tribord à bâbord, et d’arrière en avant, achèvent la solidité merveilleuse de l’ensemble. Au-dessus de la flottaison, deux ou trois entreponts s’étagent vers les gaillards, – gaillard d’avant ou château, gaillard d’arrière ou dunette. Ces entreponts vont du faux-pont, qui est juste au-dessous des gaillards. Et, plus haut, il n’y a que les mâts”.
Quatre mâts. Trois verticaux, l’artimon, le grand mât, la misaine. Un quatrième oblique, le beaupré, à l’avant. Deux de ces mâts, le grand mât et le mât de misaine, servent principalement à la propulsion. Les deux autres, beaupré et artimon, principalement à l’orientation du navire, ce pourquoi chaque mât porte des vergues, et chaque vergue sa voile. Le tout fait une montagne de toile blanche, haute de soixante mètres environ, chaque basse voile étant large d’au moins vingt-cinq. Rien de plus majestueux qu’un vaisseau de l’ancienne marine sous ses voiles.
Ce qui va le plus manquer à la marine royale – qu’elle soit de guerre ou de commerce – c’est la persévérance. Certes, au temps des grandes compagnies maritimes, les Français porteront leur flotte marchande de trois cents à mille vaisseaux. Mais les Britanniques vont en aligner quatre mille et les Hollandais seize mille! Dans cette disproportion se trouve déjà inscrite la perte de la plupart des possessions américaines, malgré les exploits des capitaines corsaires ou des flibustiers.
Il n’est pas d’empire sans maîtrise des mers. L’infortuné Louis XVI devait le comprendre, alors que tout était déjà joué depuis le funeste traité de 1763 – dont certains ont voulu faire une date aussi significative que celle de 1789.
Claude Farrère devait parfaitement tirer la leçon de près de trois siècles d’aventure navale à la française, une histoire en tragiques dents de scie, où l’héroïsme des équipages n’a que rarement compensé l’impéritie des gouvernants.
“C’est une criminelle erreur d’avoir cru qu’on peut avoir des colonies en négligeant d’avoir une marine”.
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean mabire, mers, thalassocratie, océans, marine, puissance maritime, histoire, atlantique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 24 août 2010
Cola di Rienzi & the Politics of Proto-Fascism
Cola di Rienzi & the Politics of Proto-Fascism
 A young Italian nationalist leads his followers on a march through Rome, seizing power from corrupt elites to establish a palingenetic regime. Declaring himself Tribune, his ultimate aim is to recreate the power and glory of Ancient Rome. However, a conspiracy of his enemies topples him from power, and he is imprisoned. Eventually, the most powerful man in the West frees him and restores him to power — albeit as leader of a puppet regime. His second attempt at Italian rebirth is cut short; he is captured, killed, and his body desecrated by the howling mob. A man who had attempted to drive his degenerate countrymen to fulfill a higher destiny is cut down by the unthinking masses — a cowardly herd who lacked the ability to comprehend, much less work towards, this leader’s dreams of glory.
A young Italian nationalist leads his followers on a march through Rome, seizing power from corrupt elites to establish a palingenetic regime. Declaring himself Tribune, his ultimate aim is to recreate the power and glory of Ancient Rome. However, a conspiracy of his enemies topples him from power, and he is imprisoned. Eventually, the most powerful man in the West frees him and restores him to power — albeit as leader of a puppet regime. His second attempt at Italian rebirth is cut short; he is captured, killed, and his body desecrated by the howling mob. A man who had attempted to drive his degenerate countrymen to fulfill a higher destiny is cut down by the unthinking masses — a cowardly herd who lacked the ability to comprehend, much less work towards, this leader’s dreams of glory.
Is this the life of Benito Mussolini, Duce of Fascist Italy? Well, perhaps — but even more accurately it is a description of Il Duce’s predecessor, the Roman notary Cola di Rienzi. In the mid-fourteenth century, 900 years after the Fall of Rome, di Rienzi engaged in a romantic and ill-fated attempt to restore the Roman Republic and, perhaps, the Empire itself. Musto’s book tells us what happened. To those familiar with the life of Mussolini, di Rienzi’s tale is shocking in its similarities — shocking and depressing.
The life of Cola di Rienzi — referred to by Musto as Cola di Rienzo — is well known to historians of the Middle Ages, and was, at one time, well known to Italians in general. But in the twentieth century he was eclipsed by Mussolini, who still symbolizes Roman and Italian renewal in many minds. The self-hating Italian Luigi Barzini did di Rienzi no favors in his book The Italians. Thus, Musto’s sympathetic and well-written biography of di Rienzi is long overdo, and is an excellent addition to the library of any individual interested in European history. Of interest for this essay is the relationship of di Rienzi to fascism and the role played by the church and selfish elites in the downfall of di Rienzi and in the humiliating history of modern Italy.
Roger Griffin (Fascism, Oxford University Press, 1995) famously described fascism as “palingenetic populist ultra-nationalism” — making the elements of renewal, rebirth, and regeneration central to all permutations of this ideology. That Cola di Rienzi was a proto-fascist is quite clear. He was a populist leader, appealing to the middle class against established elites, intent on the regeneration and rebirth of Rome, Italy, and, by example, the world.
That he couched this agenda in highly religious Christian terms is to be expected for the time and place — in fourteenth century Italy he could not do otherwise — and in no way detracts from the fascistic palingenetic tone of his rhetoric and actions. After all, perhaps the “most fascist” of all the twentieth-century fascisms — Romania’s Legionary movement — was devoutly Christian and made spiritual/moral regeneration the palingenetic focus of their ideology. Thus, there is no obvious reason not to see “Rienzism” as a sort of fourteenth century fascism.
Indeed, as Musto describes di Rienzi’s march through Rome (sound familiar?) to establish his buono stato (good state), we read the following : “. . . the people of Rome restored to their proper place, mingling among friends, neighbors, and strangers, all sharing the same sense of rebirth and renewal” (emphasis added). That sounds reasonably palingenetic to me; Cola di Rienzi as Tribune of Rome or Benito Mussolini as Duce of Italy — the similarities outweigh the differences.
That Cola di Rienzi is viewed by many as a generally positive figure who — for all his flaws — sincerely wanted the best for the people suggests that perhaps proto-fascism (or fascism, for that matter) is not the unalloyed evil that some make it out to be.
Musto states that di Rienzi was more of an artist than a politician in his actions and propaganda, which is completely consistent with the aesthetic nature of fascist movements (uniforms, ceremonies, rituals, art, etc.) of the twentieth century. Cola di Rienzi’s friend and admirer was the famed Petrarch, who recognized in the young Tribune the hope of Italy and the possibility of a new age, an age of rebirth and promise. Thus, a primary icon of fourteenth century Western culture was attracted to the sociopolitical and aesthetic characteristics of the Rienzian phenomenon.
Musto notes that di Rienzi spoke not only for the people of Rome but for all the people of “sacred Italy” to whom he wished to extend Roman citizenship. Musto describes in detail how, after spending time with Pope Clement VI — his eventual bitter enemy — di Rienzi returned to Rome to overthrow the feudal rule of the baronial families. These barons had turned the eternal city into a depopulated, anarchical, bloody, and violent mess, with the Roman people groaning under the self-interested misrule of the baronial elite.
Cola spent many months laying the groundwork for his revolution, engaging in various form of propaganda, including art as well as speech, until the day came when he and followers marched to seize power. Cola declared himself Tribune, ousted the barons, and began the formation of the so-called buono stato — a name which implies as much moral/spiritual renewal as much as it does plain good governance.
And di Rienzi did bring good governance; to use twentieth-century language he made the “trains run on time.” Establishing ties with other Italian cities, reaching out to the West as a whole, and supported by Petrarch, di Rienzi captured the attention not only of Europe but also instilled fear into the Islamic world, which saw the possibility of a resurgent Rome as the center of Western resistance to Asiatic expansion.
However, the Pope was not at all pleased with the rise of a secular power base in Rome to challenge the Church. As long as he perceived that di Rienzi would act as an effective mouthpiece to enforce Papal prerogatives against the barons, Clement supported the Tribune. But as soon as it became apparent that di Rienzi was his own man, with his own agenda, and that this agenda included a destiny for Rome and Italy that went beyond slavish subservience to the church, Clement decided that di Rienzi had to go.
Therefore, after months of intriguing against di Rienzi — even to the point of attempting to orchestrate food shortages to turn the Roman people against the Tribune — the Pope (the papacy at this time being self-exiled in France to protect themselves from their secular enemies) dropped the bombshell: on Dec. 3, 1347, Cola di Rienzi was condemned and excommunicated, and all who would support the Tribune were threatened with the same fate.
Indeed, if Rome still rallied behind di Rienzi, the entire city would have been under the Papal interdict; the entire city would have become a pariah in the Western, Christian world. In the fourteenth century, particularly fourteenth century Italy, excommunication was the worst sociopolitical fate for any leader, far worse than merely being labeled a “traitor” (which they called di Rienzi as well).
A whole list of crimes were put forth against the Tribune (including, absurdly, necromancy), and the Pope began to actively collaborate with the barons for the “final act” against the Rienzian regime. By this time, di Rienzi and the Roman people had decisively defeated the barons in the battle of Porta San Lorenzo. But it did not matter. In the year 1347, the Church, and the spiritual power of the Pope, was far more powerful than any army, any military victory. So, with the aid of the Pope, the barons rebelled and deposed di Rienzi, who was forced into exile.
Even then the Pope was not satisfied, remaining “fixated” on di Rienzi, scheming to have him captured and “annihilated.” Such was the hatred of this “Christian man of God” for the Tribune who wished to create regeneration for Romans and Italians. Could di Rienzi, in the fourteenth century, have said “Basta!” and defied the Church? Consider that Mussolini in the twentieth century could not do so, to his detriment. The secular power and ambitions of the Church was and remains a shackle on the aspirations of the Italian people.
Cola di Rienzi attempted to find sanctuary in Prague with the emperor Charles IV who eventually bowed to the overwhelming power of the papacy and turned di Rienzi over to the Inquisition for trial for “heresy.” Part of di Rienzi’s defense was his assertion — somewhat “outrageous” for the fourteenth century — that the church should have no secular power, since the founding basis for Christianity was “poverty and humility.” One can only imagine Pope Clements’s reaction to that.
Eventually brought before Pope Clement, di Rienzi was a shell of his former self, and the symbolism of this meeting cannot be dismissed. The populist and secular (yet devoutly religious) hope of Italy was brought as a humiliated prisoner before the man representing the memetic virus that has infected the West and enslaved the Italian people for centuries.
The worm turned after the death of Clement VI and the ascension of Pope Innocent VI, a less “worldly and extravagant” man than his predecessor. Innocent had, not surprisingly, secular aspirations in Rome and was therefore distressed by the violence and anarchy prevailing after the fall of di Rienzi and the rise, once again, of the baronial families. Therefore, Cola was “rehabilitated” and sent to Rome as a Papal puppet to restore his “good state” — but this time, as Innocent writes, without the “fantastic innovations” of the first Rienzian regime.
Of course, those “fantastic innovations” were merely the assertion of the Roman peoples’ right to rule themselves in a secular state independent of papal micromanagement, and that Rome and Italy were in dire need of regeneration and renewal. This was not exactly what the church wanted, or wants today. And so, a chastened Cola di Rienzi was put forward as Pope Innocent’s tool with the hope that the repeat of the Rienzian regime would not degenerate into farce. Rome not being what she once was, that hope was misplaced.
The ex-tribune (now “senator” and Papal rector) was painfully aware that the real leader of Rome was the Pope, not the Emperor, not any self-proclaimed Tribune. This is something that he had dedicated years to opposing. From the beginning of his second tenure of power — power only at the sufferance of the Pope — the established elites, particularly the barons, opposed and plotted against di Rienzi. The plots became complicated and di Rienzi, after years of imprisonment and hardship, and possibly suffering from epilepsy, was not the same man. Errors of judgment, executions of venerable Roman citizens, and the imposition of required taxes began to fray the support of the fickle Roman masses.
When the end came, at the instigation of the barons and their supporters, it came fast. The howling mob stormed di Rienzi’s residence and drowned out his attempts to reason with them. Cola di Rienzi was caught trying to flee the mob in disguise (like Mussolini); he was stabbed to death (like Caesar); his body was desecrated (like Mussolini again) then burnt to ashes (like Hitler). The ashes were thrown into the Tiber; all physical traces of the Tribune were gone.
The eerily similar lives and political careers of di Rienzi and Mussolini should give one pause. Both men were Italians living in a time of crisis for their people. Both men rose up to lead populist revolts against the established order. Both men established regimes which were initially successful and lauded by many, but then these regimes went sour and were overthrown by the forces of reaction. Both men were imprisoned thereafter. Both men then returned to power through the help of another, more powerful person — in the case of di Rienzi it was the Pope, in the case of Mussolini, Hitler. Both men then attempted to reestablish their regime, eventually failed, were killed by their enemies, and their bodies were desecrated by the mob. Both men attempted to lift the Italian people to greatness, but the special interests were too powerful and the lure of insipid, hedonistic stagnation too great.
The similarities are too many to be a coincidence. This then seems to be a distinctly Italian phenomenon. Who was at fault? Was it the fault of the two leaders themselves? Were they fatally flawed men? No doubt both men, particularly di Rienzi, had their flaws, and these flaws contributed to their failure and demise. But all great men have flaws. This easy explanation does not suffice.
I cannot forget reading Leon DeGrelle’s book on his experiences on the eastern front (translated as Campaign in Russia), fighting for Europe as part of the Wallonian division of the Waffen SS. The Italian soldiers he met were uninterested in fighting. They had no sense of the seriousness of the crusade against Bolshevism and for Europe. Instead, they cared only about “wine, women, and fun in the sun.” Nietzsche’s “last men” to be sure! (The rest of Europe has surely caught up with the Italians since then.) No wonder Italian military performance in WW II was a farce. No wonder that Italians have so long been the anvil of history, not the hammer, a fact lamented by great Italians from the middle ages to Machiavelli to Julius Evola to the present day.
But we cannot solely blame the Italians or focus on the personal flaws of di Rienzi and Mussolini. No, the 800 pound gorilla in the room is the Vatican.
An analysis of the career of di Rienzi clearly shows the pernicious influence of Pope Clement VI. Musto’s book makes it clear that Clement VI was little more than a self-interested feudal lord, more concerned with maintaining petty Papal power and privilege than in the national regeneration promised by di Rienzi. For example, on page 190 we read of the Pope’s real attitude toward di Rienzi’s new regime: “. . . the pope began carefully, delicately plotting Cola’s downfall and seeking his personal humiliation, as well as his public infamita as a traitor and a heretic.” In short, the church plotted to crush the political aspirations of the Italian people to keep them in secular servitude to the Vatican.
There is a long history of such behavior. Cola di Rienzi was not the first man to attempt Italian/Roman regeneration only to fall victim to the Vatican. As Musto tells us, in 1143, the people of Rome rose up against Pope Innocent II, drove the papacy into exile, re-established the Roman Senate, and even started minting coins in the name of “SPQR” — “The Senate and the People of Rome.” Arnold of Brescia, a monk and political philosopher, rose to lead the new republic and offered an intellectual rationale for the church’s renunciation of secular power. But in 1155, at the instigation of the papacy, the German Emperor Frederick I led an army against Rome to crush the republic and reinstall the pope. Arnold of Brescia was burned at the stake as a heretic and his ashes dumped into the Tiber. Yes, to preserve its power, the church turned to foreigners to suppress the political aspirations of the Romans.
The secular power of the church caused a “dual loyalty” problem that remains to this day. Is an Italian’s highest loyalty to Italy or to the Vatican? To di Rienzi and Mussolini or to the Pope? (Or, in Il Duce’s Italy, to the Pope as well as the secular figurehead, the King?) It is interested to contemplate how history might have been changed if the papacy had remained in Avignon, if the church had been disestablished and the papacy denied sovereign status once and for all after the reunification of Italy, or if Mussolini had not signed the Lateran Treaty of 1929, rescuing papal sovereignty from the legal limbo in which it had languished since 1861.
The other major party opposed to Cola di Rienzi were the barons of medieval Rome. As a self-interested elite, enriching themselves at the cost of the people’s well being, they are perfectly analogous to the white globalist elites of today, who routinely betray their race’s interests in their hedonistic pursuit of money, power, and pleasure.
The barons of di Rienzi’s time are also analogous to the established elites (King, nobility, military, and business) of Mussolini’s Italy. These elites opposed a full and radical fascistization of the Italian people and instead valued the well-being of their own caste over that of society as a whole. European-derived peoples, with their greater individualism, tend to produce elites willing to betray their race (and their own ethnic genetic interests) for selfish class/caste/individual interests.
What are the lessons of the story of Cola di Rienzi?
Culturally and politically, the Italians are one of the healthiest people in Europe today. Their tradition of palingenetic populist nationalism has deep roots, nourished and hallowed by the blood of martyrs like Arnold of Brescia, Cola di Rienzi, and Benito Mussolini. They failed because they could not overcome the resistance of the “barons” and the church — those whose petty secular interests are threatened by genuine national renewal. The next time — if there is a next time — things need to be done right.
For the West as a whole, the story of di Rienzi demonstrates that self-interested established elites always oppose palingenesis. It is time for a new elite, one that understands that their own interests and those of their people are one and the same, and who will work first towards survival, and second towards fulfilling a higher destiny, the Destiny of the West.
Will “the people” be up to the challenge? We shall see. One thing is for sure — we cannot afford to waste the likes of a di Rienzi or a Mussolini. Such leaders need to be treasured, not to have their torn bodies hanged upside down for the amusement of the small-brained, milling mob.
It is time for a clean sweep. Reform is the enemy. Only complete rebirth can save us now.
00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, italie, renaissance, 16ème siècle, histoire, fascisme, proto-fascisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 août 2010
UN ouvrage fondamental sur la "révolution conservatrice"

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1999
Un ouvrage fondamental sur la révolution conservatrice
Richard FABER (Hrsg.), Konservatismus in Geschichte und Gegenwart, Königshausen & Neumann, Würzburg, 1991, ISBN 3-88479-592-9.
Deux contributions de cet ouvrage collectif intéressent directement notre propos: 1) Richard FABER, «Differenzierungen im Begriff Konservatismus. Ein religionssoziologischer Versuch» et 2) Arno KLÖNNE, «"Rechts oder Links?". Zur Geschichte der Nationalrevolutionäre und Nationalbolschewisten». Richard Faber, dont nous connaissons déjà la concision, résume en treize points les positions fondamentales du "conservatisme" (entendu dans le sens allemand et non pas britannique):
◊1) le principe de "mortui plurimi", le culte des morts et des anciens, garant d'un avenir dans la continuité, de la durée.
◊2) Ce culte de la durée implique la nostalgie d'un ordre social stable, comme celui d'avant la révolution, la réforme et la renaissance (Hugo von Hofmannsthal).
◊3) Dans l'actualité, cette nostalgie doit conduire l'homme politique à défendre un ordre économique "sain", respectant la pluralité des forces sociales; à ce niveau, une contradiction existe dans le conservatisme contemporain, où Carl Schmitt, par exemple, dénonce ce néo-médiévisme social, comme un "romantisme politique" inopérant, au nom d'un étatisme efficace, plus dur encore que le stato corporativo italien.
◊4) L'ordre social et politique dérive d'une représentation de l'empire (chinois, babylonien, perse, assyrien ou romain) comme un analogon du cosmos, comme un reflet microcosmique du macrocosme. Le christianisme médiéval a retenu l'essentiel de ce cosmisme païen (urbs deis hominibusque communis). La querelle dans le camp conservateur, pour Faber, oppose ceux qui veulent un retour sans médiation aux sources originales païennes et ceux qui se contentent d'une répétition de la synthèse médiévale christianisée.
◊5) Les conservateurs perçoivent le ferment chrétien comme subversif: ils veulent une religion qui ne soit pas opposée au fonctionnement du politique; à partir de là, se développe un anti-christianisme conservateur et néo-païen, ou on impose, à la suite de Joseph de Maistre, l'expédiant d'une infaillibilité pontificale pour barrer la route à l'impolitisme évangélique.
◊6) Les positivistes comtiens, puis les maurrassiens, partageant ce raisonnement, déjà présent chez Hegel, parient pour un catholicisme athée voire pour une théocratie athée.
◊7) Un certain post-fascisme (défini par Rüdiger Altmann), observable dans toutes les traditions politiques d'après 1945, vise l'intégration de toutes les composantes de la société pour les soumettre à l'économie. Ainsi, le pluralisme, pourtant affiché en théorie, cède le pas devant l'intégration/homologation (option du conservatisme technocrate).
◊8) Dans ce contexte, se développe un catholicisme conservateur, hostile à l'autonomie de l'économie et de la société, lesquelles doivent se soumettre à une "synthèse", celle de l'"organisme social" (suite p. 67).
◊9) Le contraire de cette synthèse est le néo-libéralisme, expression d'un polythéisme politique, d'après Faber. Les principaux représentants de ce polythéisme libéral sont Odo Marquard et Hans Blumenberg.
◊10) Dans le cadre de la dialectique des Lumières, Locke estimait que l'individu devait se soumettre à la société civile et non plus à l'autorité politique absolue (Hobbes); l'exigence de soumission se mue en césarisme chez Schmitt. Dans les trois cas, il y a exigence de soumission, comme il y a exigence de soumission à la sphère économique (Altmann). Le conservatisme peut s'en réjouir ou s'en insurger, selon les cas.
◊11) Pour Faber, comme pour Walter Benjamin avant lui, le conservatisme représente une "trahison des clercs" (ou des intellectuels), où ceux-ci tentent de sortir du cul-de-sac des discussions sans fin pour déboucher sur des décisions claires; la pensée de l'urgence est donc une caractéristique majeure de la pensée conservatrice.
◊12) Faber critique, à la suite d'Adorno, de Marcuse et de Benjamin, le "caractère affirmateur de la culture", propre du conservatisme. Il remarque que Maurras et Maulnier s'engagent dans le combat politique pour préserver la culture, écornée et galvaudée par les idéologies de masse. Waldemar Gurian, disciple de Schmitt et historien de l'Action Française, constate que les sociétés ne peuvent survivre si la Bildung disparaît, ce mélange de raffinement et d'éducation, propre de l'élite intellectuelle et créatrice d'une nation ou d'une civilisation.
◊13) Dans son dernier point, Faber revient sur la cosmologie du conservatisme. Celle-ci implique un temps cyclique, en apparence différent du temps chrétien, mais un auteur comme Erich Voegelin accepte explicitement la "plus ancienne sagesse de l'homme", qui se soumet au rythme du devenir et de la finitude. Pour Voegelin, comme pour certains conservateurs païens, c'est la pensée gnostique, ancêtre directe de la modernité délétère, qui rejette et nie "le destin cyclique de toutes choses sous le soleil". La gnose christianisée ou non du Bas-Empire, cesse de percevoir le monde comme un cosmos bien ordonné, où l'homme hellénique se sentait chez lui. Le gnostique de l'antiquité tardive, puis l'homme moderne qui veut tout modifier et tout dépasser, ne parvient plus à regarder le monde avec émerveillement. Le chrétien catholique Voegelin, qui aime la création et en admire l'ordre, rejoint ainsi le païen catholique Maurras. Albrecht Erich Günther, figure de la révolution conservatrice, définit le conservatisme non comme une propension à tenir à ce qui nous vient d'hier, mais propose de vivre comme on a toujours vécu: quod semper, quod ubique, quod omnibus.
Dans sa contribution, Arno Klönne évoque la démarche anti-système de personnalités comme Otto Strasser, Hans Ebeling, Ernst Niekisch, Beppo Römer, Karl O. Paetel, etc., et résume clairement cette démarche entre tous les fronts dominants de la pensée politique allemande des années 20 et 30. Le refus de se laisser embrigader est une leçon de liberté, que semble reprendre la "Neue Rechte" allemande actuelle, surtout par les textes de Marcus Bauer, philosophe et théologien de formation. Un excellent résumé pour l'étudiant qui souhaite s'initier à cette matière hautement complexe (RS).
00:10 Publié dans Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, révolution conservatrice, allemagne, histoire, weimar, années 20, droite, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 août 2010
Nouvelle Revue d'Histoire n°49: en kiosque!

16:19 Publié dans Histoire, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, histoire, afghanistan, moyen orient, nouvelle droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 août 2010
Prussien par élection
Prussien par élection
Hommage à Hans-Joachim Schoeps, à l’occasion du trentième anniversaire de sa disparition
 « On n’est pas Prussien par le sang, on le devient par un acte de foi ». Cette phrase est due à la plume du philosophe juif et de l’explorateur des religions Hans-Joachim Schoeps. Le 8 juillet 2010, il y avait juste trente ans qu’il avait quitté ce monde. Inutile de préciser que la maxime mise en exergue de ce texte le concernait personnellement : Schoeps s’affirmait Prussien.
« On n’est pas Prussien par le sang, on le devient par un acte de foi ». Cette phrase est due à la plume du philosophe juif et de l’explorateur des religions Hans-Joachim Schoeps. Le 8 juillet 2010, il y avait juste trente ans qu’il avait quitté ce monde. Inutile de préciser que la maxime mise en exergue de ce texte le concernait personnellement : Schoeps s’affirmait Prussien.
Après la seconde guerre mondiale, à une époque où le peuple allemand entamait le long processus qui consistait à se nier soi-même, Schoeps s’est dressé et a commencé à militer pour le droit de l’Allemagne à la vie. Il savait comment son engagement allait être perçu et il l’a dit de manière très pertinente : « Les pierres angulaires de ma vie, être tout à la foi conservateur, prussien et juif, font bien évidemment l’effet d’une provocation chez les fils rouges de pères bruns ». Les insultes n’ont pas manqué de fuser : Wolf Biermann, compositeur juif de chansons d’inspiration communiste, s’est immédiatement laissé aller en étiquetant Schoeps de « Juif à la Heil Hitler ». Cette insulte était bien entendu une aberration telle qu’elle n’a jamais eu d’équivalent. De fait, Schoeps, qui a enseigné jusqu’en 1938 au Gymnasium juif de Vienne, n’avait pas eu d’autre alternative, après la terrible « Nuit de Cristal » d’emprunter le chemin de l’exil. Il s’est rendu en Suède. Son père, le Dr. Julius Schoeps, colonel médecin militaire attaché à l’état-major, et d’après le très officiel « Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration » (« Manuel biographique de l’émigration germanophone ») , un « nationaliste allemand », est mort en 1942 dans le camp-ghetto de Theresienstadt.
Le rêve de l’unité allemande
Hans-Joachim Schoeps est né en 1909 à Berlin. Il était sentimentalement et profondément lié à la capitale allemande et le resta jusqu’à la fin de ses jours. Il n’a malheureusement pas pu vivre la chute du Mur et la réunification du pays. Dans les souvenirs qu’il nous a laissés, il écrit : « ah, que j’aimerais encore une fois au moins me promener dans les rues de Potsdam et entendre le son des vieilles cloches de l’église de la garnison ou me retrouver sur les murailles de Marienburg pour voir y flotter l’aigle noir et le drapeau avec nos deux couleurs, le drapeau sous lequel ont combattu les Chevaliers de l’Ordre pour gagner la Prusse au Reich ».
Pendant la République de Weimar, Schoeps a fréquenté les nationaux-allemands, les mouvements de jeunesse « bündisch » (liguistes), liés à la tradition des Wandervögel, mais en s’intéressant à la politique et animés par une volonté de forger une société et un Etat nouveaux. En 1932, une année après avoir obtenu son doctorat en philosophie, thèse qui portait sur « l’histoire de la philosophie religieuse juive à l’époque moderne », Schoeps fonde le « Deutscher Vortrupp – Gefolgschaft deutsche Juden » (« Avant-garde des éclaireurs allemands – Leudes juifs allemands »), pour offrir un espace d’activité et de survie aux Juifs allemands patriotes, leur donnant simultanément la possibilité d’agir pour forger un ordre nouveau. L’entreprise fut un échec car ni les antisémites de la NSDAP ni les sionistes ne voulaient voir se constituer un tel mouvement.
En 1946, Schoeps revient de Suède et se fixe à nouveau en Allemagne. Il a l’honneur de refuser catégoriquement l’offre que lui fit immédiatement l’occupant américain : travailler dans un journal sous licence pour participer à la rééducation du peuple. « Je ne veut pas devenir un Quisling des Américains », déclara-t-il à la suite de son refus hautain. En 1947, il obtient un nouveau titre de docteur à l’Université de Marbourg et, à partir de 1950, il enseigne l’histoire des religions et des idées à l’Université d’Erlangen. Dans le cadre de ses activités universitaires, il s’est toujours dressé contre les accusations collectives que l’idéologie nouvelle, anti-allemande, ne cessait de formuler. Schoeps s’engage aussi pour réhabiliter l’histoire prussienne, continuellement diffamée. Dès 1951, il réclame la reconstitution de la Prusse, que le Conseil de Contrôle interallié avait dissoute en 1947.
Après la guerre, il n’a jamais cessé non plus de parler au nom de la communauté juive d’Allemagne. Il refusait de s’identifier aux idéologues du sionisme et n’a jamais voulu se rendre dans le nouvel Etat d’Israël.
(article paru dans DNZ, n°28/juillet 2010).
00:15 Publié dans Judaica, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, judaica, judaïsme, révolution conservatrice, histoire, années 30, années 40, weimar |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 15 juillet 2010
Foundations of Russian Nationalism
Foundations of Russian Nationalism

Translated by Greg Johnson
Throughout its history, Russia has been estranged from European dynamics. Its nationalism and national ideology are marked by a double game of attraction and revulsion towards Europe in particular and the West in general.
The famous Italian Slavist Aldo Ferrari points out that from the 10th to the 13th centuries, the Russia of Kiev was well-integrated into the medieval economic system. The Tartar invasion tore Russia away from the West. Later, when the Principality of Moscow reorganized itself and rolled back the residues of the Tartar Empire, Russia came to see itself as a new Orthodox Byzantium, different from the Catholic and Protestant West. The victory of Moscow began the Russian drive towards the Siberian vastness.
The rise of Peter the Great, the reign of Catherine the Great, and the 19th century brought a tentative rapprochement with the West.
To many observers, the Communist revolution inaugurated a new phase of autarkic isolation and de-Westernization, in spite of the Western European origin of its ideology, Marxism.
But the Westernization of the 19th century had not been unanimously accepted. At the beginning of the century, a fundamentalist, romantic, nationalist current appeared with vehemence all over Russia: against the “Occidentalists” rose the “Slavophiles.” The major cleavage between the left and the right was born in Russia, in the wake of German romanticism. It is still alive today in Moscow, where the debate is increasingly lively.
The leader of the Occidentalists in the 19th century was Piotr Chaadaev. The most outstanding figures of the “Slavophile” camp were Ivan Kireevski, Aleksei Khomiakov, and Ivan Axakov. Russian Occidentalism developed in several directions: liberal, anarchist, socialist. The Slavophiles developed an ideological current resting on two systems of values: Orthodox Christendom and peasant community. In non-propagandistic terms, that meant the autonomy of the national churches and a savage anti-individualism that regarded Western liberalism, especially the Anglo-Saxon variety, as a true abomination.
Over the decades, this division became increasingly complex. Certain leftists evolved towards a Russian particularism, an anti-capitalist, anarchist-peasant socialism. The Slavophile right mutated into “panslavism” manipulated to further Russian expansion in the Balkans (supporting the Romanians, Serbs, Bulgarians, and Greeks against the Ottomans).
Among these “panslavists” was the philosopher Nikolay Danilevsky, author of an audacious historical panorama depicting Europe as a community of old people drained of their historical energies, and the Slavs as a phalange of young people destined to govern the world. Under the direction of Russia, the Slavs must seize Constantinople, re-assume the role of Byzantium, and build an imperishable empire.
Against the Danilevsky’s program, the philosopher Konstantin Leontiev wanted an alliance between Islam and Orthodoxy against the liberal ferment of dissolution from the West. He opposed all conflict between Russians and Ottomans in the Balkans. The enemy was above all Anglo-Saxon. Leontiev’s vision still appeals to many Russians today.
Lastly, in the Diary of Writer, Dostoevsky developed similar ideas (the youthfulness of the Slavic peoples, the perversion of the liberal West) to which he added a radical anti-Catholicism. Dostoevsky came to inspire in particular the German “national-Bolsheviks” of the Weimar Republic (Niekisch, Paetel, Moeller van den Bruck, who was his translator).
Following the construction of the Trans-Siberian railroad under the energetic direction of the minister Witte, a pragmatic and autarkical ideology of “Eurasianism” emerged that aimed to put the region under Russian control, whether directed by a Tsar or a Soviet Vojd (“Chief”).
The “Eurasian” ideologists are Troubetzkoy, Savitski, and Vernadsky. For them, Russia is not an Eastern part of Europe but a continent in itself, which occupies the center of the “World Island” that the British geopolitician Halford John Mackinder called the “Heartland.” For Mackinder, the power that managed to control “Heartland” was automatically master of the planet.
Indeed, this “Heartland,” namely the area extending from Moscow to the Urals and the Urals to the Transbaikal, was inaccessible to the maritime powers like England and the United States. It could thus hold them in check.
Soviet policy, especially during the Cold War, always tried to realize Mackinder’s worst fears, i.e., to make the Russo-Siberian center of the USSR impregnable. Even in the era of nuclear power, aviation, and transcontinental missiles. This “sanctuarization” of the Soviet “Heartland” constituted the semi-official ideology of the Red Army from Stalin to Brezhnev.
The imperial neo-nationalists, the national-Communists, and the patriots opposed Gorbachev and Yeltsin because they dismantled the Eastern-European, Ukrainian, Baltic, and central-Asian glacis of this “Heartland.”
These are the premises of Russian nationalism, whose multiple currents today oscillate between a populist-Slavophile pole (“narodniki,” from “narod,” people), a panslavist pole, and an Eurasian pole. For Aldo Ferrari, today’s Russian nationalism is subdivided between four currents: (a) neo-Slavophiles, (b) eurasianists, (c) national-Communists, and (d) ethnic nationalists.
The neo-Slavophiles are primarily those who advocate the theses of Solzhenitsyn. In How to Restore Our Russia?, the writer exiled in the United States preached putting Russia on a diet: She must give up all imperial inclinations and fully recognize the right to self-determination of the peoples on her periphery. Solzhenitsyn then recommended a federation of the three great Slavic nations of the ex-USSR (Russia, Belarus, and Ukraine). To maximize the development of Siberia, he suggested a democracy based on small communities, a bit like the Swiss model. The other neo-nationalists reproach him for mutilating the imperial motherland and for propagating a ruralist utopianism, unrealizable in the hyper-modern world in which we live.
The Eurasianists are everywhere in the current Russian political arena. The philosopher to whom they refer is Lev Goumilev, a kind of Russian Spengler who analyzes the events of history according to the degree of passion that animates a people. When the people are impassioned, they create great things. When inner passion dims, the people decline and die. Such is the fate of the West.
For Goumilev, the Soviet borders are intangible but new Russia must adhere to the principle of ethnic pluralism. It is thus not a question of Russianizing the people of the periphery but of making of them definitive allies of the “imperial people.”
Goumilev, who died in June 1992, interpreted the ideas of Leontiev in a secular direction: the Russians and the Turkish-speaking peoples of Central Asia were to make common cause, setting aside their religious differences.
Today, the heritage of Goumilev is found in the columns of Elementy, the review of the Russian “New Right” of Alexandre Dugin, and Dyeïnn (which became Zavtra, after the prohibition of October 1993), the newspaper of Alexander Prokhanov, the leading national-patriotic writers and journalists. But one also finds it among certain Moslems of the “Party of Islamic Rebirth,” in particular Djemal Haydar. More curiously, two members of Yeltsin’s staff, Rahr and Tolz, were followers of Eurasianism. Their advice was hardly followed.
According to Aldo Ferrari, the national-Communists assert the continuity of the Soviet State as an historical entity and autonomous geopolitical space. But they understand that Marxism is no longer valid. Today, they advocate a “third way” in which the concept of national solidarity is cardinal. This is particularly the case of the chief of the Communist Party of the Russuan Federation, Gennady Zyuganov.
The ethnic nationalists are inspired more by the pre-1914 Russian extreme right that wished to preserve the “ethnic purity” of the people. In a certain sense, they are xenophobic and populist. They want people from the Caucasus to return to their homelands and are sometimes strident anti-Semites, in the Russian tradition.
Indeed, Russian neo-nationalism is rooted in the tradition of 19th century nationalism. In the 1960s, the neo-ruralists (Valentine Raspoutin, Vassili Belov, Soloukhine, Fiodor Abramov, etc.) came to completely reject “Western liberalism,” based on a veritable “conservative revolution”—all with the blessing of the Soviet power structure!
The literary review Nache Sovremenik was made the vehicle of this ideology: neo-Orthodox, ruralist, conservative, concerned with ethical values, ecological. Communism, they said, extirpated the “mythical consciousness” and created a “humanity of amoral monsters” completely “depraved,” ready to accept Western mirages.
Ultimately, this “conservative revolution” was quietly imposed in Russia while in the West the “masquerade” of 1968 (De Gaulle) caused the cultural catastrophe we are still suffering.
The Russian conservatives also put an end to the Communist phantasm of the “progressive interpretation of history.” The Communists, indeed, from the Russian past whatever presaged the Revolution and rejected the rest. To the “progressivist and selective interpretation,” the conservatives opposed the “unique flow”: they simultaneously valorized all Russian historical traditions and mortally relativized the linear conception of Marxism.
Bibliography
Aldo FERRARI, «Radici e prospettive del nazionalismo russe», in Relazioni internazionali, janvier 1994.
Robert STEUCKERS (éd.), Dossier «National-communisme», in Vouloir, n°105/108, juillet-septembre 1993 (textes sur les variantes du nationalisme russe d’aujourd’hui, sur le “national-bolchévisme” russe des années 20 et 30, sur le fascisme russe, sur V. Raspoutine, sur la polémique parisienne de l’été 93).
Gerd KOENEN/Karla HIELSCHER, Die schwarze Front, Rowohlt, Reinbeck, 1991.
Walter LAQUEUR, Der Schoß ist fruchtbar noch. Der militante Nationalismus der russischen Rechten, Kindler, München, 1993.
Mikhaïl AGURSKI, La Terza Roma. Il nazionalbolscevismo in Unione Sovietico, Il Mulino, Bologne, 1989.
Alexandre SOLJENITSYNE, Comment réaménager notre Russie?, Fayard, Paris, 1990.
Alexandre DOUGUINE (DUGHIN), Continente Russia, Ed. all’insegna del Veltro, Parme, 1991. Extrait dans Vouloir n°76/79, 1991, «L’inconscient de l’Eurasie. Réflexions sur la pensée “eurasiatique” en Russie». Prix de ce numéro 50 FF (chèques à l’ordre de R. Steuckers).
Alexandre DOUGUINE, «La révolution conservatrice russe», manuscrit, texte à paraître dans Vouloir.
Konstantin LEONTIEV, Bizantinismo e Mondo Slavo, Ed. all’insegna del Veltro, Parme, 1987 (trad. d’Aldo FERRARI).
N.I. DANILEVSKY, Rußland und Europa, Otto Zeller Verlag, 1965.
Michael PAULWITZ, Gott, Zar, Muttererde: Solschenizyn und die Neo-Slawophilen im heutigen Rußland, Burschenschaft Danubia, München, 1990.
Hans KOHN, Le panslavisme. Son histoire et son idéologie, Payot, Paris, 1963.
Walter SCHUBART, Russia and Western Man, F. Ungar, New York, 1950.
Walter SCHUBART, Europa und die Seele des Ostens, G. Neske, Pfullingen, 1951.
Johan DEVRIENDT, Op zoek naar de verloren harmonie – mens, natuur, gemeenschap en spiritualiteit bij Valentin Raspoetin, Mémoire, Rijksuniversiteit Gent/Université d’Etat de Gand, 1992 (non publié).
Koenraad LOGGHE, «Valentin Grigorjevitsj Raspoetin en de Russische traditie», in Teksten, Kommentaren en Studies, n°71, 1993.
Alexander YANOV, The Russian New Right. Right-Wing Ideologies in the Contemporary USSR, IIS/University of California, Berkeley, 1978.
Wolfgang STRAUSS, Rußland, was nun?, Österreichische Landmannschaft/Eckart-Schriften 124, Vienne, 1993.
Pierre PASCAL, Strömungen russischen Denkens 1850-1950, Age d’Homme/Karolinger Verlag, Vienne (Autriche), 1981.
Raymond BEAZLEY, Nevill FORBES & G.A. BIRKETT, Russia from the Varangians to the Bolsheviks, Clarendon Press, Oxford, 1918.
Jean LOTHE, Gleb Ivanovitch Uspenskij et le populisme russe, E.J. Brill, Leiden, 1963.
Richard MOELLER, Russland. Wesen und Werden, Goldmann, Leipzig, 1939.
Viatcheslav OGRYZKO, Entretien avec Lev GOUMILEV, in Lettres Soviétiques, n°376, 1990.
Thierry MASURE, «De cultuurmorfologie van Nikolaj Danilevski», in Dietsland Europa, n°3 et n°4, 1984 (version française à paraître dans Vouloir).
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2010/06/14/fondements-du-nationalisme-russe.html
00:05 Publié dans Eurasisme, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, histoire, nationalisme, europe, nationalisme russe, idéologie, théorie politique, politologie, sciences politiques, eurasisme, eurasie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 13 juillet 2010
Les travaux de Tilak et Horken: sur les origines des peuples indo-européens
 Walther BURGWEDEL :
Walther BURGWEDEL :
Les travaux de Tilak et Horken : sur les origines des peuples indo-européens
Il arrive parfois que deux chercheurs, chacun pour soi, se rapprochent de la solution recherchée, si bien que chacun d’entre eux aurait abouti dans sa démarche plus rapidement s’il avait eu connaissance des résultats de son homologue. Je vais étudier la démarche de deux chercheurs, qui ne se connaissaient pas l’un l’autre, appartenaient à des générations différentes et n’ont donc jamais eu l’occasion de se rencontrer ni, a fortiori, de compléter leurs recherches en s’inspirant l’un de l’autre. Je vais essayer de rattraper le temps perdu, tout en sachant que le résultat de mon travail contiendra forcément un dose de spéculation, comme c’est généralement le cas dans tous travaux d’archéologie et d’anthropologie. Je ne pourrai pas travailler l’ensemble prolixe des connaissances glanées par mes deux chercheurs et je me focaliserai pour l’essentiel sur un aspect de leur œuvre : celle qui étudie le cadre temporel où se situent les premières manifestations protohistoriques des peuples indo-européens. Je procéderai à une comparaison entre les résultats obtenus par les deux chercheurs.
J’aborderai trois de leurs livres qui, tous, s’occupent des premiers balbutiements de la protohistoire des peuples indo-européens. Nos deux auteurs n’étaient ni anthropologues ni archéologues et ignoraient leurs recherches respectives. Ils ont ensuite abordé leur sujet au départ de prémisses très différentes.
Voici ces livres :
- Bal Gangadhar Tilak, The Orion or Researches into the Antiquity of the Vedas, Bombay, 1893.
- Bal Gangadhar Tilak, The Arctic Home in the Vedas, Poona, 1900.
- H. K. Horken, Ex Nocte Lux, Tübingen, 1973. Seconde édition revue et corrigée, Tübingen, 1996.
(…)
Dans ces ouvrages, nous trouvons trois assertions de base :
Chez Tilak : le Rig-Veda, d’après ce qu’il contient, daterait d’environ 6000 ans ; il n’aurait été retranscrit que bien plus tard (« Orion », pp. 206 et ss.).
Les auteurs initiaux du Rig-Veda, c’est-à-dire les hommes qui furent à l’origine du texte ou d’une bonne partie de celui-ci, vivaient sur le littoral de l’Océan Glacial Arctique. Ils avaient développé là-bas une culture et une économie comparativement élevées par rapport au reste de l’humanité (« Orion », pp. 16 et ss. ; « Arctic Home », p. 276).
Pour Horken, les périodes glaciaires se sont manifestées à la suite des phénomènes liés à la séparation progressive du continent eurasien et du continent américain, d’une part, et à la suite de l’émergence du Gulf Stream, d’autre part. Elles ont eu pour résultats de fixer de grandes quantités d’eau sous forme de glace et donc de faire descendre le niveau de la mer. De cette façon, les zones maritimes, normalement inondées, qui présentent des hauts fonds plats, ont été mises à sec, zones auxquelles appartient également le plateau continental de la zone polaire eurasienne. Sur le plan climatique, le Gulf Stream apporta une source de chaleur et les zones évacuées par la mer furent recouvertes de végétation, face à la côte française actuelle et tout autour des Iles Britanniques, en direction du Nord-Est. Après la végétation vint la faune et ses chasseurs, les premiers hommes d’Europe. Ainsi, l’espace occupé aujourd’hui par la Mer du Nord a été peuplé.

Nous avons donc affaire ici à une population qui a suivi cette voie migratoire, au départ, probablement, des confins occidentaux du continent européen ; cette population, profitant d’un climat clément dans la zone aujourd’hui redevenue plateau continental, a fini par atteindre la Mer de Barents, avant qu’au sud de celle-ci, d’énormes masses de glace accumulées sur le sol de l’actuelle Scandinavie, ne leur barrent la route d’un éventuel retour.
La durée de leur migration et de leur séjour dans les régions polaires arctiques a été déterminée par les vicissitudes de la période glaciaire, de même que le temps qu’ils ont mis à s’adapter à leurs nouvelles conditions de vie. Quand le Gulf Stream a commencé à ne plus atteindre les régions constituant leur nouvelle patrie, cette population a vu revenir les conditions préglaciaires, avec, pour conséquence, que la vie y devint de plus en plus difficile et, finalement, impossible. Cette population a été contrainte d’émigrer vers l’Europe centrale et le bassin méditerranéen ou, autre branche, vers l’espace indien, au-delà des massifs montagneux de Sibérie (« Ex nocte lux »).
Tilak, lui, avance des arguments plus fiables : il étudie les descriptions dans le Rig-Veda qui ne sont compréhensibles que si l’on part du principe que les auteurs initiaux ont vécu, au moment où émerge le Rig-Veda, sur le littoral de l’Océan Glacial Arctique. Ce n’est qu’en posant cette hypothèse que les textes, considérés auparavant comme inexplicables, deviennent parfaitement compréhensibles. Tilak ne pose cependant pas la question de savoir comment cette population est arrivée dans cette région.
Horken, lui, nous offre une thèse éclairante, en se basant sur les phénomènes prouvés de l’histoire géologique de la Terre ; selon cette thèse, les événements qui se sont déroulés à l’époque glaciaire, plus spécifiquement à l’époque glaciaire de Würm, expliquent comment, par la force des choses, les premiers Européens sont arrivés sur le littoral de l’Océan Glacial Arctique. La géologie lui fournit de quoi étayer sa thèse sur la chronologie de cette migration.
On peut évidemment supposer que nos deux auteurs ont écrit sur la même population. Pour prouver que cela est exact, il faut d’abord démontrer comment les choses se sont passées sur le plan géologique en s’aidant de toutes les connaissances scientifiques disponibles et en les présentant de la manière la plus précise qui soit. Toutes les données que je vais aligner ici relèvent d’évaluations qui devront, si besoin s’en faut, être remplacées par des données plus précises. Mais pour donner un synopsis de ce déroulement, cette restriction, que je viens d’avancer, n’a guère d’importance.
La dérive des continents a fait en sorte que le Gulf Stream, après avoir passé le long du littoral occidental de l’Europe, a atteint les glaces de l’Océan Glacial Arctique et les a fait fondre dans la zone de contact. D’énormes masses d’eau se sont alors évaporées et, par l’effet des forces Coriolis (*) se sont retrouvées au-dessus des massifs montagneux de Scandinavie ; en montant, elles se sont refroidies et sont retombées sous forme de neige (Horken). Ce processus, d’après les évaluations actuelles, aurait commencé il y a 32.000 ans. Plus tard, les masses d’eau se sont figées en glace et ont entrainé la descente du niveau de la mer, non pas seulement le long des côtes, comme on peut encore les voir ou les deviner, mais sur l’ensemble du plateau continental; par la suite, la flore et la faune ont pu s’installer dans cette nouvelle région abandonnée par les flots. On peut donc admettre que l’homme, qui migre en suivant les troupeaux ou selon les espèces végétales qui le nourrissent, ait atteint les régions polaires avant que le point culminant de la glaciation ait produit ses effets. Au départ, la population arrivée là-bas n’a dû se contenter que d’un petit morceau habitable du plateau continental.
Pour pouvoir préciser quand cette phase a été atteinte, la géologie doit nous aider à éclairer ou corroborer les données suivantes, relatives à la région polaire du continent eurasiatique : fournir une chronologie capable de nous dire avec plus de précision quand le niveau de la mer est descendu, quand la glaciation est survenue et sur quelle extension géographique. La paléobotanique pourrait aider à compléter cette chronologie en nous renseignant sur la flore présente et sur la température moyenne annuelle qu’implique la présence de cette flore.
D’après une carte topographique du plateau continental en face des côtes de l’Océan Glacial Arctique, on devrait pouvoir reconnaître quelles ont été les régions de terres nouvelles disponibles pour une population migrante, qui, de surcroît, a sans doute été la première population humaine dans la région. Il faut toutefois tenir compte d’un facteur : le niveau de la mer a baissé partout dans le monde mais seulement selon un axe Ouest-Est, à commencer par la région du Golfe de Biscaye (Horken, p. 120) puis le long de toute la côte française actuelle, ensuite tout autour des Iles Britanniques ; le Gulf Stream a donc réchauffé toute cette immense région, jusqu’au littoral arctique de la Scandinavie, qu’il a ainsi rendu apte à la colonisation humaine, en modifiant le climat progressivement, jusqu’à épuisement de l’énergie thermique qu’il véhicule. Les flots qu’il pousse vers le Nord se refroidissent ensuite s’écoulent et retournent vers l’Atlantique, en faisant le chemin inverse mais sous les masses d’eau plus chaudes. Plus à l’est, les zones du plateau continental ont été également libérées des flots mais n’ont pas bénéficié indéfiniment des avantages offerts par le Gulf Stream et sont sans nul doute devenues tout aussi inhospitalières qu’aujourd’hui, vu la proximité des glaces du sud de la banquise.
Toutes les régions situées sur le littoral de l’Océan Glacial Arctique, qui font l’objet de notre investigation, se trouvent sur le plateau continental et dès lors ont été recouvertes par les flots lors de la fonte des glaces et de la montée du niveau de la mer. Il faudrait l’explorer davantage. En règle générale, le socle continental accuse une pente légère en direction du pôle, si bien que toute descente du niveau de l’océan correspond à un accroissement équivalent de terres nouvelles, également en direction du pôle. A hauteur de la Mer de Barents, par exemple, cela correspondrait, dans le cas extrême, à un recul de l’océan d’environ 500 km. Mais on peut estimer qu’une telle surface n’a pas été abandonnée par les flots : c’est ici que les géologues doivent nous apporter des précisions. Pendant la période d’occupation de ce territoire aujourd’hui retourné aux flots marins, tous les fleuves et rivières ont dû se jeter dans l’océan beaucoup plus au nord qu’aujourd’hui et il doit être parfaitement possible de repérer l’ancien lit de ces cours d’eau sur le plateau continental, comme nous pouvons d’ailleurs le faire pour l’Elbe dans la Mer du Nord. Ces fleuves et leurs affluents ont dû fournir de l’eau douce indispensable à la faune dans son ensemble et aux hommes. On peut dès lors en déduire que des sites d’installation ont existé sur les rives de ces cours d’eau. Les limites respectives du permafrost sur le continent (ou sur ce qui était le continent) ont certainement eu une influence sur la progression des migrants vers le Nord, progression que l’on pourrait suivre d’après les traces laissées. La valeur que revêt la découverte d’os dans cette région est importante : elle nous donnerait de bons indices, dès qu’on en découvrirait.
Horken nous a élaboré un modèle géophysique convainquant pour nous expliquer l’émergence et la fin de la période glaciaire de Würm. Si, à titre d’essai, nous posons cette théorie comme un fait, nous devons tout naturellement constater qu’à l’époque glaciaire, le long du littoral polaire du continent eurasiatique, des hommes ont vécu, qui devaient au préalable avoir résidé à l’Ouest de l’Europe centrale. Ils sont arrivés sur ce littoral polaire et, pendant longtemps, sans doute pendant quelques millénaires, ont dû y vivre sous un climat non hostile à la vie.
Tilak constate, en se basant sur le texte du Rig-Veda, que celui-ci a dû, pour sa matière primordiale, se dérouler dans une zone littorale polaire de l’Eurasie.
Pour ce qui concerne la durée temporelle de ce séjour, qui a vu l’émergence de la matière propre du Rig-Veda, nos deux auteurs avancent les faits suivants :
Tilak s’est préoccupé de l’âge des Vedas dans sa première publication (« Orion », op. cit.). Dans un grand nombre d’hymnes du Rig-Veda, Tilak a repéré des données astronomiques particulières et les a vérifiées sur base de la pertinence de ce que nous dit le texte de ces hymnes, d’une part, et sur les déductions étymologiques des descriptions que l’on y trouve, d’autre part. Comme l’objet de ses recherches n’était pas, de prime abord, le dit des hymnes védiques mais l’âge du Rig-Veda, il a pris en considération les phénomènes astronomiques décrits et ce, toujours en tenant compte de l’effet modifiant de la précession astronomique. Pour rappel : par le fait de la précession, le moment du printemps se déplace chaque année sur l’écliptique de 50,26 secondes, dans le sens ouest-est, ce qui nous donne un circuit entier au bout de 25.780 années. Tilak a ensuite étudié les interprétations d’autres chercheurs et explique pourquoi il ne partage pas leur avis. A l’époque où le Rig-Veda aurait émergé et où ses hymnes auraient commencé à jeter les bases de tous les sacrifices sacrés de la tradition indo-aryenne, le moment principal du cycle annuel était le moment précis où commençait le printemps, où le soleil revenait, c’est-à-dire, plus exactement, le moment même du lever du soleil quand les nuits et les jours sont strictement égaux. Il faut aussi que ce soit un moment du cycle annuel qui soit mesurable à l’aide de méthodes simples.
Tilak connaissait forcément le nom des figures zodiacales sur l’écliptique, telles que les astronomes védiques les nommaient. Contrairement à la pratique actuelle, les hommes distinguaient à l’époque vingt-sept signes du zodiaque. Tilak a fait l’importante découverte que le Rig-Veda a émergé sous la constellation d’Orion, car, il est dit que le moment du début du printemps, à l’ère d’émergence des chants védiques primordiaux, se trouvait dans la constellation d’Orion. En tenant compte de la précession astronomique, Tilak a daté les faits astronomiques relatifs au moment du début du printemps, que l’on trouve dans les hymnes védiques, et, ainsi, a pu établir que ceux-ci ont dû apparaître vers 5000 avant l’ère chrétienne.
Cette évaluation de l’âge du Rig-Veda chez Tilak, du moins dans la plus ancienne de ses publications (« Orion », op. cit.), doit être fausse.
Pourquoi ?
Ce que décrit Horken, en replaçant les faits dans le cadre de la dernière glaciation, celle de Würm, se voit confirmer par Tilak, et de façon définitive. Même quand il découvre que les événements décrits dans les hymnes du Rig-Veda se sont déroulés au départ dans une zone circumpolaire, Tilak n’a aucune idée cohérente quant à leur époque. Horken, lui, nous livre des données plus précises à ce propos, quasi irréfutables.
Nous apprenons de Tilak quel était le degré de développement atteint par les Aryas du temps du Rig-Veda ; déjà, dans son ouvrage intitulé « Orion », il rejette le doute émis par d’autres chercheurs quant aux connaissances astronomiques des Aryas des temps védiques : « je ne crois pas, écrit-il, qu’une population qui connaissait le métal et en avait fait des outils de travail, qui fabriquait des habits de laine, construisait des embarcations, des maisons et des chariots, et possédait déjà quelques connaissances en matière d’agriculture, aurait été incapable de distinguer la différence entre année solaire et année lunaire » (« Orion », pp. 16 et ss.).
Dans son second ouvrage, « The Arctic Home », Tilak avait décrit les gestes sacrés des prêtres, dont la tâche principale, semble-t-il, était de décrire les événements cosmiques et météorologiques, surtout pendant la nuit arctique. C’est ainsi que nous entendons évoquer, au fil des hymnes, des phénomènes et des choses qui nous permettent d’énoncer des conclusions d’ordre culturel. Dans un tel contexte, nous pouvons peut-être faire référence à un fait bien particulier : rien que nommer une chose ou un phénomène implique que cette chose ou ce phénomène étaient connus. Nous apprenons, surtout quand nous lisons les événements tournant autour de figures divines, que, par exemple, la première population védique utilisait l’âne comme bête de somme (p. 299), que les fortifications de Vritra étaient de pierre et de fer (p. 248), que Vishnou possédait des destriers de combat (p. 282), qu’on fait allusion à des embarcations de cent rames, bien étanches, à la domestication de moutons et au fer (p. 302, versets 8 et ss., 27 et 32), que cette population connaissait les bovins domestiques et avait des rudiments d’élevage et de fabrication de produits dérivés du lait (p. 303) ; un étable pour vache est même citée (p. 328) ; on trouve aussi un indice, par le biais d’un nom propre, que cette population travaillait l’or (p. 311), que Titra possède une flèche à pointe de fer (p. 335) et qu’un cheval, dédié à une cérémonie sacrificielle, est dompté par Titra et monté par Indra (p. 338 et ss.). Finalement, on apprend aussi l’existence de « destriers de combat de couleur brune » (p. 341).
Ce sont là tous des éléments que nous rapporte le Rig-Veda, dont l’émergence se situe quasi avec certitude dans une région correspondant au littoral polaire arctique. Cependant, cette émergence ne peut avoir eu lieu 5000 ans avant l’ère chrétienne car, à cette époque-là, la fonte des masses de glace de l’ère de Würm relevait déjà du passé ; sur le littoral polaire arctique régnait déjà depuis longtemps un climat semblable à celui que nous connaissons aujourd’hui ; le plateau continental était revenu à l’océan ; il est dès lors impossible qu’une existence, telle que décrite dans les hymnes védiques primordiaux, ait été possible sur ce littoral.
Il n’y a qu’une explication possible : Tilak, dans ses calculs, a dû oublier une période entière de précession. Cette impression nous est transmises uniquement par sa publication la plus ancienne, « Orion », où Tilak critique les affirmations de nombreux chercheurs : « La distance actuelle entre le krittikas et le solstice d’été s’élève à plus de 30°, et lorsque ce krittikas correspondait au solstice d’été, alors il devait remonter à beaucoup plus de temps par rapport au cours actuel de la précession de l’équinoxe. Nous ne pouvons donc pas interpréter le passage en question de la manière suivante : si nous plaçons le solstice d’été dans le krittikas, alors nous devons attribuer une datation plus ancienne au poème de Taittiriya Sanhitâ, correspondant à quelque 22.000 ans avant l’ère chrétienne ». On n’apprend pas, en lisant Tilak dans « Arctic Home », s’il déduit de ses constats et conclusions la possibilité ou l’impossibilité de cette datation. Sans doute a-t-il deviné qu’il risquait de faire sensation, et surtout de ne pas être cru et pris au sérieux.
En partant du principe que tant Tilak (à condition que nous tenions compte de la correction de ses calculs, correction que nous venons d’évoquer) que Horken sont dans le juste, suite à leur investigations et déductions, alors nous pouvons émettre l’hypothèse suivante quant au déroulement des faits :
Le Gulf Stream provoque une ère glaciaire. Dès que des masses glaciaires se sont accumulées en quantités suffisantes et que le niveau de la mer a baissé, de nouvelles terres sèches émergent sur l’ensemble du plateau continental. Aux endroits atteints par le réchauffement dû au Gulf Stream, ces nouvelles terres deviennent des espaces habitables, en croissance permanente au fur et à mesure que le niveau de l’océan baisse encore et que la végétation s’en empare ; elles s’offrent donc à la pénétration humaine. Les populations, habitant à cette époque dans l’Ouest de l’Europe, sans vraiment le remarquer car le processus dure sans doute des siècles, migrent vers les zones de chasse les plus avantageuses, en direction de l’est où elles rencontrent d’autres populations ; ces populations sont avantagées par rapport à d’autres car elles absorbent une nourriture plus riche en protéines, issue de la mer et disponible tant en été qu’en hiver (Horken).
Il me paraît intéressant de poser la question quant à savoir à quel type humain cette population appartenait ; vu la lenteur et la durée du phénomène migratoire qu’elle a représenté, cette population ne s’est sans doute jamais perçue comme un « groupe appelé à incarner un avenir particulier » et n’a jamais été véritablement consciente de la progression de sa migration sur l’espace terrestre. S’est-elle distinguée des autres populations demeurées dans le foyer originel ? Et, si oui, dans quelle mesure ? Appartenait-elle au groupe des Aurignaciens ? Ou à celui des Cro-Magnons ? Etait-elle apparentée à cette autre population qui, plus tard, lorsqu’elle vivait déjà dans son isolat arctique (Horken), créa les images rupestres des cavernes situées aujourd’hui en France méridionale et atteste dès lors d’un besoin, typiquement humain, de création artistique ? Les populations migrantes étaient-elles, elles aussi, animées par un tel besoin d’art ?
Dans le cadre de l’Institut anthropologique de l’Université Johannes Gutenberg à Mayence, on procède actuellement à des recherches dont les résultats permettront de formuler des hypothèses plausibles ou même d’affirmer des thèses sur la parenté génétique entre les différents groupes humains. L’axe essentiel de ces recherches repose sur la tolérance ou l’intolérance à l’endroit du lait de vache (la persistance de la lactose), tolérance ou intolérance qui sont déterminées génétiquement, comme le confirment les connaissances désormais acquises par les anthropologues. Pour vérifier, il suffit de prélever un échantillon sur un os. Les connaissances, que l’on acquerra bientôt, permettront de découvrir plus d’un indice sur l’origine et le séjour de cette population le long du littoral arctique. Comme nous l’avons déjà dit, ces populations connaissaient déjà les « vaches » et le « lait » et, vraisemblablement, l’élevage du bétail.
Les conditions de vie dominantes dans cette région dépourvue de montagnes impliquent un maintien général du corps qui est droit, afin de pouvoir voir aussi loin que possible dans la plaine. Le manque de lumière solaire a limité la constitution de pigments de la peau, d’où l’on peut émettre l’hypothèse de l’émergence d’un type humain de haute taille et de pigmentation claire (Horken). Lors de la migration toujours plus au nord, ces populations s’adaptèrent aux modifications des saisons et, dès qu’elles atteignirent la zone littorale de l’Arctique, leur mode de vie dut complètement changer. La nuit polaire est longue et la journée est courte : sur ce laps de temps finalement fort bref, il faut avoir semé et récolté, si l’on veut éviter la famine l’hiver suivant. Tous les efforts, y compris ceux qui revêtent un caractère sacré, ont surtout un but unique : savoir avec précision quel sera le cours prochain des saisons et savoir quand l’homme doit effectuer tel ou tel travail (Tilak). Dans le Rig-Veda, on apprend que pour chaque nuit de l’hiver polaire, nuit qui dure vingt-quatre heures, on avait à effectuer un acte sacré et qu’en tout une centaine de tels actes sacrés était possible. Il n’y en avait pas plus d’une centaine (Tilak, « Arctic Home… », pp. 215 et ss.) et peut-être ne les pratiquait-on pas toujours.
De ce que nous révèle ici le Rig-Véda, nous pouvons déduire à quelle latitude ces populations ont vécu, en progressant vers le nord. De même, nous pouvons admettre que ces populations ont vécu le long des fleuves et aussi sur le littoral, parce que fleuves et côtes offrent une source de nourriture abondante. D’après le texte védique, on peut émettre l’hypothèse que ces populations présentent une persistance de lactose. Vu l’absence de parenté entre le bovin primitif et le bovin domestique européen, il serait extrêmement intéressant de savoir de quel type de « vache » il s’agit dans le Rig-Véda, où ces animaux sont maintes fois cités.
Sur le plateau continental de la Mer de Barents, on devrait pouvoir trouver des ossements de bovidés, afin de pouvoir élucider cet aspect de nos recherches. La faune locale, quoi qu’il en soit, a dû correspondre à celle d’un climat plus chaud. A la même époque, les populations probablement apparentées et demeurées en Europe occidentale dans les cavernes de France et d’Espagne, représentaient en dessins des bovidés primitifs, des bisons, des rennes, des chevaux sauvages et des ours, et surtout, plus de soixante-dix fois, des mammouths. Les « hommes du nord », eux, selon Horken, représentaient la constellation d’Orion par la tête d’une antilope (Tilak, « Orion »).
Le fait que le Rig-Véda évoque, chez les populations vivant sur les côtes de l’Océan Glacial Arctique, la présence de certains animaux domestiques est d’une grande importance pour notre propos, puisque leur domestication a été datée, jusqu’ici, comme bien plus tardive. Pour ces animaux, il s’agit surtout de la vache (du moins d’une espèce de bovidé qu’il s’agit encore de déterminer), du cheval et du chien. Le Rig-Véda évoque deux chiens, que Yama va chercher, pour « garder le chemin » qui contrôle l’entrée et la sortie du Ciel (Tilak, « Orion », p. 110) ; dans le dixième mandala du Rig-Véda, on apprend qu’un chien est lâché sur Vrishâkapi. On peut imaginer que ces faits se soient réellement déroulés lorsqu’une existence quasi normale était encore possible le long du littoral arctique.
La glaciation de Würm a connu quelques petites variations climatiques, pendant lesquelles une partie de la couche de glace a fondu, ce qui a provoqué une légère montée du niveau de la mer. Pour les populations concernées, ces variations se sont étalées sur plusieurs générations ; néanmoins, le retour de la mer sur des terrains peu élevés ou marqués de déclivités a conduit rapidement à des inondations de terres arables, ce qui a marqué les souvenirs des hommes. De même, les phénomènes contraires : l’accroissement des masses de glace et la descente du niveau de la mer, soit le recul des eaux. Dans le Rig-Véda, un hymne rapporte qu’Indra a tué le démon de l’eau par de la glace (Tilak, « Arctic Home », p. 279). Sans doute peut-on y voir un rapport…
Quand la glaciation de Würm a pris fin graduellement et réellement, elle a eu pour effet sur les populations concernées que les étés sont devenus plus frais et bien moins rentables et que, pendant les nuits polaires devenues fort froides, la nourriture engrangée n’a plus été suffisante, entrainant des disettes. Dans le Rig-Véda, on trouve quelques indices sur la détérioration du climat (Tilak, « Arctic Home… », p. 203). Le contenu des textes védiques, qui contient des informations très importantes, a sans nul doute été complété, poursuivi et « actualisé ».
Les raz-de-marée, provoqués par des tempêtes, ont inondé de plus en plus souvent les terres basses, notamment celles qui étaient exploitées sur le plan agricole : la mer revenait et les populations devaient se retirer. A un moment ou à un autre, les plus audacieux ont envisagé la possibilité d’une nouvelle migration. On ne connaît pas le moment où elle fut décidée, ni les voies qu’elle a empruntées ni les moyens mis en œuvre. Quoi qu’il en soit, le Rig-Véda nous rapporte que le pays des bienheureux peut être atteint à l’aide du « vaisseau céleste dirigé par un bon timonier » (Tilak, « Orion », pp. 110 et ss.). Les voies migratoires et l’équipement des migrants ont pu changer au cours de leurs pérégrinations, car ce mouvement de retour, de plus en plus fréquent sans doute, a pu durer pendant plusieurs millénaires. Procédons par comparaison : l’ensemble de l’histoire de l’humanité compte, jusqu’à présent, 5000 ans ! Cependant, on peut déjà deviner qu’avant cela les populations s’étaient mises en branle, principalement en direction de l’Ouest, probablement à l’aide d’embarcations (Horken), pour déboucher en fin de compte dans le bassin méditerranéen, tandis qu’un autre groupe de population migrait du littoral arctique en direction du sud, en remontant le cours des fleuves et en traversant les barrières montagneuses de Sibérie, voire de l’Himalaya, en direction de l’espace indien. Horken, pour sa part, a publié une carte en y indiquant les endroits où, aujourd’hui, on parle des langues indo-européennes ; dans la zone littorale arctique, on les trouve surtout le long des fleuves, plus denses vers l’embouchure qu’en amont (p. 238).
Les migrants ont partout trouvé d’autres populations ; on peut admettre qu’ils se sont mêlés à elles, partout où ils ont demeuré longtemps ou pour toujours. De ces mélanges entre le « groupe du nord », au départ homogène, et les autres groupes humains, différents les uns des autres, ont émergé des tribus qui, plus tard, ont donné les divers peuples de souche indo-européenne (Horken). Elles ont un point commun : elles proviendraient toutes d’un foyer originel situé à l’ouest de l’Europe centrale, et, après migrations successives, auraient débouché dans l’espace arctique où elles seraient demeurées pendant plusieurs millénaires, tout en étant soumises à rude école. On peut aussi émettre l’hypothèse que des adaptations physiologiques aux rythmes saisonniers arctiques ont eu lieu. Un médecin américain a rédigé un rapport d’enquête après avoir observé pendant plusieurs années consécutives le pouls de ses patients, pour arriver au résultat suivant : les patients de race africaine présentaient les mêmes pulsations cardiaques tout au long de l’année, tandis que les Blancs europoïdes présentaient un rythme de pulsation plus lent en hiver qu’en été (Horken).
Les Indiens védiques ont la même origine géographique et génétique que les Blancs europoïdes et ce sont eux qui ont rapporté jusqu’à nos jours le message de ce très lointain passé qui nous est commun, sous la forme des chants védiques, surtout le Rig-Véda qui a été transmis par voie orale, de génération en génération, depuis des millénaires, sans jamais avoir subi d’altérations majeures ou divergentes. Cette transmission s’est effectuée en respectant une remarquable fidélité au texte que de nombreux passages de la première version écrite (vers 1800 avant l’ère chrétienne) correspond mot pour mot aux versions plus récentes, du point de vue du contenu et non de celui de la formulation lexicale (laquelle n’est plus compréhensible telle quelle par les locuteurs actuels des langues post-sanskrites). Le principal point commun est la langue, certes, mais il y en a d’autres. La Weltanschauung des Indiens et des Perses présente des grandes similitudes avec celle des Européens et plus d’une divinité des chants védiques a son correspondant dans le panthéon grec, par exemple, possédant jusqu’au même nom ! Il faudrait encore pouvoir expliquer comment les Grecs ont trouvé le chemin vers les terres qu’ils ont occupées aux temps historiques : en empruntant partiellement une voie migratoire que les Indiens ont également empruntée (c’est l’hypothèse que pose Tilak dans « Orion ») ou en passant par l’espace de l’Europe septentrionale ?
Un trait commun aux Indiens et aux Germains se retrouve dans le culte de la swastika, qui a dû revêtir la même signification dans les deux populations. Dans son livre intitulé « Vom Hakenkreuz » et paru en 1922, Jörg Lechler estime pouvoir dater la swastika de 5000 ans, en se basant sur des signes rupestres. Mais cette datation pourrait bien devenir caduque. Si les hypothèses avancées par Tilak et Horken s’avèrent pertinentes, des fouilles sur le plateau continental arctique devraient mettre à jour des représentations de la swastika.
On ne peut toutefois partir de l’hypothèse que ces « hommes du nord » ont occupé les parties du littoral plus à l’est, régions que le Gulf Stream ne fournit plus en énergie calorifique, ce qui ne permettait pas la diffusion de la végétation. Pourtant, des populations ont sûrement habité dans cette partie plus orientale du plateau continental, selon un mode de vie que nous rencontrons encore aujourd’hui chez les ressortissants de peuples et de tribus plus simples, se contentant de l’élevage du renne, de la chasse aux fourrures et de la pêche, et qui sont partiellement nomades comme les Tchouktches. Ces peuples étaient probablement habitués à un climat aussi rude que celui qui règne là-bas actuellement, ce qui implique que, pour eux, il n’y a jamais eu détérioration fondamentale du climat et qu’une émigration générale hors de cette région n’avait aucune signification. Certains chercheurs, dont M. de Saporta, pensent que certains peuples non indo-européens ont également leur foyer originel sur le littoral de l’Arctique (Tilak, « Arctic Home », p. 409).
Horken termine son ouvrage en émettant les réflexions suivantes : sur base des mêmes fondements géophysiques, qui ont fait émerger la période de glaciation de Würm, une nouvelle période glaciaire pourrait ou devrait survenir. Horken repère des transformations d’ordre météorologique dans la zone polaire qui abondent dans son sens, notamment, il constate qu’un port dans les Iles Spitzbergen peut désormais être fréquenté plus longtemps pendant la saison chaude qu’auparavant. Cet indice, il l’a repéré il y a plus de dix ans. Entretemps, nous avons d’autres géologues qui ont exprimé la conviction que nous allons au devant d’une nouvelle période glaciaire.
Walther BURGWEDEL.
(article paru dans « Deutschland in Geschichte und Gegenwart », n°4/1999 ; traduction et adaptation française : Robert Steuckers).
Notes :
(*) Le phénomène que l’on appelle les « forces Coriolis » s’inscrit dans la constitution mouvante de l’atmosphère terrestre : celle-ci est en effet toujours en mouvement parce que l’air chaud des tropiques se meut en direction des pôles, tandis que l’air froid des pôles se meut en direction de l’Equateur. Ce schéma circulatoire est influencé par un autre mouvement, impulsé par la rotation de la Terre autour de son propre axe. Cette rotation fait en sorte que les courants nord-sud s’infléchissent vers l’est ou l’ouest ; c’est précisément cet infléchissement que l’on appelle la « force Coriolis » ; celle-ci s’avère la plus forte au voisinage des pôles. Elle a été étudiée et définie par le physicien et mathématicien français Gustave-Gaspard de Coriolis (1792-1843), attaché à l’Ecole Polytechnique de Paris.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : europe, ethnologie, préhistoire, protohistoire, histoire, période glaciaire, anthropologie, archéologie, indo-européens |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 juillet 2010
Chi ha provocato la II guerra mondiale?
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, années 40 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 01 juillet 2010
La "Damnatio memoriae" fruto de la memoria historica
La Damnatio memoriae fruto de la memoria histórica
Alberto Buela (*)
Cuando el historiador Ernst Nolte demostró allá por los años ochenta del siglo pasado que la historia reciente de Alemania, especialmente la de la segunda guerra mundial, se había transformado en un pasado que no pasa, el mundo académico y los voceros de la policía del pensamiento saltaron como leche hervida. Es que Nolte puso en evidencia el mecanismo por el cual la memoria histórica había reemplazado a la historia como ciencia, con lo que quedó en evidencia la incapacidad histórica de los famosos académicos y los presupuestos ideológicos-políticos que guiaban sus investigaciones.
Es sabido que la memoria es siempre la memoria de un sujeto individual o si se quiere de una persona, singular y concreta. La memoria no existe más que como memoria de alguien. Su naturaleza estriba en otorgarle al sujeto el principio de identidad. Yo soy yo y me reconozco como tal a lo largo del tiempo de mi vida por la memoria que tengo de mi mismo desde que existo hasta el presente. Si existe o no una “memoria colectiva” esta es una cuestión que no está resuelta. El gran historiador alemán Reinhart Koselleck (1923-2006) sostuvo que no. Así, en su última entrevista en Madrid, publicada póstumamente el 24/4/2007, afirma:
“ Y mi posición personal en este tema es muy estricta en contra de la memoria colectiva, puesto que estuve sometido a la memoria colectiva de la época nazi durante doce años de mi vida. Me desagrada cualquier memoria colectiva porque sé que la memoria real es independiente de la llamada "memoria colectiva", y mi posición al respecto es que mi memoria depende de mis experiencias, y nada más. Y se diga lo que se diga, sé cuáles son mis experiencias personales y no renuncio a ninguna de ellas. Tengo derecho a mantener mi experiencia personal según la he memorizado, y los acontecimientos que guardo en mi memoria constituyen mi identidad personal. Lo de la "identidad colectiva" vino de las famosas siete pes alemanas: los profesores, los sacerdotes (en el inglés original de la entrevista: priests), los políticos, los poetas, la prensa..., en fin, personas que se supone que son los guardianes de la memoria colectiva, que la pagan, que la producen, que la usan, muchas veces con el objetivo de infundir seguridad o confianza en la gente... Para mí todo eso no es más que ideología. Y en mi caso concreto, no es fácil que me convenza ninguna experiencia que no sea la mía propia. Yo contesto: "Si no les importa, me quedo con mi posición personal e individual, en la que confío". Así pues, la memoria colectiva es siempre una ideología, que en el caso de Francia fue suministrada por Durkheim y Halbwachs, quienes, en lugar de encabezar una Iglesia nacional francesa, inventaron para la nación republicana una memoria colectiva que, en torno a 1900, proporcionó a la República francesa una forma de autoidentificación adecuada en una Europa mayoritariamente monárquica, en la que Francia constituía una excepción. De ese modo, en aquel mundo de monarquías, la Francia republicana tenía su propia identidad basada en la memoria colectiva. Pero todo esto no dejaba de ser una invención académica, asunto de profesores.”
En concordancia con esto ya había reaccionado cuando el gobierno alemán decidió erigir un símil de la estatua de La Piedad en la Neue Wache para venerar a las víctimas de las guerras producidas por Alemania. Koselleck levantó su voz crítica para advertir que un monumento de connotación cristiana resultaba una "aporía de la memoria" frente a los millones de judíos caídos en ese trance. Pero también en 1997, cuando el ayuntamiento de Berlín decidió erigir un monumento para recordar el Holocausto judío, volvió a la palestra para recordar que los alemanes habían matado por igual a católicos, comunistas, soviéticos, gitanos y gays. Nadie como él, entre los historiadores, hizo tanto para desembarazar a la escritura y a las representaciones de la historia del brete a que la someten los ideólogos de la “memoria histórica”.
El reemplazo de la historia como ciencia, como conocimiento por las causas, con el manejo metodológico que exige el trabajo sobre los testimonios y materiales del pasado, por parte de la memoria histórica siempre parcial e interesada (la ideología es un conjunto de ideas que enmascara los intereses de un grupo, clase o sector) ha desembocado en la moderna damnatio memoriae o condena de la memoria.
La damnatio memoriae era una condena judicial que practicaba el senado romano con los emperadores muertos por la cual se eliminaba todo aquello que lo recordaba. Desde Augusto en el 27 a.C. hasta Julio Nepote en el 480 d.C. fueron 34 los emperadores condenados. Se llegaba incluso hasta la abolitio nominis, borrando su nombre de todo documento e inscripción. Se buscaba la destrucción de todo recuerdo. Se destruían sus bustos y estatuas. Suetonio cuenta que los senadores lanzaban sobre el emperador muerto las más ultrajantes y crueles invectivas. La intención era borrar del pasado todo vestigio que recordara su presencia.
Las damnationes se realizaban a partir del poder constituido y su presupuesto ideológico era: de aquello que no se habla no existe. Arturo Jauretche, ese gran pensador popular argentino en su necrológica de nuestro maestro, José Luís Torres, nos habla de la confabulación del silencio como mejor mecanismo de los grupos de poder. Es una manifestación de prepotencia del poder establecido, con lo que busca eliminar el recuerdo del adversario, quedando así el poder actual como único dueño del pasado colectivo.
No es necesario ser un sutil pensador para comparar estas destrucciones de la memoria y eliminaciones de todo recuerdo con lo que sucede con nuestros gobiernos de hoy. En España una vez muerto Franco comenzó una campaña de difamación contra su persona y sus obras que llegó hasta cambiarle el nombre al pueblo donde nació. En Argentina cuando cayó Perón en 1955 se prohibió hasta su nombre (por dictador), reapareció la vieja abolitio nominis. Hace poco tiempo el gobierno de Kirchner hizo bajar el cuadro del ex presidente Videla (por antidemócrata). Al General Roca que llevó la guerra contra el indio le quieren voltear la estatua (por genocida). Se le quitó el nombre del popular escritor Hugo Wast a un salón de la biblioteca nacional (por antijudío). Y así suma y sigue.
Cuando la historia de un pueblo cae en manos de la memoria colectiva o de la memoria histórica lo que se produce habitualmente es la tergiversación de dicha historia, cuya consecuencia es la perplejidad de ese pueblo, pues se conmueven los elementos que conforman su identidad.
Es que la memoria lleva, por su subjetividad, necesariamente a valorar de manera interesada lo qué sucedió y cómo sucedió. Así para seguir con los ejemplos puestos, objetivamente considerados, Franco fue un gobernante austero y eficaz, Perón no fue un dictador, Videla fue un liberal cruel, Roca no fue un genocida y Wast fue un novelista católico. Vemos que aquello que deja la memoria histórica es un relato mentiroso que extraña al hombre del pueblo sobre sí mismo.
La memoria histórica es un producto de la mentalidad y los gobiernos jacobinos, aquellos que gobiernan a favor de unos grupos y en contra de otros. Aquellos que utilizan los aparatos del Estado no en función de la concordia interior sino como ejercicio del resentimiento, esto es, del rencor retenido, dando a los amigos y quitando a los enemigos. La sana tolerancia de la visión y versión del otro acerca de los acontecimientos históricos es algo que la memoria histórica no puede soportar, la rechaza de plano. La consecuencia lógica es la dammnatio memoriae, la condena de la memoria del otro.
(*) arkegueta, eterno comenzante- Univ. Tecnológica Nacional
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, argentine, amérique latine, amérique du sud, histoire, philosophie de l'histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La lutte du Japon contre les impérialismes occidentaux
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
La lutte du Japon contre les impérialismes occidentaux
Intervention de Robert Steuckers, 5ième université d'été de la F.A.C.E. et de «Synergies Européennes», Varese, Lombardie, 1 août 1997
 Les principales caractéristiques politiques du Japon avant son ouverture forcée en 1853 étaient:
Les principales caractéristiques politiques du Japon avant son ouverture forcée en 1853 étaient:
1. Un isolement complet
2. Un gouvernement assuré par le Shôgun, c'est-à-dire un pouvoir militaire.
3. La fonction impériale du Tennô est purement religieuse.
4. La société est divisée en trois castes:
- les Daimyos, seigneurs féodaux.
- les Samouraïs, fonctionnaires et vassaux.
- les Hinin, le peuple.
Sous le Shôgun YOSHIMUNE (1716-1745), le pouvoir impose:
- des taxes sur les biens de luxe afin d'"ascétiser" les daimyos et les samouraïs qui s'amollissaient dans l'hédonisme.
- une élévation des classes populaires.
- la diffusion de livres européens, à partir de 1720 (afin de connaître les techniques des Occidentaux).
Sous le Shôgun IEHARU (1760-1786), le Japon connaît une phase de déclin:
- la misère se généralise, les castes dirigeantes entrent en décadence (les tentatives de Yoshimune ont donc échoué).
- la misère générale entraîne le déclin du Shôgunat.
- on assiste alors à une réaction nationale, portée par le peuple, qui revalorise le shintoïsme et la figure du Tennô au détriment du Shôgun.
Avant l'ouverture, le Japon présente:
1. Une homogénéité territoriale:
- Trois îles + une quatrième en voie de colonisation, soit Kiou-Shou, Shikoku, Honshu + Hokkaïdo).
- Sakhaline et les Kouriles sont simplement perçues comme des atouts stratégiques, mais ne font pas partie du "sol sacré" japonais.
2. Une homogénéité linguistique.
3. Une certaine hétérogénéité religieuse:
- le Shinto est l'élément proprement japonais.
- le bouddhisme d'origine indienne a été ajouté à l'héritage national.
- le confucianisme d'origine chinoise est un corpus plus philosophique que religieux et il a été ajouté au syncrétisme bouddhisme/shintoïsme.
- la pratique du prosélytisme n'existe pas au Japon.
- la vie religieuse est caractérisée par une co-existence et un amalgame des cultes: il n'existe pas au Japon de clivages religieux antagonistes comme en Europe et en Inde.
- aucune religion au Japon n'aligne de zélotes.
4. Une homogénéité ethnique:
(la majeure partie de la population est japonaise, à l'exception des Aïnous minoritaires à Hokkaïdo, des Coréens ostracisés et d'une caste d'intouchables nommé "Eta").
Cette esquisse du Japon d'avant l'ouverture et ces quatre facteurs d'homogénéité ou d'hétérogénéité nous permettent de dégager trois leitmotive essentiels:
1. Contrairement à l'Occident chrétien ou même à l'Islam, le Japonais n'est pas religieux sur le mode de la disjonction (ou bien... ou bien...). Il ne dit pas: “je suis protestant ou catholique et non les deux à la fois”. Il est religieux sur le mode CUMULATIF (et... et...). Il dit: "Je suis ET bouddhiste ET shintoïste ET confucianiste ET parfois chrétien...). Le mode religieux du Japonais est le syncrétisme.
2. Le Japonais ne se perçoit pas comme un individu isolé mais comme une personne en relation avec autrui, avec ses ancêtres décédés et ses descendants à venir.
3. Pour le Japonais, la Nature est toute compénétrée d'esprits, sa conception est animiste à l'extrême, au point que les poissonniers, par exemple, érigent des stèles en l'honneur des poissons dont ils font commerce, afin de tranquiliser leur esprit errant. Les poissonniers japonais viennent régulièrement apporter des offrandes au pied de ces stèles érigées en l'honneur des poissons morts pour la consommation. A l'extrême, on a vu des Japonais ériger des stèles pour les lunettes qu'ils avaient cassées et dont ils avaient eu un bon usage. Ces Japonais apportent des offrandes en souvenir des bons services que leur avaient procurés leurs lunettes.
LE JAPON ET L'EUROPE:
Premiers contacts:
- Avec les Portugais (chargé d'explorer, de coloniser et d'évangéliser toutes les terres situées à l'Est d'un méridien fixé par le Traité de Tordesillas).
- Avec les Portugais s'installent les premières missions chrétiennes, composées de Franciscains, de Dominicains et de Jésuites.
- Le Shôgun IYEYASU est bouddhiste, membre de la secte Jodo, et s'oppose au christianisme parce que cette religion occidentale:
a) exclut les autres cultes et refuse leur juxtaposition pacifique;
b) génère des querelles incompréhensibles entre Franciscains et Dominicains espagnols d'une part et Jésuites portugais d'autre part;
c) parce que les Anglais et les Hollandais, qui harcèlent les deux puissances catholiques ibériques, promettent de ne pas s'ingérer dans les affaires religieuses du Japon, de ne pas installer de missions et donc de ne pas transposer les querelles de l'Occident au Japon.
- Après l'éviction des Portugais et des Espagnols catholiques, l'influence européenne la plus durable sera la hollandaise. Elle s'exercera surtout sur le plan intellectuel et scientifique, notamment en agriculture et en anatomie.
Le JAPON FACE AUX PUISSANCES LIBÉRALES (USA/GRANDE-BRETAGNE):
- Les Japonais se désintéressent des marchandises que leur proposent les Anglais.
- Pour gagner quand même de l'argent, les Anglais vendent de la drogue (opium).
- Ils obligent ensuite les Japonais à accepter des "traités inégaux", équivalent à un régime de "capitulations".
- Ils obligent les Japonais à accepter un statut d'EXTRA-TERRITORIALITÉ pour les résidents étrangers qui sont ainsi soustraits à toute juridiction japonaise (cette mesure a été prise à la suite de la décapitation de plénipotentiaires portugais de Macao, exécutés sans jugement et arbitrairement).
- Ils obligent les Japonais à renoncer à ériger tous droits de douane et à respecter de la façon la plus absolue le principe du "libre marché".
- Sans appareil politico-administratif issu d'un mercantilisme ou d'un protectionnisme bien étayés, les Japonais sont à la merci du capital étranger.
- Face à cette politique anglaise, qui sera appliquée également par les Etats-Unis à partir de 1853, les Japonais comprennent qu'ils doivent à tout prix éviter le sort de l'Inde, de la Chine et de l'Egypte (cette dernière était un Etat solidement établi au début du 19ième siècle, selon les principes de l'"Etat commercial fermé” de Fichte).
- Le Japon se rend compte qu'il doit adopter:
a) la technologie occidentale (armes à feu, artillerie, navires de guerre).
b) les méthodes d'organisation occidentales (il adoptera les méthodes prussiennes).
c) les techniques navales occidentales.
Pour ne pas être démuni face aux puissances européennes et aux Etats-Unis. Cette volonté de s'adapter aux technologies occidentales ouvrira l'Ere Meiji à partir de 1868.
Géopolitiquement, à partir de 1868, le Japon était coincé entre la Russie et les Etats-Unis. La Russie avançait ses pions en Sibérie orientale. Les Etats-Unis transformaient le Pacifique en lac américain.
LE JAPON FACE AUX ÉTATS-UNIS:
- Date clef: 1842. Cette année-là voit la fin de la première guerre de l'opium entre la Grande-Bretagne et la Chine. Londres impose aux Chinois le Traité de Nankin, où le Céleste Empire doit accepter la clause de la nation la plus favorisée à toutes les puissances occidentales. Sur le continent américain, les derniers soldats russes quittent leur colonie de Californie (Fort Ross).
- En 1844 est signé le Traité de Wanghia entre la Chine et les Etats-Unis. Ce Traité amorce la politique commerciale américaine en direction de l'immense marché potentiel qu'est la Chine. Jamais les Américains ne renonceront à conquérir ce marché.
- Dès le Traité de Wanghia, la volonté d'expansion des Etats-Unis dans le Pacifique prend forme.
- En 1845, cette longue marche en direction de l'hypothétique marché chinois commence sur le territoire américain lui-même, par la querelle de l'Oregon. Sur ce territoire sans souveraineté claire (ni britannique ni américaine), les Etats-Unis veulent imposer exclusivement leur souveraineté, car ils considèrent que cette région est un tremplin vers les immensités océaniques du Pacifique.
- Dans la presse de l'époque, les intentions géopolitiques des Etats-Unis s'expriment en toute clarté: «L'Oregon est la clef du Pacifique». Au Congrès, un Sénateur explique sans circonlocutions: «Avec l'Oregon, nous dominerons bientôt tout le commerce avec les îles du Pacifique-Sud et avec l'Asie orientale». Finalement, les Etats-Unis imposent leur volonté aux Britanniques (qui conservent néanmoins Vancouver, surnommé depuis une dizaine d'années, "Han-couver").
- En 1847, les Etats-Unis amorcent les premières négociations avec les Russes en vue d'acheter l'Alaska et les Aléoutiennes; ils envisagent ainsi de projeter leur puissance en direction de la Mer d'Okhotsk et du Japon (en 1867, vingt ans après le début des pourparlers, l'Alaska deviendra effectivement américain).
- En 1848, après une guerre avec le Mexique, les Etats-Unis annexent le Texas, le Nouveau-Mexique et la Californie. Ils possèdent désormais une façade pacifique.
- L'objectif est clairement esquissé: c'est la création d'un "nouvel empire" américain dans le Pacifique.
Le théoricien de cette expansion pacifique est William H. Seward. Ses théories se résument en huit points:
1. Cet empire sera commercial et non militaire.
2. Il devra compenser l'insuffisance du marché intérieur américain.
3. Il devra lancer et consolider l'industrie américaine.
4. Il devra être épaulé par un flotte de guerre importante.
5. Il devra être structuré par une chaîne de comptoirs, de points d'appui et de stations de charbon (pour les navires de commerce et de guerre).
6. Il ne devra pas être colonial au sens romain et européen du terme, mais se contenter d'une collection de “Hong-Kongs” américains.
7. Il devra viser le marché chinois et éviter toute partition de la Chine.
8. Il devra faire sauter les verrous japonais.
En 1853, avec l'expédition des canonnières du Commandant Perry, la marine américaine ouvre de force le Japon au commerce international. A partir de 1853, les Etats-Unis cherchent à contrôler îles et archipels du Pacifique.
Ce seront, tour à tour, Hawaï, Samoa (où ils s'opposeront aux Allemands et perdront la première manche) et les Philippines (qu'ils arracheront à l'Espagne à la suite de la guerre de 1898).
Avec l'acquisition des Philippines, les Etats-Unis entendent s'approprier le marché chinois, en chasser les puissances européennes et le Japon et y imposer à leur profit une économie des "portes ouvertes".
Le JAPON FACE À LA RUSSIE:
- Au 19ième siècle, la Russie s'étend en Eurasie septentrionale et en Asie Centrale. Elle vise à faire du fleuve Amour sa frontière avec la Chine, afin d'avoir pour elle le port de Vladivostok (gelé toutefois pendant quatre mois par an), puis d'étendre son protectorat à la Mandchourie et d'avancer ses pions en direction de la Mer Jaune, mer chaude, et d'utiliser Port Arthur pour avoir sa propre façade pacifique.
- La Russie encercle ainsi la Corée, convoitée par le Japon et coincée entre Vladivostok et Port Arthur.
- La Grande-Bretagne et les Etats-Unis veulent maintenir la Russie le plus loin possible de la Chine et du littoral pacifique.
- Pour contenir la Russie, la Grande-Bretagne conclut une alliance avec le Japon.
- L'appui de la haute finance new-yorkaise permet au Japon de bénéficier de crédits pour mettre sur pied une armée de terre et une marine de guerre.
- Au même moment, s'enclenche dans la presse libérale du monde entier une propagande contre le Tsar, "ennemi de l'humanité". Simultanément, émerge un terrorisme en Russie, qui agit comme cinquième colonne au profit des Britanniques, des financiers américains et des Japonais (qui servent de chair à canon).
- Le Japon frappe les Russes à Port Arthur par surprise, sans déclaration de guerre.
- La Russie doit envoyer sa flotte de la Baltique à la rescousse. Mais les Anglais ferment Suez et refusent de livrer eau potable et charbon aux navires russes.
- La Russie est battue et doit composer.
- Les Etats-Unis, qui avaient cependant soutenu le Japon, font volte-face, craignant la nouvelle puissance nippone en Mandchourie, en Corée et en Chine.
- Sous la pression américaine, les Japonais sont contraints de renoncer à toutes réparations russes, alors qu'ils comptaient sur celles-ci pour rembourser leurs emprunts new-yorkais.
- Les intrigues américaines font du Japon un pays endetté, donc affaibli, et, croit-on, plus malléable.
- Dès 1907, on assiste à un rapprochement entre Russes et Japonais.
- En 1910, les Japonais s'emparent définitivement de la Corée, sans pour autant inquiéter les Russes.
- De 1914 à 1918, les Japonais s'emparent des établissements et colonies du Reich dans le Pacifique et en Chine.
- Les Japonais interviennent dans la guerre civile russe en Sibérie:
a) ils appuient les troupes de l'Amiral Koltchak qui se battent le long du Transsibérien et dans la région du Lac BaÏkal au nord de la Mongolie.
b) ils appuient la cavalerie asiatique du Baron Ungern-Sternberg en Mongolie.
c) ils tentent de pénétrer en Asie centrale, via le Transsibérien, la Mandchourie et la Mongolie.
LE RETOURNEMENT AMERICAIN ET LA « CONFERENCE DE WASHINGTON »
- Les Etats-Unis s'opposent à cette pénétration japonaise et appuient en sous-main les Soviétiques en:
a) décrétant l'embargo sur les exportations de coton vers les Japon;
b) interdisant l'importation de soies japonaises aux Etats-Unis;
c) provoquant ainsi un chomâge de masse au Japon, lequel est dès lors incapable de financer ses projets géopolitiques et géoéconomiques en Asie septentrionale (Mandchourie et Mongolie).
- En 1922, se tient la CONFÉRENCE DE WASHINGTON.
Les Américains y imposent au monde entier leur point de vue:
1. L'Angleterre est priée de retirer définitivement tout appui au Japon.
2. Les Japonais doivent se retirer de Sibérie (et abandonner Koltchak et Ungern-Sternberg).
3. Les Japonais doivent rendre à la Chine le port ex-allemand de Kiao-Tchau.
4. La Chine doit pratiquer une politique des "portes ouvertes" (en théorie, le Japon et les Etats-Unis sont à égalité dans la course).
5. Les Etats-Unis imposent un équilibrage ou une limitation des marines de guerre:
- Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne peuvent aligner chacun 525.000 tonnes.
- Le Japon doit se contenter de 315.000 tonnes.
- L'Italie et la France se voient réduites à 175.000 tonnes chacune (Georges Valois, Charles Maurras et l'état-major de la marine française s'en insugeront, ce qui explique la germanophilie des marins français pendant la seconde guerre mondiale, de même que leur européisme actuel).
- La marine allemande est quasiment réduite à néant depuis Versailles et n'entre donc pas en ligne de compte à Washington en 1922.
- Le Japon est dès lors réduit au rôle d'une puissance régionale sans grand avenir et est condamné au "petit cabotage industriel".
- Les militaires japonais s'opposeront à cette politique et, dès 1931, une armée "putschiste", mais non sanctionnée pour avoir perpétré ce putsch, pénètre en Mandchourie, nomme Empereur du "Mandchoukuo, Pu-Yi, dernier héritier de la dynastie mandchoue et pénètre progressivement en Mongolie intérieure, ce qui lui assure un contrôle indirect de la Chine.
- Washington refuse le fait accompli imposé par les militaires japonais. C'est le début de la guerre diplomatique qui se muera en guerre effective dès 1941 (Pearl Harbour).
LE JAPON ET L'ALLEMAGNE:
C'est le facteur russe qui déterminera les rapports nippo-germaniques.
- L'Allemagne s'intéresse au Japon pour:
a) créer un front oriental contre la Russie qui se rapproche de la France.
b) créer une triplice Berlin-Pétersbourg-Tokyo.
- En 1898, au moment de la guerre hispano-américaine, le ministre japonais ITO HIROBUMI suggère une alliance eurasiatique entre l'Allemagne, la Russie et le Japon. C'est au Japon, en lisant les écrits du Prince Ito, que Haushofer a acquis cette idée de "bloc continental" et l'a introduite dans la pensée politique allemande.
- Mais en Allemagne on s'intéresse très peu au Japon et bien davantage à la Chine.
- Guillaume II est hanté par l'idée du "péril jaune" et veut une politique dure en Asie, à l'égard des peuples jaunes. Sa politique est de laisser faire les Russes.
- Par ailleurs, les diplomates allemands craignent que des relations trop étroites avec le Japon ne braquent la Russie et ne la range définitivement dans le camp français.
- L'Allemagne refuse de se joindre au Pacte nippo-britannique de 1902 contre la Russie et braque ainsi l'Angleterre (qui s'alliera avec la France et la Russie contre l'Allemagne en 1904: ce sera l'Entente).
- En 1905, la Russie, après sa défaite, quitte le théâtre extrême-oriental et jette son dévolu en Europe aux côtés de la France.
- L'Allemagne est présente en Micronésie mais sans autre atout: elle en sera chassée après la première guerre mondiale.
Les déboires et les maladresses de l'Allemagne sur le théâtre pacifique lui coûteront cher. Ce sera l'obsession du géopolitologue Haushofer.
Le DISCOURS DE LA POLITIQUE JAPONAISE:
Face à l'Europe et surtout aux Etats-Unis, à partir de la Conférence de Washington de 1922, quel discours alternatif le Japon va-t-il développer?
A. Les idéologies au Japon en général:
Pierre Lavelle, spécialiste français de la pensée japonaise distingue:
1. des formes idéologiques traditionnelles
2. des formes idéologiques néo-traditionnelles
3. des formes idéologiques modernes.
1. Les formes traditionnelles:
- Parmi les formes traditionnelles, le Shinto cherche à s'imposer comme idéologie officielle de la japonitude.
- Mais cette tentative se heurte au scepticisme des dirigeants japonais, car le Shinto éprouve des difficultés à penser le droit et la technique.
- Au cours des premières décennies de l'Ere Meiji, le bouddhisme perd du terrain mais revient ensuite sous des formes innovantes.
- Le confucianisme est revalorisé dans les milieux ultra-nationalistes et dans les milieux patronaux.
2. Les formes néo-traditionnelles:
- Leur objectif:
a) garder une identité nationale
b) cultiver une fierté nationale
c) faire face efficacement au monde extérieur avec les meilleures armes de l'Occident.
3. Les formes modernes:
- C'est d'abord la philosophie utilitariste anglo-saxonne qui s'impose au milieu du XIXième siècle.
- Après 1870, les orientations philosophiques japonaises s'inspirent de modèles allemands (ce qui perdurera).
- Vers 1895 disparaissent les dernières traces du complexe d'infériorité japonais.
- De 1900 à nos jours, la philosophie japonaise aborde les mêmes thématiques qu'en Europe et aux Etats-Unis.
- La dominante allemande est nette jusqu'en 1945.
- De 1955 à 1975 environ, le Japon connaît une période française. Michel Foucault est fort apprécié.
- Aujourd'hui, l'Allemagne reste très présente, ainsi que les philosophes anglo-saxons. Heidegger semble être le penseur le plus apprécié.
B. Le PANASIATISME (1):
L'idéal panasiatique repose sur deux idées maîtresses:
- Le Japon est puissance dominante qui a su rester elle-même et a assimilé les techniques de l'Occident.
- Le Japon est une puissance appelée à organiser l'Asie.
Dans cette optique, deux sociétés patriotiques émergent:
1) La Société du Détroit de Corée (Gen'yôsha).
2) La Société du Fleuve Amour (Kokuryûkai).
C. La “DOCTRINE D'ÉTAT”: POSITIONS ET FIGURES
Positions:
1. Centralité du Tennô/de la Maison Impériale.
2. Le Shintô d'Etat qui laisse la liberté des cultes mais impose un civisme à l'égard de l'Empereur et de la nation japonaise.
3. L'âme des sujets n'est pas distincte de l'Auguste Volonté du Tennô.
4. La vision sociale de Shibuwasa Eiichi (1841-1931):
a) subordonner le profit à la grandeur nationale;
b) subordonner la compétition à l'harmonie;
c) subordonner l'esprit marchand à l'idéalisme du samouraï.
Ce qui implique:
- des rapports non froidement contractuels;
- des relations de type familial dans l'entreprise.
5. L'idéal bismarckien d'un Etat social fort et protectionniste, s'inscrivant dans le sillage de l'école historique allemande.
6. Le développement d'un nationalisme étatique reposant, chez Inoue Testujiro (1856-1944):
a) sur une modernisation du confucianisme;
b) sur le panasiatisme;
c) sur le rejet du christianisme.
Et chez Takayama Chogyu (1871-1902) sur l'idée que le Japon est le champion des "Non-Aryens” dans la grande lutte finale entre les races qui adviendra.
7. Le développement concommittant d'un nationalisme populaire, dont les idées-forces sont:
a) le refus de l'étiquette occidentale dans les rituels d'Etat japonais.
b) la défense de l'essence nationale (kokusui).
c) la remise en cause de l'idée occidentale du progrès unilinéaire.
d) la nation est la médiation incontournable des contributions de l'individu à l'humanité.
Figures:
1. Miyake Setsurei (1868-1945):
- L'objectif du Japon doit être le suivant: il doit faire la synthèse de l'émotion chinoise, de la volonté indienne et de l'intelligence occidentale (la démarche, comme toujours au Japon, est une fois de plus CUMULATIVE).
- Le Japon doit être capable de bien faire la guerre.
- Le Japon doit éviter le piège du bureaucratisme.
- Le Japon doit adopter le suffrage universel, y compris celui des femmes.
2. Shiga Shigetaka (1863-1927):
- L'identité culturelle japonaise passe par une valorisation des paysages nationaux (Shiga Shigetaka est écologiste et géophilosophe avant la lettre).
- L'expansion dans le Pacifique doit se faire par le commerce plutôt que par les armes.
3. Okahura Tenshin (1862-1913)
- Le Japon doit prendre conscience de son asiatisme.
- Il doit opérer un retour aux valeurs asiatiques.
- Il doit s'inspirer de la démarche de l'Indien Rabindranath Tagore (1861-1941), champion de l'émancipation indienne et asiatique.
- Les valeurs asiatiques sont: le monisme, la paix, la maîtrise de soi, l'oubli de soi, une notion de la famille centrée sur la relation entre générations et non sur le couple.
4. Les nationalistes chrétiens:
Attention: les chrétiens japonais sont souvent ultra-nationalistes et anti-américains.
Pour les nationalistes chrétiens, les valeurs communes du christianisme et du Japon sont:
- la fidélité, l'ascèse, le sacrifice de soi, le dévouement au bien public, l'idée d'une origine divine de toute autorité.
Les chrétiens protestants:
a. Ebina Danjô (1856-1937):
- L'Ancien Testament doit être remplacé par la tradition japonaise.
- Le Tennô doit être adjoint à la Sainte-Trinité.
b. Uchimura Kanzô (1861-1930):
- L'Occident n'applique pas les principes chrétiens, c'est au Japon de les appliquer en les japonisant.
c. Les Catholiques:
En 1936, le Vatican s'en tire avec une pirouette: le Shintô n'est pas une religion, donc il est compatible avec le christianisme. Les Catholiques peuvent donc pratiquer les rites shintoïstes.
En conclusion, le christianisme japonais se présente comme un “christianisme de la Voie Impériale”.
Seuls les Quakers et les Témoins de Jéhovah ne s'y rallient pas.
D. L'ULTRA-NATIONALISME à partir des années 20:
Comme l'Alldeutscher Verband allemand ou la Navy League américaine, l'ultra-nationalisme japonais débute par la fondation d'une société: la SOCIÉTÉ DE LA PÉRENNITÉ (Yûzonsha).
Ses fondateurs sont: ÔKAWA SHÛMEI et KITA IKKI (1883-1937).
a. Kita Ikki:
- Kita Ikki plaide pour le socialisme et le culte de l'Etat.
- Il adhère à la "Société du Fleuve Amour".
- Il prône une solidarité avec la Chine, victime de l'Occident, dans une optique panasiatique.
- Il développe une vision "planiste" de la Grande Asie japonocentrée. Par "planisme", j'entends une vision tournée vers l'avenir, non passéiste, où la mission du Japon passe avant le culte du Tennô.
b. Ôkawa Shûmei (1886-1957):
- La pensée d'Ôkawa Shûmei est à dominante confucéenne.
- Il plaide pour une solidarité avec l'Islam.
c. Nakano Seigô (1886-1943):
- Il est le fondateur de la SOCIÉTÉ DE L'ORIENT (la Tôhôkai), qui sera active de 1933 à 1943.
- Il est le seul au Japon à se réclamer ouvertement du fascisme et du national-socialisme.
- Il plaide pour l'avènement d'un "socialisme national anti-bureaucratique".
- Dans sa défense et son illustrations des modèles totalitaires allemand et italien, il est seul car le Japon n'a jamais été, même pendant la guerre, institutionnellement totalitaire.
d. Le Général Araki Sadao (1877-1966):
- Il inscrit l'ultra-nationalisme japonais dans une perspective spirituelle et fonde la FACTION DE LA VOIE IMPÉRIALE (Kôdôha).
L'ultra-nationalisme japonais culminera pendant les années de guerre dans quatre stratégies:
- La valorisation de l'esprit (tiré des mânes des ancêtres et des dieux présents partout dans le monde) contre les machines.
- L'éradication de la culture occidentale moderne en Asie.
- La valorisation de l'"Autre Occident", c'est-à-dire l'Allemagne et l'Italie, où il mettre surtout l'accent sur l'héroïsme (récits militaires de la première guerre mondiale, pour servir d'exemple aux soldats), plutôt que sur le racisme de Mein Kampf, peu élogieux à l'égard des peuples jaunes.
- L'antisémitisme alors que le Japon n'a pas de population juive.
E. GÉOPOLITIQUE ET PANASIATISME (2):
Les sources de la géopolitique japonaise:
Les Japonais, bons observateurs des pratiques des chancelleries européennes et américaines, lisent dans les rapports de l'Américain Brooks Adams des commentaires très négatifs sur la présence allemande dans la forteresse côtière chinoise de Kiau-Tchéou, alors que les Russes se trouvent à Port Arthur.
Brooks Adams exprime sa crainte de voir se développer à grande échelle une politique de chemin de fer transcontinentale portée par les efforts de la Russie, de l'Allemagne et d'une puissance d'Extrême-Orient.
Devant une masse continentale unie par un bon réseau de chemin de fer, la stratégie du blocus, chère aux Britanniques et aux Américains, ne peut plus fonctionner.
Conclusion: Les Japonais ont été les premiers à retenir cette leçon, mais ont voulu prendre la place de la Chine, ne pas laisser à la Chine le bénéfice d'être la puissance extrême-orientale de cette future "troïka" ferroviaire.
D'où: les flottes allemande et japonaise doivent coopérer et encadrer la masse continentale russe et mettre ainsi un terme à la pratique des "traités inégaux" et inaugurer l'ère de la coopération entre partenaires égaux.
Après l'alliance anglaise de 1902 et après la victoire de 1905 sur la Russie, qui ne rapporte pas grand'chose au Japon, le Prince Ito, le Comte Goto et le Premier Ministre Katsura voulaient une alliance germano-russo-japonaise. Mais elle n'intéresse pas l'Allemagne. Peu après, le Prince Ito est assassiné en Corée par un terroriste coréen.
L'IDÉE D'UN "BLOC CONTINENTAL EURASIEN" est donc d'origine japonaise, bien qu'on le retrouve chez l'homme d'Etat russe Sergueï Witte.
F. Le PANASIATISME (3):
Quant au panasiatisme, il provient de trois sources:
1. Une lettre du révolutionnaire chinois Sun-Yat-Sen au ministre japonais Inoukaï: le leader chinois demandait l'alliance de la Chine et du Japon avec la Turquie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, pour "libérer l'Asie".
2. L'historien indien Benoy Kumar Sakkar développe l'idée d'une “Jeune Asie” futuriste.
3. Le discours de l'écrivain indien Rabindranath Tagore, exhortant le Japon à ne pas perdre ses racines asiatiques et à coopérer avec tous ceux qui voulaient promouvoir dans le monde l'émergence de blocs continentaux.
APRÈS 1945:
- La souveraineté japonaise est limitée.
- McArthur laisse le Tennô en place.
- Le Japon est autorisé à se renforcer économiquement.
Mais dès les années 80, ce statu quo provoque des réactions. La plus significative est celle de Shintaro Ishihara, avec son livre The Japan That Can Say No (1989 au Japon, avant la guerre du Golfe; 1991 dans sa traduction américaine, après la guerre du Golfe).
Dans cet ouvrage, Shintaro Ishihara:
- réclame un partenariat égal avec les Etats-Unis en Asie et dans le Pacifique.
- souligne les inégalités et les vexations que subit le Japon.
- explique que la politique des "portes ouvertes" ne réglerait nullement le problème de la balance commerciale déficitaire des Etats-Unis vis-à-vis du Japon.
- observe que si les Etats-Unis présentent une balance commerciale déficitaire face au Japon, c'est parce qu'ils n'ont jamais adapté correctement leur politique et leur économie aux circonstances variables dans le monde.
- observe que les pratiques japonaise et américaine du capitalisme sont différentes, doivent le rester et dérivent de matrices culturelles et historiques différentes.
- observe que l'imitation d'un modèle étranger efficace n'est pas un déshonneur. Le Japon a appris de l'Occident. Les Etats-Unis pourraient tout aussi bien apprendre du Japon.
- se réfère à Spengler pour dire:
a) il n'y a pas de "fin de l'histoire".
b) la quête de l'humanité se poursuivra.
c) comme Spengler l'avait prévu, la civilisation de demain ne sera possible que si se juxtaposent des cultures différentes sur la planète.
d) les différences ne conduisent pas à l'incompatibilité et à la confrontation.
- annonce que le Japon investira en Europe, notamment en Hongrie et en Tchéquie.
- suggère aux Américains un vaste programme de redressement, basé sur l'expérience japonaise.
La réponse américaine, rédigée par Meredith et Lebard (cf.) est:
- une réponse agressive;
- une réponse prévoyant une future guerre en Asie, mettant aux prises un Japon regroupant autour de lui une alliance avec l'Indonésie, Singapour, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, la Myanmar, l'Inde et la Chine. Cette alliance visera à contrôler à la place des Américains la route du pétrole du Golfe à Singapour et de Singapour au Japon, par un binôme marin Inde/Japon.
- Face à ce bloc est-asiatique et indien, les Etats-Unis doivent, disent Meredith et Lebard, mobiliser un contre-alliance regroupant la Corée, la Chine, Taïwan, l'Indonésie, l'Australie, les Philippines et Singapour.
- L'Indonésie et la Chine constituant les enjeux majeurs de cette confrontation.
Robert STEUCKERS,
Forest-Flotzenberg, juillet 1997.
BIBLIOGRAPHIE
Références principales:
- ISHIHARA, Shintaro, The Japan That Can Say No, Simon & Schuster, New York, 1991.
- LAVELLE, Pierre, La pensée politique du Japon contemporain, PUF, Paris, 1990.
- LAVELLE, Pierre, La pensée japonaise, PUF, Paris, 1997.
- SELLA, Piero, Da Madama Butterfly a Hiroshima. Origini e sviluppo dello scontro tra Giappone e Stati Uniti, Ed. L'uomo libero, Milano, 1996.
- WEHLER, Hans-Ulrich, Grundzüge der amerikanischen Außenpolitik 1750-1900, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1984.
- ZIEBURA, Gilbert, Weltwirtschaft und Weltpolitik 1922/24-1931, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1984.
Références secondaires:
- BAVENDAMM, Dirk, Roosevelts Krieg 1937-45 und das Rätsel von Pearl Harbor, Herbig, München, 1993.
- BREUILLY, John, Nationalism and the State, Manchester University Press, 1993 (2nd ed.) (Plus particulièrement le chapitre 11, «Reform Nationalism Outside Europe», pp. 230-253).
- BROSIUS, Hans, Fernost formt seine neue Gestalt, Deutsche Verlagsgesellschaft m. b. H., Berlin, s. d.
- COLLIN-DELAVAUD, Claude, Géopolitique de l'Asie, PUF, Paris, 1993.
- COUTAU-BéGARIE, Hervé, Géostratégie du Pacifique, Economica/IFRI, Paris, 1987.
- DONAT, Walter, «Der deutsche und japanische Reichsgedanke», in: Das Reich und Japan, Junker und Dünnhaupt, Berlin, 1943.
- ETRILLARD, Gilles & SUREAU, François, A l'Est du monde, Fayard, 1983.
- FRIEDMAN, George/LEBARD, Meredith, The Coming War with Japan, St. Martin's Press, New York, 1991.
- GOWEN, Herbert H., An Outline History of Japan, D. Appleton & Company, New York/London, 1927.
- HAMMITZSCH, Horst, «Die völkische Wiederbesinnung im Schrifttum des 18. und 19. Jahrhunderts in Deutschland und Japan, in: Das Reich und Japan, Junker und Dünnhaupt, Berlin, 1943.
- HÄNEL, Karl, Vom Sudan zum Kap, Goldmann, Leipzig, 1941 (Pour l'histoire des implantations commerciales japonaises en Afrique orientale avant 1941).
- HARDACH-PINKE, Irene, «Die Entstehung des modernen Japan und seine Wahrnehmung durch den Westen», in: HARDACH-PINKE, Irene (Hrsg.), Japan: eine andere Moderne, Konkursbuch/Claudia Gehrke, Tübingen, s.d.
- HAUSHOFER, Karl, Geopolitik der Pan-Ideen, Zentral-Verlag, Berlin, 1931.
- HAUSHOFER, Karl, «Panasien», in: HAUSHOFER, Karl (Hrsg.), Jenseits der Großmächte. Ergänzungsband zur Neubearbeitung der Großmächte Rudolf Kjellén, B.G. Teubner, Leipzig/Berlin, 1932.
- HAUSHOFER, Karl, «Panpazifischen Vorstellungen und Machtkreise», in: HAUSHOFER, Karl, Jenseits der Großmächte, op. cit.
- HAUSHOFER, Karl, «Ostasiatisches Kräftespiel», in: HAUSHOFER, Karl & FOCHLER-HAUKE, Gustav, Welt in Gärung. Zeitberichte deutscher Geopolitiker, Breitkopf & Härtel/Leipzig, Deutscher Verlag für Politik und Wirtschaft/Berlin, 1937.
- HAUSHOFER, Karl, «Erfahrungs-Lezitlinien zur Wehrgeopolitik des Indo-Pazifischen Raumes», in: HAUSHOFER, Karl, Wehr-Geopolitik, 1941.
- HAUSHOFER, Karl, Der Kontinentalblock. Mitteleuropa, Eurasien, Japan, Zentralverlag der NSDAP, Frz. Eher Nachf., München, 1941.
- HENRY, Paul-Marc, «Le Japon, les Etats-Unis et la Russie, triangle-clé du XXIième siècle», in: Géopolitique, n°37, 1992.
- HOGGAN, David L., Das blinde Jahrhundert. Erster Teil: Amerika, Grabert, Tübingen, 1979.
- JOYAUX, François, «La politique de sécurité japonaise à la croisée des chemins», in: Géopolitique, n°37, 1992.
- KOMURO, Tsuneo, «Der ostasiatische Großraum», in: Volk und Reich, Nr. 3/1942.
- KREINER, Josef (Hrsg.), Japan und die Mittelmächte im Ersten Weltkrieg und den zwanziger Jahren, Bouvier/Grundmann, Bonn, 1986. Recension: Orientations, n°11/1989.
- LEHMANN, Jean-Pierre, «The Cultural Roots of Modern Japan», in: HUTCHINSON John & SMITH Anthony D., Ethnicity, Oxford University Press, Oxford, 1996.
- LéVY, Roger, La révolte de l'Asie, PUF, Paris, 1965.
- MANDELBAUM, Jean, «Culture et Japon», in: Géopolitique, n°37, 1992.
- MAURER, Emil, Weltpolitik im Pazifik, Wilhelm Goldmann, Leipzig, 1942.
- MILZA, Pierre, Les fascismes, Imprimerie Nationale, Paris, 1985 (cf. le chapitre intitulé: «Le Japon: entre tradition et totalitarisme»).
- MORITA, Akio, Made in Japan, Fontana/Collins, 1986.
- NAOJI, Kimura, «Zur Rezeption “heroischer” deutscher Literatur in Japan 1933-1945», in: KREBS, Gerhard & MARTIN, Bernt (Hrsg.), Formierung und Fall der Achse Berlin-Tokyo. Monographien aus dem Deutschen Institut für Japanstudien der Philipp-Frantz-von-Siebold-Stiftung, Band 8, 1994.
- OKA, Yoshitake, Konoe Fumimaro. A Political Biography, University of Tokyo Press, 1983.
- OSTWALD, Paul, Deutschland und Japan. Eine Freundschaft zweier Völker, Junker & Dünnhaupt Verlag, Berlin, 1941.
- RAMMING, Martin, «Geschichtlicher Rückblick auf die deutsch-japanischen Beziehungen der älteren Zeit», in: Das Reich und Japan, Junker & Dünnhaupt, Berlin, 1943.
- ROSS, Colin, Das neue Asien, Brockhaus, Leipzig, 1942.
- ROTERMUND, Hartmut O., «Entre tradition et modernité: la religion et le Japon», in: Géopolitique, n°37, 1992.
- SCHUMACHER, Rupert von, «Panideen in der Weltpolitik», in: HAUSHOFER, Karl & FOCHLER-HAUKE, Gustav, Welt in Gärung. Zeitberichte deutscher Geopolitiker, Breitkopf & Härtel/Leipzig, Deutscher Verlag für Politik und Wirtschaft/Berlin, 1937.
- SEIGO, Nakano, «The Need for a Totalitarian Japan», in: GRIFFIN, Roger (ed.), Fascism, Oxford University Press, Oxford, 1995.
- SEIGO, Nakano, «Write Your Own Mein Kampf», in: GRIFFIN, Roger (ed.), Fascism, Oxford University Press, Oxford, 1995.
- SHILLONY, Ben-Ami, Politics and Culture in Wartime Japan, Clarendon Press, Oxford, 1991.
- WILKINSON, Endymion, «Le Japon, les Etats-Unis et l'Europe», in: Géopolitique, n°37, 1992.
- WIERSBITZKY, Kurt, «Südostasiens geopolitische Stellung in der Welt», in: HAUSHOFER, Karl & FOCHLER-HAUKE, Gustav, Welt in Gärung. Zeitberichte deutscher Geopolitiker, Breitkopf & Härtel/Leipzig, Deutscher Verlag für Politik und Wirtschaft/Berlin, 1937.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, extrême orient, océan pacifique, asie, affaires asiatiques, panasiatisme, impérialisme, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, histoire, histoire asiatique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 30 juin 2010
Lettre à un ami, trop sensible à la propagande de CNN...

SYNERGON - SYNERGIES EUROPÉENNES
Bruxelles/Metz
Mardi 20 avril 1999
ATELIER "MINERVE"
Lettre à un ami, trop sensible à la propagande de CNN...
par Robert Steuckers,
Secrétaire Général du Bureau Européen de SYNERGIES EUROPEENNES
Mon cher Quentin,
J'ai promis de répondre par une lettre ouverte à tes questions, traduisant l'inquiétude de nos contemporains face aux problèmes qui affectent la population albanaise du Kosovo aujourd'hui. Effectivement, plusieurs personnes m'ont posé les mêmes questions que toi: pourquoi nous sommes-nous engagés de manière aussi décisive contre l'intervention de l'OTAN, apparemment sans tenir compte des tragédies humaines qui plongent le Kosovo dans les horreurs de la guerre? Nous ne l'avons pas fait pour des raisons morales, mais pour des raisons historiques et géopolitiques, que je t'explicite dans cette lettre. Les souffrances des civils ne nous laissent pas indifférents et nous souhaitons que le programme de la Croix Rouge Internationale (CICR) pourra mettre ses structures au profit de toutes les victimes de cette guerre, dans l'esprit d'impartialité qui a fait la grandeur de Henri Dunant. Sur le plan géopolitique, je reste toutefois inébranlablement fidèle à un principe: l'espace européen, notre espace civilisationnel, ne peut en aucun cas subir des interventions américaines, chinoises, turques, islamistes ou autres. Ce doit être un axiome inébranlable dans notre pensée et notre action politiques.
Dans l'un de mes derniers communiqués, j'ai dit clairement que cette guerre n'a rien à voir avec les droits de l'homme, ni même avec le Kosovo ou les Albanophones de cette province d'Europe, ni même avec les Serbes ou avec Milosevic. Mais, pour les Américains et les Européens décérébrés et félons qui servent l'OTAN, instance foncièrement anti-européenne visant la ruine de notre culture, il s'agit avant toutes choses de bloquer le Danube, de bloquer l'Adriatique, de fermer l'espace aérien dans le Sud-est européen, de contrôler à leur guise la Méditerranée orientale et, enfin, de créer et d'entretenir le chaos dans un bon quart de notre continent pendant plusieurs décennies. Je raisonne en termes géopoltiques et rien qu'en termes géopolitiques, car un cadre géographique et historique cohérent est le seul garant possible d'une convivialité politique et civilisationnelle harmonieuse. Je ne suis l'apôtre d'aucune morale toute faite, prête-à-ânonner, d'aucune éthique de la conviction qui, dans tous les cas de figure, fait la bête en voulant faire l'ange. Bien sûr, je ne vais pas aller dire que Milosevic et ses soldats sont des enfants de choeur, tout comme les combattants de l'UCK kosovar ne sont pas davantage des enfants de choeur. Mais en temps de guerre, en politique, qui ose lever le doigt et dire: "moi, m'sieur, j'suis un bon, un gentil, un tout propre". Et les généraux de l'OTAN ne font certainement pas plus partie de la confrérie des enfants de choeur que les miliciens d'Arkan ou de l'UCK. Même s'ils prétendent qu'à coups de missiles, de bombes ou de roquettes, ils vont apporter le "Bien" (avec un grand "B") dans les Balkans, comme les cloches ou le Lapin de Pâques apportent des oeufs en chocolat à nos chères têtes blondes. Croire au "kalokagathon" des militaires de l'OTAN ou du SHAPE, c'est de la pure déraison!
Au lieu de hurler avec CNN, les intellectuels auto-proclamés et la sordide canaille journalistique (dont les plus répugnants exemplaires grenouillent à Paris) feraient bien mieux de lire quelques solides bouquins sur l'histoire de la péninsule balkanique. Dans les événements de ces dix dernières années, ni les Serbes ni les Croates ni les Albanais ne sont les "coupables" en dernière instance: les malheurs et les tragédies des Balkans sont le triste résultat de 500 ans de domination ottomane. Au cours de cette période horrible, les peuples des Balkans ont été écrasés, martyrisés, des populations entières ont été expulsées de leurs patries d'origine: les Serbes ont fui les armées ottomanes pour se réfugier en Croatie; les Croates se sont repliés en Slovénie, en Carinthie, en Italie et dans tout le reste de l'Europe (en France, il y avait des régiments croates), une partie des Albanais de souche ont dû s'installer en Italie du Sud. Les Ottomans et les convertis à l'Islam ont dominé sans partage. Chaque année, 10% des garçons étaient enlevés à leur famille, déportés en Anatolie, dressés dans des écoles de janissaires, transformés en mercenaires de la "Sublime Porte". Dans notre Occident pourri de confort, on a du mal à s'imaginer la profonde horreur que fut cette domination ottomane en Albanie, en Serbie, en Bosnie et en Croatie. Très tôt, les techniques de la guerre des partisans ont été appliquées contre les occupants dans les Balkans ottomanisés: les partisans de ces siècles d'oppression s'appelaient les Haiduks; en Albanie, ils ont été conduits par un capitaine sublime, surnommé Skanderbeg. Il avait été enlevé à sa famille, éduqué pour devenir janissaire: il s'est évadé d'Anatolie pour rejoindre son peuple dans les montagnes et combattre le joug ottoman. Dans les Balkans, il y a assez de thématiques historiques pour créer un cinéma européen pendant 300 ans, avec des films autrement plus captivants que les fades historiettes de cow-boys ou les soap-operas de la sous-culture américaine! Tout le folklore croate de Dalmatie et d'ailleurs, avec ses costumes magnifiques, rappelle la lutte pluriséculaire contre les Turcs. Pendant 500 ans, les Balkans se sont insurgés contre la culture composite de l'empire ottoman, exécrable préfiguration de la multiculture qu'on cherche à nous fourguer aujourd'hui comme la panacée définitive, qui mettra un terme aux tumultes de l'histoire et dissolvera toutes nos traditions, tous les ressorts de notre identité, toutes les constantes de nos systèmes juridiques. Relis les retentissantes sottises qu'ont écrites des Bernard-Henry Lévy et des Alain Finkielkraut. Mais cette mutliculture, on est bien forcé de le reconnaître, ne peut pas fonctionner. Elle laisse des séquelles indélébiles, elle provoque des tragédies que les siècles ne parviennent pas à effacer, elle déboussole les peuples, elle ne leur procure aucun apaisement. La preuve? La succession ininterrompue des tragédies balkaniques en ce siècle.
En Espagne, quand les armées asturiennes, aragonaises, castillanes et basques prennent enfin pied en Andalousie pour ramener cette terre à la grande patrie européenne, mettre ainsi un terme à la Reconquista et faire de la péninsule ibérique un Etat viable, ils se rendent rapidement compte qu'aucune culture composite ne permettra de donner une colonne vertébrale solide à cet Etat en jachère. Ou bien l'Ibérie était musulmane et appliquait un droit dérivé du Coran (ce qui est parfaitement respectable en soi), ou bien l'Ibérie était chrétienne et appliquait un droit dérivé du droit coutumier wisigothique (en vigueur en Espagne avant l'islamisation forcée et dans les régions non conquises par les Arabes). Un mixte de droit coranique et de droit coutumier germanique ne peut fonctionner harmonieusement, donc aucune convivialité sociale ne peut surgir si des règles boiteuses et peu claires sont appliquées dans la société. Cette impossibilité d'un droit composite a scellé le sort des vaincus, qui ont dû se replier en Afrique du Nord ou dans les provinces ottomanes, jusqu'à Istanbul, où ils pouvaient vivre sous le droit coranique selon leurs voeux et leurs convictions.
Dans les Balkans, après la terrible défaite des Serbes et de leurs alliés bosniaques, croates et albanais dans la Plaine du Kosovo, au Champ des Merles en 1389, les armées chrétiennes n'ont plus pu s'imposer. Une croisade hongroise du Roi Sigismund, aidée de chevaliers français et allemands, n'a pas pu délivrer les Balkans: elle a été écrasée en 1396 par le Sultan Bayazid Yildirim. La date de 1389 marque le début d'une affreuse tragédie pour l'Europe, qui s'agravera encore par la trahison du Roi de France, François Ier, qui s'allie aux Turcs pour prendre l'Europe centrale dans une redoutable tenaille: à l'Ouest les Français, à l'Est les Turcs. Cette alliance va durer 300 ans. Qu'on en juge: en 1526, François Ier veut s'emparer de la ville impériale de Milan. Charles-Quint, Empereur, le bat à Pavie, avec l'appui, notamment, d'une troupe d'élite: les bandes d'ordonnance des Pays-Bas, regroupant les meilleurs guerriers de la noblesse du Brabant, des Flandres, du Luxembourg et du Hainaut. Mais, l'alliance franco-turque déploie déjà sa logique implacable, celle des attaques concertées et simultanées, sur deux fronts: la même année que Pavie, les Ottomans envahissent et dévastent la Croatie, après leur victoire à Mohacs. Le vieil Etat médiéval croate, havre d'une culture incomparable, cesse d'exister, connait le même sort que la Serbie en 1389. La perte de la Croatie a été une tragédie pour l'Europe. Présents en Croatie, les Ottomans peuvent menacer et envahir la Hongrie et la Basse-Autriche à leur guise. Deux fois, Vienne sera assiégée et sauvée par le courage et la tenacité de ses milices bourgeoises et des troupes impériales et polonaises (Jan Sobiesky). Chaque fois que les Ottomans attaquent à l'Est, les Français attaquent à l'Ouest. Le Reich se défendra bec et ongles pour échapper à cette tenaille, épuisant toutes ses forces.
A la fin du 17ième siècle, se constitue la SAINTE-ALLIANCE (Bavière, Saint-Empire, Autriche-Hongrie, Pologne-Lithuanie, Russie), sous l'impulsion d'un Capitaine exceptionnel, le Prince Eugène de Savoie, qui force les Ottomans à céder 400.000 km2 aux pays de cette Sainte-Alliance. L'Empire ottoman recule partout, de la Dalmatie au Caucase. Le Reich peut respirer, mais insuffisamment: Louis XIV attaque à l'Ouest, ravage la Lorraine (50% de morts ou de réfugiés parmi les autochtones), la Franche-Comté (60% de morts et de réfugiés, notamment au Val d'Aoste), le Palatinat (66% de morts et de réfugiés). Comme dans les Balkans, les ressortissants du Saint-Empire de langue romane fuyent devant les Français comme leurs infortunés confrères des Balkans fuyaient devant les Turcs. Les Lorrains ont été recasés en Allemagne, en Suisse, dans les Pays-Bas, dans le Banat serbe et roumain, en Italie (où 6000 d'entre eux mourront de paludisme en tentant d'assécher les marais pontins près de Rome, que leur avait donnés le Pape...). En 1695, le Maréchal de Villeroy, pour soulager les Turcs et attirer vers l'Ouest une parties des armées impériales, fait bombarder à boulets rouges Bruxelles, gratuitement. C'est le premier bombardement terroriste de l'histoire, la sinistre préfiguration de Coventry, Dresde, Berlin, Hambourg, et, plus récemment, Hanoi, Bagdad et aujourd'hui Belgrade, Novi Sad, etc. La Sainte-Alliance et le Saint-Empire ont certes vaincu à l'Est, mais ils ont perdu à l'Ouest de belles provinces: la Flandre méridionale, l'Artois, le Cambrésis, la Bresse, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace. Preuve, s'il en est, qu'il est impossible de guerroyer sur deux fronts. En 1718, Belgrade est libérée par un régiment de Huy, ville de la vallée de la Meuse, où les drapeaux du Sultan, prix comme trophées, ont longtemps été conservés dans la collégiale.
En 1791, les Anglais se décident à soutenir en toutes circonstances la Turquie moribonde contre TOUTES les puissances européennes s'approchant de la Méditerranée orientale, point de passage obligé pour atteindre l'Egypte convoitée, où l'on envisageait déjà de creuser le Canal de Suez, pour rejoindre plus facilement les Indes, via la Mer Rouge. Cette politique de "containment" avant la lettre est consignée dans un mémorandum remis à Pitt, Premier Ministre anglais. Les axiomes de la politique maritime de l'Angleterre y ont été fixés une fois pour toutes: les Autrichiens ne doivent pas avancer trop loin dans les Balkans; les Russes, qui occupent la Crimée depuis 1783, doivent être contenus au Nord du Bosphore et ne pas se rendre totalement maîtres de la Mer Noire. Il faut réfléchir à ce mémorandum quand on analyse les événements d'aujourd'hui. La révolution française, en envahissant les Pays-Bas autrichiens en 1792, obligent, par leur diversion, les Serbes à capituler une nouvelle fois devant les Ottomans, à abandonner leur vague autonomie, récente et précaire, parce qu'ils ne bénéficient plus de l'appui militaire autrichien, Vienne étant obligée de mobiliser ses réserves, y compris ses régiments croates, pour faire face au déferlement des sans-culottes qui pillent et assassinent à qui mieux mieux de Tournai au Rhin (la magnifique abbaye de Villers-la-Ville sera ainsi réduite en cendres et jamais reconstruite). Ces hordes "révolutionnaires" faisaient le travail des Anglais: elles allaient éliminer quelques mois plus tard un Roi qui avait fait alliance avec l'Autriche et renoncé à la calamiteuse politique des François Ier, Richelieu et Louis XIV. Louis XVI avait mis sur pied de guerre une flotte redoutable qui avait réussi à battre la Royal Navy à Yorktown en 1783, humiliant ainsi Londres. Il avait ensuite lancé des expéditions lointaines (dont celle de La Pérouse qui l'a obsédé jusqu'au pied de l'échafaud: "A-t-on des nouvelles de La Pérouse?" a demandé ce Roi sage avant d'être décapité). L'Angleterre se débarrassait machiavéliquement d'un Roi apparemment débonnaire, mais dont la politique était européenne, offensive en direction de l'Atlantique et clairvoyante. Louis XVI est mort parce qu'il avait tourné le dos à l'alliance franco-turque, renoncé à la séculaire hostilité du Royaume de France au Saint-Empire, aperçu l'avenir de son pays au Canada (ces "arpents de neige" de la Pompadour...), dans l'Atlantique, sur les océans. Face à l'Ouest, dos au Reich, comme celui-ci pouvait désormais sans craindre de coup de poignard dans le dos, faire face aux Ottomans.
Ce n'est qu'à la fin du XIXième siècle que la France et la Russie manipuleront la Serbie contre l'Autriche. Mais avant cela, il a fallu éliminer totalement en 1903 la famille régnante des Obrenovic, qui seront remplacés par les Karageorgevic, qui dénonceront tous les liens antérieurs de la Serbie avec l'Autriche, détentrice de la dignité impériale. L'attentat de Sarajevo est le triste et dramatique aboutissement de cette prise du pouvoir par les Karageorgevic au détriment des Obrenovic. Après 1919 et la révolution bolchevique, la France exsangue utilise son or pour financer les gigantesques budgets des armées polonaises et yougoslaves (serbes), afin de contenir l'Allemagne, ni la nouvelle Turquie kémaliste ni la Russie bolchevique ne pouvant ou ne voulant plus jouer ce rôle. C'est une ironie de l'histoire de voir que la Serbie a accepté le rôle d'"ersatz" de la Turquie après le Diktat de Versailles. Mais rapidement des hommes d'Etat serbes s'apercevront que cette situation est artificielle et intenable sur le long terme; elle risquait de faire de la Yougoslavie un Etat assisté, incapable de développer de manière autonome une économie viable, en harmonie avec ses voisins. En 1934, la diplomatie de Goering (décrite par les Américains comme la tentative de construire dans le Sud-Est européen "a German informal Empire") réussit une réconciliation entre l'Allemagne et le Royaume de Yougoslavie, dirigée par la poigne de l'économiste serbe Milan Stojadinovic (1888-1961), qui comprend qu'une Yougoslavie isolée de ses voisins ne peut survivre économiquement. Stojadinovic renoue avec l'Italie et la Bulgarie (ennemie héréditaire de la Serbie) et s'appuie sur les Serbes, les Slovènes et les Bosniaques musulmans; sa popularité est nettement moindre chez les Croates catholiques (qui implicitement refuse l'alliance allemande, alors qu'on leur reproche aujourd'hui d'être des germanophiles inconditionnels!). L'alliance germano-yougoslave durera jusqu'en 1941. La Yougoslavie adhèrera à l'Axe. En mars 41, un putsch pro-britannique (Colonel Simovic) renverse le gouvernement légal. Les troupes de l'Axe entrent dans le pays pour sauver une légalité qui leur convenait. Les Croates changent de camp, trouvant dans une alliance avec l'Allemagne et l'Italie une chance de quitter l'Etat yougoslave qu'ils jugent composite (comme quoi rien n'est simple dans les Balkans, où les alliances changent souvent!). Avec l'entrée des troupes allemandes, hongroises, bulgares et italiennes, une tragédie sans nom s'abat sur tous les peuples de la Yougoslavie, avec, en plus, de nouveaux tracés pour les frontières intérieures, toujours contestés par les toutes les parties aujourd'hui, tant les populations, dispersées antérieurement par la terreur ottomane vivent les unes dans les autres, sans frontières précises. De 1941 à 1945, le gouvernement serbe du Général Nedic reste en selle, assez fidèle à l'Axe malgré le chaos dans lequel il plonge les Balkans. Il s'appuie sur une armée de 10.000 hommes bien entraînés et très disciplinés, dont les militaires allemands feront l'éloge. Mais le pays est plongé dans une abominable guerre civile: ethnie contre ethnie, mais aussi Serbes contre Serbes (soldats de Nedic, tchetniks royalistes et partisans titistes dans une terrifiante lutte triangulaire), Croates contre Croates (Oustachistes contre Partisans, Tito étant, ethniquement parlant, un Croato-slovène; Tudjman, l'actuel président croate, était partisan communiste, alors que des esprits simples, mal intentionnés et mal informés en font un fasciste de toujours!), Slovènes contre Slovènes (Domobrans contre Partisans), etc.
Aujourd'hui, après la mort de Tito, après l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie, l'alliance franco-turque de 1526 à 1792, l'alliance anglo-turque de 1791 à nos jours, fait place à un Axe américano-turc, visant à recréer une chaîne de petits Etat inféodés à l'OTAN et à la Turquie, pour faire pièce aux Européens dans le Sud-Est balkanique et y entretenir des foyers de tensions permanentes, semant la zizanie dans toute l'Europe. Ce sont essentiellement les Russes et les Allemands qui sont visés, mais aussi les Italiens qui ont toujours eu des intérêts en Méditerranée orientale (Rhodes, Cilicie), les Grecs (Chypre), les Chrétiens d'Orient (Liban, Syrie), la France (qui ne pourra plus jamais jouer son rôle de protectrice des chrétientés d'Orient). Le mémorandum adressé à Pitt est toujours d'actualité, mais c'est le Pentagone qui le concrétise dans les faits. Cette politique est inadmissible pour tous les Européens. Cette politique est anti-impériale, elle empêche l'Europe de retrouver une conscience impériale au sens de la Sainte-Alliance de 1690 à 1720. Tous ceux qui refusent de voir ce nouvel état de choses, de tirer clairement les leçons de l'histoire, sont des imbéciles. Ceux qui travaillent à occulter les leçons de l'histoire, ceux qui entretiennent délibérément l'ignorance des masses et des élites, ceux qui occupent des postes importants, ministériels ou autres, diplomatiques ou économiques, et qui ne raisonnent pas en termes d'histoire, sont de vils traîtres. Leur sort doit être mis aux mains d'une nouvelle Sainte-Vehme, tribunal occulte oeuvrant au seul salut du Saint-Empire. Et qui ne connait que deux sentences: l'acquittement ou la mort.
- Je suis un héritier spirituel des Bandes d'Ordonnance des Pays-Bas qui ont combattu contre François Ier à Pavie en 1526.
- Je suis un héritier spirituel de Don Juan d'Autriche, vainqueur à la bataille navale de Lépante en Méditerranée orientale en 1571, en tentant de reprendre Chypre aux Ottomans (puisse une flotte hispano-italo-franco-germano-croato-serbo-russo-grecque, totalement dégagée du machin OTAN, cingler très bientôt vers cette île et en faire un bastion inexpugnable de la Grande Europe!).
- Je suis un héritier spirituel du Prince Eugène de Savoie, que l'on nommait le Noble Chevalier ("Der edle Ritter").
- J'admire le long combat héroïque des Haiduks slaves et roumains et l'épopée du héros albanais Skanderbeg (tout Albanais qui ne rend pas hommage à Skanderbeg est un traître à son albanitude; tout Albanais qui ne combat pas pour son albanitude face au sud, dos au nord, n'est pas un Albanais, mais un mercenaire ottoman).
- Je place mes travaux géopolitiques sous le signe de la Sainte-Alliance de 1690 à 1720.
- Je suis un héritier spirituel des milices de la Ville de Bruxelles qui ont défendu leur ville contre les artilleurs terroristes du Maréchal de Villeroy, à côté des soldats bavarois et savoisiens de la garnison. Je te rappelle aussi, cher Quentin, qu'à l'âge de huit ans, mon cousin, de 22 ans mon aîné, m'a dit de toujours regarder la façade d'une maison de la Grand'Place de Bruxelles, sur laquelle figure un Phénix, symbolisant la cité et le Brabant résistant aux assauts du Roi Soleil et lui faisant la nique. Mon cousin m'a demandé de ne jamais oublier ce symbole. Je ne l'ai jamais oublié.
- Je suis un héritier spirituel des soldats hutois de l'armée autrichienne qui ont enlevé Belgrade en 1718, l'ont rendue à l'Europe.
- Je suis un héritier spirtuel des soldats des régiments de Baulieu, de Clerfayt, de Ligne, de Latour, qui ont tenté d'endiguer le flot des sans-culottes se déversant vers le Rhin en 1792, tandis que leurs alliés turcs reprenaient Belgrade sur le Danube et privaient les Serbes de leurs libertés.
- Je suis un héritier politique de Bismarck (et de Léopold I) qui s'opposaient à l'alliance anglo-franco-turque lors de la Guerre de Crimée contre la Russie, ancienne puissance de la Sainte-Alliance de 1690 à 1720.
- Je me souviens avec horreur de l'attentat de Sarajevo qui a coûté la vie à l'Archiduc d'Autriche et à son épouse, la Comtesse Chotek, tout comme je me souviens avec horreur du sort de la famille Obrenovic.
- Je déplore l'alliance franco-serbe d'après 1918, où la Serbie a été un "ersatz" de la Turquie ottomane et a été infidèle à son histoire.
- Je respecte rétrospectivement la politique économique et diplomatique de Milan Stojadinovic, soucieux de replacer son pays au sein de la famille des peuples de la Mitteleuropa et des Balkans.
- Je respecte l'attitude de Nedic, jeté dans un désarroi indescriptible, à l'époque la plus tragique de notre siècle.
- Je respecte tous les Yougoslaves, de quelle qu'ethnie que ce soit, qui ont combattu au cours de l'histoire du côté du Saint-Empire et de la Sainte-Alliance comme haiduks ou comme soldats réguliers, en particulier comme "granicar" (garde-frontières) le long du limes organisé par l'Autriche pour défendre l'Europe contre les Ottomans.
- Je déplore que Tito se soit laissé manoeuvrer par les Anglais contre les Allemands, les Hongrois, les Italiens et les Russes, sans pour autant condamner a priori sa politique de non-alignement (Bandoeng, etc.) et son socialisme fédéral et auto-gestionnaire, sorte de troisième voie entre le capitalisme et le panzercommunisme, à une époque où rien d'autre n'était possible.
- J'ai accepté l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie en 1991, parce que je sais que des Etats composites sont inviables, incapables de susciter l'adhésion à des codes de droit précis (curieux que les défenseurs, en théorie, des droits de l'homme, sont ceux qui manipulent des idéologies qui nient le droit concret, seul vecteur de civilité viable!). De plus, ces deux pays offraient enfin une façade méditerranéenne-adriatique aux pays d'Europe centrale, ce que la France et l'Angleterre ont toujours voulu leur confisquer, les condamnant à l'enclavement continental (on se souviendra ici des "départements illyriens" inventés par Napoléon pour couper la Hongrie et l'Autriche de la mer, fonction que devait reprendre la Yougoslavie selon Poincaré et Clémenceau).
- Je défends l'indépendance de ces deux pays, mais sans développer de serbophobie, à la manière de certains philosophes parisiens.
- Je pense que la Serbie a droit à sa spécificité au même titre que l'Albanie illyrienne, la Bosnie bogomil, la Croatie et la Slovénie. Toutes ces identités et spécificités s'enracinent et doivent nécessairement s'enraciner dans l'esprit haiduk (ou granicar).
- Je m'oppose à l'alliance américano-turque d'aujourd'hui, tout comme Bismarck s'est opposé à l'alliance anglo-franco-turque lors de la Guerre de Crimée.
- Je demeure un fidèle lecteur de Carl Schmitt (dont les deux épouses ont été serbes!), qui a théorisé l'interdiction d'intervention des puissances extérieures à un espace donné.
- Je demeure un fidèle disciple de Carl Schmitt, car je me souviens qu'il a décrit, avec force arguments juridiques solidement étayés, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis comme des Etats pirates.
- Je demeure encore et toujours un fidèle disciple de Carl Schmitt, dans le sens où il a toujours décrit les bons apôtres de la morale internationaliste comme de dangereux ferments de la dissolution des Etats, donc de la civilisation, de l'urbanité, de la culture et surtout du droit.
Telles sont mes positions. Je persiste et je signe. Rien ne m'ébranlera. Je suis dans la continuité historique donc dans le réel. Tant pis pour ceux qui restent en dehors de l'une et de l'autre.
Je reste à la disposition de mes lecteurs pour leur conseiller de bonnes lectures sur tout ce qui précède.
A bientôt, cher Quentin, meilleures amitiés.
Robert Steuckers.
00:05 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serbie, balkans, kosovo, guerre des balkans, otan, cnn? médias, manipulations médiatiques, histoire, yougoslavie, albanie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 juin 2010
Protocole de l'allocution de R. Steuckers lors de la conférence de presse du Dr. Saïd Haidar (ambassadeur d'Irak)

Protocole de l'allocution de Robert Steuckers lors de la conférence de presse du Dr. Said Haïdar, ambassadeur de la République d'Irak à Bruxelles, le vendredi 28 septembre 1990.
Excellence, Dr. Haïdar, Mesdames, Messieurs,
Depuis le déploiement des troupes américaines dans le désert arabique le long de la frontière irakienne, nous assistons à une unanimité suspecte, orchestrée par tous les médias du monde occidental, contre l'Irak et son Président. Toutes les grosses ficelles de la propagande ont été ressorties du placard et les poncifs négatifs autrefois utilisés contre Hitler, Mussolini, Staline, Nasser, Idi Amin Dada ou Khadafi ont retrouvé une nouvelle jeunesse. Ces exagérations bellicistes nous obligent à nous poser quelques questions d'ordre doctrinal. Avant-guerre, aux Etats-Unis, des intellectuels venus de tous les horizons idéologiques, s'étaient faits les avocats du «continentalisme», soit d'une doctrine de non-intervention dans les continents voisins. Pour ces hommes, l'Amérique ne devait intervenir ni en Europe ni en Asie et les Européens et les Asiatiques n'avaient rien à imposer au continent américain. Les diverses parties du monde, dans cette optique, devaient se centrer sur elles-mêmes afin de promouvoir une autonomie des grandes régions de notre planète, un organisation du monde en «grands espaces». Cette sagesse, ce bon sens, Roosevelt n'a pas voulu l'écouter et a de ce fait entraîné le peuple américain dans la guerre au nom des chimères mondialistes. L'Amérique avait, d'après Roosevelt, le devoir moral d'intervenir tous azimuts. Résultat, constaté il y a deux ou trois ans par le Professeur Kennedy: les finances américaines se sont épuisées à entretenir une machine de guerre à hauteur de cette incroyable prétention. Si l'on veut revenir au principe des «continentalistes», seule position acceptable hier comme aujourd'hui, l'Europe ni l'Amérique n'ont à intervenir dans les conflits du Proche- et du Moyen-Orient. Le conflit Iran-Irak, heureusement terminé, ou le conflit Irak-Koweit sont des affaires extérieures aux sphères européenne et américaine. La logique du bon sens voudrait donc que les Européens et les Américains n'interviennent pas dans ces conflits ou se bornent exclusivement à offrir leurs bons services de médiateurs. La morale concrète, soit une morale qui ne se base pas sur des abstractions irréalistes et désincarnées, nous impose de ne pas gaspiller des vies humaines, des vies de soldats, dans des conflits extérieurs à notre sphère vitale propre. Si l'on appliquait de tels principes concrets au lieu de s'inspirer de folies prétentieuses parées du label d'universalisme, on génèrerait de la paix partout dans le monde. L'idéologie universaliste des Américains, depuis Roosevelt, provoque des guerres mondiales, généralise l'horreur alors que le bon sens voudrait qu'on la limite par tous les moyens! Limiter volontairement nos actions à notre sphère continentale —l'européenne pour les Européens, l'américaine pour les Américains— signifie automatiquement localiser les guerres et non les étendre au monde entier.
Si un rappel du bon sens «continentaliste» est la première réflexion qui me vient en tête quand j'entends les médias aboyer leurs sornettes, la seconde réflexion qui me vient à l'esprit concerne les pétromonarchies. En se penchant sur la carte politique de la région où elles se situent, on est frappé par leur artificialité, une artificialité imposée depuis le démembrement de l'Empire Ottoman en 1918-19. Dans la région, la diplomatie britannique a pratiqué sa bonne vieille tactique: diviser pour régner. En d'autres termes, créer des Etats artificiels à l'embouchure des grands fleuves, afin de contrôler le commerce fluvial, donc l'économie de l'hinterland, et de tenir à sa merci les populations non littorales. Cette politique a été pratiquée par la France et la Suède en 1648, lors des traités de Westphalie. La création d'une Hollande sans hinterland à l'embouchure du Rhin et de la Meuse et l'occupation des embouchures de la Weser et de l'Elbe par la Suède avaient pour objectif de maintenir les Allemagnes en état de sujétion. La création de la Belgique en 1830 coupe la Confédération Germanique d'Anvers et fracasse l'unité viable du Royaume-Uni des Pays-Bas. La création du Koweit dans les années 20 de notre siècle suit la même logique: empêcher le développement optimal de la Mésopotamie irakienne, disposant d'atouts sérieux. De ce morcellement artificiel des territoires, découle une logique du blocus: si l'hinterland se montre récalcitrant, on bloque les ports, on étouffe l'économie et on affame la population.
Troisième réflexion: la création de ces petits Etats artificiels permet de concentrer les richesses en peu de mains: famille royale hollandaise, bourgeoisie belge, sheiks du Koweit. Minorités corrompues que l'on remettra en selle par tous les moyens si besoin s'en faut. Ce favoritisme exclusiviste généralise l'injustice sociale à très grande échelle. Le monde actuel vit cette anomalie très concrètement: j'en veux pour preuves les dettes immenses de l'Amérique latine et des autres zones du Tiers-Monde. Peron en Argentine, Mossadegh en Iran, Michel Aflak au Liban, en Syrie et en Irak ont voulu mettre un terme à cette aberration monstrueuse: leurs échecs relatifs ne doivent pas nous décourager. «Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer».
Quatrième réflexion: l'illogisme américain, qui consistait hier, en 1987, à envoyer la flotte de guerre pour escorter les pétroliers irakiens et qui consiste aujourd'hui à envoyer la même armada pour les bloquer, montre bien qu'il ne s'agit pas d'une «croisade pour le droit» mais d'une volonté délibérée de maintenir toute la région sous la coupe directe des intérêts américains et d'empêcher toute puissance régionale d'organiser l'espace proche- et moyen-oriental à sa guise. Peu importe si cette puissance régionale est l'amie d'hier... Le calcul impérialiste brut est à l'œuvre ici non la vertu.
Derrière tout cela se profile en fait un grave danger pour l'Europe. Depuis la chute du Mur de Berlin et l'avènement de Vaclav Havel à la Présidence de la République fédérative des Tchèques et des Slovaques, l'Europe vivait un processus de paix. Le centre du Vieux Continent se resoudait, les soldats hongrois et autrichiens démantelaient les barbelés et les miradors, la foule est-allemande exigeait la dissolution de la Stasi, etc. L'avenir était très prometteur: un redémarrage économique s'annonçait en Europe alors que rien ne laissait prévoir une diminution du déficit américain. L'Amérique, animée par les pires folies messianiques traduites pour le bon peuple, le bétail électoral, en termes de consommation, s'est ingéniée, depuis quarante ans, à mettre en œuvre les pires poncifs éculés du libéralisme sans racines et sans ancrage. Résultat: le système d'éducation va à vau-l'eau, la société chavire dans les pires indisciplines, n'accepte plus la moindre contrainte, croit vivre le paradis et s'étiole, se disloque, se désagrège. Deux hommes d'affaires japonais, dont l'ancien directeur de Sony, ont brossé de la société américaine un tableau peu séduisant. En pariant pour le «choix individuel», en bonne logique libérale-permissive, l'Américaine a bradé son avenir, tandis que l'Allemagne et le Japon (et surtout lui) n'ont cessé d'améliorer leurs systèmes d'éducation, de valoriser le savoir-faire de leurs forces vives, de mobiliser les énergies humaines de leurs nations. Pour échapper à la honte d'être vaincue par ceux qu'elle avait vaincus à coup de tapis de bombes ou par l'atomisation de Nagasaki et Hiroshima, l'Amérique, tenaillée par ses rancunes, cherche à limiter les bénéfices que pourraient engranger dans le court terme Allemands et Japonais. En tentant de leur faire payer les frais de l'opération folle amorcée dans le désert arabique, les Américains essayent tant bien que mal de retarder encore la marche en avant de l'Europe germano-centrée et de l'espace pacifique nippo-centré, exactement comme l'avait prédit le grand juriste européen Carl Schmitt. Les Etats-Unis, même s'ils se déclarent progressistes, sont en fait les grands retardateurs de l'histoire.
Retarder l'histoire, empêcher le centrage de l'Europe et l'émergence d'une sphère de co-prospérité asiatique en Extrême-Orient, empêcher tout dialogue constructif entre nations européennes et nations arabo-musulmanes, tenter de détourner les bénéfices européens et japonais dans le gouffre sans fond du gaspillage américain, voilà la logique égoïste de l'impérialisme yankee. Logique égoïste qui est aussi pour nous un défi. Un défi qui nous somme de ne pas imiter le relâchement des mœurs à l'américaine, de ne pas imiter la désinvolture américaine en matière d'enseignement, de tout miser en conséquence sur l'éducation de notre peuple, de trouver des autres sources d'énergie, selon l'adage qui veut que la science, l'inventivité des hommes, brise les monopoles. Dans le cas du pétrole, briser celui de l'Aramco.
Robert STEUCKERS.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : irak, belgique, guerre du golfe, histoire, moyen orient |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 21 juin 2010
Fondements du nationalisme russe

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES & du CRAPOUILLOT - 1994
Fondements du nationalisme russe
La Russie, dans son histoire, a toujours été étrangère aux dynamiques européennes. Son nationalisme, son idéologie nationale, sont marquées par un double jeu d'attraction et de répulsion envers l'Europe en particulier et l'Occident en général. Le célèbre slaviste italien Aldo Ferrari nous le rappelle: du 10ème au 13ème siècles, la Russie de Kiev est bien inserée dans le système économique médiéval. L'invasion tatare l'arrache à l'Occident, puis la Principauté de Moscou, en se réorganisant et en combattant les résidus de l'Empire Tatar, se veut une nouvelle Byzance orthodoxe, différente de l'Occident romain ou protestant. La victoire de Moscou amorce l'élan de la Russie vers les immensités sibériennes. De l'avènement de Pierre le Grand au règne de Catherine II et au 19° siècle, s'opère un timide rapprochement avec l'Ouest. Pour bon nombre d'observateurs, la révolution communiste inaugure une nouvelle phase de fermeture autarcique, de désoccidentalisation, en dépit de l'origine ouest-européenne de son idéologie, le marxisme.
Mais l'occidentalisation du 19° siècle n'a pas été unanimement acceptée. Dès le début du siècle, un courant fondamentaliste, romantique, nationaliste, se manifeste avec véhémence dans toute la Russie: contre les “occidentalistes”, il se veut “slavophile”. Le clivage majeur opposant la gauche et la droite venait de naître en Russie, dans le sillage du romantisme allemand. Il est toujours vivant aujourd'hui, où le débat est de plus en plus vif à Moscou. Le chef de file des occidentalistes du 19° était Piotr Tchaadaïev. Les figures les plus marquantes du camp “slavophile” étaient Kiréïevski, Khomiakhov et Axakov. L'occidentalisme russe s'est éparpillé en plusieurs directions: libéraux, anarchistes, socialistes. Les slavophiles développèrent un courant idéologique reposant sur deux systèmes de valeurs: la chrétienté orthodoxe et la communauté paysanne. En termes moins propagandistes, cela signifie l'autonomie des églises nationales (“autocéphales”) et un anti-individualisme farouche qui considèrent le libéralisme occidental, surtout l'anglo-saxon, comme une véritable abomination.
Au fil des décennies, ce dualisme va se complexifier. La gauche va, dans certaines de ses composantes, évoluer vers un particularisme russe, vers un socialisme anarcho-paysan anti-capitaliste. La droite slavophile va se muer en un “panslavisme” manipulé par le pouvoir pour assurer l'expansion russe en direction des Balkans (appui aux Roumains, aux Serbes, aux Bulgares et aux Grecs contre les Ottomans). Parmi ces “panslavistes”, le philosophe Nikolaï Danilevski, auteur d'une fresque historique audacieuse où l'Europe est considérée comme une communauté de peuples vieux, vidés de leurs énergies historiques, et les Slaves comme une phalange de peuples jeunes, appelés à régir le monde. Sous la direction de la Russie, les Slaves doivent s'emparer de Constantinople, reprendre le rôle de Byzance et construire un empire impérissable.
Face à ce programme de Danilevski, le philosophe Konstantin Leontiev, lui, veut une alliance entre l'Islam et l'Orthodoxie contre les ferments de dissolution libérale que véhicule l'Occident. Il s'oppose à toute guerre entre Russes et Ottomans dans les Balkans. L'ennemi est surtout anglo-saxon. La perspective de Leontiev séduit encore beaucoup de Russes aujourd'hui. Enfin, dans le Journal d'un écrivain, Dostoïevski développe des idées similaires (jeunesse des peuples slaves, perversion de l'Occident libéral) auxquelles il ajoute un anti-catholicisme radical qui inspirera notamment les “nationaux-bolchéviques” allemands du temps de Weimar (Niekisch, Paetel, Moeller van den Bruck qui fut son traducteur).
A la suite de la construction du chemin de fer transsibérien sous l'énergique impulsion du Ministre Witte, émerge une idéologie pragmatique et autarcique, l'“eurasisme” qui veut se mettre au service de l'espace russe, que celui-ci soit dirigé par un Tsar ou par un Vojd (un “Chef”) soviétique. Les idéologues “eurasiens” sont Troubetzkoï, Savitski et Vernadsky. Pour eux, la Russie n'est pas un élément oriental de l'Europe mais un continent en soi, qui occupe le centre des terres émergées que le géopoliticien britannique Halford John Mackinder appelait la “Terre du Milieu”. Pour Mackinder, la puissance qui parvenait à contrôler la “Terre du Milieu” se rendait automatiquement maîtresse de la planète. En effet, cette “Terre du Milieu”, en l'occurrence la zone s'étendant de Moscou à l'Oural et de l'Oural à la Transbaïkalie, était inaccessible aux puissances maritimes comme l'Angleterre et les Etats-Unis. Elle pouvait donc les tenir en échec. La politique soviétique, surtout à l'heure de la guerre froide, a toujours tenté de réaliser dans les faits les craintes du géopoliticien Mackinder, c'est-à-dire à rendre le centre russo-sibérien de l'URSS inexpugnable. Même à l'ère du nucléaire, de l'aviation et des missiles transcontinentaux. Cette “sanctuarisation” de la “Terre du Milieu” soviétique a constitué l'idéologie officieuse de l'Armée Rouge, de Staline à Brejnev. Les néo-nationalistes impériaux, les nationaux-communistes, les patriotes actuels s'opposent à Gorbatchev et à Eltsine parce qu'ils les accusent d'avoir dégarni les glacis est-européens, ukrainiens, baltes et centre-asiatiques de cette “Terre du Milieu”.
Voilà pour les prémisses du nationalisme russe, dont les multiples variantes actuelles oscillent entre un pôle populiste-slavophile (“narodniki”, de “narod”, peuple), un pôle panslaviste et un pôle eurasien. Pour Aldo Ferrari, le nationalisme russe actuel se subdivise entre quatre courants: a) les néoslavophiles; b) les eurasistes; c) les nationaux-communistes; d) les nationalistes ethniques.
Les néoslavophiles sont essentiellement ceux qui épousent les thèses de Soljénitsyne. Dans Comment réaménager notre Russie?, l'écrivain exilé aux Etats-Unis prône une cure d'amaigrissement pour la Russie: elle doit abandonner toutes ses velléités impériales et reconnaître pleinement le droit à l'auto-détermination des peuples de sa périphérie. Soljénitsyne préconise ensuite une fédération des trois grandes nations slaves de l'ex-URSS (Russie, Biélorussie et Ukraine). Il vise ensuite la rentabilisation maximale de la Sibérie et suggère une démocratie basée sur de petites communautés, un peu sur le modèle helvétique. Les autres néo-nationalistes lui reprochent de mutiler la patrie impériale et de propager un utopisme ruraliste, irréalisable dans le monde hyper-moderne où nous vivons.
Les eurasistes sont partout dans l'arène politique russe actuelle. Le philosophe auquel ils se réfèrent est Lev Goumilev, une sorte de Spengler russe qui analyse les événements de l'histoire d'après le degré de passion qui anime les peuples. Quand les peuples sont passionnés, ils créent de grandes choses. Quand la passion intérieure s'estompe, les peuples déclinent et meurent. Tel est le sort de l'Occident. Pour Goumilev, les frontières soviétiques sont intangibles mais la Russie nouvelle doit respecter le principe du pluriethnisme. Pas question donc de russifier les peuples de la périphérie mais d'en faire des alliés définitifs du “peuple impérial”. Goumilev, décédé en juin 1992, interprétait dans un sens laïc les idées de Leontiev: peuples turcophones d'Asie centrale et Russes devaient faire cause commune, sans tenir compte de leurs différences religieuses. Aujourd'hui, l'héritage de Goumilev se retrouve dans les colonnes d'Elementy, la revue de la “nouvelle droite” russe d'Alexandre Douguine, et de Dyeïnn (devenu Zavtra, après l'interdiction d'octobre 1993), le journal d'Alexandre Prokhanov, chef de file des écrivains et journalistes nationaux-patriotiques. Mais on le retrouve aussi chez certains musulmans du “Parti de la Renaissance Islamique”, notamment Djemal Haïdar. Plus curieux, deux membres du staff d'Eltsine, Rahr et Tolz, sont des adeptes de l'eurasisme. Leurs conseils n'ont guère été suivis d'effet jusqu'ici.
Les nationaux-communistes revendiquent la continuité de l'Etat soviétique en tant qu'entité historique et espace géopolitique autonome, précise Aldo Ferrari. Mais ils ont compris que les recettes marxistes n'étaient plus valables. Ils se revendiquent aujourd'hui d'une “troisième voie” où la notion de solidarité nationale est cardinale. C'est notamment le cas du chef du PC de la Fédération de Russie, Guennadi Zouganov.
Les nationalistes ethniques s'inspirent davantage de l'extrême-droite russe d'avant 1914, qui entend préserver la “pureté ethnique” du peuple. En un certain sens, ils sont xénophobes et populistes. Ils souhaitent le retour des Caucasiens dans leur pays et manifestent parfois un antisémitisme virulent, selon la tradition russe.
Le néo-nationalisme russe s'inscrit bel et bien dans la tradition nationale et s'enracine dans des corpus doctrinaux du 19° siècle. En littérature, dans les années 60, les néo-ruralistes (Valentin Raspoutine, Vassili Belov, Soloükhine, Fiodor Abramov, etc.) parviennent à évincer totalement les “libéraux occidentalistes”, amorçant de la sorte une véritable “révolution conservatrice”, avec la bénédiction du pouvoir soviétique! La revue littéraire Nache Sovremenik s'est faite le véhicule de cette idéologie néo-orthodoxe, paysanne, conservatrice, soucieuse des valeurs éthiques, écologiste. Le communisme, disent-ils, a extirpé la “conscience mythique” et créé une “humanité de monstres amoraux”, totalement “dépravés”, prêts à accepter les mirages occidentaux. Enfin, cette “révolution conservatrice” s'imposait tranquillement en Russie tandis qu'en Occident la “chienlit” soixante-huitarde (De Gaulle) provoquait la catastrophe culturelle que nous subissons encore. Les conservateurs russes mettaient aussi un terme au fantasme communiste du “filon progressiste de l'histoire”. Les communistes, en effet, sélectionnaient dans le passé russe ce qui annonçait la révolution et rejetaient tout le reste. Au “filon progressiste et sélectif”, les conservateurs opposaient le “flux unique”: ils valorisaient du même coup toutes les traditions historiques russes et relativisaient mortellement la conception linéaire du marxisme.
Robert STEUCKERS.
Bibliographie:
- Aldo FERRARI, «Radici e prospettive del nazionalismo russe», in Relazioni internazionali, janvier 1994.
- Robert STEUCKERS (éd.), Dossier «National-communisme», in Vouloir, n°105/108, juillet-septembre 1993 (textes sur les variantes du nationalisme russe d'aujourd'hui, sur le “national-bolchévisme” russe des années 20 et 30, sur le fascisme russe, sur V. Raspoutine, sur la polémique parisienne de l'été 93).
- Gerd KOENEN/Karla HIELSCHER, Die schwarze Front, Rowohlt, Reinbeck, 1991.
- Walter LAQUEUR, Der Schoß ist fruchtbar noch. Der militante Nationalismus der russischen Rechten, Kindler, München, 1993.
- Mikhaïl AGURSKI, La Terza Roma. Il nazionalbolscevismo in Unione Sovietico, Il Mulino, Bologne, 1989.
- Alexandre SOLJENITSYNE, Comment réaménager notre Russie?, Fayard, Paris, 1990.
- Alexandre DOUGUINE (DUGHIN), Continente Russia, Ed. all'insegna del Veltro, Parme, 1991. Extrait dans Vouloir n°76/79, 1991, «L'inconscient de l'Eurasie. Réflexions sur la pensée “eurasiatique” en Russie». Prix de ce numéro 50 FF (chèques à l'ordre de R. Steuckers).
- Alexandre DOUGUINE, «La révolution conservatrice russe», manuscrit, texte à paraître dans Vouloir.
- Konstantin LEONTIEV, Bizantinismo e Mondo Slavo, Ed. all'insegna del Veltro, Parme, 1987 (trad. d'Aldo FERRARI).
- N.I. DANILEVSKY, Rußland und Europa, Otto Zeller Verlag, 1965.
- Michael PAULWITZ, Gott, Zar, Muttererde: Solschenizyn und die Neo-Slawophilen im heutigen Rußland, Burschenschaft Danubia, München, 1990.
- Hans KOHN, Le panslavisme. Son histoire et son idéologie, Payot, Paris, 1963.
- Walter SCHUBART, Russia and Western Man, F. Ungar, New York, 1950.
- Walter SCHUBART, Europa und die Seele des Ostens, G. Neske, Pfullingen, 1951.
- Johan DEVRIENDT, Op zoek naar de verloren harmonie - mens, natuur, gemeenschap en spiritualiteit bij Valentin Raspoetin, Mémoire, Rijksuniversiteit Gent/Université d'Etat de Gand, 1992 (non publié).
- Koenraad LOGGHE, «Valentin Grigorjevitsj Raspoetin en de Russische traditie», in Teksten, Kommentaren en Studies, n°71, 1993.
- Alexander YANOV, The Russian New Right. Right-Wing Ideologies in the Contemporary USSR, IIS/University of California, Berkeley, 1978.
- Wolfgang STRAUSS, Rußland, was nun?, Österreichische Landmannschaft/Eckart-Schriften 124, Vienne, 1993.
- Pierre PASCAL, Strömungen russischen Denkens 1850-1950, Age d'Homme/Karolinger Verlag, Vienne (Autriche), 1981.
- Raymond BEAZLEY, Nevill FORBES & G.A. BIRKETT, Russia from the Varangians to the Bolsheviks, Clarendon Press, Oxford, 1918.
- Jean LOTHE, Gleb Ivanovitch Uspenskij et le populisme russe, E.J. Brill, Leiden, 1963.
- Richard MOELLER, Russland. Wesen und Werden, Goldmann, Leipzig, 1939.
- Viatcheslav OGRYZKO, Entretien avec Lev GOUMILEV, in Lettres Soviétiques, n°376, 1990.
- Thierry MASURE, «De cultuurmorfologie van Nikolaj Danilevski», in Dietsland Europa, n°3 et n°4, 1984 (version française à paraître dans Vouloir).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, russie, nationalisme, eurasisme, eurasie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 20 juin 2010
Octobre 1993: les événements tragiques de Moscou
 SYNERGIES EUROPÉENNES
SYNERGIES EUROPÉENNES
VOULOIR
OCTOBRE 1993
Les événements tragiques de Moscou
Communiqué de presse du comité de rédaction de VOULOIR
Le comité de rédaction de la revue VOULOIR déplore les événements tragiques qui viennent de se dérouler à Moscou. Il estime:
- que, dans la querelle qui oppose le Parlement à la Présidence, il n'a pas été suffisamment tenu compte des conseils modérateurs du Dr. ZORKINE, Président du Tribunal Constitutionnel russe, qui prône un équilibre entre l'exécutif et le législatif.
- que les appels du Patriarche Alexis ll, qui s'était naguère insurgé contre l'américanisation des mœurs en Russie, sont dignes d'être écoutés et devraient davantage susciter l'intérêt de nos médias.
- que la position de Gorbatchev, peu suspect de soutenir les nationalistes ou les communistes du Parlement, est aux antipodes du manichéisme de nos médias; en effet, Gorbatchev déplore, comme nous, le recours à la force et la dissolution du Parlement proclamée récemment par l'exécutif. Cette position commune de Gorbatchev, de certains parlementaires russes et de notre groupe, montre qu'on ne peut construire une démocratie ex nihilo, et que toute démocratie russe doit reposer sur les structures déjà existantes, quitte à les réformer progressivement.
- que les événements tragiques de ces deux derniers jours sont le résultat d'une déplorable précipitation et que la libéralisation de l'économie russe aurait dû s'effectuer sur le mode chinois, comme l'ont mentionné conjointement dans un débat à Moscou, le 1 er avril 1992, Alain de BENOIST (chef de file de la "Nouvelle Droite" française), Robert STEUCKERS (Directeur de Vouloir), Edouard VOLODINE (idéologue du FSN) et Guennadi ZOUGANOV (Président du nouveau "Parti Communiste Russe"). La Chine a procédé graduellement à une libéralisation de son économie, zone après zone. C'est ce modèle que préconise le FSN, à juste titre, nous semble-t-il.
- que les responsabilités de l'immense gâchis russe incombent principalement aux protagonistes de l'idéologie libérale pure, injectée dans la société russe lors de la libéralisation des prix de janvier 1992 par l'équipe de Mr. GAlDAR. Cette libéralisation a jeté de larges strates de la population moscovite dans la plus extrême précarité.
- que la position d'ELTSlNE a été fragilisée par les événements des 2 et 3 octobre 1993, du fait que sa police n'a pas pu tenir la rue, contrairement à ce qui avait été promis solennellement, et que sa démocratie s'impose en pilonnant le Parlement, alors que ce bâtiment aurait dû demeurer inviolable envers et contre tout, servir ultérieurement d'instrument à une démocratie réformée, partant de la base, des "Conseils" élargis à tous les éléments dynamiques de la population.
- Enfin, notre comité de rédaction déplore que le sang russe ait coulé, présente ses hommages et ses respects à toutes les victimes de cette tragédie, quel que soit leur camp. Par aileurs, nous signalons que Michel SCHNEIDER, qui avait accepté d'être l'un de nos correspondants à Moscou, a été blessé à l'épaule à proximité des bâtiments de la télévision dimanche soir. Et que Mme Larissa GOGOLEVA, qui était son interprète, a été très grièvement blessée par balle au même endroit. Notre comité rend hommage au courage de cette jeune femme, tombée dans l'exercice de sa profession et rappelle qu'elle avait traduit en russe plus d'un texte émanant de nos publications.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, russie, moscou, années 90 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 juin 2010
Cù Chulainn in the GPO: The Mythic Imagination of Patrick Pearse
 Cù Chulainn in the GPO:
Cù Chulainn in the GPO:
The Mythic Imagination of Patrick Pearse
Michael O'MEARA
Ex: http://www.counter-currents.com/
 On Easter Monday, April 24, 1916, while all Europe was mobilized for the first of its terrible civil wars, Patrick Pearse, James Connolly, and several hundred “militia men” from the Irish Citizen Army and the Nationalist Volunteers commandeered the General Post Office on Dublin’s O’Connell (then Sackville) Street.
On Easter Monday, April 24, 1916, while all Europe was mobilized for the first of its terrible civil wars, Patrick Pearse, James Connolly, and several hundred “militia men” from the Irish Citizen Army and the Nationalist Volunteers commandeered the General Post Office on Dublin’s O’Connell (then Sackville) Street.
Once a defensive parameter was established around the stately, neo-classical symbol of British rule, the tall, lanky 37-year-old Pearse, titular head of the self-proclaimed “provisional government of the Irish Republic,” appeared on the GPO’s steps to read out to a small crowd of bewildered and skeptical by-standers a proclamation.
“Irishmen and Irishwomen: In the name of God and the dead generations from which she receives her old tradition of nationhood, Ireland, through us, summons her children to her flag and strikes for her freedom.”
This line — the entire proclamation, even — is a work of art.
Some say the Uprising itself was a work of art.
***
As the GPO was being fortified on the 24th, 700 or 800 lightly-armed rebels, most with shotguns and home-made bombs, some with rifles secretly obtained from Germany — (the same “gallant ally in Europe” who allied with the IRA in the next European civil war) — spread out across Dublin, occupying other public buildings and sites associated with the Crown.
The Uprising was not a direct military assault on British authority per se (the rebels lacked the fire power). It was nevertheless an armed assertion of Irish authority — an authority however poorly armed that was nevertheless imbued with a powerful idea — the idea that does not tire or break and that imparts “its mantle of strength upon those in its service” — the idea of destiny (Francis Parker Yockey).
***
The English garrison in Ireland, larger than the garrison that held India, was caught entirely off-guard by the insurrection.
There was good reason for this.
In 1914 the Irish Parliamentary Party had not only pledged to support the British government, as Germany challenged its supremacy on the killing fields of Flanders and Northern France, the party called on its paramilitary wing, the 170,000 strong Irish Volunteers, to enlist in the British army. (The ten to twenty thousand Volunteers who refused to follow the IPP’s lead, those rechristened “the Nationalist Volunteers,” were to be the Uprising’s principal military arm, though their mobilization, for reasons too complicated to explain here, was countermanded at the last moment).
The Irish people, one of the most dispossessed and economically distressful of Europe’s peoples, were enjoying a brief spell of good times, as employment and agriculture flourished in the wake of the British war effort.
Westminster had also promised to implement Home Rule, once the war ended.
Ireland never seemed more securely in English hands.
***
The rebellion was greeted with surprise and rage — by both the British government and the Irish population.
This would change, as the government turned the rebels into martyrs, “snatching political defeat from the jaws of military victory.”
In the view of much of the world, especially among the popular classes of nationalist-minded Irish-America, the forces of the crown were seen as reacting with characteristic English brutality, as their powerful naval guns pounded Britain’s second most important city, destroying the GPO and much of the city’s heart, as well as wounding or killing a thousand civilians
James Connolly, that most Aryan of Marxists, had thought the British forces, beholden to English capital, would never turn their guns on their own commercial property: Little did he know — and little did he realize that his sophisticated understanding of urban warfare would crumble before this fact.
Ground troops, supported by field artillery, then suppressed the lingering rebellion on the streets — though not before Pearse ordered a general surrender, once it was clear civilians were the main victim of Britain’s crushing counter-attack.
***
Like most of the six armed rebellions the Irish had raised in the previous 200 years, there was a good deal of futility and desperation in the Easter Uprising — begun on Monday and extinguished, at least so everyone thought, by the following Saturday.
Pearse, Connolly, and much of the Irish Republican Brotherhood responsible for the insurrection had, in fact, no illusion that they would succeed or even survive the Uprising.
Once rounded up, the fifteen nationalist leaders of the revolt were court martialed and shot.
“Dear, dirty Dublin” came, then, to resemble the war-ravaged towns and cities along the Franco-German front, as the cause of Irish freedom seemed to suffer another damning setback.
Yet five years later, Ireland was a nation once again.
***
Like much of the Uprising’s revolutionary nationalist leadership, Pearse sought a path that led away not just from British rule, but from British modernity — which, like its larger civilizational expression, seemed to suffocate everything heroic and great in life.
Against the empire’s cold mechanical forces, he arrayed the powerful mythic pulse of the ancient Gaels.
As Carl Schmitt might have described it: “Against the mercantilist image of balance there appears another vision, the warlike image of a bloody, definitive, destructive, decisive battle.”
Pearse was not alone in thinking myth superior to matter.
Indeed, his Ireland was Europe in microcosm — the Europe struggling against the forces of the coming anti-Europe.
In Germany, no less than in Ireland, powerful cultural movements based on “peasant” mythology and traditional culture had arisen to repulse the modern world — movements which did much to revive the spirit of Western Civilization (before it was again struck down by the ethnocidal Pax Americana).
In Germany this movement frontally challenged the continental status quo, in Ireland it challenged the British Empire.
Lacking a political alternative, the frustrated national unity of 19th-century “Germany” had looked to increase its cultural cohesion and self-consciousness.
Like its German counterpart, Ireland’s Celtic Twilight was part of a larger European movement — of a romantic and romanticizing nationalism — to revive the ancient Volk culture in its struggle against the anti-national forces of money and modernity.
Though the Famine had delayed the movement’s advent in Ireland, it came.
The cultural phase of Irish nationalism formally began with Parnell’s fall in 1889. Turning away from the personal and political tragedy of their uncrowned king, nationalists started re-thinking their destiny in other than political terms.
If the Germans, in the cultural assertion of their nationalism, had to free themselves from the overwhelming hegemony of French culture, the Irish had to turn away from the English, who considered them barbarians.
In rejected liberal modernity, these barbarians sought to recapture something of the archaic, Aryan spirit still evident in the Táin Bó Cuailnge and in Wagner’s Ring des Nibelingen — the spirit distilled today in Guillaume Faye’s “archeofuturism.”
***
Before Parnell, Irish resistance to English subjugation (with the exception of O’Connell’s movement) had taken the form of numerous, rather badly planned military defeats.
But the Irish had little recourse, especially in law. (Indeed, the only justice for the Irishman in Ireland came from his shillelagh, whenever it took precedent over the judge’s gravel).
Centuries of Irish violence and resistance had convinced the English of Irish lawlessness and of their incapacity for self-rule.
Savage English repression begot savage Irish resistance, which, in turn, begot savage repression and so on: The long, unfortunate, blood-soaked dialectic of Anglo-Irish relations.
The empire’s violence was legitimated in the name of cultural superiority. Throughout British society, which thought itself the height of Western civilization, it was held that Ireland before the Norman Conquest had lacked any form of civilization or High Culture — even the learned David Hume held this view. Indeed, the Irish were seen as yet fully civilized.
In British eyes this “race” was a lesser breed, somewhat like a nonwhite one, like wild Indians, and imperial conflict with it was something like conflict with a savage tribe — it was not the relationship Paris had to her provinces, it was not even what the German Hapsburgs had to their Slavic nations.
The Catholic Irish are famous in 19th-century English periodicals for their simian features.
The lawless Celts (the very word comes from the Greek for “fighter”), so obviously inferior to the civilized “Saxons,” brought upon themselves thus the rent racking, the enclosures, and the garrison state that came with the English occupation (the so-called “Union”).
***
William Butler Yeats, Lady Gregory, John Millington Synge, and other gifted members of the Anglo-Irish Ascendancy had no love for the world’s workshop, longing, as they did, for “the integral community of the old manorial days.”
The Irish Literary Renaissance was launched, following Parnell’s fall, with “The Wanderings of Oisin,” in which Yeats called for “a new literature, a new philosophy, and a new nationalism.”
Irish folklore for Yeats was not simply Irish, but the conservator of “an ancient, sacred worldview overwhelmed by the abstract, highly differentiated,” and generally ignoble forms of modern bourgeois life (forms, as we Americans have learned, that have, among other negative things, imbued money-changing aliens with great power over us).
For Ireland’s cultural nationalists, the past was a realm of meaning — prefiguring a future to rebuke the present. And a great past, which the culturalist nationalists soon enough discovered, beckoned, as William Irwin Thompson surmised, “a future fit for an exalted heritage.”
The romanticized “peasant,” along with the medieval knight and the gentleman cavalier, were celebrated in Yeats’ poetic rebellion against the modern world.
This “nationalization” of the people’s heritage appealed to nationalists disgusted with things English; its moralistic rejection of decadence and empire also appealed to the emerging Irish Catholic lower-middle class; at the highest, most important, level, its mythic vision organically merged with “a culture that renews itself by reference to its mythology.”
By the early 20th century, a new ideology gripped Ireland, Germany, and many European nations, an ideology which defined the nation in racialist, romantic, and anti-modernist terms centered on certain cultural polarities: viz., anti-liberal versus liberal, past v. present, agricultural community v. industrial society, small moral nation v. decadent world empire, myth v. reason, quality v. quantity, Gaelic v. English, German v. French, Ireland v. England, Europeans v. Anglo-Americans, etc.
***
The hard men of the Irish Republican Brotherhood — (the Fenians, the progenitors of the many factions making up today’s IRA, were very unlike the genteel Anglo-Irish artists who made Dublin a cultural capital of the Anglophone world) — but they too were part of the general revolt against liberal civilization — against the devirilizing tenets of positivist thought, against the primacy of monetary values, against the spirit-killing effects of mechanization, massification, and deracination, and, above all, against the empire’s imposition on everything native to Irish identity.
In France, Italy, and Spain rebels opposing liberalism’s realm of “consummate meaninglessness” threw bombs, in Ireland, where the cult of violence was ancient, they made up an army of bomb-throwers — for it was the nation seeking to be born, “ourselves alone,” not the solitary resister, who filled the rebel ranks.
Violence and self-sacrifice, as such, needed no justification in Catholic Ireland (though they seemed totally alien and barbaric to England’s liberal Protestants).
***
Ireland’s brave rebels are best seen against a European backdrop.
At its center was the Sorelian myth of violence, imagining the overthrow of Cromwell’s cursed regime.
This myth of violence was no ideology, but a Nietzschean assertion of will.
Its dreamscape was the apocalyptic catastrophe in which all things became possible.
Its promised violence wasn’t aimless or nihilistic, like that of a Negro hoodlum, but soteriological, seeking the salvation of man’s soul in a world made especially evil by the efficacy of science and reason.
***
Violence here — in the mythic context of Pearse’s imagination and in the social-political world of late 19th-century, early 20th-century Europe — became “a path to a new faith” — a path that ran over the ruins of modernity, as it endeavored to redeem it.
The Irish cosmological view, in Patrick O’Farrell’s study, perceived England as a secular, unethical, money-grubbing power that had “violated” Caithlin Ni Houlihan — the Old Woman of Beare, Roisin Dubb, Shan Van Vocht, Deidre of the Sorrows, Queen Sive, and all the feminine symbols personifying Ireland’s perennial spirit.
In such a cosmology, national liberation was eschatological, millennarian, and, above all, mythic.
For here myth seizes the mind of the faithful as it prepares them to act. Its idea is “apocalyptic, looking toward a future that can come about only through a violent destruction of what already exists.”
Pearse’s myth was of a noble Ireland won by violent, resolute, virile action — nothing less would merit his blood sacrifice.
Fusing the unique synergy of millennarian Catholicism (with its martyrs), ancient pagan myth (with its heroes), and a spirit of redemptive violence (couched in every recess of Irish culture) — his myth has since become the ideological justification for the physical force tradition of Irish republicanism — a tradition which holds that no nation can gain its freedom except through force of arms — that is, by taking it — by forthrightly asserting it in the Heideggerian sense of realizing the truth of its being.
Pearse’s allegiance to armed struggle came with his disgust with parliamentary politics. He thought Parnell’s party “had sat too long at the English table” — that it had come to regard Irish nationality “as a negotiable rather than a spiritual thing.”
All states, he considered, rested on force. If Ireland should be “freed” through Home Rule, that is, under British auspices, it would make the Irish smug and loyal — and British.
With the advent of the Great War of 1914 and the Burgfrieden negotiated between the parliamentary nationalists of the IPP and the British government, the flame of Ireland’s national spirit began to dim.
The violent break with Britain, which Pearse and other revolutionary nationalists sought, was inspired by the conviction that every compromise weakened Ireland’s soul and strength — that the flame had always to burn heroically — that the spirit had to be pure — otherwise the sacramental lustre of the Republican cause would be lost.
***
The tradition of armed resistance of which Pearse became the leading Irish symbol was not unique to Ireland, but part the same European tradition that inspired the Slavic Communist storming of the Winter Palace, the same that guided the anti-liberal, fascist, and national socialist opposition to liberalism’s interwar regimes — the same that appears still on the hard streets of Northern Ireland and in the minds of a small number of exceptional Europeans.
For Pearse, the Uprising was more than a blow struck for Irish freedom, it was “a revolt against the materialistic, rationalistic, and all-too-modern world” of the British Empire.
Pearse was not unlike Charles Péguy, who too conceived of a national myth “to stand against the modernist tide.”
Péguy: “Nothing is as murderous as weakness and cowardice / Nothing is as humane as firmness.”
This was Pearse’s thought, exactly.
***
Such a mythic conviction came, though, at a high cost, for it required a willful self-immolation and the promise of death, however heroic.
***
Pearse’s conviction sprang from Ireland’s long history of resistance and the Aryo-European spirit it reflected, but it also came from the old sagas, from the stories and legends of the ancient Gaels, that celebrated the values and traditions of Ireland’s heroic age.
Prior to the modern age Ireland’s Gaelic vernacular literature was the largest of any European peoples, except that of the Greeks and Romans.
The Irish loved to tell stories, a great many of which their monks wrote down a thousand years ago.
Like other Gaelic-speaking nationalists, Pearse was especially affected by the Ulster Cycle of legends and myths associated with Cù Chulainn — the symbol of Ireland — the symbol of one powerful man standing alone against a terrible, overwhelming force — the Irish Achilles — whose heroic temper was a rebuke to the corruptions and weaknesses of the modern age.
***
In August 1915, a year into the European civil war, and three-quarters of a year before the Easter Uprising, the IRB staged a ceremonial burial for one of its own — in a country where ceremonial burials have often given birth to new forms of life.
In his funeral oration at the grave side of the dead Fenian, O’Donovan Rossa, the Cù Chulainn (who would soon fight his epic battle in the GPO) augured that: “Life springs from death and from the graves of patriot men and women spring nations. . . . They [the English] think that they have pacified Ireland. They think that they have pacified half of us and intimidated the other half. They think that they have provided against everything: but the fools, the fools, the fools! — they have left us our Fenian dead, and while Ireland holds these graves, Ireland unfree shall never be at peace.”
Man, in Pearse’s mythic imagination, doesn’t act on the chance of being successful, but for the sake of doing what needs to be done. The nationalist movement, united in hatred of the English ruling class, was full of such men.
Their doing, their sacrifice — like that of Jesus on the cross or the tragic Cù Chulainn burying his son in the indifferent sea tide — was of utmost importance.
For everything, the rebels knew, would follow from it — the slaughtered sheep brightening the sacramental flame of their spirit.
***
Some historians claim Pearse’s “suicidal” insurrection bequeathed “a sense of moral conviction to revolutionaries all over the world.”
From a military perspective, the Uprising, of course, was a categorical failure. But morally, it became something of a world-changing force — which wasn’t surprising in a country like Ireland, whose mythology had long favored ennobling failures.
As Pearse told the military tribunal that condemned him to death: “We seem to have lost. We have not lost. To refuse to fight would have been to lose. We have kept faith with the past, and handed down a tradition to the future.”
***
In the course of the extraordinary events following The Proclamation (as the rebels kept faith with their past), mind, imagination, and myth fused into a synergetic force of unprecedented brilliance and power — the terrible beauty being born.
***
Patrick Pearse fell before the English guns soon after Easter, but the ennobling image of him standing upright in the burning GPO lives on in the heritage he willed not just to Irishmen but to all white men.
For of the insurgents, at least fifty of them, including Pearse himself, were of mixed Irish-English parentage.
They fought the cruel empire not just for Ireland’s sake, but for the sake of redeeming, in themselves, something of the old Aryo-Gaelic ways.
April 24, 2010
Sources:
Thomas M. Coffey, Agony at Easter: The 1916 Irish Uprising (Baltimore: Penguin, 1971).
Ruth Dudley Edwards, Patrick Pearse: The Triumph of Failure (New York: Taplinger, 1978).
Sean Farrell Moran, Patrick Pearse and the Politics of Redemption (Washington: Catholic University Press of America, 1994).
Joseph O’Brien, Dear, Dirty Dublin: 1899–1916 (Berkeley: University of California Press, 1982).
Patrick O’Farrell, Ireland’s English Question (New York: Schocken, 1971).
Dáithí Ó hÓgáin, The Lore of Ireland (Cork: Boydell, 2006).
William Irwin Thompson, The Imagination of an Insurrection: Dublin, Easter 1916 (New York: Harper, 1967).
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, littérature irlandaise, lettres irlandaises, irlande, histoire, celtes, celtisme, celtitude, pays celtiques, mythologie, mythologie celtique, mythes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 14 juin 2010
France et Bretagne en 1532
France et Bretagne en 1532
Ex: http://propos.sturiens.over-blog.com/
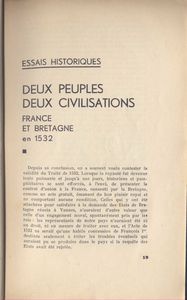 Depuis sa conclusion, on a souvent voulu contester la validité du Traité de 1532. Lorsque la royauté fut devenue toute puissante et jusqu'à nos jours, historiens et pamphlétaires se sont efforcés, à l'envi, de présenter le contrat d'union à la France, consenti par la Bretagne, comme un acte gratuit, émanant du bon plaisir royal et ne comportant aucune condition. Celles qui y ont été attachées pour satisfaire à la demande des Etats de Bretagne réunis à Vannes, n'auraient d'autre valeur que celle d'un engagement moral, spontanément pris par les rois : les représentants de notre pays n'auraient été ni en droit, ni en mesure de traiter avec eux, et l'Acte de 1532 ne serait qu'une habile concession de François Ier, destinée seulement à éviter les troubles éventuels qui auraient pu se produire dans le pays si la requête des Etats avait été rejetée. D'autres historiens ont, en leur temps, fait justice de ces assertions, et il ne nous appartient pas d'y revenir. L'examen du droit public breton peut, à lui seul, nous convaincre de l'entière validité du contrat. Ce qui apparaît comme contestable à la lumière du seul droit public français, devient une vérité d'évidence si l'on fait appel à la notion bretonne de ce même droit.
Depuis sa conclusion, on a souvent voulu contester la validité du Traité de 1532. Lorsque la royauté fut devenue toute puissante et jusqu'à nos jours, historiens et pamphlétaires se sont efforcés, à l'envi, de présenter le contrat d'union à la France, consenti par la Bretagne, comme un acte gratuit, émanant du bon plaisir royal et ne comportant aucune condition. Celles qui y ont été attachées pour satisfaire à la demande des Etats de Bretagne réunis à Vannes, n'auraient d'autre valeur que celle d'un engagement moral, spontanément pris par les rois : les représentants de notre pays n'auraient été ni en droit, ni en mesure de traiter avec eux, et l'Acte de 1532 ne serait qu'une habile concession de François Ier, destinée seulement à éviter les troubles éventuels qui auraient pu se produire dans le pays si la requête des Etats avait été rejetée. D'autres historiens ont, en leur temps, fait justice de ces assertions, et il ne nous appartient pas d'y revenir. L'examen du droit public breton peut, à lui seul, nous convaincre de l'entière validité du contrat. Ce qui apparaît comme contestable à la lumière du seul droit public français, devient une vérité d'évidence si l'on fait appel à la notion bretonne de ce même droit.
Alors que le droit public du royaume de France confondait à cette époque, quant au roi, souveraineté et propriété, en Bretagne les deux notions étaient déjà distinctes. Pour les Bretons, le « dominium » et l'« imperium » du prince n'étaient pas confondus. Le pouvoir du duc n'était pas considéré comme absolu, et le duché n'était pas considéré comme sa chose propre. A chaque acte du pouvoir central devait correspondre la sanction populaire. Les Etats de Bretagne étaient un véritable Parlement, dont le caractère politique était très accentué, et dont on retrouve l'intervention depuis l'origine la plus reculée, dans tous les actes politiques intéressant le duché. Un acte aussi grave que celui de la réunion du duché à la couronne, s'il avait été consommé sans leur intervention, ne pouvait être que frappé de nullité absolue.
La forme du gouvernement breton était un produit spontané de la nature et de l'histoire, particulièrement bien adapté aux besoins de la Bretagne et à la mentalité de son peuple. Une conception particulière du droit, conception proprement celtique et spiritualiste, animait tous les rouages de l'administration de la justice et de l'organisation politique. On y trouve la raison de la longue et héroïque lutte de la Bretagne contre les rois de France, dont l'erreur fut, après la réunion, de considérer le peuple breton comme le reste de leur peuple, et de vouloir lui appliquer les mêmes méthodes et les mêmes lois.
L'examen de l'état politique, administratif et social de la Bretagne, au jour de la réunion, fait ressortir très vivement les différences profondes qui existaient alors entre la France et la Bretagne ; ainsi s'expliquent également les précautions multiples prises dans le traité de 1532 contre les empiétements du pouvoir royal et l'obstination avec laquelle les Bretons s'efforcèrent de sauvegarder l'intégrité de leur constitution nationale, gage de leur autonomie.
*
**
En Bretagne, les rapports du peuple et du souverain, aussi bien que ceux des diverses classes sociales entre elles, étaient régis par des principes étonnamment modernes et libéraux. Aucune charte particulière, aucune constitution écrite ne les réglaient ; mais ils prenaient appui sur les principes fondamentaux du droit public breton de formation traditionnelle. La Très Ancienne Coutume de Bretagne proclamait que la législation bretonne devait être toute entière de raison.
En réalité, la confiance mutuelle qui unissait le souverain et ses sujets était le produit d'une lente évolution qui, au cours des siècles, maintint en le transformant et en l'adaptant chaque fois à des besoins plus actuels, le principe de gouvernement très libéral en vigueur dans les confédérations celtiques de l'époque préchrétienne. A l'origine, comme dans toute l'antiquité nordique, le chef suprême était élu, et les comtes ou seigneurs bretons devaient se rallier autour de lui pour combattre l'ennemi commun. Mais le roi ne pouvait lever aucun impôt, prendre aucune mesure générale sans l'assentiment des chefs réunis, le pays étant toujours plus puissant que le monarque. Lorsque les rois de Bretagne devinrent héréditaires, ce principe libéral continuera à s'appliquer, et il dominera toute la constitution bretonne jusqu'en 1532 et même jusqu'en 1789. Le roi ou le duc ne pouvait toucher à aucun intérêt public sans l'avis et le consentement des seigneurs du pays dont l'assemblée, en se transformant, devint peu à peu les Etats de Bretagne. Le roi Salomon III, aux environs de l'an 1000, fut empêché de quitter le pays par une défense formelle des seigneurs assemblés. Plus tard, le duc Jean IV fut exilé, puis rappelé par les Etats.
L'histoire bretonne est pleine de faits semblables : « Le droit fondamental du pays, dit M. de Carné, de l'aveu du prince et de ses sujets, frappait de nullité tout acte politique non ratifié par l'assentiment formellement exprimé des Etats ». Depuis le XIIe siècle, on peut suivre sans la perdre jamais de vue, la trace de l'action exercée par l'Assemblée bretonne sur tous les événements de quelque importance et sur l'orientation même de la politique du duc. Les rares conquérants de la Bretagne, ou plutôt les princes victorieux qui avaient battu ses armées, se soumettaient eux-mêmes à cette inévitable coutume des assemblées. Aussi La Borderie a-t-il pu écrire que le gouvernement breton « prend la forme de la monarchie représentative dont jouissait dès lors aussi l'Angleterre, et qui était le gouvernement le plus modéré, le plus régulier, le plus libéral sous lequel put vivre, au XVe siècle, une nation chrétienne ».
C'est dans l'attachement que portaient à leur gouvernement les différentes classes de la société bretonne que se rencontre l'explication de la longue lutte soutenue par la Bretagne contre le pouvoir central. L'élément féodal qui dans notre pays s'était développé dans sa plénitude, n'y avait pas été vicié dans son essence. La conquête n'avait pas été à l'origine des pouvoirs des seigneurs, et les « antipathies héréditaires » qu'elle avait ailleurs suscitées n'y existaient guère. Le servage, sous sa forme la plus dure et la plus cruelle, ne s'y retrouve jamais : on n'en aperçoit de traces que dans une petite partie de la Haute-Bretagne, région la plus soumise aux influences du dehors, et dans le Léon, où « l'usement de motte », dernier vestige du servage, fut aboli par François II en 1486. Dès le XIe et le XIIe siècle, les paysans pouvaient quitter la terre, la vendre à leur gré, la transmettre à leurs héritiers, se marier à leur guise, plaider librement, parfois même contre leur seigneur.
Augustin Thierry avait été frappé de ce fait lorsqu'il écrivit : « Les gens du peuple en Basse-Bretagne n'ont jamais cessé de reconnaître dans les nobles de leur pays les enfants de la terre natale ; ils ne les ont jamais haï de cette haine violente que l'on portait ailleurs aux seigneurs de race étrangère et, sous les titres féodaux de barons et de chevaliers, le paysan breton retrouvait encore les tierns et les mac-tierns des premiers temps de son indépendance ». La plupart des nobles de Bretagne, en effet, très nombreux et très pauvres, se confondaient dans leurs derniers rangs avec la population rurale. Ils en partageaient les deuils et les plaisirs, et recevaient, en nature, de leurs colons, la plupart des choses fongibles. Les colons eux-mêmes participaient à la possession du sol, puisqu'ils l'occupaient en grande partie alors à titre de « domaine congéable ». Un parfait accord attesté par les traditions, l'histoire et les chants populaires, semblait régner entre les paysans et les nobles, rapprochés par la communauté des habitudes et la simplicité de la vie. Aussi, du commencement du XIe siècle au début du XVIe siècle, ne voit-on pas en Bretagne se produire les jacqueries qui se retrouvent périodiquement en France à cette époque.
*
**
Les mêmes règles familiales, le même libéralisme se retrouvait dans l'administration du pays. Une décentralisation intelligemment comprise avait donné aux cités et aux paroisses des pouvoirs très étendus d'administration. Dès la plus haute antiquité, s'affirment les libertés des communes bretonnes, et leurs franchises étaient, au XVIe siècle, inviolables. Loin de reposer sur des chartes octroyées par le bon plaisir, ou arrachées par la violence, elles dérivaient d'une évolution traditionnelle qui avait peu à peu adapté le mécanisme des antiques institutions à des nécessités plus modernes.
La coutume de Bretagne qui condense le droit public et privé du pays, est inspirée par une moralité très haute et par un idéalisme élevé. Les idées religieuses, la famille, la charité, la tolérance y tiennent une grande place. « Son caractère le plus remarquable, dit Planiol, est l'esprit de solidarité qui l'anime. On chercherait vainement ailleurs, non pas le droit, mais le même accent d'honnêteté, de bonté, le même souci non seulement de justice, mais de charité. Cette tournure d'esprit est propre à la Bretagne ». Or, ce sont également de ces principes que s'inspirait le gouvernement ducal.
La centralisation du pouvoir politique aux mains des ducs s'était opérée peu à peu ; mais l'évolution qui accroissait les droits du souverain tempérait également la puissance que les événements tendaient à lui donner, en développant les institutions politiques et administratives du peuple breton. Si dans la plupart des pays féodaux, la reconstitution de la souveraineté est passée par les mêmes phases, il est rare de voir s'accomplir ce qui s'est passé en Bretagne : un développement parallèle et harmonieux des pouvoirs du duc comme des droits de ses sujets. L'évolution a tendu dans les pays centralisateurs, en France en particulier, à faire disparaître entièrement les franchises féodales et les libertés qu'elles garantissaient aux seigneurs comme à leurs vassaux, aux bourgeois comme aux artisans : en Bretagne, au contraire, l'évolution n'a dépouillé ces franchises et ces libertés que de ce qu'il y avait en elles d'anarchique et d'inconciliable avec un gouvernement qui devait obéir à des nécessités plus modernes. Elle en a conservé le meilleur : l'esprit de ces antiques institutions nordiques qui fut toujours le frein le plus efficace à l'établissement du despotisme et de la servilité. Le résultat fut un remarquable développement de l'esprit public dans toutes les classes de la nation. Les admirables résultats pratiques que donnaient les méthodes administratives si humaines du gouvernement breton venaient encore consolider l'inébranlable attachement du peuple à sa constitution politique et à sa liberté.
La prospérité du pays, favorisée par la modération des charges publiques s'était affirmée particulièrement sous le règne du duc Jean V, administrateur éclairé, qui a laissé une œuvre législative considérable. Essentiellement décentralisateur, le gouvernement breton favorisait l'accomplissement de grands travaux publics, mais il laissait à la ville ou à la région intéressée toute liberté d'action. Loin d'entraver l'initiative privée, il la favorisait de tout son pouvoir, subventionnant même les entreprises qui présentaient le caractère d'entreprises nationales. Mais si l'Etat Breton se renfermait dans son rôle de défenseur des intérêts publics, et répudiait tout monopole, il ne laissait pas agir sans contrôle les fermiers des impôts et les grandes entreprises. Il estimait que son premier devoir était de surveiller toutes les branches de l'activité nationale et de réprimer les abus : ce fut le principe administratif de tous les souverains bretons. Jean V, en particulier, intervint fréquemment pour réprimer les exactions et faire rendre à ses sujets une bienveillante justice. Déjà le duc Pierre II avait organisé l'assistance judiciaire gratuite. Pour statuer sur les réclamations auxquelles donnait lieu l'impôt des fouages, Jean V envoyait sur place un de ses agents avec cette mission : « Faites ainsi que vous verrez qu'il sera à faire de raison, en forme que pour le temps à venir elle se puisse perpétuer au mieux pour le profit de nos sujets ». Les litiges étaient ainsi réglés sur place, selon une situation de fait précis, et non selon des textes, démontrant une fois de plus la supériorité de la coutume sur la règle latine du droit écrit.
Les ordonnances de Jean V dénotent souvent aussi des conceptions économiques et sociales très audacieuses pour l'époque. Parmi celles-ci, l'ordonnance de 1425, sur l'administration générale du pays, discutée et approuvée par les Etats à Vannes, fut le point de départ d'une véritable révolution économique, qui donna à la Bretagne une longue avance sur toutes les autres nations. Elle réservait pour l'industrie et la consommation locale certains produits de première nécessité, établissait un service de répression des fraudes, instituait l'unité de poids et mesures, fixait le minimum de salaire pour les ouvriers de l'industrie.
Toutes ces mesures adaptées aux besoins du pays déterminèrent une ère de prospérité incomparable. Aussi le bon chroniqueur Alain Bouchard, sans exagérer beaucoup, pouvait-il écrire au moment de la réunion à la France, que la Bretagne « florissait en toutes prospérités, qu'il n'était de petit village où l'on ne put trouver de la vaisselle d'argent » ; que la Bretagne « est un véritable paradis terrestre, alors que le royaume de France est en telle misère que l'on n'y peut trouver refuge de sûreté ».
*
**
Fière de sa liberté, calme et forte, la Bretagne portait donc à ses antiques institutions un attachement profond et légitime. Aussi, nous dit l'aumônier de la reine Anne : « Quand les Bretons connurent que le roy de France les voulait de fait appliquer à lui et les régir selon ses lois, lesquelles ne s'accordaient pas aux leurs, parce qu'ils avaient toujours été en liberté sous leurs princes, et ils veoient les Français comme serfs chargés de maints subsides, ne voulant obtempérer à l'intention du roy, commencèrent à faire monopolle et eurent conseil ensemble de se défendre ».
Ce passage résume admirablement les raisons de la répugnance de toute la Bretagne pour l'union définitive avec le royaume de France. Le fait de la réunion n'était rien : la cause française avait de nombreuses sympathies dans le peuple comme à la cour. Mais les Bretons, comme jadis, craignaient les lois du roi de France et tenaient à conserver les leurs.
L'opposition dernière qui se manifesta aux Etats de 1532 ne se basait pas sur d'autres arguments. Aussi l'Acte d Union fut-il, en plus d'une nécessité constitutionnelle, acte de grande sagesse politique de la part du roi de France. Le souverain français paraissait aussi rester un duc de Bretagne en même temps qu'un roi de France. Si la souveraineté extérieure de la nation bretonne disparaissait, la Bretagne n'en paraissait pas moins garder sa liberté intérieure, son régime politique et administratif, ses coutumes particulières. Et pour les Bretons, particulièrement respectueux de la parole donnée et très sensibles au sentiment de l'honneur, la violation du serment solennel prêté par une personne royale à chaque début de règne, de respecter les institutions et les lois de la province n'était pas concevable.
Mais l'acte d'Union de 1532, ainsi conçu, malgré les nombreuses précautions qu'il prenait, devait-il conserver intégralement à la Bretagne les favorables institutions qui la régissaient ? La France, d'ailleurs, pouvait-elle lui sauvegarder, avec l'esprit libéral qui animait leur gouvernement, les résultats particulièrement heureux de la politique des ducs ?
En fait, le traité de 1532 conserva à la Bretagne, jusqu'en 1789, l'essentiel des libertés qui lui étaient si chères. Mais ce ne fut que grâce à l'exceptionnelle opiniâtreté de son peuple, dont l'esprit de résistance au pouvoir central se manifesta constamment, et parfois de façon violente, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Les luttes que la Bretagne eut à soutenir étaient la conséquence des frictions inévitables qui devaient se produire entre deux peuples de régime et de tempérament différents, entre deux nations dont l'évolution politique s'était faite selon des principes opposés.
Les institutions de la Bretagne, la forme constitutionnelle et parlementaire de son gouvernement, l'accord harmonieux qui continuait d'y régner généralement entre les classes sociales, montrent que dans ce pays les transformations du droit public s'étaient faites pour le peuple, sinon pour et par lui. Le duc ne peut d'abord rien sans l'approbation des seigneurs, puis ensuite sans l'approbation des Etats, dont l'organisation progressive tend à donner une image de plus en plus fidèle de la nation.
Ce fut de très bonne heure au contraire que ces principes disparurent en France. La politique de la puissante maison capétienne a toujours été de faire de la France une monarchie absolue, qui deviendrait le centre de l'Europe, la plus forte nation d'occident. Pour réaliser ce projet, que nous appellerions aujourd'hui impérialiste, poursuivi par les rois de France, de règne en règne avec une remarquable et surprenante opiniâtreté, il fallait de toute nécessité abattre ce vieil esprit d'indépendance et de liberté, héritage celtique, qui se traduisit à l'époque médiévale par le régime féodal. Philippe Auguste, en attaquant les bases de ce régime, Philippe le Bel en livrant les coutumes nationales à la merci de ses légistes, furent les véritables fondateurs de l'absolutisme royal en France. Dès ce jour les juristes, épris de droit romain, vont s'efforcer non seulement de justifier les actes de la royauté, mais aussi de leur donner toute apparence de légitimité et de justice.
Et le picard Beaumanoir proclame : « Le roi est souverain par-dessus tout et a, de son droit, le général garde du royaume, pourquoi il peut faire tel établissement comme il lui plaît, pour le commun profit et chi il établit, i doit être tenu ». Alors qu'en Bretagne l'évolution politique continua d'obéir à cette maxime : « Lex fit consensu populi et constitutione regis », en France elle se fît sur ces paroles qui « faisaient bouillir le sang breton de notre illustre d'Argentré » : « Le roi ne tient fors de Dieu et de son épée, ce qui li plest à fère doit estre tenu par loi ». Cette phrase fut, depuis Philippe le Bel, l'évangile de tous les « politiques » du royaume de France.
*
**
Ce système, érigé en raison d'Etat, réclamait l'asservissement du peuple et la disparition de toutes les existences particulières. Bientôt la domination temporelle ne suffit plus. L'unification politique, presque complètement achevée lors de la réunion de la Bretagne à la France, ne faisait que précéder l'unification administrative. La difficulté de gouverner un royaume aussi étendu et aussi varié, dans ses institutions et dans ses lois, les nécessités nouvelles nées des guerres continuelles entreprises pour obéir à l'ambitieuse pensée des rois, obligeait le pouvoir central à une sévérité et à un despotisme accru vis-à-vis des collectivités comme des individus. Ainsi disparurent une à une les libertés coutumières, nées spontanément au cours des siècles, témoignages de l'effort collectif des générations, et fruits de leurs longues aspirations vers le bien du peuple et le libre gouvernement de la cité. Corporations, provinces, ordres, classes et toutes institutions particulières, furent transformés en organismes administratifs froids et rigides, d'où toute évolution était désormais exclue.
Les princes et leurs conseillers, préfaçant les initiatives révolutionnaires, en diffamant le passé, s'efforcèrent d'éteindre parmi leurs peuples tous les souvenirs d'indépendance légués par leurs ancêtres. Tout ce qui ne tenait pas à l'Etat fut calomnié, insulté, déshonoré par les historiographes et les légistes de cour. Tout ce qui était antérieur au grand roi passa pour entaché de barbarie et les dernières paroles de Louis XIV consacrèrent l'ultime et ambitieuse pensée qui, malgré tout, devait créer la France. « Les peuples sont nés pour obéir sans discernement, et les rois pour posséder tout et commander à tout ».
En face de cette conception, la lutte acharnée que soutint la Bretagne contre les exigences des rois les plus absolus, personnifia la résistance du vieil esprit celtique, avide d'indépendance et de liberté qui s'était conservé chez les Bretons. C'était l'esprit d'une civilisation particulière, une conception morale et philosophique du droit qu'il fallait défendre, d'un droit qui plaçait le bien du peuple au-dessus de tout, et pour qui la justice n'était pas suffisante car il fallait encore faire une place à la bienveillance et à la charité. Aussi, en face de conceptions inverses et du dogme de l'Etat-Dieu qui commençait à naître et dont nous souffrons aujourd'hui plus que jamais, des luttes parlementaires violentes et parfois des révoltes sanglantes opposèrent jusqu'à la Révolution la nation bretonne à la royauté française.
C'est ce divorce de conceptions, d'idées et de tempéraments entre les deux races, qui entretint pendant près de trois siècles entre la Bretagne et la France cette mésintelligence marquée par de terribles conflits. De nos jours encore, sous des manifestations et des modalités diverses, et à une époque où l'on parle depuis longtemps déjà du droit des peuples, la même lutte se perpétue. Mais c'est aussi dans ces mêmes dissemblances entre l'esprit français et l'esprit breton que l'on peut trouver la raison de cette incompréhension et parfois de cette hostilité sourde que l'on rencontre souvent encore dans tous les milieux, vis-à-vis de la Bretagne.
Yann Kerberio.
STUR n° 9 Avril 1937
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, bretagne, celtisme, celtitude, pays celtiques, armorique, celtes, nationalisme breton |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le Koweit appartient-il à l'Irak?
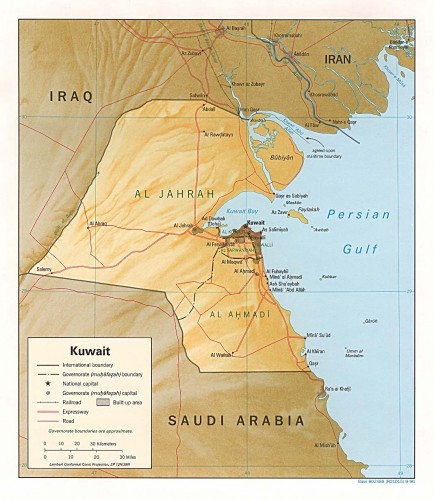
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991
Le Koweit appartient-il à l'Irak?
Quelques rappels historiques
par Franz KARG von BEBENBURG
Pour pouvoir juger sereinement la volonté irakienne de conserver le Koweit, il faut savoir analyser les faits historiques. La Mésopotamie, soit le pays sis entre les deux fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate, a toujours eu un destin changeant. Son histoire récente commence sous les Sassanides. De 226 à 651, la Mésopotamie était la région centrale de l'Empire perse. Sous les Abassides, entre 750 et 1258, elle a été le centre du monde islamique, jusqu'au moment où elle a été conquise par les Mongols. Au début du 16ième siècle, elle redevient perse. De 1638 à 1918, elle est turque. De 1915 à 1917, elle est envahie par les troupes britanniques. Au Traité de Sèvres, l'Angleterre obtient cette région et la place sous mandat. Les choses resteront telles jusqu'en 1921. Pour leur part, les Français reçoivent un mandat sur la Syrie et le Liban. En 1921, les Britanniques hissent le roi Fayçal 1er sur le trône de l'Irak mais politiquement, militairement et économiquement, le pays reste sous la coupe des Anglais.
Après plusieurs révoltes et putsch (1936, 1941, 1952), une révolution renverse la monarchie le 14 juillet 1958; le roi, sa famille et tous les membres du gouvernement sont massacrés. Le Général Kassem prend la tête du nouveau gouvernement et y reste jusqu'au jour où, en 1963, un putsch d'officier le renverse et le fait fusiller. Son successeur Aref reste au pouvoir jusqu'en 1968, quand une révolution organisée par le Parti Baath porte au pouvoir Sayyid Hassan al-Bakr. Celui-ci renonce au pouvoir en 1979 pour laisser la place au Général Saddam Hussein qui cumule les fonctions de Président et de Chef du gouvernement.
L'histoire de l'Emirat du Koweit est plus courte, du moins pour ce qui concerne sa structure étatique actuelle. A partir de 1648, le Koweit est partie intégrante de l'Empire Ottoman. En 1775, les Anglais y fondent une mission commerciale. La ville de Koweit, d'importance économique nulle, est resté jusqu'en 1950 une petite bourgade portuaire le long d'une côte désertique, torride et ne recevant preque aucune précipitation. Située à l'extrémité nord-ouest du Golfe Persique, elle a acquis progressivement de l'importance pour les Britanniques parce qu'elle devait devenir le terminus de la fameuse ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad, laquelle aurait offert à l'Empire Ottoman une voie commerciale de première importance; à l'aide de capitaux allemands, [suisses et français], les autorités turques commencent la construction de la ligne en 1903. Elle n'arrivera à Bagdad qu'en 1940. Pour contrer ce projet [qui, à leurs yeux, menaçait la route des Indes], les Britanniques déclarent le Koweit protectorat de la Couronne en 1889 et déploient toute leur énergie pour que la ligne n'atteigne pas les rives du Golfe. En 1961, le Koweit accède à l'indépendance et, malgré les protestations de l'Irak qui considère que cette région lui appartient, adhère à la Ligue arabe. Le nouveau pays est ainsi reconnu comme un Etat arabe à part entière. En juillet 1977, Irakiens et Koweitiens se mettent d'accord sur le tracé définitif de leur frontière, échangeant entre eux quelques bandes de territoire. Bandes de territoire qui poseront problème en cas d'évacuation du Koweit par les troupes irakiennes.
D'après la constitution de 1962, le Koweit est un émirat héréditaire. Le chef de l'Etat est le Cheik. Il gouverne le pays autocratiquement depuis la dissolution en 1976 de l'Assemblée Nationale. Jusqu'au moment de son expulsion par les soldats de Saddam Hussein en août 1990, le Cheik Al Ahmed Al Sabah, âgé de 64 ans, vivait dans son palais luxueux avec ses 70 femmes et sa progéniture de plus de 60 enfants. Le palais comptait 200 chambres. L'écurie de cet intéressant personnage comptait 14 avions privés, 10 Rolls-Royce, 15 Cadillac et une flotte de limousines Mercédès. Le confort de cette sympathique famille était assuré... La miséricorde d'Allah octroyait à ce bon Cheik quelque 44 millions de DM par jour. Ses petites économies personnelles se chiffreraient à environ 310 milliards de DM (un petit trois et neuf petits zéros). Très soucieux de la bonne santé de son peuple, notre brave rentier et homme d'affaires a investi 300 de ces 310 milliards à l'étranger. Des 2 millions d'habitants que compte son pays, 500.000 seulement sont citoyens koweitiens de souche arabe. La grande majorité des autres, 1,5 million de personnes, sont des travailleurs immigrés, des spécialistes ou des ingénieurs occidentaux qui travaillent dans les raffineries et l'exploitation pétrolières. Ils n'ont qu'un seul droit: se taire. Les partis y sont interdits. Ce n'est donc pas une démocratie que les Américains vont aller sauver des griffes d'un méchant fasciste.
Sans le coup de force perpétré par les Anglais en 1889 contre les Ottomans et sans le pillage systématique du Moyen Orient commis par les Français et les Anglais après 1918, il n'y aurait ni Irak, ni Syrie, ni Liban, ni Koweit. La Jordanie, elle aussi, est une création britannique datant de l'immédiat après-Versailles. Au départ, elle se composait de la Palestine et de la Transjordanie, que les bureaux londoniens ont préféré séparer en 1923. Sur les plans géopolitique et ethnique, le petit espace territoriale koweitien appartient à la Mésopotamie, donc à l'Irak. D'autant plus que le Koweit est le port naturel de la Mésopotamie. Si les Britanniques n'étaient pas intervenu et si l'on n'y avait pas découvert du pétrole en 1938, la bourgade de Koweit et la région aux alentours seraient demeurées irakiennes. Peut-on dire que Saddam Hussein a profité de l'atmosphère réunioniste qui règnait en Allemagne à la veille de la réunification formelle du 3 octobre, pour essayer son propre Anschluß, d'autant plus que ni les Russes ni les Américains ne s'opposaient plus aux désirs du peuple allemand? Pourquoi les Etats-Unis et l'URSS ont-ils accepté la réunification allemande et refusé la réunification de la Mésopotamie? Sans doute parce que le lobby sioniste s'y est opposé. Ce qui explique pourquoi l'«opinion publique internationale» a été mise en alerte. Et mobilisée contre l'Irak.
Franz Karg von Bebenburg.
(extrait de Mensch und Maß, 1991/2; adresse: Verlag Hohe Warte, Ammerseestr. 2, D-8121 Pähl).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, koweit, irak, monde arabe, proche-orient, moyen orient, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 12 juin 2010
The Grand Strategy of the Byzantine Empire
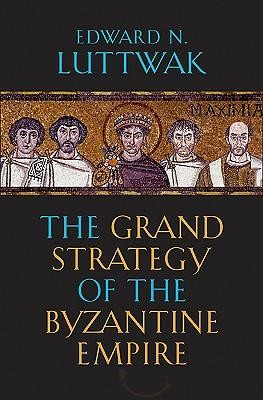 The Grand Strategy of the Byzantine Empire
The Grand Strategy of the Byzantine Empire
"In this book, the distinguished writer Edward Luttwak presents the grand strategy of the eastern Roman empire we know as Byzantine, which lasted more than twice as long as the more familiar western Roman empire, eight hundred years by the shortest definition. This extraordinary endurance is all the more remarkable because the Byzantine empire was favored neither by geography nor by military preponderance. Yet it was the western empire that dissolved during the fifth century. The Byzantine empire so greatly outlasted its western counterpart because its rulers were able to adapt strategically to diminished circumstances, by devising new ways of coping with successive enemies. It relied less on military strength and more on persuasion--to recruit allies, dissuade threatening neighbors, and manipulate potential enemies into attacking one another instead. Even when the Byzantines fought--which they often did with great skill--they were less inclined to
destroy their enemies than to contain them, for they were aware that today’s enemies could be tomorrow’s allies. Born in the fifth century when the formidable threat of Attila’s Huns were deflected with a minimum of force, Byzantine strategy continued to be refined over the centuries, incidentally leaving for us several fascinating guidebooks to statecraft and war.
"The Grand Strategy of the Byzantine Empire is a broad, interpretive account of Byzantine strategy, intelligence, and diplomacy over the course of eight centuries that will appeal to scholars, classicists, military history buffs, and professional soldiers."
Edward N. Luttwak, The Grand Strategy of the Byzantine Empire, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2009.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, empire byzantin, byzance, méditerranée, stratégie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le Japon: le succès d'une "voie prussienne"
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1993
Le Japon: le succès d'une «voie prussienne»
par Josef SCHÜSSLBURNER
Né en 1954, Josef Schüßlburner est diplômé en sciences juridiques des universités de Ratisbonne et Kiel. Il a été conseiller scientifique auprès de la chaire de droit des peuples et des Etats de l'Université de Saarbrücken. Depuis 1985, il est fonctionnaire de l'administration de la RFA. De 1987 à 1989, il a travaillé à New York auprès du département juridique de l'ONU à titre d'enseignant pour la codification du droit des gens. Il est un collaborateur assidu de la revue munichoise Criticón, dont ce texte magistral sur les rapports germano-nippons est extrait.
Lorsque nous atteignons un point de vue supérieur, notre regard balaye l'horizon. La fumée monte très haut. Les foyers du peuple montrent et prouvent son bien-être (1).
Nintoku Tenno (IVième/Vième siècles)
 Une guerre entre les Etats-Unis et le Japon est-elle imminente? On peut l'admettre surtout si l'on lit l'analyse de Friedman et LeBard (The Coming War with Japan). Cet ouvrage est important car il n'est pas l'une de ces innombrables études qui entendent faire violence au passé japonais. C'est un livre qui cherche à comprendre les motivations de la politique japonaise qui ont conduit, il y a 52 ans, à Pearl Harbour. Le Japon, en déclenchant cette attaque, avait espéré monter la population américaine contre la politique de son Président, qui enfreignait les règles de la neutralité (2). Mais le Japon n'a pas réussi son coup: au contraire, il est tombé dans le piège que lui tendait Roosevelt. Nous, Allemands, ne devrions pas négliger les analyses sérieuses, qui prévoient un conflit entre Américains et Japonais, car les hommes politiques anglo-saxons considèrent les termes «Allemands» et «Japonais» comme interchangeables. J'en veux pour preuve la préface d'Edward Seidensticker au livre de J. Taylor, Shadows of the Rising Sun - A critical View of the «Japanese Miracle». Dans cette préface, on peut lire: «Nos anciens ennemis, les Allemands et les Japonais, semblent être les peuples qui, pour nous, sont les plus difficilement insérables dans un système». Réflexion curieuse, surtout pour ceux qui se sont contentés de lire l'ouvrage de Büscher et Homann, Japan und Deutschland, qui défendait la thèse que les deux pays étaient de bons élèves des Etats-Unis. S'il était exact que le succès économique japonais découlait en droit ligne des quelques années de régime militaire américain, alors les Philippines auraient dû devenir la grande puissance dominante du Pacifique, puisqu'elles ont bénéficié pendant plus d'un demi-siècle d'une administration américaine! Soyons sérieux: ce qui inquiète les hommes politiques américains face aux succès économiques du Japon (et partiellement aussi de l'Allemagne), c'est le fait que ce succès contredit certaines prémisses idéologiques et que, par conséquent, le Japon ne peut entrer dans un système pensé à l'américaine.
Une guerre entre les Etats-Unis et le Japon est-elle imminente? On peut l'admettre surtout si l'on lit l'analyse de Friedman et LeBard (The Coming War with Japan). Cet ouvrage est important car il n'est pas l'une de ces innombrables études qui entendent faire violence au passé japonais. C'est un livre qui cherche à comprendre les motivations de la politique japonaise qui ont conduit, il y a 52 ans, à Pearl Harbour. Le Japon, en déclenchant cette attaque, avait espéré monter la population américaine contre la politique de son Président, qui enfreignait les règles de la neutralité (2). Mais le Japon n'a pas réussi son coup: au contraire, il est tombé dans le piège que lui tendait Roosevelt. Nous, Allemands, ne devrions pas négliger les analyses sérieuses, qui prévoient un conflit entre Américains et Japonais, car les hommes politiques anglo-saxons considèrent les termes «Allemands» et «Japonais» comme interchangeables. J'en veux pour preuve la préface d'Edward Seidensticker au livre de J. Taylor, Shadows of the Rising Sun - A critical View of the «Japanese Miracle». Dans cette préface, on peut lire: «Nos anciens ennemis, les Allemands et les Japonais, semblent être les peuples qui, pour nous, sont les plus difficilement insérables dans un système». Réflexion curieuse, surtout pour ceux qui se sont contentés de lire l'ouvrage de Büscher et Homann, Japan und Deutschland, qui défendait la thèse que les deux pays étaient de bons élèves des Etats-Unis. S'il était exact que le succès économique japonais découlait en droit ligne des quelques années de régime militaire américain, alors les Philippines auraient dû devenir la grande puissance dominante du Pacifique, puisqu'elles ont bénéficié pendant plus d'un demi-siècle d'une administration américaine! Soyons sérieux: ce qui inquiète les hommes politiques américains face aux succès économiques du Japon (et partiellement aussi de l'Allemagne), c'est le fait que ce succès contredit certaines prémisses idéologiques et que, par conséquent, le Japon ne peut entrer dans un système pensé à l'américaine.
L'exemple prussien
Jusqu'à présent, le Japon est le seul pays non-européen qui a réussi à créer une société industrielle et productiviste (progressivement, les anciennes colonies japonaises y arrivent aussi, comme Taïwan et la Corée du Sud, ou son allié de la seconde guerre mondiale, la Thaïlande). C'est dû au modèle que les Japonais ont adopté, en l'occurrence le modèle prussien.
En 1853, les Japonais avaient pris conscience de leur retard militaire et technologique, à l'arrivée des canonnières américaines. Un danger les menaçait, à l'instar de toutes les autres puissances asiatiques: être contraints d'accepter des traités inégaux, qui les auraient conduits à s'endetter vis-à-vis de l'extérieur, à faire gérer leur dette par l'étranger et à admettre que les clauses de ces traités soient réalisées à coups de canon. Il ne leur restait plus qu'une solution: accepter une politique de modernisation à l'européenne afin de renforcer leur propre puissance et avoir ainsi au moins une chance de se développer. Les intellectuels japonais se sont mis à étudier intensément les institutions des pays européens, jugés plus performants. Leur intention première était de les concilier, dans la mesure du possible, avec les traditions japonaises. Pour les institutions de base que sont la constitution et la chose militaire, ils ont étudié la Prusse, dont ils considéraient les institutions comme conciliables. L'œuvre des juristes allemands Hermann Roesler (1834-1894) et Albert Mosse (1848-1925) a été déterminante dans l'élaboration de la Constitution de l'Ere Meiji (3), appliquée à partir de 1889. Sur le plan idéologique, cette constitution reposait sur les conceptions de l'Etat de Rudolf von Gneist et Lorenz von Stein, qui avaient reçu la visite, à Berlin et à Vienne en 1882 et 1883, des deux conseillers de l'Empereur, Hirobumi Ito et Kowaski Inoue, chargés d'élaborer la constitution. Gneist et Stein représentaient les conceptions de l'Etat-Providence du XVIIIième siècle, plus exactement les conceptions de la monarchie sociale, qui visaient à créer les conditions institutionnelles sur base desquelles le libre jeu des forces sociales, voulu par les libéraux, débouchaient ou devait déboucher sur un ordre social juste. Bismarck était un représentant de cette tendance, d'autant plus que Gneist (4) avait été le porte-paroles de l'opposition libérale lors du fameux «conflit du budget», qui avait animé le parlement prussien, et avait ainsi représenté la droite; par la suite, Gneist était devenu l'un des protagonistes les plus décidés de la politique bismarckienne (ce qui n'était nullement contradictoire).
En important la constitution prussienne de 1850 (et non la constitution allemande de 1871, comme on l'affirme quelque fois pour diffamer cette dernière), les constitutionalistes japonais instituaient un Parlement composé de deux chambres, soit une chambre de l'aristocratie (pour laquelle l'ancienne caste dirigeante a été divisée en cinq catégories) et une chambre des représentants, élus selon un mode de suffrage censitaire, déterminé par le paiement d'un certain montant d'impôt (en 1925, les Japonais passent au suffrage universel limité aux hommes). Le pouvoir législatif était concentré dans les mains de l'Empereur, mais celui-ci ne pouvait l'exercer qu'en accord avec le parlement. Ce dernier fixait également le budget de l'Etat. Dans le cas où le budget n'était pas accordé, l'administration avait pour tâche de reconduire le budget de l'année précédente. C'est de cette façon que Roesler a tenté de résoudre au Japon le «conflit du budget», qui avait tant agité la Prusse!
Conformément à la structure présidentielle de la monarchie constitutionnelle, la nomination des ministres n'avait pas besoin de l'accord du Parlement, ce qui n'empêcha pas l'avènement de gouvernement de partis dans les années 20 de notre siècle. Le pouvoir suprême était aux mains de l'Empereur qui ne pouvait l'exercer que dans le cadre de la constitution. Les règles de fonctionnement du Conseil d'Etat, instance secrète, du Cabinet et du Parlement limitaient de façon drastique le pouvoir direct de gouverner dont disposait l'Empereur dans le Japon traditionnel, ce qui constituait —cela va sans dire— une innovation extraordinaire. Ces règlements ont été introduits en même temps qu'un droit prévoyant de gouverner dans une très large mesure par ordonnances et décrets, dépassant nettement, dans ce domaine, le modèle prussien. Ce droit fit du Japon un Etat administratif qui permit, en concordance avec l'éthique politique confucianiste, de construire et d'organiser dans de très brefs délais un Etat moderne. En introduisant le droit constitutionnel prussien, les Japonais adoptaient aussi le droit civil et le droit commercial allemands, auxquels l'Allemagne actuelle doit l'essentiel de sa santé économique.
Le Japon a d'abord tenté d'organiser son armée sur le modèle français, car le mythe napoléonien était toujours vivace. Mais le général prussien Jacob Meckel (5), devenu célèbre par son livre intitulé Elemente der Taktik qui lui avait valu l'estime de Moltke, persuada les Japonais d'abandonner cette option. Sur la recommandation de Moltke, Meckel est devenu leur conseiller et les convainquit de parfaire leur réforme militaire selon le modèle prussien. La victoire militaire allemande en 1870/71 a terni l'image de la France dans le monde et aidé indirectement Meckel dans la réalisation de son projet.
Quelles sont les raisons profondes qui ont motivé cette orientation prussienne? Pour répondre à cette question, nous devons tout d'abord nous rappeler que le Japon a pu adopter avec succès des modèles européens parce que, comme l'étude de son histoire nous le montre, des institutions et des idées y ont émergé, qui correspondaient étonnamment à celles nées en Europe occidentale (6), dans un contexte religieux et spirituel toutefois radicalement différent. Pour citer quelques exemples (7): le moine zen Takuan (1573-1645), une sorte de Calvin japonais, développe une doctrine bouddhiste de la prédestination, associée à une morale pratique des affaires; quant au moine Shosan Suzuki (né en 1579), il fut une sorte d'Adam Smith japonais, qui démontra que la morale pratique des affaires était un principe bouddhique, valorisant du même coup la caste des marchands, dont la fonction principale serait de créer de la liberté en offrant des marchandises.
Les Japonais qui, pendant des siècles ont observé au sein des autres cultures tous les phénomènes qui leur semblaient apparentés à leurs propres institutions pour les mobiliser au profit du Japon, ont été essentiellement motivés, à mes yeux, par le rapport tacite qui existait entre les vertus dites «prussiennes», telles la gestion efficace et non partisane des fonctions étatiques et l'Etat fondé sur un ordre
Le Japon est par ailleurs le seul pays du monde bouddhiste où s'est opérée une transformation des valeurs monachistes en valeurs militaro-bureaucratiques, comme en Prusse, où c'est l'Etat de l'Ordre des Teutoniques qui est devenu l'Etat prussien. Ainsi, au Japon, le bouddhisme, non guerrier, est devenu la religion de la caste des chevaliers, les samouraïs, dont l'existence même présente une analogie frappante avec l'Europe occidentale. Cette transformation a eu lieu à la période Kamakura (1192-1333), soit à une époque où, en Europe, apparaissait la chevalerie croisée. A cette période, au Japon, se renforce la parenté spirituelle entre le chevalier et le moine, deux figures en quête du dépassement de soi, c'est-à-dire deux figures qui tentent de surmonter la peur de la mort, de freiner les tendances humaines, trop humaines, vers la décadence et l'oubli des devoirs.
Quand le Japon commence à se doter d'une industrie, qui, dans un premier temps, est principalement une industrie militaire ou, au moins, une industrie liée au secteur militaire, cette discipline et ces vertus monachiques-guerrières se transforment en culte de la prestation industrielle (8). De cette façon, le Japon a pu se donner les hommes capables de lui construire des navires de guerre et des avions. Le progrès technique qui, de cette façon, prend aussitôt son envol, permet au Japon de refuser les traités inégaux qu'on lui avait imposés, ainsi que la juridiction spéciale des consulats qui impliquait l'extraterritorialité des Européens résidant au Japon et pouvait toujours donner prétexte à des interventions militaires des puissances étrangères, soucieuses de «protéger» leurs ressortissants. Le Japon pouvait dès lors réclamer l'égalité en droit face aux puissances européennes et son droit à disposer d'un empire colonial. Tous les autres Etats non européens, anciennes grandes puissances mondiales, comme la Chine, la Turquie, l'Egypte (9) ou l'Inde (10), qui n'ont pas réussi une réforme de leur armée, prélude à une industrialisation moderne, ont été maintenu dans un stade pré-industriel misérable.
La constitution de MacArthur
Quand l'on garde à l'esprit tous ces préludes historiques, on peut s'imaginer le choc ressenti par les Japonais en 1945 quand débarquent au Japon les soldats de la puissance qui, en 1853 déjà, avait menacé le Japon d'une invasion. Les Japonais avaient mobilisé tous leurs efforts pour échapper au statut colonial (11) et ils risquaient de le subir, après avoir succombé face à la coalition de l'URSS, de l'Empire britannique et des Etats-Unis, qui, un moment agités par un racisme aussi fou que missionnaire, avaient décidé de démocratiser le Japon et de le maintenir au niveau des pays sous-développés d'Asie. Selon toute vraisemblance, les Américains jugeaient que de tels procédés et de tels objectifs étaient acceptables et réalisables, ce qui nous permet de nous demander aujourd'hui comment on a pu les qualifier de «démocratiques».
Heureusement pour le Japon, la guerre froide éclata très vite et l'archipel nippon devait servir au moins de point d'appui industriel. Ensuite, le Japon a eu, en la personne de MacArthur, un administrateur militaire conservateur qui a mis directement un frein aux velléités des «rééducateurs» américains qui cherchaient à expérimenter une «révolution sociale» (12). MacArthur a tout de suite compris qu'une administration militaire correcte, capable d'éviter tout désordre, ne serait possible que si la puissance occupante ne touchait pas à la personne du Tenno et ne mettait pas en pratique les fantaisies exterministes qu'avait véhiculées la propagande de guerre. MacArthur refusa ainsi d'appliquer toutes les mesures que l'Amérique en guerre avait envisagé de prendre contre l'Empereur et se contenta de faire pendre les généraux qui lui avaient infligé des défaites aux Philippines, ainsi que le Premier Ministre, ce qui avait indigné Churchill (13), partant très logiquement du principe que, dans ce cas, on pouvait également lui faire un procès et l'envoyer au gibet.
Conformément aux principes du droit des gens, le gouvernement japonais est demeuré en exercice et la nouvelle constitution japonaise a pu voir le jour en conservant une filiation immédiate avec les principes de la constitution Meiji, si bien que l'on peut dire que la constitution Meiji est encore formellement en vigueur. Les libéraux japonais (14), c'est-à-dire ceux qui sont libéraux au sens américain du terme et se distinguent des libéraux-démocrates nippons, doutent du caractère démocratique de cette constitution. En effet, disent-ils, à cause des conditions imposées par la capitulation, l'acceptation par la chambre des aristocrates (qui se supprima elle-même en acceptant) de la nouvelle constitution et la sanction du Tenno n'ont eu qu'un caractère formel. Cette critique de la gauche libérale conduit à un curieux jugement de valeur, que l'on rencontre aussi en Allemagne, qui veut que les réformes introduites par la caste dirigeante du pays (comme par exemple le droit de vote démocratique pour le Reichstag) sont soupçonnées de fascisme, tandis que les régimes militaires étrangers sont considérés comme des garanties de démocratie!
La constitution de MacArthur, comme l'appellent ses critiques, a été jugée de façons très diverses. D'une part, elle semblait si libérale, qu'on pouvait se dire que même les Américains ne l'auraient pas acceptée (15), ce qui est juste, dans la même mesure où la Grundgesetz ouest-allemande ne pourrait faire consensus aux Etats-Unis (16) pour divers motifs, parfaitement compréhensibles d'un point de vue conservateur. Par ailleurs, cette constitution a été contestée parce qu'elle constituait une nouvelle mouture de la constitution Meiji —et MacArthur l'avait perçue ainsi. Des juristes japonais, qui veulent être lus en Occident, tentent évidemment d'en donner une interprétation «occidentaliste», décrivant toutes les décisions de la majorité parlementaire et des tribunaux japonais comme autant de renforcements du «militarisme» ou du «nationalisme». Cela leur assure un public de lecteurs étrangers (17).
Quoi qu'il en soit, le Japon a réussi à pratiquer sa nouvelle constitution dans le sens de la constitution dont elle est la continuité en termes formels. Preuve que le constitutionalisme peut être un mode de gouvernement efficace, comme l'atteste la façon dont le Japon a réglé le problème de la privatisation des chemins de fer, alors qu'en Allemagne les milliards de dettes s'accumulent. En outre, signalons que la sanction impériale confère aux lois une signification religieuse, dans l'optique de la majorité des citoyens nippons, du moins insconsciemment. Ce qui explique le taux de criminalité extrêmement bas que connaît l'Empire du Soleil Levant.
En dépit des exagérations proférées par ces commentateurs ou idéologues libéraux, il me faut tout de même signaler que la constitution actuelle a tout de même transposé dans les faits certains projets ou idées défendus pendant l'entre-deux-guerres par le plus connu des représentants de la «nouvelle droite» d'alors, Kita Ikki (18), comme la suppression de la caste aristocratique, afin d'éliminer les obstacles existants entre l'Empereur et le peuple, et de la remplacer par une assemblée consultative élue, destinée à orienter les décisions de la chambre des représentants. Les revendications d'Ikki se référaient aux réformes du Régent Shotoku Taishi (574-622) (19), que l'on peut considérer comme le Solon japonais. Dans un recueil de dix-sept articles, ce dernier a forgé la structure de la vieille constitution japonaise, en s'appuyant sur un confucianisme adapté au pays, c'est-à-dire un confucianisme respectant la religion bouddhiste et acceptant le mythe shintoïste de l'Empereur.
Afin de préserver le Japon de tous troubles révolutionnaires, pareils à ceux secouant en permanence la Chine, parce qu'on y avait affirmé que l'Empereur, ou plutôt la dynastie, avait perdu le mandat du Ciel, Taishi octroya au Grand-Roi du Japon (O-kimi) le titre de Tenno, qui, de ce fait, fut décrété «divinité révélée» (arahito gami). Cette doctrine, souvent mésinterprétée, correspond ni plus ni moins à la conception ouest-européenne des deux corps du monarque (20). L'existence du deuxième corps du monarque, invisible et divin, implique la conception de corporéité personnelle et territoriale de l'«Etat» (qui, lui non plus, n'est pas «visible»), et que le monarque symbolise en tant qu'être visible (21). Conséquence de cette doctrine: il était désormais impossible que Dieu et l'Empereur puissent être en contradiction, ce qui, ipso facto, excluait toute révolution à la mode chinoise. La succession du trône était légitimée par filiation directe et droit d'aînesse (ce qui est une autre analogie frappante avec l'Europe occidentale). Devant l'Empereur, qui règne sur tous, tous sont toutefois égaux. Les fonctions ne sont pas héréditaires; les fonctionnaires ne sont recrutés que sur base de leurs compétences. Le peuple doit obéir à l'Empereur, mais celui-ci n'a pas le droit d'exercer une dictature, car il doit tenir compte du principe du consensus (art. 10 et 17) (22).
Autre moyen pour préserver le système du Tenno de tout danger révolutionnaire: l'obligation, pour l'autorité suprême de conserver une stricte neutralité. Grâce à ce principe, le système du Tenno a pu se maintenir en dépit des guerres civiles, du Shogunat et du système féodal, érigé à l'encontre des intentions de Taishi (23). Ce système présente donc une continuité, semblable à celle de la papauté romaine (24). Au vu de cette évolution, on comprend pourquoi le Japon a emprunté la voie de la modernisation en réactivant tout simplement l'exercice direct du pouvoir par l'Empereur, et permet aussi de comprendre pourquoi la revalorisation du rôle du Tenno et la démocratisation, achevée en 1925, ont été concomitantes. Il faut tenir compte de cet arrière-plan historique pour bien saisir la démarche de ceux qui se font les avocats des «obstacles» entre l'Empereur et le peuple nippon, obstacles qui sont notamment le «Shogunat» américain ou les intellectuels de gauche japonais qui réclament l'avénement d'un fondamentalisme libéral par le biais d'un culte pacifiste (25) quasi religieux, appelé à devenir une nouvelle religion d'Etat, ou encore l'opposition de gauche qui, dans un passé récent, s'engouait pour les rituels politiques de l'orwellienne Corée du Nord (26).
La gauche allemande et le Japon
On pourrait penser que le Japon offre beaucoup à la gauche allemande dans sa recherche permanente de patries de remplacement. Car, enfin, l'inlassable quête de la gauche intellectuelle, la recherche fébrile de modèles étrangers, trouverait dans l'Empire du Soleil Levant un pays extra-européen qui a tenu tête aux impérialismes européens, a conservé son identité culturelle dans une très large mesure, tout en demeurant un pays industriel compétitif et offensif; nous dirions même mieux: le Japon est devenu tel précisément parce qu'il a su conserver son identité (27). Mais, pour la gauche allemande, le Japon reflète trop la vieille Prusse pour que son égophobie puisse l'admirer. Un fait est certain: le Japon a réussi à maîtriser la modernité dans un sens positif; il a construit une société industrielle, imperméable à tout mythe révolutionnaire, a souligné l'importance d'une réforme militaire pour le développement de l'industrie (assortie d'une politique systématique et fanatique visant l'interdiction de toute exportation d'armements, pratique considérée comme freinant l'autarcie du développement industriel), a inauguré une voie conservatrice vers le développement qui a démontré son efficacité. Tout cela contrarie l'euphorie de la gauche allemande en faveur des sociétés multiculturelles.
Ensuite, le Japon prouve, par ses succès, que les religions asiatiques, dans le concret, n'offrent pas de la consolation à bon marché, contrairement à ce que croient les adeptes du New Age, mais indiquent plutôt une voie de salut personnel reposant sur l'ascèse et le travail assidu (depuis le XVIième siècle, les moines japonais ne mendient plus mais convertissent la population à un «ascétisme immanentiste», un peu au sens où l'entendait Max Weber). Quand on examine comment a été traitée l'information venue d'Extrême-Orient dans un hebdomadaire comme le Spiegel, on constate que le régime abstrus d'un Mao Tse-Toung (28) y a été mieux traité que la politique japonaise, émanation de procédures démocratiques. Un homme de gauche chinois qui s'embrouille et se trompe, mais prétend travailler pour le salut de l'humanité, sera mieux jugé par nos journalistes qu'un homme de droite japonais qui commet quelques gaffes en finançant sa campagne électorale.
Cette vision des choses est due à la manipulation de l'histoire, que nous avons vécue dans le sillage de la rééducation, optique pour laquelle le Japon est même tenu responsable de l'atomisation de Hiroshima et de Nagasaki (29). Dans ce cadre, la gauche parlait beaucoup de la «responsabilité» du Tenno, récemment décédé (30), ce qui prouve que cette gauche, face au fait Japon, instrumentalise une fois de plus la vision rééduquée de l'histoire à son profit.
Tout cela est d'autant plus absurde que le «militarisme» japonais présentait des aspects qualifiables d'«extrême-gauche». En 1925, au Japon, l'introduction du suffrage universel était lié à un compromis: en même temps que son adoption était promulguée une loi visant à garantir la paix civile, impliquant l'interdiction de toutes les organisations visant à changer la structure de l'Etat et à éliminer la propriété privée. Ce compromis obligea la gauche à s'adapter au «socialisme impérial» (31), surtout au moment de la crise économique, quand l'armée, radicalisée, contraignit les gouvernements bourgeois successifs, notamment pendant la guerre de Mandchourie, à passer à l'action. Dans un mémorandum adressé au Tenno, le futur Premier Ministre Konoé évoque les hommes de la droite musclée et dit d'eux qu'ils ne sont rien d'autre que des communistes masqués, qui ont revêtu les oripeaux de la kokutai (l'idéal de la communauté nationale), tout en planifiant une véritable révolution communiste destinée à préparer le Japon à une guerre de libération panasiatique (32).
Lorsque les députés japonais ont voté la loi de 1938 décrétant la mobilisation générale, le représentant du peuple Nishio Suehiro, du «Parti des masses populaires» (après la guerre, Suehiro fonde le Parti Démocratique Socialiste, dissidence de l'aile syndicaliste traditionnelle des Socialistes, amis de la Corée du Nord), déclare que le Premier Ministre japonais doit être un chef aussi crédible que le sont Mussolini, Hitler et Staline (33). La gauche avait appliqué son schéma de la lutte des classes à la politique internationale et admis que le Japon (tout comme l'Allemagne) était une «nation prolétaire», opposée aux Etats possédants, qui instrumentalisaient une «morale supérieure pacifiste» pour pouvoir défendre leurs possessions coloniales plus aisément (34). Ce constat, posé par une personnalité de gauche comme Suehiro, a été accepté par bon nombre d'hommes de droite, si bien que la guerre, au Japon, a fait l'objet d'un consensus global entre gauche et droite (35).
Or, comme la gauche ne se distingue de la droite que dans la question de la position du Tenno, les protagonistes de la gauche manipulent l'histoire en rendant le système du Tenno responsable de la guerre et tente de faire passer la droite pour un ramassis de canailles. Pourtant, jamais un régime véritablement totalitaire ou national-socialiste n'a accédé au pouvoir au Japon (36), parce qu'avec la monarchie, les élites traditionnelles du pouvoir pouvaient affirmer leurs positions, même si les partis avaient été réunis dans un mouvement, pour des raisons dépendant davantage des circonstances de guerre que d'une idéologie bien profilée. Et si l'on veut absolument affirmer la culpabilité japonaise, il faut rendre le peuple responsable, vu le large consensus qui a règné tout au long de la guerre. Mais une inculpation globale du peuple japonais ne cadre pas avec le dogme démocratique de l'innocence a priori du peuple, surtout si ce sont des Européens qui inculpent, jugeant de la sorte un peuple non-européen auquel on accole une culpabilité collective: c'est à juste titre alors qu'on soupçonnera les «juges» de racisme. De ce fait, manipuler le passé ne peut plus se faire que sur base d'«analyses structurelles post-racistes» à la Habermas, où la canaille est toujours celui qui «représente» le passé.
Mais on s'aperçoit bien vite dans quelle continuité se situent ces analyses: la littérature de la gauche allemande sympathise très souvent avec les projets les plus étonnants des autorités d'occupation américaine au Japon, comme par exemple, l'idée fumeuse de remplacer le Japonais par l'Anglais (37), parce que ç'aurait été, paraît-il, la meilleure façon d'éliminer les «structures linguistiques non démocratiques» (mais, dans les mêmes ouvrages, on accuse les Japonais d'avoir voulu imposer leur langue aux Coréens, ce qui est normal, puisque leur grammaire est «non-démocratique»...). C'est ainsi que l'on s'aperçoit, au fond, que les gauches ne tolèrent aucunement la multiculturalité, car elles s'y attaquent par tous les moyens, précisément là où cette multiculturalité revêt un sens, c'est-à-dire à l'échelon international. La gauche —c'est un fait acquis— croit au «bon sauvage», mythe qui avait déjà conduit les révolutionnaires français à commettre l'irréparable, dans leur propre pays, en Vendée et à Lyon. Et lorsque les ressortissants d'un pays exotique ne se comportent pas, dans leur vie quotidienne ou leur vie politique, comme on a imaginé qu'ils devraient se comporter, et quand ils deviennent des concurrents sérieux, que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan économique (38) et confisquent de la sorte à la gauche son beau rôle favori, qui est de materner, d'«aider au développement», alors les masques tombent: les mêmes moralisateurs exigent que la communauté récalcitrante soit mise au pas, au diapason des valeurs qui ont été posées une fois pour toutes comme seules valables, ou exigent pire encore, l'atomisation, les tapis de bombes, l'éradication (39)...
La politique allemande et le Japon
Face à cette volonté des gauches de tout vouloir uniformiser et mettre au pas, nous sommes bien obligés de considérer la voie particulière, suggérée par le Japon, comme un enrichissement de l'horizon des expériences humaines. Et de la défendre comme telle. Si le Japon est en passe de devenir la nation-guide en matière de technologie (40) —après que l'on ait reproché, et pendant longtemps, aux Japonais de n'être que des «imitateurs» plus ou moins talentueux— on a intérêt à s'interroger très sérieusement sur la signification des «voies particulières» pour le développement futur de l'humanité, et donc des potentiels de créativité qu'elles incarnent. Les «voies particulières» ont ceci pour elles qu'elles s'avèrent toujours être les meilleures voies; dans le cas du Japon, son exemple a séduit les autres pays de l'Asie orientale, dans le sens où il constitue une remarquable synthèse, réussie, entre le confucianisme traditionnel et les modèles européens (ajoutons que cette synthèse a pu s'accomplir parce que le modèle prussien a été importé, imité et japonisé). A juste titre, plusieurs voix ont demandé aux Américains de ne pas imiter les Japonais pour tenir bon face à la concurrence extérieure, mais de revenir à leurs propres traditions, notamment celle, puritaine, du travail acharné (41), créateur de richesses, et, partant, signe d'élection divine. Les Allemands feraient d'ailleurs bien d'imiter pour leur propre compte ce conseil donné aux hommes d'affaire américains et, mieux, de le mettre en pratique de façon plus systématique encore: en étudiant l'histoire du Japon, ils verraient que leurs propres traditions politiques germaniques permettent parfaitement à un pays faible de sortir très vite de sa misère pré-industrielle.
Les auteurs allemands qui savent comment s'agencent réellement les choses et, partant, ne partagent pas l'opinion, courante de nos jours, qui veut que le Japon soit l'«élève modèle des Etats-Unis» et, a fortiori, n'ont pas succombé à l'esprit du temps, qui se veut anti-prussien, ne critiquent pas les Japonais d'avoir adopté des modèles prussiens et non pas des modèles britanniques «libéraux et éclairés». Certes, le Japon n'est pas un Etat idéal de facture libérale-démocratique (42), ce qui ne doit pas nous empêcher de constater que les pays non-européens qui, plutôt de mauvais gré que de bon gré, ont adopté le modèle britannique, n'ont jamais pu dépasser le stade de la pauvreté pré-industrielle ou celui de cette pauvreté perpétuée par le socialisme, en dépit des aides au développement. C'est le cas de l'Inde ou des pays des Caraïbes. Ou bien, ils ont basculé dans les dictatures socialistes dites «de développement» (Afrique). Mais lorsque des régions de l'ex-Commonwealth britannique connaissent le succès économique en conservant des institutions de type britannique, comme Singapour ou Hong Kong, elles se placent en dessous du Japon sur le plan de la démocratie pure et théorique. Qui plus est, ces régions doivent leur succès pour l'essentiel à l'afflux de capitaux privés japonais et à l'imitation des modes japonais de gestion d'entreprise.
Dans le passé, les échanges germano-japonais se sont effectués sur une voie à sens unique, raison pour laquelle le monde politique allemand n'a jamais pris correctement connaissance des affaires japonaises. Cela vaut même pour la seconde guerre mondiale, quand pourtant les services secrets britanniques gaspillaient beaucoup d'heures précieuses en tentant de déchiffrer les arcanes d'une stratégie germano-japonaise secrète qui n'existait pas... (43). En dépit des nombreux intérêts communs qui pourraient unir Allemands et Japonais, les hommes politiques allemands font tout pour que cette réelle communauté d'intérêts ne se transforment pas en une politique commune. Quand un chancelier allemand se plaint devant les Américains que l'Allemagne porte le fardeau le plus lourd dans le financement de la perestroïka et que ce chancelier en appelle à d'«autres» pour participer à cette opération hasardeuse, il ne peut que susciter le mépris des Japonais. Car, en fin de compte, ceux-ci ne sont nullement responsables du fait que les Allemands, niais, se montrent incapables de reconnaître leurs propres intérêts. Or comme cette plainte est adressée aux Américains, les Japonais pourraient parfaitement interpréter cette démarche comme une menace, en d'autres termes, comme un appel aux Américains —qui ne veulent pas payer eux-mêmes la perestroïka— à pressurer les Japonais. Ceux-ci perçoivent dans ces exercices de mauvais goût une sorte de pression morale constante, qui les obligerait, en bout de course, à participer à ces exhibitions de culpabilité dont les hommes politiques allemands sont passés maîtres et où ils étalent sans vergogne le mépris qu'ils cultivent à l'égard de leur propre peuple. Les Japonais essuyent de plus en plus souvent des allusions désobligeantes comme celles d'un Helmut Schmidt, qui se venge parce que les Japonais n'avaient pas suivi jadis sa folie des grandeurs, en refusant le rôle de locomotive de l'économie mondiale qu'il suggérait à un tandem germano-nippon. D'où son argument: les Japonais doivent chercher la «réhabilitation» (44).
Cette dénonciation infantile des Japonais n'est d'aucune utilité pour les Allemands. Ceux-ci devraient bien plutôt tirer les leçons qui s'imposent du conflit qui se profile nettement à l'horizon, entre le Japon et les Etats-Unis. Ils apprendraient ainsi qu'il ne suffit pas de connaître le succès économique sur la scène internationale (45). D'autres Etats ont des idées très claires sur la «responsabilité pour le monde» qui découle de la puissance économique.
Sur base de l'équation désormais conventionnelle entre les intérêts de l'Occident anglo-saxon et ceux de la «démocratie» (mais du pouvoir de quel peuple s'agit-il en l'occurrence?), n'est-ce pas une honte que ce ne soit pas le gouvernement légitime du Japon, démocratiquement élu, qui puisse définir cette «responsabilité», mais, à sa place, l'Administration américaine? Le succès économique japonais s'est effectué malgré les quantités réduites de matières premières dont dispose la métropole. Une telle situation est précaire, relève même d'une précarité croissante, car le Japon tombe de plus en plus sous la dépendance de l'étranger, fragilisant du même coup sa position stratégique. Le Japon pourrait de la sorte être contraint de payer comme au lendemain d'une guerre perdue. Le progrès sur les plans économique et technique devient un élément cardinal de la grande politique planétaire, surtout au moment où les Etats-Unis ne peuvent plus faire la guerre sans la technique japonaise et sans l'accord de Tokyo pour financer le déficit de l'Etat américain (n'oublions pas que les contributions japonaises et allemandes ont permis aux Etats-Unis de tirer de substantiels profits financiers de l'opération koweitienne) (46). Dans de telles circonstances, la présence des troupes américaines revêt une finalité économique et technologico-politique (47), si bien que l'on risque l'Europe au profit de l'OTAN. Le public japonais, lui, sent toujours la corde que l'on veut lui passer autour du cou (48). Ainsi, on pousse chaque jour davantage le Japon à risquer une confrontation avec la Chine (49); ensuite, la Corée du Nord donne bonne conscience aux Anglo-Saxons: ils peuvent y trouver un Saddam Hussein qui y règne depuis 40 ans. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir (50)? Les avertissements que lancent les militaires ne sauraient être négligés sous prétexte qu'ils sont des exagérations, même si notre époque considère, en théorie, que les guerres ne sont plus «rentables» (c'est également ce que l'on croyait à la veille de la première guerre mondiale). En effet, dès 1925, l'année où le suffrage universel est introduit au Japon (51), un spécialiste britannique de la marine (52) décrit dans un roman le déroulement de la guerre du Pacifique de 1941-45, avec une relative exactitude. Si l'on suit attentivement le fil conducteur, mentionné au début du livre, il apparaît tout de suite clairement qu'une bonne partie du public américain s'imagine parfaitement qu'une guerre contre le Japon est possible, de même d'ailleurs qu'une guerre contre l'Allemagne (53), ce qui ne doit pas nous étonner, vu qu'il y a très souvent équation entre les deux puissances. Celles-ci peuvent éviter la guerre en payant, bien entendu pour soutenir de «nobles causes». Et si ces puissances se rebiffent, elles pourront aisément être manœuvrées et succomber à ces stratégies fatales dont les Américains se sont fait une spécialité, tablant sur la fragilité de leurs adversaires et les forçant, comme l'avouait le ministre de la guerre de Roosevelt juste avant Pearl Harbour, à frapper le premier coup et à passer aux yeux de l'opinion publique internationale comme des «agresseurs» méritant une juste punition. Aujourd'hui, Allemands et Japonais paient tout de suite, volontairement, même sans y être formellement obligés comme dans l'art. 231 du Traité de Versailles ou selon le droit dit à Nuremberg ou à Tokyo. De plus, on a extirpé du mental allemand, mais aussi du mental japonais, l'«esprit prussien» qui s'oppose radicalement au sentiment des Anglo-Saxons d'être un peuple élu. Il y aurait aujourd'hui des Japonais qui souhaiteraient avoir comme nous Allemands un Président, qui déclarerait que le 8 mai est une «journée de libération» (53) (pour le Japon ce serait sans doute le 6 août, jour où Hiroshima fut atomisée, à la suite, c'est bien connu, d'une «provocation» japonaise). En effet, ces deux journées de l'an 1945 ont inauguré l'ère de paix et de liberté que nous avait annoncée et promise Roosevelt.
Josef SCHÜSSLBURNER.
(texte issu de Criticón, März/April 1992; adresse: Knöbelstrasse 36/0, D-8000 München 22; prix de l'abonnement: DM 63,- ou DM 42,- pour les étudiants et les lycéens).
Notes:
(1) S. Shinkokinwakashu-Japanische Gedichte, Reclam, p. 91.
(2) Ce n'est qu'en juillet 1991 que le gouvernement américain a reconnu que les anciens «Flying Tigers», engagés aux côtés des Chinois avant Pearl Harbour, étaient des vétérans comme les autres. Cf. A. Schickel, «Verdeckte Kampfhandlungen durch Fliegende Tiger», in Geschichte, n°6/1991, p. 64. Le fait qu'E. Wickert (dans son article de la Frankfurter Allgemeine Zeitung du 28 nov. 1991), qui s'efforce pourtant de nous présenter les faits de manière équilibrée, ne mentionne pas cet aspect des choses et parle plutôt d'«une attaque en pleine paix», ce qui est vrai mais seulement du point de vue de l'opinion publique américaine et ne correspondait nullement à l'expérience des Japonais. On voit que l'on est toujours loins d'une présentation objective.
(3) Cf. C.H. Ule, «100 Jahre Meiji-Verfassung in Japan», DVBl., 1989, pp. 173 et ss.; les textes de la constitution Meiji et de la constitution de MacArthur figurent en annexe du livre de Miyazawa Toshiyoshi, Verfassungsrecht (Kempo), vol. 21, de la Schriftenreihe Japanisches Recht, 1986.
(4) Cf. Klaus Luig, «Rudolf von Gneist (1816-1895) und die japanische Verfassung von 1889», in Kulturvermittler zwischen Japan und Deutschland, édité par le Japanisches Kulturinstitut de Cologne, 1990, p. 50 et ss.
(5) Cf. Andreas Meckel, «Jacob Meckel (1842-1906), Instrukteur der japanischen Armee - Ein Leben im preußischen Zeitgeist», in [voir note (4)], pp. 78 et ss.
(6) Cf. John Whitney Hall, Das Japanische Kaiserreich, vol. 20 de la Fischer Weltgeschichte, 1968, p. 10.
(7) Cf. Hajime Nakamura, «Der religionsgeschichtliche Hintergrund der Entwicklung Japans in der Neuzeit», in Japan und der Westen, édité par v. Barloewen/Werhahn-Mees, vol. 1, pp. 56 & ss. De même, Shichihei Yamamoto, Ursprünge der japanischen Arbeitsethik, ibid., pp. 95 & ss.
(8) Cf. Michio Morishima, Warum Japan so erfolgreich ist, 1985, surtout pp. 95 & ss.
(9) Voir à ce propos, David B. Ralston, Importing the European Army. The Introduction of European Military Techniques and Institutions into the Extra-European World, 1600-1914, 1990.
(10) Cf. Ingeborg Y. Wendt, Japanische Dynamik und indische Stagnation?, 1978, voir surtout les p. 67 & ss.; quand on songe au fait que le Japon n'a imposé son autonomie douanière qu'en 1911, on comprend que le Japon a longtemps risqué d'être houspillé sur une «voie indienne».
(11) On oublie trop souvent aujourd'hui qu'en 1945 le colonialisme n'était interdit qu'aux Japonais et aux Allemands. Les Hollandais ont aussitôt repris leurs guerres coloniales en Insulinde mais l'occupation japonaise avait déstabilisé et affaibli trop considérablement l'administration néerlandaise, ce que les Hollandais ne pardonneront pas de si tôt aux Japonais (voir note 39).
(12) La grève générale planifiée par les socialistes et les communistes en février 1947 a été interdite à temps par le quartier général allié, inquiet des succès communistes en Chine, voir note 8), p. 171; à cause d'une intrigue machinée par la CIA, le seul cabinet socialiste japonais est tombé en 1948, voir à ce propos Crome, note 30), pp. 246 & ss. De cette façon, les forces de gauche, que le libéralisme américain avait pourtant hissé aux positions dirigeantes, ont été éloignées du pouvoir. L'introduction d'une système électoral qui fait que les campagnes électorales sont chères, a rendu difficiles les victoires de la gauche, surtout qu'il n'existait pas de système de financement des partis et des campagnes électorales. A propos du financement des partis au Japon, cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25 nov. 1991 (supplément «économie»).
(13) Cf. Walter Millis (éd.), The Forresal Diaries, 1951, p. 524.
(14) C'est ce que dit Toshiyoshi, voir note 3), pp. 43 & ss.
(15) Voir note 6), p. 347.
(16) voir à ce propos notre article, «Wie soll eine gesamtdeutsche Verfassung aussehen», in Criticón, Nr. 120, pp. 171 & ss.
(17) Ce que l'ont peut observer en lisant le Japan Quarterly, notamment le numéro d'oct.-déc. 1988, pp. 350 & ss., «When Society is Itself the Tyrant», où l'on entend par «tyran» la société japonaise elle-même, qu'il s'agit de «rééduquer» selon les principe du «libéralisme de gauche», idéologie dominante aux Etats-Unis.
(18) En dépit de ses positions socialistes, il n'en était pas moins un monarchiste tiède (cf. son ouvrage de 1906, Die Theorie des Nationalen Gemeinwesens und des wahren Sozialismus); cette orientation est opposée à la droite traditionnelle, dont le «noyau dur» comprend environ 1/5 de la fraction du PLD (Parti Libéral-Démocrate) et dont les intellectuels les plus représentatifs sont les journalistes Hideaki Kase et le compositeurs japonais le plus connu, Toshiro Mayuzumi. En partant du principe que si le Japon n'avait pas été la première victime d'une attaque atomique, il n'y aurait pas eu dans le monde de «zones dénucléarisées», ce groupe se réserve l'option d'un armement atomique pour le Japon.
(19) Voir note 8), pp. 29 & ss. Ces articles sont explicités de façon fort complète par Hermann Bohner et Shotoku Taishi de la Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Tokyo (s.d.).
(20) Ouvrage fondamental à ce sujet: Ernst H. Kantorowicz, Die zwei Körper des Königs, Première édition all.: dtv/Wissenschaft, 1990.
(21) Comme l'art. 1 de la constitution japonaise actuelle ne dit pas autre chose, Hirohito, à juste titre, n'a pas accordé d'importance particulière à son renoncement au statut de «divinité». Lorsque l'on songe qu'une entité aussi décisive que l'«Etat» n'existe qu'en tant que chose pensée (ou crue, c'est-à-dire en un certain sens en tant que mythe), cela devrait en fait réfuter toute forme de matérialisme.
(22) L'art. 17 doit être cité à ce niveau-ci de notre exposé, tant il reflète la sagesse politique asiatique: «Les décisions ne doivent pas être prises par une seule et unique personne... Dans un cas de moindre importance, c'est facile; on ne doit pas être nombreux pour délibérer; seulement dans les cas où il s'agit d'affaires importantes, et où vous vous inquiétez du fait de pouvoir éventuellement vous tromper, alors il faut que vous vous concertiez à plusieurs pour obtenir une vision claire de l'affaire. Alors il en sortira quelque chose de rationnel». La première des cinq promesses inscrites dans le serment de la Restauration Meiji, qui promettait d'instaurer un conseil de type parlementaire aussi large que possible, de façon à ce que les «dix mille affaires de l'Empire» puissent être réglées au départ de discussions publiques, remonte à l'art. 17 du Codex Taishi (voir note 19)).
(23) L'art. 12 ôtait aux administrateurs provinciaux le droit de lever l'impôt de manière autonome, de façon à garantir l'unité de l'appareil administratif de l'Etat.
(24) Comme le Tenno, aux époques les plus grandioses de l'histoire japonaise, voyait ses fonctions réduites à celle de pontife supérieur, l'histoire du Japon présente, quoique dans une forme édulcorée, quelque chose ressemblant à la bipolarité (Empereur/Pape; spirituel/temporel; religieux/scientifique) propre à la voie particulière empruntée par l'Europe occidentale, ce qui explique sans doute les analogies entre le Japon et la portion occidentale de notre continent.
(25) C'est clair dans le texte mentionné en note 17), qui signale qu'à la place de la théocratie d'avant-guerre s'est substituée une «serious soul-searching» (une recherche de l'âme sérieuse), débouchant sur une obligation de pacifisme (v. p. 352), qui s'enlise rapidement dans un dogme postulant que seul l'Etat nippon est en tort quand surviennent des tensions. Dans ce sens, on prétend (p. 351) que le refus japonais du service militaire a fait que les tensions en Asie n'ont pas conduit à l'escalade (mais on ne prévoit rien dans le cas où le Japon serait dans son droit).
(26) Ce n'est que depuis peu de temps que les socialistes japonais, qui se nomment désormais «sociaux-démocrates», s'efforcent d'adopter une attitude plus positive à l'égard de la Corée du Sud. Le fait que l'idéologie pacifiste juge positivement le régime nord-coréen, montre qu'en Asie les ersätze de religion peuvent prendre des formes plus perverses que les mauvais usages de religions traditionnelles originales.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, asie, affaires asiatiques, japon, extreme orient |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 juin 2010
Irak 1941: la révolte de Rachid Ali contre les Britanniques
 Irak 1941: la révolte de Rachid Ali contre les Britanniques
Irak 1941: la révolte de Rachid Ali contre les Britanniques
d'après une étude de Marzio Pisani
En 1941, l'Irak, nominalement indépendant, était de fait un protectorat britannique. La domination impérialiste anglaise en Irak se basait sur une présence militaire, sur le conditionnement politique et sur l'exploitation économique. La présence militaire consistait en deux bases aériennes, l'une à Chaïba, près de Bassorah au Sud, et l'autre à Habbaniya près de Bagdad. La RAF y entretenait 88 appareils. Une troisième base était en construction à Routbah. Les Anglais avaient permis que se constituent une armée et une police irakiennes, dotées d'avions. Ces troupes étaient sensées défendre les intérêts de l'Empire. Elles allaient se révéler instruments du nationalisme arabe, sans que les Anglais ne s'en aperçoivent à temps. Les Britanniques avaient imposé à leur marionette irakienne, le Cheik Abdoul Ila, un traité qui autorisait les troupes anglaises à circuler librement partout sur le territoire irakien, inclus d'office dans le Commonwealth. Mais les éléments d'élite de la nation irakienne n'acceptaient que très difficilement cette mise sous tutelle: la politique pro-arabe de l'Axe les séduisait. Les diplomates italiens et allemands en poste dans le pays l'infiltrèrent idéologiquement, ébranlant le prestige des Britanniques dans toute la région.
Sur le plan économique, le capitalisme anglo-saxon exploitait sans vergogne les ressources pétrolières du pays par le biais de ses compagnies pétrolières. A la déclaration de guerre, cette arrogance conduisit les Irakiens à rompre les relations diplomatiques avec l'Allemagne et l'Italie —sous pression britannique— tout en refusant de déclarer la guerre à l'Axe. De plus, l'Irak offre l'asile au Grand Moufti de Jérusalem, grand propagandiste de la politique germano-italienne en Islam. Le 1er avril 1941, le groupe germanophile dit de la «Place d'Or», rassemblé autour de Rachid Ali, prend le pouvoir par un coup d'Etat. L'ensemble des forces armées irakiennes, armée de terre, aviation et police, se joint au nouveau régime. Les Anglais réagissent très vite pour remettre en place leur marionnette qui avait fui à l'étranger. Le porte-avions Hermes se porte dare-dare dans les eaux du Golfe Persique et la 20ième Brigade Indienne, accompagnée d'un régiment d'artillerie, débarque à Bassorah. Devant cette violation du territoire irakien, Rachid Ali organise l'insurrection fin avril. Les forces armées irakiennes comptaient quatre divisions d'infanterie, quelques unités mécanisées à faibles effectifs dispersés dans tout le pays et de 60 avions, des vieux modèles servis par des équipages inexpérimentés.
Fin avril, début mai, les Irakiens arrêtent les sujets britanniques résidant sur leur territoire et dirigent les flux de pétrole vers la Syrie de Vichy. Le 30 avril, ils lancent une attaque contre la base de Habbaniya. La police de Routbah verrouille la ville et la population de Bassorah s'insurge contre les Anglo-Indiens et amorcent une guerrilla aux environs de la cité. Surpris, les Anglais doivent contre-attaquer par la Transjordanie, appuyés par les chars de la 1ière Division de Cavalerie (la «Habforce»), la fameuse Légion Arabe et quelques unités jordaniennes. Des renforts sont appelés d'Egypte et des Indes. Avec l'appui de la RAF, la Habforce reprend Routbah et brise l'encerclement de Habbaniya. A Al-Falloudjia, la bataille décisive a lieu entre le 19 et le 23 mai: les Irakiens résistent mais sont battus, écrasés par la supériorité matérielle de leurs adversaires.
Les forces de l'Axe étaient clouées dans les Balkans et en Afrique du Nord. Le seul appui dont purent bénéficier les Irakiens: une petite escadrille germano-italienne et des approvisionnements fournis par la France de Vichy au départ de la Syrie. L'extrême-nord du pays n'est pacifié définitivement que le 9 juin. L'occupation du pays est laissée à deux divisions indiennes: la 8ième au Sud et la 10ième au Nord, tandis qu'une brigade entière (la 24ième) est mobilisée pour protéger les lignes de communications entre Bassorah et Bagdad, menacées par les partisans irakiens. Ceux-ci ne déposèrent pas les armes de sitôt. Francs-tireurs et saboteurs restèrent actifs pendant toute la guerre. Les Britanniques durent mettre sur pied une flotille de bâteaux patrouilleurs sur les deux grands fleuves. Autre souci pour la 24ième Brigade: la protection des oléoducs.
En fin de compte, la révolte irakienne fut un échec. Les Anglais sont restés solidement accrochés au Moyen-Orient. Mais les destructions opérées préalablement par les troupes irakiennes en retraite, pratiquant la politique de la terre brûlée, ont mobilisé les énergies de bon nombre d'unités de génie. Obligés de distraire de gros moyens pour mater les Irakiens, les Anglais ont dû dégarnir leurs fronts libyen et malaisien, permettant à Rommel d'avancer vers l'Egypte et aux Japonais de s'emparer de Singapour.
Les Britanniques, après la départ de Rachid Ali pour Berlin, réinstallent l'ancien gouvernement et maintiennent le pays en état d'occupation. En 1943, le gouvernement anglophile irakien déclare la guerre à l'Axe mais sans pouvoir aligner des troupes. Quelques pilotes irakiens s'engagent dans l'armée de l'air italienne.
Marzio PISANI.
(résumé d'un article paru dans L'Uomo Libero, n°16, nov. 1983; adresse de la revue: L'Uomo Libero, Casella postale 14035, I-20140 Milano, Italie).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, irak, moyen orient, proche orient, monde arabe, années 40, mésopotamie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 juin 2010
L'internationale secrète qui ébranle les dictatures de l'Est
 SYNERGIES EUROPEENNES – BRUXELLES / GENEVE - Décembre 2004
SYNERGIES EUROPEENNES – BRUXELLES / GENEVE - Décembre 2004
Chers amis,
Voici l’excellent dossier que consacre le quotidien de Suisse romande, “Le Temps”, aux événements qui ébranlent l’Ukraine aujourd’hui et qui sont en fait la répétition des événements antérieurs qui ont agité la Serbie, la Géorgie et la Biélorussie (où la tentative de subversion générale avait échoué). L’article interroge les acteurs de ces “putschs” déguisés et en apparence pacifiques et dévoile utilement certaines de leurs tactiques. Ces tactiques sont déployées pour le bénéfice de l’impérialisme américain, qui applique tout simplement la stratégie Brzezinski, qui consiste à fractionner les franges de la puissance qui détient la “Terre du Milieu” et d’éloigner cette dernière des littoraux des mers chaudes. L’objectif est aussi de rendre inopérant tout Axe Paris-Berlin-Moscou, en introduisant entre l’Allemagne et la Russie une sorte de nouveau “cordon sanitaire”, comme le voulait, après la révolution bolchevique, Lord Curzon. Les atlantistes, les trotskistes, les fondamentalistes islamistes et les néo-conservateurs (de l’entourage de Bush, qui sont, dans la plupart des cas, d’anciens trotskistes) orchestrent, à gauche et à droite de l’échiquier politique, l’application de la doctrine Brzezinski. Pour le plus grand malheur de l’Europe et de ses enfants, qui vivront dans un monde infernal et dans un espace politique n’autorisant aucun développement ni épanouissement. La prise de conscience de cette situation doit nous conduire à combattre sans relâche ni pitié les canailles atlantistes, alliées objectives de la crapule gaucho-trotskiste, qui souillent encore, de leur présence et de leur indécrottable bêtise, le milieu identitaire. L’atlantiste, le trotskiste, le fondamentaliste islamiste et le néo-conservateur sont des ennemis mortels de notre civilisation, de la Vieille Europe, de tout ce qui nous est cher. Ils ne méritent que la haine et le mépris : une créature qui ose, en Europe aujourd’hui, se dire pro-américaine, ne mérite plus l’honneur d’être un citoyen d’Europe, ne mérite plus d’être considérée comme héritière et partie intégrante de notre civilisation, car elle nie la valeur de tous nos héritages et prépare un monde de mort et de misère pour nos enfants. Le quotidien suisse “Le Temps” —sans nul doute grâce à la neutralité helvétique, où l’atlantisme n’est pas aussi puissant que dans les pays de l’OTAN— nous donne des armes pour résister et pour comprendre comment fonctionnent les mécanismes qui conduisent à notre asservissement.
L’internationale secrète qui ébranle les dictatures de l’Est
La Serbie en 2000, la Géorgie en 2003, l’Ukraine en 2004: trois pays, trois révolutions populaires. Mais derrière les foules de manifestants s’active une nébuleuse d’activistes internationaux, de théoriciens de la non-violence et de financiers proches du gouvernement américain. Enquête.
Les manifestants installés depuis dix-huit jours dans le centre de Kiev imposeront-ils le réformateur Viktor Iouchtchenko à la tête de l’Ukraine? Ou leur mouvement sera-t-il finalement étouffé par les manœuvres du président sortant Leonid Koutchma? A des centaines de kilomètres de là, dans le centre de Belgrade, une poignée de jeunes Serbes se posent et se reposent cette question avec fébrilité. Membres de l’ancien mouvement étudiant Otpor («Résistance»), fer de lance du mouvement qui a chassé du pouvoir en 2000 le président yougoslave Slobodan Milosevic, ils ne se reconnaissent pas seulement dans les protestataires aujourd’hui à l’œuvre, ils les connaissent très bien pour leur avoir porté assistance ces derniers mois.
C’est que tous les anciens d’Otpor n’ont pas quitté la scène politique après la chute de «leur» dictateur. Bien conscients que d’autres peuples d’Europe orientale continuaient à vivre sous d’autres régimes autoritaires, un certain nombre d’entre eux ont décidé d’exporter leur combat et de se reconvertir en militants internationalistes de la révolution non violente. Certains sont allés en Géorgie l’an dernier pour prodiguer leurs conseils aux jeunes militants du mouvement étudiant de désobéissance civile Kmara («Assez!»), qui a contribué à renverser l’ancien président Edouard Chevardnadze et à porter au pouvoir le réformateur démocrate Mikhaïl Saakachvili. D’autres se sont rendus plus récemment en Ukraine dans l’espoir d’y rééditer leur exploit. «Nous y avons été 26 fois entre les printemps 2003 et 2004», se souvient Aleksandar.
Sur ce dernier terrain, les militants du Centre Otpor de résistance non violente sont à l’origine de deux organisations subversives. La première, Pora («C’est l’heure»), a été chargée de conduire une campagne de communication «négative», en dénonçant les inégalités: «Il s’agissait de pointer du doigt des problèmes sociaux, explique l’un d’eux. Des attaques contre les dysfonctionnements politiques n’auraient mobilisé qu’une minorité d’Ukrainiens.» L’autre organisation, Znayu («Je sais»), a reçu pour mission de mener une campagne «positive», en expliquant comment éviter les détournements de voix, vérifier les listes électorales, s’inscrire pour la première fois, etc.
Les activistes serbes sont d’autant plus habiles et efficaces qu’ils sont solidement encadrés. Ils ont ainsi bénéficié en Ukraine du soutien financier d’une organisation basée à Washington et très proche du gouvernement américain, Freedom House, qui se trouvait déjà à leur côté en Serbie à l’automne 2000 et qui les a aidés à former, mais sans succès pour le moment, des jeunes biélorusses du mouvement Zubr («Le Taureau»). En Géorgie l’an dernier, l’Open Society Institute (OSI) du financier George Soros a pareillement pris en charge la formation des militants de Kmara.
Et ce n’est pas tout. L’aide étrangère apportée aux activistes démocrates d’Europe orientale s’étend également à la formation. Ainsi, des séminaires de «formation des formateurs» ont été organisés outre-Atlantique – l’un d’eux a eu lieu le 9 mars dernier à Washington. Ces réunions, qui permettent des échanges d’expérience, réunissent de jeunes militants de terrain, tels ceux d’Otpor, ainsi que des anciens, tel Mukhuseli Jack, un acteur de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Ils attirent aussi des théoriciens de la lutte non violente, dont Jack DuVall, producteur d’un documentaire, Comment renverser un dictateur, qui a circulé sous le manteau dans de nombreux pays du monde, de la Géorgie à l’Iran, en passant par Cuba… Sans oublier certains proches du principal théoricien du mouvement, Gene Sharp, auteur d’un manuel traduit dans près de vingt langues, De la dictature à la démocratie.
Les organisations de base comme Otpor ne sont bien sûr pas capables d’imposer seules des révolutions. Pour provoquer un changement de régime, elles doivent cohabiter avec une opposition politique classique déterminée et s’appuyer sur un fort désir de changement au sein de la société. Il est parallèlement nécessaire que les régimes qu’elles affrontent leur laissent une liberté de mouvement minimale. A ces conditions cependant, fortes de leur courage juvénile et de leur art consommé de la subversion, elles sont devenues aujourd’hui le cauchemar de nombreux dictateurs.
*******
Les hommes forts de la région s’organisent
Une anecdote raconte qu’en décembre 2003, lors des funérailles du président azerbaïdjanais Heydar Aliev auxquelles assistaient tous les dirigeants de la CEI, Vladimir Poutine aurait commenté la Révolution des Roses en déclarant de façon très crue à sa nouvelle homologue géorgienne par intérim Nino Burdzhanadze que «tous les dirigeants font dans leur pantalon» à l’idée qu’un mouvement similaire puisse survenir chez eux.
De fait, nombreux sont les régimes autoritaires de la région à prendre des mesures contre la contagion du modèle non violent. La coopération avec les services secrets russes a permis la rédaction d’une liste noire d’activistes que détiennent le KGB Biélorusse et le FBU ukrainien, et qui a servi à expulser de ces pays au moins trois membres d’Otpor entre juillet et octobre. Autre exemple, plus médiatique, celui du chef d’Etat Kirghiz, Askar Akaev, qui s’est fendu d’un article dans le journal russe Rossiiskaya Gazeta, le 8 juin dernier, pour dénoncer «les nouvelles technologies internationales (pour organiser) des révolutions de velours».
Vladimir Poutine a envoyé de son côté des conseillers politiques russes pour soutenir la campagne de son protégé ukrainien Viktor Ianoukovitch contre ce qu’il a lui-même appelé une intervention «coloniale» de l’Occident. Mais son geste s’est révélé parfaitement inefficace.
*******
Gene Sharp: «L’essentiel est de diviser le camp adverse»
Le principal théoricien du mouvement, Gene Sharp, a quelques dizaines d’années d’expérience derrière lui. Et une volonté farouche de peser sur le cours des événements.
A 86 ans, Gene Sharp apparaît comme le principal théoricien du réseau international de révolution non violente à l’œuvre dans les pays d’Europe orientale. Pacifiste de la première heure durant la Seconde Guerre mondiale, il a approfondi sa réflexion en correspondant notamment avec Albert Einstein, avant de mettre ses théories à l’épreuve des faits sur des terrains aussi durs que la Birmanie. Interview.
Le Temps: Ainsi, la non-violence peut résoudre des conflits…
Gene Sharp: Soyons clairs: nous ne parlons pas de résolution de conflit mais de conflit tout court, de combat qu’il s’agit de gagner. Notre rhétorique s’apparente plus à celle de la guerre qu’à celle de la négociation. La méthode convaincra si elle est efficace. Mon travail a consisté à chercher dans le passé des exemples de soulèvement pacifistes susceptibles d’améliorer nos méthodes dans l’avenir. La chute du mur de Berlin a apporté une multitude de cas d’étude. Les Tchèques, les Polonais, les Allemands de l’Est, les Baltes ont beaucoup improvisé, mais avec succès. Le Printemps de Pékin a échoué de peu. La société parallèle albanaise du Kosovo des années 90, ainsi que les protestations serbes de 91 et 96 se sont en revanche avérées trop symboliques: jolies, mais pas efficaces. Otpor, en 2000, a eu une approche beaucoup plus technique. Ils ont compris qu’il ne servait pas à grand-chose de clamer le bien ou de critiquer le mal. L’essentiel est de diviser le camp adverse, pour affaiblir sa police, son armée, ses différents piliers, pour le saper jusqu’à l’effondrement.
– Comment avez-vous commencé votre recherche sur la lutte non violente?
– L’Holocauste venait, en 1945, de se produire. Nous assistions impuissants à la pérennisation de la tyrannie stalinienne et à l’explosion de la première bombe atomique. Le monde faisait face à une immense violence. Comme beaucoup de jeunes de ma génération, je me suis engagé à l’époque dans des mouvements pacifistes mais j’ai vite dû déchanter. Aucun n’avait de réponse à la violence extrême ou aux dictatures. Bien souvent, ils n’étaient même pas intéressés par la question. J’ai alors découvert le pacifisme actif dans l’histoire. La non-violence n’est pas nouvelle. Le concept existait déjà dans la Chine antique! Gandhi est un exemple incontournable mais il y en a d’autres, des gens qui ignoraient souvent ce qu’ils faisaient, qui se voyaient perdus d’avance mais qui, parfois, gagnaient. J’étais alors journaliste à Londres, mais mes recherches me passionnaient. Je suis passé à l’université de philosophie d’Oslo, puis à Oxford, où j’ai trouvé un livre de Karl Deutcher, un philosophe allemand qui analysait les faiblesses des dictatures. J’ai pensé qu’on pourrait se concentrer sur ces faiblesses. J’ai aussi découvert les «sources de pouvoir»: Hitler, Staline et leurs semblables n’étaient que des pauvres types, mais ils s’appuyaient sur des structures. Si on peut étouffer ces dernières, alors les dictatures s’effondrent d’elles-mêmes.
– Quels sont vos projets?
– J’ai écrit une vingtaine de livres sur la non-violence. Certains sont traduits en 30 langues et disponibles sur Internet. Le Centre Albert-Einstein pour la non-violence, que j’ai créé à Boston, collabore avec Freedom House, le Centre des conflits non violents, l’Open Society Institute… Nous avons des contacts avec les Nations unies. Aujourd’hui, je ne suis plus tout jeune. Je verrais bien Otpor assurer la relève…
*******
Milos, militant de l’ombre
Personne ne contestera à ce grand blond aux yeux bleus ses origines slaves. Milos Milenkovic a été membre fondateur d’Otpor en 1998, à l’âge de 19 ans. Depuis, il a participé à toutes les révolutions non violentes qu’a connues, de Belgrade à Kiev, sa région. Et s’il dirige aujourd’hui une ONG culturelle à Belgrade, il se tient prêt à aider d’autres oppositions si le besoin se fait sentir.
«L’Ukraine? J’y suis interdit de séjour jusqu’au premier janvier de l’an 3000, assure-t-il. Le pouvoir a fini par repérer nos ateliers de formation, trop tard pour lui. J’y suis allé une vingtaine de fois à partir d’avril 2001. Nous avons eu nos premiers contacts avec les Ukrainiens à Minsk, quand nous avons entrepris de former les ONG biélorusses, dont Zubr. Ils avaient été invités en tant qu’observateurs à notre séminaire.»
Lors de ses premiers voyages en Ukraine, Milos n’a que 23 ans mais il possède déjà une grande expérience de la révolution. L’an 2000, il l’a passé à former les nouvelles recrues d’Otpor, avant de diriger les 35 000 étudiants qui ont donné l’assaut à la dictature de Milosevic, le 5 octobre. Ses débuts de «consultant en révolutions non violentes» n’ont pas été faciles. Beaucoup de ses interlocuteurs doutaient de son utilité et prenaient plus au sérieux les instructeurs occidentaux. «Nous, les Serbes, avons l’avantage de présenter un point de vue différent, commente le militant. Nous avons plus l’habitude de travailler dans des conditions difficiles, avec des budgets limités et sous une surveillance constante. D’ailleurs, avant de nous attaquer à notre propre dictature, nous avions nous-mêmes rencontré des Polonais de Solidarnosc et des Slovaques d’OK Campaign, qui nous ont bien aidés.»
L’engagement de Milos est total. Les budgets de ces premiers séminaires – expérimentaux – sont réduits, et comme les autres formateurs serbes de l’époque, le militant est bénévole. Mais il ne regrette rien. «J’ai eu beaucoup de problèmes, j’ai perdu mes jobs d’étudiant, les services secrets serbes m’ont passé à tabac plusieurs fois. Mais on a gagné.»
*******
Quelques règles de base pour réussir sa révolution
Un harcèlement continuel vaut mieux qu’une attaque frontale, le rire que la force.
Cocktail nouveau composé d’ingrédients anciens, les révolutions qui ébranlent depuis quatre ans l’Europe de l’Est mêlent intimement une base théorique inspirée des travaux de l’Institut Einstein et des trouvailles d’une bande de camarades de faculté qui ont cru, dans le Belgrade des années 90, que la dérision était l’arme la mieux adaptée à la quête d’une vie meilleure.
D’abord comprendre
Mais avant d’attaquer un régime autoritaire, il convient de comprendre comment il fonctionne. «La dictature de grand papa, où un tyran règne sans partage sur un pays asservi n’existe presque plus, explique Slobodan, la trentaine, ancien d’Otpor et de la Géorgie. A la place, nous avons aujourd’hui des fausses démocraties où des élections sont organisées, où une opposition vivote mais où, au final, la même tête se retrouve toujours au sommet, sous un titre ou un autre.» La description convient au Serbe Slobodan Milosevic, qui a alterné les postes de président serbe et yougoslave, comme à l’Ukrainien Leonid Koutchma qui multiplie les manœuvres pour trahir la vox populi.
Or, ces dictatures s’appuient sur un certain nombre de piliers: police, armée, médias serviles, justice aux ordres, population obéissante… L’idée fondamentale de nos révolutionnaires est qu’un renversement du pouvoir passe par l’affaiblissement préalable de ces soutiens. Dans cette lutte, les coups les plus divers peuvent servir. En Serbie, dans les petites villes où tout le monde se connaît, les mères de militants arrêtés harcelaient la police locale de coups de téléphone implorant le pardon pour leurs adolescents de fils. A Kiev, de jolies jeunes filles ont fleuri les boucliers du cordon de sécurité du palais présidentiel, en demandant aux jeunes policiers s’ils allaient «vraiment les frapper». Le rire est une autre arme redoutable. Otpor a fait la quête pour «payer Milosevic afin qu’il quitte le pouvoir»; l’opposition Orange pour financer l’enterrement de Koutchma. Mais attention! La communication doit aller crescendo. Et puis il y a une multitude de petits trucs à connaître. «Un autocollant s’arrache en un instant, note Slobodan. Mais si vous le lacérez à coup de rasoir, il s’effritera sous les doigts de ceux qui voudront le décoller et il en restera toujours un morceau…»
Plus largement, les révolutions de Kiev, Tbilissi et Belgrade se sont articulées sur deux campagnes de communication. L’une, négative, critique les travers du pouvoir: corruption, pauvreté, manque de libertés… L’autre, positive, incite l’électorat à se mobiliser. Elle se base sur un calcul simple: «Les partisans du pouvoir votent de toute façon, explique un employé du Cesid, une ONG serbe spécialisée dans la surveillance des élections. Le tout est donc d’amener les autres aux urnes.»
*******
Succès et échecs
La Révolution d’octobre en Serbie
En janvier 2000, les organisations non gouvernementales serbes imposent leur réunification à une opposition politique divisée, qui entame une reconquête du pouvoir en s’appuyant sur un mouvement étudiant très populaire, Otpor. En juillet, le président Milosevic décide par surprise de remettre en jeu son poste de président de Yougoslavie. Après le scrutin truqué du 24 septembre, une grève générale s’organise et paralyse le pays. Le 5 octobre, la «Marche sur Belgrade» de 700 000 personnes (10% de la population) aboutit, en 5 heures d’insurrection populaire, à la prise du parlement et à l’effondrement du régime.
La révolution des Roses en Géorgie
En novembre 2002, des ONG géorgiennes contactent Otpor pour s’inspirer de l’expérience serbe. Des rencontres sont organisées par l’Open Society Institute (OSI) du milliardaire américain d’origine hongroise George Soros. Un réseau d’activistes et le mouvement étudiant Kmara se construisent, avec l’aide de l’OSI et du National Democratic Institute, une fondation politique américaine liée au Parti démocrate. Ces militants et l’opposition politique réunie derrière Mikhail Saakachvili contestent pendant 3 semaines le résultat des élections du 2 novembre et, le 22 décembre, la rose à la main, une foule envahit le parlement. Le président Edouard Chevardnadze prend la fuite.
Tentatives ratées en Biélorussie
Tentée en 2001 et 2004, la contestation en Biélorussie, qui s’appuie notamment sur le mouvement étudiant Zubr («Le Taureau») a échoué pour le moment. L’opposition politique harcelée par le pouvoir ne réussit pas à se renforcer. Le pouvoir entretient un sentiment de peur du changement dans les campagnes, s’assurant ainsi un réservoir de voix appréciable. Le 17 octobre au soir, jour d’élection, une manifestation d’environ 2000 personnes s’est formée dans le centre de Minsk, avant d’être violemment dispersée par les forces de sécurité, qui ont procédé à des arrestations. Le président Alexandre Loukachenko est accusé de graves violations des droits de l’Homme.
La révolution orange d’Ukraine
Préparée depuis le printemps 2003, la Révolution Orange aurait dû avoir lieu aux élections législatives de 2006, car ni l’opposition ni les ONG d’activistes n’étaient unies face au président sortant. Il a fallu le résultat contesté du premier tour pour que les socialistes se joignent à Iouchtchenko et que les organisations concurrentes «Pora jaune» et «Pora noir» s’unissent. Le mouvement a failli triompher lors d’une prise du parlement par Youlia Timochenko, numéro 2 de la liste «Notre Ukraine», le 30 novembre. Organisé par une population peu habituée à la contestation, le soulèvement a fortement ébranlé le pouvoir mais ne l’a pas (encore?) abattu.
source: letemps.ch
00:05 Publié dans Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, histoire, politique internationale, politique, serbie, ukraine, géorgie, otpor, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 05 juin 2010
Sur les mythes de la Guerre d'Espagne

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1989
Sur les mythes de la Guerre d'Espagne
Thomas KLEINSPEHN & Gottfried MERGNER (Hrsg.), Mythen des Spanischen Bürgerkriegs, Trotzdem Verlag, Grafenau-Döffingen, 1989, DM 22, 170 S., ISBN 3-922209-24-6.
La guerre civile espagnole a généré beaucoup de mythes tenaces. Dès 1936, aussitôt que claquèrent les premiers coups de feu et que les premiers Junker 52 débarquèrent les troupes hispano-marocaines de Franco en Andalousie, l'imagination populaire et les officines de propagande se mirent à produire du mythe à qui-mieux-mieux. Depuis la Commune de Paris de 1871, aucun événement politique n'avait autant excité l'imagination de la classe ouvrière européenne. Dès la fin des hostilités sur le terrain, la presse, les historiens et l'opinion publique ont repris ces discours mythifiants et élaboré quantité de variations à leur sujet. Le livre de Kleinspehn et Mergner reprend les actes d'un colloque organisé en 1987 à l'Université d'Oldenburg sur la Guerre d'Espagne. Successivement, une éminente brochette de spécialistes aborde les mythes relatifs aux brigades et aux milices, à l'anarcho-syndicalisme, au parti communiste qui a eu tant de «rénégats»... Dans un second volet, deux historiennes féminisantes mettent en évidence les difficultés des femmes dans la «révolution sociale» en œuvre sous la République et dans l'espace révolutionnaire de l'extrême-gauche espagnole. Enfin, troisième volet, les questions régionales de la péninsule ibérique, avec une analyse des mouvements basque et catalan. En conclusion, une critique serrée mais positive de l'obsession hispanique entretenue depuis cinq décennies par la gauche allemande quant à la Guerre d'Espagne. Ecrit par des personnalités de la gauche anarchisante allemande, cet ouvrage constitue une brillante critique pro domo. Le livre, de surcroît est illustré de nombreux fac-similés d'affiches éditées à l'époque de la Guerre Civile par des mouvements de l'extrême-gauche combattantes espagnoles. Elles témoignent toutes d'un style futurisant, très épuré et très poignant.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, guerre d'espagne, espagne, idéologie, mythes, manipulations médiatiques, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 04 juin 2010
G. Maschke: ex-gauchiste, schmittien, pessimiste et amoureux de la vie
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
Günter Maschke: ex-gauchiste, schmittien, pessimiste et amoureux de la vie
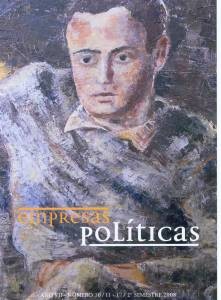 A l'âge de six ans, Günter Maschke, natif d'Erfurt en Thuringe, s'installe dans la ville épiscopale de Trêves, en Rhénanie-Palatinat. En 1960, il adhère à la Deutsche Friedensunion (l'Union allemande pour la paix) et, plus tard, à la KPD communiste illégale. Deux tentatives pour échapper à l'étroitesse d'esprit de cette ville provinciale. Après des études secondaires et un diplôme de courtier d'assurances, il décide de devenir écrivain. Dans le cercle qui se réunissait autour de Max Bense et de Ludwig Harig, il fait la connaissance de Gudrun Ensslin (future figure de proue de la Bande à Baader) à la Technische Hochschule de Stuttgart. Accompagné de la sœur de Gudrun, Johanna, il va s'installer à Tübingen pour y prendre en charge la rédaction du journal étudiant Notizen, de concert avec le futur terroriste Jörg Lang.
A l'âge de six ans, Günter Maschke, natif d'Erfurt en Thuringe, s'installe dans la ville épiscopale de Trêves, en Rhénanie-Palatinat. En 1960, il adhère à la Deutsche Friedensunion (l'Union allemande pour la paix) et, plus tard, à la KPD communiste illégale. Deux tentatives pour échapper à l'étroitesse d'esprit de cette ville provinciale. Après des études secondaires et un diplôme de courtier d'assurances, il décide de devenir écrivain. Dans le cercle qui se réunissait autour de Max Bense et de Ludwig Harig, il fait la connaissance de Gudrun Ensslin (future figure de proue de la Bande à Baader) à la Technische Hochschule de Stuttgart. Accompagné de la sœur de Gudrun, Johanna, il va s'installer à Tübingen pour y prendre en charge la rédaction du journal étudiant Notizen, de concert avec le futur terroriste Jörg Lang.
En 1964, Maschke met sur pied un “Groupe d'Action Subversive” à Tübingen, une organisation légendaire qui a préfiguré la fameuse SDS gauchiste, à laquelle ont appartenu Rudi Dutschke et Bernd Rabehl. Un an plus tard, Maschke reçoit son ordre de rejoindre la Bundeswehr: il refuse tant le service armé que le service civil. Il prend la fuite et commence un exil qui l'amènera d'abord à Paris puis à Zurich et finalement à Vienne, où il est collaborateur occasionnel de Volksstimme (d'obédience communiste) et du Wiener Tagebuch. Après une manifestation énergique contre la guerre du Vietnam dans la capitale autrichienne, Maschke est arrêté par la police. Il est déclaré “étranger indésirable” et il risque d'être refoulé en Allemagne où l'attend un mandat d'arrêt pour désertion. Après trois semaines de prison, l'ambassade de Cuba lui propose l'asile politique.
Il restera à Cuba du début de 1968 à la fin de 1969. Dans le pays de Castro, Maschke est devenu national-révolutionnaire. Les raisons de cette conversion sont sans doute multiples: les conditions déplorables dans lesquelles végétaient ses amis ou les formes spéciales du “stalinisme tropical”... Ami du poète Padilla, un adversaire du régime cubain, il est impliqué dans cette affaire, arrêté par la police de Castro et renvoyé en Allemagne. Il y passera d'abord treize mois dans les prisons de Munich et de Landsberg.
C'est là qu'il passera définitivement à “droite”. Mais le camp de la droite a hérité là d'un allié très critique, trop critique aux yeux de bon nombre de conservateurs bon teint. Ses premières avances sont brusquement repoussées. Beaucoup de droitiers et de conservateurs rejettent aveuglément les idées de gauche, un aveuglement que Maschke n'a jamais compris. Avec la gauche radicale, il s'est révolté contre l'américanisme, contre le parlementarisme et a milité en faveur d'une réforme du droit de la propriété. Mais, par ailleurs, il a toujours plaidé, contre une gauche qui ne cesse plus de s'éloigner du marxisme, pour un Etat fort, modérément autoritaire.
Dans sa vie privée aujourd'hui, Maschke traduit et édite les textes de l'Espagnol Juan Donoso Cortés et de Carl Schmitt. Sur le plan scientifique, il travaille dur, il est exigeant et méticuleux, mais quand il reçoit ses amis, il est un hôte jovial et généreux, qui aime les bons plats et les bons vins, qui dissimule son pessimisme notoire derrière des blagues hautes en couleurs, derrière un charme exquis, avec une souveraineté bien consciente d'elle-même.
Werner OLLES.
(article paru dans Junge Freiheit, n°26/97).
00:05 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, gauche, gauchisme, carl schmitt, théorie politique, politologie, sciences politiques, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 02 juin 2010
Aux sources de la crise du Golfe

Article paru dans « Nationalisme et République », 1991.
Aux sources de la crise du Golfe: la volonté britannique d'exercer un contrôle absolu du Proche-Orient
par Robert Steuckers
La crise du Golfe a fait couler beaucoup de sang irakien mais aussi beaucoup d'encre. Très souvent inutilement. Inutilement parce presque personne, exceptés quelques très rares spécialistes, n'a cru bon d'interroger les textes anciens, de recourir aux sources de la pensée géopolitique. La géopolitique, comme on commence à le savoir dans l'espace linguistique francophone, est l'art d'examiner et de prophétiser les événements historiques à la lumière de la géographie. Cette démarche a eu des précurseurs allemands (Ratzel et Haushofer que l'on vient de traduire en France chez Fayard; Dix, Maull, Obst, Oesterheld qui demeurent toujours d'illustres inconnus dans nos milieux diplomatiques et intellectuels), suédois (Kjellen) et britanniques (Mackinder, Lea). Pour ce qui concerne les rapports entre l'Europe et le Proche-Orient, c'est le Suédois Kjellen qui, en 1916, en pleine guerre, a émis les théories les plus fines, qui gardent toute leur pertinence aujourd'hui et qui, malheureusement, ne sont plus guère lues et méditées dans nos chancelleries. S'appuyant sur les thèses de Dix, Kjellen, dans son petit ouvrage concis de 1916 (Die politischen Probleme des Weltkrieges; = les problèmes politiques de la guerre mondiale), rappelle que l'Angleterre poursuivait au début du siècle deux objectifs majeurs, visant à souder ses possessions éparpillées en Afrique et en Asie. Albion souhaitait d'abord dominer sans discontinuité l'espace sis entre Le Caire et Le Cap. Pour cela, elle avait éliminé avec la rigueur que l'on sait les deux petites républiques boers libres et massacrés les mahdistes soudanais. L'un de ses buts de guerre, en 1914, était de s'emparer du Tanganyka allemand (la future Tanzanie) par les forces belges du Congo interposées: ce qui fut fait. Le Général belge Tombeur expulse les vaillantes troupes d'askaris allemands de von Lettow-Vorbeck l'Invaincu vers le Mozambique, mais l'Angleterre acquiert le Tanganyka en 1918, laissant à la Belgique le Ruanda et la Burundi, deux bandes territoriales de l'ouest de la colonie allemande. A cette politique impérialiste africaine, l'Angleterre voulait ajouter une domination sans discontinuité territoriale du Caire à Calcutta, ce qui impliquait de prendre sous sa tutelle les provinces arabes de l'Empire ottoman (Palestine, Jordanie, Irak, Bassorah) et de mettre la Perse à genoux, afin qu'elle lui cède le Kouzistan arabe et le Baloutchistan, voisin du Pakistan. Pour parfaire ce projet grandiose, l'Angleterre devait contrôler seule tous les moyens de communication: elle s'était ainsi opposée à la réalisation d'un chemin de fer Berlin-Bagdad, financé non seulement par l'Allemagne de Guillaume II mais aussi par la France et la Suisse; elle s'était opposée aussi —et les Français l'oublient trop souvent depuis 1918— à la présence française en Egypte et au contrôle français des actions du Canal de Suez. En 1875, l'Angleterre achète massivement des actions, éliminant les actionnaires français; en 1882, ses troupes débarquent en Egypte. L'Egypte était aussi vitale pour l'Angleterre d'il y a 80 ans qu'elle l'est aujourd'hui pour Bush. Lors du Traité de paix avec la Turquie, l'Angleterre confine la France en Syrie et au Liban, l'expulsant de Mossoul, zone pétrolifère, qui pourtant lui avait été attribuée.
L'histoire du chemin de fer Berlin-Bagdad est très instructive. En 1896, les ingénieurs allemands et turcs avaient déjà atteint Konya en Anatolie. L'étape suivante: le Golfe Persique. Ce projet de souder un espace économique étranger à la City londonienne et s'étendant de la Mer du Nord au Golfe contrariait le projet anglais de tracer une ligne de chemin de fer du Caire au Golfe, avant de la poursuivre, à travers la Perse, vers Calcutta. Albion met tout en œuvre pour torpiller cette première coopération euro-turco-arabe non colonialiste, où le respect de l'indépendance de tous est en vigueur. L'Angleterre veut que la ligne de chemin de fer germano-franco-helvético-turque s'arrête à Bassorah, ce qui lui ôte toute valeur puisqu'elle est ainsi privée d'ouverture sur le trafic transocéanique. La zone entre Bassorah et la côte, autrement dit le futur Koweit, acquiert ainsi son importance stratégique pour les Britanniques seuls et non pour les peuples de la région. Dès 1880 les Anglais avaient déjà joué les vassaux côtiers, accessoirement pirates et hostiles aux autochtones bédouins, contre la Turquie. Puisque le terminus du chemin de fer ne pouvait aboutir à Koweit, que les Anglais avait détaché de l'Empire Ottoman, les Turcs proposent de le faire aboutir à Kor Abdallah: les Anglais prétendent que cette zone appartient au Koweit (comme par hasard!). Deuxième proposition turque: faire aboutir la ligne à Mohammera en Perse: les Anglais font pression sur la Perse. Les prolégomènes à l'entêtement de Bush...! Le 21 mars 1911, Allemands et Turcs proposent l'internationalisation de la zone sise entre Bassorah et Koweit, avec une participation de 40% pour la Turquie, de 20% pour la France, 20% pour l'Allemagne, 20% pour l'Angleterre. Proposition on ne peut plus équitable. L'Angleterre la refuse, voulant rester absolument seule entre Bassorah et la côte.
Ce blocage irrationnel —malgré sa puissance, l'Angleterre était incapable de réaliser le projet de dominer tout l'espace entre Le Caire et Le Cap— a conduit à la fraternité d'armes germano-turque pendant la Grande Guerre. A la dispersion territoriale tous azimuts de l'Empire britannique, Allemands, Austro-Hongrois, Bulgares et Turcs proposent un axe diagonal Elbe-Euphrate, Anvers-Koweit, reliant les ports atlantiques de la Mer du Nord, bloqués par la Home Fleet pendant les hostilités, à l'Insulinde (Indonésie) néerlandaise. Cet espace devait être organisé selon des critères nouveaux, englobant et dépassant ceux de l'Etat national fermé, né sous la double impulsion de 1789 et de la pensée de Fichte. Ces critères nouveaux respectaient les identités culturelles mais fédéraient leurs énergies auparavant éparses pour bâtir des systèmes politiques nouveaux, répondant aux logiques expansives du temps.
Les buts de guerre de l'Angleterre ont donc été de fragmenter à l'extrême le tracé de cette diagonale partant des rives de la Mer du Nord pour aboutir au Golfe Persique voire à l'Insulinde néerlandaise. L'alliance entre la France et l'Angleterre s'explique parce que la France n'avait pas de politique pouvant porter ombrage à Londres dans l'Océan Indien. L'alliance, plus étonnante, entre la Russie tsariste et l'Angleterre vient du fait que la Russie avait, elle, intérêt à couper la diagonale Elbe-Euphrate à hauteur du Bosphore et des Dardannelles. C'est ce qui explique la tentative désespérée de Churchill de lancer des troupes contre Gallipoli, avant que les Russes ne s'y présentent. Avec les Russes à Constantinople, la diagonale germano-turque était certes brisée, mais la Russie aurait été présente en Serbie et en Grèce, puis en Crète et à Chypre, ce qui aurait menacé la ligne de communication transméditerranéenne, partant de Gibraltar pour aboutir à Suez en passant par Malte. La révolution bolchévique est venue à temps pour éliminer la Russie de la course. L'entrée en guerre de la Roumanie et la balkanisation de l'Europe centrale et orientale procèdent de la même logique: fragmenter la diagonale.
Revenons à l'actualité. La disparition du rideau de fer et l'ouverture prochaine de la navigation fluviale entre Rotterdam et la Mer Noire par le creusement d'un canal entre le Main et le Danube reconstitue le tracé de la diagonale de 1914, du moins jusqu'à Andrinople (Edirne en turc). Les volontés de balkanisation de l'Europe, imposées à Versailles et à Yalta sont réduites à néant. L'intervention des Etats-Unis au Koweit, nous l'avons déjà dit, avait pour objectif premier de restaurer le statu quo et de remettre en selle la famille Al-Sabah qui investit toutes les plus-values de son pétrole dans les circuits bancaires anglais et américains, évitant de la sorte l'effondrement total des économies anglo-saxonnes, basées sur le gaspillage, le vagabondage financier et secouées par l'aventurisme thatchéro-reaganien. Mais les Etats-Unis, héritiers de la politique thalassocratique anglaise, ont en même temps des objectifs à plus long terme. Des objectifs qui obéissent à la même logique de fragmentation de la diagonale Mer du Nord/Golfe Persique.
Les stratèges de Washington se sont dit: «si l'Europe est reconstituée dans son axe central Rhin-Main-Danube, elle aura très bientôt la possibilité de reprendre pied en Turquie, où la présence américaine s'avèrera de moins en moins nécessaire vu la déliquescence du bloc soviétique et les troubles qui secouent le Caucase; si l'Europe reprend pied en Turquie, elle reprendra pied en Mésopotamie. Elle organisera l'Irak laïque et bénéficiera de son pétrole. Si l'Irak s'empare du Koweit et le garde, c'est l'Europe qui finira par en tirer profit. La diagonale sera reconstituée non plus seulement de Rotterdam à Edirne mais d'Edirne à Koweit-City. La Turquie, avec l'appui européen, redeviendra avec l'Irak, pôle arabe, la gardienne du bon ordre au Proche-Orient. Les Etats-Unis, en phase de récession, seront exclus de cette synergie, qui débordera rapidement en URSS, surtout en Ukraine, pays capable de revenir, avec un petit coup de pouce, un grenier à blé européen auto-suffisant (adieu les achats de blé aux USA!), puis aux Indes, en Indonésie (un marché de 120 millions d'âmes!), en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un grand mouvement d'unification eurasien verrait le jour, faisant du même coup déchoir les Etats-Unis au rang d'une puissance subalterne qui ne ferait plus que décliner. Les Etats-Unis ne seraient plus un pôle d'attraction pour les cerveaux du monde et on risquerait bien de voir s'effectuer une migration en sens inverse: les Asiatiques d'Amérique retourneraient au Japon ou en Chine; les Euro-Américains s'en iraient faire carrière en Allemagne ou en Italie du Nord ou en Suède. Comment éviter cela? En reprenant à notre compte la vieille stratégie britannique de fragmentation de la diagonale!».
En effet, les troubles en Yougoslavie ne surviennent-ils pas au bon moment? Rupture de la diagonale à hauteur de Belgrade sur le Danube. Le maître-atout des Etats-Unis dans ce jeu est la Turquie. Le verrou turc bloque tout aujourd'hui. N'oublions pas que c'est dans le cadre de l'OTAN que le Général Evren renverse la démocratie au début de la décennie 80 et que ce putsch permet, après une solide épuration du personnel politique turc, de hisser Özal au pouvoir. Un pouvoir qui n'est démocratique qu'en son vernis. Özal proclame qu'il est «européen» et qu'il veut adhérer à la CEE, malgré les impossibilités pratiques d'une telle adhésion. Les porte-paroles d'Özal en Europe de l'Ouest, notamment en RFA, affirment que la Turquie moderne renonce à tout projet «ottoman», c'est-à-dire à tout projet de réorganisation de l'espace proche-oriental, de concert avec les autres peuples de la région. Pire: Özal coupe les cours du Tigre et de l'Euphrate par un jeu de barrages gigantesques, destinés, dit-on à Ankara, à verdir les plateaux anatoliens. Mais le résultat immédiat de ces constructions ubuesques est de couper l'eau aux Syriens et aux Irakiens et d'assécher la Mésopotamie, rendant la restauration de la diagonale Elbe-Euphrate inutile ou, au moins, extrêmement problématique.
L'Europe n'a donc pas intérêt à ce que la guerre civile yougoslave s'étende; elle n'a pas intérêt à ce qu'Özal reste au pouvoir. Les alliés turcs de l'Europe sont ceux qui veulent, avec elle, reconstituer l'axe Berlin-Constantinople-Bagdad et ceux qui refusent l'assèchement et la ruine de la Mésopotamie (déjà les Anglais avaient négligé de reconstituer les canaux d'irrigation). Ensuite, l'Europe doit dialoguer avec un régime européophile à Bagdad et soutenir le développement de l'agriculture irakienne. Ensuite, l'Europe a intérêt à ce que la paix se rétablisse entre la Syrie et l'Irak. Après l'effondrement de l'armée de Saddam Hussein et le déclenchement d'une guerre civile en Irak, elle doit mobiliser tous ses efforts pour éviter la balkanisation de l'espace irakien et l'assèchement de la Mésopotamie. Celui qui tient la Mésopotamie tient à moyen ou long terme l'Océan Indien et en chasse les Américains: un principe géostratégique à méditer. Si l'Europe avait soutenu l'Irak, elle aurait eu une fenêtre sur l'Océan Indien. En resserrant ses liens avec l'Afrique du Sud et avec l'Inde non alignée, elle aurait pu contrôler cet «océan du milieu» et souder l'Eurasie en un bloc cohérant, libéré des mirages du libéralisme délétère.
Souder l'Eurasie passe 1) par la reconstitution de la diagonale Mer du Nord/Golfe Persique; 2) par la création d'un transsibérien gros porteur, à écartement large et à grande vitesse, reliant Vladivostock à Hambourg via un système de ferries à travers la Baltique, entre Kiel et Klaipeda en Lituanie (autre point chaud; un hasard?); 3) par une liaison ferroviaire de même type reliant Novosibirsk à Téhéran et Téhéran à Bagdad; 4) par une exploitation japonaise des voies maritimes Tokyo/Singapour, Singapour/Bombay, Bombay/Koweit, cette dernière en coopération avec l'Europe; 5) par une liaison maritime Koweit/Le Cap, exploitée par un consortium euro-turco-irakien. Le rôle de la France dans ce projet: 1) protéger la façade maritime atlantique de l'Europe, en revalorisant sa marine; 2) participer, à hauteur des Comores et de la Réunion, à l'exploitation de la ligne maritime Koweit/Le Cap; 3) jouer de tous les atouts dont elle dispose en Afrique francophone.
Un tel projet permet à chaque peuple de la masse continentale eurasiatique de jouer dans ce scénario futuriste un rôle bien déterminé et valorisant, tout en conservant son indépendance culturelle et économique. C'est parce que ce projet était tou d'un coup réalisable que les forces cosmopolites au service de l'Amérique ont mis tout en œuvre pour le torpiller. Peine perdue. Ce qui est inscrit dans la géographie demeure. Et finira par se réaliser. Il suffit de prendre conscience de quelques idées simples. Qui se résument en un mot: diagonale. Diagonale Rotterdam/Koweit. Diagonale Hambourg/Vladivostock. Diagonale Novosibirsk/Téhéran.
Robert STEUCKERS.
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, histoire, golfe, moyen orient, proche orient, politique internationale, iran, irak, golfe persique, guerre du golfe, koweit, impérialisme, impérialisme britannique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



 Chi ha provocato la II guerra mondiale?
Chi ha provocato la II guerra mondiale?