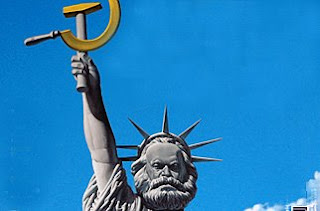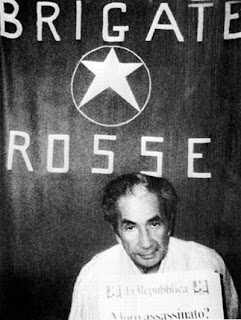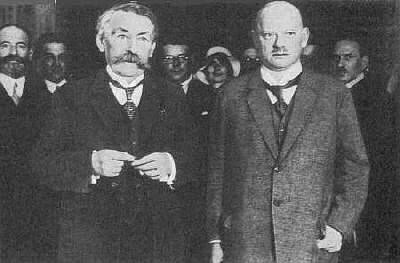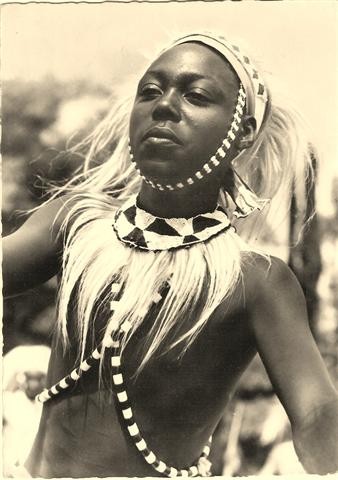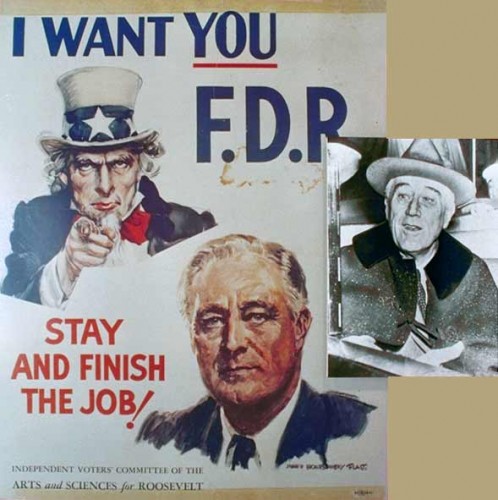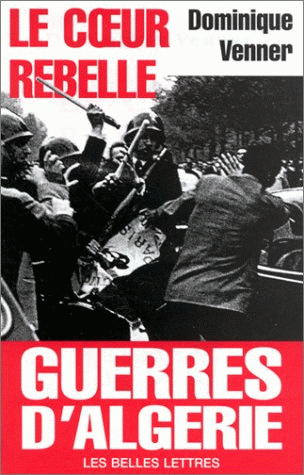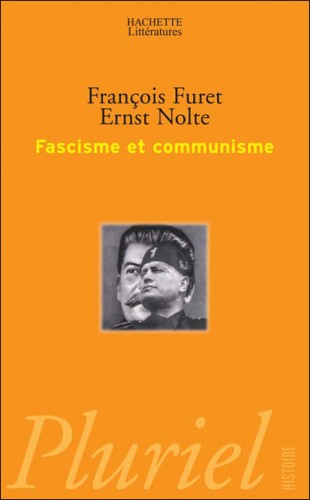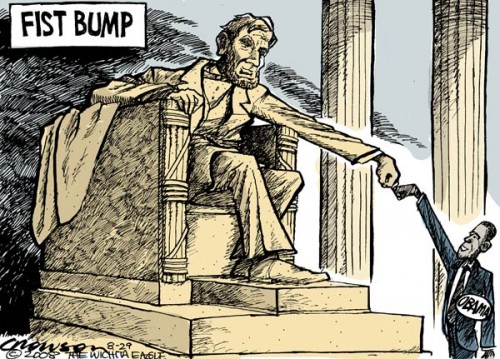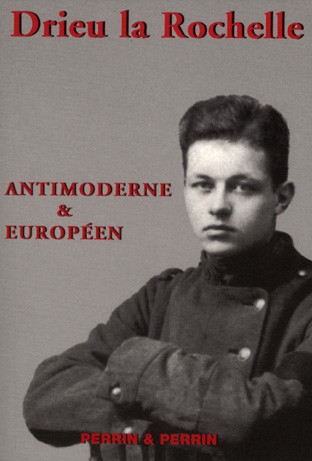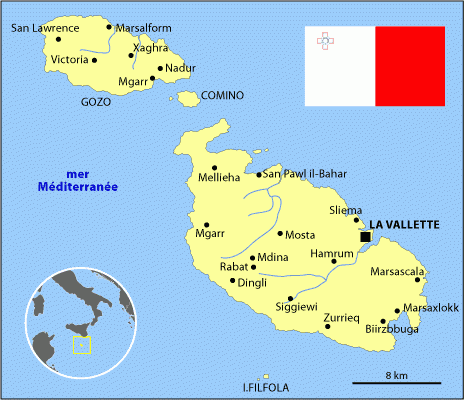
Tratto da Rinascita
Di Achille Ragazzoni
Dopo il periodo cavalleresco ed il turbine dell’epoca napoleonica, che aveva visto Malta prima sotto la sovranità francese e poi occupata dalle armi britanniche, si arrivò al Congresso di Vienna, una sorta di grande mercato dove i popoli e le nazioni venivano venduti all’incanto per soddisfare le brame di imperialisti non meno pericolosi (anzi, ancor più pericolosi!) di Napoleone. Per sollevare i popoli contro la Francia imperiale si era fatto leva proprio sul sentimento nazionale, promettendo quella libertà nazionale nata come idea proprio nella Francia del 1789 ma che proprio dalla Francia veniva, generalmente, calpestata. Una volta sconfitto Napoleone, però, ci si dimenticò delle promesse fatte (ricordate il verso mazziniano: “O stranieri!/ Sui vostri stendardi/ sta l’obbrobrio di un giuro tradito” e si volle tornare sic et simpliciter all’Antico Regime, se possibile ancora peggiorato. Pensare che in una situazione come quella, dove ogni diritto nazionale veniva calpestato, qualcuno si preoccupasse delle aspirazioni nazionali maltesi, è addirittura ridicolo. Il Congresso di Vienna, quindi, confermò la sovranità britannica su Malta che diveniva, a tutti gli effetti, una colonia.
Gli unici che tentarono di opporsi a questo stato di cose, è giusto ricordarlo, furono i Borboni di Napoli, che non vollero mai giuridicamente riconoscere la definitiva perdita dei loro antichi diritti sull’arcipelago maltese. Anche i Cavalieri di Malta, le cui lamentele in sede congressuale non vennero neppure ascoltate, provarono vanamente ad opporsi. Per evitare che a Malta, Paese profondamente cattolico, questioni religiose potessero degenerare in questioni nazionali, il governo britannico ottenne dal papa Gregorio XVI che la Diocesi di Malta non dipendesse più da quella di Palermo e che la Corte di Napoli (ove regnava pur sempre un sovrano italiano, ancorché del tutto indifferente alla questione dell’unità nazionale) non potesse più vantare diritti sulle questioni ecclesiastiche maltesi. Malta, terra culturalmente italiana, divenne meta d’esilio per parecchi patrioti italiani perseguitati, dal governo borbonico ma non solo. Tra gli esuli per il fallimento dei moti del 1821 ricordiamo il poeta e dantista Gabriele Rossetti, il generale Michele Carascosa e Raffaele Poerio, che dalle autorità britanniche subì persecuzioni non molto diverse da quelle subite dalle autorità borboniche… Un’altra ondata di profughi politici italiani raggiunse Malta dopo il fallimento dei moti del 1831. Tra essi i coniugi Tommaso e Ifigenia Zauli Sajani, che daranno lustro alle lettere e al giornalismo maltesi, ed i membri della famiglia Fabrizi, che molta rilevanza avranno nel movimento mazziniano.
A Malta la libertà di stampa venne concessa nel 1839 (nella penisola praticamente non esisteva ancora…) e di essa approfittarono i patrioti colà esuli per provocare, con la diffusione clandestina di libri e giornali negli stati preunitari, positivi contraccolpi in senso patriottico. Il giurista Luigi Zappetta con due suoi giornaletti (”L’Unione” e “Giù la tirannide”) mise non poco a soqquadro gli ambienti politici napoletani, sostenendo la causa di Carlo di Borbone, principe di Capua e fratello del re, anch’egli in esilio a Malta per i suoi sentimenti liberali. Il principe Carlo, nel 1847, tenterà uno sbarco in Sicilia alla testa di 200 uomini armati. Gli ideali nazionali italiani iniziarono a diffondersi anche tra la borghesia maltese e molti maltesi aderirono alla Giovine Italia (tra essi i quattro fratelli Sceberras, che per il loro impegno patriottico possono essere definiti “i Cairoli di Malta”) e al movimento mazziniano in generale. Sul giornale “Il Mediterraneo” il già ricordato Tommaso Sauli Zajani rivendicava l’italianità di Malta, e tale rivendicazione gli procurerà non poche noie.
Nel 1847 giunse sull’isola come governatore l’irlandese Richard More O’Ferral, che nel biennio 1848-49 espulse da Malta alcuni tra i patrioti italiani più accesi, essendosi reso conto che l’incendio nazionalista che divampava in Italia avrebbe facilmente potuto estendersi all’arcipelago. Intanto alcuni patrioti maltesi, il dr. Giancarlo Grech-Delicata, Enrico Naudi ed il dr. Filippo Pullicino costituirono un’associazione per inviare mensilmente contributi in denaro a Venezia assediata dagli austriaci; uno dei motivi per cui i maltesi avrebbero dovuto sostenere la lotta della coraggiosa città era il richiamo alle “comuni leggi, usi, costumanze, religione e lingua”. Un gesto particolarmente odioso del famigerato O’Ferral fu, nel luglio del 1849, il rifiuto di far sbarcare gli esuli della Repubblica Romana, guidati da quel Nicola Fabrizi che era già stato esule nell’isola. Le proteste furono molte, sia a Malta, che a Torino che a Londra, ma O’Ferral ascoltò chi, come l’allora vescovo, indicava i danni incalcolabili che quei patrioti avrebbero portato “in questo piccolo paese di cui parlano la lingua”.
Costretto a giustificarsi di fronte ai propri superiori O’Ferral affermò esplicitamente che l’intimo contatto dei patrioti italiani con la popolazione maltese, facilitato anche dall’identità di lingua e di costumi, avrebbe potuto far nascere in seno a quest’ultima aspirazioni di libertà e di indipendenza nei confronti dell’Inghilterra, quando non addirittura una precisa volontà di entrare a far parte integrante della nazione italiana. Ed in effetti, poco tempo prima, era sorta l’”Associazione Patriottica Maltese”, guidata da Gian Carlo Grech-Delicata, che con due organi di stampa, “L’Avvenire”, in italiano, e “Il Malti”, in maltese, mostrava coincidenza di vedute e di concezione del mondo con i patrioti risorgimentali italiani.
L’associazione si sciolse da solo per evitare, probabilmente, di essere posta fuori legge dal governatore O’Ferral. Nella primavera del 1850 giunsero a Malta i reduci della “Legione Italiana” che, comandata dal colonnello Alessandro Monti, bresciano, aveva combattuto a fianco dei patrioti ungheresi contro i russi e gli austriaci. In rotta per Cagliari, da Gallipoli in Turchia ove erano partiti (si noti che dal governo ottomano essi erano stati trattati assai umanamente, tanto che qualche legionario, forse per riconoscenza, si era avvicinato all’Islam), O’Ferral impedì lo sbarco degli uomini e poi, dopo vibrate proteste del console sardo, acconsentì che sbarcassero solo gli ufficiali. Il colonnello Monti rispose che né lui né sua moglie, per inciso un’inglese, sarebbero sbarcati. Giunti a Cagliari Monti inviò alla stampa una relazione che provocò un incidente diplomatico tra Torino e Londra ma che ebbe, perlomeno, una conseguenza positiva, ossia le dimissioni del governatore di Malta per non meglio precisati motivi di salute.
I patrioti italiani rifugiati a Malta venivano sovente aiutati dal fratelli Sceberras, referenti locali della mazziniana “Giovine Italia”. Troppi sarebbero i patrioti esuli a Malta da ricordare: tra i più importanti Nicola Fabrizi, che a Malta visse molti anni e Francesco Crispi, che giunse sull’isola nel 1853 e che pubblicò anche scritti di storia maltese. Dopo la liberazione delle Due Sicilie, invece, si rifugiarono a Malta diversi nostalgici del regime borbonico e scoppiarono non poche zuffe tra nostalgici e fautori del nuovo ordine.
Grande successo ebbe la visita di Garibaldi a Malta, che sbarcò il 23 marzo 1864 assieme ai suoi figli Menotti e Ricciotti ed al segretario Giuseppe Guerzoni, suo futuro biografo. Ancora claudicante per la ferita di Aspromonte, il Nizzardo prese alloggio all’Hotel “Imperial” e qui ricevette un sacco di entusiasti ammiratori, che gli venivano via via presentati da Nicola Fabrizi ed Emilio Sceberras. Malta aveva dato, nel 1860, due valorosi volontari, arruolatisi dopo Marsala, alle schiere garibaldine: Giorgio Balbi e Giuseppe Camenzuli.
Due giovani ed entusiasti patrioti maltesi, i ventiquattrenni Ramiro Barbaro e Zaccaria Roncalli, scrissero un indirizzo di saluto al Duce delle Camicie Rosse, indirizzo che venne firmato da oltre trecento personalità maltesi e che gli venne consegnato dalla baronessa Angelica Testaferrata Abela. L’indirizzo era così concepito: “Signor Generale, i Maltesi, onorati dalla visita del primo uomo del secolo, esprimono a lui i loro sentimenti d’ossequio e d’amore, augurando a Giuseppe Garibaldi, l’eroe italiano, la felice riuscita di ogni sua impresa, che è sempre rivolta al bene dell’umanità e del progresso”. La risposta di Garibaldi, consegnata alla stessa baronessa, suonava: “Mando una parola d’addio e di riconoscenza alla brava popolazione maltese, e l’accerto che giammai nella mia vita oblierò la fraterna accoglienza di cui volle onorarmi”.
Uno degli autori materiali del messaggio fu, come si è detto, Ramiro Barbaro, marchese di San Giorgio che nel 1861, appena ventunenne, aveva pubblicato l’opuscolo “Napoli, i Borboni e il Governo Italiano”, che era un inno all’Italia una ed indivisibile. Poco dopo fonderà il giornale “Il Progressista”, fortemente nazionalista e nel 1870 il “Don Basilio”, dai toni ancora più accesi.
Eletto consigliere di governo, si diede molto da fare per migliorare le condizioni morali e materiali dei maltesi. Odiato dagli anglofili, nel 1877 venne arrestato sotto l’accusa di aver offeso il prestigio del governatore e fu costretto all’esilio in Italia. Qui scrisse il romanzo storico “Un martire”, ambientato nella Malta del Cinquecento, pubblicato in italiano a Città di Castello nel 1878 e presto tradotto in maltese. Tornò nell’isola natale solo nel 1912 e passò a miglior vita, quasi completamente cieco, nel 1920. Chi raccolse, in un certo senso, il testimone da Ramiro Barbaro fu Fortunato Mizzi (1844 - 1905), ardente italofilo. Nel 1883 fondò il giornale “Malta”, divenuto presto quotidiano e poi soppresso dalle autorità britanniche. Con una schiera di validissimi collaboratori, tra cui vale la pena ricordare Benoit Xuereb, i fratelli Paolo ed Ernesto Manara (fondatori del battagliero giornale “Il Diritto di Malta”), Antonio Cini, Filippo Sceberras, Salvatore Castaldi, Arturo Mercieca, Salvatore Cachia Zammit, a Fortunato Mizzi riuscì il miracolo che prima di lui non era riuscito a nessuno dei più ardenti patrioti: quello di far prendere coscienza della propria italianità anche al popolo minuto. Proprio in quel periodo iniziò un’aperta lotta contro la lingua italiana a Malta, ma Fortunato Mizzi difese molto bene la lingua di Dante, appoggiato dal popolo maltese. Nel 1887, in seguito alla campagna promossa da Fortunato Mizzi, Londra costrinse alle dimissioni il direttore della Pubblica Istruzione, fiero italofobo, e concesse una costituzione molto più liberale e democratica di quella in vigore dal 1849, dove la lingua italiana veniva esplicitamente tutelata.
Poco tempo dopo però, calmatesi le acque, la costituzione venne emendata in senso antidemocratico e la lotta alla lingua italiana riprese, tanto che il 15 marzo 1899 un’ordinanza introduceva l’inglese come lingua giudiziaria nei tribunali per i sudditi britannici non naturalizzati maltesi, mentre un dispaccio ministeriale emesso nella stessa giornata manifestava l’intenzione di arrivare, entro quindici anni, al bando della lingua italiana in tutte le pratiche legali e giudiziarie. La reazione dei maltesi fu vigorosa e per la prima volta si chiese aiuto all’opinione pubblica italiana. Significativo un episodio accaduto nel 1901 a Noto, in Sicilia, dove per la festa del patrono si erano recati circa 700 maltesi il cui capogruppo pronunciò in pubblico parole che non potrebbero essere più chiare: “Siamo italiani e italiani vogliamo rimanere a costo di perdere tutto, anche la vita. Il diritto e la ragione ci assistono. Dio ci aiuta. Siamo italiani. Ce lo dice la religione che professiamo e soprattutto ce lo dice la lingua che parliamo e che vorrebbero togliere dalle nostre labbra”.
A Malta Fortunato Mizzi ed Arturo Mercieca fondavano nello stesso anno il circolo nazionalista “La Giovine Malta”, autentica fiaccola di italianità. Il Mercieca durante il discorso inaugurale disse che i maltesi mai si sarebbero adattati “… a vedere esulare dai loro lidi il linguaggio più bello e musicale che voce umana abbia mai pronunciato”, quel linguaggio per cui i maltesi avevano tutti i diritti di considerare come propria “l’arte divina di Dante e del Manzoni”.
Nel marzo del 1902 Giovanni Pascoli, docente all’Università di Messina, dedicò l’ode latina “Ad sodales Melitenses” ad un gruppo di studenti maltesi in visita in Sicilia e l’intervento del grande poeta servì a rendere più popolare la causa maltese in Italia. Anche il ministro degli esteri Emilio Visconti Venosta e Sidney Sonnino fecero garbate pressioni sul governo britannico, così come, va riconosciuto, fece il proprio dovere in pro di Malta anche il corrispondente del “Times” a Roma, Wickam Steed. Alla fine il governo britannico, ufficialmente per deferenza nei confronti dell’Italia con cui voleva intrattenere buoni rapporti, ritirò il famigerato proclama sulla lingua. Il 18 maggio muore Fortunato Mizzi e la sua scomparsa non è priva di conseguenze per il movimento nazionalista: mentre i patrioti più intransigenti si stringono intorno a monsignor Ignazio Panzavecchia, altre correnti perdono tempo a polemizzare tra di loro o a propugnare forme di collaborazionismo.
Nel gennaio del 1912 ad opera di alcuni giuristi si costituisce un battagliero Comitato Pro Lingua Italiana. Ad esso aderiscono di cuore anche gli studenti nazionalisti che, riuniti in assemblea, così deliberano: “Gli studenti dell’Università si associano al movimento iniziato dalla Camera degli Avvocati a favore della lingua italiana, di cui l’esistenza nelle leggi e nei tribunali sembra nuovamente minacciata, convinti che per ragioni etniche, storiche, economiche e sociali, essa debba continuare a regnarvi sovrana, e che la sua soppressione costituirà da parte della nazione britannica una ingiustificata violazione delle sue promesse, una improvocata violenza, soverchiatrice del diritto, e per il popolo maltese un’offesa al suo nazionalismo secolare, una grave iattura ai suoi più vitali interessi”. La preoccupazione non era del tutto ingiustificata, in quanto nel 1912 una commissione reale propose la sostituzione dell’italiano con il maltese nei procedimenti orali delle corti inferiori e con l’inglese in certi tipi di cause. La parte nazionalista promosse allora, il 2 luglio 1912, una poderosa manifestazione al Teatro Manoel. Parlò il vecchio Ramiro Barbaro che dichiarò, tra il resto: “… ci mettono innanzi il dialetto maltese, molto simpatico del resto, per farne sgabello a un’altra lingua… la quale lingua si vuole sovrapporre alla lingua italiana, alla più bella fra quante si parlano in Europa… Nella nostra lealtà resisteremo affinché ci resti la cara favella. In questa vecchia anima di poeta e di patriota trovo ancora la forza, in sostegno della bellissima lingua, da me insegnata lunghi anni all’estero, di cui fo anche oggi uso, in servizio de’ miei concittadini. E a chi domanda di rinunziarvi, rispondo con un’espressione, una parola, un solo monosillabo, forte, come indignazione di popolo: no, no, no”. La manifestazione approvò una mozione in cui la proposta britannica veniva definita “inopportuna, dannosa e offensiva”.
Altra splendida figura del nazionalismo maltese fu Enrico Mizzi, figlio di Fortunato. Studiò legge in Italia e aderì sin dai primi tempi all’Associazione Nazionalista Italiana, divenendo assiduo collaboratore de “L’Idea Nazionale”. Nel 1911, al Teatro Argentina di Roma, tenne un’applaudita conferenza sull’italianità di Malta. Tornato in patria divenne molto popolare e la sua attività pubblicistica e politica si distinse per una intransigente difesa dell’italianità. Il 27 marzo 1917, nel Consiglio di Governo ove era deputato, tenne un fiero discorso sottolineando che la Gran Bretagna, scesa in guerra per difendere il diritto delle nazionalità oppresse, ben si guardava dall’applicare i principi per i quali combatteva alle nazionalità che facevano parte del suo vasto Impero. I deputati godevano dell’immunità parlamentare, soprattutto per le affermazioni contenute nei discorsi ufficiali, ma evidentemente per Enrico Mizzi la prerogativa non valeva, in quanto il 7 maggio successivo venne arrestato e tenuto in isolamento per quattro mesi! Al processo di fronte alla corte marziale venne accusato di avere con dichiarazioni a voce (il discorso parlamentare) e scritte (interpolazioni nella versione scritta del discorso che però furono riconosciute false dallo stesso pubblico ministero), tentato di far venire meno l’affetto dei maltesi nei confronti di Sua Maestà Britannica, nonché di essere in possesso di documenti che, se pubblicati (in realtà articoli di giornali già abbondantemente pubblicati su giornali italiani…) avrebbero potuto nuocere alle amichevoli relazioni tra Gran Bretagna ed Italia. Mizzi dichiarò: “Io sono d’opinione che la migliore soluzione del problema maltese sarebbe l’annessione di Malta all’Italia. Ma fino a quando alla provvidenza piacerà di tenerci sotto la bandiera inglese, il nostro dovere è di mantenerci leali alla Corona britannica. Come pensatore e come studioso della questione ritengo che il nostro destino naturale è di far parte della grande famiglia nazionale, alla quale apparteniamo geograficamente e storicamente; ma, ripeto, sino a tanto che ci troviamo sotto il Governo britannico, penso che tutti debbono esser leali al Governo britannico ed osservarne le leggi”. Enrico Mizzi venne condannato ad un anno di reclusione ed alla perdita dei diritti civili e politici.
Terminata la guerra, ai maltesi sorse l’idea di costituire un’Assemblea Nazionale che potesse effettivamente rappresentare le aspirazioni del popolo maltese. Il vecchissimo mazziniano Filippo Sceberras si dichiarò disposto a prendere l’iniziativa per la sua costituzione e l’Assemblea Nazionale sorse proprio nei locali della “Giovine Malta” (il nuovo nazionalismo si legava direttamente al Risorgimento…); la prima deliberazioni fu di chiedere a Londra una forma di governo che rispettasse i caratteri nazionali maltesi, “salvo ogni altro maggiore diritto che sarà eventualmente riconosciuto a queste Isole dalla Conferenza della Pace”. Evidentemente si sperava che dalla pace sorgessero o l’indipendenza di Malta o la sua annessione all’Italia, ma le cose andarono diversamente…




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg La guerre de Sécession, qui fit 620 000 morts, fut le conflit le plus sanglant de toute l’histoire des Etats-Unis : les pertes furent supérieures d’un tiers à celles de l’Amérique durant la Seconde Guerre Mondiale, pour une population pourtant sept fois moins nombreuse (31 millions d’habitants à la veille des hostilités).
La guerre de Sécession, qui fit 620 000 morts, fut le conflit le plus sanglant de toute l’histoire des Etats-Unis : les pertes furent supérieures d’un tiers à celles de l’Amérique durant la Seconde Guerre Mondiale, pour une population pourtant sept fois moins nombreuse (31 millions d’habitants à la veille des hostilités). (Synergies européennes - Bruxelles - mai 2006) - L’objectif des manoeuvres américaines dans le “rimland” entre la Russie et les mers chaudes (Méditerrannée, Océan Indien, Golfe Persique) vise non seulement à empêcher la constitution et la consolidation de tout axe Moscou-Téhéran, voire Beijing-Téhéran, mais aussi à encercler l’Iran, pièce centrale du marché commun que les Etats-Unis veulent faire émerger et appellent “Grand Moyen Orient”, une vaste zone dont ils entendent faire un débouché pour leur propre industrie, complétant ainsi les atouts que leur offre le contrôle économique du continent sud-américain, transformé de facto en un “Ergänzungsraum” (“espace de complément”) depuis l’émergence de l’idéologie panaméricaniste, mais espace aujourd’hui rebelle qui s’auto-organise via des structures unificatrices et continentalistes telles le Mercosur ou la “Communauté andine des nations”, ou via des suggestions indépendantistes, baptisées “bolivaristes” et formulées par le président vénézuélien Hugo Chavez. Ces structures modernes, incarnant un esprit de résistance latino-américain, entraînent une réorientation, encore timide mais certaine, du commerce et de l’économie sud-américains vers l’Europe ou vers l’Asie, diversifiant ainsi les rapports de dépendances; ce qui permet à l’Amérique ibérique de déserrer l’étau du “panaméricanisme” imposé par les Etats-Unis à leur seul profit.
(Synergies européennes - Bruxelles - mai 2006) - L’objectif des manoeuvres américaines dans le “rimland” entre la Russie et les mers chaudes (Méditerrannée, Océan Indien, Golfe Persique) vise non seulement à empêcher la constitution et la consolidation de tout axe Moscou-Téhéran, voire Beijing-Téhéran, mais aussi à encercler l’Iran, pièce centrale du marché commun que les Etats-Unis veulent faire émerger et appellent “Grand Moyen Orient”, une vaste zone dont ils entendent faire un débouché pour leur propre industrie, complétant ainsi les atouts que leur offre le contrôle économique du continent sud-américain, transformé de facto en un “Ergänzungsraum” (“espace de complément”) depuis l’émergence de l’idéologie panaméricaniste, mais espace aujourd’hui rebelle qui s’auto-organise via des structures unificatrices et continentalistes telles le Mercosur ou la “Communauté andine des nations”, ou via des suggestions indépendantistes, baptisées “bolivaristes” et formulées par le président vénézuélien Hugo Chavez. Ces structures modernes, incarnant un esprit de résistance latino-américain, entraînent une réorientation, encore timide mais certaine, du commerce et de l’économie sud-américains vers l’Europe ou vers l’Asie, diversifiant ainsi les rapports de dépendances; ce qui permet à l’Amérique ibérique de déserrer l’étau du “panaméricanisme” imposé par les Etats-Unis à leur seul profit.