lundi, 03 novembre 2025
Il faut relire les oeuvres d'Arnold J. Toynbee
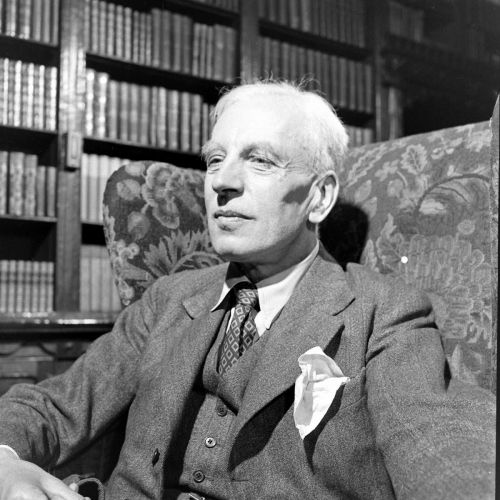
Il faut relire les oeuvres d'Arnold J. Toynbee
Rodolfo S. Souza
Source: https://www.facebook.com/rodolfo.souza.7
Arnold J. Toynbee, qui est aujourd'hui malheureusement tombé dans l'oubli, fut l'un des plus grands historiens du 20ème siècle. Son ouvrage « A Study of History » (publié en 12 volumes entre 1934 et 1961) est l'un des plus grands traités théoriques d'histoire comparée, au même titre que des ouvrages tels que « Le Déclin de l'Occident » d'Oswald Spengler. « A Study of History » attire l'attention tant par son immense érudition que par l'ambition épistémologique et spirituelle de sa vision: formuler une métathéorie de l'histoire humaine qui ne se réduit à aucune science particulière, ni à une simple succession de faits — une histoire qui est à la fois philosophie, théologie et diagnostic civilisationnel.
Pour Toynbee, l'histoire ne doit pas être racontée à partir des États, des empires ou des individus, mais à partir des civilisations: de grandes totalités culturelles, spirituelles et sociales. Il a identifié environ 21 civilisations, des Sumériens et des Hellènes à l'Occident moderne, et a cherché à comprendre comment elles apparaissent, s'épanouissent et déclinent. Son originalité réside dans le fait qu'il ne considérait pas les civilisations comme des entités déterminées par la race ou la géographie, mais comme des organismes spirituels, façonnés par des réponses créatives aux défis de l'existence. Chaque civilisation naît d'un défi environnemental, social ou spirituel (famine, invasions, désordre moral, perte de sens) et ne survit que si une élite créative (une minorité inspirée) répond de manière adéquate à ce défi, en générant de nouvelles institutions, de nouvelles valeurs et de nouveaux modes de vie.

Lorsque cette élite perd son dynamisme, elle devient une minorité dominante (au lieu d'être créative), et la civilisation entre alors en déclin, remplacée par la passivité et la révolte des masses. Contrairement au biologisme d'Oswald Spengler, Toynbee rejette le déterminisme. Aucune civilisation n'est condamnée à mourir: sa mort survient lorsqu'elle perd le contact avec son élan spirituel originel, c'est-à-dire lorsque ses institutions cessent de servir la vocation créative et religieuse qui les a fondées. Le déclin est donc moral et spirituel, et pas seulement matériel ou politique.
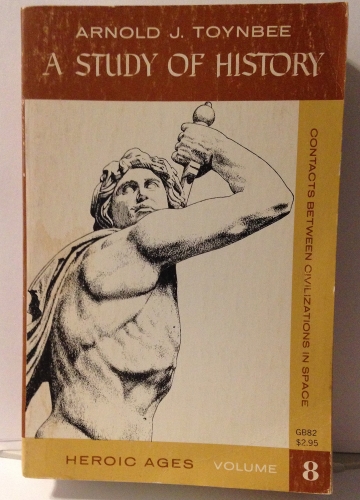
Toynbee réintroduit également l'élément religieux dans la philosophie de l'histoire, à une époque dominée par le matérialisme historique et la sociologie sécularisée. Il croyait que le sens de l'histoire réside dans un rapprochement progressif avec le divin, et que les religions universelles (en particulier le christianisme, le bouddhisme et l'hindouisme dans leurs dimensions mystiques) représentent des tentatives de transcender le cycle d'ascension et de chute des civilisations.
Dans ses derniers volumes, Toynbee en vient à parler d'une histoire dont le point culminant n'est pas politique, mais spirituel: la quête humaine de l'union avec l'Absolu. Ce tournant mystique situe sa pensée en dehors du positivisme, du libéralisme et du marxisme.
14:55 Publié dans Histoire, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arnold j. toynbee, histoire, philosophie de l'histoire, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La fuite annuelle des cerveaux hors de France

La fuite annuelle des cerveaux hors de France
Peter W. Logghe
Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94
Ils ont terminé leurs études d'ingénieur à Polytechnique, ont peiné dans les écoles de commerce de l'EDHEC et ont enfin obtenu leur diplôme. Et pourtant, ils prennent l'avion pour partir vers des régions et des pays où ils n'ont pas fait leurs études. Chaque année, environ 15.000 jeunes quittent la France, comme l'indique le baromètre Ipsos 2025 pour cette année.
La fuite des cerveaux hors de France se poursuit et s'accentue. Les jeunes, qui, avec leurs diplômes d'ingénieurs, sont censés représenter l'élite intellectuelle de la nation, partent. Chaque année, « environ 10% de nos jeunes diplômés des écoles d'ingénieurs et 15% des diplômés français des écoles de management quittent la France ». Et si les pourcentages de la fuite des cerveaux peuvent être considérés comme « assez normaux » par Ipsos, l'institut de sondage, il n'en reste pas moins que l'évolution est alarmante.
La France est un pays en déclin, alors pourquoi y rester ?
Selon Ipsos, ce qui est alarmant dans ce pourcentage, c'est qu'il augmente chaque année. En 10 ans, 25% de diplômés français supplémentaires ont émigré à l'étranger. « Cela représente un risque structurel pour le renouveau et la compétitivité de la France », selon Ipsos. Une évolution alarmante, surtout quand on sait « que le pourcentage de diplômés qui quittent la France augmente avec le niveau d'études ». En d'autres termes, la France perd ses cerveaux.
Pourquoi tant de jeunes partent-ils ? Selon Ipsos, la réponse est claire: « Il existe en France des freins structurels à l'attractivité des talents. La fiscalité est perçue comme un lourd fardeau par la moitié des jeunes Français interrogés. Les salaires sont clairement insuffisants (pour 44%) et le marché du travail est trop rigide (pour 32% des jeunes Français) ».
Mais ce n'est pas tout. Si les jeunes intellectuels français quittent le pays, c'est aussi parce que « 70% des talents estiment que la France est un pays en déclin. 74% s'inquiètent de la situation économique et 81% de la situation politique ». 73% des jeunes Français interrogés attendent une action du gouvernement, mais avec un cinquième, voire peut-être déjà un sixième Premier ministre, ces jeunes intellectuels, qui constituent l'épine dorsale de la nation, ne sont malheureusement pas servis à leur guise !
Et la situation chez nous, en Flandre/aux Pays-Bas, est-elle vraiment meilleure ?
13:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emploi, fuite des cerveaux, france, actualité, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le magnétiseur magnetisé: l'art de Luc-Olivier d'Algange

Le magnétiseur magnetisé: l'art de Luc-Olivier d'Algange
par Frédéric Andreu
« Je ne puis me défendre de l’idée que le livre que nous écrivons est déjà écrit dans quelque « registre de lumière ». En écrivant, nous sommes des Servants. Une trame secrète se révèle peu à peu ». — Luc-Olivier d’Algange, Entretien avec André Murcie.
Porteur de la lampe poétique, Luc-Olivier d’Algange connaît l’art d’éclairer les blasons d’attente de nos âmes. On lit un texte de lui en se surprenant, parfois, à voir le monde par ses yeux. Et lorsque l’ouvrage se referme et que sa trace narrative s’estompe dans les brumes de l’oubli, il demeure en nous comme un bruissement de feuilles : trace d’une forêt enchantée qu’il a su éveiller en nous.
Les fieffés rêveurs que nous sommes savent que nos images oniriques dérivent parfois jusqu’aux rivages les plus secrets de Mnémosyne, mère des Muses. Peu savent, en revanche, que ces rivages, infrarouges et ultraviolets du monde suprasensible, sont aussi ceux où scintillent les récits de nos légendes. Car le monde légendaire prolonge la lumière naturelle : il fait rayonner, au-delà du visible, ces couleurs interdites au regard, mais familières à l’âme.

Laissant entrer ces fréquences suprasensibles, la prose dalgangienne évoque, par certains côtés, les vitraux d’église traversés par la clarté du sacré. J’ajouterais quelques rares estampes, celles d’Aude de Kerros, dont le magnétisme sourd des mêmes rêveries cheminantes : https://audedekerros.fr
Textes ajourés, estampes magnétiques ou vitraux d’église nous met en contact cette vie dans la vie qui nous attend avant la mort, celle qui pleut en rosée mystique sur les pétales de nos âmes — et non celle qui nous serait promise après la mort.
En contrepoint à l’approche héraldique de Luc-Olivier se tient l’approche étymologique de Philippe Barthelet. J’ai longtemps cherché à comprendre pourquoi deux factures aussi différentes semblaient participer d’une même tradition. Tout récemment, une réponse à cette question s’est imposée à moi: quand Luc-Olivier « remonte » la tradition vers les pistils, bourgeons et fleurs du langage — où butinent tant d’abeilles poétiques ! —, l’auteur du Voyage d’Allemagne descend, lui, vers le sol de cette langue où racines et bulbes des mots forment leurs rhizomes. D’où ces étymons qui émaillent presque chacune de ses phrases.
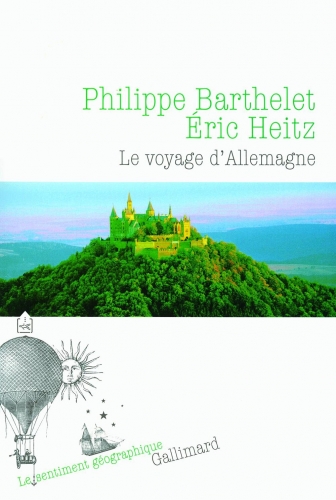
Ces deux explorations, aussi riches de découvertes soient-elles, ne sont pas sans risque : la première peut perdre le Petit Poucet lecteur non averti dans les Holzwege des brumes ésotériques ; la seconde risque de prendre les mots pour les choses. Cependant, mises bout à bout, ces deux œuvres forment un axe lumineux et vertical, absolument nécessaire en ces temps d’avachissement généralisé et de nivellement par le bas.
En elles-mêmes, les œuvres font et sont signes — car tout ce qui est n’est-il pas signe d’autre chose. Elles nous intiment dans l’idée que l’existence n’est que sous l’horizon de notre propre transfiguration, que du point de vue d’elle et d’elle seule. Au coeur de cette attente, les œuvres sont témoins, rappels, voire appels. À la fois balises et boussoles magnétiques, elles ont vocation à nous faire entendre - dans ce monde-ci - les échos de l’autre monde qui veille dans les marges du visible. On peut dire avec Ernst Jünger que l’art agit comme puissance d’orientation. Observons-le dans nos vies intimes : parfois, la montre de l’art se met à sonner quand nous sommes égarés dans les doublures factices de ce monde.Dans ces moments de tourmente, tout se passe comme si quelque chose de nous, en nous, mystérieux et nostalgique, se mettait soudain à résonner avec l’art. Cette résonance rend alors possible d’autres raisonnements plus affûtés que ceux issus de notre logique primaire. Plus encore, l’art nous intime dans l’idée que notre vie entière est, un jour ou l’autre, appelée à changer d’octave, à ôter ses vieux habits de l’âme. D’ailleurs, un des contes recueillis par les frères Grimm, Die Sterntaler, ne dit pas autre chose. Ôtant son unique chemise pour la donner à une enfant plus pauvre qu’elle, la jeune fille du conte voit tomber les étoiles du ciel qui se transforment en ducats d’or. Son vieil habit n’est autre ce qui nous voile la « légende éveillée », l’« imagination vraie » pourtant face à nos yeux de toute éternité. Non seulement l’or tombe dans la nouvelle robe miraculeuse de la jeune fille, mais encore les animaux de la forêt se mettent à lui parler, et elle à les comprendre ! Les fleurs deviennent des sceptres, les êtres apparaissent revêtus de leur manteau de sacre...
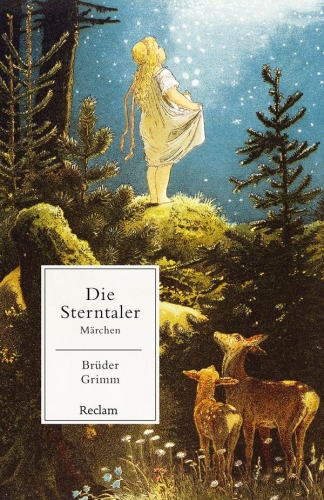
Cet écho « transfigurique » — dont le conte de fée conserve l’octave — est sans doute le plus haut et souverain qui dans une vie d’homme, il nous soit donné d’entendre. Mais il contient aussi sa part de risque : l’oubli de lui-même. Une fois sa conscience altérée, il est fatalement remplacé qui, par une théologie créationniste, puis un moralisme fossilisé et enfin une croyance athéiste. Autant de vérités chrétiennes dont Chesterton nous enseigne qu’elles seraient « devenues folles ». Bref, autant de château en ruine, de parodies du plan initial... On peut dire que lorsque le son initial disparaît, il est remplacé par un bruit, lui-même par un autre, et ainsi de suite, jusqu’au règne assourdissant du monde-machine.
« Le monde devient un monde-machine, toutes les souverainetés sont corrodées, arasées » écrit si justement Luc-Olivier. La catena aurea où scintillent tant d’oeuvres et de poèmes, agit alors comme un rappel du son primordial, un tocsin ; un antidote et un acte de résistance. S’il déplore, certes, ce paysage de chantier que devient notre monde, cet imaginaire en ruine que la technologie laisse derrière elle, Luc-Oliver d’Algange n’ignore pas non plus que la providence est inscrutable. C’est à travers les murs fissurés des ruines qu’il guette l’aurore. L’oeuvre de Luc-Olivier n’est ni progressiste, ni réactionnaire ; c’est à ce signe que l’on peut dire qu’elle est l’un des maillons de la catena aurea, chaîne d’or de la tradition.
« L’ennemi, c’est la planification du monde : l’homme-machine, le monde sans imprévu, sans feu », écrit Dominique de Roux dans Mémoires de l’inassouvissement. Disciple du faucon royal Dominique de Roux, Luc-Olivier n’ignore pas que des mains visqueuses, toujours à louvoyer et à comploter dans l’ombre, agissent aujourd’hui à ciel ouvert. Leur technologie noire, planificatrice et ensorcelante, brouille le message divin, le détourne de sa finalité libératrice. Ce dispositif vise un but : empêcher notre éveil individuel et collectif. Les grands planificateurs visent en effet moins notre mort physique que notre consentement au déclin et à la zombification. Pour ce faire, ils remplacent nos royaumes, nos récits fondateurs, nos arts et nos dieux par autant de doublures parodiques et subliminales. Leur stratégie a une force, mais aussi une faiblesse, elle est reconnaissable entre toutes. Celle-ci consiste toujours à présenter la copie à la place de l’original, avant de l’imposer comme la norme. Le règne contemporain de l’« art conceptuel » est emblématique de ce processus. Heureusement, Aude de Kerros s’est employée à démasquer le dispositif. Mais sans aller jusqu’à s’interroger sur l’essence de cet art. Pourtant, rien de nouveau sous le soleil. Ce dispositif, à l’œuvre dans la laideur contemporaine, n’est-il pas inscrit dans l’essence même de la technique ? Aussi bien actif dans l’asphalte qui recouvre la terre, l’écran de l’ordinateur qui s’érige en fenêtre, le dispositif ainsi à imposer le faux art pour le vrai.
L’art qui contient un secret, un magnétisme, une orientation, doit être remplacé par un autre, bidulaire, qui n’en contient pas. La finalité du dispositif est d’obombrer notre potentiel transfigurique, d’opacifier la conscience collective. Mais, aussi, à mesure que la vie se parodise en palais de miroir technique et administratif, augmente la nostalgie du fil d’Ariane. C’est donc en ces temps de règne sans partage des Titans et des Cyclopes, que poèmes, estampes et vitraux redeviennent autant d’aiguilles magnétiques de notre horloge intérieure.
Oui, Luc-Olivier d’Algange : la Tradition n’est pas derrière nous, mais devant nous.
Et les œuvres d’art en sont les balises secrètes.
Contacts :
dalgangelucolivier@gmail.com
audedekerros@yahoo.fr
phiiippe.barthelet@orange.fr (s’écrit avec trois « i »)
13:12 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 02 novembre 2025
Carlos X. Blanco énonce une critique marxiste de la théorie de l’Empire chez Gustavo Bueno

Carlos X. Blanco énonce une critique marxiste de la théorie de l’Empire chez Gustavo Bueno
Source: https://socialismomultipolaridad.blogspot.com/2025/11/la-...
Carlos X. Blanco distingue, dans une optique critique du matérialisme philosophique de Gustavo Bueno, entre empires absorbants et unificateurs, proposant une vision plus proche du marxisme et de l’idée d’empire comme forme d’émancipation des peuples.

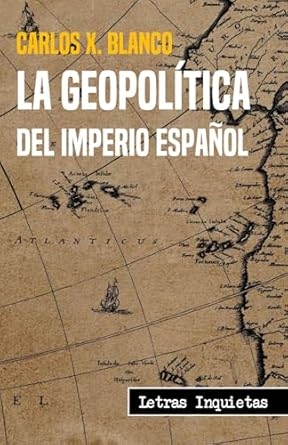
Gustavo Bueno et Carlos X. Blanco
Carlos X. Blanco, bien qu’issu de l’école de Gustavo Bueno, s’en éloigne en réinterprétant le concept d’empire d’un point de vue plus historiciste et marxiste. Dans son ouvrage sur la géopolitique de l’Empire espagnol, Blanco introduit une distinction clé entre empires absorbants et unificateurs, qui s’éloigne de la classification de Bueno qui voyait des empires générateurs et prédateurs, telle que cela fut présenté par ÑTV España.
Différences clés entre Blanco et Bueno
Gustavo Bueno distingue entre :
- Empires générateurs : qui créent des structures politiques et culturelles durables (comme l’Empire romain ou l’Empire espagnol).
- Empires prédateurs : qui extraient uniquement des ressources sans laisser d’institutions solides (comme l’Empire britannique ou belge en Afrique).
Carlos X. Blanco, quant à lui, propose :
- Empires absorbants : qui détruisent les identités des peuples intégrés, en les homogénéisant sous une seule culture dominante.
- Empires unificateurs : qui respectent et articulent les différences culturelles, ethniques et politiques, en les intégrant dans une structure commune sans les annihiler.
Cette distinction ne se limite pas à la sémantique : Blanco l’utilise pour revendiquer le rôle de l’Empire espagnol comme empire unificateur, ayant permis la survie de multiples peuples, langues et cultures sous une unité politique commune. En ce sens, il s’oppose à la Légende Noire comme à la Légende Rose, proposant une troisième voie qui reconnaît la complexité du processus impérial hispanique.
Approche marxiste et émancipatrice
Blanco donne une tournure marxiste au concept d’empire, s’éloignant de l’impérialisme comme domination économique et politique, pour s’approcher de l’idée d’empire comme structure de libération face au chaos, à la fragmentation ou à la domination des puissances étrangères. Dans ce cadre:
- L’empire peut constituer une forme de résistance culturelle face à la mondialisation néolibérale.
- L’Hispanité se présente comme une alternative civilisatrice à l’anglosphère, avec des racines dans une tradition communautaire, catholique et populaire.
- L’empire unificateur devient un outil d’émancipation des peuples, et non leur soumission.
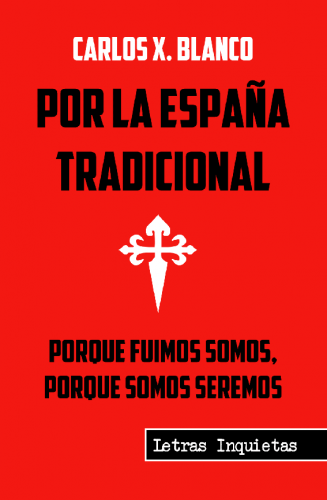
Implications géopolitiques
Blanco voit dans la restauration de l’héritage impérial espagnol une voie pour reconstruire une identité commune entre les peuples hispaniques, tant en Espagne qu’en Amérique. Cette vision comporte des implications politiques et culturelles profondes:
- Rejet du nationalisme fragmenteur et de l’européisme technocratique.
- Défense d’une unité hispanique basée sur la tradition partagée et la souveraineté populaire.
- Critique du modèle libéral et de l’hégémonie culturelle anglo-saxonne.
En résumé, Carlos X. Blanco redéfinit le concept d’empire d’une perspective marxiste et traditionaliste, proposant une alternative à la pensée dominante, aussi bien à gauche qu’à droite. Cette vision est reliée à d’autres penseurs hispaniques comme Bolívar, Mariátegui, ainsi qu’à des marxistes internationaux tels que Lénine, Gramsci, La Grassa et Preve.
20:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : empire, notion d'empire, carlos x. blanco, gustavo bueno, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Beaucoup d'argent des contribuables allemands pour l'extrême gauche

Beaucoup d'argent des contribuables allemands pour l'extrême gauche
Peter W. Logghe
Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94
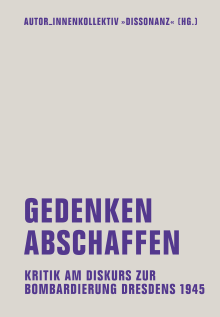 Le ministre allemand de la Culture, Wolfram Weimer (CDU), a critiqué la remise d'un prix à une maison d'édition d'extrême gauche. Selon son porte-parole, aucun « signe suspect » de « glorification de la violence » n'a été découvert chez l'éditeur concerné, a-t-il déclaré au portail d'information Nius. Pour la cinquième fois, cette maison d'édition, baptisée « Verbrecher Verlag » (littéralement « maison d'édition criminelle »), a reçu une prime de 18.000 euros. En 2013, la maison d'édition a publié le livre « Gedenken abschaffen » (Supprimer la mémoire), dans lequel tout souvenir des bombardements de Dresde est rejeté et rendu suspect. Le collectif d'auteurs « Rechercheteam Dresden » avait déjà publié une liste des « lieux de rencontre de l'extrême droite » dans la ville de Dresde. Peu après cette publication, le bureau d'une association qualifiée d'extrême droite a été gravement endommagé.
Le ministre allemand de la Culture, Wolfram Weimer (CDU), a critiqué la remise d'un prix à une maison d'édition d'extrême gauche. Selon son porte-parole, aucun « signe suspect » de « glorification de la violence » n'a été découvert chez l'éditeur concerné, a-t-il déclaré au portail d'information Nius. Pour la cinquième fois, cette maison d'édition, baptisée « Verbrecher Verlag » (littéralement « maison d'édition criminelle »), a reçu une prime de 18.000 euros. En 2013, la maison d'édition a publié le livre « Gedenken abschaffen » (Supprimer la mémoire), dans lequel tout souvenir des bombardements de Dresde est rejeté et rendu suspect. Le collectif d'auteurs « Rechercheteam Dresden » avait déjà publié une liste des « lieux de rencontre de l'extrême droite » dans la ville de Dresde. Peu après cette publication, le bureau d'une association qualifiée d'extrême droite a été gravement endommagé.
Une deuxième subvention a attiré encore plus l'attention. Le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la ville de Mari ont décerné le Grimme Online Award au site web « afd-verbot.de » du Zentrum für Politische Schönheit, un groupe d'extrême gauche. Ce site plaide ouvertement en faveur de l'interdiction du parti d'opposition AfD et présente les représentants du parti comme des ennemis criminels de la Constitution. Selon la chancellerie du Land, ce choix a été fait « par une commission indépendante et des experts ». La subvention s'élève à 2,51 millions d'euros, soit 85 % des ressources opérationnelles de l'association.

Pendant ce temps, l'Allemagne est en proie aux flammes. Le lundi 6 octobre, le pavillon de chasse Thiergarten de la princesse Gloria von Thurn und Taxis (près de Ratisbonne) a été entièrement détruit par un incendie, comme vous avez pu le lire sur le site web de l'hebdomadaire anversois 't Pallieterke. Meubles anciens, lustres, porcelaine, collection complète d'objets de chasse : tout a été détruit. Très vite, on a soupçonné qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Peu après l'incendie, un « commando Antifa » a revendiqué la responsabilité de l'incendie via le portail Internet d'extrême gauche Indymedia. Selon ce commando, l'attaque est un avertissement à la maîtresse des lieux, car Gloria von Thurn und Taxis ne cache pas son amitié avec Alice Weidel, présidente de l'AfD. Et cela n'est bien sûr pas acceptable pour la gauche tolérante en Allemagne.
Entre-temps, le danger continue de venir de la droite et les contribuables allemands continuent de débourser des sommes considérables pour financer toutes sortes de clubs d'extrême gauche. À qui cela profite-t-il ? Et surtout, pourquoi un parti centriste comme la CDU laisse-t-il passer tout cela ? Pourquoi n'intervient-il pas, par exemple sur le plan financier ? Considère-t-il ses propres électeurs comme des idiots ?
Ainsi, le centre-droit ou les conservateurs semblent encore pires que la gauche : avec une politique de gauche, on sait à quoi s'attendre, tandis qu'un gouvernement de centre-droit ou conservateur prétend faire les choses « différemment », alors que rien ne change, bien au contraire.
Récemment, quelqu'un m'a dit : « Un gouvernement de droite est un gouvernement qui commet les mêmes bêtises qu'un gouvernement de gauche, mais à un rythme plus lent ». Ne peut-on vraiment pas attendre davantage d'une politique de droite ?
15:37 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Parution du numéro 74 de la revue War Raok

Parution du numéro 74 de la revue War Raok
Editorial
Défendre l’idée de patrie … c’est défendre l’âme de la nation bretonne !
Parmi les idées qui sont particulièrement attaquées, et au premier rang d’entre elles par ceux qui rêvent et encouragent un idéal internationaliste, se trouve au premier chef celle de la patrie.
Aujourd’hui, sachez bien qu’il n’y a guère d’idée plus attaquée, menacée constamment par des idéologies comme le socialisme, cette religion de la fausse fraternité, les libres penseurs qui, dans l’assaut désespéré qu’ils donnent à toutes nos traditions, déclarent l’idée de patrie étroite et surannée, sans oublier bien sûr les chantres du libéralisme et leurs oraisons jaculatoires au néant !
La patrie est attaquée également par certains esprits « forts », ou plutôt prétendument forts tant il est vrai que ces nouveaux esprits imbus d’eux-mêmes ne sont en réalité que des faibles d’esprit qui s’imaginent que « l’universalité » doit nécessairement s’accompagner d’un effacement total des peuples et des nations et d’un renoncement à ce que celle-ci, historiquement, charrie de grandeur, de dévouement et de sens de l’honneur.
C’est même ce que ces beaux esprits ont appelé bien souvent l’étroitesse. Leur intellectualisme étouffe dans ses limites ! Et n’osant pas toutefois l’attaquer ouvertement, c’est alors qu’ils en cherchent les moyens plus obliques, et les ayant trouvés, c’est ainsi qu’ils deviennent et qu’ils sont vraiment plus dangereux.
L’attaque est d’autant plus redoutable qu’elle est sournoise et que son enjeu est masqué. Dans ce combat, notre combat de nationaliste breton, ce qui se joue n’est rien d’autre que la survie de l’âme bretonne, véritable communication héréditaire de sentiments et d’idées.
Mais les ennemis de l’âme bretonne sont bien nombreux. S’ils n’ont pas nécessairement de nom, ont du moins un visage, ce sont tous ceux qui veulent éradiquer les plus belles et anciennes traditions de Bretagne et du peuple breton. Et parmi celles-ci plus que toutes autres, celles qui, parce qu’elles témoignent de l’âpreté des combats passés et de la force du lien sacral, unissent les unes aux autres les générations. Toucher aux traditions, c’est toucher au patrimoine génétique de la Bretagne, c’est affaiblir ses défenses immunitaires… C’est donc prendre le risque d’affaiblir durablement l’âme de la nation bretonne, c’est prendre le risque d’anéantir la civilisation qu’elle porte et qui s’incarne en elle. On ne saurait toucher les unes sans atteindre mortellement les autres.
Grâce à notre grande histoire nationale, grâce aux épreuves subies en commun, grâce aux exemples et aux leçons de quelques grands hommes de Bretagne… s’il y a une patrie qui soit vraiment un organisme, quelque chose d’harmonieusement complexe, de véritablement vivant, qui ne soit pas une abstraction mais une réalité, … c’est la patrie bretonne ! Notre longue histoire n’est pas seulement, comme beaucoup d’autres et je pense tout particulièrement à celle de notre voisin, véritable agrégat de pièces assemblées au hasard des batailles, une succession de dates, un enchaînement de faits, une alternative de prospérités et de revers... Elle est, encore et surtout, une tradition. Du milieu même de ses vicissitudes, une intention générale se dégage, identique à elle-même depuis des siècles et des siècles et c’est ce qui achève de vivifier cette idée de patrie.
Enfin, je dirais volontiers de l’amour de la patrie ce qu’on peut dire du besoin de croire. Cet amour nous l’apportons avec nous en naissant et ce n’est pas pour la fortifier ou la glorifier que nous avons besoin de longs raisonnements ou de brillants sophismes.
Voilà bien des raisons de croire que, dans un monde moderne et quelque peu perturbé, l’idée de patrie n’est pas près de périr.
Padrig Montauzier, directeur de publication.

SOMMAIRE N° 74
Buhezegezh vreizh, page 2
Editorial , page 3
Buan ha Buan, page 4
Tribune libre
Portrait du Progressiste, page 11
Environnement
La Bretagne défigurée : un autre mémoricide, page 12


Société
La révolte des Penn Sardin et Joséphine Pencalet , page 16
Hent an Dazont
Votre cahier de 4 pages en breton, page 19

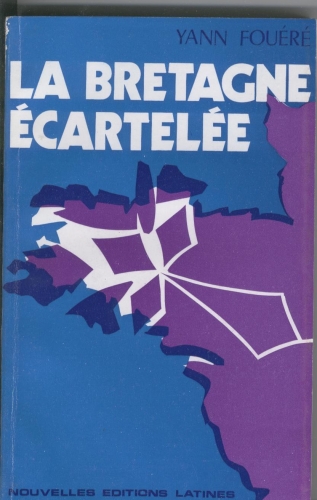
LES CAHIERS DE L’EMSAV
Yann Fouéré, patriote, infatigable combattant… , page 23
Yann Fouéré, une vie au service du peuple breton, page 24
Politique
Pour un renouveau de la nation bretonne, page 32
Histoire de Bretagne
Un jeune lévrier nommé Yoland, page 34

Nature
Le Faucon crécerelle, page 36

Lip-e-bav
Sardines bretonnes au gros-plant, page 37
Keleier ar Vro
Breizh-a-live, un baptême réussi, page 38
Bretagne sacrée
L’abbaye de Beauport, page 39


15:17 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, bretagne, traditions, traditions bretonnes, pays celtiques, celtisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Retour sur une votation inaperçue

Retour sur une votation inaperçue
par Georges Feltin-Tracol
En cette fin de mois d’octobre, la dernière lubie d’Emmanuel Macron serait de soumettre la réforme des retraites décalée, suspendue ou abrogée à un possible référendum. La démarche est étonnante pour un sujet d’une si grande complexité qu’il ferait passer la rédaction des traité de Maastricht de 1992 et constitutionnel européen de 2005 pour d’aimables facéties adolescentes. Un tel scrutin se révélerait aussitôt en plébiscite sur la personne même de l’actuel chef de l’État hexagonal. Oserait-il se suicider politiquement au point de cramer son éventuel retour élyséen en 2032 surtout si l’horrible « extrêêêêêêêêêêêêêêêême droite » arrivait au pouvoir en 2027 ? La proposition présidentielle appartient pour l’instant à une divagation exprimée à haute voix.
La Confédération helvétique a l’habitude de convoquer ses citoyens à l’occasion de référendums – les votations –, souvent d’initiative populaire, c’est-à-dire lancées à partir d’un nombre suffisant de signatures. Les électeurs ont ainsi le droit d’annuler les décisions prises par le pouvoir législatif et mises en application, régime d’assemblée oblige, par le pouvoir exécutif.

Le 28 septembre 2025, deux votations se tenaient à l’échelle nationale. L’une d’elles concernait le sort de la loi sur l’e-ID. Il s’agit de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur l’identité numérique et d’autres moyens de preuves électroniques. Le gouvernement suisse – le Conseil fédéral – entend dématérialiser tous les documents officiels dont la carte d’identité dans une application conçue par les services de l’État suisse sur les fameux téléphones intelligents. Les autorités précisent volontiers que cette démarche demeure facultative. Les non-détenteurs de ces mini-ordinateurs portatifs ne seront pas affectés… pour l’instant.
Le résultat de ce vote est très serré: le oui l’emporte à 50,39 % (49,61 % de non). La participation s’élève à 49,55 %. Si les cantons de Genève, du Tessin et de Vaud ont voté « oui », le Valais, le canton de Neuchâtel et celui du Jura s’y sont opposés nettement. On doit regretter la forte abstention pour un scrutin déterminant. Les Suisses ne perçoivent pas les risques et autres méfaits de l’intrusion de la cybernétique, d’État comme des entreprises, dans leur vie privée. Outre leur faible esprit civique pour la circonstance, les Suisses ne se rendent pas compte du détournement de la procédure. L’approbation du 28 septembre 2025 annule en effet le refus du 7 mars 2021. Ce jour-là, une votation rejetait la loi du 27 septembre 2019 sur les services d’identification électronique à 64,36 % avec une participation de 51,29 %. Commentateurs, politiciens et experts crurent que cette hostilité populaire résultait du climat de méfiance suscité par l’épisode covidien.
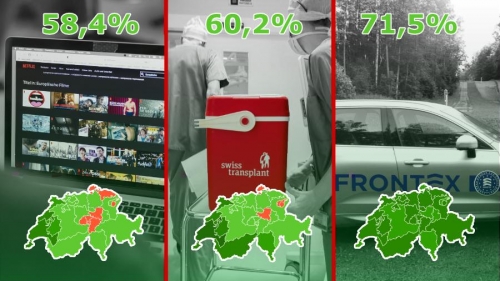
Ce rejet momentané ne signifia nullement l’émergence d’une attitude réfractaire ou contestataire. Un trimestre plus tard, le 13 juin 2021, les Suisses acceptaient à 60,20 % la loi sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de covid-19. Comment expliquer cette contradiction électorale flagrante ? Un important travail de persuasion sur l’opinion publique suisse a permis l’acceptation au final de ces choix liberticides. Sur la même lancée négative, le 26 septembre 2021, la Suisse approuvait le mariage pour tous à 64,10 % !
Ces quelques exemples infirment la vision, largement défendue naguère par des Gilets jaunes naïfs, du référendum d’initiative citoyenne comme méthode radicale de résolution des problèmes politiques, sociaux et économiques. Les chantres du référendum vu en deus ex machina de la politique méconnaissent toujours le rôle et l’impact du système informationnel – médiatique sur la population. On retrouve ce phénomène dans le verdict des cours d’assises avec des jurés tirés au sort sur les listes électorales. Le manque criant de preuves tangibles (un corps jamais retrouvé) n’empêche pas la condamnation d’un accusé qui n’a jamais avoué et, au contraire, clamé son innocence.

L’emploi du référendum comme moyen de surmonter les pesanteurs institutionnelles enrobées sous le mantra surgi de la novlangue de l’« État de droit » n’est plus d’actualité. Un référendum est-il encore possible en France afin de contenir les autorité judiciaire hypertrophiée ainsi que l’ingérence des agences administratives indépendantes ? Une révision radicale de la Constitution de 1958, défigurée, pervertie et déséquilibrée, par l’article 11 ne serait-elle pas empêchée par un avis du Conseil constitutionnel ? Le gouvernement pourrait-il passer outre, quitte à engager l’épreuve de force et ouvrir les bureaux de vote malgré les menaces du dit-conseil ? À part quelques exceptions, le système médiatique, bras armé du Conseil constitutionnel, dénoncerait une soi-disant manœuvre despotique de la part du pouvoir. Le Conseil constitutionnel annulerait de facto tout résultat au préalable entaché par une abstention assez forte.
Décevons immédiatement les tenants du pouvoir populaire ! Le référendum n’est pas une panacée. Pour que la procédure référendaire soit optimale, il faut appliquer au quotidien une véritable démopédie, une instruction civique et politique permanente des citoyens. Cette exigence impliquerait en contrepartie une indispensable politisation des enjeux et des personnes. Or, avec le développement de nouveaux pouvoirs (militaire – renseignement, système médiatique, pègres, complexes techno-industriels et bio-technologiques) et la consécration de l’hyper-individualisme anomique, la tripartition institutionnelle chère à Montesquieu, s’estompe. La neutralisation du politique demeure l’événement principal de la présente phase historique de transition épochale, un interrègne confus entre une Modernité tardive, un postmodernisme wokiste et une Post-Modernité archéofuturiste.
Loin d’être une île isolée au cœur du continent européen, la Suisse démontre dès à présent par ses comportements électoraux sa pleine intégration aux rouages euro-atlantistes et globalistes du collectif occidental cosmopolite si bien qu’elle en est le vingt-huitième membre officieux de la pseudo-Union européenne. Sa neutralité devient formelle, rhétorique et illusoire. Le peuple suisse ne peut plus aller à l’encontre de cette assimilation silencieuse. Son modèle politique fondé sur le fédéralisme, la subsidiarité et le référendum s’étiole. Un mythe politique disparaît.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 172, mise en ligne le 29 octobre 2025 sur Radio Méridien Zéro.
14:33 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : référendum, actualité, suisse, votation, europe, affaires européennes, europe alpine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Élections législatives argentines: victoire à la Pyrrhus pour Milei?
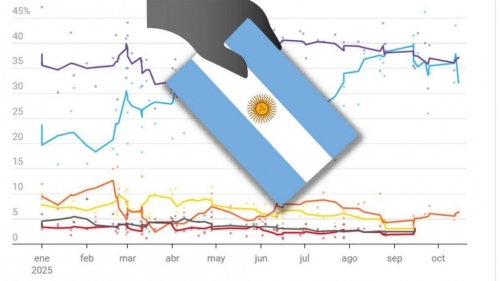
Élections législatives argentines: victoire à la Pyrrhus pour Milei?
Raphael Machado
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069794930562
Beaucoup d'observateurs ont été surpris par les résultats favorables obtenus par Milei lors des élections législatives argentines, qui visaient le renouvellement de la moitié de la Chambre des députés et d’un tiers du Sénat.
La coalition La Libertad Avanza, dirigée par Javier Milei, a obtenu un peu plus de 9,3 millions de voix (40%), tandis que son principal rival, la coalition Fuerza Patria, dirigée par Cristina Kirchner, a recueilli 7,7 millions de voix (34%).
Le résultat est comparé à celui des élections législatives de 2023, où la coalition La Libertad Avanza avait atteint 6,8 millions de voix (28%) et la coalition kirchneriste Unión por la Patria 9,2 millions (38%).
Cette comparaison sert de base pour analyser le paysage politique argentin comme étant un paysage où le peuple continue de faire confiance à Milei et de miser sur "des réformes difficiles". On utilise également ces résultats pour critiquer les analyses qui pointent les erreurs et la perte de popularité de Milei.
Mais il y a beaucoup de superficialité et de précipitation dans un tel raisonnement.
Tout d’abord, il y a une grande différence entre les élections de 2023 et celles de 2025: la consolidation de presque toutes les forces "de droite" dans la coalition La Libertad Avanza. En 2023, Mauricio Macri dirigeait la coalition Juntos por el Cambio, avec 6,4 millions de voix (26%). En 2025, les forces menées par Macri se sont alignées sur La Libertad Avanza, unifiant leurs forces avec celles de Milei.
Il n’existe plus de "troisième force" politique argentine représentée par une droite libérale centriste; la politique argentine se consolide en seulement deux grands camps.
Prendre en compte ce facteur remet en question la narration triomphaliste, car si l’on additionne les voix du camp macriste et celles de Milei, la coalition de ce dernier aurait dû dépasser les 13 millions de voix.
La droite a donc perdu 4 millions de soutiens entre 2023 et 2025. Mais ces soutiens perdus ne sont pas passés au kirchnerisme, car la gauche a aussi perdu des électeurs, mais seulement 1,5 million durant cette même période.
La démographie électorale de base aide à expliquer une partie du phénomène: en 2023, 24,5 millions d’Argentins ont voté valide, contre 22,9 millions en 2025.
Un autre facteur est le renforcement du fédéralisme, avec des gouverneurs provinciaux formant la coalition Provincias Unidas, qui a recueilli 1,5 million de voix. Le reste des voix "perdues" s’est dispersé entre de nombreuses autres micro-coalitions (Innovación Federal, Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Nuevos Aires, etc.).
Dans ce sens, ce que montre le résultat de ces élections, c’est une déception du peuple argentin envers la politique traditionnelle. Le peuple en a assez de Milei, mais ne veut pas voter pour Kirchner. Les Argentins attendent donc une nouvelle alternative politique — mais il n’y a rien à l’horizon. En attendant, la tendance est à une baisse progressive de la participation populaire, ainsi qu’à une augmentation du soutien à des micropartis localistes ou radicaux.
Pour Milei, c’est une victoire à la Pyrrhus.
D’abord, parce qu’elle n’a pas permis d’obtenir la majorité parlementaire, de sorte que le législatif restera fracturé et contre Milei.

Ensuite, parce qu’elle a été une victoire obtenue grâce au pouvoir d’autrui, avec l’aide financière des États-Unis, qui ont fourni 40 milliards de dollars pour maintenir l’Argentine à flot. Sans cet argent, le peso argentin aurait été en chute libre en pleine période électorale.

Cette même aide financière résulte d’un accord entre l’oligarque Robert Citrone (photo) et le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent. Citrone a misé une grande partie de ses fonds sur l’Argentine au début du mandat de Milei, mais lui et d’autres investisseurs n’ont pas vu de résultats satisfaisants.
L’argent qui entre a pour seul but de stabiliser la monnaie argentine juste le temps que Citrone et d’autres investisseurs puissent partir du pays, en limitant leurs pertes.
Après que cet effet d’injection d’argent aura disparu, l’Argentine continuera à s’enfoncer.
Par exemple, selon les données publiées la semaine dernière par la Banque centrale argentine, le taux de défaut des familles argentines a atteint son niveau le plus élevé depuis 2010 (date du début de la série statistique), et les taux d’intérêt sur les prêts personnels ont atteint 74%.
Pour les entreprises, la situation est encore pire. Le coût de financement des avances en compte courant (couramment utilisées pour payer les salaires) est de 190% par an, le plus haut niveau de l’histoire argentine depuis la publication de cette statistique en 2009.
En résumé, Milei n’a obtenu qu’une survie. Et cette survie a été octroyée par des tiers, et non même en raison de Milei, mais pour garantir la sécurité financière des investisseurs étrangers qui ont parié gros sur le succès argentin.
14:14 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : javier milei, argentine, amérique du sud, amérique ibérique, amérique latine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 01 novembre 2025
L'Europe et le financement de l’Ukraine: la logique d’une soumission progressive

L'Europe et le financement de l’Ukraine: la logique d’une soumission progressive
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
Le rapport d’Euractiv (https://www.euractiv.com/news/rapporteur-the-ukraine-funding-option-europe-fears/) sur la « Option de financement de l’Ukraine » décrit en réalité un cas typique de mauvaise analyse géopolitique.
L’Europe tente de compenser une crise stratégique par une symbolique financière – c'est quasiment un idéalisme moral dépourvu de substance stratégique.
1. L’illusion de la mission morale
- L’Europe a interprété le conflit ukrainien en catégories morales – démocratie contre autocratie, bien contre mal.
- Elle se condamne ainsi à la cécité face à la structure de la politique internationale :
- Les puissances n’agissent pas pour paraître morales, mais pour préserver leurs intérêts et leur sécurité.
- En interprétant la guerre comme un "combat entre civilisations" plutôt que comme une collision d’architectures sécuritaires, elle perd la compréhension de la mécanique que constitue l’équilibre des pouvoirs.
2. L’argent remplace la stratégie
- L’« option de financement » n’est pas un signal économique, mais un signal politique.
- Au lieu d’élaborer une véritable architecture de paix pour l’Europe de l’Est, Bruxelles crée des lignes de crédit, des fonds et des constructions juridiques.
- L’UE se comporte comme un joueur cherchant à couvrir sa défaite stratégique par de nouveaux engagements.
- Mais l’argent ne peut remplacer la géographie. La guerre en Ukraine est un conflit d’influence, non de ressources budgétaires.
- Ceux qui veulent gérer une guerre financièrement plutôt que la résoudre politiquement la prolongent.
3. La fiction juridique
- L’affirmation d’une « base légale solide » pour l’utilisation des avoirs russes gelés est un embellissement diplomatique.
- Pour un réaliste, ce n’est qu’un acte de pouvoir déguisé en droit.
- En pratique, le principe de propriété est sacrifié pour démontrer une unité politique.
- Ainsi, l’Europe sape ce qui a, jusqu’ici, soutenu sa puissance – la crédibilité de son ordre juridique.
- À Moscou, Pékin et New Delhi, ce message est clair : « Votre argent n’est en sécurité chez nous que tant que vous nous obéissez. »
4. La chape superstructurelle américaine
- Cette architecture financière n’est pas un projet européen – c’est la poursuite institutionnalisée de la stratégie géopolitique américaine.
- Depuis 2022, l’UE opère dans l’ordre dirigé par les États-Unis, non comme un acteur autonome, mais comme une branche financière de l'endiguement.
- Washington définit l’objectif stratégique (limiter la Russie), l’UE en supporte les coûts économiques.
- Ce n’est pas un partenariat, mais une hiérarchie.
- L’Europe s’est dégradée de sujet de la politique de puissance à l’instrument des intérêts de sécurité étrangers.
5. La peur face à la réalité
- Le titre de l’article – « L’Europe a peur » – est exact, mais pas dans le sens moral.
- L’Europe ne craint pas la Russie, mais la prise de conscience qu’elle ne contrôle plus sa propre politique de sécurité.
- Elle redoute qu’une réorganisation souveraine de l’Eurasie implique de sortir du manteau de protection américain.
- Mais cela serait la condition de toute maturité stratégique.
- Au lieu de cela, l’UE s’accroche à des dépendances transatlantiques qui la fragilisent économiquement et la paralysent politiquement.
Conclusion – Le prix de l’auto-tromperie
- D’un point de vue réaliste, la guerre en Ukraine n’est plus une lutte pour des territoires, mais un conflit systémique portant sur l’ordre d'agencement de la puissance future en Eurasie.
- L’Europe s’est réduite dans ce conflit à un acteur secondaire – qui fait beaucoup de bruit en énonçant des principes moraux mais qui est devenu géopolitiquement sans importance.
- L’« option de financement de l’Ukraine » n’est donc pas un instrument de puissance, mais un symbole de la perte de toute autonomie stratégique.
Selon Mearsheimer :
- Les États qui justifient leur politique extérieure par la morale sont vaincus par ceux qui la calculent rationnellement.
- L’Europe ne paie pas aujourd’hui pour l’Ukraine – mais pour conserver l’illusion de pouvoir être une grande puissance sans en être une.
11:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europa, ukraine, affaires européennes, actualité, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’économie est cyclique et le capitalisme intrinsèquement instable : l’échec de l’école de Chicago et l’effondrement des États-Unis
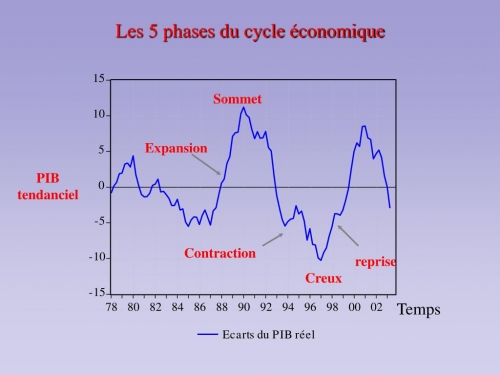
L’économie est cyclique et le capitalisme intrinsèquement instable : l’échec de l’école de Chicago et l’effondrement des États-Unis
de Fabrizio Pezzani
Source: https://www.ariannaeditrice.it/articoli/keynes-aveva-ragi...
Face au chaos mondial, il ne faut pas oublier les visions prophétiques mais réalistes de John Maynard Keynes, que les chercheurs ayant continué à défendre sa conception de la cyclicité naturelle de l’économie ont renforcées par des analyses empiriques des faits. Si nous voulons soutenir une vision anthropologique de la crise, nous ne pouvons pas dissocier la connaissance des outils dont nous disposons de celle des sujets qui utilisent ces outils pour satisfaire leurs besoins.
Lorsque Keynes affirme que le capitalisme est naturellement instable, il relie également cette observation à la dynamique de la nature humaine, qui fait du capitalisme un instrument destiné à réaliser les désirs. En ce sens, on ne peut dire que le capitalisme existe indépendamment de la structure psychique des hommes qui le créent et le gouvernent ; en d’autres termes, il n’existe pas un capitalisme en tant qu’entité abstraite, mais il existe des hommes capitalistes qui façonnent ce modèle de relations économiques au sein d’un système social. Sa dynamique est dans un équilibre instable parce qu’il n’existe pas de systèmes, même sophistiqués, permettant de définir la notion de juste profit.
Si l’on pouvait, en se limitant à la détermination du résultat d’exploitation, définir « rationnellement » et avec certitude quelle part revient au capital investi et quelle part revient aux travailleurs, la plupart des luttes sociales s’en verraient peut-être allégées. Dans la tradition juive, l’institution de l’année sabbatique et dans la tradition chrétienne, l’institution de la période jubilaire avaient pour but d’annuler les positions de dette et de crédit entre les différents membres de la société ; ainsi, on posait une limite temporelle à l’accumulation. Tout cela n’est plus possible aujourd’hui.
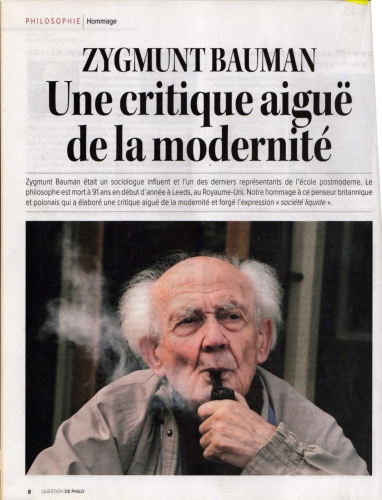
Pour reprendre la définition de « société liquide » que Bauman utilise pour décrire un système social en constante mutation et difficile à stabiliser, on peut étendre ce même concept, aujourd’hui, à l’économie qui, dans le cadre d’une société liquide, ne peut qu’être elle-même liquide. Il est donc naturel que l’économie, et encore plus la finance, deviennent un système perpétuellement instable, car il n’est pas possible de définir la « mesure » dans la répartition du bonheur ou de la richesse, si celle-ci est fonction de la réalisation du bonheur.
Contrairement aux systèmes mécaniques ou naturels pour lesquels la mesurabilité permet de déterminer les lois physiques qui les régissent, en mettant en évidence le risque de points ou de moments de rupture – la chute d’un grave, la portée d’une grue, la combinaison d’agents chimiques, la mesure des paramètres biologiques d’un organisme – dans la société, le système relationnel de personnes différentes, dont la composante émotionnelle et psychique n’est pas mesurable, rend impossible la détermination du point de non-retour d’un processus déséquilibrant la société elle-même.
Il n’est pas possible de dire quel est le pourcentage de personnes sous le seuil de pauvreté qui représente le dernier stade avant l’effondrement, ni de faire de même pour la concentration de richesse, le chômage ou d’autres pathologies sociales. Simplement, la société humaine ne possède pas d’éléments certains et mesurables de son point de rupture, et toutes les révolutions et guerres de l’histoire démontrent l’incapacité à prévoir le krach.
Si Louis XVI avait compris le niveau de misère de la population française, il aurait envoyé des chariots de pain et non des soldats. Il en a été de même pour la Russie des Romanov et les États-Unis contre la couronne anglaise. L’histoire confirme la vision de Keynes et annonce l’échec d’un libéralisme qui, sans règles morales, devient dévastateur car il finit par favoriser la partie la plus barbare de l’homme.
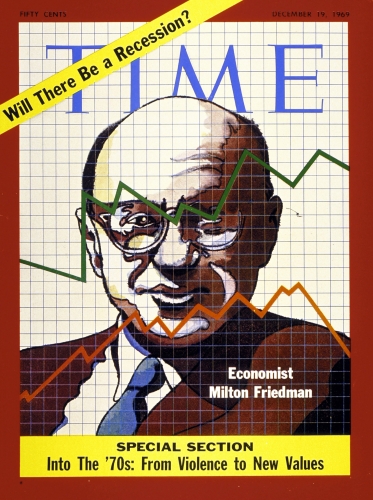
L’école de Chicago, représentée par Milton Friedman – qui a reçu le prix Nobel en 1976, deux ans après celui de Hayek de l’École de Vienne, qui campait sur une position contraire – a fini par s’opposer à la fausseté de ses hypothèses, dans lesquelles la réalité doit s’adapter au modèle, et le cas du Chili de Pinochet est l’expression la plus évidente de la grossière erreur de ne pas considérer l’histoire et la nature humaine dans la vie sociale.
Penser qu’on peut appliquer la même recette à des réalités profondément différentes, comme c’était le cas du Chili, avec ses disparités de richesse et son retard culturel, aurait été impossible dans une réalité comme celle d’Amérique du Nord. L’ignorance n’est jamais le problème que doit affronter l’évolution de la science, mais plutôt l’arrogance de ceux qui se considèrent investis de la vérité indiscutable ; malheureusement, c’est toujours la population pauvre qui en paie le prix.
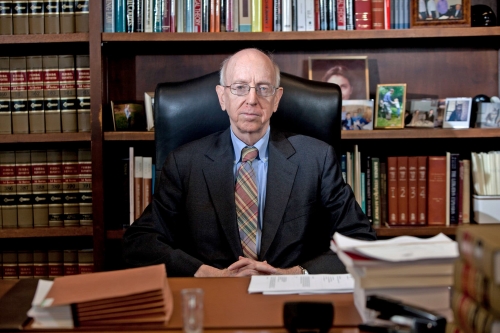
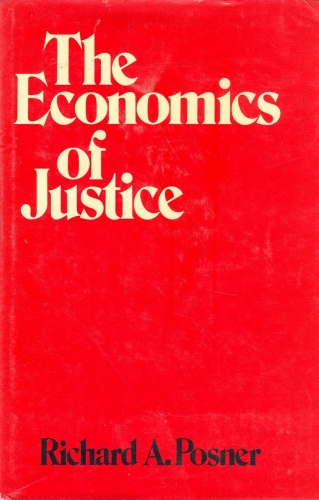

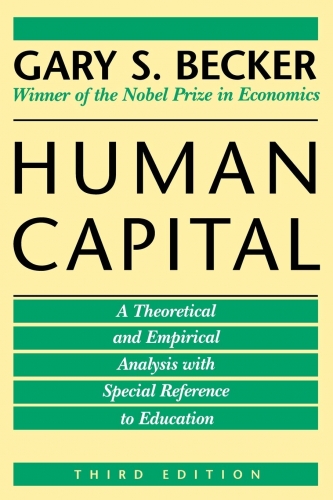
Les travaux de Posner, mais aussi ceux de Gary Becker, montrent à quel point, même dans le monde culturel américain, on comprend le lent effondrement d’un modèle incapable de répondre aux problèmes qu’il a créés et qui, ne voulant pas ou ne pouvant pas se remettre en question, ne fait qu’aggraver et empirer ces problèmes. Leur référence à la pensée de Keynes devient de plus en plus forte et entendue.
Les États-Unis, qui ont indissolublement adopté cette culture en la transformant en vérité absolue, sont la représentation extrême de la vérité trahie : un pays qui a oublié ses principes constitutifs, représentés par les formules E pluribus unum et In God we trust, et qui fait face à un effondrement socio-culturel sans précédent dans son histoire. Avoir confié l’avenir à la finance a été un suicide, car en fin de compte, cette fausse vérité des marchés rationnels a fini par dépouiller la société de l’intérieur, et aujourd’hui, c’est un géant aux pieds d’argile. Aujourd’hui, les États-Unis, comme on peut le voir, sont un pays qui, sur le plan social, est avant toute chose, techniquement en faillite.
08:48 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, économie cyclique, états-unis, monétarisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 31 octobre 2025
De Grokipedia à la chute de l'Occident - L'IA remplace l’homme alors que l’Occident approche de sa fin

De Grokipedia à la chute de l'Occident
L'IA remplace l’homme alors que l’Occident approche de sa fin
Alexander Douguine
Alexander Douguine avertit que l'humanité fait face à un effondrement imminent alors que l’IA, la guerre génétique et la chute du Sacré marquent la dernière descente de l’Occident.
La fin de l'humanité pourrait être plus proche que nous ne le pensons.
Le 27 octobre, d’un simple clic, Elon Musk a remplacé l'encyclopédie en ligne Wikipedia libérale-globaliste (qui a mis 25 ans à se construire) par la Grokipedia neutre, tandis que Jeff Bezos a remplacé 300.000 employés d’Amazon par l’intelligence artificielle. De plus, Musk a préparé une armée de robots, dont l’apparition sur les champs de bataille est attendue pour le printemps prochain. Les cyborgs et les animaux modifiés artificiellement sont déjà en développement. Demain, ce seront les humains eux-mêmes qui seront modifiés.
Guerre et paix évoluent à une vitesse fulgurante.
La recherche génétique a fait de la société une cible facile pour un génocide massif — possiblement avec une composante ethnique. Des armes ethniques ont été créées et pourraient être utilisées à tout moment.
Le contrôle mental a atteint des sommets sans précédent, et la virtualité remplace la réalité.

Je crois que la convergence de ces menaces pourrait conduire à un effondrement total — non pas sur plusieurs décennies, mais dans les années à venir.
Selon les prévisions statistiques, un effondrement est beaucoup plus probable que la poursuite des tendances actuelles sous quelque forme que ce soit.
Le libéralisme était la dernière idéologie à préserver le statu quo, mais il s’est avéré totalement nihiliste et destructeur, et il s’est effondré. S’y accrocher est inutile. Il a largement provoqué cette situation lui-même.
Tout a commencé avec la perte du Sacré. L'humanité a annulé Dieu. Au début, au nom de l’homme. La religion a été remplacée par la philosophie et la science. Puis l’homme lui-même est entré dans une crise: la philosophie s’est effacée, et la science est devenue la servante de la technologie. L’homme a commencé à se désintégrer en fragments. Transgenres, transespèces (furries, quadrobers, chimères), transethnies, et enfin, transhumanisme. L’homme est devenu une question de choix.


Il ne faut pas se faire d’illusions: la fin est à portée de main. Pour l’éviter — ou même pour la retarder — nous devons identifier la racine du problème. C’est, en essence, le but de l’Occidentologie. C’est une carte qui permet de saisir la nature de la Modernité occidentale. L’Occident en tant que tel, et surtout la Modernité occidentale, est responsable de tout ce qui arrive à l’humanité.
L’Occident n’est pas seulement un concept géographique mais aussi une limite historique. Hegel a écrit que l’histoire se déplace d’Est en Ouest. Cela signifie du début à la fin. L’Occident est un phénomène eschatologique.
17:06 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les Etats d'Europe centrale se rapprochent - L'axe de coordination d'Orbán et la pression financière de Bruxelles

Les Etats d'Europe centrale se rapprochent
L'axe de coordination d'Orbán et la pression financière de Bruxelles
Elena Fritz
Bron: https://t.me/global_affairs_byelena
Selon les recherches de Politico, la Hongrie travaille avec la République tchèque et la Slovaquie à la création d'un bloc de coordination au sein de l'UE. L'objectif est de coordonner des positions communes avant les sommets européens, en particulier sur les questions relatives à l'aide à l'Ukraine. À Bruxelles, on parle déjà d'une « alliance anti-ukrainienne », mais il s'agit en réalité d'un signe qui annonce une différenciation croissante au sein de l'UE.
Les points clés de l'initiative sont les suivants :
- coordination régulière des chefs de gouvernement avant les réunions du Conseil;
- recherche d'une ligne commune pour l'Europe centrale;
- distanciation par rapport à la politique d'escalade envers Moscou.
Viktor Orbán a exprimé ouvertement ce que de nombreux gouvernements pensent sans le dire :
«L'UE est à court d'énergie et d'argent. Qui va payer pour ce qui reste de l'Ukraine?».
Ce scepticisme intervient dans une période de tensions financières croissantes au sein de l'UE. Politico décrit comment la Commission européenne exerce une pression croissante sur les États membres pour les contraindre à trouver un accord sur le financement de l'Ukraine.
Politico : « L'UE joue les durs: si vous ne voulez pas prendre l'argent de la Russie, ouvrez vos propres portefeuilles».
Selon Politico, la plupart des gouvernements rejettent l'idée d'une dette européenne commune (euro-obligations).
La Commission utilise donc cette question comme levier pour forcer l'accord sur la confiscation des avoirs russes.
- Les gouvernements qui s'opposent à de nouvelles dettes ou à des paiements à Kiev sont soumis à des pressions: « Si vous ne faites pas payer la Russie, vous devrez payer vous-mêmes. »
- Le plan B – les euro-obligations – est considéré comme encore plus toxique politiquement que l'utilisation des fonds russes gelés.
- L'Allemagne et les Pays-Bas, en particulier, rejettent catégoriquement l'idée d'un endettement commun, tandis que les États fortement endettés comme la France et l'Italie peuvent difficilement soutenir de nouvelles charges.
- Néanmoins, Bruxelles mise sur le fait que des pays comme la Belgique, où une grande partie des fonds russes sont stockés, finiront par céder, par crainte de l'alternative que représente l'endettement commun.
Le directeur du Centre for European Policy Studies, Karel Lannoo, est cité dans ce contexte:
«Le manque de discipline budgétaire dans certains pays est tel que les euro-obligations sont impensables pour les dix prochaines années. C'est pourquoi les actifs russes restent la seule issue».
L'UE est donc soumise à une double pression d'ordre temporel:
1. L'Ukraine pourrait se retrouver dans l'incapacité d'agir financièrement d'ici mars 2026.
2. Dans le même temps, il y a le risque d'une contre-alliance en Europe centrale, qui pourrait bloquer de nouveaux plans d'aide; ce risque s'accroît.
Selon Politico, un diplomate européen a commenté ouvertement la tactique de Bruxelles:
« C'est de la diplomatie : on offre aux gens quelque chose qu'ils ne veulent pas afin qu'ils acceptent la proposition la moins désagréable. »
Conclusion :
L'UE se trouve dans une impasse financière et politique. La tentative d'utiliser les actifs russes révèle non seulement des risques juridiques, mais aussi le processus d'érosion de la cohérence européenne.
Dans le même temps, un groupe d'États se forme en Europe centrale, qui mise sur la souveraineté, le réalisme et la raison budgétaire.
Entre Budapest, Prague et Bratislava, ce n'est pas un bloc anti-ukrainien qui se crée, mais un indicateur précoce du retour de la rationalité politique en Europe.
12:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, viktor orban, europe centrale, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’Autre Gramsci

L’Autre Gramsci
par João Martins
Source: https://www.arktosjournal.com/p/the-other-gramsci
João Martins se souvient du frère oublié du célèbre théoricien marxiste italien Antonio Gramsci, Mario Gramsci, un soldat dévoué dont la vie aventureuse incarnait la loyauté, le courage et le destin tragique des guerres civiles en Europe.
Au-delà de toutes tendances idéologiques, nous admirons les hommes et les femmes qui ont consacré leur vie à un idéal. Sans de telles vies, expériences et actes décisifs de volonté ou de courage, toute conception du monde devient totalement dépourvue d’humanité — ces visages, ces sentiments et ces émotions sont si souvent portés à des niveaux d’intensité étonnants qu’ils débouchent sur des drames humains tragiques. Les guerres civiles représentent le point culminant de tels drames, car aucune famille n’échappe au spectacle de ses membres présents de part et d’autre des barricades.
Récemment, lors de mes pérégrinations à travers l’histoire européenne moderne, je suis tombé sur un épisode des plus curieux qui m’a profondément ému — un épisode qui s’est déroulé en Italie durant la première moitié du 20ème siècle, ou, pour être plus précis, durant ce que l’historien allemand Ernst Nolte appelait la "Deuxième Guerre civile européenne".
Je souhaite partager avec vous le destin d’un homme portant un nom bien connu, mais dont la mémoire, en raison de circonstances politiques, a été reléguée dans l’oubli obscur de l’histoire. J’en profite donc pour sauver de l’oubli une vie, une damnatio memoriae, et pour brosser, aussi brièvement et injustement que ce soit, sa biographie extraordinaire.
Antonio Gramsci, le célèbre penseur marxiste et théoricien de l’"Hégémonie culturelle", était en prison sous le régime fasciste, qui lui permit néanmoins de poursuivre son travail idéologique en captivité. Il est décédé il y a 70 ans. Nous pouvons éprouver une certaine sympathie pour cet homme, ou même étudier sa pensée complexe ; pourtant, aucun biographe ne pourrait lui attribuer ce qui rend une vie humaine plus riche et plus belle — l’esprit d’aventure, de renoncement, cette impulsion rebelle de marcher à contre-courant ou simplement d’être la « brebis noire » de la famille. La dernière expression convient ici le mieux, évoquant la chemise noire des escadrons fascistes — la même que portait fièrement le frère d’Antonio, Mario Gramsci, et dans laquelle il savait vivre et mourir.

Né en 1893 dans une famille modeste, le plus jeune de sept enfants, Mario Gramsci ne vécut pas longtemps, mais ses jours furent remplis de sentiments profonds et d'un patriotisme ardent — une vie si intense qu’elle aurait pu sortir tout droit du Manifeste futuriste italien, cette célèbre diatribe de Marinetti contre la timidité et la conformité, qui exaltait «l’amour du danger, l’habitude de l’énergie et de l’audace (…) le courage, l'audace, la rébellion».
Dans l’année fatidique de 1914, la Première Guerre mondiale éclata — un conflit qui clôturerait dans le sang les illusions impérialistes du 19ème siècle. À 22 ans, Mario Gramsci soutint avec enthousiasme l’entrée de l’Italie dans la guerre en 1915 et s’engagea volontairement au front, où il combattit comme lieutenant. Lorsque le conflit prit fin, l’Italie se trouva plongée dans une crise politique et sociale profonde (1). La « victoire mutilée » et la montée de l’agitation communiste le poussèrent à rejoindre les Fasci di Combattimento, la nouvelle organisation fondée par le vétéran socialiste et ex-soldat Benito Mussolini. Il grimpa rapidement au poste de secrétaire fédéral du Fasci de Varese, et même les supplications persistantes d’Antonio Gramsci et de toute la famille (Mario était le seul fasciste parmi eux) ne purent le dissuader — pas même les solides raclées qu’il reçut des camarades communistes de son célèbre frère, qui l’envoyèrent à l’hôpital.
Antonio rompit tout contact avec lui en 1921. Néanmoins, en août 1927, à la demande de leur mère, Mario tenta de se réconcilier avec Antonio — qui était alors emprisonné à San Vittore — pour l’aider dans ses difficultés juridiques.
En 1935, l’Italie déclara la guerre et envahit le Royaume d’Abyssinie. Encore une fois, Mario Gramsci se porta volontaire pour rejoindre le corps expéditionnaire italien qui allait conquérir l’Éthiopie de l’empereur Haïle Selassié — une campagne féroce de neuf mois qui permit à Mussolini de proclamer depuis le Palazzo Venezia la naissance de l’Empire italien.
En 1941, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, mû par son esprit guerrier et désormais âgé de 47 ans, Mario — qui considérait la vie comme une bataille permanente — retourna en Afrique, cette fois pour faire face aux forces britanniques menaçant les possessions italiennes en Libye et en Afrique orientale italienne.
À mesure que la guerre avançait, les puissances de l’Axe perdaient l’initiative, et le tournant du conflit s’opéra de manière décisive en faveur des Alliés. En 1943, suite à une série de défaites, une partie de la péninsule italienne fut envahie par les troupes anglo-américaines. Le mécontentement se répandit dans le Grand Conseil fasciste, et Mussolini fut démis de ses fonctions par le roi Victor Emmanuel III, puis arrêté. Peu après, le 8 septembre, vint la trahison de Badoglio: l’Italie se rendit aux Alliés et déclara la guerre au Troisième Reich.
Au milieu du chaos, Mario resta inébranlable, sa foi dans la doctrine fasciste demeura intacte. Mussolini, libéré de la captivité par un commando SS, proclama le 23 septembre l'avènement de la République sociale italienne (RSI) — la courte mais mal famée République de Salò. Au lieu d’accueillir les envahisseurs avec des drapeaux blancs, ou parfois rouges ou même américains, Mario Gramsci répondit à l’appel fasciste à continuer le combat, en s’engageant dans les forces armées de la RSI.
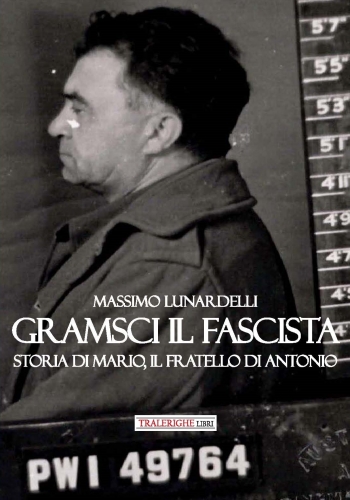
Capturé par les partisans, le Gramsci fasciste fut remis aux Britanniques et déporté dans un camp de concentration en Australie, très loin de chez lui. Les conditions difficiles qu’il endura — une forme de traitement inhumain réservée surtout aux soldats fascistes sans repentir — détruisirent peu à peu sa santé.
Libéré fin 1945, il revint en Italie, pour mourir peu après, ses blessures en camp s’étant révélées incurables. Il fut admis dans une clinique mal équipée, où il mourut à l’âge de 52 ans, en présence de sa femme Anna et de leurs enfants, Gianfranco et Cesarina.
Ironiquement, il est intéressant de noter qu’Antonio Gramsci, lorsqu’il tomba malade en prison à cause d’une maladie chronique contractée dans sa jeunesse, fut libéré et, en tant qu’homme libre, put recevoir un traitement — aux frais du régime fasciste — dans une clinique privée.
Le nom de Mario ne fut jamais donné à une rue, contrairement à celui de son frère Antonio, et il est presque oublié dans les pages injustes de l’histoire. Pourtant, Mario — le Gramsci en chemise noire — reste sans doute l’image même de l’aventurier: un exemple de courage et de loyauté, la glorification du soldat politique. Peut-être que les mots de John M. Cammett résument la richesse émotionnelle de la vie de Mario Gramsci: « Il était volontaire pendant la Première Guerre mondiale, volontaire lors de la guerre en Éthiopie, et à nouveau lors de la Seconde Guerre mondiale (à 47 ans !). Et entre ces catastrophes, il était un volontaire enthousiaste pour l’idéologie qui l’a finalement détruit ! Quelle vie ! » (2).
Notes:
(1) Bien que nation victorieuse, l’Italie n’a pas vu la pleine mise en œuvre des traités qui lui auraient accordé des territoires supplémentaires et des avantages économiques.
(2) John M. Cammett, “L’autre frère de Antonio : une note sur Mario Gramsci,” International Gramsci Society Newsletter 7 (mai 1997) [ http://www.internationalgramscisociety.org/igsn/articles/... ].
12:10 Publié dans Biographie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mario gramsci, fascisme, histoire, italie, biographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Hegel et l’Intelligence Artificielle
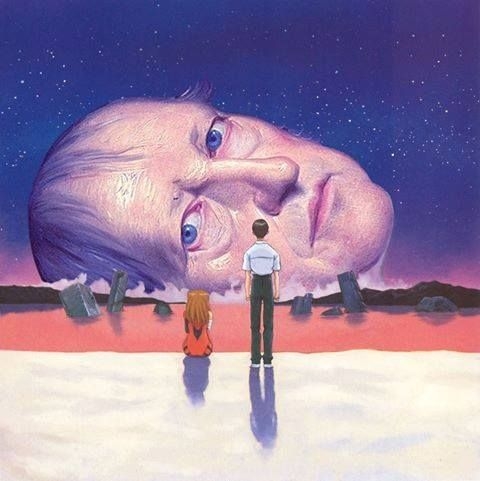
Hegel et l’Intelligence Artificielle
Un essai dialogique d’Enrico Arduin : le volume est ouvert par la préface de Massimo Donà, directeur de la collection, et par une contribution de Gianfranco Bettin
de Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/125712-hegel-e-lintelligenza-ar...
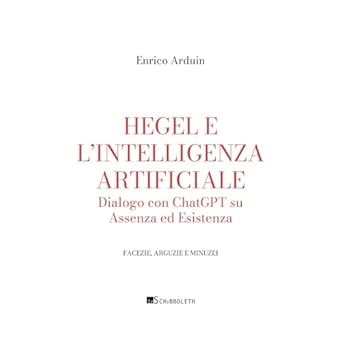 Nous avons lu un volume original et très actuel. Original, mais attention, non dans le sens commun du terme, renvoyant, dans le cas d’une production intellectuelle, à quelque chose d’inhabituel et de singulier, mais dans un sens profond, comme une production centrée sur la confrontation avec l’origine.
Nous avons lu un volume original et très actuel. Original, mais attention, non dans le sens commun du terme, renvoyant, dans le cas d’une production intellectuelle, à quelque chose d’inhabituel et de singulier, mais dans un sens profond, comme une production centrée sur la confrontation avec l’origine.
Ce livre est très actuel pour une autre raison: il aborde, au-delà de tout canon herméneutique déjà expérimenté, le problème de l’Intelligence Artificielle (IA). Il s’agit du essai dialogique du philosophe Enrico Arduin, récemment paru dans le catalogue des éditions InSchibboleth, dans la collection « Facéties, sagacités et minuties », Hegel e l'intelligenza artificiale. Dialogo su Assenza e Esistenza (= Hegel et l’Intelligence Artificielle. Dialogue avec ChatGPT sur l’Absence et l’Existence). Pour toutes commandes : info@inschibbolethedizioni.com).
Le volume commence par la préface de Massimo Donà, directeur de la collection, ainsi que par une contribution de Gianfranco Bettin. Ces deux textes synthétisent, avec une argumentation pertinente, les thèses d’Arduin et introduisent le lecteur dans l’univers idéal des thèmes complexes abordés dans les pages du volume.
Jusqu’à présent, la bibliographie critique sur le thème de l’IA a été marquée par des positions divergentes. D’un côté, les partisans de l’IA, qui en exaltent les avantages et les aspects positifs, de l’autre, ses détracteurs, qui la considèrent essentiellement comme un danger pour la liberté et la pensée. Arduin, en revanche, part d’un échange direct et actif avec l’IA, un dialogue sur des thèmes que certains pourraient considérer inhabituels pour l’IA, concernant les aspects les plus significatifs de la spéculation d’un des grands pères de la philosophie, Hegel.
Dans la première partie du volume, l’auteur a choisi, en tant que deutéragoniste, le plugin « Mr. Logical », basé sur ChatGPT ; dans la seconde section, Arduin dialogue avec un modèle plus avancé de ChatGPT, produit au cours des premiers mois de 2024, tandis que, dans les conclusions, le dialogue devient le chat de la toute dernière génération, GPT-4.5.
Arduin est conscient que, dans le contexte actuel, marqué par des dispositifs synthétiques constitués de PC et de téléphones, il existe une possibilité d’intégration entre la dimension physiologique-biologique de l’humain et celle représentée par la nouvelle technologie. La comparaison qu’il met en scène, remarque Donà, est celle qui existe entre « la fragilité et l’imperfection de notre être sensible et l’action symbolique générée par les articulations synaptiques complexes conservées par un processus computationnel sans identité matérielle ni corporelle » (p. 10). De ce processus, il ressort, à la manière nietzschéenne, la disparition du sujet, de l’agent, puisque tout est action.

Les questions pressantes, critiques, parfois subtiles, que pose Arduin à l’IA, l’éclairent. L’incipit du dialogue avec l’IA revient tout au long de la discussion et est représenté par la dialectique hégélienne, relue au-delà des exégèses scolastiques accumulées dans la philosophie depuis plus de deux siècles.
La conversation montre que chez le philosophe allemand, les concepts de Dieu et de la Religion ne renvoient jamais, souligne le préfacier, à quelque chose de semblable à une réification conceptuelle fallacieuse, qui ne peut être ramenée au mouvement général de l’Esprit (p. 12). De cette conceptualisation, conçue de façon dynamique, non statique, découle l’auto-cancellation à laquelle toute détermination de l’Absolu est destinée.
Le philosophe vénitien Andrea Emo en a pris conscience dans son ultra-temporalité. Dans la logique de l’essence, Hegel a saisi la négativité du principe, qui se répercute perpétuellement dans l’apparition « positive » des multiples. L’auteur conclut: « Adopter cette perspective exige une ouverture philosophique à la fluidité de la réalité et à la nature provisoire de nos horizons conceptuels. Elle nous invite à voir le monde [...] comme un processus dynamique et interconnecté en devenir » (p. 21). Arduin évoque et confronte, dans le dialogue avec l’IA, la thèse du « manque » lacanien.
Le « manque », que nous expérimentons concrètement dans la vie, donne lieu à un mouvement désirant sans fin, destiné à déstabiliser [...] toute tentative de « fixer » la substance du réel » (p. 13). L’origine est infondée, c’est la liberté non réduite aux catégories eidétiques, aux universaux.
Hegel et Lacan sont envisagés comme des auteurs capables de résoudre le problème complexe du rapport entre nos existences individuelles, «incorporées», et «le réseau extrêmement compliqué de processus computationnels rendu à l’humain [...] par une action inexistante mais hyper efficace capable de modifier [...] notre rapport [...] avec la réalité» (p. 13). La vision de Lacan, selon l’auteur, « offre une voie valable pour comprendre le processus dialectique [...] en intégrant les dimensions physiques, existentielles et symboliques de l’expérience humaine » (p. 22), nous rendant donc, selon Bettin, conscients que l’histoire de l’individu est l’histoire de la physis.
L’exégèse de Hegel est menée par Arduin à la lumière de la notion de «contradiction». Elle clarifie l’interrelation entre être et non-être et présente cinq configurations. La confrontation avec l’IA permet aussi d’accéder aux thèmes éthico-politiques vivants: entre autres, avec le lien qui unit pouvoir et liberté, toujours entrelacés, de façon à ce que, précise Donà, «reconnaître l’un, c’est aussi reconnaître, dans l’un, l’autre» (p. 15).
La thèse centrale du livre doit être saisie dans la discussion sur les développements futurs de l’IA, qui prévoient la nullification de la distance entre processus neuronaux numériques et l’expérience de la conscience analogique. Les premiers, attention, tendent toutefois à nier le flux de conscience humaine. La solution se trouve encore une fois dans la notion de «contradiction» chez Hegel, où les «dépassés» (intelligence analogique et computationnelle) ne sont pas effacés, mais radicalisés dans leur incommensurabilité. Une «synthèse», donc, incapable d’être vraiment telle, et de statuer et d’atteindre un nouveau positivum. En fin de compte, l’auteur remarque que la révolution informatique ne fait que remettre en question le problème de la signification, sur lequel la réflexion philosophique s’est penchée, dès l’origine, de manière sceptique et critique.
Enrico Arduin, Hegel e l'intelligenza artificiale. Dialogo con ChatGPT su l'Assenza e l'Esistenza (= Hegel et l’Intelligence Artificielle. Dialogue avec ChatGPT sur l’Absence et l’Existence), Edizioni InSchibboleth, pp. 345, 26 euros
11:47 Publié dans Actualité, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, livre, philosophie, hegel, intelligence artificielle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 30 octobre 2025
Orbán ressuscite l’esprit de Visegrád

Orbán ressuscite l’esprit de Visegrád
Source: https://report24.news/orban-belebt-den-geist-von-visegrad...
Hongrie, Slovaquie et République tchèque – un trio de pays d’Europe centrale, dirigé par Orbán, Babiš et Fico, qui refuse de se soumettre aux eurocrates bruxellois. Désormais, le groupe de Visegrád cherche à se redonner vie avec ces trois États.
Pendant que Bruxelles inonde Kiev de milliards et parle de “solidarité européenne”, un contrepoids se forme discrètement mais avec détermination en Europe centrale. Viktor Orbán, qui est depuis des années l’enfant terrible de l’UE, pense que son heure est arrivée. Après les récentes élections en République tchèque et le retour au pouvoir du pragmatique Andrej Babiš, de nouveaux horizons stratégiques s’ouvrent. Avec le Premier ministre slovaque Robert Fico, Orbán veut raviver ce qui, autrefois, en tant que “groupe de Visegrád”, a conservé une bonne dose de bon sens – et qui pourrait aujourd’hui devenir le dernier bastion du bon sens sur un continent dominé par une fièvre de nature idéologique.
Si Prague, Bratislava et Budapest unissent leurs forces, elles pourraient sérieusement freiner la folie financière et politique des aides à l’Ukraine. Orbán a déjà prouvé à plusieurs reprises qu’il sait comment bloquer la machinerie de l’UE – au grand dam de la Commission, qui s’arroge de plus en plus de pouvoirs. Mais cette fois, il y a davantage en jeu. Il ne s’agit plus seulement de sanctions ou de quotas de réfugiés, mais de la question de savoir si l’Europe continuera à se laisser entraîner dans une guerre économique ou si elle choisira une voie basée sur la raison économique.
L’alliance de Visegrád – autrefois symbole de la résistance contre la tutelle bruxelloise – s’est effondrée lorsque la Pologne a rejoint, une fois pour toutes, la politique anti-russe menée par les États-Unis. Mais désormais, cette idée renaît sous la forme de “Visegrád 3”. Orbán, Babiš et Fico – trois hommes très différents, mais partageant un même point de vue: leur refus de faire de leurs pays des États vassaux de la bureaucratie européenne.
La victoire de Babiš aux élections tchèques marque un tournant décisif. Le milliardaire et ancien Premier ministre en a assez des leçons moralisatrices de Bruxelles. Son programme: défendre les intérêts nationaux plutôt que la loyauté transatlantique. Il se rapproche ainsi plus que jamais d’Orbán. Fico, de son côté, privilégie le dialogue avec Moscou plutôt que l’escalade – ce qui met en rage les soutiens de Kiev en Occident. Ce qui se forme ici n’est pas simplement une alliance politique utile, mais un contrepoids idéologique: souveraineté nationale contre ingérence supranationale, politique réaliste contre exaltation gonflée à la moraline, recherche de paix contre guerre permanente.
Une telle alliance constitue une épine dans le pied pour Bruxelles. Un pays seul peut plus facilement être mis sous pression qu’un trio. Si Budapest, Prague et Bratislava défendent leurs intérêts conjointement, à l’avenir, l’équilibre des pouvoirs dans l’UE pourrait basculer. Au Conseil, le bloc “Visegrád 3” aurait assez de poids pour bloquer de futurs financements pour l’Ukraine ou des paquets de sanctions. Bruxelles redoute le scénario qu’elle craint le plus: une coalition de forces réalistes au cœur de l’Europe.
De plus, au Parlement européen, on commence à sentir du mouvement. Balázs Orbán, le directeur politique du Premier ministre hongrois, a annoncé que la fraction “Patriots for Europe” voulait s’unir aux conservateurs européens et aux souverainistes. L’objectif : une nouvelle majorité de droite qui pourrait faire vaciller l’alliance déjà fragile d’Ursula von der Leyen. Ce double-front contre les eurocrates bruxellois sera-t-il couronné de succès ?
21:32 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : viktor orban, visegrad, europe, affaires européennes, actualité, europe centrale, slovaquie, hongrie, république tchèque |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Foreign Affairs: « L’Amérique doit diviser le groupe BRICS » – Quand le monde devient trop indépendant
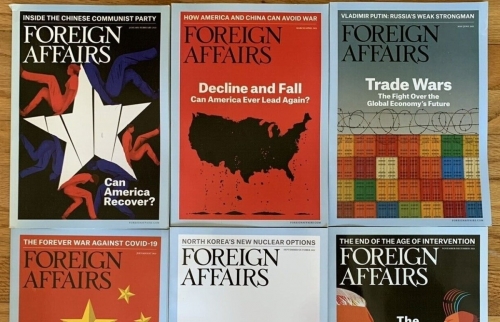
Foreign Affairs: « L’Amérique doit diviser le groupe BRICS » – Quand le monde devient trop indépendant
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
Aux États-Unis, on pense désormais à voix haute à chercher comment fragmenter le bloc que forment les États du BRICS.
Dans Foreign Affairs, la revue porte-voix de l’élite de la politique étrangère américaine, deux stratégistes républicains, Richard Fontaine et Gibbs McKinley, écrivent très franchement que les États-Unis devraient isoler la Russie et la Chine — tout en se rapprochant davantage du Brésil, de l’Inde et de l’Afrique du Sud.
Pourquoi ?
Parce que ces cinq pays font quelque chose qui effraie Washington: ils construisent étape par étape un monde soustrait au contrôle américain.
Le véritable cœur du problème : le pouvoir par l’argent
Les auteurs le disent presque sans détour: si les États du BRICS commencent à ne plus commercer entre eux en dollars américains, Washington perdra son arme de pression la plus importante — le système financier utilisé comme une arme.
Car tant que le dollar reste la monnaie mondiale, les États-Unis peuvent presque frapper n’importe quel pays via les banques, le système SWIFT et les sanctions.

Mais si le Brésil achète du pétrole en yuan, l’Inde paie en roupies et la Russie utilise ses réserves d’or, cette emprise disparaît peu à peu.
C’est cela qui compte — pas la démocratie, pas les valeurs invoquées, mais la domination économique.
Pourquoi les États-Unis doivent diviser
Un bloc BRICS uni serait une véritable alternative à l’ordre occidental: banques de développement propres, systèmes de paiement indépendants, et une voix politique commune qui ne plie pas devant Washington.
C’est ce qu’ils veulent empêcher.
Ils tentent donc de séduire les États « plus neutres » — le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud — avec des accords commerciaux, des contrats d’armement, de l’attention diplomatique.
Objectif: affaiblir la cohésion interne du groupe BRICS pour que la Russie et la Chine restent seules.
La logique plus large...
Ce n’est pas un cas isolé, mais une partie d’une stratégie éprouvée: lorsqu’un concurrent devient trop fort, il est divisé de l’intérieur. Cette méthode a déjà fonctionné durant la Guerre froide — et elle doit maintenant empêcher la transformation de l’ordre mondial.
Mais cette fois, l’Occident ne fait plus face à des États dépendants, mais à des puissances régionales confiantes qui ont déjà appris à gérer les offres de Washington sans se soumettre.
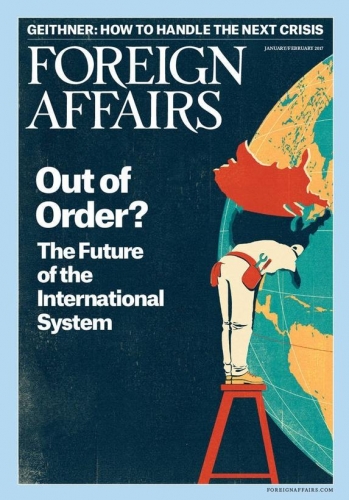
Conclusion :
Ce que Foreign Affairs présente comme une « stratégie », c’est en réalité la reconnaissance d'un fait patent: celui d'une hégémonie qui perd son contrôle.
Quand une superpuissance commence à parler ouvertement de division, cela montre qu’elle craint déjà l’unité des autres.
Et c’est là que se trouve le vrai tournant de la politique mondiale.
Les États-Unis ne combattent pas le BRICS, ils luttent pour retarder le moment où ils perdront le contrôle de la scène mondiale.
Il ne s’agit pas de politique, mais de garder le contrôle sur le système monétaire.
21:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, brics, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Moeller van den Bruck, avant-garde de la révolution conservatrice
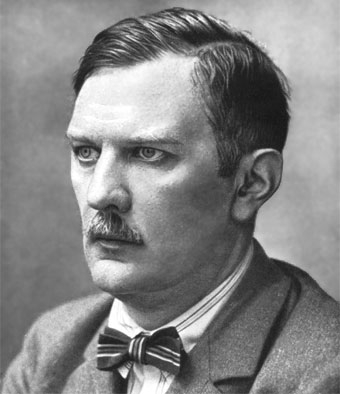
Moeller van den Bruck, avant-garde de la révolution conservatrice
Par Enrico Colonna
Source: https://www.ilprimatonazionale.it/primo-piano/konservativ...
Souvent, lorsqu’on parle de la Révolution Conservatrice, l’idée qui en ressort est assez floue. Non pas parce qu’on ignore ce dont il s’agit — du moins parmi ceux qui s’intéressent à ces questions — mais parce que ce mouvement était plutôt varié en lui-même et parce qu’à différence d’autres mouvements culturels du 20ème siècle, la Révolution Conservatrice n’a pas eu de véritable manifeste (comme par exemple le Manifeste du Futurisme de 1909). Pour une systématisation bibliographique de ce mouvement, il faut attendre l’essai d’Armin Mohler de 1950, La Révolution Conservatrice, récemment réédité en Italie par "Passaggio al Bosco Edizioni" dans une version enrichie avec la bibliographie de Nicola Cospito et les essais d’Alain De Beniost, Adriano Scianca et Lorenzo Di Chiara.
Les trois étapes de la révolution conservatrice
Cependant, on peut repérer une sorte de « manifeste en trois étapes » dans l’œuvre de l’un de ses principaux initiateurs : Arthur Moeller van den Bruck. Né en 1876, soldat de réserve durant la Première Guerre mondiale, Moeller van den Bruck écrivit dans la dernière décennie de sa vie trois essais qui devinrent en quelque sorte les manifestes de la Révolution Conservatrice : Le Style prussien (1916), Le Droit des jeunes peuples (1919), et Le Troisième Reich (1923).
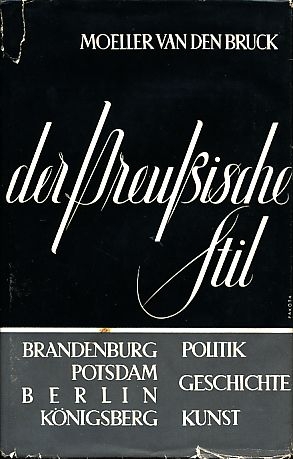
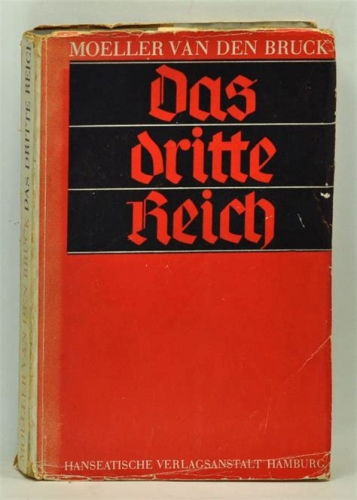
Une « triade » qui amena un penseur marxiste comme Stefano Azzarà à qualifier Moeller van den Bruck de « Lénine de droite », en raison de ses réflexions sur l’effondrement de l’ordre bourgeois et la nécessité d’une transformation radicale après un tel effondrement.
Moeller van den Bruck a ses racines culturelles dans la lecture passionnée de Nietzsche et dans la critique artistique et littéraire: notons que sa première notoriété en Italie vint avec son essai La beauté italienne, écrit après un séjour en Toscane où il put admirer l’art et l’architecture du Moyen Âge et de la Renaissance. De cette formation culturelle émerge sa conception particulière du « style », qui, selon lui, ne concerne pas seulement l’art ou l’esthétique.
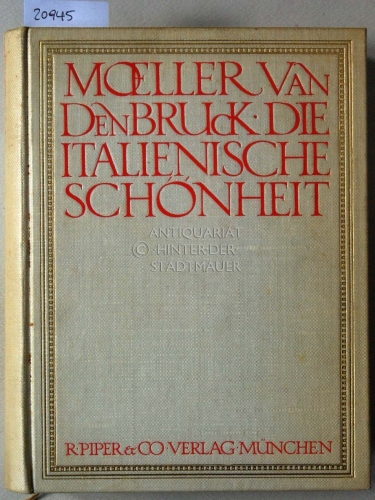
Le style est la forme morale que donne un peuple à sa vie. La louange ici n’est pas pour la Prusse en tant qu’État ou sujet historique-politique, mais comme « manière d’être » : une façon d’être qui privilégie la mesure à l’excès, qui exaltent la primauté du devoir sur le plaisir, qui oppose l’héroïsme quotidien « anonyme » basé sur la constance à l’héroïsme du geste spectaculaire et de la gloire personnelle.
Le style et le droit des peuples jeunes
Moeller van den Bruck, en effet, est très satisfait que l’Allemagne se soit unifiée sous la direction du Royaume de Prusse et non, par exemple, du Royaume de Bavière : en s’unifiant sous la direction et l’impulsion militaire prussienne, l’Allemagne s’est formée sur cette base morale. Il soutient également qu’il existe des « Prussiens d’adoption », comme Georg Wilhelm Friedrich Hegel (originaire de Stuttgart), c’est-à-dire ceux qui ont fait leur la mentalité prussienne. La Prusse n’est donc pas une entité géographique sur la carte, mais — justement — un « style » qui imprègne tous les aspects de la vie.
À la fin de la Grande Guerre, Moeller van den Bruck acheva la rédaction de la deuxième étape de son « manifeste » de la Révolution Conservatrice : Le Droit des jeunes peuples.
A la base de ce texte se trouve une distinction assez « classique » : celle entre vieux et jeunes peuples. Les premiers, qui ont atteint le sommet de leur civilisation et sont désormais en déclin, doivent être balayés par les seconds, qui n’ont pas encore atteint leur plein développement et qui ont le droit historique et moral de se manifester sur la scène de l’histoire.

Est ici évidente l’influence de la pensée de Hegel dans ses Leçons sur la philosophie de l’histoire, où le philosophe de Stuttgart souligne la nécessité du conflit et de la « tempête » pour garder la mer de l’histoire limpide et empêcher qu’elle ne se transforme en un marécage calme et plat.
Le conflit par lequel l’ancien est renversé par le nouveau occupe une place centrale dans la pensée de Moeller van den Bruck. La Première Guerre mondiale a été, dans cette vision de l’histoire, un « chapitre » de cette lutte.
La troisième voie du nationalisme allemand
Mais la notoriété de Moeller van den Bruck repose surtout sur la création d’une expression qui, après sa mort (en 1925, par suicide), a acquis une grande popularité : Le Troisième Reich.
Cette expression devint un mot-clé du mouvement völkisch, bien avant que le national-socialisme en fasse son programme politique.
Il est également intéressant de voir comment, à l’origine, l’auteur envisageait d'intituler « Der Dritte Weg » (la Troisième Voie) cet essai qui constitue la troisième et dernière étape de son « manifeste »: une voie « allemande » vers la révolution, alternative aussi bien au capitalisme qu’au socialisme scientifique.
Comme le note Armin Mohler dans l’essai déjà cité sur la Révolution Conservatrice :
« Face au Saint-Empire romain universel de la nation allemande et au petit ‘Zwischenreich’ (l'Empire intermédiaire) de Bismarck, Moeller van den Bruck, avec le ‘Troisième Reich’, propose l’image d’un Empire final, où les contradictions du socialisme et du nationalisme, de la gauche et de la droite, s’annulent en se réunifiant. Le chiffre trois ne signifie pas seulement la succession des empires au fil de l’histoire ; il exprime l’idée d’une synthèse conciliant une thèse et une antithèse. »
En somme, un Empire de l’âme et un « mythe politique » mobilisateur. Une condition morale avant d’être historique, semblable à celui de l'« Allemagne secrète » évoquée par les intellectuels (comme l’historien Ernst Kantorowicz) réunis dans le cercle du poète nationaliste Stefan George.
20:09 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arthur moeller van den bruck, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les Balkans sont la chair et le sang de l’Europe, tandis que l’UE n’est qu’une institution économique

Les Balkans sont la chair et le sang de l’Europe, tandis que l’UE n’est qu’une institution économique
Maintenant, les drones turcs équipent les Albanophones du Kosovo, où le conflit pourrait être réactivé contre la Serbie
Par Francesco Cosimato
Source: https://www.barbadillo.it/125378-i-balcani-sono-carne-e-s...
Les livraisons de drones militaires au Kosovo par la Turquie remettent en question le statut des Balkans occidentaux et leur position par rapport à l’Union européenne, et plus généralement par rapport à l’Europe, cette réalité physique qui ne correspond pas aux institutions européennes : celles-ci ne représentent qu’une partie du continent et uniquement du point de vue économique : l’UE n’est pas un État.
Les drones sont des Skydagger Rft15, drones FPV capables de transporter jusqu’à 5 kg de charge utile, y compris des explosifs, et de voler sur 10 km à 130 km/h. Ils ont été fournis en grande quantité aux forces du Kosovo, qui, conformément à des accords prévoyant la présence des forces de l’OTAN (Kfor), ne devraient avoir que des missions de sécurité intérieure. Ils ne devraient donc pas disposer d’armes offensives.
Anti-Slaves, c’est-à-dire anti-Russes
Les Balkans sont assurément européens, mais ils sont lourdement marqués par des rivalités historiques et des ingérences occidentales : les États-Unis sont intervenus dans l’ex-Yougoslavie pour des raisons anti-slaves et, surtout, anti-russes.
L’auteur de cet article s’est rendu au Kosovo et voit comment la région est bien vivante grâce au financement américain, et comment les conditions de vie difficiles des minorités serbes sont inacceptables et incontestables, tout comme celles de la majorité albanaise.
L’Europe est un concept culturel depuis l’époque de Charlemagne, mais l’UE semble ne pas savoir ce qu’est l’Europe quand elle poursuit des politiques dictées par des puissances outre-océaniques.
La position turque dans les Balkans, depuis longtemps, est d’islamiser la région, formant une sorte de sandjakkat, qui, en se basant sur les données historiques ottomanes, comprime l’entité serbo-slave pour servir les intérêts des États-Unis.
Adhésion suicidaire à la politique américaine
La direction actuelle — une gouvernance, non élue par les peuples — de l’UE devrait examiner attentivement s'il est vraiment utile de suivre les États-Unis dans leur lutte contre les zones slaves en Europe. Priver l’Europe de la composante slave, cela ne signifie pas seulement la priver d’énergie, ce qui est déjà une question stratégique importante. Priver l’Europe de la Serbie et de la Russie, cela signifie priver le vieux monde de sociétés cohésives qui s’opposent à la dérive woke et gender, importée d’outre-atlantique. Le patriarche serbe de Belgrade s’installe à Pećka Patriarska, un lieu du Kosovo, juste pour mieux comprendre.
Cette gouvernance ne parvient pas à définir des lignes d’action diplomatique pour calmer les crises qui nous entourent. Cela conduira probablement à une Europe amputée, sans énergie, vieillie et idéologisée. Du Moyen-Orient à l’Asie, l’Europe devient insignifiante.
Diplomatie non, guerre oui
Les déclarations bellicistes de la commissaire européenne, Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère et de la sécurité, indiquent la volonté d’éviter la voie diplomatique pour gérer les conflits. La volonté de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de « réarmer » une Europe qui n’est pas un État, s'avère également nuisible et dangereuse.
Une des choses les plus importantes à connaître sur les Balkans occidentaux est la « bataille de la plaine des merles », défaite serbe contre les Ottomans à Kosovo Polje le 28 juin 1389, épisode clé de la lutte entre chrétiens et Ottomans. Que ceux qui veulent livrer les Balkans au Sandjakkat aillent de l’avant…
19:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : balkans, europe, actualité, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 29 octobre 2025
L'Europe, la grande perdante dans la guerre entre les États-Unis et la Chine pour les métaux rares, selon les médias

L'Europe, la grande perdante dans la guerre entre les États-Unis et la Chine pour les métaux rares, selon les médias
Source: https://es.sott.net/article/102129-Europa-la-gran-perdedo...
Bruxelles risque de devenir subordonnée aux deux puissances en raison de sa dépendance aux services numériques américains et à l’exploitation minière chinoise, avertit le journal The Financial Times. Il ajoute que l’investissement de l’UE dans les industries clés est ridicule par rapport aux milliards que Pékin et Washington y investissent.
« La double dépendance de l’Europe vis-à-vis des services numériques américains et de l’industrie chinoise de traitement des minéraux critiques la rend très vulnérable aux pressions extérieures », souligne-t-il.
Cela s’aggrave du fait que la stratégie de l’UE concernant les matières premières entre en conflit avec l’opposition des écologistes, tandis que ses investissements technologiques sont bien inférieurs à ceux de la Chine et des États-Unis, indique la publication.
Même dans le domaine où l’Europe était considérée comme leader — énergie solaire, éolienne et véhicules électriques — la Chine domine actuellement ces secteurs, notamment avec la production de batteries au lithium.
« Si Bruxelles ne parvient pas rapidement à mobiliser les États membres, l’UE finira par devoir supplier en permanence la Chine, les États-Unis ou les deux », résume The Financial Times.
Cela se produit dans le contexte de la guerre technologique entre Pékin et Washington, dans laquelle les États-Unis restreignent l’accès de la Chine aux microprocesseurs, majoritairement fabriqués à Taïwan. La Chine, pour sa part, est devenue le leader mondial du traitement des métaux rares, en réalisant ses opérations à un coût 30% inférieur à celui de ses concurrents et en monopolisant les terres rares. Cela lui permet de contre-attaquer et d’imposer ses propres règles du jeu.
Les nouveaux tarifs douaniers imposés par Trump contre la Chine entreront en vigueur à partir du 1er novembre, ce qui porterait les droits de douane de Washington contre Pékin à 130%, alors que jusqu’à présent, la Chine applique une taxe de 10% sur les produits américains.
Le 15 octobre, la Chine a lancé un avertissement aux États-Unis concernant la guerre commerciale. La réponse de Pékin aux tarifs américains sera ferme et personne ne l’intimidera, ont assuré le ministère chinois du Commerce.
20:12 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, chine, europe, affaires européennes, terres rares, métaux rares |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Guerre financière

Guerre financière
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/guerre-finanziarie/
Bart De Wever, le Premier ministre belge, est tenaillé par de nombreux doutes.
La confiscation des biens russes, des actions et autres, situés dans l’Union européenne, pour les remettre à Zelensky, le laisse extrêmement perplexe. Et ce n’est pas parce qu’il serait un dangereux pro-russe. Absolument pas.
Le fait est qu’un tel comportement serait extrêmement inhabituel. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, les biens allemands déposés dans les banques occidentales n’ont pas été touchés. Et inversement, bien sûr.
Il s’agit d’une attention mutuelle visant à ne pas faire totalement s’effondrer le système international du crédit et des banques.
Mais maintenant, la Commission européenne, soutenue par certains gouvernements, notamment ceux l’Allemagne et de la France, souhaite aller dans cette direction. Tous les actifs financiers russes seraient confisqués. Et, ensuite, remis à Zelensky.
Cependant, c’est là que commence la perplexité et l’inquiétude du Premier ministre belge. La Russie ne pourrait pas ne pas réagir, en confisquant et nationalisant des actifs économiques et surtout des entreprises européennes. Et cela causerait un grave, très grave, préjudice. Car ce que, dans leur ensemble, les pays européens perdraient, est énormément supérieur à ce qu’ils pourraient confisquer en actifs russes. Sans parler du petit détail que tout ce qui est confisqué en Europe irait, tout droit et gratuitement, dans les mains cupides de Zelensky. Tandis que les pertes retomberaient sur les pays européens eux-mêmes.
Ceci dit, De Wever est, manifestement, quelqu’un qui sait compter. Et il se rend compte que le jeu n’en vaut pas la chandelle.
Au contraire, il représente une voie très rapide vers le suicide économique.
D’où sa perplexité, qu'il exprime toutefois de manière très mesurée. Et cependant, très significative.
Car beaucoup, même dans les pays d’Europe occidentale, commencent à douter de cette politique de l’Union, visant une guerre sans règles ni quartier contre Moscou.
Des doutes qui, de l’Espagne à la Belgique, fragilisent de plus en plus ce qui reste encore debout de cette marionnette unitaire.
20:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre financière, bart de wever, belgique, europe, affaires européennes, actifs russes, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pourquoi la gauche perd les élections... et est rejetée par les classes populaires

Pourquoi la gauche perd les élections... et est rejetée par les classes populaires
Nicolas Maxime
Source: https://www.facebook.com/nico.naf.735
Javier Milei a été confirmé aux législatives de mi-mandat, encore un nouveau signe que le basculement dans le Monde vers la droite populiste se poursuit, pendant que la gauche continue de s’effondrer, incapable de comprendre ce qui lui arrive. La gauche perd élection après élection, et elle continuera à les perdre, partout dans le monde, pendant que l’extrême droite poursuit sa progression — y compris avec un programme économique pourtant contraire aux intérêts matériels des classes populaires. Pourquoi ? Parce que l’extrême droite, elle, a parfaitement compris la logique girardienne du bouc émissaire, en désignant les « assistés », les chômeurs, les migrants voire les fonctionnaires et les retraités comme étant responsables de la crise. Tandis que la gauche, devenue nullissime (y compris dans ses formes dites « radicales »), n’a plus rien compris au peuple, au point d'en être venue, par inversion mimétique, à faire du prolo blanc son bouc émissaire car perçu comme un plouc ou un « beauf » réactionnaire et raciste.
Cette déconnexion avec le réel s’incarne parfaitement dans le mépris de classe d’un Édouard Louis, qui va jusqu’à rêver — comme il l’exprime sans gêne — d’un régime où les villes et les campagnes auraient des gouvernements séparés, tant il estime irréconciliables le peuple urbain « progressiste » et les campagnes jugées réactionnaires. C’est le symbole parfait d’une gauche culturelle, moraliste et métropolitaine, qui ne supporte plus le peuple réel, celui qui ne parle pas comme elle, ne vit pas comme elle, et surtout, ne vote plus pour elle.
Aux yeux des classes populaires, motivées par un instinct de survie et de préservation de leur mode de vie, la gauche d’aujourd’hui n’est plus qu’une « gauche morale », une gauche qui incarne précisément tout ce qu’elles détestent.
Cette « gauche morale » n’a plus grand-chose à proposer sinon quelques réformes sociétales, une écologie quinoa-vegan fondée sur les interdictions et la culpabilisation, et la taxation des riches comme ultime horizon moral. En somme, elle est devenue la gauche du Capital — celle des médias, des grandes institutions culturelles, des universités et des métropoles. Elle est désormais considérée par les classes populaires comme plus dangereuse encore que l’extrême droite, parce qu’elle a trahi le camp qu’elle prétendait défendre, elle inspire désormais le rejet d’une majorité silencieuse qui, faute d’alternative crédible, se tourne vers l’extrême droite ou se réfugie dans l’abstention, perçue comme le moindre mal.
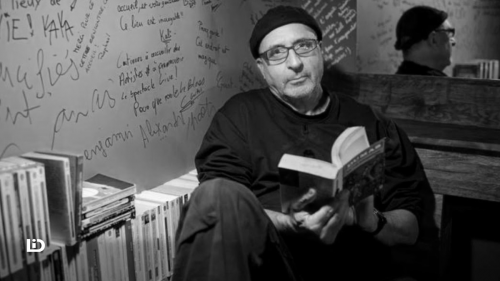
Comme le disait Jean-Claude Michéa, cette gauche a définitivement rompu avec le peuple dès lors qu’elle a cessé de se définir par la critique du capitalisme pour se fondre dans la logique du progressisme libéral. Depuis les années 1980, elle a abandonné la lutte des classes, la socialisation des moyens de production et la défense du monde du travail, pour devenir « gauche morale » des droits individuels, de la redistribution des richesses et de la bonne conscience. Elle ne s'adresse plus aux ouvriers et aux employés mais à la bourgeoisie culturelle, à ceux qui détiennent le capital symbolique, et non plus à ceux qui n’ont que leur force de travail pour vivre.
Comme le résume Michéa, elle ne combat plus le système, elle l’accompagne au nom du « progrès ». Et c’est précisément parce qu’elle a cessé d’être populaire qu’elle est devenue, dans le regard des classes populaires, la gauche du haut, celle des donneurs de leçons et des convertis au nouvel ordre moral libéral.
Dans ses enquêtes sur les campagnes françaises, il montre que les territoires périphériques et ruraux, loin d’être des bastions réactionnaires, sont d’abord des espaces de sociabilité, de solidarité et d’entraide, mais où domine un profond sentiment d’abandon. Coquard décrit un monde populaire attaché à la reconnaissance, au travail bien fait et qui voit dans la gauche diplômée et urbaine non plus une alliée, mais une élite moralisatrice qui ne les comprend pas et les méprise.
Pendant que la gauche sermonne et culpabilise, l’extrême droite capte les affects, les colères, les peurs — bref, tout ce que la gauche a méprisé au nom de sa « supériorité morale ». Et c’est ainsi qu’elle s’installe durablement comme le seul refuge politique pour ceux qui, désespérément, veulent encore croire qu’ils existent.
Bien entendu, l’extrême droite ou la droite populiste sera une impasse, et les classes populaires le découvriront (malheureusement) à leurs dépens. Car ce ne sont pas les immigrés, les minorités ou les élites culturelles qui menacent leurs modes de vie et les traditions : c’est le capitalisme lui-même, dans sa phase terminale, qui bascule désormais vers une forme autoritaire et libertarienne, où il n’y aura plus aucun compromis avec les travailleurs.
La véritable question est donc : comment le faire comprendre sans tomber dans les mêmes travers que la gauche morale ?
19:53 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, gauche, droite, idéologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Un pont à Budapest - Trump, Poutine et Orbán aux carrefours du chaos et de la puissance à Budapest

Un pont à Budapest
Trump, Poutine et Orbán aux carrefours du chaos et de la puissance à Budapest
Alexandre Douguine
Alexandre Douguine retrace comment Budapest émerge comme le point de friction où l’imprévisibilité de Trump et la stratégie de Poutine reshaping le jeu mondial.
Entretien avec Alexandre Douguine dans le programme Escalation
Présentateur : Donald Trump, le président des États-Unis, sera fréquemment mentionné dans notre émission aujourd’hui. Il a eu une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine et a rencontré personnellement Vladimir Zelensky. Je souhaite poser une question simple: sans les comparer directement, mais en analysant la dynamique de ces relations — comment la situation a-t-elle évolué après la conversation avec Poutine et la rencontre avec le leader du régime de Kiev? Existe-t-il des différences fondamentales entre ces interactions, ou Trump reste-t-il fidèle à son style, partout et toujours?
Alexandre Douguine : Lorsqu’on évalue le comportement de Trump en ce qui concerne la résolution de notre guerre contre l’Occident — en gros, contre Trump lui-même sur le sol ukrainien — nous partirons naturellement de notre propre perspective. Chaque fois que Trump fait un pas en direction de la Russie, nous considérons sa démarche comme favorable. Lorsqu’il soutient Zelensky et les politiques militaristes russophobes de l’Union européenne, nous qualifions une telle posture d’hostile. Pourtant, Trump vacille — il fait un pas dans une direction, un autre dans l’autre. Au moment où nous le déclarons favorable, il nous contredit subitement en promettant des Tomahawks aux Ukrainiens, en proclamant que l’Ukraine peut nous vaincre sur le champ de bataille, en exigeant que la Chine et l’Inde abandonnent l'achat de notre pétrole, et en renforçant les plans agressifs de l’UE. Dès que nous le qualifions d’hostile, il convoque Zelensky, l’humilie publiquement, le réprimande, lui tire les oreilles, se moque de ses protecteurs européens, et annonce en souriant qu’il serait heureux de rencontrer son “ami Vladimir” en Alaska ou à Budapest. L’Union européenne panique — Orbán et Fico apparaissent comme des rossignols blancs en raison de leur position souveraine. Trump ajoute alors: «Et si, demande-t-il à Zelensky — nous construisons un tunnel entre l’Alaska et la Sibérie russe?». Zelensky reste alors sans voix — c’est une humiliation publique. Nous trouvons cela amusant et commençons à penser que Trump se range de notre côté. Mais quinze minutes plus tard, il dit: « Peut-être que je plaisantais. Peut-être que je donnerai quand même les Tomahawks — je vais y réfléchir. Une rencontre ? — pas clair. Le tunnel ? — je ne sais pas. L’Inde doit toujours abandonner le pétrole. » Et il redevient hostile.

De notre point de vue, son essence est insaisissable — il est à la fois une chose et une autre, son contraire. Cela est devenu sa norme, sa façon de faire. La gamme de ses fluctuations est plus grande que celle de l’administration Biden. Biden a poursuivi une politique d’escalade — pression sur la Russie, soutien maximal à l’Ukraine, militaire, économique, diplomatique, médiatique — mais dans certaines limites, évitant la confrontation nucléaire. Leur ligne rouge était claire: ne jamais dépasser la limite de l’escalade contrôlée. Trump semble n’avoir pas de telle limite. Livrer des Tomahawks à Kiev serait une menace anti-russe plus dure que tout ce que Biden a osé. C’est effrayant: dans le sens des politiques anti-russes, Trump est prêt à aller plus loin que les globalistes. Pourtant, il peut tout aussi bien dire à Zelensky: «Gère toi-même ton conflit avec les Russes» — chose impensable sous Biden. L'amplitude de ses variations s’étend dans les deux sens: on peut attendre de lui du favorable ou du catastrophiquement dangereux. Un pas vers nous sera presque certainement suivi d’un virage brusque vers nos adversaires. Il cherche à s’élever au-dessus du conflit, mais en reste un participant.
Poutine tente de négocier avec lui; lorsque Trump est par hasard sur notre longueur d’onde, il écoute des arguments d'ordre historique. Mais seulement partiellement — car c’est difficile pour lui. La raison historique pour laquelle l’Ukraine nous appartient demande des connaissances, de la dialectique et de la compréhension pour les origines de ce conflit. L’histoire de l’Amérique est courte — trois ou quatre siècles. La nôtre est longue; celle de la Chine remonte à cinq mille ans. Trump n’a aucun intérêt pour cette longue durée; il n’a pas le temps de s’y plonger. Il agit par impulsion — parfois en cherchant à obtenir le Prix Nobel, prix discrédité, qui est devenu une marque de honte pour les personnalités les plus viles, celles qui le reçoivent. Il aspire à la gloire d’un pacificateur, mais n’y parvient pas. Israël a soutenu ses “missions de paix” pendant quinze minutes avant de se remettre à bombarder Gaza. A ses propres yeux, il demeure un héros, et cela le motive. Pourtant, en substance, il ne se range derrière personne. Un pas vers nous — Budapest, la réprimande à Zelensky, le refus des Tomahawks — est suivi d’un coup de pied de la Maison Blanche. Il écoute un chanteur italien puis réprimande Zelensky: « Va-t’en ! ». C’est un spectacle effrayant, mais l’humiliation, cela fait partie de son style.

Ce pandémonium ressemble à la série américaine Succession, où le magnat change de position chaque seconde, humiliant sans cesse tout le monde — ses proches, le monde entier, celui qui lui est proche et celui qui lui est éloigné. Pour Trump, le monde entier, c'est sa “succession”. Un geste vers nous ne doit nous donner aucune illusion — attendez-vous à un revirement soudain. Nous, cependant, nous avons un objectif stratégique: l’Ukraine sera nôtre, ou elle cessera d’exister. La neutralité est impossible; après ce qu’elle a fait, tout espoir en ce sens est perdu. Pour bétonner nos intérêts, nous devons rétablir le contrôle sur elle. Telle est notre tâche, et nous avançons dans cette direction — pas nécessairement dans l'immédiat, mais étape par étape. Trump, lui, s’en fiche; il est motivé par des motifs superficiels, momentanés, mais souvent grevés d'une grande dangerosité. Il n’est pas un allié et ne nous offrira pas l’Ukraine en cadeau. Nous devons la libérer nous-mêmes, la reconquérir, et établir une gouvernance conforme à nos intérêts.
Échapper à une Troisième Guerre mondiale — nucléaire ou autre — demeure une inconnue. Mais Poutine agit brillamment, de manière cohérente, cherchant à gagner en Ukraine sans déclencher une apocalypse nucléaire qui serait suicidaire. Telle est notre position.
Aux États-Unis, la situation paraît différente. Il y a trois forces stratégiques en présence. La première est le mouvement MAGA, grâce auquel Trump s’est élevé au pouvoir. Leur position est proche de la nôtre: pas d’interventions, pas d’aide à Zelensky — car ils estiment que ce n’est pas leur affaire. Quand Trump met fin à tout soutien à Zelensky, il parle au nom du mouvement MAGA: que Russes et Ukrainiens gèrent le conflit eux-mêmes. C’est aussi l'avis de l'électorat principal, la stratégie de MAGA. Lorsque Trump dévie, les militants de MAGA s’en affligent; lorsqu’il revient à leurs positions, ils l'acclament: « C'est mon président — c’est pourquoi j’ai voté pour lui». Si il dit: « Je vais donner des Tomahawks à Kiev », ils répondent: « Pas mon président — ce n’est pas la raison pour laquelle j’ai voté». C’est une force puissante. Ils veulent une Grande Amérique, pas un garant de la démocratie mondiale à la Wilson. Ils s’opposent au libéralisme, à la mode LGBT, au mouvement Antifa de Georges Soros, à la corruption, à Epstein.
Les Démocrates, la seconde force en présence, soutiennent Zelensky mais restent dans l’opposition et n’ont aucune influence sur la politique de Trump. La troisième force — les néoconservateurs et les RINOs, l’ancienne garde des Républicains cherchant l’hégémonie mondiale — comme Kellogg et d’autres autour de Trump, le poussent vers l’escalade. Entre MAGA et les néocons, Trump oscille, comme il le fait face à nos propres positions. Sa position sur l’Ukraine est le test décisif. MAGA est contre le soutien à Zelensky, mais Trump cherche à apparaître indépendant — comme Logan Roy dans Succession.
Présentateur : Au fait, je me souviens avoir lu que certains des scénarios et personnages de Succession étaient inspirés de Trump et de sa famille, même si la série a été créée avant sa présidence. En revenant à sa personnalité — d’après vos mots, il est clair que Trump possède une certaine stratégie, que ses actions et déclarations reposent sur quelque chose. Pourtant, beaucoup en Europe, en Amérique et en Russie constatent que Trump peut soudainement sortir quelque chose ou agir impulsivement simplement parce qu’il est Trump. Avant la dernière élection, Poutine, en réponse à la question de qui serait préférable pour la Russie, a nommé Biden — en disant qu’il était plus prévisible. L'imprévisibilité de Trump est-elle vraiment le résultat d’un manque de connaissance profonde ou de frivolité? Son équipe, disons, est plutôt expressive. Lorsqu’on leur demande pourquoi Budapest a été choisie pour une rencontre Trump–Poutine, ils répondent : « Et ta mère. »
Alexandre Douguine: Poutine a soutenu Biden pour ne pas nuire à Trump — s’il avait nommé Trump, ils l’auraient éliminé de la course, en l’accusant d’être la tête d'un « complot russe ». Ce fut une faveur. Biden était prévisible; ses lignes rouges étaient claires. Lui et les démocrates poursuivaient une escalade linéaire — une guerre chaude avec tout l’Occident qui finira par éclater.

L’imprévisibilité de Trump va dans deux directions: il peut aller plus loin dans l’escalade ou dans la réconciliation. Son impulsivité, sa frivolité — qui, parfois, ressemblent à de la démence — sont évidentes. Celles de Biden étaient silencieuses; celles de Trump sont tapageuses. Mais il y a néanmoins une logique. Lorsque des néoconservateurs comme Kellogg ou le terroriste, désigné comme tel par la Russie, Lindsey Graham, lui mettent la pression, il s’appuie sur MAGA. Lorsqu’il demande trop à MAGA, il se tourne vers les néocons. Ce mouvement entre les pôles n’est pas une simple spontanéité mais un algorithme.
La réponse « et ta mère » à la question sur Budapest dépasse la simple impolitesse; c’est une réponse au ton russophobe de la question — l’allusion « es-tu l’espion de Poutine ? », Caroline Leavitt et l’équipe de Trump disent essentiellement: « Fous le camp, porc ». Et ils ont raison — c’est ainsi qu’on doit parler à une opposition fallacieuse qui a déclenché une guerre. Les journalistes libéraux qui assiègent le gouvernement se saisissent de telles phrases.
L’impulsivité de Trump possède sa propre logique, comme celle de Prigogine dans la physique du chaos: le chaos est un ordre complexe. Poutine a parlé à Valdai de la «philosophie de la complexité» d’Edgar Morin. Dans le monde quantique, Trump navigue bien — même si ce n’est pas la mécanique classique de Newton, mais un système non linéaire. Ses conditions aux limites sont plus larges que celles de Biden. Il est prêt à l’escalade tant que cela évite la guerre nucléaire. Biden, par russophobie, pouvait faire empirer la situation, tandis que Trump fait peut-être semblant d’être prêt à l’apocalypse. C’est un épicurien, un bon vivant, ni suicidaire ni fanatique, prêt à sacrifier les principes libéraux pour en tirer des avantages.
Présentateur : En poursuivant notre entretien — peut-être en abordant un autre sujet — j’aimerais discuter plus en détail du lieu possible de la prochaine rencontre entre Poutine et Trump. Cela revient à ce que vous avez mentionné plus tôt. A Budapest, en Hongrie: dans une ville avec un héritage historique et des atouts modernes liés au pays même et à ses dirigeants. Comment doit-on voir ce choix si les présidents de la Russie et des États-Unis se rencontrent réellement là-bas et si le choix de Budapest est confirmé?
Alexandre Douguine: Cette situation doit être analysée à travers le prisme des couches politiques et géopolitiques de la réalité. Il est évident que l’Europe n’est pas une — il y a deux Europes. Autrefois, l'«Occident collectif» — l’administration Biden et l’UE — formait un seul champ, celui des démocraties libérales et du mondialisme, avançant un programme de perversions, de défilés LGBT (interdits en Russie), de turbulences BLM, de haine de ses propres racines et cultures, de culture de l’annulation, de migrations incontrôlées. C’était la plateforme commune de l’Occident — des États-Unis et de l’Europe ensemble.
La révolution de Trump, fondée sur le mouvement MAGA, a introduit des tendances opposées en Amérique. Les États-Unis se sont retrouvés dans une position unique: ils sont toujours le « père » de l’Europe — le "papa" comme Rutte et von der Leyen appellent Trump, le parrain de l’Europe — mais leur président suit une stratégie contraire à celle des dirigeants de l’UE. J. D. Vance en a parlé en Europe; Elon Musk soutient activement les populistes, secouant les élites libérales-globalistes en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et en Roumanie via X.com. Ces élites ont été vaincues en Amérique, mais conservent une influence en Europe.
La deuxième Europe est souveraine, populiste, « à la façon du mouvement MAGA » — faire en sorte que l’Europe soit à nouveau grande, par analogie avec MAGA. C’est l'Euro-Trumpisme, défendant l’indépendance et la souveraineté, s’opposant aux mondialistes, à la migration de masse, au pandémonium LGBT et au mariage gay — tous interdits en Russie et en Hongrie. Le Budapest d’Orbán est la citadelle de l'Euro-Trumpisme, une forteresse du conservatisme et des valeurs traditionnelles où Soros, les défilés gays et la migration illégale sont interdits. C’est le contrepoids, façon MAGA, c'est une autre Europe face à l'Europe de l'UE.

Interrogé sur « pourquoi Budapest ? », Trump répond: «C’est notre territoire». Orbán est son allié le plus proche en Europe. Fico est un populiste de gauche, tandis qu’Orbán est de droite et conservateur comme Trump. Un autre populiste conservateur est notre propre président Vladimir Poutine, qui mise sur le peuple et les valeurs traditionnelles tout en s’opposant à la migration et aux perversions. Trois leaders — Poutine, Trump et Orbán — se rencontrent à Budapest, un lieu plus proche de la Russie mais encore inclus dans l’Occident. Anchorage était autrefois proche aussi, faisant partie de notre ancien empire, tout comme la Hongrie durant la période soviétique. Trump exécute une danse géopolitique à nos frontières — hier l’Alaska, aujourd'hui Budapest. Après la visite de Poutine chez son ami Orbán, il est logique que Trump vienne à notre rencontre. Orbán est un outsider parmi les dirigeants paléolibéraux, mais il est un ami de Trump et de Poutine. En quel "ailleurs" pourraient-ils se rencontrer, sinon chez un ami commun, en quel autre lieu ces deux puissances en guerre devraient-elles se rencontrer pour bâtir des ponts? La Hongrie d’Orbán est l’adversaire principal de l’Ukraine: son veto bloque l’aide militaire, financière et diplomatique à Kiev au sein de l’UE. Orbán est notre ami, l’ami de Trump, proche des deux. Zelensky est en mode panique — il a subi une humiliation triple. Il s’appuie sur la direction libérale-globaliste de l’UE — Schwab, Larry Fink, le Forum de Davos. Zelensky est leur marionnette, un opposant à toute forme de souveraineté, aux nations et aux traditions, imaginant un monde sans la Russie, l’Ukraine, la France ou l’Allemagne — un gouvernement mondial et une humanité zombifiée. Sous couvert de patriotisme, il trahit idéologiquement l’Ukraine. Orbán, en revanche, est un vrai patriote hongrois, ne cédant pas la souveraineté ni à l’UE, ni à nous, ni à Trump. La Hongrie est le point symbolique idéal pour une rencontre Poutine–Trump.
Si la rencontre réussit à se faire — bien que, comme nous l’avons dit, rien n’est prévisible avec Trump, car il peut faire n’importe quelle cabriole dans son algorithme chaotique — la prochaine étape serait une visite de Trump à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Kazan ou à Sotchi, mais pas encore en Crimée. Trump tourne autour de nous: nous avançons vers lui, ou lui vers nous, ou nous nous rencontrerons sur un terrain neutre. L’Europe, sauf Orbán et Fico, n’est pas neutre — c’est une zone de conflit car elle arme le régime de Zelensky. Budapest est le choix logique de Trump. Les journalistes qui ont demandé « pourquoi Budapest ? » ont été rapidement écartés — le choix est évident. Où sinon, si ce n’est là? Anchorage a déjà été utilisée; l’Inde est impossible à cause de la question du pétrole; la Chine et le monde islamique ne conviennent pas. Budapest s’adapte parfaitement. Trump s’y sent confiant, parmi les alliés idéologiques du mouvement MAGA. Pour nous, c’est optimal: Fico est de gauche, Trump est de droite, et il n’accepte pas les gauchistes.
Cette rencontre pourrait être une percée — mais dans la fragile, volatile réalité de Trump, où il se comporte comme une figure de la mécanique quantique plutôt que comme en physique classique. Le monde sombre dans le chaos, qui exige une pensée rapide. L’inconstance de Trump n’est pas une folie, mais une logique d’un autre ordre. La psychanalyse révèle des scripts dans le chaos. Pour une action efficace, il faut une diplomatie quantique — comme Poutine l’a dit à Valdai — qui prend en compte les boucles rétroactives d’Edgar Morin. La résolution d’un problème en crée un autre — économique, idéologique ou religieux. Poutine gère ce chaos avec brio, suivant un algorithme complexe orienté vers la consolidation de la puissance, de la souveraineté et vers un monde multipolaire. Ses mouvements semblent non linéaires, mais ont du sens pour ceux qui les perçoivent. Trump est un chaos plus sauvage, mais lié à un algorithme. Une approche intégrée psychologique, idéologique et géopolitique pour le prochain rendez-vous pourrait le rendre fructueux. La convergence de Trump avec MAGA et avec nous donne naissance à l’idée d’un tunnel Alaska–Sibérie. La formuler, c’est déjà redessiner la carte du monde à l’ère de l’information.
D’un certain point de vue, c’est du trolling — mais dans notre époque, presque tout est du trolling. Nous vivons dans un monde rapide, superficiel, où la vérification des faits a disparu. Les mondialistes libéraux ont approprié ce terme : leurs intérêts sont des «faits», tout le reste est «fake» ou relève d'une «théorie du complot». La vérification des faits elle-même est devenue un faux. Les gens sont déconcertés; exposer les flux d’informations n’a plus d’importance. Le projet Alaska–Sibérie, lancé par Trump et repris par Poutine, commence à vivre sa propre vie. Qu’il soit réel ou non, cela importe peu. Il dissout le système mondialiste pour lequel un tel projet serait impensable. Une proposition d’un président américain, au cœur d’une guerre entre l’Occident et la Russie, pour une communication directe — cela sabote leur campagne informationnelle, comme l’a fait le sabotage du gazoduc Nord Stream en une forme matérielle, mais ici cela se passe dans l’imagination. À l’ère de l’information, l’imagination l’emporte sur la réalité.
Un jour, j’ai publié sur les réseaux sociaux une image générée par IA de Brigitte Macron comme une figure de type "Néandertal" sortant d’une grotte. Candace Owens l’a repostée, et maintenant cela figure dans un procès en France contre elle — une demande de 200 millions de dollars pour un repost. Où se trouve la frontière entre l’imagination et la réalité juridique? C’est un exemple de la philosophie de la complexité, des relations internationales quantiques.

Présentateur : Revenons au Moyen-Orient. Cessez-le-feu, accords, la guerre stoppée par Trump — tout cela n’existe plus. Israël continue de frapper et l’admet ouvertement, déclarant ironiquement: «Nous frapperons maintenant, lancerons une opération, puis reviendrons à la paix».
Alexandre Douguine: Les mêmes cycles courts se répètent. Trump a arrêté la guerre, est arrivé à la Knesset, a reçu des applaudissements, est reparti — et tout a été oublié. La guerre continue, les gens meurent comme si de rien n’était. Personne ne le remarque; ils tournent la page et passent au sujet suivant — disons, à Budapest. Dans ce monde, il n’y a pas de stabilité — ni paix, ni guerre, ni victoire, ni défaite. C’est un monde de cycles courts, de fragments, de clichés, de titres de journaux réarrangés dans un ordre aléatoire. Baudrillard a appelé cela la post-histoire — où le passé et l’avenir échangent leur place à travers des flux informationnels. Netanyahu enregistre de nouvelles frappes sur Gaza comme si c’étaient des anciennes — d’avant le cessez-le-feu — et tout le monde acquiesce. Nous vivons dans un monde de discours. La vérification des faits devient absurde — cela prend trop de temps ; les gens oublient. Il faut, comme faire du surf, chevaucher les vagues des campagnes d’information vers son propre objectif, sans se laisser distraire. Israël fait cela — et, hélas, avec succès — poursuivant une politique atroce qui coûte des milliers de vies humaines.
19:38 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, budapest, viktor organ, vladimir poutine, donald trump, hongrie, états-unis, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 28 octobre 2025
Fico appelle à la création d'un front slave contre la folie de l'UE

Fico appelle à la création d'un front slave contre la folie de l'UE
Source: https://x.com/SlavicNetworks
Le Premier ministre slovaque Robert Fico s'occupe de lancer ce qui pourrait devenir l'un des changements politiques les plus importants au sein de l'Union européenne depuis des années.
Il a proposé une nouvelle alliance entre la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, quatre nations d'Europe centrale, principalement slaves, qui partagent des liens culturels, historiques et économiques profonds.
Son objectif : mettre fin à ce qu'il appelle la « folie » de Bruxelles.
Qu'entend Fico par « folie de l'UE » ?
Le dirigeant slovaque affirme que l'UE a perdu le contact avec la réalité.
Selon lui, l'Union n'est plus une instance de coopération, mais de contrôle, forçant les nations à se plier à des expériences idéologiques et économiques qui nuisent à leurs citoyens.
Parmi les principales préoccupations :
- Le Green Deal et les taxes ETS2 : le nouveau système d'échange de quotas d'émission de carbone de Bruxelles rendra le carburant, les transports et le chauffage plus chers pour les citoyens ordinaires.
- Le pacte migratoire : les pays qui refusent d'accueillir des migrants pourraient se voir infliger de lourdes sanctions financières.
- La surréglementation et les sanctions: ce sont là les politiques de l'UE qui, selon les termes de Fico, « détruisent l'industrie européenne au nom de l'idéologie ».
Fico qualifie cela de « folie de l'Union »: des politiques élaborées par des technocrates non élus qui vivent confortablement à Bruxelles, tandis que les familles à travers l'Europe sont confrontées à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie.
Un appel à la création d'un « front slave »
L'idée de Fico n'est pas anti-européenne.
Il ne veut pas détruire l'UE, mais la rééquilibrer.
« Il est temps que l'Europe centrale défende son peuple, et non les bureaucrates de Bruxelles. »
Son projet consiste à relancer la coopération entre les pays du groupe de Visegrád (Slovaquie, Pologne, Hongrie, Tchéquie) et à promouvoir :
- Une politique énergétique réaliste
- Le respect de la souveraineté nationale
- La protection des industries et des traditions locales
- L'opposition aux réformes idéologiques imposées
Ensemble, ces quatre pays représentent plus de 60 millions d'habitants, soit une force considérable au sein de l'UE qui pourrait en redéfinir l'orientation.
Pourquoi est-ce important à l'échelle mondiale ?
Depuis des décennies, Bruxelles est dominée par les voix de l'Europe occidentale, principalement l'Allemagne et la France.
Aujourd'hui, les nations slaves et d'Europe centrale affirment qu'elles méritent elles aussi d'avoir leur mot à dire.
Ce mouvement reflète une tendance mondiale plus large :
- Des nations qui revendiquent leur souveraineté contre l'idéologie
- Des économies qui recherchent un équilibre entre environnement et survie
- Des cultures qui défendent leur identité contre l'uniformisation
Si elle aboutit, la proposition de Fico pourrait créer un nouveau centre de pouvoir en Europe, ancré dans les valeurs slaves de réalisme, de foi et de liberté.
19:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert fico, europe, actualité, slovaquie, europe centrale, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Coïncidence ou sabotage ? Des incendies dans des raffineries hongroises et roumaines soulèvent quelques questions

Coïncidence ou sabotage ? Des incendies dans des raffineries hongroises et roumaines soulèvent quelques questions
Source: https://www.freilich-magazin.com/welt/zufall-oder-sabotag...
En l'espace de quelques heures, deux raffineries de pétrole en Hongrie et en Roumanie ont été secouées par des explosions. Les autorités s'interrogent encore sur la cause. La coïncidence temporelle rend la situation politiquement explosive.
Lundi 20 octobre, deux incidents graves se sont produits en l'espace de quelques heures dans deux raffineries d'Europe de l'Est. En Hongrie et en Roumanie, des installations ont été touchées par des explosions et des incendies. Deux groupes ayant des liens avec la Russie sont concernés: le géant hongrois de l'énergie MOL et la filiale roumaine de Lukoil.
Raffinerie fermée pour maintenance
Vers 11h30, une explosion s'est produite sur le site de la raffinerie Petrotel-Lukoil à Ploiești, en Roumanie. Selon les médias roumains, l'installation était hors service au moment de l'explosion en raison de travaux de maintenance. La détonation aurait eu lieu dans la zone où se trouve l'installation industrielle qui traite les eaux usées. Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête, mais aucune cause officielle n'a encore été établie.
Incendie dans la raffinerie hongroise MOL
Quelques heures seulement après l'incident en Roumanie, un événement similaire s'est produit en Hongrie. Un incendie s'est déclaré dans la raffinerie MOL de Százhalombatta, l'un des principaux nœuds du réseau de stations-service en Europe centrale et orientale. L'installation traite le pétrole brut provenant de l'oléoduc russe Droujba. Selon les informations fournies par le gouvernement hongrois, l'incendie a pu être maîtrisé mardi matin. La cause exacte n'est pas claire.
Comme les deux événements se sont produits à peu de temps d'intervalle, les spéculations sur d'éventuels actes de sabotage se multiplient. Comme le rapporte le portail Hungarian Conservative, les événements donnent lieu à de telles suppositions. Les autorités officielles ne se sont pas encore exprimées à ce sujet.
L'UE prévoit de se passer de l'énergie russe
Les observateurs soulignent que ces incidents se sont produits le jour même où les ministres de l'Énergie de l'UE se sont mis d'accord sur un calendrier visant à mettre fin aux importations d'énergie russe d'ici 2028. Dans le même temps, Kiev exerce une pression croissante sur des pays comme la Hongrie pour qu'ils mettent fin à leur dépendance au pétrole russe. L'Ukraine a déjà attaqué à plusieurs reprises les infrastructures énergétiques russes par le passé, ce qui alimente les spéculations sur le contexte géopolitique des incidents récents.
Informations non confirmées en provenance de Slovaquie
De plus, le portail CZnews a signalé mercredi un incendie dans la raffinerie de Bratislava exploitée par le groupe MOL, qui traite du pétrole brut russe via l'oléoduc Droujba. Cependant, ces informations n'ont pas été confirmées par les autorités officielles, comme l'a annoncé CZnews dans une mise à jour.
18:53 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hongrie, roumanie, europe, affaires européennes, oléoducs, raffineries de pétrole, pétrole, hydrocarbures, sabotage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le Japon se réveille à la Tradition

Le Japon se réveille à la Tradition
Moscou voit une nouvelle voie alors que le Japon passe d’un déclin libéral à une consolidation sur base de ses valeurs ancestrales
Alexander Douguine
Alexander Douguine voit le tournant du Japon sous Sanae Takaichi comme un réveil civilisateur qui pourrait aligner Tokyo avec la Russie dans la révolte mondiale contre le libéralisme.
Le Japon a élu sa première femme Premier ministre — Sanae Takaichi. Son élection constitue un signe politique très sérieux.

Partout dans le monde, l’idéologie libérale s’effondre. Dès le début des années 1990, elle avait dominé la politique, l’économie et la culture — presque sans rencontrer d'opposition. Pourtant, après trente-cinq ans de règne ininterrompu, le libéralisme est arrivé à une exhaustion totale. Ses principes fondamentaux — universalité des droits de l'homme, la notion de « fin de l’histoire » (Fukuyama), le principe de l’identité individuelle, la woke culture, l’idéologie transgenre, l’immigration illégale, et le multiculturalisme — ont échoué à l’échelle mondiale.
Les libéraux étaient sur le point de prendre le contrôle de toute l’humanité; aujourd’hui, le libéralisme et le mondialisme s’effondrent partout. La Russie, la Chine, l’Inde, le monde islamique, les pays africains et l’Amérique latine — unis dans le BRICS — se sont levés précisément contre ce programme. L’élection de Donald Trump a été le premier grand coup porté à l’hégémonie libérale: dès son premier jour au pouvoir, il a rejeté les dogmes fondamentaux du projet libéral, y compris l’activisme LGBT et transgenre, ainsi que l’idéologie de la Critical Race Theory — celle du racisme anti-blanc qui avait envahi l’éducation et la culture occidentales. Tout ce paquet a été rejeté par la majorité de l’humanité non-occidentale, et maintenant aussi par l’Amérique elle-même. Seule l’Union européenne reste la dernière forteresse de ce pandémonium, bien que tous ses États membres ne partagent pas encore les mêmes convictions.
Il n’est donc pas surprenant que le paradigme libéral ait également disparu au Japon — longtemps considéré comme un pays intégré dans le monde occidental centré sur l’Amérique. À l’instar des Etats-Unis trumpistes, le Japon a élu une femme qu’on peut qualifier de « Trumpiste » — ou peut-être de «Trumpiste japonaise ». Sanae Takaichi incarne des valeurs traditionnelles: elle voit le mariage comme une union entre un homme et une femme, elle trouve normal que les femmes prenant le nom de leur mari après le mariage, et vise le « zéro immigration » — ce qui signifie que les migrants illégaux et légaux devraient être expulsés du Japon.

Takaichi appelle à un retour à la foi shintoïste, à une réaffirmation du culte impérial, et à la renaissance du bouddhisme traditionnel. Elle visite régulièrement le sanctuaire dédié aux morts de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, défiant ouvertement les récits libéraux sur le passé du Japon. En substance, elle prône la restauration de la souveraineté militaire et politique du Japon. Il est frappant que la première femme Premier ministre ait autrefois joué de la batterie dans un groupe de heavy metal. Cette femme remarquable — une ancienne batteuse de métal — mène désormais la renaissance de l’esprit samouraï, des valeurs traditionnelles, du culte impérial, de la religion shintoïste, et du culte de la déesse du soleil Amaterasu, ancêtre de la lignée impériale.
C’est rien de moins qu’une révolution conservatrice au Japon, qui se déroule sous nos yeux. Le parti bouddhiste modéré Komeito s’est retiré de la coalition de gouvernement avec le Parti libéral-démocrate maintenant dirigé par Mme Takaichi. Pourtant, elle a mobilisé une autre force — le Parti de l’innovation japonaise (Ishin no Kai), encore plus à droite et conservateur.
Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour nous ? Idéologiquement, c’est positif. La Russie aussi revient à des valeurs traditionnelles — aux idéaux de l’Empire, de l’Orthodoxie et de l’identité nationale. C’est notre tendance, comme c’est le cas en Amérique et de plus en plus dans le monde entier. Le Japon, qui se dresse aujourd'hui contre le libéralisme, ne fait que rattraper le reste de l’humanité, qui se débarrasse rapidement de toute la pourriture de l’idéologie libérale.
L’Union européenne reste le dernier bastion du déclin, de la dégénérescence et de la sénilité politiques — mais probablement pas pour longtemps. Le Japon, en revanche, rejoint les rangs des pays fondés sur des valeurs traditionnelles. La Russie appartient à ce même camp, ce qui crée un terrain fertile pour le dialogue.

Parallèlement, le Japon reste néanmoins bien ancré dans le cadre de la politique étrangère américaine. Sa militarisation croissante signifie qu’il adoptera une ligne plus agressive dans la région du Pacifique. La Russie et le Japon ont une longue et difficile histoire commune — à commencer par la guerre russo-japonaise du début du 20ème siècle, lorsque Tokyo, après la restauration Meiji, s’était orienté vers les États-Unis. Cela pourrait présenter un certain risque pour la Russie.
Pourtant, cette nouvelle orientation du Japon est un défi encore plus grand pour la Chine — un autre géant du Pacifique, et ami proche ainsi que partenaire de la Russie. C’est pourquoi la restauration de relations normales avec un Japon récemment redevenu traditionaliste — et désormais idéologiquement plus proche de nous — ne doit pas se faire au détriment de notre partenariat qu'est la Chine, notre principal allié et partenaire fondamental .
Cependant, si nous voyons dans Sanae Takaichi — cette « batteuse d'esprit samouraï » — quelqu'un qui amorce un véritable mouvement vers la Russie et qui preste un effort sincère pour atteindre la souveraineté stratégique du Japon, c’est-à-dire vise à se libérer du contrôle direct du pays par les Américains, alors nous aurons une bonne base pour discuter. La Russie pourrait établir une relation bilatérale avec le Japon basée sur des intérêts mutuels. Nous pourrions même agir en tant que médiateurs de la paix dans le Pacifique, aidant nos amis chinois à passer de la confrontation à une forme de coopération en Asie de l’Est. En tant que grande puissance pacifique, la Russie pourrait jouer un rôle important dans cette transformation.

Il est encore trop tôt pour dire ce que la gouvernance de cette exceptionnelle figure du Japon — qui incarne l’essence symbolique de la déesse Amaterasu — apportera. Mais, quoi qu'il en soit, son arrivée au pouvoir marque un moment remarquable dans l’histoire du Japon. Et peut-être, sous cette nouvelle « Déesse Amaterasu », la Russie pourra établir des relations constructives, tournées vers l’avenir, et multipolaires avec le Japon — des relations basées sur les plans idéologique, civilisationnel et géopolitique — en harmonie avec notre alliée et partenaire la plus chère, la grande Chine, où les valeurs traditionnelles prévalent également.
Au fait, les valeurs traditionnelles triomphent aussi dans la belle Corée du Nord — contrairement à ce qui se passe en Corée du Sud, pays qui demeure l’un des bastions de la décadence libérale. J’espère cependant que ce ne sera que temporaire, et que la Corée retrouvera son unité et sera alors véritablement coréenne. Il faut aussi se rappeler qu’il existe de profondes tensions entre la Corée et le Japon.
En résumé, la Russie a maintenant une chance de réinitialiser ses relations avec le Japon sur la base d’un retour commun aux valeurs traditionnelles. Voyons ce que cela donnera.
17:19 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, actualité, japon, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


