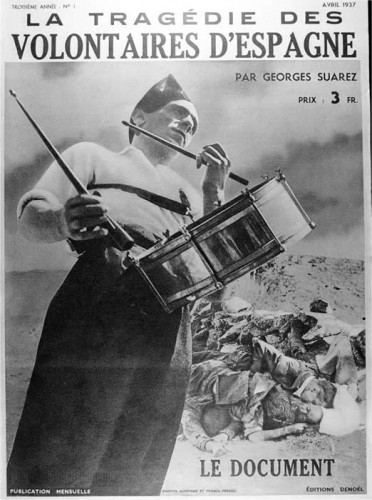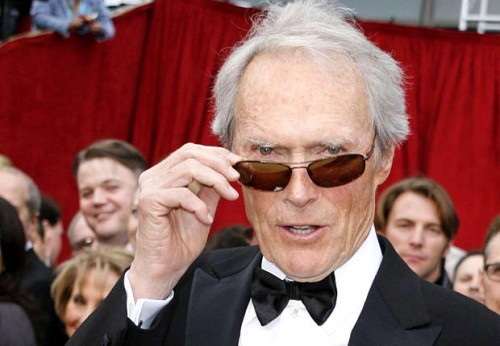Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/
Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/samedi, 07 mars 2009
Année 2008 : l'effondrement du modèle individualiste
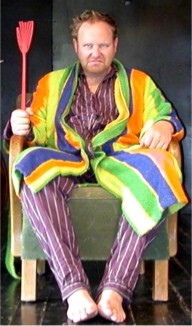
Année 2008 : l’effondrement du modèle individualiste [1]
Par Olivier Carer
La faillite de Lehman Brother le 15 septembre 2008 et l’écroulement du frauduleux château de cartes Madoff auront signifié pour l’ordre marchand ce que l’effondrement des Tours jumelles du World Trade center représenta pour l’Empire états-uniens.
Le krak mou qui aspira en quelques mois l’adiposité des fortunes les plus installées, de même que la déconfiture des usuriers ou la ruine de leurs malheureux clients ont scellé la fin du mythe de l’argent facile fondé sur une pyramide spéculative, sur des montages financiers incompréhensibles ou même souvent sur des manipulations mirobolantes. L’immoralité des spéculateurs névrotiques, la perversité de systèmes de rémunérations des traders ou des banquiers, la complaisance d’agences de notation consanguines ont accompagné la généralisation d’agissements collectifs illégaux pour lequel le médiatique Kerviel servit un temps de bouc émissaire utile.
Mais cette analyse technique de la crise de l’automne 2008, somme toute assez classique, ne laisse apparaître que l’écume de la vague. Car sous les soubresauts boursiers, un mouvement tellurique de grande ampleur ébranle tout un système de valeurs. C’est une véritable déflagration à laquelle nous assistons. Elle vient saper les fondements d’un ordre marchand que le vaticinateur Jacques Attali décrivait avec une provocante délectation dans sa « Brève histoire de l’avenir ».
La bataille de l’homme invisible avec lui même
Avec un à-propos salvateur, une intelligence invisible est venue menotter « la main invisible du marché » et faire sortir de ses rails la globalisation marchande et la financiarisation de l’économie qui se voulaient inéluctables. Ce déraillement de la locomotive mondialiste a surtout renvoyé à la figure d’une élite mondiale anthropocentrée qui a cru pouvoir revendiquer le meurtre de Dieu, les règles de l’ordre naturel.
La revanche du réel
L’économie qui relève moins d’une science prédictive que d’une méthode d’analyse de phénomènes passés, feint depuis peu d’opportunes indignations !
Comment réclamer 12% de rendement garanti lorsque la richesse effectivement produite ne dépasse pas 3%? Comment les banques ont-elles pu s’écarter des règles prudentielles en acceptant d’investir dans un système de titrisations risquées enrobé dans une opacité entretenue ? Pourquoi aucun organisme de contrôle privé ou étatique n’est intervenu comme régulateur d’un petit monde financier devenu fou ? Comment professer qu’un prêt puisse être accordé au delà des capacités propres de remboursement de l’emprunteur? Comment les états ont-ils pu croire que l’overdose de crédits allait pouvoir masquer indéfiniment l’érosion du pouvoir d’achat des ménages ? Comment imaginer un seul instant que la planète pouvait supporter la généralisation du modèle de consommation américaine pour les milliards d’humains à venir?
Le retour sur terre est effroyable. L’univers « champagne» où les financiers naviguaient dans un océan de liquidités et de bulles, s’est brutalement asséché. Les bulles boursières, du crédit, de l’immobilier, et récemment celle des matières premières ont explosé faisant de nombreuses victimes. On ne peut dépenser que la richesse que l’on a réellement créée. On ne peut engager nos économies que sur des risques que l’esprit humain est capable de mesurer. On ne peut rembourser qu’avec des revenus effectifs et non supposés car personne n’est riche de crédits garrotteurs. Enfin, la terre ne peut satisfaire la promesse mondialiste de l’accès à un salut de l’homme ici-bas par la consommation planétarisée. Dans un monde purement matérialiste où le seul moteur collectif est la consommation, lorsque le mirage des écrans plats et des gadgets informatiques qui servait de but ultime de la vie s’évapore, il ne reste rien que le désarroi. En 1951, l’économiste François Perroux proclamait déjà avec justesse: « les biens les plus précieux et les plus nobles dans la vie des hommes, l’honneur, la joie, l’affection, le respect d’autrui, ne doivent venir sur aucun marché ».
La revanche du grégaire
La conception d’un monde « nomade », du règne de la jouissance éphémère et immédiate qu’avec Bernard Attali, les mondialistes appelaient de ses vœux sombre dans le grand tourbillon bancaire et financier. Nous vivons le discrédit d’un paradigme cosmopolite qui annonçait l’avènement de l’homme nouveau « libéré » de ses attaches territoriales, historiques ou identitaires et devait voir la naissance d’un être de consommation, ne vivant que pour lui, n’agissant que pour satisfaire son égocentrisme, ne connaissant de loyauté qu’envers ses propres intérêts.
En cette fin d’année, cette utopie dangereuse rejoint le communisme au cimetière des idéologies cannibales.
Ce cataclysme bienfaisant qui balaye « le nouvel ordre mondial » devenu subitement ancien, déverrouille les portes d’un monde qui situe l’homme dans sa communauté et dans la chaine des générations. L’hétéronomie a désormais vocation à effacer progressivement la tyrannie de l’autonomie qui reconnaissait à l’homme un droit absolu de s’affranchir de tout mode de pensée héritée, de toute référence à une norme collective. Dans une économie qui ne doit être une fin en soi, ce mouvement rappelle à nous les valeurs des peuples sédentaires, celles des hommes qui construisent les murets de la montagne sur plusieurs générations pour eux-mêmes mais aussi pour leurs descendants. Refusant l’éphémère, le superficiel et l’individualisme prédateur, ils œuvrent dans la durée, dans le souci du futur et le respect de la nature.
Ce mouvement plein d’espoir pour l’avenir, vient donner à Barrès et à Péguy une nouvelle modernité.
Article printed from AMI France: http://fr.altermedia.info
URL to article: http://fr.altermedia.info/general/annee-2008-leffondrement-du-modele-individualiste_18822.html
URLs in this post:
[1] Image: http://fr.altermedia.info/images/olivier_carer51.jpg
00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : finance, usure, crise, individualisme, politique internationale, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L. F. Céline: la grande attaque contre le Verbe
Louis-Ferdinand Céline : La grande attaque contre le Verbe
Il faut, dit-il, sortir les phrases de leur sens usuel, d'un écart très léger comme on déplace une porte hors de ses gonds:
"Le style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, de les sortir des gonds pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens."
Ce "labeur" exige beaucoup de doigté. Céline enchaîne immédiatement sur sa "grande attaque contre le Verbe":
"Vous savez, dans les Ecritures, il est écrit : "Au commencement était le Verbe" Non! Au commencement était l'émotion..."
Tecniquement parlant, l'auteur décrit, par l'image, les procédés grâce auxquels il fait passer le langague parlé à travers l'écrit, pour atteindre, dit-il ailleurs, "cette espèce de prose versifiée (...) de dentelle" toute "en émotion et en violence" (1), un travail aussi "éreintant" que celui du médium en transe. Il faut gauchir, "tordre la langue tout en rythme, cadence, mots"(2). "C'est transposé dans le domaine de la rêverie entre le vrai et le pas vrai." (3)
Les gonds et la porte sont aussi un archétype très ancien. En posant son Verbe magique en rival de celui des Ecritures, Céline ne pouvait guère faire l'impasse sur ce point. L'idée d'axe du monde, de cycle, d'ouverture et de fermeture des portes solsticiales, tout ceci est contenu dans l'image de la porte et des gonds, nommés dans l'Antiquité par le même mot "cardo", d'où dérive le terme "cardinalis" servant à désigner les quatre directions de l'espace. Dans la symbolique romane les portes désaxées figurent une atteinte à l'âme du monde et à celle de l'homme. Le Christ, que l'Evangéliste désigne par le Verbe est dit "la Vraie Porte".
[...] La "grande attaque contre le Verbe" menée par Céline a bien d'autres finalités qu'un simple retour à la pureté des origines émotives du langage. Le métro célinien est tellement contre-nature que le colonel Réséda, à l'esprit si lent, finit par céder à la panique :
"il voit le métro sur le boulevard!... là, sur le boulevard Sébastopol!... il se cramponne... (...) Les rails!... qu'il crie, lui (...) traître! les rails!... il a dévissé tous les rails!... (...) au secours! au secours! (...) il a mis des soupirs partout!... monstre anarchiste!... vendu!... traître!... traître!..."
La vision n'est pas si délirante. Elle énonce le remède. Le colonel hurle:
"C'est le métro! (...) c'est le métro!" "Sauvez-moi! sauvez-moi tous!" "Un taxi pour l'amour de Dieu!"
Dans son accès de démence, Réséda propose une sortie du métro, au jour, il achète des fleurs, "les lys, les glaïeuls, les roses", véritable antidote. La fable ne saurait se contenter de cette fin : Réséda perd ses lys; hypocritement Céline les ramasse, mais le coeur n'y est pas :
"C'est vrai, il perdait ses fleurs!... (...) il en perd encore!... j'en ramasse..."
Récapitulons: Les Entretiens avec le Professeur Y constituent une véritable parabole de l'oeuvre célinienne, de ses tropismes, et de l'envoûtement qu'elle exerce sur le lecteur. L'auteur y livre rétrospectivement la théorie et la pratique de ses écrits, tout particulièrement leur phase "au noir" constituant sa grande période créatrice. Le renversement des valeurs diurnes, symboliquement la Surface - avec majuscule - la chute active, accélérée vers le "bout de la nuit" sont exprimés par la métaphore du métro Pigalle.
L'écrivain fera basculer ses fables pseudo-biographiques dans cet "Espace Pigalle" ainsi que toute la matière substancielle de ses romans.
Le choix dit Pascalien de Céline témoigne d'une sacralité inversive. Descendre au gouffre par le "Nord-Sud", à toute vapeur, s'y boucler avec les voyageurs en un trajet strictement nocturne analogue à la navigation des morts, signifie un renversement caractéristique de substitution de la nuit au jour. Telle est la politique qui sera celle de Céline dans Voyage au bout de la nuit, métaphoriquement et intuitivement comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, puis, bien plus tard, consciemment dans les Féerie dont les allégories offrent un véritable florilège de tous les gestes de l'Oeuvre au noir, première époque célinienne.
Les Entretiens considèrent l'état mental des voyageurs-lecteurs entraînés dans l'abîme : vivre dans les ténèbres substituées au jour sous la dictature du magicien-inventeur-ferroviaire est une situation inviable, à plus forte raison si l'auteur réussit, comme il l'a fait dans Voyage, à faire passer pour naturelle cette chute aux enfers. Céline ajoute dans un entretien avec A. Zbinden :
"Et pour tout avouer, si je me suis mis tant de gens à dos, l'hostilité du monde entier, je ne suis pas certain que ce ne soit pas volontairement. (...) Je me suis isolé, pour ainsi dire. Isolé, c'est pour être plus en face de la "chose".
[...] Il avait de quoi s'isoler volontairement face à la "chose", la redouter, lui attribuer tous les malheurs, estimer qu'ils remontent à Voyage, "le seul livre vraiment méchant" de sa carrière... (4) C'est peut-être dans cette magie noire du Verbe qu'il faut chercher le trouble que Céline inspire. C'est peut-être la perversité, le malaise, la délectation du pacte forcé avec la nuit que certains lecteurs lui pardonnent le moins.
Source : Denise Aebersold, Goétie de Céline, SEC, 2008.
Notes
1- Lettre de Céline au Dr Camus du 24 mai 1950, citée par P. Alméras, in Dictionnaire Céline, pp 802-803.
2- Lettre du 16 avril 1947 à Milton Hindus.
3- Entretien avec Claude Sarraute, Le Monde, 1/6/1960, Cahiers Céline 2.
4- Préface à une réédition de Voyage au bout de la nuit, 1949.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lettres, littérature, littérature française, lettres françaises, france, philosophie, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
F. M. Dostojevski: "Duivels"
Fjodor Michailovitsj Dostojevski, ‘Duivels’ (2008)
Cédric Raskin
Te traag, te weinig actie en te moeilijk: altijd een makkelijk excuus om in luie momenten een zware Dostojevski links te laten liggen. Niet zo met deze frisse nieuwe editie van ‘Boze geesten’. Met maar liefst dertien doden (als we goed hebben geteld) is dit verhaal zowat het bloederigste van alle Dostojevski’s. En door de universele tijdloze thematiek blijft deze roman, een van de literaire hoogtepunten van de wereldliteratuur, ook nu nog brandend actueel.
Een en ander is ook te danken aan de uitstekende vertaling van Hans Boland. Eindelijk eens een vertaler die doorheeft dat de Russen elkaar dan wel aanspreken met alle mogelijke vadersnamen en koosnaampjes, maar dat die patroniemen voor ons, Vlamingen en Nederlanders, alleen maar verwarrend overkomen. Dus heeft hij de vrijheid genomen om alle personages consequent bij dezelfde naam te noemen - met uitzondering van de pedante verfransingen om het taalgebruik van de aristocratische klasse te parodiëren -, en daar zijn wij allerminst rouwig om.
Een andere spectaculaire ingreep van Boland is dat hij ‘Boze geesten’ of ‘De demonen’ voor het eerst herdoopt tot ‘Duivels’. Helemaal geen slechte titelkeuze als je de psychologie van het hoofdpersonage Nikolai Stavrogin onder de loep houdt. Als een echte Mefistofeles is Stavrogin de duivel in eigen persoon die enkele andere anarchistische en nihilistische jongeren ophitst om de revolutie voor te bereiden en zo de rust te verstoren in een vredig doorsnee Russisch provinciestadje. Zo krijgt het kleinburgerlijke wereldje vol hypocrisie, schijn en praalzucht een flinke uppercut die op zich nog aardig uit de hand loopt…
Revolutie, daar draait het om. Als blijkt dat die enkel kan worden bereikt door terrorisme als conditio sine qua nonvan politiek extremisme, is het niet verwonderlijk dat de meest controversiële schrijver uit Rusland met ‘Duivels’ ook zijn meest controversiële roman aflevert. Dat de duivelse opstandelingen en onevenwichtige socialisten ook daadwerkelijk zijn opgestaan zo’n halve eeuw nadat Dostojevski dit in 1873 op papier zette, geeft het boek ook een opvallend hoog profetisch karakter mee en draagt dankbaar bij tot de mythe.
Maar hoewel ‘Duivels’ op het eerste gezicht vooral een politieke roman lijkt, is het religieuze en filosofische debat over het bestaan van God minstens even sterk uitgewerkt. Dostojevski’s werk wemelt van intellectuelen met psychische stoornissen en dat is ook hier weer geen uitzondering. Zo is naast Stavrogin de vurige ongelovige Kirilov ongetwijfeld een van de merkwaardigste figuren. Gekweld door de vraag of er al dan niet een God bestaat, of dat hij die God zélf is, neemt hij het zekere voor het onzekere en pleegt hij zelfmoord om volledig vrij te zijn. Ook de constante psychische tweestrijd van de crimineel Stavrogin, de chef-duivel Pjotr Verchovenski of de moordenaar Raskolnikov is ronduit geniaal. Je zou voor minder beginnen twijfelen aan de geestelijke gezondheid van Dostojevski zelf, die zo’n scherp vermogen heeft om zich in te leven in het brein van wrede moordenaars…
Wie Russische literatuur zegt, hoeft niet te rekenen op een snel tempo. De Russen hebben en nemen hun tijd. Begint het verhaal wat te vlotten, dan haalt Dostojevski het tempo al te graag onderuit door zijsprongen te maken en dieper te graven in de psyche van zijn personages. Is dat niet echt je ding, laat het boek dan nog even in de rekken rijpen. Genoot je wél van pakweg ‘De gebroeders Karamazov’, ‘Misdaad en straf’ of ‘Schuld en boete’, dan zal dit verduiveld sterke meesterwerk zeker niet misstaan in je bibliotheek.
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres russes, littérature russe, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Qui a peur de la géopolitique?

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1994
Qui a peur de la géopolitique?
Un spectre hante l'Europe d'aujourd'hui. Des conseillers politiques de la Maison Blanche, d'anciens agents du KGB cherchant à se recycler, des publicistes libéraux défendant de troubles et occultes intérêts réactionnaires, des professeurs gauchistes amateurs de liaisons dangereuses avec les droites, tentent désespérément d'en trouver la trace. Ce spectre, c'est la géopolitique.
Eh oui, elle revient au grand galop, cette géopolitique condamnée à une damnatio memoriae depuis la fin de la seconde guerre mondiale, dont on a nié la validité sans lui permettre de se défendre et d'apporter les preuves de sa pertinence, que l'on a réduite au silence pendant toute la guerre froide qui avait imposé au monde une lecture strictement idéologique et socio-économique des conflits. Pour satisfaire au rituel du langage dominant, il fallait dire qu'elle était une “pseudo-science”, fondée par deux pères historiques: l'embarrassant Friedrich Ratzel, auteur, entre 1882 et 1991, d'une Anthropogeographie évolutionniste et déterministe (que l'on a longtemps considérée comme l'antécédent wilhelmien du racisme hitlérien) (1), et le général, diplomate et érudit Karl Haushofer, qui avait caché Rudolf Hess dans sa maison après le putsch raté de Munich en 1923 et dont le fils, poète ésotérique, fidèle, comme son père, à l'idée d'une alliance nord-européenne entre l'Allemagne et l'Angleterre, sera massacré par la police nazie le 23 avril 1945 à l'âge de 42 ans.
Les noms de Ratzel et de Haushofer ont servi à démoniser la géopolitique, considérée pendant trop longtemps comme une “fausse science”, dont le but aurait été de chercher le rapport existant entre les circonstances géographiques d'un pays et les choix politiques du peuple qui l'habite. Mais force est bien de noter que les géopolitiques de Ratzel et de Haushofer, en réalité, ont constitué une géographie politique fonctionnelle, à l'ère des grands impérialismes et des entreprises coloniales, entre 1870 et 1914, quand ont eu lieu les affrontements entre la France et l'Allemagne, entre l'Autriche et la Russie, entre la Russie et la Turquie.
En cela, plutôt que d'être une rupture par rapport au passé, les grands impérialismes ont montré qu'ils étaient les héritiers directs des conflits du 19ième et de l'idéologie évolutionniste: «La géographie est une donnée immuable qui conditionne la vie des peuples» aimait à dire le condottiere Mussolini, oubliant ainsi l'autre aspect du problème: les peuples manipulent et modifient très souvent les scenarii géographiques.
Même si sont encore bien ancrés tous les “a priori” idéologiques mis en place pour interpréter les conflits selon un schéma “scientifique”, mettre au rencart les “vieilleries” ethniques et religieuses, légitimer l'unique mode explicatif toléré, c'est-à-dire celui qui évoque la raison socio-économique, depuis la fin de la guerre froide, bon nombre de signes avant-coureurs nous annonçaient le retour de conflits qui ne pouvaient s'expliquer que par d'autres motivations que celles que retenait comme seules plausibles le conformisme idéologique. Mieux: rien n'est revenu et un fait est certain, les tensions et les conflits à caractère ethnique et religieux ont toujours existé, rien n'est venu les atténuer, au contraire, les retombées tumultueuses du colonialisme et de l'hégémonisme européens les ont exaspérés. Il suffit de penser au Kurdistan qui, par l'effet de la politique de containment forcenée qu'ont pratiquée les Anglais et les Français au Moyen-Orient entre 1917 et 1920, est devenu un facteur de déstabilisation. Ou à la “guerre oubliée” entre l'Irak et l'Iran, et à ses rapports complexes avec la guerre civile en Afghanistan, ou encore, au front composite de la résistance afghane en lutte contre l'Armée Rouge.
Les temps sont mûrs, pourtant, pour dresser l'ébauche d'une nouvelle géopolitique, comprise non plus comme une “science” ou une “pseudo-science” mais plutôt comme une méthode proprement interdisciplinaire —dans laquelle convergeraient la géographie, l'histoire, la politologie, l'anthropologie, etc.— visant à comprendre et à expliquer rationnellement les tensions à l'œuvre sur certains territoires. Cette méthode se distancierait bien entendu de toutes les formes de moralisme, sans pour autant observer une “neutralité axiologique” rigide et incapacitante: cette méthode existe, elle a déjà été hissée au niveau scientifique, elle a été forgée au milieu des années 70 par les animateurs de la revue parisienne Hérodote et par le groupe de chercheurs rassemblés autour du géographe Yves Lacoste. En Italie, un groupe d'intellectuels de gauche vient de fonder la revue Limes (titre schmittien!) et s'aligne sur Hérodote; à ce corpus géopolitique de base, qui, sous bien des aspects, constitue une “anthropopolitique” (ou une “géoanthropologie”?), le célèbre philosophe Massimo Cacciari propose d'ajouter une fascinante “géophilosophie de l'Europe”, dont il a jeté les fondements en publiant un livre chez l'éditeur Adelphi. L'Europe, à ses yeux, est une idée —et un continent— “malade” au sens nietzschéen, instable, incertain sur ses confins, qui ne peut progresser qu'à coup de “décisions” fatidiques, un continent sur lequel pèse le poids d'innombrables impondérables et d'hérédités mêlées, entrecroisées.
Les assises et la structure du monde pèsent évidemment sur le destin des hommes. Mais les hommes, à leur tour, posent des choix et imposent des géostratégies. Quand, en 1867, le gouvernement américain achète au gouvernement russe les terres de l'Alaska, le Secrétaire d'Etat William Seward déclare: «L'Océan Pacifique deviendra le grand théâtre des événements du monde... le commerce européen, la pensée européenne, la puissance des nations européennes sont destinés à perdre leur importance». C'est ainsi que les Etats-Unis ont lancé l'idée d'un “Occident”, non plus synonyme mais bien antonyme de l'idée d'“Europe”. Or, sur ce chapitre, un pas nouveau vient d'être franchi avec le sommet des pays du Pacifique tenu en novembre 1993 à Blake Island près de Seattle: on y a esquissé les grandes lignes d'une nouvelle stratégie américaine, visant à faire du Japon un “Extrême-Occident” et à recentrer sur le Pacifique une intense activité dirigée vers la Chine, le Japon et l'Australie, impliquant l'exploitation intensive des mers, des fonds marins, du sous-sol de l'Océan, afin d'acquérir des protéines (à partir du planton) ou d'exploiter de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz naturels.
Reste à savoir comment réagira le bloc “eurasiafricain” face à cette hégémonie nouvelle, à ce continent immense et richissisme qui va de l'Alaska à l'Australie et de la Chine à la Californie, qu'a parfaitement conceptualisé le bon génie du MIT (Massachussets Inbstitute of Technology), Noam Chomsky, qui prévoit un isolement définitif de l'Eurasie par rapport au “Centre de l'Empire” américain? Allons-nous vers un nouveau brigandage déterministe et planétaire, vers une nouvelle entreprise impérialiste qui, comme toutes les entreprises impérialistes, ne rougit pas en se définissant comme “nécessaire”?
Franco CARDINI.
(article extrait de L'Italia Settimanale, n°34/1994).
(1) Pour nuancer ce jugement et découvrir la grande variété de l'œuvre de Ratzel, cf. Robert Steuckers, «Friedrich Ratzel», in Encyclopédie des Œuvres philosophiques, PUF, Paris, 1992.
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, histoire, géopolitique, politique internationale, politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 mars 2009
Retour dans l'OTAN: Bayrou réclame un référendum
Retour dans l'Otan : Bayrou réclame un référendum
Le président du Modem François Bayrou a déclaré ce dimanche, lors du lancement de sa campagne pour les européennes, que le projet de réintégrer la France dans l'Otan, serait une "défaite" pour la France et l'Europe. Il juge que c'est aux Français de trancher cette question.
 François Bayrou, président du Mouvement Démocrate (MoDem), a qualifié dimanche 8 février de "défaite" pour la France et pour l'Europe le projet de réintégration de la France dans le commandement de l'Otan, défendu par Nicolas Sarkozy, jugeant qu'un tel sujet exigeait un référendum.
François Bayrou, président du Mouvement Démocrate (MoDem), a qualifié dimanche 8 février de "défaite" pour la France et pour l'Europe le projet de réintégration de la France dans le commandement de l'Otan, défendu par Nicolas Sarkozy, jugeant qu'un tel sujet exigeait un référendum.
Tout comme l'ancien premier ministre Dominique de Villepin, François Bayrou se dit opposé au retour de la France dans le commandement de l'Otan. Lors d'une conférence nationale du MoDem à Paris, il a demandé que le choix qui avait été fait en 1966 par le général de Gaulle, de quitter la structure militaire intégrée de l'Alliance atlantique, "ne soit pas bradé, pas jeté aux orties".
Une réintégration serait "un aller sans retour", a-t-il prévenu. "Parce qu'il n'est pas imaginable qu'un grand pays comme le nôtre, à chaque alternance, entre et sorte du commandement intégré".
"Un tel choix, aussi lourd, ne peut pas se faire par les autorités politiques seules, encore moins par le président de la République. Ce choix ne peut se faire que par un référendum du peuple français", a déclaré M. Bayrou, interrogé par la presse à l'issue de la réunion.
"C'est un changement de cap radical, qui porte atteinte au patrimoine historique et diplomatique de la France, et un tel choix ne peut pas se faire en catimini, simplement par entente au sein d'une majorité passagère. Il faut que ce soit une décision majeure du peuple français", a-t-il ajouté.
En réintégrant cette structure, "nous lâchons la proie pour l'ombre", a également déclaré M. Bayrou à la tribune. "En nous alignant, nous abandonnons un élément de notre identité dans le concert des nations, y compris dans le concert des nations européennes".
"C'est une défaite pour la France", et "c'est une défaite pour l'Europe", a-t-il affirmé. "Nous abandonnons une part de notre héritage, et nous l'abandonnons pour rien".
"Quand on est intégrés, on ne compte plus", a assuré le député des Pyrénées-Atlantiques. "On peut être indépendants en étant alliés, on ne peut pas être indépendants en étant intégrés".
L'ex-candidat à la présidentielle s'en est pris également au ministre de la Défense Hervé Morin, qui fut un de ses lieutenants du temps de l'UDF.
"Il a dit : 'il faut arrêter de barguigner'. Et il a ajouté: 'notre position d'indépendance aujourd'hui, elle est purement symbolique'", a cité M. Bayrou. "Innocent !" s'est-il exclamé. "On peut en dire des bêtises, en deux phrases!".
Le président Nicolas Sarkozy a fait un nouveau pas samedi, devant la conférence sur la sécurité de Munich (sud de l'Allemagne), vers un retour complet de Paris dans l'Otan.
Source : L'EXPRESS
13:59 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otan, france, atlantisme, occidentalisme, alliance atlantique, armées, défense |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Arabisch geld voor de Palestijnen?
Arabisch geld voor de Palestijnen?
Geplaatst door yvespernet
http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2009/03/arabieren_geen_cent_voor_pales.html
De Arabische landen beloofden 1,3 miljard dollar aan de Palestijnen, maar voorlopig heeft nog niemand een cent overgemaakt. De officiele lezing is dat Hamas en Fatah het niet eens zijn over de besteding van de gelden. De Arabische landen stonden na de Israelische invasie in de rij om in het openbaar te roepen dat ze hun broeders zouden steunen.

Maar nu het op betalen komt, verzandt de hele actie in vergaderingen. Morgen wordt er verder over gesproken in Egypte. Saoedie Arabie beloofde een miljard, Qatar 250 miljoen en Algerije 100 miljoen.
Zo kan ik mij ook de actie naar aanleiding van de tsunami herinneren. Toen gaven de Arabische landen hun moslimbroeders- en zusters ook maar een peuleschil. In het geval van Palestina beloven Arabische landen veel, maar laten zij liever de sociale problemen in hun land bestaan en gebruiken ze Israël als afleiding om het protest tegen de grote ongelijkheid in hun eigen landen stil te houden.
Met de hulp van de CIA e.d. houden Arabische landen ook gematigde bewegingen tegen die de landen willen hervormen. Op die manier hebben zij zelf de radikale moslims een voedingsbodem gegeven, vaak hebben ze die radikale moslims ook actief gesteund. Willen we de moslimterroristen tegenhouden, dan is het dringend tijd om te werken aan een alternatief voor de huidige corrupte regimes. Want het is wel héél triestig gesteld als een racistische staat als Israël op het vlak van mensenrechten e.d. een palmares kan voorleggen dat op vele vlakken beter is dan de Arabische regimes…
00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : palestiniens, monde arabe, proche orient, moyen orient, méditerranée, palestine, israël |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
El postneoliberalismo y sus bifurcaciones

El neoliberalismo tocó fin definitivamente con la crisis estallada en 2008. No hay vuelta atrás. El mercado, por sí mismo, es autodestructivo. Necesita soportes y contenedores. La sociedad capitalista, arbitrada por el mercado, o bien se depreda, o bien se distiende. No tiene perspectivas de largo plazo.
Después de 30 años de neoliberalismo ocurrieron las dos cosas. La voracidad del mercado llevó a límites extremos la apropiación de la naturaleza y la desposesión de los seres humanos. Los territorios fueron desertificados y las poblaciones expulsadas. Los pueblos se levantaron y la catástrofe ecológica, con un altísimo grado de irreversibilidad, comenzó a manifestarse de manera violenta.
Los pueblos se rebelaron contra el avance del capitalismo bloqueando los caminos que lo llevaban a una mayor apropiación. Levantamientos armados cerraron el paso a las selvas; levantamientos civiles impiden la edificación de represas, la minería intensiva, la construcción de carreteras de uso pesado, la privatización de petróleo y gas y la monopolización del agua. El mercado, solo, no podía vencer a quienes ya estaban fuera de su alcance porque habían sido expulsados y desde ahí, desde el no-mercado, luchaban por la vida humana y natural, por los elementos esenciales, por otra relación con la naturaleza, por detener el saqueo.
El fin del neoliberalismo inicia cuando la medida de la desposesión toca la furia de los pueblos y los obliga a irrumpir en la escena.
Los cambios de fase
La sociedad capitalista contemporánea ha alcanzado un grado de complejidad que la vuelve altamente inestable. De la misma manera que ocurre con los sistemas biológicos (Prigogine, 2006), los sistemas sociales complejos tienen una capacidad infinita y en gran medida impredecible de reacción frente a los estímulos o cambios. El abigarramiento con el que se edificó esta sociedad, producto de la subsunción pero no eliminación de sociedades diferentes, con otras cosmovisiones, costumbres e historias, multiplica los comportamientos sociales y las percepciones y prácticas políticas a lo largo y ancho del mundo y abre con ello un espectro inmenso de sentidos de realidad y posibilidades de organización social.
La potencia cohesionadora del capitalismo ha permitido establecer diferentes momentos de lo que los físicos llaman equilibrio, en los que, a pesar de las profundas contradicciones de este sistema y del enorme abigarramiento que conlleva, disminuyen las tendencias disipadoras. No obstante, su duración es limitada. En el paso del equilibrio a la disipación aparecen constantemente las oportunidades de bifurcación que obligan al capitalismo a encontrar los elementos cohesionadores oportunos para construir un nuevo equilibrio o, en otras palabras, para restablecer las condiciones de valorización del capital. Pero siempre está presente el riesgo de ruptura, que apunta hacia posibles dislocamientos epistemológicos y sistémicos.
Los equilibrios internos del sistema, entendidos como patrones de acumulación en una terminología más económica, son modalidades de articulación social sustentadas en torno a un eje dinamizador u ordenador.
Un eje de racionalidad complejo que, de acuerdo con las circunstancias, adopta diferentes figuras: en la fase fordista era claramente la cadena de montaje para la producción en gran escala y el estado en su carácter de organizador social; en el neoliberalismo el mercado; y en el posneoliberalismo es simultáneamente el estado como disciplinador del territorio global, es decir, bajo el comando de su vertiente militar, y las empresas como medio de expresión directa del sistema de poder, subvirtiendo los límites del derecho liberal construido en etapas anteriores del capitalismo.
Los posneoliberalismos y las bifurcaciones
La incertidumbre acerca del futuro lleva a caracterizarlo más como negación de una etapa que está siendo rebasada. Si la modalidad capitalista que emana de la crisis de los años setenta, que significó una profunda transformación del modo de producir y de organizar la producción y el mercado, fue denominada por muchos estudiosos como posfordista; hoy ocurre lo mismo con el tránsito del neoliberalismo a algo diferente, que si bien ya se perfila, todavía deja un amplio margen a la imprevisión.
Posfordismo se enuncia desde la perspectiva de los cambios en el proceso de trabajo y en la modalidad de actuación social del estado; neoliberalismo desde la perspectiva del mercado y del relativo abandono de la función socializadora del estado. En cualquiera de los dos casos no tiene nombre propio, o es un pos, y en ese sentido un campo completamente indefinido, o es un neo, que delimita aunque sin mucha creatividad, que hoy están dando paso a otro pos, mucho más sofisticado, que reúne las dos cualidades: posneoliberalismo. Se trata de una categoría con poca vida propia en el sentido heurístico, aunque a la vez polisémica. Su virtud, quizá, es dejar abiertas todas las posibilidades de alternativa al neoliberalismo -desde el neofascismo hasta la bifurcación civilizatoria-, pero son inciertas e insuficientes su fuerza y cualidades explicativas.
En estas circunstancias, para avanzar en la precisión o modificación del concepto es indispensable detenerse en una caracterización de escenarios, entendiendo que el espectro de posibilidades incluye alternativas de reforzamiento del capitalismo -aunque sea un capitalismo con más dificultades de legitimidad-; de construcción de vías de salida del capitalismo a partir de las propias instituciones capitalistas; y de modos colectivos de concebir y llevar a la práctica organizaciones sociales nocapitalistas.
Trabajar todos los niveles de abstracción y de realidad en los que este término ocupa el espacio de una alternativa carente de apelativo propio, o el de alternativas diversas en situación de coexistencia sin hegemonismos, lo que impide que alguna otorgue un contenido específico al proceso superador del neoliberalismo.
El posneoliberalismo del capital
Aun antes del estallido de la crisis actual, ya eran evidentes los límites infranqueables a los que había llegado el neoliberalismo. La bonanza de los años dorados del libre mercado permitió expandir el capitalismo hasta alcanzar, en todos sentidos, la escala planetaria; garantizó enormes ganancias y el fortalecimiento de los grandes capitales, quitó casi todos los diques a la apropiación privada; flexibilizó, precarizó y abarató los mercados de trabajo; y colocó a la naturaleza en situación de indefensión. Pero después de su momento innovador, que impuso nuevos ritmos no sólo a la producción y las comunicaciones sino también a las luchas sociales, empezaron a aparecer sus límites de posibilidad.
Dentro de éstos, es importante destacar por lo menos tres, referidos a las contradicciones inmanentes a la producción capitalista y su expresión específica en este momento de su desarrollo y a las contradicciones correspondientes al proceso de apropiación y a las relaciones sociales que va construyendo:
1. El éxito del neoliberalismo en extender los márgenes de expropiación, lo llevó a corroer los consensos sociales construidos por el llamado estado del bienestar, pero también a acortar los mercados. La baja general en los salarios, o incluso en el costo de reproducción de la fuerza de trabajo en un sentido más amplio, fue expulsándola paulatinamente del consumo más sofisticado que había alcanzado durante el fordismo.
La respuesta capitalista consistió en reincorporar al mercado a esta población, cada vez más abundante, a través de la producción de bienes precarios en gran escala. No obstante, esta reincorporación no logra compensar ni de lejos el aumento en las capacidades de producción generadas con las tecnologías actuales, ni retribuir las ganancias esperadas. El grado de apropiación y concentración, el desarrollo tecnológico, la mundialización tanto de la producción como de la comercialización, es decir, el entramado de poder objetivado construido por el capital no se corresponde con las dimensiones y características de los entramados sociales. Es un poder que empieza a tener problemas serios de interlocución.
2. Estas enormes capacidades de transformación de la naturaleza en mercancía, en objeto útil para el capital, y la capacidad acumulada de gestión económica, fortalecida con los cambios de normas de uso del territorio y de concepción de las soberanías, llevaron a una carrera desatada por apropiarse todos los elementos orgánicos e inorgánicos del planeta. Conocer las selvas, doblegarlas, monopolizarlas, aislarlas, separarlas en sus componentes más simples y regresarlas al mundo convertidas en algún tipo de mercancía fue -es- uno de los caminos de afianzamiento de la supremacía económica; la ocupación de territorios para convertirlos en materia de valorización. Paradójicamente, el capitalismo de libre mercado promovió profundos cercamientos y amplias exclusiones. Pero con un peligro: Objetivar la vida es destruirla.
Con la introducción de tecnologías de secuenciación industrial, con el conocimiento detallado de genomas complejos con vistas a su manipulación, con los métodos de nanoexploración y transformación, con la manipulación climática y muchos otros de los desarrollos tecnológicos que se han conocido en los últimos 30 años, se traspasó el umbral de la mayor catástrofe ecológica registrada en el planeta. Esta lucha del capitalismo por dominar a la naturaleza e incluso intentar sustituirla artificialmente, ha terminado por eliminar ya un enorme número de especies, por provocar desequilibrios ecológicos y climáticos mayores y por poner a la propia humanidad, y con ella al capitalismo, en riesgo de extinción.
Pero quizá los límites más evidentes en este sentido se manifiestan en las crisis de escasez de los elementos fundamentales que sostienen el proceso productivo y de generación de valor como el petróleo; o de los que sostienen la producción de la vida, como el agua, en gran medida dilapidada por el mal uso al que ha sido sometida por el propio proceso capitalista. La paradoja, nuevamente, es que para evitar o compensar la escasez, se diseñan estrategias que refuerzan la catástrofe como la transformación de bosques en plantíos de soja o maíz transgénicos para producir biocombustibles, mucho menos rendidores y tan contaminantes y predatorios como el petróleo.
El capitalismo ha demostrado tener una especial habilidad para saltar obstáculos y encontrar nuevos caminos, sin embargo, los niveles de devastación alcanzados y la lógica con que avanza hacia el futuro permiten saber que las soluciones se dirigen hacia un callejón sin salida en el que incluso se van reduciendo las condiciones de valorización del capital.
3. Aunque el neoliberalismo ha sido caracterizado como momento de preponderancia del capital financiero, y eso llevó a hablar de un capitalismo desterritorializado, en verdad el neoliberalismo se caracterizó por una disputa encarnizada por la redefinición del uso y la posesión de los territorios, que ha llevado a redescubrir sociedades ocultas en los refugios de selvas, bosques, desiertos o glaciares que la modernidad no se había interesado en penetrar. La puesta en valor de estos territorios ha provocado una ofensiva de expulsión, desplazamiento o recolonización de estos pueblos, que, evidentemente, se han levantado en contra.
Esto, junto con las protestas y revueltas originadas por las políticas de ajuste estructural o de privatización de recursos, derechos y servicios promovidas por el neoliberalismo, ha marcado la escena política desde los años noventa del siglo pasado. Las condiciones de impunidad en que se generaron los primeros acuerdos de libre comercio, las primeras desregulaciones, los despojos de tierras y tantas otras medidas impulsadas desde la crisis y reorganización capitalista de los años setenta-ochenta, cambiaron a partir de los levantamientos de la década de los noventa en que se produce una inflexión de la dinámica social que empieza a detener las riendas sueltas del neoliberalismo.
No bastaba con darle todas las libertades al mercado. El mercado funge como disciplinador o cohesionador en tanto mantiene la capacidad desarticuladora y mientras las fuerzas sociales se reorganizan en correspondencia con las nuevas formas y contenidos del proceso de dominación. Tampoco podía ser una alternativa de largo plazo, en la medida que la voracidad del mercado lleva a destruir las condiciones de reproducción de la sociedad.
El propio sistema se vio obligado a trascender el neoliberalismo trasladando su eje ordenador desde la libertad individual (y la propiedad privada) promovida por el mercado hacia el control social y territorial, como medio de restablecer su posibilidad de futuro. La divisa ideológica del "libre mercado" fue sustituida por la "seguridad nacional" y una nueva fase capitalista empezó a abrirse paso con características como las siguientes:
1. Si el neoliberalismo coloca al mercado en situación de usar el planeta para los fines del mantenimiento de la hegemonía capitalista, en este caso comandada por Estados Unidos, en esta nueva fase, que se abre junto con la entrada del milenio, la misión queda a cargo de los mandos militares que emprenden un proceso de reordenamiento interno, organizativo y conceptual, y uno de reordenamiento planetario.
El cambio de situación del anteriormente llamado mundo socialista ya había exigido un cambio de visión geopolítica, que se corresponde con un nuevo diseño estratégico de penetración y control de los territorios, recursos y dinámicas sociales de la región centroasiática. El enorme peso de esta región para definir la supremacía económica interna del sistema impidió, desde el inicio, que ésta fuera dejada solamente en las manos de un mercado que, en las circunstancias confusas y desordenadas que siguieron al derrumbe de la Unión Soviética y del Muro de Berlín, podía hacer buenos negocios pero no condiciones de reordenar la región de acuerdo con los criterios de la hegemonía capitalista estadounidense. En esta región se empieza a perfilar lo que después se convertiría en política global: el comando militarizado del proceso de producción, reproducción y espacialización del capitalismo de los albores del siglo XXI.
2. Esta militarización atiende tanto a la potencial amenaza de otras coaliciones hegemónicas que dentro del capitalismo disputen el liderazgo estadounidense como al riesgo sistémico por cuestionamientos y construcción de alternativas de organización social no capitalistas. Sus propósitos son el mantenimiento de las jerarquías del poder, el aseguramiento de las condiciones que sustentan la hegemonía y la contrainsurgencia. Supone mantener una situación de guerra latente muy cercana a los estados de excepción y una persecución permanente de la disidencia.
Estos rasgos nos llevarían a pensar rápidamente en una vuelta del fascismo, si no fuera porque se combinan con otros que lo contradicen y que estarían indicando las pistas para su caracterización más allá de los "neos" y los "pos".
Las guerras, y la política militar en general, han dejado de ser un asunto público. No solamente porque muchas de las guerras contemporáneas se han enfocado hacia lo que se llama "estados fallidos", y en ese sentido no son entre "estados" sino de un estado contra la sociedad de otra nación, sino porque aunque sea un estado el que las emprende lo hace a través de una estructura externa que una vez contratada se rige por sus propias reglas y no responde a los criterios de la administración pública.
El outsourcing, que se ha vuelto recurrente en el capitalismo de nuestros días, tiene implicaciones muy profundas en el caso que nos ocupa. No se trata simplemente de privatizar una parte de las actividades del estado sino de romper el sentido mismo del estado. La cesión del ejercicio de la violencia de estado a particulares coloca la justicia en manos privadas y anula el estado de derecho. Ni siquiera es un estado de excepción. Se ha vaciado de autoridad y al romper el monopolio de la violencia la ha instalado en la sociedad.
En el fascismo había un estado fuerte capaz de organizar a la sociedad y de construir consensos. El estado centralizaba y disciplinaba. Hoy apelar al derecho y a las normas establecidas colectivamente ha empezado a ser un disparate y la instancia encargada de asegurar su cumplimiento las viola de cara a la sociedad. Ver, si no, los ejemplos de Guantánamo o de la ocupación de Irak.
Con la reciente crisis las instituciones capitalistas más importantes se han desfondado. El FMI y el Banco Mundial son repudiados hasta por sus constructores. Estamos entrando a un capitalismo sin derecho, a un capitalismo sin normas colectivas, a un capitalismo con un estado abiertamente faccioso. Al capitalismo mercenario.
El posneoliberalismo nacional alternativo
Otra vertiente de superación del neoliberalismo es la que protagonizan hoy varios estados latinoamericanos que se proclaman socialistas o en transición al socialismo y que han empezado a contravenir, e incluso revertir, la política neoliberal impuesta por el FMI y el Banco Mundial. Todas estas experiencias que iniciaron disputando electoralmente la presidencia, aunque distintas entre sí, comparten y construyen en colaboración algunos caminos para distanciarse de la ortodoxia dominante.
Bolivia, Ecuador y Venezuela, de diferentes maneras y con ritmos propios, impulsan políticas de recuperación de soberanía y de poder participativo, que se ha plasmado en las nuevas Constituciones elaboradas por sus sociedades.
La disputa con el FMI y el Banco Mundial ha determinado un alejamiento relativo de sus políticas y de las propias instituciones, al tiempo que se inicia la creación de una institucionalidad distinta, todavía muy incipiente, a través de instancias como el ALBA, el Banco del Sur, Petrocaribe y otras que, sin embargo, no marcan una pauta anticapitalista en sí mismas sino que apuntan, por el momento, a constituir un espacio de mayor independencia con respecto a la economía mundial, que haga propicia la construcción del socialismo. Considerando que, aun sin tener certeza de los resultados, se trata en estos casos por lo menos de un escenario posneoliberal diferente y confrontado con el que desarrollan las potencias dominantes, es conveniente destacar algunos de sus desafíos y paradojas.
1. Para avanzar en procesos de recuperación de soberanía, indispensable en términos de su relación con los grandes poderes mundiales --ya sea que vengan tras facetas estatales o empresariales--, y para emprender proyectos sociales de gran escala bajo una concepción socialista, requieren un fortalecimiento del estado y de su rectoría. Lo paradójico es que este estado es una institución creada por el propio capitalismo para asegurar la propiedad privada y el control social.
2. Los procesos de nacionalización emprendidos o los límites impuestos al capital transnacional, pasándolo de dueño a prestador de servicios, o a accionista minoritario, marca una diferencia sustancial en la capacidad para disponer de los recursos estratégicos de cada nación. La soberanía, en estos casos, es detentada y ejercida por el estado, pero eso todavía no transforma la concepción del modo de uso de estos recursos, al grado de que se estimulan proyectos de minería intensiva, aunque bajo otras normas de propiedad. Para un "cambio de modelo" esto no es suficiente, es un primer paso de continuidad incierta, si bien representa una reivindicación popular histórica.
3. El reforzamiento del interés nacional frente a los poderes globales o transnacionales va acompañado de una centralización estatal que no resulta fácilmente compatible con la plurinacionalidad postulada por las naciones o pueblos originarios, ni con la idea de una democracia participativa que acerque las instancias de deliberación y resolución a los niveles comunitarios.
4. Las Constituyentes han esbozado las líneas de construcción de una nueva sociedad. En Bolivia y Ecuador se propone cambiar los objetivos del "desarrollo" por los del "buen vivir", marcando una diferencia fundamental entre la carrera hacia delante del desarrollo con la marcha horizontal e incluso circular del buen vivir, que llamaría a recordar la metáfora zapatista de caminar al paso del más lento. La dislocación epistemológica que implica trasladarse al terreno del buen vivir coloca el proceso ya en el camino de una bifurcación societal y, por tanto, la discusión ya no es neoliberalismo o posneoliberalismo sino eso otro que ya no es capitalista y que recoge las experiencias milenarias de los pueblos pero también la crítica radical al capitalismo. Los apelativos son variados: socialismo comunitario, socialismo del siglo XXI, socialismo en el siglo XXI, o ni siquiera socialismo, sólo buen vivir, autonomía comunitaria u horizontes emancipatorios.
Ahora bien, la construcción de ese otro, que genéricamente podemos llamar el buen vivir, tiene que salirse del capitalismo pero a la vez tiene que transformar al capitalismo, con el riesgo, siempre presente, de quedar atrapado en el intento porque, entre otras razones, esta búsqueda se emprende desde la institucionalidad del estado (todavía capitalista), con toda la carga histórica y política que conlleva.
El posneoliberalismo de los pueblos
Otro proceso de salida del neoliberalismo es el que han emprendido los pueblos que no se han inclinado por la lucha electoral, fundamentalmente porque han decidido de entrada distanciarse de la institucionalidad dominante. En este proceso, con variantes, se han involucrado muchos de los pueblos indios de América, aunque no sólo, y su rechazo a la institucionalidad se sustenta en la combinación de las bifurcaciones con respecto a la dominación colonial que hablan de rebeliones larvadas a lo largo de más de 500 años, con las correspondientes a la dominación capitalista. Las naciones constituidas en el momento de la independencia de España y Portugal en realidad reprodujeron las relaciones de colonialidad interna y por ello no son reconocidas como espacios recuperables.
La resistencia y las rebeliones se levantan a veces admitiendo la nación, más no el estado, como espacio transitorio de resistencia, y a veces saltando esta instancia para lanzarse a una lucha anticapitalista-anticolonial y por la construcción-reconstrucción de formas de organización social simplemente distintas.
Desde esta perspectiva el proceso se realiza en los espacios comunitarios, transformando las redes cotidianas y creando condiciones de autodeterminación y autosustentación, siempre pensadas de manera abierta, en interlocución y en intercambio solidario con otras experiencias similares.
Recuperar y recrear formas de vida propias, humanas, de respeto con todos los otros seres vivos y con el entorno, con una politicidad libre y sin hegemonismos. Democracias descentradas. Este es el otro camino de salida del neoliberalismo, que sería muy empobrecedor llamar posneoliberalismo porque, incluso, es difícil de ubicar dentro del mismo campo semántico. Y todos sabemos que la semántica es también política y que también ahí es preciso subvertir los sentidos para que correspondan a los nuevos aires emancipatorios.
Lo que viene después del neoliberalismo es un abanico abierto con múltiples posibilidades. No estrechemos el horizonte cercándolo con términos que reducen su complejidad y empequeñecen sus capacidades creativas y emancipatorias. El mundo está lleno de muchos mundos con infinitas rutas de bifurcación. A los pueblos en lucha toca ir marcando los caminos.
Bibliografía
Acosta, Alberto 2008 "La compleja tarea de construir democráticamente una sociedad democrática" en Tendencia N° 8 (Quito).
Prigogine, Ilya 2006 (1988) El nacimiento del tiempo (Argentina: Tusquets).
Constitución de la República del Ecuador 2008.
Asamblea Constituyente de Bolivia 2007 Nueva Constitución Política del Estado (documento oficial)
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : théorie politique, sciences politiques, libéralisme, politologie, néo-libéralisme, globalisation, mondialisation, monétarisme, crise, finances |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Verkiezingen: De Periodieke Supersoap
Verkiezingen: De Periodieke Supersoap
 Het begin van weer eens een verkiezingsronde in dit land is volop begonnen. Dat is niet te merken aan de lawine ideeën en ideologische inzichten door het politieke profitariaat naar onze hoofden geslingerd. Neen, het is alleen te merken aan hoe de kopstukken van de respectieve partijen zichzelf aan het verkiezen zijn om zo zichzelf en hun naaste vrienden (of familieleden) op topplaatsen te wringen. Dat noemen die politieke creaturen dan de eerste stap in een democratisch proces: "Hoe wring ik mezelf op een verkiesbare plaats?" Het is meteen een van de belangrijkste fasen van de partijwerking geworden als men de kranten erop naleest.
Het begin van weer eens een verkiezingsronde in dit land is volop begonnen. Dat is niet te merken aan de lawine ideeën en ideologische inzichten door het politieke profitariaat naar onze hoofden geslingerd. Neen, het is alleen te merken aan hoe de kopstukken van de respectieve partijen zichzelf aan het verkiezen zijn om zo zichzelf en hun naaste vrienden (of familieleden) op topplaatsen te wringen. Dat noemen die politieke creaturen dan de eerste stap in een democratisch proces: "Hoe wring ik mezelf op een verkiesbare plaats?" Het is meteen een van de belangrijkste fasen van de partijwerking geworden als men de kranten erop naleest.
Alle nieuwkomers hebben daarbij zo te zien een snelcursus genomen in hoe de oude militanten beter een valse stoot te verkopen. En "Hoe schop ik tijdens lijstvorming een medestander in de vernieling?" is haast uitgeroepen tot een olympische discipline, in zoverre dat die nog niet verheven is tot de enige politieke activiteit die partijkopstukken in het parlementaire circus beoefenen. Die kunst bestaat er ook in (met name voor de slapjanussen die in de partijen tweede viool spelen) zich zo geruisloos mogelijk te verstoppen achter de tapkast van de parlementaire bar en dat liefst gedurende de volledige legislatuur. Het enige wat de ja-knikkers binnen de partijen moeten doen is kijken hoe de kop beweegt van hun voorman. Ze moeten dan vooral hun kop in dezelfde richting bewegen als die verlichte leiders. Dat is alleszins een succesformule die de meeste parlementairen behoorlijk onder de knie hebben. In platbroekerij zijn die parlementairen behoorlijk geschoold. En na een tijdje is niks doen en je vol vreten op kosten van de gemeenschap een tweede natuur geworden voor dat politiek personeel van de tweede garnituur. De bazen, die de grote partijen exploiteren als een soort veredelde bordelen, waar verkozenen zich openlijk prostitueren, zijn dan ook maar wat gewillig om die ongevaarlijke nullen rond zich te tolereren en hun zelfs een mooie carrière in ruil voor bewezen diensten aan te bieden. Inderdaad, politieke hoeren, je moet ze huren en betalen, en ze woekeren meestal in achterkamertjes en louche cafés.
Voor de kopstukken is het van het grootste belang om zichzelf aan te top van de lijsten te plaatsen, want dat is de enige manier om aan de geldpomp van het systeem te kunnen blijven hangen. Al hun mooie manieren en praatjes moeten verbergen dat ze er gewoon op uit zijn weer een periode van vaste vergoedingen en staatsgegarandeerd inkomen te verwerven. En maak je geen illusies: de Dewevers en de Dewinters zijn ook niet te beroerd zichzelf te verkopen om die smerige Belgische euro's van de Belgische staat in hun vette pootjes te nemen. Geld heeft geen naam, en in Europa heeft het zelfs geen volk dat dat beheert of controleert, maar wie maalt daar nu om? Toch zeker niet de bijna slimste mens en de - op Dedecker na - luidruchtigste? De partijbonzen kijken met bewondering naar iemand als Rudy Aernoudt, hoe deze man zich een weg knort en wroet om ook in de troch te geraken is gewoonweg bewonderenswaardig. Bij zo iemand herkennen ze de fijne kneepjes van het vak!
Terwijl het volk in een steeds vlugger tempo aan het verarmen is en ons economisch en sociaal stelsel zowat implodeert, hebben die partijfeestneuzen zichzelf weer goed in de kijker gezet. Voor het N-SA is deze hele verkiezingbedoening echter een non-event en men zou het beter de 'pak-de-poen show voor onbenullen en maatschappelijk gestoorden' noemen, uitgezonden in een format met Walter Grootaers. Daar hebben die politieke clowns toch al een pak ervaring mee. Zolang er geen hervormingen van het politiek bestel op de agenda staan, is elke verkiezing nutteloos en waardeloos. Het is een bestendiging van het profitariaat, met als enige bedoeling weer enkele jaren een vaste wedde zonder werken binnen te halen. Het zijn parasieten in een parasitair systeem.
U zult deze smeerlapperij toch niet verder ondersteunen met uw goedkeuring in de vorm van een stem? Ik in elk geval niet.
Eddy Hermy
Hoofdcoördinator N-SA
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : électoralisme, élections, belgique, flandre, wallonie, europe, affaires européennes, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
"Continente Indiano" - Entre Nomos y Anomos
| |
00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, amérique latine, amérique du sud, amérique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Lucien Combelle

Lucien Combelle
...Voici bientôt quinze ans qu’il nous a quittés. Je n’ai dû le rencontrer qu’une ou deux fois, rue Monge où il habitait alors. C’était en compagnie de Laurence Granet qui avait soutenu, quelques années auparavant, une thèse de doctorat sur « L’idéologie fasciste dans les œuvres de Brasillach, Drieu La Rochelle, Rebatet ». Le souvenir de ces conversations s’est effacé. Je me souviens seulement du jour où, en public, il évoqua, au risque de lui nuire, son « éditeur fasciste » [sic] qui publia au début des années quatre-vingts ses souvenirs de prison. Cette sortie ne fut pas sans choquer un ami célinien qui fit cette réflexion : « Tout de même, il exagère, c’est lui qui a été fasciste ! ». Longtemps, j’ai cru que, dans son journal Révolution nationale, il s’était montré partisan d’un fascisme « libéral », je veux dire moins radical que celui prôné par ses confrères de la presse parisienne. Jusqu’à cet été 1988 où, pour annoter la correspondance que lui adressa Céline sous l’Occupation, je dépouillai, à la Bibliothèque Royale (de Belgique), la collection complète de cet hebdomadaire. Comme l’a également montré Jeannine Verdès-Leroux, qui s’est livrée au même exercice, Lucien Combelle était, bien au contraire, partisan d’un collaborationnisme sans concessions. C’est dire si Vichy n’était pas ménagé, surtout quand le régime prenait l’initiative, approuvé en cela par l’Église, de censurer en zone non occupée des écrivains jugés délétères : « Valéry, Fargue interdits. Demain Gide et Proust. Et Céline et Marcel Aymé. Et Montherlant. La France officielle semble vouloir retrouver sa beauté en avalant la jouvence de l’abbé Soury, et soigner ses blessures avec de l’eau bénite »¹. On n’est donc pas étonné de le voir dénoncer ensuite l’une des plus hautes autorités du clergé français, « Mgr Gerlier, primat des Gaules – quelle fâcheuse consonance ! – qui se permet de jouer au conseiller d’État et se mêler aux affaires de César. Monseigneur n’aime point l’antisémitisme. Monseigneur n’est pas révolutionnaire. (…) Il est démocrate et pluraliste, comme on dit. Bref, Monseigneur est, à sa manière, un dissident » ². Fustigeant le chef de l’Action française, Combelle n’y allait pas davantage de main morte : « M. Maurras a été antisémite et antidémocrate pour son bonheur et pour le nôtre. Mais, pour son malheur et pour celui de la France, M. Maurras reste germanophobe. La France, pour lui, c’est le félibrige » ³. « Révolution » est sans doute le mot qui revient alors le plus souvent sous sa plume : « Nous sommes, ou les acteurs, ou les témoins, selon une bonne ou une mauvaise fortune, d’une révolution mondiale, d’une révolution qui est née très exactement sur notre continent, dans cette Europe qui, pour notre orgueil, continue à étonner le monde » 4. « Grand garçon, intelligent, très cultivé, avec l’esprit caustique, bon avec les copains, plutôt désagréable avec ceux qui lui avaient fait dans les bottes, Combelle cultivait une pointe de cynisme » 5 : c’est ainsi que le décrit Henry Charbonneau, venu, comme lui, de l’Action française.
Après la guerre, Lucien Combelle présentera naturellement un profil nettement moins tranché. Ainsi, lors de l’émission « Apostrophes » (1978), il évoqua le « jeune fasciste sincère, de bonne foi et naïf » qu’il fut. C’est seulement chez le juge d’instruction, ajouta-t-il, qu’il découvrit ce qu’est la responsabilité des intellectuels. Philippe Alméras, qui l’avait rencontré, lui aussi, dans les années quatre-vingts, garde le souvenir de sa grande prudence : « Comme tous les ébouillantés de la Libération, il craignait l’eau froide 6 ». Céline entretint avec lui une relation du même type (un peu paternelle) que celle qu’il noua avec Henri Poulain, le secrétaire de rédaction de Je suis partout. D’une vingtaine d’années leur aîné, il ne craignait pas de les morigéner dès que paraissait dans leur journal respectif un article qu’il désapprouvait. Ainsi, à propos de cet éditorial sur (ou plutôt contre) Maurras : « Combelle fait l’enfant. Il sait aussi bien que moi l’origine de l’horreur de Maurras pour l’Allemagne – le Racisme 7. » Ou à propos d’un compte rendu du livre, Pétition pour l’histoire, d’Anatole de Monzie : « Tu dédouanes Monzie à présent et son histoire ? La merde est à ton goût ! Rien de plus pourri que ce vieux pitre – membre de la Ligue des Droits de l’Homme – membre de la Lica – grand ami de Lecache et Jean Zay ! » 8. Les exemples sont nombreux… Contrairement à Poulain, exilé en Suisse, Combelle reverra Céline. C’est seulement à la parution d’Un château l’autre qu’il reprit contact. « Tout ceci ne nous rajeunit pas ! » 9, lui répond Céline, une dizaine d’années après la tourmente qui les vit embastillés l’un à Copenhague, l’autre à Fresnes.
Marc LAUDELOUT
Notes
1. Lucien Combelle, « Avec ou sans prières », Révolution nationale, 22 août 1942.
2. Id., « Où en sommes-nous ? », Révolution nationale, 26 septembre 1942.
3. Id., « La France de M. Maurras », Révolution nationale, 31 mai 1942.
4. Id., « Ceci commande cela », Révolution nationale, 8 mai 1943.
5. Henry Charbonneau, Les mémoires de Porthos, La Librairie française, 1981 (rééd.).
6. Philippe Alméras, « Lucien Combelle relaps », Le Bulletin célinien, janvier 2006.
7. Lettre du 31 mai 1942 in L’Année Céline 1995, Du Lérot-Imec Éditions, 1996, p. 122.
8. Lettre du 21 août 1942, Ibidem, p. 127.
9. Lettre du 12 août 1957, Ibid., p. 154.
Bibliographie
Lucien Combelle est l’auteur de six livres : Je dois à André Gide (Frédéric Chambriand, 1951) ; Chansons du Mirador (Frédéric Chambriand, 1951) ; Prisons de l’espérance (ETL, 1952) ; Louis Renault ou un demi-siècle d’automobile française (La Table ronde, 1954) [signé d’un pseudonyme : Lucien Dauvergne] ; Péché d’orgueil (Olivier Orban, 1978) et Liberté à huis clos (La Butte aux cailles, 1983). Sous le titre « Céline, le pérégrin », il a préfacé un recueil de textes de Céline (Le style contre les idées, Complexe, 1987). Il a également écrit le scénario d’une bande dessinée de José Fernandez Bielsa, Quand les héros étaient des dieux (Dargaud, 1969). Au début des années 80, il avait l’intention d’écrire, en collaboration avec Laurence Granet, un Panorama des écrivains de l’Occupation ; le projet n’a pas abouti. En 1997, Pierre Assouline lui a consacré un livre, Le fleuve Combelle (Calmann-Lévy). L’année suivante, Lucien Combelle lui accorda une série de cinq entretiens dans le cadre de l’émission À voix nue sur les ondes de France-Culture (25-29 juillet 1998). Le 1er décembre 1978, à l’occasion de la parution de son livre de souvenirs, Péché d’orgueil, il participa – aux côtés de Henri Amouroux, Raymond Bruckberger, Jean-Luc Maxence et Dominique Desanti – à l’émission Apostrophes de Bernard Pivot sur le thème « Les intellectuels et la collaboration ». Il donna également son témoignage dans le film documentaire d’Alain de Sédouy et Guy Seligmann, Paris l’outragée (Antenne 2, 1989). On trouvera dans L’Année Céline 1995 (Du Lérot, 1996) la correspondance que lui adressa Céline, présentée et annotée par Éric Mazet. Plusieurs ouvrages retracent brièvement son itinéraire : Dictionnaire Céline de Philippe Alméras (Plon, 2004), Dictionnaire commenté de la Collaboration française de Philippe Randa (Jean Picollec, 1997) et Histoire de la Collaboration de Dominique Venner (Pygmalion, 2000). Sur son activité sous l’Occupation, on lira le livre de Jeannine Verdès-Leroux, Refus et violences. Politique et littérature à l’extrême droite des années trente aux retombées de la Libération (Gallimard, 1996), qui s’appuie sur une lecture de ses articles de l’Occupation.
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, france, années 30, années 40, épuration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le féodalisme, une légende?
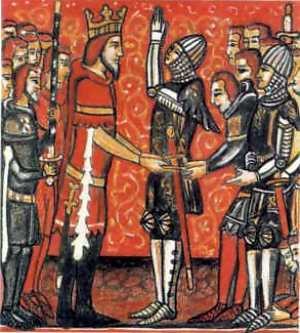
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1994
Le féodalisme, une légende?
L'historienne britannique Susan Reynolds avance une thèse innovatrice: le féodalisme médiéval n'aurait pas existé tel qu'on l'imagine communément; il serait une invention ultérieure de juristes modernes, hostiles au Moyen Age. La cérémonie symbolique, liant le vassal à son suzerain, n'est pas le fondement général, omniprésent en Europe, de l'Etat féodal, dominant notre continent de Charlemagne à la chute de Constantinople en 1453. Susan Reynolds affirme que les preuves sont trop peu nombreuses pour pouvoir affirmer sans nuances que l'ensemble du Moyen Age européen ait été marqué par ce type de contrat, fondé sur la fidélité et la dépendance réciproque. Cette affirmation, impertinente au regard de l'historiographie conventionnelle, notre historienne d'Oxford la tire d'une exploration systématique des documents, des actes, etc., conservés dans tous les musées et bibliothèques d'Europe.
Première révision, due à cette analyse systématique des écrits médiévaux: après l'Empire romain, l'Europe n'a pas sombré dans un “vide juridique” et n'a pas vraiment été livrée à la “loi de la jungle”. La réglementation féodale était conçue pour calmer les puissants, les obliger à respecter la paix et l'harmonie. Au départ, le lien de vassalité, liant par exemple un duc à son roi ou à son empereur, n'était pas conçu pour durer éternellement. Le principe de l'hérédité d'un fief n'avait pas été retenu. Charles le Chauve a dû finalement le concéder (mais partiellement) à sa noblesse franque pour calmer les esprits et pour s'assurer ses arrières quand il guerroyait en Italie entre 870 et 880.
La féodalité conçue comme système rigide est une invention des juristes du début de l'ère moderne, qui s'opposaient aux concepts vagues, souples et imprécis du droit coutumier. Il fallait donc qu'ils le schématisent et lui donnent une image négative. Cette construction artificielle de juristes en mal de pouvoir, poursuivant un objectif finalement totalitaire, visant à annihiler les autonomies multiples tolérées par le droit coutumier, a oblitéré la vision des historiens. Ceux-ci sont demeurés prisonniers d'une vision du Moyen Age figée, ne correspondant nullement à sa grande diversité et à son étonnante variété. L'omniprésence de cette légende, fabriquée par les juristes, a fait que les historiens n'ont plus pris la peine de consulter les archives. Susan Reynolds s'attend bien entendu à des critiques serrées de ses thèses, surtout de la part de l'école française de Marc Bloch, fidèle à la modernité des juristes, des jacobins et des idéologues marxistes. Mais cette modernité, plus idéologique que fiable, tiendra-t-elle le coup devant le sérieux d'Oxford, déployé par Susan Reynolds?
Susan REYNOLDS, Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford University Press, 544 p., £20.
00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : moyen-âge, féodalisme, histoire, traditions, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 05 mars 2009
Turkije en de Koerden
Turkije en de Koerden
Geplaatst door yvespernet
Wilt Turkije in de EU worden opgenomen als volwaardigd lid, moeten aan bepaalde sociale, economische en politieke voorwaarden worden voldaan. Met het toelaten van landen als Bulgarije is ondertussen gebleken dat dit voor sommige landen te snel gebeurd is en dat de controle op het naleven van die voorwaarden tekort schiet. Één van die voorwaarden, in het geval van Turkije, is het verbeteren van de huidige bewust achtergestelde toestand van de Koerden. Dat dit nog gebreken vertoont, kan volgend “incident” goed illustreren;
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/europe/02/24/turkey.television.kurdish.party/index.html
ISTANBUL, Turkey (CNN) — The head of a Kurdish nationalist party in Turkey addressed his party members Tuesday in the Kurdish language — which is illegal — prompting the national broadcaster to pull the plug on the live broadcast. In

his address, Democratic Society Party leader Ahmet Turk began his speech in Turkish, addressing the value of a “multilingual culture” and decrying the fact that the Kurdish language is not protected under Turkey’s constitution. ”We have no objection to Turkish being the official language, yet we want our demands for the lifting of the ban on Kurdish language to be understood as a humanitarian demand,” he said.
Turk then announced he would deliver the rest of his speech in Kurdish and, at that point, state broadcaster TRT cut the broadcast. ”Since no language other than Turkish can be used in the parliament meetings according to the constitution of the Turkish Republic and the Political Parties Law, we had to stop our broadcast,” the TRT announcer stated. “We apologize to our viewers for this and continue our broadcast with the next news item scheduled.”
Binnen nu en een paar decennia zal bijna de helft van de inwoners van Turkije bestaan uit Koerden. Koerden migreren ook meer en meer naar de Turkse steden in plaats van op het platteland te blijven. Dit kan wel eens een zeer gevaarlijke cocktail worden…
00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, kurdes, proche orient, moyen orient, méditerranée, politique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Bulletin célinien n°306
00:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
NATO Defence College reviews Dmitry Rogozin's book "Enemy of the People"
The NATO Defence College review of the book ‘Enemy of the People’ by Dmitry Rogozin
http://natomission.ru/en/society/article/society/artbews/...

The curious reader might do well to start Ambassador Dmitri Olegovich Rogozin’s book by looking at the comments about him which the author has chosen to include as an annex - essentially abuse from prominent Russian political figures, including the leader of the LDPR, Vladimir Zhirinovsky (whose father Rogozin pointedly identifies as being named Edelshtein): “Rogozin is an agent three times over - of the Kremlin, the KGB and the Comintern. He is a villain three times over.” Anatoli Chubais, formerly head of electricity monopoly RAO UES, and whom Rogozin identifies as the “spiritual guru” of the liberal SPS party and author of the concept of “voucher privatization”, describes Rogozin as a National Socialist. The author records other attacks on him by some of his favourite targets of abuse.
It would be natural to suppose that these quotations were recorded by Rogozin in a spirit of irony. It would also be wrong. There is so far as I could teil no trace of irony or self doubt in what Rogozin writes in this account of his political development and ideas. He means every word. It is natural enough that an autobiography should centre on its subject’s actions. This one is deeply personal. The only people mentioned in it who come out consistently well are Rogozin himself, and why not, for it is his story; Rogozin’s distinguished military father (General-Lieutenant Oleg Konstantinovich Rogozin, Hero of Socialist Work, Doctor of Technical Sciences and professor); and Vladimir Putin - who has yet to earn Rogozin’s despair. The introduction to the fourth edition of the book, sent for publication as Rogozin was about to take up his appointment as Russian Ambassador to NATO in January 2008, records his view that Rodina “won” the 2003 Duma elections (Rogozin’s word, presumably implying a moral victory since the party did not come near to winning a majority of the recorded votes, even if its showing was better than the Kremlin had anticipated). Since then, he says, vital elements of Rodina’s programme have been adopted by the Russian government. Putin’s real convictions, (page 5) says Rogozin, are those of the patriotic opposition. His book is dedicated to President Putin, as he then was.
The first set of Rogozin’s ideas would not al! be easy to square with Putin’s actions as President or Prime Minister, though some arguably have elements in common with Putin’s sentiments. Rogozin complains at various points in his book of the way that the media are constrained, the legal system is manipulated and elections are fixed. In so doing, he draws on personal experience. “The ability to lie to your face is the visiting card of power (vlast) today.” (An apt quotation from page 14). His writing is even more impassioned in his attacks on the “thieves” who have stolen, and steal, from Russia, whether bureaucrats or ‘oligarchs’. But then, “Bonapartism is always and everywhere partnered by stealing from the treasury…the consolidation of the Vertical of power’ has led to a real epidemic of theft.” Much of the book is a cry of pain for what has happened to Russia since Stalin’s death in 1953, and particularly since 1991, with the failure of the August putsch that year. Rogozin’s admiration for Stalin is for what the author sees as his success as a national leader who instilled discipline, not as the builder of’socialism in one country’.
The remedy sketched by Rogozin for Russia’s present ills is not what might be expected from his attacks on the way the present state of affairs rests on arbitrary controls. It is for the power of the centre to be increased, under the condition that the exercise of absolute power be governed by absolute responsibility, borne personally by the leader himself. He does not explain exactly what this might mean. He would no doubt be enraged by the suggestion that it is a doctrine that notorious figures of the middle of the 20th Century would instantly accept.
Rogozin argues for increased national ownership of critical economic factors. He does not explain how such a system could work, or how it would prevent what he sees as the treachery and incompetence which brought the USSR to needless and tragic collapse being repeated under another centrally directed government of Russia. His domestic policy prescriptions are however often declarative rather than analytical, for instance in his lengthy and agonised account of Russia’s demographic problems. Russia should be, he writes at one point, aiming at a population of 500 million, without giving a clear idea of how this degree of reproductive fervour could be brought about
That should not be read as a sneer. Rogozin’s despair at what he sees as his country’s fall deserves better than that. He records his academic achievements, but his book is not that of an educated sceptic. In one striking passage, following on Rogozin’s account of the Chechen mentality, he tells of an interview with Putin in which he offered to go to Grozny as Presidential Representative. The President’s response, which Rogozin saw as “very significant” was that Putin wanted him to stay for the time being in the Duma. That, thought Rogozin, was a missed opportunity. Had he taken charge in Grozny the bloodshed would have been minimal. It does not seem to have occurred to him that the President may have been less confident than Rogozin of the latter’s ability to sort things out Putin’s ability to keep others under the impression that he sympathises with their aspirations even when he does not is again illustrated at other points in Rogozin’s account.
The heart of Rogozin’s book, whether he is recording his efforts as a dogged and immovable defender of his country’s true interests, or setting out his political creed, is the need to revive Russian national feeling, and thereby to restore Russia to her rightful status, as he would see it, as a Great Power. He makes it very clear, though not in a consistently specific manner, that this aim entails Russia’s borders enlarging to include all the territories that have been hers over the course of Russian history. He refers on page 145 to the national idea enshrining the right for Russians to be the formers of the state not just in the present territory of the Federation but also “inherently Russian lands beyond its borders. Crimea, Little Russia, Belorussia, the Cossack steppes of Kazakhstan, TransDniestra, the PriBaltic - these are the native lands of the Russian nation.” Russians brought civilisation to the peoples who fell under her control, and they now share her destiny as a beneficent result. “It is inadmissible to remain silent while the country that gave you life is robbed and humiliated. If even a drop of Russian blood runs in our veins we should be readying ourselves to fight….It is on our bones that Europe prospers today” (page 443). And so on throughout the book- often.
Rogozin’s political programme is mystical rather than practical, despite the fact that he recounts his involvement in many of the political dramas over the last couple of decades of his country’s history. He vents his frustration at being balked of the success he is sure was his in Duma and Moscow elections. The administrative barriers in the way of setting up independent parties are excoriated. He nonetheless sees the revival and channeling of Russian nationalism as essential to the nation’s survival, and achievable through disciplined action by a committed elite. He seems to take it for granted that the restoration of true patriotic feeling, and the direction of affairs by true patriots, would restore harmony as well as greatness to his country, and that it would be thoroughly democratic too.
This is all disputable, and the*fenguage in which it is conveyed is in places disreputable too. But Rogozin’s book is honest in its efforts to convey what he really thinks, and innocent of guile. There are many other Russians, and decent ones too, that share his prejudices to a greater or lesser degree, and who reach too readily for the language of abuse when others do not accept them: a Pravda inheritance, maybe. Many Russians for instance seem genuinely to believe that they have a better sense of what other formerly Soviet people - and particularly those of Slavonic origin - truly want and need than what these people choose for themselves through their elected leaders. When Rogozin says that Sevastopol is “ours”, and that that is a “fact” (page 129), he is only giving more emphatic expression to a view that others of greater authority than he have set out more cautiously. When he laments the treatment accorded to Russia by her enemies, internal or external, he is giving his own version of the sense of national(ist)
grievance that has developed so strongly in recent years. There was a contrast to be drawn in the 90s between Serbia’s haunted sense of wrong and Russia’s efforts to make a new and post imperial start. The parallels between Serbian nationalism then and Russian feelings now, as illustrated by Rogozin’s book, can be uncomfortably close.
The aim of restoring, as its advocates term it, Russia’s status as a Great Power runs beyond the “patriotic opposition” invoked by Rogozin. It is deeply felt to be legitimate, and necessary, by Russians who are far more liberal in their outlook than Rogozin, and has been articulated in various forms by the highest leadership, including by the former and current Presidents. But while there is no doubting its emotional appeal to many Russians, if to few of their neighbours, Rogozin in his book has been no more able than others to set out exactly what it means. If Russia is a Great Power, then presumably there are others, and presumably they have parallel rights. No one knows exactly who these other “Great Powers” might turn out to be. It would also seem to follow that “Great Powers” have greater rights than lesser ones, a proposition that is contrary to the Charter of the United Nations, and unacceptable to those relegated to the second or perhaps third division. The aspiration to be recognised as a Great Power, which runs so clearly throughout Rogozin’s book, in short, is a lament for past glory to return, not a practical guide to policy. It is not however the less compelling for those who would pursue it because it is incapable of definition, or perhaps even of cure.
ON THE NATO DEFENCE COLLEGE REVIEW OF THE BOOK
‘ENEMY OF THE PEOPLE’ BY DMITRY ROGOZIN
The very fact that a major agency of NATO’s educational system got down to reading such an alien book dedicated to Russian domestic affairs means a lot. The author of the review has taken the reading seriously, and building upon his knowledge he made an attempt to analyze what was written by Dmitry Rogozin. There is no doubt that NATO is primarily interested in political views of the ambassador it is dealing with rather than Russian domestic policy as such.
It is quite another matter that it is a tough job for a Westerner to give a fair assessment of those views; the temptation to slide down to stereotypes (Putin as the sole ruler of the country, patriotic views as an extreme form of xenophobia, etc.) is too big. The author of the review attempts to disregard details about Russian domestic policy, however, he delightfully quotes Rogozin’s criticism of the Russian bureaucracy and in the end he reduces everything to the ‘favourite’ common denominator of Western analysts – that Russia is yet again aspiring to become an empire and a great power, while it lacks either rights or good reasons for that. In the author’s opinion, such an aspiration lacks “legitimacy”, and he notes that Rogozin is just one among many Russians who want to see their country regain its greatness. The author argues that allegedly there is no ‘cure’ for this concept that has basically become the ideology Russian policy is guided by. Apparently, neither is there a cure for the aspiration of the Westerners to not let Russia become a great country again, just as for any form of maniacal schizophrenia. He particularly bridles at Rogozin’s ideas of uniting inherently Russian lands, and the role of the Russian nation as a civilization factor triggers nothing more than an ironic smile.
Nevertheless, this review seems in general to be quite well balanced and serious. The author admires Rogozin’s sincerity and consistency, his concerns over the present situation in the country, even though the style he chooses does not always seem justified to the author.
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, otan, atlantisme, relations internationales, politique internationale, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Intervention de F. Ranson au Colloque identitaire (28-02-09)

Frédéric RANSON:
Intervention au colloque identitaire du 28 février 2009
Sint-Pieters-Leeuw (Brabant)
Il m’incombe aujourd’hui de vous présenter le manifeste du néo-solidarisme. En fonction du sujet d’aujourd’hui, j’en voudrais retenir deux idées en particulier, à méditer par le public. D’abord, je voudrais féliciter les organisateurs et les autres participants pour leur contribution à un genre de débat qu’on ne connaît plus ailleurs en Flandre, malgré des conditions plus favorables qu’en Belgique francophone. Des identitaires s’occupent aujourd’hui des questions sociales et c’est déjà une bonne description pour les néo-solidaristes.
En bref, la crise que nous vivons est celle de plus de trente ans de néolibéralisme anglo-saxon. L’architecture financière mondiale de l’après-guerre a toujours été conçue, par les Etats-Unis et leur haute finance, de telle manière que les profits soient pour eux-mêmes et les charges pour le reste du monde. Depuis les années septante, le néolibéralisme sert de nouvel instrument pour assurer leurs intérêts financiers. L’ouverture des marchés financiers a permis de prolonger l’hégémonie du dollar. Ensuite, suivaient le Royaume-Uni et plus tard l’Union européenne. La première conséquence était que les « capitaux sociaux » des Etats européens, accumulés depuis des décennies, étaient alors transférés à un marché financier mondialisé. La deuxième conséquence était l’invention des produits dérivés, contrepartie pour les risques sur un marché dérégulé. L’ampleur de la crise actuelle est un indice du degré d’américanisation et de mondialisation.
Il faut se rendre compte de quelle manière, non pas seulement les conditions économiques ou financières, mais par là aussi les conditions politiques ont changé. Oui, ils sont encore là, les parlementaires, mais ils sont presque dégradés jusqu’au niveau de conseiller communal dans le « village global ». Le cadre national, base de notre modèle social et du consensus entre travail et capital, est en voie de disparition, sapé par le néolibéralisme et le libre-échangisme. L’embourgeoisement des droites et des gauches les a rendu totalement incapables à proposer des alternatives. Face à leur incapacité et face aux nouvelles conditions, de nouvelles réponses s’imposent. La crise actuelle est une rupture. Ou bien on voit dans cette crise une nouvelle phase de concentration et de mondialisation. Ou bien on y voit une occasion d’organiser une colère légitime et de proposer des alternatives.
La première idée que je veux retenir de notre manifeste est donc celle de la renationalisation de l’Etat et de l’économie, tant l’économie monétaire que l’économie réelle, de Fortis à Opel. Dans les conditions actuelles, où vous étés trompés par des propositions européanistes et altermondialistes qui se relaient, où la pensée unique prône un « socialisme des banquiers » et ainsi de suite, cette revendication est déjà un acte révolutionnaire. La deuxième idée à retenir est celle de la souveraineté monétaire, qui implique une redéfinition des notions habituelles sur l’argent. J’y reviens en brève réponse à monsieur Robert. La synthèse idéale de ces deux idées serait la correspondance entre l’économie réelle et l’économie monétaire. Donc : plus de bulles, plus d’inflation, plus de déflation, mais « euflation » (notion d’Antonio Miclavez). Hélas, nos banques centrales semi-publiques n’ont pas ce but. Elles agissent dans l’intérêt des banquiers et pas dans l’intérêt des peuples. Les mêmes critiques, dans la tradition populiste, à la Réserve fédérale américaine peuvent s’appliquer à la Banque centrale européenne. Les premières banques à nationaliser seront donc les banques centrales elles-mêmes !
Monsieur Robert vient d’attribuer le « miracle économique » de l’Allemagne nationale-socialiste à son ministre de l’économie Schacht et sa « politique très éloignée du programme en 25 points ». D’autres l’attribueront à Keynes. Eh bien, quel était le secret de ce miracle ? Les travaux publics et le réarmement allemands étaient payés par des « bons Öffa » et des « bons MeFo », donc de l’argent alternatif ou supplémentaire, sans accroître la dette publique, c’est à dire basé sur la notion de souveraineté monétaire. Ces bons étaient au moins une idée hybride, parce que ils étaient effectivement déjà proposée dans le Programme en 25 Points sous le nom de « Staatskassengutscheine » (bons du Trésor publique). Evidemment, les idées de son auteur, Gottfried Feder, allaient encore plus loin. Ses idées étaient très proches des principes antiques et scholastiques, aujourd’hui encore présents dans le financement islamique. Schacht, profondément banquier, a enfin même refusé l’émission ultérieure de cet argent sans dette, ainsi qu’un autre célèbre banquier, Necker, plus d’un siècle avant lui, avait refusé l’émission des assignats. L’argent alternatif est-il une utopie aujourd’hui ? Non ! Qui ne connaît pas les chèques de repas ou les chèques de service, qui sont simplement des formes de salaire alternatif ?
Peut-être ces quelques propositions semblent encore précoces ou futuristes, mais nous sommes surs que la situation aggravante les rendra de plus en plus acceptées. L’importance est de ne surtout pas rater ce rendez-vous avec le 21ième siècle, ou de subir le renforcement du système par une « gouvernance mondiale » accrue et répandue par la pensée unique. Je vous remercie pour votre attention.
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mondialisation, globalisation, solidarisme, solidarité, finances, économie, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Guerre d'Espagne: mémoire historique ou mémoire hystérique?
Guerre d'Espagne : mémoire historique ou mémoire hystérique ?
Présenté sous un tel titre, l’article de Arnaud Imatz ne cache rien de son objet. On voit immédiatement où l’auteur veut en venir et c’est probablement une des raisons pour lesquelles la « Nouvelle Revue d’Histoire », dirigée par Dominique Venner, l’a publié.
Cette publication bimestrielle, taxée par la vulgate médiatique de non-conformisme au sens du politiquement correct historique, a déjà presque sept ans d’âge et recueille des signatures prestigieuses, plumes de marque, historiens et chercheurs de talent.
Dans la dernière livraison, Arnaud Imatz revient sur la toujours très controversée Guerre civile espagnole de 1936-1939, dont les plaies sont rouvertes périodiquement, et il nous fait découvrir comment les politiques de gauche espagnols se sont emparés de l’histoire, très exactement comme nos politiques, hélas de toute tendance à de rares exceptions près, l’ont si bien fait en France en 1990 avec la loi Gayssot. Les Espagnols se trouvent donc, eux aussi, affublés d’une loi outrageusement partisane dont on ne sera pas étonné de lire qu’elle trouve son origine dans une proposition du Parti communiste. Cette loi de « Mémoire historique » a été adoptée par les députés espagnols le 26 décembre 2007. Le lecteur ne sera pas surpris de trouver au détour de cette loi le célèbre juge Garzon, connu même sur le plan international puisqu’il a été l’initiateur du mandat d’arrêt lancé contre le général Pinochet : ce juge se consacre à corps perdu à la recherche des « criminels du camp national ». Enfin, là aussi, on assiste à une bataille de chiffres des victimes, décidément pomme de discorde éternelle et arme suprême de la propagande idéologique.
Cet article historico-politique est passionnant et il montre qu’en Espagne, tout comme dans une grande partie des pays appartenant à l’Union européenne, l’histoire est aujourd’hui confisquée par le pouvoir politique relayé par la justice, et donne lieu à l’intauration de « lois mémorielles » et à la judiciarisation du fait historique.
Polémia
Tous les historiens reconnaissent l’impressionnant développement économique et social de l’Espagne après la mort de Franco. Tous admirent l’exemple de transition démocratique pacifique et tolérante donné au monde par le peuple espagnol. Bien sûr, selon leurs convictions, les analystes s’affrontent : certains considèrent que ce processus s’étend de 1966 à 2004, d’autres soulignent l’importance de l’approbation de la Constitution de 1978, d’autres encore mettent en valeur l’arrivée au pouvoir de Felipe Gonzalez et du PSOE (1982), d’autres enfin insistent sur le retour de la droite de José Manuel Aznar (1996), mais tous reconnaissent la formidable et spectaculaire transformation du pays. Pendant près de trois décennies, deux principes ont animé « l’esprit de la transition » : le pardon réciproque et la concertation entre gouvernement et opposition. Il ne s’agissait pas d’oublier le passé (la conscience de l’histoire est au contraire une des conditions pour éviter de répéter les erreurs), mais de le surmonter, de regarder résolument vers l’avenir. On aurait pu penser qu’au fil des ans le calme et la sérénité se seraient imposés, que soixante dix ans après la fin de la Guerre civile les historiens se seraient adonnés enfin librement aux plaisirs tranquilles du champ de leur connaissance, mais il n’en est rien.
Depuis son accession au pouvoir, en 2004, plutôt que de contribuer à effacer les rancœurs, José Luis Rodriguez Zapatero, a délibérément choisi de raviver la bataille culturelle et de rouvrir les blessures du passé. Zapatero a expliqué en de nombreuses occasions comment la mémoire de son grand père, Juan Rodriguez Lozano, fusillé par les franquistes, a motivé ses convictions politiques. Une explication tronquée, quand on sait que son grand-père, qui fut exécuté par les troupes nationales, en 1936, pour avoir franchi leurs lignes dans un but d’espionnage, avait été aussi décoré, en 1934, pour avoir contribué à restaurer la légalité républicaine sous les ordres du général Franco et participé à cette occasion à la répression des mineurs d’Asturies. Mais le caractère monstrueusement fratricide de la guerre civile semble évacué par Monsieur Zapatero et son gouvernement.
On pourrait rappeler quelques exemples frappants et cruels comme celui des prestigieux écrivains, Antonio et Manuel Machado, qui se trouvaient chacun dans des camps différents, ou celui du dirigeant anarchiste Buenaventura Durruti dont les deux frères étaient phalangistes, ou encore celui de Constancia de la Mora, l’épouse communiste du général de l’aviation républicaine Hidalgo de Cisneros, dont la sœur Marichu était une journaliste phalangiste. Il serait inutile de s’acharner à répéter que la plupart des ministres de la démocratie espagnole, qu’ils soient de gauche ou de droite, ont des pères, des oncles et des grands-parents qui ont soutenu le régime franquiste. Tout cela, Monsieur Zapatero le sait. Le grand-père de son épouse, Sonsoles Espinosa, n’était-il pas lui aussi franquiste ? Mais le chef du gouvernement espagnol et son équipe n’en ont cure. La politique n’est pas le terrain de la morale, pas plus qu’il n’ait celui du droit ou de l’histoire.
Les raisons de la pugnacité du gouvernement socialiste espagnol sont essentiellement politiques. Il s’agit de donner quelques gages au parti communiste et à l’extrême gauche qui, depuis des décennies, cherchent invariablement à imposer leur vision unilatérale de l’histoire, et, par la même occasion, à condamner moralement la droite conservatrice pour l’écarter durablement du pouvoir.
Avec l’aide du député travailliste maltais, Léo Brincat, le 17 mars 2006, Zapatero a d’abord fait adopter par la commission permanente, agissant au nom de l’assemblée du Conseil de l’Europe, une recommandation sur « la nécessité de condamner le franquisme au niveau international ». Par la suite, il n’a eu de cesse de faire voter par le parlement espagnol une loi de « Mémoire historique » dont l’origine se trouve dans une proposition du Parti communiste (Izquierda Unida).
L’expression « mémoire historique » est devenue le lieu commun de la culture espagnole. L’effort de récupération de la mémoire historique n’est évidemment pas un mal en soi, mais encore faut-il qu’il ne soit pas un prétexte pour que les plus sectaires s’arrogent le droit de séquestrer l’histoire ou de la manipuler. On ne peut pas, en effet, comparer la récupération de la mémoire pour ressusciter la haine de l’autre avec la récupération de la mémoire pour rénover la fraternité et la concorde. Or, si la « loi de Mémoire historique », du 26 décembre 2007, reconnait et amplifie justement les droits en faveur de ceux qui ont pâti des persécutions ou de la violence pendant la Guerre civile et la dictature, elle accrédite une vision manichéenne de l’histoire et contrevient à l’éthique la plus élémentaire. « Le pire de la prétendue “mémoire historique”, déclare le prestigieux hispaniste américain Stanley Payne, ce n’est pas la falsification de l’histoire, sinon l’intention politique qu’elle renferme, sa prétention à fomenter l’agitation sociale. » (Congrès universitaire de Madrid du 5.11.2008).
Une des idées fondamentales de la « loi de Mémoire historique » est que la démocratie espagnole est l’héritage de la Seconde République. Un point de vue d’autant plus discutable que le processus de transition fut mené conformément aux mécanismes prévus par le régime de Franco et qu’il fut dirigé à la fois par un roi désigné par le généralissime et son premier ministre qui était l’ancien secrétaire général du Movimiento. Selon le raisonnement de la « mémoire historique », la Seconde République, mythe fondateur de la démocratie espagnole, aurait été un régime presque parfait dans lequel l’ensemble des partis de gauche auraient eu une action irréprochable. Pour couronner le tout, mettre en cause cette absurdité ne saurait être qu’une apologie exprès ou déguisée du fascisme.
Les anomalies de cette loi ne se comptent plus. Elle effectue un amalgame stupide entre le soulèvement militaire, la guerre civile et le régime de Franco qui sont autant de faits distincts relevant d’interprétations et de jugements différents. Elle exalte les victimes et les assassins, les innocents et les coupables lorsqu’ils sont dans le camp du Front populaire et uniquement parce qu’ils sont de gauche. Elle confond les morts en action de guerre et les victimes de la répression. Elle jette le voile de l’oubli sur toutes les victimes « républicaines » qui moururent aux mains de leurs frères ennemis de gauche. Elle encourage et justifie tout travail visant à démontrer que Franco à mener délibérément et systématiquement une répression sanglante pendant et après la guerre civile. Elle reconnait, enfin, le légitime désir de beaucoup de personnes de pouvoir localiser le corps de leur ancêtre, mais refuse ce droit à ceux qui étaient dans le camp national sous le prétexte fallacieux qu’ils ont eu tout le temps de le faire à l’époque du franquisme.
Après l’adoption de la loi de « mémoire historique » et les débats qui l’ont précédée, fin 2007, la boîte de Pandore est ouverte. Dès le 15 décembre 2006, diverses associations « pour la récupération de la mémoire », avaient déposé des plaintes auprès du Juge d'instruction de l’Audience nationale, Baltasar Garzón « pour détention illégale en vertu d'un plan systématique d'élimination physique de l'adversaire pendant la guerre civile (1936-1939) et les années de l'après-guerre, méritant le qualificatif juridique de génocide et de crime contre l'humanité ». L’Audience nationale est l’héritière directe du Tribunal de l'ordre public de la dictature franquiste qui fut supprimé en 1977. Le juge Garzón est un magistrat instructeur connu internationalement pour avoir lancé un mandat d’arrêt contre Augusto Pinochet. Il avait effectué une brève incursion dans la vie politique comme second sur la liste du parti socialiste de Madrid derrière Felipe Gonzalez. Dans une ordonnance, qui échappe à la logique de la procédure judiciaire et ne suit aucune méthodologie historique, Baltasar Garzón s’est déclaré compétent. Un magistrat instructeur se doit de diligenter une affaire à charge et à décharge. Lui, soutient une thèse. Lorsque les faits le gênent, il les écarte. La responsabilité et la cruauté de la guerre civile et des exactions retombent, selon lui, entièrement sur un seul camp. L’affaire est donc entendue ! Il n’y a pas à prendre en compte les crimes survenus pendant la IIème République, ni les crimes du Front Populaire. Et qu’on ne lui reproche pas d’avoir rejeté une plainte contre le communiste, Santiago Carrillo, un des principaux responsables du massacre de Paracuellos, en se fondant sur des arguments et une jurisprudence exactement inverses. La plainte contre le « prétendu » crime de Paracuellos (plus de 4000 morts) était, dit-il, « inconsistante » : les faits, avaient été jugés, les victimes avaient été identifiées (quand ?, où ?, comment ? il ne le précise évidemment pas !), en outre, ajoute-t-il, « ces faits n’attentaient en rien aux hautes autorités de la nation » !
Enfermé dans sa logique sectaire, Garzón n’a pas l’ombre d’une hésitation. Les vainqueurs, selon lui, ont porté atteinte à la légalité en s’insurgeant contre le Gouvernement de la République et ont eu le temps d’identifier leurs victimes et de demander réparations. Les vaincus, en revanche, n’ont jamais pu le faire et en conséquence le délit perdure aujourd’hui. Mieux, les « rebelles » voulaient exterminer leur opposant de façon systématique et donc « le caractère de crime contre l’humanité imprescriptible tel qu’il est défini par les normes du droit pénal international ne fait pas de doute ». Frisant le grotesque, Garzón demande les certificats de décès de Franco et de 34 dignitaires franquistes « pénalement responsables ». Il autorise les exhumations de corps des fosses contenant des républicains dans les délais les plus urgents et demande la formation de groupes d’experts et l’utilisation de tous les moyens techniques et scientifiques à cet effet. Ultime incongruité, Garzón réclame la liste des principaux dirigeants de la Phalange Espagnole entre le 17 juillet 1936 et décembre 1951, ignorant sans doute que la Phalange de José Antonio, très divisée à l’heure de se joindre aux forces de droite insurgées, en juillet 1936, fut dissoute le 19 avril 1937 et que le second chef de la Phalange fut condamné à mort par un tribunal militaire franquiste.
Le recours immédiat contre cette décision de justice intenté devant la salle pénale de l’Audience nationale par l’Avocat général, Javier-Alberto Zaragoza Aguado, a fait beaucoup moins de bruit. Dommage ! car ce texte qui est celui d’un professionnel du droit est une véritable leçon, un camouflet pour le juge Garzón. « Dans un état de droit, écrit Javier Zaragoza, le procès pénal est sujet à des règles et des limites de procédure qui en aucun cas ne peuvent être violées ». L’Avocat général blâme le juge pour avoir contourné la loi d’amnistie votée par les premières Cortès démocratiques en 1977. « Questionner la légitimité d'origine de cette loi, écrit-il, et pire la stigmatiser comme loi d'impunité serait la sottise juridique absolue ». Il reproche encore au juge Garzón : d’ignorer les règles de compétence territoriale des tribunaux, d’utiliser une habile « couverture » pour qualifier les actes de crimes contre l’humanité et de construire un « échafaudage juridique singulier » qui lui permet de lier les délits de détentions illégales avec un délit contre les hautes autorités de l'État, alors que non seulement les responsables théoriques de ces délits sont morts mais que, en raison de leur condition et responsabilité, la compétence de l'instruction revient au Tribunal suprême. « En résumé, écrit Zaragoza, on peut affirmer que la prétention de tout connaître et sur tous en une seule procédure rompt les plus élémentaires règles du procès pénal et débouche inévitablement sur une inquisition générale interdite par notre Constitution ».
En ce qui concerne la qualification de génocide ou de lèse humanité des faits dénoncés, l’Avocat général explique pourquoi celle-ci n’est juridiquement pas applicable dans ce cas. Le corpus de normes qui conforme la légalité pénale internationale n'existait pas à l'époque ou les actes ont été commis ; cette qualification juridique ne peut donc s'appliquer rétroactivement sans attenter à la légalité pénale dans toute sa dimension ; enfin, l'exécution des faits est antérieure à leur qualification dans le droit pénal international.
Mais le juge Garzón n’est pas du genre à faire amende honorable. Le 18 novembre, coup de théâtre ! Alors que la Salle pénale de l’Audience nationale est sur le point de se réunir pour prendre sa décision, afin d’éviter de courir le risque d’être désavoué par ses pairs et, vraisemblablement, sous la pression de certains de ses amis politiques qui jugent qu’il en faisait trop, Garzón a édicté une nouvelle ordonnance. Dans un texte interminable, saturé de faits incertains, de semi-vérités et d’interprétations contestables, le juge prétendait se justifier et « ratifier avec force tous les motifs qui l’ont amené à considérer cette instruction nécessaire ». Mais après 148 pages de cette eau, il déclarait que la responsabilité pénale du dictateur Franco et des dignitaires franquistes était éteinte en raison de leurs morts et, simultanément, que l’instruction des disparitions était désormais de la compétence des juges de provinces où se trouvent les fosses qu’il avait ordonné d’ouvrir.
Nouvelle contradiction juridique de Garzón, soulignée immédiatement par les présidents de plusieurs tribunaux supérieurs de province : on ne voit pas comment des auteurs de crimes seraient décédés pour Madrid sans l’être pour d’autres villes. Deux jours plus tôt, le Professeur Stanley Payne, célèbre spécialiste américain de la guerre-civile espagnole, prononçait sa propre sentence devant la presse : « L’idée qu’un juge puisse se déclarer en faveur de l’annulation de la transition et de la loi est parfaitement grotesque ».
Critiquables sur le plan juridique, les ordonnances de Garzón ne le sont pas moins au niveau historique (1). Tout d’abord - est-il besoin de le rappeler ? - les historiens ne reconnaissent ni aux politiciens, ni aux juristes la moindre autorité pour venir leur dire comment il faut écrire les faits et interpréter le passé ? Quant aux objections de fond, elles sont multiples.
Ce n’est pas le soulèvement militaire de juillet 1936 qui est à l’origine de la destruction de la démocratie. C’est parce que la légalité démocratique avait été est détruite par le Front populaire que le soulèvement s'est produit. En 1936, personne ne croyait en la démocratie libérale telle qu’elle existe aujourd’hui en Espagne. Le mythe révolutionnaire partagé par toute la gauche était celui de la lutte armée. Les anarchistes et le parti communiste, un parti stalinien, ne croyaient certainement pas en la démocratie. L’immense majorité des socialistes et, notamment leur leader le plus significatif, Largo Caballero, le « Lénine espagnol », qui préconisait la dictature du prolétariat et le rapprochement avec les communistes, n’y croyait pas davantage. Les gauches républicaines du jacobin Azaña, qui s’étaient compromises dans le soulèvement socialiste de 1934, n’y croyaient pas plus. Quant aux monarchistes de Rénovation espagnole, aux carlistes, aux phalangistes et à la majorité de la CEDA (Confédération espagnole des droites autonomes), ils n’y croyaient pas non plus.
Les anarchistes se révoltèrent en 1931, en 1932 et en 1933. Les socialistes se soulevèrent contre le gouvernement de la République, du radical Alejandro Lerroux, en octobre 1934. Appuyé par toutes les gauches, ce soulèvement fut planifié par les socialistes comme une guerre civile pour instaurer la dictature du prolétariat. Dès son arrivée au pouvoir, le Front populaire ne cessa d'attaquer la légalité démocratique. Le résultat des élections de février 1936 ne fut jamais publié officiellement. Plus de 30 sièges de droite furent invalidés. Le président de la République, Niceto Alcalá Zamora fut destitué de manière illégale. La terreur s'imposa dans la rue, faisant plus de 300 morts en trois mois.
On aimerait bien que les nombreux « écrivains d’histoires », défenseurs des vieux mythes du Komintern, nous expliquent la réflexion lapidaire du libéral antifranquiste, Salvador de Madariaga, tant de fois reprise par les auteurs les plus divers : « Avec la rébellion de 1934, la gauche espagnole perdit jusqu’à l’ombre d’autorité morale pour condamner la rébellion de 1936 ». On aimerait qu’ils nous disent pourquoi, à l’exclusion de la Gauche républicaine et de l’Union républicaine, les militants et sympathisants de toutes les autres tendances, depuis les partis républicains de Lerroux, Martinez Velasco, et Melquiadez Alvarez, jusqu’aux traditionalistes carlistes, furent tous considérés en territoire front populiste comme des ennemis à extirper. Pourquoi les ministres démocrates du parti radical Salazar Alonso, Abad Conde, Rafael Guerra del Rio furent condamnés à mort et assassinés. Pourquoi des libéraux comme José Ortega y Gasset, Perez de Ayala, Gregorio Marañon, qui étaient alors « les pères fondateurs de la République », ou encore des démocrates et républicains comme le Président du parti radical, ex-chef du gouvernement de la République, Alejandro Lerroux ou le philosophe catholique-libéral, ami de Croce et d’Amendola, Miguel de Unamuno, choisirent le camp national ? Pourquoi les nationalistes basques ont préféré négocier leur reddition avec le Vatican, les italiens et leurs frères carlistes-requetes (Pacte de Santoña, 24 août 1937) plutôt que de poursuivre la lutte aux côtés de révolutionnaires « persécuteurs et athées ». Pourquoi l’assassinat du député Calvo Sotelo, menacé de mort au Parlement par le ministre de l’intérieur socialiste, Angel Galarza, et liquidé par des militants du PSOE qui furent aidé dans leur crime par les forces de l’ordre, puis protégés par les députés socialistes Vidarte, Zugazagoitia, Nelken et Prieto, n’a-t-il jamais été condamné par les Cortès démocratiques de l’après-franquisme ?
Le caractère partisan de l’action de Baltasar Garzón est flagrant. Mais imaginons que le juge médiatique fasse des émules à droite. Au nom de quels principes pourrait-on alors leur empêcher d’instruire des plaintes contre les responsables : des 200 tchekas qui fonctionnaient à Madrid ; des fosses nationales de Paracuellos (plus de 4000 morts), Torrejón de Ardoz et Usera ; de l’assassinat de García Lorca (cf. notre article dans ce numéro) par les uns et des assassinats de Muñoz Seca, Maeztu, Ledesma et Pradera par les autres ; des massacres républicains de Malaga et de la prison Modèle de Madrid ; de l’extermination de près de 7000 religieux et de 12 évêques ; du bombardement de Cabra (plus de 100 morts et 200 blessés civils) dans des conditions aussi barbares que Guernica (126 à 1635 morts selon les sources) ; de la détention illégale de José Antonio Primo de Rivera quatre mois avant le soulèvement et de son assassinat, en novembre 1936, après une parodie de procès ; des réglements de compte de Marty le boucher d’Albacete, responsable de la mort de plus de 500 brigadistes internationaux ; de l’assassinat du dirigeant anarchiste, Buenaventura Durruti, par les communistes ; de la disparition d’Andreu Nin, le dirigeant du POUM torturé à mort par les staliniens ; des purges de mai 1937 à Barcelone, contre les dissidents de l’orthodoxie stalinienne traités au préalable de trotskistes et d’agents fascistes ; des exécutions sommaires à l’issue de la petite guerre civile qui se déroula à l’intérieur de la guerre civile dans le camp Front populiste, à Madrid, en mars 1939 ; de la spoliation par Moscou des réserves d’or de la Banque d’Espagne ; des milliers d’enfants évacués de force par les autorités républicaines vers l’URSS et qui perdirent ainsi à jamais leur identité … et de tant d’autres exemples polémiques ?
Venons-en enfin au nœud de la controverse : les chiffres de la répression et l’existence de fosses aux victimes non identifiées. Depuis la fin du conflit, de part et d’autre, les protagonistes et leurs descendants les plus enragés n’ont cessé de se jeter des cadavres à la face. Pendant près de 70 ans les chiffres sur les répressions ont oscillé de façon inconsidérée et absurde. Les auteurs favorables au Front populaire, ont cité tour à tour 500 000, 250 000, 192 548 (selon les prétendus propos d’un fonctionnaire franquiste jamais identifié), 140 000, 100 000 (selon Tamames, qui était alors communiste), et, finalement, « plusieurs dizaine de milliers » (selon Hugh Thomas). Par ailleurs, ils ont toujours assuré que les quelques milliers, voire dizaine de milliers de franquistes victimes de la répression l’avaient été parce que le gouvernement de la République était débordé par des groupes incontrôlés alors que dans la zone nationale l’action répressive était préméditée et avait pris l’allure d’une extermination.
En revanche, pour les franquistes qui se fondaient sur les investigations du Ministère public menées dans le cadre de la « Causa general » (procès instruit contre « la domination rouge », au début des années 40, dont l’énorme documentation est conservée, depuis 1980, à l’Archivo Histórico Nacional de España de Madrid et qui n’a jamais été publiée intégralement), il était avéré que les front-populistes avaient commis 86 000 assassinats et les nationaux entre 35 et 40 000. Pour les besoins de sa cause, Baltasar Garzón retient aujourd’hui le chiffre de 114 266 républicains disparus « un chiffre qui, dit-il, pourrait être révisé par un groupe d’experts ». Il prétend nous faire croire qu’ils seront identifiés grâce aux techniques modernes sans préciser bien entendu que la constitution d’une banque d’ADN et l’utilisation systématique de tests constituerait une dépense colossale pour l’État espagnol. Mais peut-on accorder quelque crédit à un juge qui ne cite jamais un expert ou historien adverse ? En fait, dans la majorité des publications que manie Garzón, le préjugé des auteurs se fonde souvent sur des estimations approximatives et des témoignages relevant de l'imagination. Enfin, lorsque ces publications présentent des relations nominales, elles attribuent fréquemment à la répression franquiste des victimes qui, en réalité, sont mortes en action de guerre ou mortes en combattant pour le camp national. Il en résulte que le bilan final est inacceptable sur le triple plan moral, juridique et historique.
Un seul exemple suffit à illustrer l’ampleur des passions dangereuses que l’imprudence des autorités et des médias déchainent dans l’opinion publique. Le 5 mars 2008, l’information de la découverte de nouvelles fosses à Alcala de Henares circulait dans toutes les agences de presse. Immédiatement, le gouvernement espagnol insinua qu’il s’agissait de nouvelles victimes du franquisme, puis, lorsque quelques spécialistes firent remarquer que cette ville étant restée sous contrôle du Front Populaire jusqu’à la fin du conflit, il était peu probable qu’il s’agisse de victimes du camp républicain, le silence se fit et l’affaire fut étouffée.
Même s’il reste à déterminer de façon rigoureuse les morts irrégulières qui, de part et d’autre, n’ont pas encore été inscrites dans les registres d’état civil, on peut considérer que les chiffres pratiquement définitifs des deux répressions sont les suivants : 60 000 victimes chez les nationaux et 80 000 victimes chez les républicains (50 000 pendant la guerre et 30 000 exécutés après la fin du conflit). Des chiffres si lourds n’ont pas besoin d’être exagérés pour rendre compte de l'intensité des passions et l’étendue des massacres qui ont affecté les deux camps.
Plus de trente ans après l’instauration de la démocratie en Espagne, on ne peut toutefois manquer de s’interroger sur un fait étrange. Alors que les publications plus ou moins sérieuses sur la répression se succèdent à bon rythme, personne ne semble avoir eu l’idée de réunir les très nombreux témoignages de tous ceux qui, dans un camp comme dans l’autre, ont essayé en pleine guerre civile de sauver quelqu’un dans le camp ennemi. Ce sont pourtant ces personnes qui sont les plus méritantes, les seules dignes de figurer au tableau d’honneur d’une guerre civile. Mais ne rêvons pas, car parmi ces hommes d’exception devraient figurer en bonne place : Julian Besteiro, le social-démocrate qui s’opposa à la ligne bolchévique de son parti et mourut, en 1939, dans les geôles franquistes ; Melchor Rodriguez García, l’anarchiste de la CNT, délégué général des prisons, qui s’opposa au communiste-stalinien Santiago Carrillo et sauva des centaines de vie humaines, en novembre et décembre 1936, ou José Antonio Primo de Rivera, le chef de la Phalange, assassiné par les front-populistes puis instrumentalisé par les franquistes, qui proposa sa médiation avec insistance au Président des Cortes, Diego Martinez Barrio, en août 1936… et la guerre idéologique, fomentée par tant de politiciens irresponsables, risquerait de s’éteindre.
Arnaud Imatz
Nouvelle revue d’Histoire, janvier/février 2009 n°40
Polémia
28/02/09
Note :
(1) Les origines et les causes de la guerre civile espagnole et la nouvelle historiographie du conflit ont fait l’objet d’un dossier publié dans le numéro 25 de la NRH: 1936-2006 : la guerre d’Espagne.
Arnaud Imatz, docteur d’état ès sciences politiques, diplômé d’études supérieures en droit, ancien fonctionnaire international à l’OCDE, a publié sur la Guerre d’Espagne : « La guerre d’Espagne revisitée », Paris, Economica, 1993, « José Antonio, la Phalange Espagnole et le national-syndicalisme », Paris, Godefroy de Bouillon, 2000 et, plus récemment, « José Antonio : entre odio y amor. Su historia como fue », Barcelone, Áltera.
Arnaud Imatz
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : espagne, gauche, droite, guerre d'espagne, histoire, années 30, guerre civile, historiographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Novembre 1941: la perestroïka de Staline

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - Octobre 1988
Novembre 1941: la "Perestroïka" de Staline
par Wolfgang STRAUSS
Rudolf Augstein va-t-il faire mentir l'histoire? "Stra-tège de bistrot", "handicapé de l'argumentaire", "im-bécile", "masochiste", "accoucheur de monstruo-sités": ce sont quelques-uns des traits hardiment dé-cochés par l'ex-artilleur Augstein contre le plus grand spécialiste allemand de l'histoire contem-porai-ne avec Helmut Diwald. La cible de cette philippique n'est autre qu'Ernst Nolte, à cause de son ouvrage Der europäischer Bürgerkrieg, 1917-1945 - Natio-nal-sozialismus und Bolschewismus (= La guerre ci-vile européenne, 1917-1945 - National-socialisme et bolchévisme, Berlin, Propyläen, 1987). Augstein trai-te en outre le livre de Nolte de "subversion de la science" (Der Spiegel, n°1/1988). Or, que nous pro--pose donc l'auteur de cette bordée d'insultes? Rien moins q'un viol de l'histoire. Surtout à propos de Staline. Augstein fait un contre-sens total sur la po-litique et sur les motivations du "petit père des peu-ples".
Certes, concède-t-il, Staline "a assassiné à tour de bras", il "a fait tuer à l'intérieur plus de monde qu'Hitler" (sic), "20 millions de personnes rien qu'entre 1934 et 1938". Mais il y a des réalisations gran-dioses au palmarès du Géorgien: l'industria-li-sa-tion, le maintien de la cohésion de l'empire, la mise en place d'une "dictature pédagogique", l'éradica-tion de l'analphabétisme…
Staline a vaincu les Allemands parce qu'il a fait vibrer in extremis la fibre patriotique des Russes
Il va falloir dorénavant se passer des lumières his-toriques d'Augstein, qui n'est qu'un amateur, même s'il est fort lu. Le voilà qui affirme tout de go que le Géorgien a vaincu Hitler et "ses généraux nazis" parce que le "système stalinien" disposait d'un im-mense potentiel de défense "révolutionnaire", en clair: communiste. Rien n'est plus faux. Staline n'a réussi -in extremis- à mobiliser les forces patrio-ti-ques, c'est-à-dire nationales-russes, qu'au prix d'un reniement complet de ses postulats idéologiques fon-damentaux. En peu de temps, le bolchévik Staline mit en scène une véritable perestroïka spirituelle et morale, un renversement total de son système de ré-férence: finie l'eschatologie communiste-marxiste, fi-ni l'internationalisme prolétarien. Retour au mes-sia-nisme russe, celui de la Grande Guerre Patrioti-que et Nationaliste. Staline, une fois encore, était tiré d'affaire. Pour entrer dans l'histoire comme le plus grand des rénégats.
Moscou, 7 novembre 1941: revue des troupes sur la Place Rouge. "Le monde regarde votre force", lance le Géorgien à ses soldats russes. "Vous avez une gran-de mission libératrice à accomplir. Soyez-en di-gnes. La guerre que vous menez est une guerre de li-bération, et c'est une guerre juste". Pas un mot sur Marx et Engels. La Révolution mondiale? Passée aux oubliettes. Staline proclame le nationalisme rus-se comme la seule force légitime de survie. "Battez-vous comme se sont battus vos grands ancêtres: Nev-ski, Donskoi, Minine, Pojarski, Souvorov et Kou-touzov!". En 1812, le maréchal Koutouzov alla re-joindre ses troupes devant Smolensk dans un con-cert de cloches et de chorales. Et le 2 août 1914, le Tsar Nicolas II s'était agenouillé pour prier l'icône miraculeuse de la Vierge de Kazan dans son Palais d'Hiver de Saint-Pétersbourg. De même, l'athée Sta-line, en invoquant des ancêtres à la fois patriotes et chrétiens, relie un passé glorieux, pré-bolchévique, à un présent apocalyptique.
Le 7 novembre 1941, les Saints et les Martyrs de la Russie sont remis à l'honneur. En ce jour anniver-sai-re de la Révolution, l'histoire russe reprend ses droits. La conscience historique des sujets de Staline re-devient subitement patriotique. L'internationale s'est tue, le Manifeste communiste de Marx se cou-vre de poussière. La religion d'Etat redevient le na-tionalisme russe, aux racines mythiques et religieu-ses. En comparaion, la perestroika culturelle d'un Gorbatchev est une aimable plaisanterie, à la fois su-perficielle et terne.
Les Russes percevaient les Allemands comme des libérateurs
C'est la dictature stalinienne elle-même, ce qu'Aug-stein appelle la "révolution socialiste", qui, en s'ef-fondrant par sa propre faute, à l'été 1941, a contraint Staline à recourir au nationalisme russe. L'heure du communisme soviétique avait sonné. "Beaucoup, au-jourd'hui, oublient (ou feignent d'oublier car cela cadre mal avec l'"antifascisme" ambiant)", écrit Carl Gustav Ströhm, Allemand des Pays Baltes et com-patriote de l'auteur de ces lignes, "que de larges frac-tions de la population soviétique ont accueilli les Allemands en libérateurs, que des centaines de mil-liers de soldats de l'Armée Rouge ont changé de camp, à l'été et à l'automne 1941, et que des mil-lions se sont laissés capturer, bien souvent sans op-po-ser grande résistance. Ce n'étaient pas seule-ment des Ukrainiens ou des Baltes qui, eux, avaient quel-ques raiosns de saluer l'arrivée des Allemands; il y avait aussi d'innombrables Russes. La terreur stali-nien-ne avait laissé de telles cicatrices (c'était quel-ques années seulement après la collectivisation forcée et sanglante des terres) que de nombreux Russes étaient prêts à collaborer avec l'ennemi extérieur" (Die Welt, 26 septembre 1987).
Octobre 1941: les semaines les plus dures pour l'U-nion Soviétique. Au Kremlin, c'est une atmosphère de fin de règne. Staline, "l'homme d'acier", le "so-leil du prolétariat mondial", connait les affres du dé-clin. Le 3 octobre, il a dicté quelques lettres où il qué-mandait l'aide de Roosevelt et de Churchill. Puis il s'est tu jusqu'au début novembre. Le Premier Mi-nis-tre anglais et le Président américain lui écrivent, mais Staline ne répond plus. Smolensk est aux mains des Allemands. Kiev aussi, ainsi que l'Ukrai-ne centrale. Une douzaine d'armée, soit plus de six cent mille soldats de l'Armée Rouge, sont hors de combat. Le cœur industriel du Sud est perdu.
Staline demande aux Anglais de débarquer en Russie
Dans une lettre du 13 septembre, alors même que se re-ferme l'étau sur Kiev, Staline demande à Churchill de faire débarquer à Archangelsk, sans grand risque, 20 à 25 divisions britanniques, ou bien de les faire transiter par la Perse vers les territoires asiatiques de l'URSS "afin qu'elles combattent aux côtés des trou-pes soviétiques, sur le sol soviétique, comme el-les le firent au cours de l'autre guerre sur le sol fran-çais". Faut-il que le successeur de Lénine ait été aux abois pour mendier ainsi l'intervention de troupes que la jeune Armée Rouge de Lénine avait victorieu-se-ment affrontées lors des combats de 1918 à 1921! Mais l'Anglais refuse, faisant observer que les Etats-Unis d'Amérique vont entrer en guerre sous peu.
A Moscou, c'est la paralysie. Le moral n'y est plus. La confiance des sujets s'évanouit. Quand ils ne vont pas à la rencontre de l'envahisseur, bannières dé-ployées, ils lui offrent le pain et le sel. Par mil-lions! Et pas seulement les ethnies traditionnellement "peu sûres": Ukrainiens, Lithuaniens, Estoniens, Let-tons. On trouve parmi eux des Russes, des Bié-lo-russes des territoires occupés! Le 13 octobre, Ka-louga tombe, à 160 km au Sud-ouest de Moscou. C'était le pivot de la première ligne de défense avan-cée devant Moscou. Le 14, Borodino est dépassé. C'est à 100 km à peine de Moscou. L'endroit est his-torique, sacré: n'est-ce pas là qu'au siècle der-nier, la Grande Armée de Napoléon a frisé la dérou-te? C'est là que Staline voudrait stopper ce deuxième envahisseur venu de l'Ouest. En vain. La 32ème di-vi-sion sibérienne, division d'élite, meurt sur les hau-teurs de Borodino. C'était l'ultime espoir. Les Pan-zers de la 10ème division blindée allemande défilent devant le monument aux morts de Borodino et s'en-foncent dans les espaces enneigés jusqu'à la Mosco-va. Le verrou du dernier bunker saute. Le 19 octobre, Mojaïsk tombe. Or, la Chaussée de Mojaïsk con--duit tout droit dans la métropole de Staline. Plus que 100 km d'autoroute! "Mojaïsk est tombé, entend-on crier dans les rues de Moscou. Mojaïsk est perdu, les Allemands arrivent!".
Les Allemands n'atteignent pas Moscou, les Russes se sont ressaisis
Cinq jours auparavant, le 15 octobre, Molotov, Mi-nistre des Affaires Etrangères avait reçu Steinhardt, l'ambassadeur américain, pour lui annoncer que le Gou-vernement soviétique quitterait Moscou et que le corps diplomatique se replierait sur Kouibichev, à 850 km à l'Est. Lorsque la nouvelle fut connue, et lors-qu'on apprit que le tombeau de Lénine serait ex-trait de son Mausolée, ce fut la panique dans Mos-cou: "les Fritz arrivent".
Ce qui s'est passé alors, aucun livre d'histoire so-vié-tique ne l'a jamais raconté, alors même que des té-moins de cette époque sont encore en vie. Car à Mos-cou ce n'est pas seulement dans la crainte que l'on attend les "Fritz": certains Moscovites souhaitent leur venue.
"Les occupants des immeubles de la Chaussée de Mojaïsk tendent l'oreille au moindre bruit de che-nilles. Sont-ils déjà là? Pendant ces journées, tout reste possible à Moscou… Les nouvelles alarmistes se succèdent dans la ville… Le gouvernement a fui… Le pouvoir de Staline chancelle. Son portrait mê-me est décroché des murs; les premières cartes du Parti se consument. Des tracts simples, qu'on devi-ne confectionnées à la hâte, apparaissent soudain, au petit matin, dans les boîtes aux lettres: "Mort aux com-munistes!"… Le cœur de l'Union s'arrête. Tout le fanatisme du Parti, tous les tribunaux d'exception, toutes les exécutions ne peuvent, en cette fin d'oc-tobre, endiguer la décomposition de la ville. Les do-miciles des personnalités évacuées sont pillés. Des déserteurs s'y installent. Des blessés, des enfants, des jeunes gens échappés des équipes de travail, rô-dent çà et là. Moscou semble agoniser…".
Le témoignage de Mandel Mann
Ces lignes incroyables et pourtant si vraies, sont ex-traites des mémoires d'un instituteur de village, d'o-ri-gine juive polonaise, émigré en Russie en 1939. Le livre de Mandel Mann Aux portes de Moscou parut d'abord en Israël avant d'être traduit dans presque tou-tes les langues et publié en Allemagne aux édi-tions Heinrich Scheffler de Francfort en 1961. Man-del Mann se souvient avoir assisté à certaines scènes:
"Une patrouille de six hommes en armes, trois de la Mi-lice et trois du NKWD, s'arrête devant une porte-cochère puis se replie lentement dans la rue Sadovaïa où elle disparaît dans l'entrée obscure d'une maison. Au bout d'un moment, les six hommes réapparais-sent, tête nue et sans armes. Sur leurs capotes mili-taires, les insignes de miliciens ont disparu"… "Les rats quittent le navire", leur lance une femme. "Ils peu-vent toujours courir, on les rattrapera! "…
Lentement, la foule forme un cortège; en tête, mar-chent les blessés, suivis des femmes et de tous les au-tres. Des rues adjacentes surgissent des gamins de quatorze ou quinze ans qui travaillaient jusqu'alors en usine. "Mort aux communistes!" hurle le porte-dra-peau. "La guerre est finie!", "Grâce te soit ren-due, Sainte Vierge, Mère de Dieu!".
Mais les "Fritz" ne vinrent pas. Où étaient-ils donc pas-sés? Ils avaient pourtant emprunté les autoroutes et les chaussées de la périphérie moscovite! A une heure de route à peine de la capitale!…
La victoire du général Hiver
Deux semaines plus tard, le 5 décembre. Un froid arc-tique a ralenti l'avance allemande. Des éléments de choc des 3ème et 4ème Armées blindées forment l'aile gauche du groupe d'armées Centre, décrivant un vaste arc de cercle au Nord et au Nord-Ouest de Moscou. Dans les faubourgs de Gorki, de Katiouch-ki, de Krassnaïa Poliana, les hommes de la 2ème Pan-zerdivision viennoise grelottent par 40° au-des-sous de zéro, à 16 km à peine des tours du Kremlin. A la lunette binoculaire, les chefs de régiments peu-vent observer la vie dans les rues de Moscou. Mais c'est un Moscou où, depuis le 7 novembre, le vent d'hi-ver a tourné, où souffle un nouvel esprit de ré-sis-tance qui puise sa force et son intransigeance dans le tréfonds immémorial du nationalisme russe. En un seul discours prononcé sur la Place Rouge enneigée, que les Allemands paraissent avoir oublié et que les historiens occidentaux ne commentent guère (car ils sont incapables de l'expliquer), Staline rendit à la na-tion russe son histoire, sa fierté et son identité à un moment historique où cette nation, ne pouvait plus croire qu'en des miracles. Des avions sovié-ti-ques largueront derrière les lignes allemandes des tracts reproduisant le texte du discours du 7 no-vem-bre, afin que les populations occupées sachent ce qui se passait à Moscou: une perestroika de l'esprit et du cœur…
D'un point de vue "antifasciste", Staline fut un rénégat, un capitulard idéologique, un déviationniste. C'est vrai: Staline a heurté de front les vaches sa-crées de l'internationalisme marxiste-léniniste et trotz-kiste. Mais l'Histoire, elle, est du côté des vain-queurs, pas des gourous idéologiques. En réhabili-tant le nationalisme russe, en le sanctifiant et en l'é-levant au rang de religion d'Etat, Staline a sauvé l'em-pire. La Grande Guerre Patriotique —l'expres-sion évoque à dessein une autre "Guerre Patrio-ti-que", celle de 1812-1813— ne fut pas menée au nom de Karl Marx.
Augstein se trompe. Le potentiel révolutionnaire a sur-gi du nationalisme, pas du communisme. Du point de vue de la vulgate "antifasciste", Staline a réveillé et mobilisé précisément ces forces, valeurs, attitudes et idéaux "irrationnels" qu'un Jürgen Ha-ber-mas considère comme des "phénomènes préfascistes": conscience et fierté nationales, foi et fidélité, abnégation, esprit de sacrifice, amour du peuple et de la patrie, sentiment d'être prédestiné, et d'être uni-que au monde…
Wolfang STRAUSS.
(texte issu de Nation Europa, n°3/1988; traduction française: Jean-Louis Pesteil).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, allemagne, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, années 40, staline, guerre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 mars 2009
E. Todd: "Le protectionnisme est l'antidote à la guerre"
EMMANUEL TODD : « LE PROTECTIONNISME EST L’ANTIDOTE A LA GUERRE »
Ex: http://unitepopulaire.org/
 « Le libre-échange est responsable de la crise dans laquelle nous sommes plongés. Il tire les salaires vers le bas et attise les conflits sociaux. Il faut sortir de ce système, mais de façon réfléchie, en se donnant du temps. Je ne suis pas un dogmatique buté. Aujourd'hui, c'est le libre-échange, avec sa théorie des avantages comparatifs, qui nous conduit à la guerre. Le protectionnisme est l'antidote à la guerre.
« Le libre-échange est responsable de la crise dans laquelle nous sommes plongés. Il tire les salaires vers le bas et attise les conflits sociaux. Il faut sortir de ce système, mais de façon réfléchie, en se donnant du temps. Je ne suis pas un dogmatique buté. Aujourd'hui, c'est le libre-échange, avec sa théorie des avantages comparatifs, qui nous conduit à la guerre. Le protectionnisme est l'antidote à la guerre.
C'est l'Europe qui doit être le moteur de ce nouveau projet économique. Le continent européen a une économie relativement saine. Il produit ce qu'il faut d'exportations pour financer ses importations de matières premières. Le protectionnisme est la meilleure manière de se protéger – ce n'est pas un gros mot – de la pression exercée par les salaires des pays émergents. Et ce, pour permettre en Europe une relance des salaires et de la demande. (...)
Le centre de gravité économique dans le monde a repassé l'Atlantique. Il est en Europe, et plus particulièrement en Allemagne. Or les Européens ne font pas preuve de responsabilité face à cette mission qui est la leur. Ils ont le prétexte de la division, mais en vérité ils sont aussi dans un état de manque de réflexion économique, qui est probablement encore pire que celui des Américains. Ils se comportent comme des enfants qui ne veulent pas devenir adultes. Ils ne peuvent pas se contenter de mettre en place un protectionnisme européen à moyen et long terme, ils doivent s'accepter en tant que régulateurs hégémoniques dans le monde sur le plan économique. (...)
La crise de 1929 a produit le Front populaire en France, le New Deal aux Etats-Unis, le nazisme en Allemagne, un conservatisme un peu mou en Angleterre. On devrait assister, compte tenu d'une certaine dérive oligarchique, avec beaucoup d'inégalités des revenus, à l'émergence d'un mélange de lutte des classes et des générations. On a vu la crise des banlieues en France, et aujourd'hui les événements de Grèce. »
Emmanuel Todd, interviewé par Le Matin, 14 décembre 2008
LE LIBRE-ECHANGE OU LA DÉMOCRATIE : IL FAUT CHOISIR – LA FIN D’UN CYCLE – LE RÉVEIL EN FORCE DU PROTECTIONNISME CHINOIS
00:31 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, protectionnisme, économie, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Clint Eastwood heeft gelijk...
Clint Eastwood heeft gelijk
Geplaatst door yvespernet
Op dit vlak dan toch: http://in.news.yahoo.com/139/20090227/906/ten-eastwood-thinks-political-correctnes.html
London, February 27 (ANI): Acting legend Clint Eastwood , 79, apparently believes that political correctness has rendered modern society humourless, for he accuses younger generations of spending too much time trying to avoid being offensive. The Dirty Harry star insists that he should be able to tell harmless jokes about nationality without fearing that people may brand him “a racist”.
“People have lost their sense of humour. In former times we constantly made jokes about different races. You can only tell them today with one hand over your mouth or you will be insulted as a racist,” the Daily Express quoted him as saying. ”I find that ridiculous. In those earlier days every friendly clique had a ‘Sam the Jew’ or ‘Jose the Mexican’ - but we didn’t think anything of it or have a racist thought. It was just normal that we made jokes based on our nationality or ethnicity. That was never a problem. I don’t want to be politically correct.
We’re all spending too much time and energy trying to be politically correct about everything,” he added. (ANI)
00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, etats-unis, political correctness, actualité, film |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'Alsace en Europe
L’Alsace en Europe: Rives du Rhin ou plateau lorrain, il faut choisir!

Parmi les mesures qui devraient être rendues publiques figurerait le regroupement - sur des bases à priori volontaires - de quelques-unes des 22 régions actuelles qui ne devraient plus à l’avenir en former que 15 dans le but de leur donner “une dimension européenne”.
C’est ainsi que serait envisagé le regroupement des actuelles régions Alsace et Lorraine au sein d’une super région du Grand Est.
Une telle proposition reflète le tropisme franco-parisien de ses auteurs tout comme la méconnaissance des réalités régionales et européennes.
L’observation de ce qui se passe chez nos proches voisins européens nous montre au contraire que la viabilité d’une région, d’un Land allemand ou d’un canton suisse, n’est pas fonction de l’importance de sa superficie ni de sa population, mais de son homogénéité et des atouts liés à sa situation géographique comme à la présence sur son territoire d’activités économiques à forte valeur ajoutée, et à son rayonnement culturel.
C’est le cas de la Freie und hansestadt Hamburg, la ville libre et hanséatique de Hambourg, qui avec ses 1,8 M d’habitants et ses 755 km² est le premier des 16 Länder allemands pour le PIB par habitant.
Plus grand port d’Allemagne et deuxième port européen, la Ville-Etat d’Hambourg a su depuis la fin de la guerre se spécialiser dans les domaines de la chimie, de la construction aéronautique et navale, et est devenu un leader en matière de technique médicale et de biotechnologie, tout en développant un fort secteur des services.
Plus proche de nous la prospérité du canton de Bâle-Ville, le plus petit des cantons suisses avec ses 190 000 habitants et ses 37 km², vient encore contredire le raisonnement du Comité Balladur.
Vouloir noyer l’Alsace dans un hypothétique Grand Est reviendrait en fait à nous couper de l’espace du Rhin Supérieur qui est notre espace de vie et de développement naturel et historique, et à nous éloigner du centre économique européen qui court de l’Italie du Nord jusqu’à Londres en passant par la vallée du Rhin et la Ruhr sous la dénomination de Banane Bleue.
Il est urgent que ces réalités reviennent à l’esprit des grands élus alsaciens et que la dimension régionale et européenne de l’Alsace l’emporte sur la logique nationale.
La clé de la prospérité de l’Alsace et son avenir se trouvent sur les deux rives du Rhin, pas sur le plateau lorrain.
Article printed from :: Novopress.info Alsace / Elsass: http://alsace.novopress.info
URL to article: http://alsace.novopress.info/?p=803
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, régions, régionalisme, autonomisme, alsace, france, collectivités locales, balladur |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 mars 2009
La mort du leadership américain
Un pays discrédité et en faillite/La mort du leadership américain
Une fois encore, Paul Craig Roberts présente une analyse pessimiste sur l’avenir américain. Il ne voit pas comment les Etats-Unis retrouveraient leur leadership et il ne peut s’empêcher d’observer l’ancien rival pour se demander si le monde n’assiste pas à l’avènement d’une nouvelle ère « Poutine ». Polémia
Un nombre incroyable de personnes, aux Etats-Unis et à l’étranger, espère que le Président Obama mettra fin aux guerres illégales de l’Amérique, qu’il mettra un terme au soutien de l’Amérique aux massacres de Libanais et de Palestiniens commis par Israël et qu’il punira, au lieu de les récompenser, les banquiers gangsters (ou les « banksters escrocs »), dont les instruments financiers frauduleux ont détruit l’économie et imposé une souffrance massive à tous les gens dans le monde. Si les nominations d’Obama sont une indication, tous ces gens qui espèrent vont être déçus. (…)
Ce qui est décourageant est le fait que, même confronté à une crise économique et à une crise de politique étrangère, le système politique américain est incapable de produire le moindre leadership. Nous nous trouvons dans la pire crise économique de toute une vie, peut-être de notre histoire, et à la veille d’une guerre au Pakistan et en Iran, alors que la guerre en Afghanistan s’escalade. Et tout ce que nous obtenons est un gouvernement constitué de ces mêmes personnes qui nous ont amenés ces crises.
L’ère du leadership américain est révolue. Le système financier d’escrocs de l’Amérique a plongé le monde entier dans la crise économique. Les guerres d’agression de l’Amérique sont vues comme servant d’autres buts, comme l’enrichissement des industries militaires associées à Dick Cheney. Le monde est à la recherche d’un autre leadership.
Vladimir Poutine a bien joué à Davos pour endosser ce rôle. Son discours, lors de la cérémonie d’ouverture, était le plus intelligent de tout l’évènement. Poutine a rappelé au Forum Economique Mondial que les délégués américains qui s’exprimaient depuis cette tribune, il y a tout juste un an, avaient insisté sur la stabilité fondamentale de l’économie américaine et ses perspectives limpides. Aujourd’hui, les banques d’investissement, la fierté de Wall Street, ont virtuellement cessé d’exister. En 12 mois exactement, elles ont publié des pertes excédant les profits qu’elles ont réalisés au cours des 25 dernières années
Poutine a défendu l’idée selon laquelle le système financier existant, basé sur le dollar et l’hégémonie financière américaine, avait échoué.
Poutine a démontré que sa compréhension de l’économie était supérieure à celle de l’équipe d’Obama, lorsqu’il a déclaré que créer plus de dettes venant s’ajouter à des « dettes inextricables », comme le fait Obama, « prolongerait la crise ».
Dans une autre pique visant le leadership économique raté de l’Amérique, Poutine a déclaré qu’il est temps de se débarrasser de l’argent virtuel, des faux rapports financiers et des notations de crédit douteuses. Poutine a proposé un nouveau système de devise de réserve pour « remplacer le concept mondial unipolaire obsolète. » Poutine a dit qu’un monde en sécurité nécessitait la coopération, qui elle-même nécessite la confiance. Il a bien fait comprendre que les Américains avaient prouvé qu’on ne peut pas leur faire confiance.
Ce fut un message puissant qui a été beaucoup applaudi..
Par Paul Craig Roberts
CounterPunch, 3 février 2009
article original : "The Death of American Leadership"
Traduction : [JFG-QuestionsCritiques]
http://questionscritiques.free.fr/
Correspondance Polémia
12/02/09
00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, politique, politique internationale, etats-unis, géopolitique, sociologie, obama, atlantisme, occidentalisme, otan |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La "diversité" au service des inégalités
LA "DIVERSITE" AU SERVICE DES INEGALITES
Ex: http://unitepopulaire.org/
 « Au cours des 30 dernières années, les pays comme la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada sont devenus de plus en plus inégalitaires, économiquement parlant. Et plus ils sont devenus inégalitaires, plus ils se sont attachés à la diversité. C'est comme si tout le monde avait senti que le fossé grandissant entre les riches et les pauvres était acceptable du moment qu'une partie des riches sont issus des minorités. Les gens se sont de plus en plus attachés à un modèle libéral de justice, dans lequel la discrimination – racisme, sexisme, homophobie, etc. – est le pire de tous les maux. Si ça marche, c'est à la fois parce que c'est vrai – la discrimination est évidemment une mauvaise chose – et parce que ça ne mange pas de pain – le capitalisme n'a pas besoin de la discrimination. Ce dont le capitalisme a besoin, c'est de l'exploitation.
« Au cours des 30 dernières années, les pays comme la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada sont devenus de plus en plus inégalitaires, économiquement parlant. Et plus ils sont devenus inégalitaires, plus ils se sont attachés à la diversité. C'est comme si tout le monde avait senti que le fossé grandissant entre les riches et les pauvres était acceptable du moment qu'une partie des riches sont issus des minorités. Les gens se sont de plus en plus attachés à un modèle libéral de justice, dans lequel la discrimination – racisme, sexisme, homophobie, etc. – est le pire de tous les maux. Si ça marche, c'est à la fois parce que c'est vrai – la discrimination est évidemment une mauvaise chose – et parce que ça ne mange pas de pain – le capitalisme n'a pas besoin de la discrimination. Ce dont le capitalisme a besoin, c'est de l'exploitation.
Il est évident que la diversité ne réduit pas les inégalités économiques. Si vous prenez les 10% de gens les plus riches (ceux qui ont en fait tiré le plus de bénéfices de l'explosion néolibérale des inégalités) et que vous vous assurez qu'une proportion correcte d'entre eux sont noirs, musulmans, femmes ou gays, vous n'avez pas généré plus d'égalité sociale. Vous avez juste créé une société dans laquelle ceux qui tirent avantage des inégalités ne sont pas tous de la même couleur ou du même sexe. Les avantages en termes de gouvernance sont assez évidents, eux aussi. L'objectif du néolibéralisme, c'est un monde où les riches peuvent regarder les pauvres et leur affirmer (à raison) que personne n'est victime de discrimination, leur affirmer (tout autant à raison) que leurs identités sont respectées. Il ne s'agit pas, bien sûr, de les rendre moins pauvres, mais de leur faire sentir que leur pauvreté n'est pas injuste. (...)
Aux Etats-Unis, les Noirs radicaux se sont battus à la fois contre le racisme et le capitalisme. Des gens comme le Black Panther Bobby Seale ont toujours estimé qu'on ne peut pas combattre le capitalisme par le capitalisme noir, mais par le socialisme. Mais avec l'ère du marché triomphant débutée sous Reagan et Thatcher, l'antiracisme s'est déconnecté de l'anticapitalisme et la célébration de la diversité a commencé. Bien entendu, il n'y a rien d'anticapitaliste dans la diversité. Au contraire, tous les PDG américains ont déjà eu l'occasion de vérifier ce que le patron de Pepsi a déclaré dans le New York Times il y a peu: "La diversité permet à notre entreprise d'enrichir les actionnaires". De fait, l'antiracisme est devenu essentiel au capitalisme contemporain. Imaginez que vous cherchiez quelqu'un pour prendre la tête du service des ventes de votre entreprise et que vous deviez choisir entre un hétéro blanc et une lesbienne noire. Imaginez aussi que la lesbienne noire est plus compétente que l'hétéro blanc. Eh bien le racisme, le sexisme et l'homophobie vous souffleront de choisir l'hétéro blanc tandis que le capitalisme vous dictera de prendre la femme noire. Tout cela pour vous dire que même si certains capitalistes peuvent être racistes, sexistes et homophobes, le capitalisme lui-même ne l'est pas. (...)
Ces quarante dernières années, les étudiants des universités américaines ont changé, et de deux façons. Premièrement, ils se sont beaucoup diversifiés. Deuxièmement, ils sont toujours plus riches. Cela signifie qu'alors que les universités américaines se sont autoproclamées de plus en plus ouvertes (à la diversité), elles se sont en réalité de plus en plus fermées. Ça ne veut pas seulement dire que les jeunes issus de milieux modestes ont du mal à payer leur scolarité, ça signifie aussi qu'ils ont reçu un enseignement si bas de gamme dans le primaire et le secondaire qu'ils n'arrivent pas à passer les examens d'entrée à l'université. Donc, la première chose à faire lorsqu'on décide de mettre en place une politique de discrimination positive, c'est de le faire par classes et non par races. La seconde – mais de loin la plus importante – chose à faire serait de commencer à réduire les inégalités du système éducatif américain dès le primaire. Tant que ça ne sera pas fait, les meilleures universités américaines continueront à être réservées aux enfants de l'élite comme le sont, pour l'essentiel, les meilleures grandes écoles françaises. (...)
Du point de vue de la justice économique, Obama, c'est juste un Sarkozy noir. Bien sûr, ce n'est pas un problème pour Sarkozy, mais c'est un problème pour tous les gens qui se disent de gauche, qui aiment Obama et pensent que l'engagement dans la diversité dont il est le produit va également produire une société plus égalitaire. Le thème central de La Diversité contre l'Egalité, c'est qu'ils se trompent ; la diversité est au service du néolibéralisme, et non son ennemie. »
Walter Ben Michaels, auteur de "La Diversité contre l’Egalité" (Liber, 2009), interviewé par Marianne, 21 février 2009
00:26 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, modes, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Censure et diffamation

Censure et diffamation
Dans le précédent numéro, j’ai signalé le blog « Entre guillemets... » qui comprend une partie consacrée à Céline et une autre à l’actualité vue de droite, sans complexe ¹. Est-ce celle-ci ou celle-là qui a défrisé un internaute peu tolérant ? Toujours est-il que ce vigilant citoyen a dénoncé ce blog auprès de « Google ». Conséquence : si l’on souhaite y accéder via ce moteur de recherche, on tombe sur un avertissement, sorte de filtre bien-pensant qui permet l’accès audit blog à condition de cliquer sur l’une des deux options proposées : « poursuivre » (après avoir pris connaissance de cet avertissement), comme s’il s’agissait d’un vulgaire site pornographique. Ce procédé témoigne, une fois encore, d’une intolérance bien dans l’air du temps. Ce qui est tout autant déplaisant, c’est le commentaire d’un (autre) internaute, le fameux célinien-reconnaissable-entre-tous, qui, sous le couvert de l’anonymat, m’accuse de mettre en danger le webmestre en raison du fait que, dans cet article, je précise son identité. Imagine-t-il, cet autre sycophante, que celle-ci fut révélée sans l’aval de l’intéressé ?! Pour la gouverne de ce lecteur (faussement ingénu ou franchement malveillant) qui se répand sur la toile, je confirme donc que le texte intégral de cet article fut soumis avant publication à l’animateur du blog. Mieux : c’est ce dernier qui m’avait transmis ces indications afin qu’elles fussent insérées dans cet article destiné à faire connaître son initiative auprès des lecteurs du BC ².
Ceci m’amène à une réflexion. Dès lors que l’on édite, sur la toile ou ailleurs, un travail régulier sur Céline, faut-il plonger dans la clandestinité comme s’il s’agissait d’une activité répréhensible ? Si tel est le cas, serais-je une sorte de héros de la cause célinienne puisque voici trente ans que j’édite une publication célinienne (d’abord une revue, puis ce bulletin) à visage découvert ? Certes, cela m’a valu des procès d’intention et même parfois des intimidations : le seul fait d’éditer une publication mensuelle consacrée à Céline étant considéré par certains comme une inqualifiable provocation. Il s’est même trouvé un libraire (célinien !) qui n’a pas craint de me dénoncer comme coupable de mauvaises pensées à sa clientèle… laquelle s’est empressée de me le signaler. Comme, dans le même temps, certains lecteurs du BC me reprochaient de trop donner la parole aux détracteurs de Céline, j’ai considéré que ces critiques s’annulaient en quelque sorte. Dans certaines situations, il convient de demeurer impassible. Pour en revenir au blog, d’autres internautes ont heureusement tenu à contredire mon accusateur public. Même si Céline demeure un sujet controversé, ne serait-il pas temps de le défendre, en tant qu’écrivain, sans craindre, à chaque fois, les foudres ou les ukases de tel ou tel ? Et si aucun (modeste) hommage public ne peut manifestement lui être rendu, à Paris, Rennes ou Genève, il n’est pas encore interdit, que je sache, de lui consacrer une revue, un blog ou une émission radiophonique. Et ce serait, à mon sens, donner raison aux minables censeurs que de se dissimuler, comme eux, sous des pseudonymes ou l’anonymat, par ailleurs si commode pour tenter de nuire à ceux envers lesquels on nourrit une rancœur tenace.
Marc LAUDELOUT
1. M. L., « Un blog consacré à Céline », Le Bulletin célinien, n° 304, janvier 2009. (http://ettuttiquanti.blogspot.com)
2. Entre-temps, Matthias Gadret, l’animateur de ce blog, me signale que cet article lui a valu une audience accrue et des témoignages enthousiastes de lecteurs du Bulletin.
00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : censure, diffamation, totalitarisme, intolérance |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Néo-nationalisme et "Neue Rechte" en RFA de 1946 à 1988

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1988
Néo-nationalisme et «Neue Rechte» en RFA de 1946 à 1988
par René LAUWERS
Placer la "Nouvelle Droite" allemande sous la loupe n'est pas une chose aisée; d'abord parce que le terme n'est ni utilisé ni revendiqué par les hommes et les regroupements que les journalistes rangent arbitrairement sous cette étiquette. En effet, le vocable "Neue Rechte" est une création de journalistes, une paresseuse commodité de vocabulaire qui désigne les tentatives d'innovation idéologique et pratique qui sont survenues dans le camp "nationaliste" en RFA. Récemment, Margret Feit a tenté de mener une enquête dans ce landernau et il en est sorti un livre, épais de 244 pages qui foisonnent d'informations utiles mais aussi, hélas, de commentaires incongrus et de simplifications abusives.
La raison de ces déraillements est simple: Margret Feit est une militante anti-fasciste professionnelle, une de ces Don Quichotte qui, quarante après l'effondrement spectaculaire du Reich de Hitler, passe son temps à harceler des fantômes de plus en plus poussiéreux. Mais la variante de son donquichottisme diverge un peu de celle de ses collègues francophones de la bande à Article 31 (Paris) ou à Celsius (Bruxelles); ceux-ci s'emmêlent les pinceaux, fabriquent des complots rocambolesques où l'on voit, par exemple, le Ministre de la Justice belge Jean Gol, libéral et israëlite, planifier, dans un arrière-restaurant bruxellois, l'émergence d'un gigantesque réseau para-militaire avec l'ancien chef du mouvement Jeune Europe, Jean Thiriart, et un représentant du Président zaïrois, Mobutu Sese Seko! Margret Feit ne pousse pas la plaisanterie aussi loin.
Pourquoi lire ce livre?
Si les gugusses d'Article 31, deCelsius, leur copain flamand qui sévit au Morgen et le non moins inénarrable Maurice Sarfatti, alias Serge Dumont, plumitif au Vif/L'Express dont les collègues se gaussent en privé en disant, poliment, "Il est resté un grand adolescent...", relèvent tous de la fantaisie charmante, de l'incurable gaminerie des fils à papa des Golden Sixties, Margret Feit effectue un travail plus sérieux; elle est de la variante masochiste, celle qui traque (mal) ses propres fantasmes mais collectionne quand même les documents authentiques afin de dénoncer, croit-elle, un véritable réseau, perclus de méchanceté et prêt à se jeter sur la pauvre démocratie comme le loup de la fable sur l'agneau tendrelet. Mais Dame Feit est archiviste, elle cite ses sources et c'est pourquoi son livre vaut une note, même s'il ne contient pas d'index et si le canevas des chapitres qui se veulent une analyse du contenu intellectuel de la "Neue Rechte" est purement et simplement repris d'un livre utile et bien fait, paru en 1975 (il y a 14 ans!) et dû à la plume de Günter Bartsch (1).
Il vaut plus d'une note si on le débarrasse de ses fantasmes, certes traqués, mais qui reviennent à chaque paragraphe au grand galop, pour être sans cesse repoussés par l'énergie terrible que déploie le désir quasi névrotique de Margret Feit d'acquérir tout de même un brin de respectabilité scientifique. Considérons donc que ce livre à une certaine valeur, qui demeure cachée derrière des broussailles de fantasmes, et qu'il faut savoir le lire avec l'adresse d'un défricheur professionnel.
Le camp nationaliste avant l'avènement de la "Neue Rechte"
Dès 1946, apparaît la DReP (Deutsche Rechts-Partei; = Parti Allemand du Droit), fusion de la DKoP (Deutsche Konservative Partei) et de la DAP (Deutsche Aufbau-Partei; = Parti Allemand de la Reconstruction), deux formations nées en 1945. La DReP, dirigée par Fritz Dorls et Fritz Rößler, était trop hétérogène pour pouvoir durer; l'aile conservatrice se sépara de l'aile socialisante qui, avec les deux chefs de file, forme en 1949, la SRP (Sozialistische Reichs-Partei). En octobre 1952, le gouvernement interdit ce parti, sous la pression des alliés, inquiets parce qu'il avait fait preuve d'un certain dynamisme (1951: 11% des voix en Basse-Saxe et 16 sièges). Le parti s'était opposé à la politique pro-occidentale d'Adenauer, luttait pour une Allemagne réunifiée dans la neutralité et concurrençait sérieusement les "gauches" grâce à son programme social audacieux. Margret Feit ne souffle mot de cet engagement résolument non droitier... L'interdiction oblige les militants à changer de sigle et à modifier le style de leur propagande. Ce sera, notamment, la DRP (Deutsche Reichs-Partei) qui prendra le relais en enregistrant encore un certain succès en Basse-Saxe (8,1%, plus que les libéraux de la FDP). Le redressement économique joue cependant en faveur des partis confessionnels et de la SPD.
Du nationalisme étatique au nationalisme plébiscitaire et "basisdemokratisch"
A la suite de l'échec et de l'interdiction de la SRP et de la stagnation de la DRP, les milieux nationalistes opèrent une sorte de retour sur eux-mêmes. Les plus audacieux rejettent toutes formes de pro-occidentalisme et choisissent un neutralisme ou une forme allemande de gaullisme. Mais les critiques se portent essentiellement contre les reliquats d'étatisme bismarckien que véhiculaient encore les dirigeants du "vieux nationalisme" de la SRP et de la DRP. Le noyau organisationnel de cette révision hostile à l'étatisme centralisateur, ce fut la DG (Deutsche Gemeinschaft; = Communauté Allemande) d'August Haußleiter, issu de la CSU bavaroise. Cette DG était nationale-neutraliste et anti-libérale dans le sens où l'entendaient les principaux protagonistes de la "konservative Revolution" du temps de Weimar. L'Etat auquel aspirait cette formation se légitimerait, non sur la puissance d'un parti qui gagnerait les élections, mais sur la volonté populaire, génératrice d'une harmonie et d'une convivialité populaires. D'emblée, avec un tel programme, annoncé pour les deux républiques allemandes et pour l'Autriche, les militants de la DG ont pris le parti des peuples colonisés en lutte pour l'acquisition de leur indépendance (Egypte nassérienne, FLN algérien, etc.) car ces combats sont à mettre en parallèle avec la volonté des Allemands d'obtenir, eux aussi, leur propre auto-détermination.
En mai 1965, alors que les restes de la DRP venaient de se rassembler au sein d'une nouvelle formation, la NPD (National-Demokratische Partei Deutschlands), fondée en novembre 1964, la DG, avec le DFP (Deutsche Freiheits-Partei; = Parti Allemand de la Liberté) et la VDNV (Vereinigung Deutsche National-Versammlung; = Association pour le Rassemblement national-allemand), se mue en AUD (Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutsche; = Communauté d'Action des Allemands Indépendants). Un clivage net se forme immédiatement: les vieux-nationalistes, étatistes, se retrouvent à la NPD, tandis que la gauche des nationaux, avec les principaux intellectuels, se retrouve à l'AUD.
De l'AUD à l'ouverture aux mouvements de gauche et à l'écologisme
Notons que la VDNV comptait dans ses rangs Wolf Schenke, fondateur d'une conception de "troisième voie" et partisan de la neutralité, et l'historien Wolfgang Venohr (cf. Orientations n°3). L'AUD, fidèle à son refus des vieilles formules étatistes et fascisantes et à sa volonté populiste et organique, s'ouvrira à l'APO (Außerparlamentarische Opposition; = Opposition extra-parlementaire) gauchisante et fera sienne quantité d'arguments pacifistes et néo-démocratiques (dont l'objectif est l'édification d'une démocratie au-delà des partis et des familles idéologiques traditionnelles). Les pourparlers engagés avec l'APO échoueront (bien que plusieurs responsables de l'APO et du SDS, son organisation étudiante, se retrouveront dans les années 80 dans le camp néo-nationaliste) et les militants de l'AUD investiront les cercles d'écologistes, au nom d'un idéologème organique, de tradition bien romantique et germanique: la protection de la Vie (Lebensschutz). Plusieurs de ces militants fonderont, avec des éléments plus gauchistes, le fameux "Parti des Verts" que nous connaissons aujourd'hui.
Les Strassériens: "Troisième Voie", Solidarisme, Européisme
Les Strassériens, regroupés autour d'Otto Strasser, constituent une composante supplémentaire du néo-nationalisme d'après 1945. Dès l'effondrement du IIIème Reich, Otto Strasser, depuis son exil canadien, envoie massivement des "Rundbriefe für Deutschlands Erneuerung" (= Circulaires pour le Renouveau Allemand) à ses sympathisants. Ces circulaires évoquent une réunification allemande sur base d'une "troisième voie européenne", axée sur un solidarisme qui renverrait dos à dos le capitalisme libéral occidental et le socialisme à la soviétique. Ce solidarisme abolirait les clivages de classe, tout en forgeant une élite dirigeante nouvelle. L'unité allemande, vue par Strasser, implique un neutralisme armé, noyau militaire futur d'une Europe indépendante qui doit devenir une puissance politique égale, sinon supérieure, aux USA et à l'URSS. Cette Europe serait l'alliée du Tiers-Monde, car les pays de ce Tiers-Monde devront fournir les matières premières à la "Fédération Européenne" en gestation.
Pour soutenir et diffuser ce programme, les Strasseriens ouest-allemands fondent en 1954 la DSU (= Deutsche Soziale Union). Plusieurs militants nationaux-révolutionnaires y ont fait leurs premières armes, notamment Henning Eichberg entre 1956 et 1959. En 1961, il passe à la VDNV de Venohr et Schenke (cf. supra). Ce passage implique un abandon de l'étatisme et du centralisme néo-strassériens et une adhésion au démocratisme populiste, dont l'AUD allait se faire le champion.
Auto-gestion ouvrière et nationalisme de libération
Dans cette même mouvance, apparaissent les "Vötokalisten" autour d'E. Kliese. Ce cercle politique élabore une théorie nouvelle de l'auto-gestion ouvrière, dérivée des principes du "socialisme allemand" (cf. Orientations n°7 et Trasgressioni n°4), seule véritable rénovation du marxisme en ce siècle. Cette théorie de l'auto-gestion formera le noyau de la doctrine sociale de l'UAP (= Unabhängige Arbeiter Partei), autre formation qui se crée au début des années soixante et qui se veut "la formation de combat pour un socialisme libertaire et démocratique de la nation allemande". Vötokalisten et militants de l'UAP se réclament de Ferdinand Lassalle, fondateur de la social-démocratie allemande et admirateur de l'œuvre de Bismarck. Le lecteur francophone constatera ici combien proches de la social-démocratie sont les différentes variantes du néo-nationalisme allemand.
Ce socialisme allemand, à connotations lassalliennes, s'oppose tant à la NPD, jugé droitière, qu'aux communistes et à la SPD, jugés traîtres à l'idéal socialiste. Un personnage important apparaît dans cette mouvance: Wolfgang Strauss, ancien militant du parti libéral est-allemand (LDPD) et ancien forçat de Vorkhuta. Strauss se fait l'avocat d'un socialisme populaire et d'un nationalisme de libération, dont le modèle dérive, entre autres, de la résistance ukrainienne, du solidarisme russe et de la révolution hongroise de 1956. Le nationalisme est conçu, dans cette optique, comme le levain sentimental qui fera naître un socialisme proche du peuple, résolument anti-impérialiste, hostile aux super-gros, ethno-pluraliste.
Le déclin de la NPD
Malgré quelques succès initiaux lors des élections dans les Länder, la NPD ne parvint jamais à dépasser le score de 4,3% (en 1969) pour le scrutin fédéral. Le parti s'est divisé entre idéalistes et opportunistes, tandis que la mouvance du nationalisme démocratique, néo-socialiste et pré-écologique attire davantage les intellectuels et les étudiants. Cette strate sociologique est effectivement porteuse des principales innovations idéologiques du néo-nationalisme allemand à la veille de l'agitation de 68. Si l'on s'intéresse à cette germination constante plutôt qu'aux structures fixes, une analyse des associations étudiantes qui se sont créées en marge de la NPD (et souvent en opposition directe à elle) se révèlera très utile.
Plusieurs initiatives se succèderont dans le monde universitaire. Parmi elles, le BNS (= Bund Natio-na-ler Studenten; Ligue des Etudiants Nationaux) en 1956, sous l'impulsion de Peter Dehoust, l'actuel directeur de la revue Nation Europa (Cobourg). De-houst et ses compagnons voulait appuyer le combat proprement politique des nationaux par une in-ter-ven-tion tous azimuts dans le domaine de la "culture", ce qui, dans le langage politique allemand, s'appelle en--gager un nouveau "Kulturkampf". Les disci-pli-nes que privilégiait ce "Kulturkampf" étaient bien en-tendu l'histoire et la biopolitique. Le BNS a assu-ré-ment constitué un modèle d'organisation bien conçu, mais son message idéologique était, sous bon nom-bre d'aspects, plus conservateur que le pro-gram-me et les intentions de la DG qui, plus tard, donnera l'AUD.
Les organisations qui prendront le relais dans les années soixante, entre la mise sur pied de la NPD et l'effervescence de 67-68, seront, elles, plus fidèles au populisme révolutionnaire et assez hostiles aux derniers linéaments d'étatisme. En octobre 1964, Sven Thomas Frank, Bodo Blum et Fred Mohlau fondent à Berlin l'IDJ (= Initiative der Jugend; Ini-tia-tive de la Jeunesse), qui, en 1968, fusionera avec quelques autres organisations militantes pour for-mer l'APM (= Außerparlamentarische Mitarbeit; Coopé-ra-tion extra-parlementaire); cette nouvelle ini-tia-tive était à l'évidence calquée sur l'APO (= Außer-par-la-mentarische Opposition) gauchiste. L'APM vi-sait à regrouper les nationaux, ceux qui ne re-non-çaient pas à l'idée d'une réunification allemande et ne cessaient de considérer Berlin comme la capitale unique de tou-te l'Allemagne.
Rudi Dutschke et Bernd Rabehl glissent vers une forme de nationalisme
Günther Bartsch souligne très pertinemment, au con--traire de Margret Feit, que, malgré le clivage ini-tial induit par la
question nationale, les groupes d'é-tudiants glissaient tous, gauchistes comme natio-na-listes, vers une forme nouvelle, militante et re-ven-dicatrice de nationalisme. Bartsch rappelle que les deux leaders gauchistes du Berlin de 68, Rudi Dut-schke et Bernd Rabehl, ne posaient pas du tout l'é-quation éculée: "nationalisme = fascisme". Au contraire, très tôt, Rabehl, dans plusieurs textes théo-ri-ques, insista sur le fait que les motivations natio-na-listes avaient joué un rôle de premier plan dans les révolutions française, russe, yougoslave et chinoise.
Dialectiquement, selon Rabehl, le natio-na-lisme re-cè-le une utilité progressiste; il dynamise le pro-cessus de l'histoire et provoque l'accélération des conflits de classe, donc le déclenchement des ré-vo-lutions so-cialistes. L'idéologie nationale permet de don-ner un discours unificateur aux différentes com-posantes de la classe ouvrière. A l'échelle du globe, poursuit Ra-behl, un néo-nationalisme allemand, por-té par la clas-se ouvrière, permettrait d'ébranler le condomi-nium américano-soviétique, incarnation de la réac-tion, de l'immobilisme, au XXème siècle, tout com-me le "système Metternich", issu du Congrès de Vienne de 1815, l'avait été au début du XIXème.
Dutschke, avec tout son charisme, appuya ce glis-sement entamé par son camarade Rabehl. Il alla mê-me plus loin: il écrivit que le XXème siècle alle-mand avait connu trois formes de socialisme ouvrier et révolutionnaire: la SPD socialiste, la KPD com-mu-niste et... la NSDAP de Hitler (à qui il re-prochait toutefois certaines compromissions et orien-ta-tions diplomatiques). Cette réhabilitation (très) partielle du rôle historique de la NSDAP démontre à l'évidence que l'anti-fascisme manichéen, qui fait rage de nos jours, n'avait déjà plus droit de cité chez les théo-ri-ciens gauchistes sérieux des années 60. Margret Feit ne souffle évidemment mot de ce glissement et évite, dogmatiquement, de se pencher sur la valeur théo-rique de cet argu-men-taire commun à la "Nouvelle Gauche" et à la "Nouvelle Droite". Bartsch constate que les mili-tants de gauche et les jeunes nationalistes avaient bon nombre d'idées en commun, notam-ment:
- le refus de l'establishment;
- la critique de la société de consommation;
- l'hostilité à l'encontre des manipulations média-ti-ques;
- le refus de l'hyper-spécialisation;
- l'attitude anti-technocratique à connotations écolo-gi-ques;
- l'anticapitalisme et la volonté de forger un nouveau socialisme;
- le mythe de la jeunesse rénovatrice;
- l'anti-bourgeoisisme où marxisme et niétzschéisme se mêlaient étroitement;
- la volonté de remettre absolument tout en question.
Pourquoi nationalistes et gauchistes n'ont-ils pas mar-ché ensemble contre le système, puisque leurs po--sitions étaient si proches? Bartsch estime que c'est parce que les nationalistes véhiculaient encore de ma---nière trop patente des imageries et des références du passé, tandis que la gauche maniait la théorie "cri--tique" avec une dextérité remarquable et béné-fi-ciait de l'impact retentissant du livre de Marcuse, L'homme unidimensionnel. La césure entre les "sty---les" était encore insurmontable.
"Junges Forum" et "Junge Kritik": un laboratoire d'idées à Hambourg
La revue Junges Forum, fondée en 1964 à Ham-bourg, envisageait d'emblée de "jeter les bases théo-riques d'une pensée nouvelle". La volonté qui ani-mait cette intention, c'était de sortir du ghetto stric-te-ment politique, où se percevait une nette stagna-tion quant au recrutement de militants nouveaux, et de sug-gérer aux citoyens dépolitisés un message neuf, sus-ceptible de les intéresser et de les sortir de leur tor-peur. Ceux que Margret Feit nomme les "têtes pen-santes" de la "Neue Rechte" ont publié articles et manifestes dans les colonnes de Junges Forum. Par-mi elles: Wolfgang Strauss, Lothar Penz, Hans Am-hoff, Henning Eichberg et Fritz Joß. Les thèmes abor-dés concernaient: le renouveau intellectuel, la re-cherche d'une forme de démocratie plus satisfai-san-te, l'élaboration d'un socialisme organique, la réu-ni-fi-cation allemande, l'unité européenne, l'ébauche d'un ordre international basé sur les principes de l'or-ganicité, l'écologie, le régionalisme, le solida-ris-me, etc.
En 1972, le comité de rédaction de la revue publie un manifeste en 36 points, dont l'objectif avéré est de poser les bases d'un socialisme populaire et orga-nique, capable de constituer une alternative cohé-ren-te aux idéologies libérale et marxisante alors do-mi-nan-tes (le texte, sans les notes, est reproduit in ex-ten-so en annexe du livre de Bartsch). Ce manifeste exer-cera une influence relativement modeste chez nous, notamment dans certains cercles proches de la Volksunie, chez les solidaristes flamands, chez les régionalistes, chez quelques néo-socialistes et/ou so-lidaristes bruxellois, notamment dans la revue ly-céenne Vecteurs (1981) dont il n'est jamais paru qu'un seul numéro, lequel reproduisait une tra-duc-tion adaptée du programme de Junges Forum, par Chris-tian Lepetit, militant de l'AIB (Anti-Impe-rialistische Bond; Ligue Anti-Impérialiste) para-maoïs-te. Robert Steuckers diffusait ce mes-sage dans l'or-bi-te de la revue Pour une renaissance européenne, organe du GRECE-Bruxelles, dirigé par Geor-ges Hupin.
Nationalisme européen, nouvel ordre économique, philosophie et politique
Parallèlement à la revue paraissait une collection de pe-tits livres de poche, dénommée Junge Kritik. Da-van--tage encore que les cahiers de Junges Forum, les textes de réflexions alignés dans les pages des trois volumes de Junge Kritik constituent la base es-sen-tielle d'une rénovation totale de la pensée natio-na-liste à l'aube des années 70 (la parution des trois premiers fascicules s'étend de 1970 à 1973). Mar-gret Feit, évidemment, ne s'intéresse pas à l'évo-lu-tion des idées: elle préfère fabriquer un puzzle de connections réelles ou imaginaires pour étayer une Xième théorie du complot.
L'objectivité nous oblige à recourir directement aux textes. Dans le volume n°1 (Nationalismus Heute; = Le Nationalisme au-jour-d'hui), les jeunes leaders Hartwig Singer (pseu-donyme d'Henning Eichberg), Gert Waldmann et Mi-chael Meinrad entonnaient un plaidoyer pour une européanisation du nationalisme et, partant, pour une libération de l'ensemble de notre sous-continent des tutelles américaine et soviétique. Le nationalisme rénové serait dès lors "progressiste" puisqu'il im-pli-querait, non la conservation de structures mortes (comme le suggère la vieille historiographie libé-ra-le/marxiste), mais la libération de nos peuples d'u-ne oppression politique et économique, fonctionnant à deux vitesses (l'occidentale et la soviétique), ce qu'a--vaient déjà envisagé les "dutschkistes" berli-nois.
Dans le second volume de Junge Kritik, intitulé Leis-tungsgemeinschaft (= communauté de presta-tion), Meinrad, Joß et Bronner développent le pro-gramme économique du néo-nationalisme: solida-rité des strates laborieuses de toutes les nations, pro-prié-té des moyens de production pour tout ceux qui pres--tent, limitation drastique des concentrations ca-pitalistes. Hartwig Singer, pour sa part, y publiait un Manifest Neue Rationalität (= Manifeste pour une nouvelle rationalité), où le parallèle avec les ef-forts d'Alain de Benoist à la même époque saute aux yeux. Singer et de Benoist, en effet, voulaient, par le biais de l'empirisme logique anglo-saxon et de l'in--terprétation que donnait de celui-ci le Français Louis Rougier, lancer une offensive contre l'essen-tia-lisme des idéologies dominantes de l'époque. Singer ajoutait toutefois à ce message empiriste et rougiérien l'apport de Marx, pour qui toute idéologie cache des intérêts, et de Max Weber, théoricien du processus de rationalisation en Occident. Singer, s'ins-crivant dans un contexte allemand nettement plus révolutionnaire que le contexte franco-parisien, grèvé d'un anti-marxisme trop littéraire, osait mo-bi-liser le Marx dur et réaliste contre le Marx abstrait et faux des néo-moralistes. Ce qui permettait de corri-ger l'apoli-tisme de Rougier qui conduisait à un con-ser-vatisme BCBG, incapable de briser les incohé-ren-ces prati-ques du libéralisme ambiant de l'Oc-ci-dent.
Le néo-nationalisme est "progressiste"
Dans le troisième volume, qui eut pour titre Euro-päischer Nationalismus ist Fortschritt (= Le Na-tio-na-lisme Européen, c'est le progrès!), Meinrad, Wald--mann et Joß reprenaient et complétaient leurs thèses, tandis que Singer, dans sa contribution ("Lo-gischer Empirismus"), accentuait encore le modernis-me conceptuel de Junge Kritik; la proximité de sa démarche par rapport à celle d'Alain de Benoist dans Nouvelle Ecole en 1972-73 apparaît plus évidente encore que dans le texte Manifest Neue Rationalität. Singer non seulement cite abondamment Nouvelle Ecole mais incite ses camarades à lire Monod, Rus-sell, Rougier et Heisenberg, quatre auteurs étudiés par Nouvelle Ecole. Singer ajoute que, de cette qua-druple lecture, il est possible de déduire un socia-lis-me de type nouveau (Monod et Russell), un néo-na-tionalisme (Heisenberg) et une nouvelle "conscience européenne" (Rougier). Rougier, en effet, avait dé-mon-tré que le génie européen était le seul génie ou-vert sur le progrès, capable d'innovation et d'adapta-tion. La rationalité européenne, selon Rougier, de Be-noist et Singer, transcendait largement les idéaux orientaux contemplatifs que la vogue hippy, dans le sillage de 68 et de la contestation américaine contre la guerre du Vietnam, injectait dans l'opinion pu-blique. Le néo-nationalisme apparaissait dès lors com-me progressiste, car ouvert aux sciences moder-nes, tout comme il apparaissait progressiste aux yeux de Dutschke et Rabehl car il pouvait briser, par son énergie, l'oppression représentée par une aliéna-tion macro-politique: celle instaurée à Yalta.
Ce tandem philosophique germano-français ne dure-ra pas: quelques années plus tard, la revue Eléments, organe du GRECE et proche d'Alain de Benoist, attaque la mouvance écologique, dans laquelle les Al-le-mands se sentent directement engagés. Sur le plan de la défense nationale, les Français appuyent l'ar-mement atomique national, démarche dans laquelle les Allemands ne se sentent pas concernés. Ce n'est qu'à partir de 1982, quand Alain de Benoist tranche nettement en faveur du neutralisme allemand, que les positions respectives des Allemands et des Français se rejoignent une nouvelle fois.
L'apport flamand
En Flandre, le pays où, en dehors de l'Allemagne, Junges Forum compte le plus d'abonnés, le soli-da-risme et le régionalisme de la revue hambourgeoise ont éveillé beaucoup d'intérêt, si bien que bon nombre d'écrivains (méta)politiques flamands ont contribué à l'effort de Junges Forum. Citons, pêle-mêle: Jos Vinks (Le nationalisme flamand, 1977; Le pacifisme du mouvement flamand, 1981; La langue afrikaans, 1987), Roeland Raes (Le régionalisme en Europe, 1979), Willy Cobbaut (L'alternative solida-riste, 1981), Frans de Hoon (Approche positive de l'anarchisme, 1982), Piet Tommissen (Le con-cept de "métapolitique" chez Alain de Benoist, 1984), Robert Steuckers (Henri De Man, 1986). A l'oc-ca-sion du 150ième anniversaire de la Belgique, en 1980, Jos Vinks, Edwin Truyens, Johan van Her-re-weghe et Pieter Moerman expliquent, d'un point de vue flamand, les racines historiques et la si-tuation de la querelle linguistique en Belgique. La contribution française se limite, en 1984, à un texte d'Alain de Benoist définissant la "Nouvelle Droite" et à un essai de Jacques Marlaud sur la théorie grams-cienne de la métapolitique et sur son appli-cation pratique par la "Nouvelle Droite".
On imagine ce qu'aurait pu donner, en Europe, une fusion du "dutschkisme", du néo-européisme et de la praxis gramscienne -ce qu'a-vaient espéré les quelques lycéens bruxellois fran-cophones, regrou-pés autour de Christian Lepetit et Eric Delaan, avant que la dispersion universitaire et le service militaire ne les séparent... La mésaventure furtive de Lepetit et de Delaan mérite l'attention car elle montre que le néo-nationalisme néo-socialiste et régionaliste, pré-co-nisé par les Allemands, pouvaient séduire, au-delà des frontières, des garçons qui militaient dans la mouvance anti-impérialiste du maoïsme en pleine li-qué-faction.
Les "groupes de base" nationaux-révolutionnaires
Parallèlement à l'entreprise Junges Forum, qui se pour-suit toujours aujourd'hui et qui fêtera ses 24 ans en 1988, la mouvance néo-nationaliste allemande s'est constituée en "groupes de base" (Basis-grup-pen). Le terme est issu du vocabulaire de la con-tes-tation gauchiste. Les organisations étudiantes de gau--che avaient débordé le cadre universitaire et en-va-hit les lycées et les usines. L'émergence du "grou-pe de base" si-gnifie que, désormais, il existe une im-brication des révolutionnaires nationaux dans toutes les couches de la société. Cette diversification pos-tule une décentralisation et une relative auto-no-mie des groupes locaux qui doivent être prêts à intervenir à tout moment et très vite dans leur ville, leur lycée, leur usine, sans devoir s'adresser à une instance centrale.
Agitation à Bochum
La stratégie des "groupes de base" se manifestera de la façon la plus spectaculaire à l'Université de la Ruhr à Bochum. Un groupe d'activistes néo-natio-na-listes y militait efficacement et y avait fondé un jour-nal, le Ruhr-Studenten-Anzeiger. Autour de cet-te feuille militante, s'organise en 1968 un "Repu-bli-kanischer Studentenbund" (RSB; = Ligue des Etu-diants Républicains) qui se propose de devenir un con-tre-poids au SDS gauchiste. L'affrontement n'al-lait pas tarder: les militants du RSB reprochaient au SDS d'organiser des grèves sans objet afin d'asseoir leur pouvoir sur les masses étudiantes. Au cours d'un blocus organisé par les gauchistes, le RSB prend l'université de Bochum d'assaut et proclame, avec un langage marxiste-populiste, son hostilité aux "ex-ploiteurs" et aux "bonzes" du SDS, devenus par--ties prenantes d'un néo-establishment, où le gau-chisme avait désormais sa place. Les proclamations du RSB, rédigées par Singer, étaient truffées de ci-tations de Lénine, de Marx et de Mao. Singer se ré-fé-rait également aux discours tenus par les agitateurs ouvriers berlinois contre les fonctionnaires commu-nistes d'Ulbricht, lors du soulèvement de juin 1953. Les révoltés insultaient les fonctionnaires est-alle-mands de la SED, marionnettes des Soviétiques, de "singes à lunettes", de "patapoufs adipeux" et de "ronds-de-cuir réactionnaires". Cette annexion du vo---cabulaire marxiste et de la verve berlinoise de 53 irritait les gauchistes car, ipso facto, ils perdaient le monopole du langage-choc militant et entrevoyaient une possible intrusion des NR dans leurs propres milieux, avec le risque évident du débauchage et de la contre-séduction...
Les bagarres de 1968 et l'adoption par les natio-na-listes d'un langage puisé dans l'idéologie marxiste, bien qu'elles aient surpris le SDS, n'eurent guère d'échos en dehors de la Ruhr et durent affronter la cons-piration du silence. Le RSB et le Ruhr-Stu-den-ten-Anzeiger disparurent, sans pour autant entraîner la disparition totale d'une agitation nationaliste de gauche à Bochum. Ainsi, au début des années 70, les nationalistes participent aux manifestations de la gau-che contre la spéculation immmobilière et l'augmentation des loyers et reprennent à leur comp-te le slogan des groupes trotskystes: "La division de l'Allemagne, c'est la division du prolétariat alle-mand!". L'aventure du RBS est en ceci significative pour l'évolution ultérieure du néo-nationalisme alle-mand (que Margret Feit nomme abusivement "Neue Rechte"), qu'elle marque sa transition définitive vers la gauche, sa sortie hors du microcosme para-droi-tier dans lequel, du fait de l'existence de la NPD, il demeurait incrusté. La faillite et la stérilité historique du "droitisme" y sont proclamées et l'accent est mis résolument sur le socialisme, la rationalité critique, l'athéisme militant et le futurisme.
Munich et Bielefeld
Après Bochum, d'autres "groupes de base" voient le jour et chacun d'eux développe une originalité pro-pre. Ainsi, à Munich, Wolfgang Strauss forme un comité pour jeunes travailleurs, lycéens et étu-diants, dont l'objectif est de donner une culture mi-litante, basée sur la littérature et la science politique. Strauss nomme son groupe "Club Symonenko", du nom d'un poète ukrainien, Wasyl Symonenko, dé-cé-dé en 1963, après avoir subi la répression so-vié-tique. Ce comité exige la libération de l'historien ukrai-nien Valentin Moro, organise des soirées avec l'écrivain polonais exilé Zygmunt Jablonski et des matinées du 17 juin, en souvenir du soulèvement ouvrier berlinois de 1953, distribue des tracts bilin-gues en faveur de l'IRA irlandaise et fonde un "cer-cle de travail" James Connolly, en hommage au syn-dicaliste militant et nationaliste irlandais, qui savait puiser ses arguments dans la mythologie celtique. Les références allemandes étaient le poète Georg Büch-ner, fondateur au XIXème siècle de la "Société des droits de l'Homme" et le poète romantique Theo-dor Körner, engagé dans le "Corps Lützow" (Cf. la musique de Weber) pour chasser l'oppres-seur bonapartiste et ses troupes de pillards hors d'Al-lemagne. Strauss réussit à la veille des années 70 à jeter les bases d'une culture politique originale, puisant dans le corpus des nationalismes populaires et libertaires slaves et celtiques et à réveiller l'en-thousiasme des jeunes allemands pour leurs poètes nationalistes, libertaires, anarchisants et radicalement anti-bourgeois du début du XIXème. Ce corpus se main-tiendra tel jusque dans les colonnes de la revue Wir Selbst, au début des années 80 (cf. infra).
Si en Sarre et en Rhénanie-Westphalie, les "groupes de base" finissent par choisir une inféodation à la NPD —qui ne cessa jamais d'être problématique et d'engendrer des conflits idéologiques graves— à Bielefeld, le groupe "NJ-Stadtverband" (= Groupe urbain de la jeunesse nationaliste), proche des Berlinois de l'APM, parvient à organiser une agitation mo-derne, avec disques de chants protestataires com-posés par Singer, et à tirer un journal, Wendepunkt, à 4500 exemplaires! Du jamais vu! La tactique édi-toriale était de rassembler un maximum de textes et d'informations, émanant directement des militants, et de les aligner dans les colonnes du journal; d'au-tres "groupes de base" suivent la même stratégie, ce qui permet de former un cadre solide, grâce à une bonne division du travail et à une masse concentrée d'informations militantes. Le militantisme devenait ain-si vivant donc rentable.
Cinq types d'action
La coordination entre les groupes doit s'étendre à l'échellon national, pensait Meinrad, et éliminer la NPD droitière et désuète. Les groupes doivent comp-ter de 15 à 20 activistes locaux auto-financés grâce à des cotisations relativement élevées, et mener régulièrement cinq types d'action, explique Bartsch:
1) Les commémorations, notamment celle du 17 juin 1953 et du 13 août 1961, date à laquelle fut érigé le Mur de Berlin.
2) Les actions écologiques; le groupe Junges Forum de Hambourg y excella. Il organisa des Bürger-ini-tiativen (= Initiatives de Citoyens) contre la construction d'une autoroute en plein milieu de la ville. Le nationalisme, dans cette perspective, c'était de protéger l'intégrité naturelle du biotope populaire.
3) Les actions sociales: elles sont essentiellement di-rigées contre la spéculation immobilière, l'augmen-tation des loyers et l'augmentation des tarifs des trans-ports en commun. Ces actions visent aussi à ex-pliquer l'irrationalité du fonctionnement de la ma-chine étatique, qui prétend être une démocratie par-faite.
4) Les actions de solidarité: elles visent à soutenir les nationalismes contestataires est-européens, car, pen-sent les activistes néo-nationalistes ouest-allemands des années 70, l'unité allemande ne pourra se réali-ser que si un bouleversement majeur s'effectue en Europe de l'Est.
5) Les actions de résistance: il s'agit surtout de cha-huts contre la visite de personnalités est-allemandes à l'Ouest dans le cadre de l'Ostpolitik de Willy Brandt.
Vers l'unité: la NRAO ("Nationalrevolutionäre Aufbauorganisation")
L'ensemble des "groupes de base" ne forme pas un parti, structuré de façon rigide, mais un mouvement dynamique qui intègre sans cesse des informations et des faits nouveaux. Sa non-rigidité et sa diversité le mettent au dia-pason de l'actualité et empêchent tout encroûtement, tout repli sur soi et/ou sur un cor-pus figé. Le politique ne se joue pas seulement aux élec-tions, mo-ments furtifs, mais se déploie et s'insi-nue sans cesse dans la vie quo--tidienne. Mieux: il s'in-cruste dans les conscien-ces grâce à une agitation constante, laquelle implique que cha-que militant ait à cœur de se former personnellement chaque jour en lisant la presse et les livres, ceux qui con--fortent ses références culturelles essen-tiel-les et spontanées et ceux écrits par ses adver-sai-res, afin de bien con-naî-tre les clivages idéologiques qui s'articulent dans le pays.
Afin d'amplifier l'action de ces "groupes de base" bien imbriqués dans les villes et dans les universités allemandes, plusieurs figures de proue de cette mou-vance néo-nationaliste (ou nationale-révolutionnaire) décident en mars 1974 de créer une "organisation de coordination" qui prendra le nom de NRAO ou "Na-tionalrevolutionäre Aufbauorganisation" (= Organi-sa-tion de Construction nationale-révolutionnaire). Plu--sieurs réunions seront nécessaires pour mettre au point une stratégie commune. Au cours de la pre-mière, qui eut lieu les 2 et 3 mars 1974 à Würzburg, trois orateurs jetèrent les bases du renouveau: Alexan--der Epstein (alias Sven Thomas Frank), Lo-thar Penz et Hans Amhoff.
Le discours d'Epstein
Le discours tenu par Epstein révélait, entre autres cho--ses, une volonté de combattre les "ennemis de l'in-térieur", de réfuter le patriotisme ersatz ouest-euro-péen (l'intégration-CEE vendue comme une pa-nacée par les amis d'Adenauer), de jouer, en poli-tique in-ter-nationale, la carte chinoise contre les deux super-gros. Epstein intégrait de cette façon la théorie maoïste des "trois mondes" dans le corpus doctrinal NR. En outre, il pose le mouvement NR comme le seul mouvement authentiquement national, puisque la SED est-allemande et la DKP ouest-allemande sont à la solde de l'URSS, tandis que les partis bour-geois, la SPD, la FDP et la CDU/CSU cons-ti-tuent les garants de la présence américaine, malgré l'aile gauche de la SPD, favorable à une Ostpolitik démissionnaire. Dans ce schéma, la NPD, par son droitisme incurable, se place à la droi-te de la CSU bavaroise. Seul, le petit microcosme maoïste berli-nois, éditeur de la prestigieuse revue Befreiung, trou-vait grâce aux yeux d'Epstein qui, du coup, se faisait l'avocat d'une coopération tacite et courtoise en-tre maoïstes et NR.
Epstein, comme Penz et Amhoff, pensait que la stra-tégie à suivre ne pouvait nullement être clan-destine ou illégale; comme seuls les NR réclamaient de façon cohérente la réunification du pays, leur pro-gram-me était conforme au mot d'ordre inscrit dans le préambule de la constitution démocratique de la RFA, mot d'ordre qui demandait aux citoyens de mo-biliser tous leurs efforts pour redonner l'unité et la liberté à l'Allemagne. Ensuite, toujours à l'occa-sion de ce rassemblement de Würzburg, Penz pré-ci-se sa vision sociale "biohumaniste" et Amhoff ex-plicite sa définition rénovée du nationalisme moder-ne de libération, anti-impérialiste dans son essence.
La création de "Sache des Volkes"
La dispersion géographique des groupes, les modes de travail différenciés que chacun d'entre eux avait acquis et quelques divergences idéologiques firent en sorte qu'aucun centralisme ne pouvait plus cha-peau-ter la diversité propre au mouvement NR. Dès le 31 août 1974, Epstein (= S.T. Frank), Waldmann et Amhoff convoquent un millier de militants NR pour leur faire part de nouveaux projets: embrayer sur la contestation écologique parce que le massacre du paysage est l'œuvre d'un capitalisme apatride et dé-raciné; ébaucher un socialisme solidaire, po-pu-lai-re, enraciné, à la mode des socialismes adoptés par les peuples opprimés du tiers-monde; construire l'au-to-gestion ou-vriè-re à la façon yougoslave, etc. Le mou-vement "Sache des Volkes" (en abrégé, SdV; = Cause du Peuple), qui est issu de ce ras-semblement, se veut partie d'un mouvement mon-dial diffus qui lutte, partout dans le monde, contre le ca-pitalisme et le so-cialisme étatisé à la soviétique.
Hartwig Singer va donner corps à ce double refus, auquel adhéraient également les militants NR fran-çais (notamment ceux du CIPRE et de "Lutte du Peu-ple" de Yannick Sauveur et les militants proven-çaux du CDPU) et les Italiens et les Belges de Jeune Europe et de ses divers avatars. Dans le discours qu'il envoie aux congressistes et qui leur sera lu, il rap-pelle l'abc qu'est le refus de Moscou comme de Wa-shington, mais explique aussi qu'il est nécessaire de tenir compte de faits nouveaux: l'ennemi principal n'est plus le capitalisme localisé, à base nationale, mais le capitalisme multinational qui a fait de l'US Army et de l'Armée Rouge ses deux instances po-licières sur l'ensemble du globe. Singer désignait dès lors un ennemi plus précis, unique: le capital mul-ti--na-tional, dont les impérialismes classiques, ins-tallés de-puis Yalta, ne sont que les instruments. La po--litique de la détente, dans cette op-tique, n'aurait pour objectif que de permettre au capitalisme occidental multinational d'ouvrir des marchés à l'est.
SdV s'est exprimée de 1978 à 1988 dans la revue Neue Zeit qui continue de paraître à Berlin, tandis qu'une série de feuilles ont ponctué la vie militante du mouvement comme Laser (Düsseldorf), Ideo-lo-gie und Strategie, Rebell et Der Nationalre-vo-lu-tionär à Vienne; cette dernière paraît toujours sous la direction d'Helmut Müller.
Solidaristische Volksbewegung (SVB)
Tandis que les éléments les plus jeunes de la mou-vance NR calquaient leur stratégie offensive sur celle des gauchistes, les militants de Hambourg, regrou-pés autour de la revue Junges Forum et de la per-son-nalité de Lothar Penz, optaient pour un "so-li-da-risme" plus positif que le discours critique, offensif et révolutionnaire de SdV. De ce désaccord pratique, naîtra un mouvement parallèle, la "Solidaristische Volksbewegung" (= Mouvement Solidariste du Peu-ple), dont l'organe de presse sera SOL. En 1980, la SVB devient le BDS ("Bund Deutscher Soli-da-ris-ten"; = Ligue des Solidaristes Allemands), après avoir téléguidé la GLU écologiste ("Grüne Liste Umweltschutz"; = Liste Verte pour la Protection de l'Environnement). En janvier 1981, SOL fusionne avec Neue Zeit, qui devient ipso facto l'organe commun de SdV et du BDS.
"Wir Selbst" et NRKA
Les deux formations perdent au début des années 80 le monopole de la presse NR, à cause de l'apparition de deux nouveaux facteurs: la création par Siegfried Bu-blies de la presti-gieuse revue Wir Selbst (Cob-lence) et l'émergence d'un nouveau réseau coor-do-nateur, le NRKA ("Na-tio-nal-revolutionärer Koordi-na-tionsausschuß"; = Com-mission de Coordination NR), appuyé par la revue Aufbruch. Né à Düs-sel-dorf dans le sillage de la revue Laser préalablement in-féodée à SdV, le NRKA veut d'emblée rompre avec Neue Zeit pour aborder les questions sociales dans une perspective plus "progressiste" et pour ac-centuer encore la critique anti-capitaliste du mouve-ment NR.
Cette mutation provient du fait que les nouveaux membres de la cellule de Düsseldorf ne sont plus ex-clusivement issus de la filière néo-nationaliste clas-sique de notre après-guerre mais viennent sou-vent du marxisme-léninisme. Ces éléments nou-veaux en-tendaient rester fidèles à la "quintuple révolution" prônée par SdV, dans son manifeste de 1974. Quin-tuple révolution qui devait s'opérer aux niveaux na-tio-nal, social, écologique, démocratique et cultu-rel. La critique lancée par les militants du NRKA est le fait d'une "deuxième génération" NR, dont le mi-litantisme récent empêche de retomber dans les "er-rements" du paléo-nationalisme droitier.
De nouveaux vocables et concepts apparaissent, no-tamment celui d'une "démocratie des conseils" (Rä-tedemokratie) autogestionnaire, celui de la "dé-con-nexion" à l'albanaise ou à la nord-coréenne, etc. Ce sont aussi de nouvelles figures qui animent les cer-cles et les revues de cette "deuxième génération": H.J. Ackermann, S. Fadinger, P. Bahn, Armin Krebs (que l'on ne confondra pas avec le Français Pierre Krebs, qui fonde en 1985 la revue Elemente, sœur jumelle d'Eléments, la revue du GRECE).
Fin 1979, le jeune activiste nationaliste Siegfried Bu-blies fonde la revue Wir Selbst (= Nous-mêmes; traduction allemande du gaëlique irlandais "Sinn Fein") où, très tôt, l'influence de Henning Eichberg (= Hartwig Singer) se fera sentir. Celui-ci reprend la plume pour réclamer, dans une optique de réno-va-tion révolutionnaire partagée par les Verts, la "dé-mo-cratie de base" (Basisdemokratie), la révolution cul-turelle, l'instauration d'un ordre économique dé-cen--tralisé, un socialisme à visage humain (basé sur les thèses de l'économiste tchèque du "printemps de Prague", Ota Sik), une approche de la vie en accord avec l'écologie et l'ethnopluralisme, pierre angulaire de la vision anthropologique du néo-nationalisme al-le-mand. Bublies trouve en outre une formule qui ex-plique succinctement le sens de son combat: Für na-tionale Identität und internationale Solidarität, c'est-à-dire pour l'identité nationale et la solidarité inter-na-tionale. Bublies cherche ainsi à préserver les iden-ti-tés de tous les peuples et à solidariser, au-delà des cli-vages idéologiques, raciaux et religieux, tous ceux qui, dans le monde, luttent pour la préservation de leur originalité.
"Wir Selbst": une tribune remarquée pour les débats politiques allemands
Mais les essais politico-philosophiques demeurent minoritaires dans la revue qui, rapidement, devient la tribune de tous ceux qui cherchent à aborder la question allemande, toujours non résolue, d'une manière neuve. Wir Selbst ouvre ainsi ses colonnes à des personnalités n'ayant jamais appartenu à la mouvance nationaliste stricto sensu: l'urbaniste éco-logiste Konrad Buchwald, l'historien Helmut Di-wald, l'ancien haut fonctionnaire est-allemand Wolf-gang Seiffert, le producteur de télévision Wolf-gang Venohr (ancien de la VDNV), le jour-naliste Se-bas-tian Haffner (anti-hitlérien émigré à New York pen-dant la guerre et revenu au nationalisme dans les an-nées 80), l'artiste provocateur Joseph Beuys (ancien de l'AUD), le Prof. Schweißfurth (membre influent de la SPD), etc.Plus récemment, les généraux e.r. Lö-ser et Kießling (cf. Vouloir n°30) ont abordé dans les colonnes de Wir Selbst les problèmes de la défense du territoire et de la réorganisation des for-ces armées dans une perspective démocratique et po-puliste.
La revue de Bublies, dont la maquette et la pré-sen-ta-tion générale sont de qualité, réussit ainsi à se po-si-tion-ner com-me un forum où peuvent débattre en tou-te liberté des hommes venus d'horizons divers. L'an-née 1987 a connu un ralentissement du rythme des parutions, du fait que la revue cherche à se donner définitivement un ton, qui ne soit plus celui du militantisme activiste de SdV et qui ne soit pas une pâle copie du militantisme marxiste. Quant au NRKA, il s'est d'abord mué en NRKB ("NR-Koordinationsbüro"; = Bureau de Coordination NR), avant de se nommer plus simplement "Po-litische Offensive". Il est encore trop tôt pour tirer toutes les conclusions de cette mutation. Il est certain que les militants NR de la "deuxième génération" sont tiraillés entre, d'un côté, une fidélité à l'héritage de SdV et, de l'autre côté, une volonté de rompre tous les ponts avec le "droitisme" anti-marxiste des NR de 68. Il semble que les "nationaux-marxistes", derrière Stefan Fadinger, veulent se séparer des "NR traditionnels de la deuxième génération", re-groupés derrière Markus Bauer, éditeur d'Aufbruch, nouvelle mouture. D'autres figures, comme Peter Bahn, Karlheinz Prö-huber et Werner Olles, pré-fè-rent garder une neutra-lité dans ce débat interne et s'ex-primer dans Wir Selbst.
La mouvance NR entre les surfeurs et les militants
Vingt ans après 68, le militantisme connaît un ressac dans toute l'Europe. Guy Hocquenghem disait à Pa-ris que les "cols Mao" s'étaient recyclés au Ro-tary; Lévy et Glücksmann renient allègrement leurs enga-ge-ments antérieurs, etc. En Allemagne, la gauche mar-xisante connaît une crise réelle, tout comme les NR. Tous les mouvements hyper-politisés doivent faire face à la dépolitisation croissante et à l'hé-mor-ra-gie des militants. La contestation, la volonté de cons-truire l'alternative a fait place à la farniente des surfeurs, les barricades ont cédé le pas aux sé-duc-tions du "sea, sex and sun", du moins jusqu'au jour où la catastrophe boursière ne pourra plus être enra-yée ni freinée.
NR et marxistes soixante-huitards ont exploité un uni-vers de valeurs qui, qu'on le veuille ou non, de-meu-re immortel, même s'il enregistre aujourd'hui une inquiétante assomption. C'est pourquoi, des pa-no-ramas globaux, restituant le fil conducteur histo-rique d'une mouvance, ont une utilité: celle de pré-pa-rer le terrain pour la prochaine offensive qui, inéluctablement, surviendra.
Quelques conclusions
Les livres de Günter Bartsch et de Margret Feit nous permettent de saisir l'évolution du néo-nationalisme allemand depuis 1945. Ils nous permettent aussi de cer-ner les grandes options philosophiques de cette mou-vance politique; citons, pêle-mêle: une théorie de la connaissance scientiste et européo-centrée (du moins dans la phase initiale qui revalorisait la scien-ce et la rationalité européennes, avec l'appoint de l'em-pirisme logique et des travaux de Rougier, Mo-nod et Heisenberg; Français et Allemands parta-geaient à ce moment les mêmes préoccupations), le biohumanisme oscillant entre l'anthropologie orga-ni-que/biologisante et le matérialisme biologique, le nomi-nalisme ethnopluraliste, le socialisme national et en-raciné (le modèle irlandais de James Connolly et les populismes slaves), le nationalisme de libération et l'idée d'un espace européen.
Une hétérogénéité que Margret Feit ne veut pas apercevoir
La dénomination "Neue Rechte" laisse sous-en-ten-dre que les mouvements allemands que Margret Feit qualifie de la sorte sont des frères jumeaux de la "Nou-velle Droite" française. Le chercheur sérieux per--cevra pourtant bien vite l'hétérogénéité de ces deux mondes, malgré les chevauchements évidents, che-vauchements que l'on pourrait tout aussi bien constater entre Dutschke et Eichberg (alias Singer) ou entre le GRECE et le CERES socialiste d'un Chevènement. La pseudo-"Neue Rechte" allemande se profile sur un arrière-plan plus militant, moins mé-tapolitique, et exploite des domaines de l'esprit différents de ceux exploités en France par de Benoist et ses amis. S'il faut chercher une influence directe et sans détours du GRECE en Allemagne, c'est chez Pierre Krebs, directeur d'Elemente, chez Armin Moh-ler qui a révélé au public de Criticon l'existence de la ND française ou dans les traductions éparses des textes néo-droitistes français.
Sur le plan doctrinal, les Allemands n'ont pas trop insisté sur l'égalitarisme, cheval de bataille de la ND française; seul Lothar Penz, théoricien NR du so-lida-risme biohumaniste, a inclu quelques réflexions sur les hiérarchies biologiques dans sa vision de l'homme et de la Cité. Ensuite, l'impact du paga-nisme esthétisant, hellénisant voire celtisant est très réduit en Allemagne, bien que beaucoup d'activistes NR soient adeptes de l'"unitarisme" de Sigrid Hun-ke, dont l'ouvrage La vraie religion de l'Europe a été traduit en France par les éditions Le Labyrinthe en 1985, sous les auspices d'Alain de Benoist.
Si Bartsch avait objectivement limité son enquête à la mouvance nationale-révolutionnaire et avait bien mon--tré son souci de ne pratiquer aucun amalgame, Margret Feit, elle, mélange les genres et inclut dans son analyse de la "Neue Rechte" (terme pour le moins impropre) des organisations ou des journaux appartenant à la droite nationale classique, comme Mut, la revue de Bernhard Wintzek, ou le mensuel Nation Europa de Peter Dehoust. Elle pousse l'a-malgame encore plus loin en incluant, dans ce qu'el-le estime être un complot, la revue conservatri-ce Cri-ticon de Caspar von Schrenck-Notzing, pro-che, par cer-tains aspects, de la CSU bavaroise. La lec-ture de ces diverses revues révèle que les thèmes choisis et les options philosophiques prises par cha-cune d'en-tre elles sont différents, malgré des re-coupe-ments, dus, bien évidemment, à l'actualité lit-té-raire, philo-so-phique et politique. Chaque revue pos-sède son ori-ginalité et ne tient pas à la perdre.
L'aventure brève de l'ANR
La confusion entretenue par Margret Feit entre la mou-vance NR et les droites nationales classiques pro-vient de l'observation partiale d'un phénomène datant de 1972. En janvier de cette année, une dis-si-dence survient au sein de la NPD bavaroise, sous l'impulsion d'un certain Dr. Pöhlmann. Celui-ci demande quelques conseils à Singer tout en n'avalisant pas son anti-américanisme. De cette dissidence nait un groupement activiste, l'ANR ("Aktion Neue Rech-te"; = Action pour une Nouvelle Droite), qui rassemble les jeunes mécontents de la NPD, repro-chant à leur parti d'être socialement et politiquement trop conservateur. L'aventure durera jusqu'en no-vem-bre 1973 quand l'ANR se fractionne en plu-sieurs groupes:
1) les nationaux-conservateurs, qui formeront l'AJR ("Aktion Junge Rechte"; = Action pour une Jeune Droite);
2) les "hitléromaniaques" (d'où sont issus, en par-tie, les farfelus friands en déguisements bruns et noirs, avec cuirs et clous, que l'on entend parfois beugler des slogans, notamment à Dixmude et dans les bistrots louches des grandes villes, et qui, dans certains cas, se sont recyclés dans une homosexua-lité ridicule où les corps "aryens" et juvéniles sont érigés en objets de culte);
3) ceux qui retournent au bercail qu'est, pour eux, la NPD;
4) ceux qui évoluent vers l'idéologie NR.
Ce fait divers que fut l'ANR et la présence en son sein de quelques idiots compromettants, perpétuelle-ment ivres et rapidement éconduits, permet à des mo-ralisateurs en chambre de conclure au "nazisme" de toute une école de pensée qui véhicule, fina-le-ment, une idéologie de synthèse, exerçant une réelle séduction sur les esprits libres de la gauche militan-te. Le vocable "Neue Rechte" est ainsi erronément appliqué à la sphère NR. La tactique de Margret Feit est grossière: c'est celle de la pars pro toto. La frange de l'ANR qui évolue vers le nationalisme révo-lutionnaire finit par donner son nom à tous les mou-ve-ments nationalistes, même ceux de gauche, qui lui ont été contemporains. L'objectif de cet amalgame est évident: associer les braillards bottés (média-ti-sa-bles) aux intel-lectuels modernistes, de façon à ce que ceux-ci ne puissent plus influencer les esprits libres et larges de la gauche dutschkiste et para-dutsch-kiste ou, en France, souder en un bloc idéologique instru-mentalisable les analyses du GRECE et du CERES.
On perçoit évidemment, à la lumière de ces faits, quel-le erreur tactique ont commis certains respon-sa-bles du GRECE en acceptant et en revendiquant l'étiquette "Nouvelle Droite" que leur ont accolée les journalistes provocateurs de la bourgeoisie gau-chi-sante parisienne. L'opération de diversion de Mar-gret Feit s'en est trouvée ultérieurement confortée: la pseudo-"Neue Rechte" est amalgamée sans nuance à la "Nouvelle Droite" alors qu'il s'agit de mouve-ments assez distincts.
Impacts en Flandre et en Wallonie
En Flandre, la tentative de syn--thèse qu'ont essayée Pol Van Caeneghem et Chris--tian Dutoit, notamment avec le groupe "Ar-beid" et les revues Meervoud et De Wesp, a malheureusement viré au gauchisme stérile, de même que les brillantissimes synthèses de Mark Cels-Decorte et Freddy Seghers (un moment proche de Wir Selbst) au sein de la Volksunie et des VUJOs (Cf. les volumes de propagande intitulés In-tegraal Federalisme -1976- et Integraal Federalisme 2 -1980). Tandis qu'en Wallonie, "Jeune Europe" —dont le leader Jean Thiriart avait esquissé d'ex-cel-lents projets d'alliances géopolitiques avec les Etats non alignés du Tiers-Monde, avec la Chine et avec les militants noirs américains— restait prisonnière d'une pensée politique latine rigide et impropre à sus-citer un dynamisme rénovateur, son syndicat em-bryonnaire et rapidement dissident, l'USCE ("U-nion des Syndicats Com--munautaires Européens"), sous la direction de Jean Van den Broeck, Claude Lenoir et Pierre Ver-has, opte pour une organisation régionaliste de notre continent et se distancie offi-ciel-lement dès 1969 de "tout ce qui est de droite".
L'USCE publiera d'abord Syndicats Européens et, en-suite, L'Europe Combat, qui paraîtra jusqu'en 1978. Cette expérience fut la seule tentative NR sérieuse en Wallonie après l'é-chec de "Jeune Europe", quand Thiriart n'a pas su in---culquer son anti-améri-canisme à son public droi-tier, lequel s'est empressé de le trahir. Aujourd'hui, une synthèse sympathique voit le jour à gauche, à proximité de l'idéologie éco-logiste, dans les colon-nes de la revue W'allons-nous.
De "Jeune Europe" au néant
Avatar de "Jeune Europe" qui a évolué vers un phi-losoviétisme non instrumentalisable, le PCN du Carolorégien Luc Michel, issu, pour son malheur, des grou-puscules extrê-me-droitistes et néo-nazillonneurs les plus rocamboles-ques, ne parvient pas à décoller po-litiquement (et pour cause!) et son entreprise édi-to-riale, très instruc-tive pour les spécialistes et les his-toriens (Cf. Vou-loir n°32-33-34), stagne parce qu'elle ne traite pas de problèmes qui intéressent di-rec-tement un public mi-litant. La revue Conscience Eu-ro-péenne, qui a récemment consacré de bons numéros sur la guerre économique entre les USA et l'Eu-rope et sur l'illusion de la détente, a subi une dissidence en 1984 qui a donné le jour à Volonté Européenne et au "Cercle Copernic", dirigé par Ro-land Pirard, un individu quelque peu bizarre qui chan-ge de pseudonyme à tour de bras (Bertrand Tho-mé, Roland Van Hertendaele, Roland Brabant, etc.) et rêve naïvement de fonder un "ordre de chevalerie" néo-teutonique! Si Luc Michel effectue un tra-vail documentaire utile et fournit des analyses très intéressantes, malgré la langue de bois, la dissidence Pirard sombre dans un burlesque complet, renforcé par une rédaction épouvantablement négligée et par des analyses d'une confondante médiocrité, où sur-gissent de temps à autre des prurits hitléroma-nia-ques, mâtinés d'un néo-stalinisme et d'un pro-kho-meinysme d'une lourdeur telle qu'en comparaison, la langue de bois soviétique s'avère superlyrique. Au-cun es-poir donc que le dynamisme de "Jeune Eu-ro-pe" et de son héritier français, le CIPRE de Yannick Sauveur et d'Henri Castelferrus, ne renaisse à Bruxelles ou en Wallonie.
En conclusion, nous pourrions dire que la mou-vance NR allemande a constitué une synthèse qui s'est si-tuée à la charnière du gauchisme et du natio-nalisme et qu'elle recèle bien des potentialités pour les mili-tants sincères, ceux qui ont vraiment le souci de la Ci-té. Qui plus est, quand on observe la synthèse opé--rée par Cels-Decorte et Seghers au sein de la Volk-s-unie entre 1975 et 1981, on voit qu'une syn-thèse comparable est davantage possible dans nos pays, en de-hors de toute marginalité. Il faut y réflé-chir.
René LAUWERS.
Margret FEIT, Die "Neue Rechte" in der Bundes-republik. Organisation - Ideologie - Strategie, Campus, Frankfurt a.M., 1987, 242 S., DM 36.
Bibliographie complémentaire:
Günter Bartsch, Revolution von rechts? Ideologie und Organisation der Neuen Rechten, Herder-bücherei, Freiburg i.B., 1975, 287 S., DM 7,90.
Karl-Heinz Pröhuber, Die nationalirevolutionäre Be-wegung in Westdeutschland, Verlag deutsch-euro-päischer Studien, Hamburg, 1980, 228 S., DM 22.
Nous livrerons à nos lecteurs tout autre ren-seigne-ment d'ordre bibliographique.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nationalisme révolutionnaire, politique, théorie politique, histoire politique, allemagne, belgique, flandre, nationalisme, solidarisme, ethnopluralisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 mars 2009
La lettre de Steinmeier
La lettre de Steinmeier
MOSCOU, 12 janvier - RIA Novosti. La lettre ouverte du vice-chancelier et ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, au président américain élu, Barack Obama, publiée lundi dans l'hebdomadaire Der Spiegel, est un document opportun à tous les égards, a déclaré à RIA Novosti le sénateur russe Mikhaïl Marguelov.
"Ce texte renferme des idées réalistes et rationnelles de M.Steinmeier sur la future politique mondiale, tout en traduisant le caractère amical des relations entre l'Allemagne et la Russie", a indiqué M.Marguelov, président du Comité pour les Affaires internationales du Conseil de la Fédération (Chambre haute du parlement russe).
Dans cette lettre, le chef de la diplomatie allemande appelle le président élu des Etats-Unis à accepter l'initiative du président russe Dmitri Medvedev visant à rénover l'architecture de la sécurité européenne et insiste sur la nécessité d'une nouvelle orientation pour l'Alliance de l'Atlantique Nord, rappelle le sénateur russe.
M.Steinmeier se montre très critique vis-à-vis de la situation qui règne actuellement au sein de l'OTAN, exigeant une réforme profonde de l'Alliance. Les pays membres "ont trop longtemps esquivé une franche discussion sur les tâches (de l'OTAN)", a-t-il estimé.
M.Steinmeier promet au futur locataire de la Maison Blanche le soutien des Allemands et de l'ensemble de la communauté internationale en cas de changements positifs dans la politique extérieure des Etats-Unis, qu'il s'agisse de l'amélioration de la situation en Irak (les Allemands sont prêts à accorder une assistance réelle dans l'édification d'une nouvelle société) ou de la fermeture envisagée du camp de détention de Guantanamo (les Européens pourraient accueillir les anciens détenus).
"Si l'Amérique tend la main aux autres, je promets que la communauté internationale et l'Europe n'abandonneront pas la nouvelle administration dans l'accomplissement de cette tâche", souligne le ministre.
Selon M.Marguelov, la lettre du chef de la diplomatie allemande montre que le monde, et notamment la Vielle Europe, en ont assez des démarches unilatéralistes des Etats-Unis et veulent des décisions collectives. Néanmoins, a fait remarquer le sénateur, l'Allemagne figure parmi les principaux alliés américains en Europe.
15:26 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, allemagne, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook