Synergies Européennes – Bruxelles / Zagreb – février 2009
Tomislav SUNIC :
Amérique réelle, Amérique hyperréelle
Un phénomène important est survenu dans les relations entre les élites américaines détentrices du pouvoir et les élites médiatiques. Au début du 21ème siècle, l’Amérique, contrairement aux autres pays européens, se vante ouvertement qu’elle garantit une liberté d’expression totale. Pourtant, les médias américains osent rarement soulever des thématiques considérées comme contraires à l’esprit postmoderne de l’américanisme. De fait, la « médiacratie » américaine postmoderne opère de plus en plus en liaison avec le pouvoir exécutif de la classe dominante. Cette cohabitation se déroule sur un mode mutuellement correcteur, où les uns posent des critères éthiques pour les autres et vice-versa. Les principales chaînes de télévision et les principaux journaux d’Amérique, comme CNN, The New York Times ou The Washington Post suggèrent aux hommes politiques la ligne à suivre et vice-versa ou, pour un autre sujet, les deux fixent de concert les critères du comportement politique général qu’il faudra adopter. Parmi les citoyens américains, l’idée est largement répandue que les médias représentent un contre-pouvoir face au système et que, de par leur vocation, ils doivent être par définition hostiles aux décisions prises par les élites au pouvoir. Mais en réalité, les médias américains ont toujours été les porte-paroles et les inspirateurs du pouvoir exécutif, bien que d’une manière anonyme, sans jamais citer les noms de ceux qui, au départ de la sphère gouvernementale, leur filaient des tuyaux. Depuis la première guerre mondiale, les médias américains ont eu une influence décisive, dans la mesure où ils ont créé l’ambiance psychologique qui a précédé et soutenu la politique étrangère américaine, en particulier en poussant les politiques américains à bombarder au phosphore les villes européennes pendant la seconde guerre mondiale. La même stratégie, mais avec une ampleur réduite, a été suivie, partiellement, par les médias américains lors de l’engagement US en Irak en 2003.
Médias et classe dominante : opérations conjointes
Dans le choix des mots, la classe dominante américaine et ses courroies de transmission dans les médias et l’industrie de l’opinion ne fonctionnent plus d’une manière disjointe et exclusive l’une de l’autre ; elles opèrent conjointement dans le même effort pédagogique de « répandre la démocratie et la tolérance » dans le monde entier. « Qu’il y ait ou non un soutien administratif au bénéfice des médias », écrit Régis Debray, « ce sont les médias qui sont les maîtres de l’Etat ; l’Etat doit négocier sa survie avec les faiseurs d’opinion » (1). Debray, figure de proue parmi les théoriciens de la postmodernité, ne révèle au fond rien de neuf, sauf que dans la « vidéo-politique » postmoderne, comme il l’appelle, et qui est distillée par les médias électroniques modernes, les mensonges des politiciens semblent plus digérables qu’auparavant. En d’autres mots, le palais présidentiel n’a plus d’importance politique décisive ; c’est la tour de la télévision qui est désormais en charge de la « haute politique ». L’ensemble des discours et récits politiques majeurs ne relève plus de la « graphosphère » ; il entre dans le domaine de la « vidéosphère » émergente. En pratique, cela signifie que toutes les absurdités que pense ou raconte le politicien n’ont plus aucune importance de fond : quel que soit leur degré de sottise, il faut qu’elles soient bien présentées, qu’elles suscitent l’adhésion, comme sa propre personne, sur les écrans de la télévision. Il peut certes exister des différences mineures entre la manière dont les médias, d’une part, et la classe dominante américaine, d’autre part, formulent leur message, ou entre la façon dont leur efforts correcteurs réciproques se soutiennent mutuellement, il n’en demeure pas moins vrai que la substance de leurs messages doit toujours avoir le même ton.
La télévision et les médias visuels ont-ils changé l’image que nous avons du monde objectif ? Ou la réalité du monde objectif peut-elle être saisie, si elle a été explicitée autrement qu’elle ne l’est par les médias ? Les remarques que les universitaires ou d’autres hommes politiques formulent et qui sont contraires aux canons et aux vérités forgées par les médias se heurtent immédiatement à un mur de silence. Les sources et informations rebelles, qui critiquent les dogmes de la démocratie et des droits de l’homme, sont généralement écartées des feux de la rampe. C’est vrai surtout pour les écrivains ou journalistes qui remettent en question l’essence de la démocratie américaine et qui défient la légitimité du libre marché.
Significations à facettes multiples
Les hommes politiques américains contemporains ont de plus en plus souvent recours à des références voilées derrière un méta-langage hermétique, censé donner à ses locuteurs une aura de respectabilité. Les hommes politiques postmodernes, y compris les professeurs d’université, ont recours, de plus en plus, à une terminologie pompeuse d’origine exotique, et leur jargon se profile souvent derrière une phraséologie qu’ils comprennent rarement eux-mêmes. Avec la propagation rapide du méta-discours postmoderne au début du 21ème siècle, la règle, non écrite, est devenue la suivante : le lecteur ou le spectateur, et non plus l’auteur, devraient devenir les seuls interprètes de la vérité politique. A partir de maintenant, le lexique politique est autorisé à avoir des significations à facettes multiples. Mais, bien sûr, cela ne s’applique pas au dogme du libre marché ou à l’historiographie moderne, qui doit rester à tout jamais en un état statique. Le discours postmoderne permet à un homme politique ou à un faiseur d’opinion de feindre l’innocence politique. De cette manière, il est libre de plaider l’ignorance si ses décisions politiques débouchent sur l’échec. Ce plaidoyer d’ignorance, toutefois, ne s’applique pas s’il osait tenter ou s’il désirait déconstruire le proverbial signifiant « fascisme » qui doit rester le référent inamovible du mal suprême.
Dans un essai de 1946, un an après la défaite totale du national-socialisme, Orwell notait combien le mot « fascisme » avait perdu sa signification originelle : « il n’a maintenant plus aucune signification sauf dans la mesure où il désigne quelque chose qui n’est pas désirable » (…). On peut dire la même chose d’un vaste éventail de référents postmodernes, y compris du terme devenu polymorphe de « totalitarisme », qui date du début des années 20 du siècle passé, quand il est apparu pour la première fois et n’avait pas encore de connotation négative. Et qui sait s’il aura toujours cette connotation négative si on part du principe que le système américain, monté en épingle, pourrait, en cas d’urgence, utiliser des instruments totalitaires pour garantir sa survie ? Si l’Amérique devait faire face à des affrontements interraciaux de grande ampleur (on songe aux clivages raciaux de grande envergure après les dévastations causées par l’ouragan Katrina à la Nouvelle Orléans en 2005, qui pourrait être le prélude de plus graves confrontations ultérieures), elle devra fort probablement adopter des mesures disciplinaires classiques, telles la répression policière et la loi martiale. On peut imaginer que la plupart des théoriciens postmodernes n’émettraient aucune objection à l’application de telles mesures, bien qu’ils esquiveront probablement le vocable « totalitaire ».
Incantations abstraites
Il y a longtemps, Carl Schmitt théorisa et explicita une vérité vieille comme le monde. Notamment, que les concepts politiques acquièrent leur véritable signification si et seulement si l’acteur politique principal, c’est-à-dire l’Etat et sa classe dominante, se retrouvent dans une situation d’urgence soudaine et imprévue. Dans ce cas, toutes les interprétations usuelles des vérités posées jusqu’alors comme « allant de soi » deviennent obsolètes. On a pu observer un tel glissement après l’attaque terroriste du 11 septembre 2001 à New York (un événement qui n’a pas encore été pleinement élucidé) ; la classe dirigeante américaine a profité de cette occasion pour redéfinir la signification légale d’expressions comme les « droits de l’homme » et la « liberté de parole ». Après tout, la meilleure façon de limiter les droits civiques concrets n’est-elle pas d’abuser d’incantations abstraites sur les « droits de l’homme » et sur la « démocratie » ? Avec la déclaration possible d’un état d’urgence à grande échelle dans l’avenir, il semble tout à fait probable que l’Amérique finira par donner de véritables significations à son vocabulaire politique actuel. Pour les temps présents, toutefois, la postmodernité américaine peut se décrire comme une sémantique transitoire et un engouement esthétique parfaitement idoine pour assumer une surveillance dans les sphères académiques et politiques, sous le masque d’un seul terme : celui de « démocratie ».
Contrairement au mot, le concept de postmodernité désigne un fait politique ou social qui, selon diverses circonstances, signifie tout et le contraire de tout, c’est-à-dire, finalement, rien du tout. La postmodernité est tout à la fois une rupture avec la modernité et sa continuation logique sous une forme hypertrophiée. Mais, comme nous avons déjà eu l’occasion de le noter, en termes de dogme égalitaire, de multiculturalisme et de religion du progrès, le discours postmoderne est resté le même que le discours de la modernité. Le théoricien français de la postmodernité, Gilles Lipovetsky, utilise le terme d’hypermodernité lorsqu’il parle de la postmodernité. La postmodernité est hypermodernité dans la mesure où les moyens de communication défigurent et distordent tous les signes politiques, leur font perdre toutes proportions. De ce fait, quelque chose que nous allons considérer comme hypermoderne doit simultanément être considéré comme ‘hyperréel’ ou ‘surréel’ ; c’est donc un fait gonflé par une prolifération indéfinie de mini-discours ; des mémoires historiques et tribales travesties en panégyriques aux commémorations de masses honorant les morts de la guerre. De nouveaux signes et logos émergent, représentant la nature diversifiée du système mondial américanisé. Lipovetsky note que « très bientôt, il n’y aura plus aucune activité particulière, plus aucun objet, plus aucun lieu qui n’aura pas l’honneur d’un musée institué. Depuis le musée de la crêpe jusqu’à celui des sardines, depuis le musée d’Elvis Presley jusqu’à celui des Beatles » (2). Dans la postmodernité multiculturelle, tout est objet de souvenir surréel et aucune tribu, aucun style de vie ne doit se voir exclu du circuit. Les Juifs se sont déjà taillé une position privilégiée dans le jeu global des cultes de la mémoire ; maintenant, c’est au tour d’une myriade d’autres tribus, de styles de vie ou de divers groupes marginaux cherchant à recevoir leur part du gâteau de la mémoire globale.
Obsession de la « race »
Officiellement, dans l’Amérique multiculturelle, il n’y a ni races ni différences raciales. Mais les quotas de discrimination positive (« affirmative action ») et l’épouvantail du racisme ramènent sans cesse le terme ‘race’ à l’avant-plan. Cette attitude qui se voit rejetée, de manière récurrente, par l’établissement postmoderne américain, est, de fait, une obsession ressassée à l’infini. Les minorités raciales réclament plus de droits égaux et se font les avocates de la diversité sociale ; mais dans les termes mêmes de leurs requêtes, elles n’hésitent jamais à mettre en exergue leur propre ‘altérité’ et le caractère unique de leur propre race. Si leurs requêtes ne sont suivies d’aucun effet, les autorités courent le risque de se faire accuser d’ ‘insensibilité’. De ce fait, pourquoi n’utiliserait-on pas, dès maintenant, les termes d’Hyper-Amérique hyperraciale ? Ce qui importe, ici, c’est que le lecteur saisisse ces termes dans leur sens aléatoire car la postmodernité, selon les circonstances, peut se donner des significations contradictoires.
L’Amérique est un pays aussi moderne qu’il a voulu l’être. La modernité et la religion du progrès font partie du processus historique qui l’a créé. En même temps, toutefois, les éléments méta-statiques de la postmodernité, en particulier l’ ‘overkill’, les tueries excessives, que l’on voit à satiété dans les médias, sont désormais visibles partout. La postmodernité a ses pièges. Afin de les éviter, ses porte-paroles font usage d’approches particulières du discours moderne en recourant à des qualifiants apolitiques et moins connotés. Dans le monde postmoderne, écrit Lipovetsky, « on note la prédominance de la sphère individuelle sur la sphère universelle, du psychologique sur l’idéologique, de la communication sur la politisation, de la diversité sur l’homogénéité, de la permissivité sur la coercition » (3). De même, certaines questions sociales et politiques apparaissent désormais sous les feux de rampe alors qu’elles étaient totalement ignorées et inédites au cours des dernières décennies du 20ème siècle. L’éventuelle impuissance sexuelle d’un candidat à la présidence est désormais considérée comme une événement politique de premier plan —souvent plus que sa manière de traiter un thème important de la criminalité publique. La mort d’un enfant en bas âge dans une Afrique ravagée par les guerres en vient à être considérée comme une affaire nationale urgente. Même le supporter le plus ardent du multiculturalisme aurait eu grand peine à imaginer, jadis, les changements phénoménaux qui se sont opérés dans le discours pan-racialiste des élites américaines. Même le progressiste américain le plus optimiste de jadis, avocat de la consommation à outrance, n’aurait jamais imaginé une telle exhibition colossale de permissivité langagière ni l’explosion de millions de signes de séduction sexuelle. Tout chose se mue en sa forme plus « soft » que suggère la nouvelle idéologie ; depuis l’idéologie du sexe jusqu’à la nouvelle religion du football en passant par la croisade idéologique contre le terrorisme réel ou imaginaire.
Transformations sémantiques
La culture de masse à l’âge de la néo-postmodernité, comme l’écrit Ruby, facilite le développement d’un individualisme extrême, au point où la plus petite parcelle d’une existence humaine doit dorénavant être perçue comme une commodité périssable ou hygiénique. « La personnalité de quelqu’un est jugée d’après la blancheur de ses incisives, d’après l’absence de la moindre gouttelette de sueur aux aisselles, de même d’après l’absence totale d’émotion » (4). La culture des mots en langue anglaise a, elle aussi, été sujette à des transformations sémantiques. Actuellement, ces mots transformés existent pour désigner des styles de vie différents et n’ont plus rien en commun avec leur signification d’origine. C’est pourquoi on pourrait tout aussi bien appeler l’Amérique postmoderne « Amérique hypermoderne », désignation qui suggère que, dans les années à venir, il y aura encore plus d’hyper-narrations tournant autour de l’hyper-Amérique et du monde « hyper-américanisé ».
Et qu’est-ce qui viendra après la postmodernité ? « Tout apparaît », écrit Lipovetsky, « comme si nous étions passés d’un âge ‘post’ à un âge ‘hyper’ ; une nouvelle société faite de modernité refait surface. On ne cherche plus à quitter le monde de la tradition pour accéder à la modernité rationnelle mais à moderniser la modernité, à rationaliser la rationalisation » (5). Nous avons donc affaire à la tentative d’ajouter toujours du progrès, toujours de la croissance économique, toujours des effets télévisés spéciaux pour, imagine-t-on, nourrir l’existence de l’Amérique hyperréelle. Le surplus de symbolisme américain doit continuer à attirer les désillusionnés de toutes races et de tous styles de vie, venus de tous les coins du monde. N’importe quelle image télévisée ou n’importe quelle historiette de théâtre sert désormais de valeur normative pour une émulation quelconque à l’échelle du globe —ce n’est plus le contraire. D’abord, on voit émerger une icône virtuelle américaine, généralement par le truchement d’un film, d’un show télévisé ou d’un jeu électronique ; ensuite, les masses commencent à utiliser ces images pour conforter leur propre réalité locale. C’est la projection médiatique de l’Amérique hyperréelle qui sert dorénavant de meilleure arme propagandiste pour promouvoir le rêve américain. Nous voyons se manifester un exemple typique de l’hyperréalité américaine lorsque la classe politique américaine prétend que toute erreur générée par son univers multiculturel ou tout flop dans son système judiciaire tentaculaire pourrait se réparer en amenant dans le pays encore plus d’immigrants, en cumulant encore davantage de quotas raciaux ou en gauchisant encore plus ses lois déjà gauchistes. En d’autres termes, la hantise d’une balkanisation du pays, qu’elle ressent, elle croit pouvoir s’en guérir en introduisant encore plus de diversité raciale et en amenant encore plus d’immigrants de souche non européenne. De même, les flops du libre marché, de plus en plus visibles partout en Amérique, elle imagine qu’elle leur apportera une solution, non pas en jugulant la concurrence sur le marché, mais en acceptant encore davantage de concurrence grâce à plus de privatisations, en encourageant plus encore la dérégulation économique, etc. Cette caractéristique de l’ ‘overkill’, de la surenchère postmoderne est l’ingrédient constitutif principal de l’idéologie américaine, qui semble avoir trouvé son rythme accéléré au début de l’âge postmoderne. Jamais il ne vient à l’esprit de l’élite américaine que le consensus social dans une Amérique multiraciale ne pourra s’obtenir par décret. Pourtant, si l’on recourrait à des politiques contraires à tous ces efforts hyperréels en lice, cela pourrait signifier la fin de l’Amérique postmoderne.
Tout doit pouvoir s’expliquer selon des formules toute faites
Déjà à la fin du 20ème siècle, l’Amérique a commencé à montrer des signes d’obésité sociale. C’est la nature irrationnelle de la croyance au progrès qui a crû démesurément à la manière des métastases et qui, de ce fait, annonce, le cas échéant, la fin de l’Amérique. Lash notait, il y a déjà pas mal d’années, que tout à la fin du 20ème siècle, les narcisses américains savoureraient les plaisirs sensuels et se vautreraient dans toutes les formes d’auto-gratification. ‘Prendre du plaisir’ est une option qui a toujours fait partie des prescrits de l’idéologie américaine. Cependant le narcisse américain postmoderne à la recherche du plaisir, comme le nomme Lipovetsky, a d’autres soucis actuellement. Son culte du corps et l’amour qu’il porte à lui-même ont conduit à des crises de panique et des anxiétés de masse : « L’obsession à l’égard de soi se manifeste moins dans la joie fébrile que dans la crainte, la maladie, la vieillesse, la ‘médicalisation’ de la vie » (6). Dans l’Amérique hyperrationnelle, tout doit absolument s’expliquer et s’évacuer à l’aide de formules rationnelles, peut importe qu’il s’agisse de l’impuissance sexuelle d’une personne particulière ou de l’impuissance politique du président des Etats-Unis. La nature imprévisible de la vie représente le plus gros danger pour l’homo americanus parce qu’elle ne lui offre pas sur plateau une formule rationnelle pour lui dire comment éviter la mort ; l’imprévisibilité de la vie défie par conséquent la nature intrinsèque de l’américanisme. Tout effraye l’homme américain aujourd’hui : du terrorisme au rabougrissement de son plan retraite ; de l’immigration de masse incontrôlée à la perte probable de son emploi. Ce serait gaspiller du temps de dénombrer et de chiffrer les maux sociaux américains en ce début de troisième millénaire : songeons à la pédophilie, à la toxicomanie, à la criminalité violente, etc. Le nombre de ces anomalies croîtra de manière exponentielle si la marche en avant du progressisme postmoderne américain se poursuit.
Tout est copie grotesque de la réalité
Chaque postmoderne utilise un méta-langage qui lui est propre et donne sa propre interprétation aux significations de l’histoire. Si nous acceptons la définition de la postmodernité que nous livre le théoricien français Jean Baudrillard, alors tout dans l’Amérique postmoderne est une copie grotesque de la réalité. L’Amérique aurait donc fonctionné depuis 1945 comme un gigantesque photocopieur xérographique, produisant une méta-réalité, qui correspond non pas à l’Amérique telle qu’elle est mais à l’Amérique telle qu’elle devrait être pour le bénéfice du globe tout entier. La seule différence est la suivante : à l’aube du 21ème siècle, le rythme doux et allègre de l’histoire de jadis s’est modifié continuellement, s’est mis à s’accélérer pour passer à la cinquième vitesse. Les événements se déroulent à la vitesse d’une bobine de film, comme détachés de toute séquence historique réelle, et s’accumulent inlassablement jusqu’à provoquer un véritable chaos. Selon Baudrillard, qui est à coup sûr l’un des meilleurs observateurs européens de l’américanisme, l’hyperréalité de l’Amérique a dévoré la réalité de l’Amérique. C’est pourquoi une question doit être posée : pour parachever le rêve américain, les Américains du présent et de l’avenir ne sont-ils pas sensés vivre dans un monde de rêve projeté ? L’Amérique ne se mue-t-elle pas dans ce cas en une sorte de « temps anticipatif » (« a pretense »), en une sorte de fiction, de métaréalité ? L’Amérique a-t-elle dès lors une substance, étant donné que l’américanisme, du moins aux yeux de ses imitateurs non américains, fonctionne seulement comme un système à faire croire, c’est-à-dire comme une « hypercopie » de son soi propre, toujours projeté et embelli ? Dans le monde virtuel et postmoderne d’internet et de l’informatique, toute mise en scène d’événements réels en Amérique procède toujours déjà d’un modèle de remise en scène antérieur et prêt à l’emploi, sensé servir d’instrument pédagogique pour différents projets contingents. Par exemple, les élites militaires américaines disposent de toutes sortes de formules possibles pour tous cas d’urgence qui surviendrait, en n’importe quel endroit du monde. On peut dès lors parier en toute quiétude qu’un scénario, selon l’une ou l’autre de ces nombreuses formules, pourra aisément correspondre à un événement réel sur le terrain. En bref, raisonne Baudrillard, dans un pays constitué de millions d’événements « fractaux », bien que surreprésentés et rejoués à satiété comme ils le sont, tout se mue en un non événement. La postmodernité rend triviales toutes les valeurs, même celles qu’elle devrait honorer pour sa propre survie politique !
De nouvelles demandes sociales émergent sans fin
L’Amérique et sa classe dirigeante pourraient peut-être un jour disparaître, ou, même, l’Amérique pourrait se fractionner en entités étatiques américaines de plus petites dimensions ; dans l’un ou l’autre de ces cas, l’hyperréalité américaine, cependant, continuera à séduire les masses partout dans le monde. L’Amérique postmoderne doit demeurer le pays de la séduction, même si cette séduction fonctionne davantage auprès des masses non européennes et moins auprès des Américains de souche européenne qui, en privé, rêvent de se porter vers d’autres Amériques, non encore découvertes. Dans un pays comme l’Amérique, écrit Baudrillard, « où l’énergie de la scène publique, c’est-à-dire l’énergie qui crée les mythes sociaux et les dogmes, est en train de disparaître graduellement, l’arène sociale devient obèse et monstrueuse ; elle se dilate comme un corps mammaire ou glandulaire. Jadis, cette scène publique s’illustrait par ses héros, aujourd’hui elle s’indexe sur ses handicapés, ses tarés, ses dégénérés, ses asociaux —tout cela dans un gigantesque effort de maternage thérapeutique » (7). Les marginalisés de la société et les marginaux tout court sont devenus des modèles, qui ont un rôle à jouer dans la postmodernité américaine. La « vérité politique » est d’ores et déjà devenue une thématique de la scène privée et émotionnelle, dans le sens où le membre d’une secte religieuse ou le porte-paroles d’un quelconque « lifestyle » (mode de vie) peut émettre sans frein ses jugements politiques nébuleux. Un toqué bénéficie d’autant de liberté de beugler publiquement ses opinions politiques que le professeur d’université. Il arrive qu’un serial killer devienne une superstar de la télévision, aussi bien avant qu’après ses bacchanales criminelles. En fait, comme la quête de diversité ne cesse de s’élargir, de nouveaux groupes sociaux, et, avec eux, de nouvelles demandes sociales émergent sans fin. Le stade thérapeutique de la post-Amérique, comme l’appelle Gottfried, est le système idéal pour étudier tous les comportements pathologiques.
En ces débuts du 21ème siècle, les postmodernistes aiment exhorter tout un chacun à remettre en question tous les paradigmes et tous les mythes politiques, mais, en même temps, ils adorent chérir leurs propres petites vérités étriquées ; notamment celles qui concerne l’une ou l’autre « vérité » de nature ethnique ou relevant des fameux « genders ». Ils continuent à se faire les avocats des programmes d’ « affirmative action » (= de « discrimination positive »), destinés à « visibiliser » les modes de vie non européens et à valoriser les narrations autres, généralement hostiles aux Blancs. Le terme « diversité » est devenu le mot magique des postmodernistes : c’est une diversité basée sur une légitimation négative, dans le sens où elle rejette toute diversité d’origine européenne en mettant l’accent sur la nature soi-disant mauvaise de l’interprétation que donne l’homme blanc de l’histoire.
Les narrations postmodernes ne peuvent être soumises à critique
Bien que la plupart des postmodernistes tentent de déconstruire la modernité en utilisant l’œuvre de Frédéric Nietzsche et en s’en servant de fil d’Ariane, ils persistent à soutenir leurs propres ordres du jour, micro-idéologiques et infra-politiques, basés sur la valorisation d’autres races et de modes de vie différents. Ce faisant, ils rejettent toute autre interprétation de la réalité, surtout les interprétations qui heurtent de front le mythe omniprésent de l’américanisme. L’approche intellectuelle sous-tendant leurs micro-vérités ou leurs micro-mythes ne peut être soumise à critique, en aucun circonstance. Leurs narrations demeurent les fondements sacro-saints de leur postmodernité. Pour l’essentiel, la narration de chaque tribu ou de chaque groupe apparaît comme un gros mensonge commis sur le mode horizontal, ce qui a pour effet que chacun de ces mensonges élimine la virulence d’un autre mensonge concurrent. Le protagoniste d’un mode de vie quelconque et bizarre, présent sur la scène américaine, sait pertinemment bien que sa narration relève de la fausse monnaie ; mais il doit faire semblant de raconter la vérité. Finalement, et dans le fond, le discours de la postmodernité est un grand discours de méta-mensonge, de méta-tromperie.
Si vous adoptez la logique de la postmodernité permissive et la micro-narration hyperréelle d’un zélote religieux ou d’un quelconque tribal de la planète postmoderne, indépendamment du fait qu’il souhaite ou non devenir l’hôte d’un talk show télévisé, ou devenir une star du porno, ou le porte-paroles imaginaire d’une guérilla, alors vous devez implicitement accepter également l’idée d’un « post-démocratie », d’un « post-libéralisme », d’une ère « post-holocaustique » et d’une « post-humanité » dans une post-Amérique. Comme toutes les grandes narrations de la modernité mourante peuvent être remises en question en toute liberté, on peut trouver plein de bonnes raisons pour remettre en question et pour envoyer aux orties la grande narration qui se trouve à la base de la démocratie américaine. En utilisant le même tour de passe-passe, on pourrait remettre au goût du jour en Amérique des penseurs, des auteurs et des hommes de science qui, depuis la fin de ce Sud antérieur à la guerre civile ou, plus nettement encore, depuis la fin de la seconde guerre mondiale en Europe, ont été houspillés dans l’oubli ou ont été dénoncés comme « racistes », bigots ou « fascistes » ou ont reçu l’un ou l’autre nom d’oiseau issu de la faune innombrable de tous ceux que l’on a campés comme exclus. Les auteurs postmodernes évitent toutefois avec prudence les thèmes qui ont été dûment tabouisés. Ils se rendent compte que dans la « société la plus libre qui soit », les mythes antifascistes et anti-antisémites doivent continuer à prospérer.
Tomislav SUNIC.
(extrait du livre « Homo Americanus – Child of the Postmodern Age », publié à compte d’auteur, 2007, ISBN 1-4196-5984-7, pp. 146 à 156 ; trad. franc. : Robert Steuckers).
Notes :
(1) Régis DEBRAY, Cours de médiologie générale, Gallimard, 1991, p. 303.
(2) Gilles LIPOVETSKY/Sébastien CHARLES, Les temps hypermodernes, Grasset, 2004, p. 124.
(3) Gilles LIPOVETSKY, L’ère du vide, Gallimard, 1983.
(4) Christian RUBY, Le champ de bataille postmoderne, néo-moderne, L’Harmattan, 1990.
(5) Gilles LIPOVETSKY/Sébastien CHARLES, Les temps hypermodernes, Grasset, 2004, p. 78.
(6) Ibidem, p. 37.
(7) Jean BAUDRILLARD, Les stratégies fatales, Grasset, 1983, p. 79.
 Jour après jour, il apparaît de plus en plus clair que des banques et des fonds spéculatifs américains jouent l’éclatement de la zone euro : d’abord la Grèce avant le Portugal, l’Espagne, etc.
Jour après jour, il apparaît de plus en plus clair que des banques et des fonds spéculatifs américains jouent l’éclatement de la zone euro : d’abord la Grèce avant le Portugal, l’Espagne, etc.




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg The liberty of subsidy
The liberty of subsidy Grecia reveló hoy a través de su Centro Nacional de Inteligencia nuevas complicidades contra su economía de inversores internacionales, especialmente de empresas financieras de Estados Unidos.
Grecia reveló hoy a través de su Centro Nacional de Inteligencia nuevas complicidades contra su economía de inversores internacionales, especialmente de empresas financieras de Estados Unidos.
 Dès le milieu du siècle, la seconde guerre mondiale offre une occasion inespérée pour l’Amérique, dans une Europe affaiblie et divisée, puisque des deux rivaux continentaux (Allemagne nazie et Russie soviétique), il n’en reste qu’un. Cette lutte contre l’URSS a en fait un autre objectif : la prise de pouvoir économique par l’accès aux matières premières et aux ressources naturelles, concentrées au cœur de l’Eurasie. Pour ce faire, l’Amérique propose à l’Europe dévastée le "plan marshall" (1947) destiné à sa reconstruction. 16 états Européens, et la Turquie se partageront les fonds en créant l’
Dès le milieu du siècle, la seconde guerre mondiale offre une occasion inespérée pour l’Amérique, dans une Europe affaiblie et divisée, puisque des deux rivaux continentaux (Allemagne nazie et Russie soviétique), il n’en reste qu’un. Cette lutte contre l’URSS a en fait un autre objectif : la prise de pouvoir économique par l’accès aux matières premières et aux ressources naturelles, concentrées au cœur de l’Eurasie. Pour ce faire, l’Amérique propose à l’Europe dévastée le "plan marshall" (1947) destiné à sa reconstruction. 16 états Européens, et la Turquie se partageront les fonds en créant l’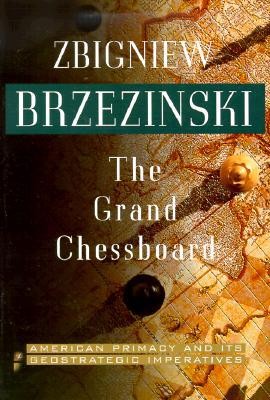 L’histoire du mouvement prométhéen remonte au début du siècle, lorsque des responsables de « républiques Russes », notamment musulmanes se concertent afin de discuter leur "indépendance". Au début du siècle, lors de ces premiers congrès, deux lignes s’opposent, les partisans d’un nationalisme territorial et les partisans d’une union panturque (le rôle d’intellectuel Turc appelant à la réunification panturque étant relativement importante au sein de ce mouvement). Rapidement, ces questions d’indépendance gagneront les républiques non musulmanes de Russie, notamment dans le Caucase.
L’histoire du mouvement prométhéen remonte au début du siècle, lorsque des responsables de « républiques Russes », notamment musulmanes se concertent afin de discuter leur "indépendance". Au début du siècle, lors de ces premiers congrès, deux lignes s’opposent, les partisans d’un nationalisme territorial et les partisans d’une union panturque (le rôle d’intellectuel Turc appelant à la réunification panturque étant relativement importante au sein de ce mouvement). Rapidement, ces questions d’indépendance gagneront les républiques non musulmanes de Russie, notamment dans le Caucase.  Louis Farrakhan n'est pas le seul Américain qui exprime aujourd'hui du scepticisme à l'égard de l'idéal d'intégration raciale. Tony Brown, Républicain noir et hôte de la chaîne de télévision PBS, condamne, lui aussi, cette tendance contemporaine à l'“assimilation raciale”. Voici son argument majeur: «Nous pouvons rester séparés racialement tout en maintenant une nation saine et productive». Clarence Thomas, de la Cour Suprême de Justice, a condamné les projets d'intégration scolaire fondés sur le principe que les non-Blancs doivent s'asseoir à côté des Blancs dans les école pour acquérir de l'éducation (!). Tant parmi les Noirs que parmi les Blancs, le projet d'intégration est respecté par conformisme et non plus par conviction réelle, comme l'indique du reste le fait patent que dans tous les domaines sociaux où l'intégration n'est pas imposée par coercition, les races choisissent toutes de vivre séparément. Dans les églises, les prisons, à l'armée, dans les équipes professionnelles d'athlétisme, sur les campus universitaires, les races suivent toutes leur propre voie. Nous avons donc affaire à une ségrégation que les gens, toutes races confondues, s'imposent spontanément à eux-mêmes: reste à savoir si cet état de choses est aussi choquant et aussi indésirable que les commentateurs médiatiques veulent nous le faire croire...
Louis Farrakhan n'est pas le seul Américain qui exprime aujourd'hui du scepticisme à l'égard de l'idéal d'intégration raciale. Tony Brown, Républicain noir et hôte de la chaîne de télévision PBS, condamne, lui aussi, cette tendance contemporaine à l'“assimilation raciale”. Voici son argument majeur: «Nous pouvons rester séparés racialement tout en maintenant une nation saine et productive». Clarence Thomas, de la Cour Suprême de Justice, a condamné les projets d'intégration scolaire fondés sur le principe que les non-Blancs doivent s'asseoir à côté des Blancs dans les école pour acquérir de l'éducation (!). Tant parmi les Noirs que parmi les Blancs, le projet d'intégration est respecté par conformisme et non plus par conviction réelle, comme l'indique du reste le fait patent que dans tous les domaines sociaux où l'intégration n'est pas imposée par coercition, les races choisissent toutes de vivre séparément. Dans les églises, les prisons, à l'armée, dans les équipes professionnelles d'athlétisme, sur les campus universitaires, les races suivent toutes leur propre voie. Nous avons donc affaire à une ségrégation que les gens, toutes races confondues, s'imposent spontanément à eux-mêmes: reste à savoir si cet état de choses est aussi choquant et aussi indésirable que les commentateurs médiatiques veulent nous le faire croire...
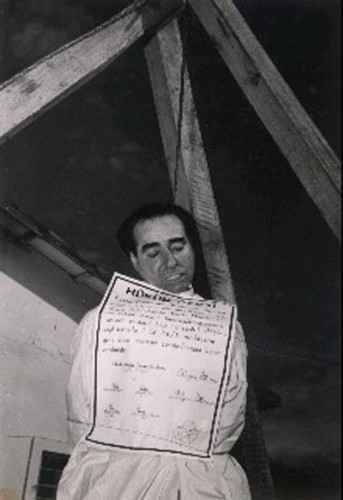 Interessant ist es, die Clintonsche Politik der Türkei gegenüber zu analysieren: der amerikanische Präsident versprach, unter anderem während eines offiziellen Besuchs in Istanbul und Ankara, die Türkei wieder eine Rolle im Balkan nach der Unabhängigkeit Bosniens spielen zu lassen, die EG-Kandidatur der Türkei zu unterstützen, eine Schlüsselrolle in der Ausschaltung des Iraks mitspielen zu lassen, und ihr eine getarnte und faktische Anwesenheit im ölreichen nordirakischen ethnisch-kurdischen Mossul-Gebiet zu garantieren.
Interessant ist es, die Clintonsche Politik der Türkei gegenüber zu analysieren: der amerikanische Präsident versprach, unter anderem während eines offiziellen Besuchs in Istanbul und Ankara, die Türkei wieder eine Rolle im Balkan nach der Unabhängigkeit Bosniens spielen zu lassen, die EG-Kandidatur der Türkei zu unterstützen, eine Schlüsselrolle in der Ausschaltung des Iraks mitspielen zu lassen, und ihr eine getarnte und faktische Anwesenheit im ölreichen nordirakischen ethnisch-kurdischen Mossul-Gebiet zu garantieren.

 Wie zuverlässige amerikanische Quellen berichten, ist beim Bureau of Intelligence and Research des US-Außenministeriums eine vertrauliche Anfrage des Büros von Erard Corbin de Mangoux, dem Chef des französischen Auslandsnachrichtendienstes DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) eingegangen. Den Berichten zufolge bezieht sich die Anfrage auf die kürzlich veröffentlichte Darstellung über die Mitschuld der US-Regierung an dem mysteriösen Ausbruch von Massenwahnsinn in dem südfranzösischen Dorf Pont-Saint-Esprit im Jahr 1951.
Wie zuverlässige amerikanische Quellen berichten, ist beim Bureau of Intelligence and Research des US-Außenministeriums eine vertrauliche Anfrage des Büros von Erard Corbin de Mangoux, dem Chef des französischen Auslandsnachrichtendienstes DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure) eingegangen. Den Berichten zufolge bezieht sich die Anfrage auf die kürzlich veröffentlichte Darstellung über die Mitschuld der US-Regierung an dem mysteriösen Ausbruch von Massenwahnsinn in dem südfranzösischen Dorf Pont-Saint-Esprit im Jahr 1951. Obama-Berater will Verschwörungstheorien verbieten? Toll. Dann hat endlich die Geschichte von Obama bzw. Osama und den 19 Räubern ein Ende, die am 11. September 2001 auszogen, die Weltmacht USA zu attackieren. Oder die Verschwörungstheorien über Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, die nie gefunden wurden. Oder die Theorien, dass der Iran demnächst eine Atombombe bauen kann. Doch man ahnt es schon: Diese Verschwörungstheorien sind natürlich nicht gemeint. Vielmehr sind jene Theorien im Visier von totalitären Politikern, die den obrigkeitlichen Blödsinn immer wieder als Verschwörungstheorie entlarven.
Obama-Berater will Verschwörungstheorien verbieten? Toll. Dann hat endlich die Geschichte von Obama bzw. Osama und den 19 Räubern ein Ende, die am 11. September 2001 auszogen, die Weltmacht USA zu attackieren. Oder die Verschwörungstheorien über Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, die nie gefunden wurden. Oder die Theorien, dass der Iran demnächst eine Atombombe bauen kann. Doch man ahnt es schon: Diese Verschwörungstheorien sind natürlich nicht gemeint. Vielmehr sind jene Theorien im Visier von totalitären Politikern, die den obrigkeitlichen Blödsinn immer wieder als Verschwörungstheorie entlarven.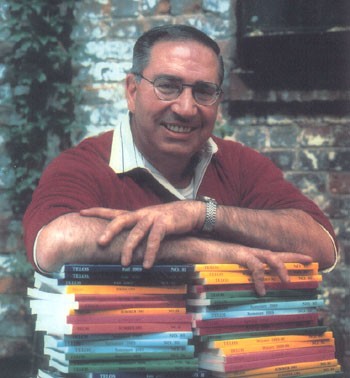 Archives de Synergies Européennes - 1995
Archives de Synergies Européennes - 1995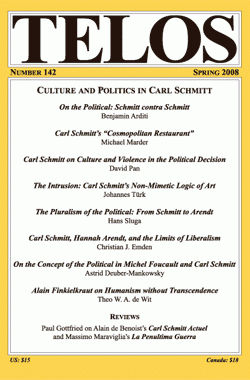 PP: C'est vrai. Très américain au sens le plus profond du terme. La démocratie américaine, en effet, a été fondée par des fanatiques religieux
PP: C'est vrai. Très américain au sens le plus profond du terme. La démocratie américaine, en effet, a été fondée par des fanatiques religieux


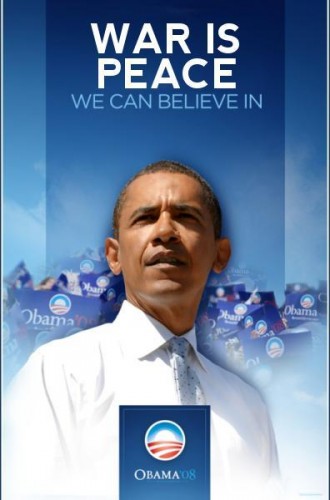 Sarà una guerra diversa quella che l’amministrazione Obama ha intenzione di condurre contro il terrorismo e i nemici degli Stati Uniti. Non certo meno costosa - visto che il piano spese presentato in questi giorni dal presidente è solo lievemente inferiore a quelli presentati negli ultimi due anni del suo predecessore - ma sicuramente diversa da quella di Bush. La nuova strategia messa a punto dal ministro della Difesa Robert Gates, infatti, punta soprattutto sull’aumento delle operazioni speciali segrete, sull’utilizzo massiccio degli aerei senza pilota e su una rinnovata attenzione nei confronti degli Stati “deboli”, come Yemen e Somalia, considerati un rifugio sicuro per gli uomini di Al Qaida. In generale, Gates ha sottolineato la necessità di abbandonare la precedente politica (eredità della Guerra Fredda), che chiedeva alle forze armate di prepararsi a combattere simultaneamente in due conflitti regionali (ad esempio in Vicino Oriente e nella penisola coreana), e di sostituirla con la capacità di fronteggiare diversi conflitti minori in ogni parte del mondo. Le linee guida di questo riordino sono descritte nel Quadriennal Defense Review (QDR), il rapporto quadriennale del Pentagono presentato lunedì scorso. Il testo indica come priorità attuale delle forze armate statunitensi il “prevalere nelle guerre odierne“ e sostiene la necessità di “smantellare le reti terroristiche” in Afghanistan e in Iraq.
Sarà una guerra diversa quella che l’amministrazione Obama ha intenzione di condurre contro il terrorismo e i nemici degli Stati Uniti. Non certo meno costosa - visto che il piano spese presentato in questi giorni dal presidente è solo lievemente inferiore a quelli presentati negli ultimi due anni del suo predecessore - ma sicuramente diversa da quella di Bush. La nuova strategia messa a punto dal ministro della Difesa Robert Gates, infatti, punta soprattutto sull’aumento delle operazioni speciali segrete, sull’utilizzo massiccio degli aerei senza pilota e su una rinnovata attenzione nei confronti degli Stati “deboli”, come Yemen e Somalia, considerati un rifugio sicuro per gli uomini di Al Qaida. In generale, Gates ha sottolineato la necessità di abbandonare la precedente politica (eredità della Guerra Fredda), che chiedeva alle forze armate di prepararsi a combattere simultaneamente in due conflitti regionali (ad esempio in Vicino Oriente e nella penisola coreana), e di sostituirla con la capacità di fronteggiare diversi conflitti minori in ogni parte del mondo. Le linee guida di questo riordino sono descritte nel Quadriennal Defense Review (QDR), il rapporto quadriennale del Pentagono presentato lunedì scorso. Il testo indica come priorità attuale delle forze armate statunitensi il “prevalere nelle guerre odierne“ e sostiene la necessità di “smantellare le reti terroristiche” in Afghanistan e in Iraq.
 La Nato chiede all’Unione europea una più stretta collaborazione militare nell’ambito di una nuova visione strategica per il XXI secolo.
La Nato chiede all’Unione europea una più stretta collaborazione militare nell’ambito di una nuova visione strategica per il XXI secolo. Pour répandre la « démocratie libérale » dans le monde et, simultanément, pour étayer leur position hégémonique, les Etats-Unis ne se contentent pas de faire des guerres mais se servent aussi d’un bon nombre d’organisations et d’institutions. Parmi celles-ci, il y en a une, l’ « United States Agency for International Development », ou, en abrégé « USAID », qui occupe une place particulièrement importante. Les activités de cette agence indépendante, dont le siège se trouve dans l’immeuble Ronald Reagan à Washington, ne se limitent pas aux seules régions habituelles, qui ont besoin d’une aide au développement, comme, par exemple, pour construire des routes ou des hôpitaux. Elle soutient aussi, comme elle le signale elle-même, « les objectifs de la politique extérieure américaine en apportant une aide aux partenaires locaux des Etats-Unis, afin de pouvoir rétablir dans les pays cibles ravagés par la guerre la paix et la démocratie ». Son objectif principal semble être de favoriser des « changements politiques » dans des pays récalcitrants, qui refusent de suivre l’exemple de « la Cité lumineuse sur la colline », c’est-à-dire les Etats-Unis, comme ils aiment à se décrire eux-mêmes. Car, comme l’affirme tout de go la ministre américaine des affaires étrangères Hillary Clinton, avec un sentiment de supériorité bien yankee, « le monde a besoin d’une direction ».
Pour répandre la « démocratie libérale » dans le monde et, simultanément, pour étayer leur position hégémonique, les Etats-Unis ne se contentent pas de faire des guerres mais se servent aussi d’un bon nombre d’organisations et d’institutions. Parmi celles-ci, il y en a une, l’ « United States Agency for International Development », ou, en abrégé « USAID », qui occupe une place particulièrement importante. Les activités de cette agence indépendante, dont le siège se trouve dans l’immeuble Ronald Reagan à Washington, ne se limitent pas aux seules régions habituelles, qui ont besoin d’une aide au développement, comme, par exemple, pour construire des routes ou des hôpitaux. Elle soutient aussi, comme elle le signale elle-même, « les objectifs de la politique extérieure américaine en apportant une aide aux partenaires locaux des Etats-Unis, afin de pouvoir rétablir dans les pays cibles ravagés par la guerre la paix et la démocratie ». Son objectif principal semble être de favoriser des « changements politiques » dans des pays récalcitrants, qui refusent de suivre l’exemple de « la Cité lumineuse sur la colline », c’est-à-dire les Etats-Unis, comme ils aiment à se décrire eux-mêmes. Car, comme l’affirme tout de go la ministre américaine des affaires étrangères Hillary Clinton, avec un sentiment de supériorité bien yankee, « le monde a besoin d’une direction ». L’Ukraine cependant demeure la cible principale des activités de la NED sur le continent européen. L’USAID, organisation américaine destinée à l’aide au développement, maintient son point de vue : il faut créer une Ukraine démocratique, prospère et sûre qui « pourra alors être entièrement intégrée dans la communauté euro-atlantique ». L’hégémonie américaine en Europe s’étendrait alors jusqu’aux frontières de la Russie. Ensuite, il faut aussi retourner la « Serbie récalcitrante » et faire de Belgrade une capitale sagement soumise aux volontés américaines. Pour atteindre cet objectif, le « National Democratic Institute » (NDI) a obtenu le soutien de l’USAID afin de soutenir les « partis politiques favorables aux réformes », comme on peut le lire sur internet, de façon à « augmenter leurs chances lors d’élections ». par « favorables aux réformes », on entend toutes les forces politiques prêtes à soumettre tous les intérêts nationaux légitimes de la Serbie aux ukases de Washington et de l’eurocratie bruxelloise. Dans ce cadre, ces forces politiques, pour bénéficier de la générosité américaine doivent reconnaître notamment l’indépendance du Kosovo. Dans cette province sécessionniste, Washington entretient depuis 1999 une base militaire gigantesque de 386 hectares, le « Camp Bondsteel », destiné à devenir l’un des principaux points d’appui des forces américaines dans le Sud-Est de l’Europe.
L’Ukraine cependant demeure la cible principale des activités de la NED sur le continent européen. L’USAID, organisation américaine destinée à l’aide au développement, maintient son point de vue : il faut créer une Ukraine démocratique, prospère et sûre qui « pourra alors être entièrement intégrée dans la communauté euro-atlantique ». L’hégémonie américaine en Europe s’étendrait alors jusqu’aux frontières de la Russie. Ensuite, il faut aussi retourner la « Serbie récalcitrante » et faire de Belgrade une capitale sagement soumise aux volontés américaines. Pour atteindre cet objectif, le « National Democratic Institute » (NDI) a obtenu le soutien de l’USAID afin de soutenir les « partis politiques favorables aux réformes », comme on peut le lire sur internet, de façon à « augmenter leurs chances lors d’élections ». par « favorables aux réformes », on entend toutes les forces politiques prêtes à soumettre tous les intérêts nationaux légitimes de la Serbie aux ukases de Washington et de l’eurocratie bruxelloise. Dans ce cadre, ces forces politiques, pour bénéficier de la générosité américaine doivent reconnaître notamment l’indépendance du Kosovo. Dans cette province sécessionniste, Washington entretient depuis 1999 une base militaire gigantesque de 386 hectares, le « Camp Bondsteel », destiné à devenir l’un des principaux points d’appui des forces américaines dans le Sud-Est de l’Europe.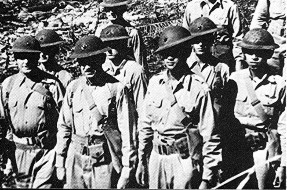 En 1914, les Américains placent le président haïtien devant un choix : céder l’administration des douanes aux Etats-Unis ou s’en aller. Le président refuse et l’Amiral Caperton fait débarquer ses marines, bloquer le parlement par des sentinelles américaines ; dans l’hémicycle, des officiers américains surveillent les députés avec des airs menaçants et, du coup, un nouveau président est élu. Ce nouveau président crée aussitôt une nouvelle constitution, adaptée aux circonstances, qui consent notamment aux étrangers le droit d’acheter des terres à Haïti. Selon le « Département d’Etat » américain, il n’avait pas été possible d’agir autrement car : « si notre occupation doit avoir un effet positif pour Haïti et favoriser son progrès, l’arrivée de capitaux étrangers s’avère nécessaire et on ne pourra évidemment pas demander à des Américains d’investir leur argent dans des plantations et des entreprises agricoles sans qu’ils ne puissent disposer de la propriété pleine et entière de ces terres ».
En 1914, les Américains placent le président haïtien devant un choix : céder l’administration des douanes aux Etats-Unis ou s’en aller. Le président refuse et l’Amiral Caperton fait débarquer ses marines, bloquer le parlement par des sentinelles américaines ; dans l’hémicycle, des officiers américains surveillent les députés avec des airs menaçants et, du coup, un nouveau président est élu. Ce nouveau président crée aussitôt une nouvelle constitution, adaptée aux circonstances, qui consent notamment aux étrangers le droit d’acheter des terres à Haïti. Selon le « Département d’Etat » américain, il n’avait pas été possible d’agir autrement car : « si notre occupation doit avoir un effet positif pour Haïti et favoriser son progrès, l’arrivée de capitaux étrangers s’avère nécessaire et on ne pourra évidemment pas demander à des Américains d’investir leur argent dans des plantations et des entreprises agricoles sans qu’ils ne puissent disposer de la propriété pleine et entière de ces terres ».
 Am 11. Januar gab das Weiße Haus in einer Presseerklärung – die in der Nachrichtenflut über die tragischen Ereignisse am folgenden Tag in Haiti weitgehend unbeachtet geblieben ist – bekannt, dass der Präsident eine Exekutivorder mit dem harmlos klingenden Titel »Bildung des Gouverneursrats« unterzeichnet hat. Der Titel der Order ist irreführend, denn tatsächlich werden nur die Gouverneure von zehn der 50 US-Bundesstaaten dem Rat angehören, der dem US-Verteidigungsminister unterstehen wird. Es bedeutet eine einschneidende Veränderung, denn nachdem das Militär nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren in die innenpolitischen Auseinandersetzungen eingegriffen hatte, war 1878 vom der Kongress das bis heute geltende Posse-Comitatus-Gesetz verabschiedet worden, das den Einsatz der US-Streitkräfte im eigenen Land verbietet.
Am 11. Januar gab das Weiße Haus in einer Presseerklärung – die in der Nachrichtenflut über die tragischen Ereignisse am folgenden Tag in Haiti weitgehend unbeachtet geblieben ist – bekannt, dass der Präsident eine Exekutivorder mit dem harmlos klingenden Titel »Bildung des Gouverneursrats« unterzeichnet hat. Der Titel der Order ist irreführend, denn tatsächlich werden nur die Gouverneure von zehn der 50 US-Bundesstaaten dem Rat angehören, der dem US-Verteidigungsminister unterstehen wird. Es bedeutet eine einschneidende Veränderung, denn nachdem das Militär nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren in die innenpolitischen Auseinandersetzungen eingegriffen hatte, war 1878 vom der Kongress das bis heute geltende Posse-Comitatus-Gesetz verabschiedet worden, das den Einsatz der US-Streitkräfte im eigenen Land verbietet.
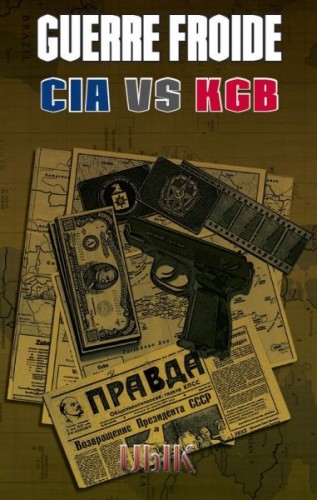 Peu après 1989, on pensait que le monde libre et la démocratie avaient triomphé grâce à la victoire des Etats-Unis sur l’Union soviétique. La réalité de 2009 est différente. Le modèle démocratique américain ne s’est de loin pas imposé partout à travers le globe. […] Dans la politique américaine, il y a des relents de Guerre froide. L’attitude de Washington par rapport à Cuba n’a pas fondamentalement changé.
Peu après 1989, on pensait que le monde libre et la démocratie avaient triomphé grâce à la victoire des Etats-Unis sur l’Union soviétique. La réalité de 2009 est différente. Le modèle démocratique américain ne s’est de loin pas imposé partout à travers le globe. […] Dans la politique américaine, il y a des relents de Guerre froide. L’attitude de Washington par rapport à Cuba n’a pas fondamentalement changé.