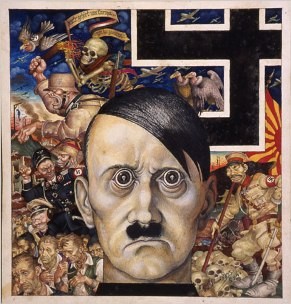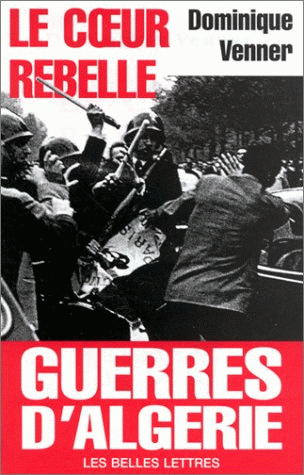Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Entretien avec Pavel Vladimirovitch Toulaev, Vice-Président de « Synergies Européennes » à Moscou
1. Pavel Vladimirovitch, comment vous présenteriez-vous à vos amis synergétistes d’Europe occidentale ?
PVT : Je m'appelle Pavel Vladimirovitch Toulaev et j'ai 39 ans. Russe et citoyen de la Russie, je réside à Moscou. De par ma formation, je suis traducteur-interprète en langue espagnole, anglaise et française et licencié en histoire ; par vocation je suis poète, philosophe et homme de lettres ; par profession, je suis professeur à l'Université linguistique d'Etat de Moscou ; par engagement social, je suis rédacteur scientifique et littéraire de la revue historique et culturelle Naslednié Predkov (Les legs des ancêtres). J'ai une cinquantaine de publications à mon actif sur la Russie, l'Espagne, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord dans les genres les plus divers: des études scientifique aux visions mystiques. Parmi les plus significatives, je citerai: « Comprendre l'Entité russe », « Sept rayons », « La croix sur la Crimée », « La Révolution conservatrice en Espagne », « La Russie et l'Espagne s’ouvrent l'une à l'autre ». Parmi les livres sortis sous ma rédaction, je choisirais les recueils suivants: « La Russie et l'Europe: expérience d’une analyse à partir de l'idée de "sobornost " », « Le peuple et les intellectuels», « Perspective russe » et également « Philosophie posthistorique» par Vitalii Kovalev et « Comment l'ordre organise les guerres et les révolutions » par Antony Sutton.
2. Quelles sont les sources de votre mode de penser ?
PVT : Ma famille, mes amis et ma Patrie ont joué le rôle principal dans ma formation. Elevé dans les bonnes traditions russes et dans la famille d'un officier des services de renseignement pour l'étranger, j'ai reçu une éducation avec une forte orientation idéologique, fidèle aux principes du patriotisme, du socialisme soviétique et de la pratique sportive et culturelle au sein des organisations des pionniers et du Komsomol. Depuis l'enfance, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Né à Krasnodar, dans le sud ensoleillé de la Russie, j'ai passé ma jeunesse au bord de la mer Noire à Sotchi, j'ai été plus d'une fois dans la ville natale de mon père, Saint-Pétersbourg, et en Sibérie, pays natal de ma mère ; j'ai vécu en Autriche et en Australie, j'ai travaillé en Espagne et aux Etats-Unis. Mon expérience à l'étranger a considérablement influencé ma vision du monde, mais j'ai passé la plus grande partie de ma vie dans la capitale de la Russie. C'est surtout grâce à Moscou, avec ses traditions russophiles, orthodoxes et impériales, que j'ai atteint ma maturité.
La beauté et le mystère qui se manifestent dans la nature, dans l'érotisme et dans l'art ont aussi exercé une grande influence depuis toujours sur ma façon de penser. J'ai toujours considéré la création artistique et l'amour comme l'expression la plus naturelle du monde intérieur. Dans ma jeunesse je me suis appliqué à la peinture, j'ai été barde lorsque j'étais étudiant et j'ai vécu d'impressions musicales et théâtrales, j'ai écrit et exécuté moi-même des chansons. Après avoir adopté la foi orthodoxe, j'ai appris à chanter la messe. L'esthétique m'attire sous toutes ses formes et surtout sous sa forme musicale, qui n'a jamais cessé de m'envoûter véritablement. J'écoute régulièrement la musique classique de Bach et Tchaïkovski à Richard Strauss et Rachmaninov. J'aime également la musique populaire y compris l’occidentale par sa vitalité et son naturel.
3.Quels auteurs et quels livres vous ont marqué le plus dans votre jeunesse ?
PVT : Il est difficile d'opérer une sélection parmi les centaines d'auteurs et de livres que j'ai lus. Depuis l'enfance, j'ai avalé de tout selon de contes, des livres d'aventures, des romans policiers, des romans d'amour et des poésies. La première œuvre sérieuse dont je me rappelle est l'Odyssée d'Homère dans ma jeunesse, en dehors de ma passion pour la peinture et pour la musique, j'ai pris goût aux œuvres ayant trait aux beaux-arts aux musées et aux albums d'art.
Pendant les années universitaires sous l'influence de mon éducation soviétique, je me suis passionné pour le romantisme soviétique et le mouvement des partisans de l'époque. Une fois devenu boursier de thèse à l'Institut de lyrique latine de l'Académie des sciences de l'URSS, où je me suis spécialisé dans le Pérou, j'ai été enchanté par les travaux et la biographie de Che Guevara, de Fidel Castro, de Ho Chi Min, de José Carlos Mariategui, de Aya de la Torre, de Simon Bolivar et de José Marti. J'ai traduit et chanté les chansons de Victor Hara.
C'est au cours d’un stage de boursier de thèse que j'ai souhaité me familiariser avec les auteurs classiques russes de Pouchkine et Gogol, Tolstoï et Essenine, en dehors des œuvres de Marx, Hegel et Lénine, qu'il fallait obligatoirement lire à l'époque. Je me suis littéralement plongé dans leurs œuvres complètes pendant des semaines et des mois entiers dans les bibliothèques.
Dostoïevski m'a profondément secoué et ce sont surtout Les Démons et Les frères Karamazov qui ont produit une grande impression sur moi. En lisant Dostoïevski, je me suis reconnu sans réfléchir... Ensuite cela a été le tour de Nikolaï Fedorov, utopiste l'excès, qui rêvait de redonner la vie tous nos ancêtres, une idée qui m'a stupéfié. En bon élève de la période soviétique, j'avais étudié l'histoire selon les principes du matérialisme historique et je me trouvais alors confronté à la résurrection des pères, aux racines aryennes, aux recherches de berceaux indo-européens, à la guerre pour Constantinople. En un mot, j'étais confronté à la contre-révolution. J'ai éprouvé un grand bonheur esthétique en lisant Nabokov. Sa langue somptueuse, veloutée et extraordinairement poétique, m'a charmé. Le roman surréaliste de Nabokov Le Don est un des meilleurs romans du XXième siècle.
 Parmi les philosophes, mon premier maître à penser a été Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Pendant mon stage de boursier de thèse, j'ai été obligé d'étudier Les cahiers philosophiques de Lénine qui contiennent beaucoup d'extraits de la philosophie classique allemande. Je n'en suis pas resté là. M'étant armé de patience, j'ai consacré plusieurs mois à l'étude en autodidacte de la dialectique de l’absolu. J'ai étudié L'Encyclopédie philosophique, La
Parmi les philosophes, mon premier maître à penser a été Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Pendant mon stage de boursier de thèse, j'ai été obligé d'étudier Les cahiers philosophiques de Lénine qui contiennent beaucoup d'extraits de la philosophie classique allemande. Je n'en suis pas resté là. M'étant armé de patience, j'ai consacré plusieurs mois à l'étude en autodidacte de la dialectique de l’absolu. J'ai étudié L'Encyclopédie philosophique, La
science de la logique, L'éstétique et ensuite La philosophie de l'histoire, le résultat a surpassé toute attente car je suis devenu un idéaliste convaincu.
Platon, que j'ai aussi lu en entier, a suivi Hegel et j'ai même composé deux dialogues philosophiques en m'inspirant des siens. Aristote ne m'a pas vraiment captivé et, au lieu d'étudier la Métaphysique, j'ai relu les biographies philosophiques de Diogène Laërce, les poèmes d'Homère et des magnifiques traductions d'hymnes anciens. Les classiques orientaux ont également exercé une influence considérable sur moi: parmi eux le « Rigveda », le « Mahabharata », Le chevalier dans la peau de tigre de Chota Roustavéli ainsi que la poésie lyrique dans l'esprit de Nizami et de Omar Khayyam. En général, j'ai une prédilection pour l'Orient à laquelle ont contribué le Précis d'Histoire mondial de Djavaharlal Nehru, mon engouement pour les livres et les tableaux de Nikolaï Roerich, mon intérêt scientifique pour l'lnde, la Chine et la Corée du Nord. L'Orient de l’époque classique m'a toujours inspiré un sentiment de respect profond et parfois même d'exaltation et de vive émotion.
Le Zarathoustra de Friedrich Nietzsche m'a beaucoup marqué. Je l'ai lu pour la première fois dans une édition d'avant la révolution (il n'y avait pas d'éditions soviétiques), par la suite, j'ai eu accès aux nouvelles traductions et j'ai lu avec inspiration La naissance de la tragédie et l’esprit de la musique, L'Antéchrist et d'autres œuvres. C'est en partie sous l'influence de Nietzsche que j'ai créé la société littéraire moscovite « Prométhée » avec une orientation pour l'esthétique musicale, pour le « cosmos russe » et l'astronautique. C'était une étape importante de mon cheminement spirituel, où trouvèrent leur expression les recherches et les élans de ma jeunesse romantique.
4. Quels penseurs ont attiré votre attention dans la maturité ?
PVT : Parmi les auteurs occidentaux, ce sont Wagner, Schopenhauer, Heidegger, Camus, Dali, Ortega y Gasset qui m'ont captivé, ensuite Dante, Baltasar Gracian, Ignace de Loyola, Rafael Calvo Serrer (surtout sa Théorie de la Restauration), Escriva de Balaguer (Chemin) et aussi la grandiose poésie épique espagnole « El Cid », que j'ai étudiée dans le texte original. Après avoir travaillé à Séville pour l'Expo-92 et avoir fait connaissance avec des phalangistes, j'ai étudié les œuvres de José Antonio Primo de Rivera, j'ai écrit la brochure La révolution conservatrice en Espagne et l'essai biographique Franco - Caudillo de l'Espagne.
Peu à peu, j'ai commencé à préférer les penseurs russes. Encore dans les années soviétiques grâce aux recherches fondamentales du fondateur de l'école mythologique A.H. Afanasiev (son travail principal Les conceptions poétiques des Slaves sur la nature) et de l'académicien B. A. Rybakov (Le paganisme des anciens Slaves et Le paganisme de l'ancienne Russie), j'ai découvert le monde de l'antiquité slave et je me suis sérieusement intéressé aux racines aryennes de notre civilisation. C'est ainsi que mon intérêt profond pour le passé est né et que j'ai été amené à lire avec la plus grande attention l'ouvrage en plusieurs tomes l’Histoire de l'Etat russe par N. M. Karamzine, à cela ont suivi les œuvres choisies sur l'histoire russe de S. M. Soloviev et les conférences renommées de M. O. Klioutchevski. Dans cette période, je suis devenu militant de la Société panrusse de protection des monuments historiques et culturels.
Depuis le debut de la « perestroïka », j'ai essayé de lire tout ce qui était interdit auparavant et qui était désormais disponible: les livres des écrivains russes-blancs, les analyses des dissidents soviétiques sur le rôle des juifs et des francs-maçons. Je me suis abonné à une montagne de revues copieuses: Problèmes de philosophie, Notre contemporain (Nach Sovremenik), Moscou, Science et religion et d'autres sans compter quelques journaux politiques d'orientation patriotique dans le genre du Messager russe (Russkii Vestnik) et de Jour (Dyeïnn). C'est avec difficulté que j'ai avalé cette avalanche d'informations où foisonnaient les scandales, les sujets à sensation et les nouvelles tragiques.
Après l'abolition de la censure et la libération totale de la presse, les classiques de la pensée russe ont commencé à être publiés en gros tirages: Vl. Soloviev, N. Berdiaev, P. Florenski, Illin, E. Troubetskoi, L. Tikhomirov, I. Solonevitch et d'autres. Ils sont tous des idéalistes orthodoxes de tendances différentes. Je ne peux affirmer avoir lu toutes leurs œuvres (il y en a des centaines), mais j'ai étudié sérieusement l'essentiel. Sous l'influence des philosophes orthodoxes, j'ai élaboré l'idée russe: la « sobornost », qui signifie la liberté hiérarchique et différenciée en Dieu.
C'est à cette époque que j'ai étudié la Bible et que j'ai lu plusieurs fois l'Evangile. L'Ancien Testament a produit sur moi une impression sombre et lors de la lecture du Nouveau Testament j'ai été particulièrement touché par l'Evangile de Saint-Jean et par l'Apocalypse. La Liturgie divine et l'expérience mystique du martyr aident sensiblement à la compréhension de la véritable Orthodoxie.
Sur le plan personnel c'est le père Dmitri Doudko, éminent pasteur moderne et chef spirituel reconnu de l'opposition nationale-patriotique qui m'a offert son aide. J'ai en effet eu l'occasion de réviser un recueil de ses sermons choisis.
Alexei Fedorovitch Lossev reste pour moi encore aujourd'hui le dieu de la philosophie. Il est en même temps philosophe, philologue, musicologue, écrivain, expert de l'antiquité. C'est en la personne de Lossev que la pensée russe a surpassé pour la première fois l'école allemande, réunissant en soi les théories les plus innovantes de la dialectique antique et classique, de la phénoménologie moderne, de la philosophie de l'histoire et de la linguistique. La conception de Lossev est complète ; et elle est aussi exquise ; sa compréhension seule offerte un plaisir esthétique. Les travaux de Lossev, que je préfère, sont : La dialectique du mythe, La mythologie des Grecs et des Romains, Le problème du symbole et l’art réaliste et bien sûr, son oeuvre fondamentale Histoire de l'Esthétique de l'Antiquité. Lossev est encore inconnu en Occident mais, avec le temps, il occupera sans aucun doute la place qui lui revient dans l'Olympe intellectuel.
Dans le cadre de cet interview, il faut réserver une place à part au fameux livre de Nikolaï Yakovlevitch Danilevsky La Russie et l'Europe: Aperçu sur l’attitude culturelle et politique du monde slave vis-à-vis du monde romano-germanique, où l'on élabore pour la première fois, sur une base scientifique, la doctrine du « type slave du point de vue historico-culturel ». J'ai non seulement étudié soigneusement cette œuvre fondamentale qui a exercé en son temps une influence fondamentale sur Spengler et qui a suscité un débat animé dans le milieu intellectuel russe de la fin du XIXième et du début du XXième siècle, mais j'ai aussi étudié l'histoire du problème, j'ai tenu une conférence scientifique à ce sujet dans le cadre du programme de la société historico-religieuse « Sobor » que je dirige et j'ai publié la première anthologie de la philosophie russe de l'histoire, qui comprenait des extraits de l’œuvre des slavophiles classiques, des occidentalistes et des eurasiens: Khomiakov, Kiréevski, Tioutchev, Herzen,
Danilevski, Léontiev, Rosanov, Troubetskoï, Ivanov, Fedotov, Lossev, et aussi des articles de mes contemporains et amis: Vitali Kovalev, Igor Demine, Vladimir Martchenkov, Nikolaï Licovoï, Andreï Pavlenko, Gueïdar Djemal, Viatcheslav Parchkov et d'autres auteurs de talent.
6. Quelles sont les grandes lignes de votre conception du monde ?
L'esprit russe a l'habitude d'écarter les structures de pensée rigides et encombrantes. Le paganisme slave était ouvert et polythéiste. L'Orthodoxie est à sa base apophatique. Les partisans de Bakounine et les marxistes-léninistes ont transformé la dialectique de Hegel en dialectique de la révolution. Les systèmes philosophiques, tels que « la sophiologie » de Vladimir Soloviev ou « la philosophie du nom » d'Alexeï Lossev, sont de rares exceptions.
Je n'ai jamais essayé de créer un système philosophique qui soit en même temps développé et achevé. De temps en temps, naturellement, j'ai dressé le bilan de mes recherches, mais à chaque fois une nouvelle vision du monde s'est ouverte à moi. De la fougue révolutionnaire de ma jeunesse, je suis passé à un prométhéisme créatif, du prométhéisme à l'esprit de « sobornost », de cet esprit de « sobornost » à l'académisme romantique. Maintenant je préfère contempler le monde, l'écouter, l'étudier, le comprendre en profondeur, le savourer, l'apprécier tout en exprimant ma volonté dans l'aspiration à la perfection et à la supériorité. D'ailleurs, je n'ai pas tiré un trait définitif sur mes recherches et je reste ouvert à la vie et à la connaissance. Disons que dans la poésie pendant un certain temps j'ai sciemment visé le symbolisme ontologique, mais actuellement, je me sens plus proche de la simplicité organique d'un romantisme concret et combatif. La paix, la guerre, l'amour, le foyer familial, une mort digne me sont nécessaires en tant que tels et non pas par le biais de symboles et de reflets.
Dans la thèse que je prépare actuellement sur l'histoire des relations russo-hispaniques, je développe une nouvelle tendance de la sémiotique historique. Je considère, étudie et lis toute l'histoire y compris les relations internationales comme un texte. Pour moi, en tant que culturologue qui se veut objectif et impartial, il est important de fuir l'idéologisation et la modernisation des faits historiques. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que je n'ai pas de préférences, de convictions civiques et d'opinions politiques. Je suis un fondamentaliste russe, un patriote, j'aime la liberté et je déteste le pouvoir de l'argent.
Ce sont surtout mes poésies et mes essais réunis dans le livre Comprendre l’Entité russe qui illustrent le mieux ma conception. A ceux qui s'intéressent aux racines indo-européennes, aryennes et slaves, je recommande la lecture de mon étude Nos Dieux originaires: Zeus, Léto, Artemis, Apollon et leurs ancêtres et aussi le précis bibliographique Pôle hyperboréen (in : Naslédnié Predkov, n°4). Mes opinions actuelles, fondées sur un paradigme qualitativement nouveau, qui a été élaboré en tenant compte de l'utilisation de l'ordinateur et de l'expérience acquise aux Etats-Unis, ont été exprimées dans le recueil Prospective russe et également dans une série de nouveaux articles de revues et dans des interventions publiques. Une place particulière devrait être réservé, selon moi, à l’article « Les guerres de la nouvelle génération » (NdSE n°39).
7. Quel est le contenu du livre Perspective russe?
Perspective russe est un recueil collectif d’une dizaine d'écrivains russes, publié en 1996 par le centre de coordination «Pôle» en tant que supplément spécial à la revue Naslédnié Predkov. Ce recueil a le mérite fondamental de créer un modèle de passage au mouvement patriotique russe où le mode de pensée littéraire et idéaliste cèdera la place à une approche militaire et stratégique et où le national-conservatisme sera remplacé par le national-technocratisme.
Dans ce livre il y a six divisions: « L'ideologie nationale », « Guerre et Géopolitique », « La percée technologique », « La Russie et le monde contemporain », « Les conférences et les rencontres scientifiques », « Les nouvelles publications », qui contiennent les analyses des intellectuels les plus avancés de mon entourage. A part mon introduction, « La Renaissance russe: objectifs et priorités», les articles présents dans ce recueil sont: « Russie: principe aristocratique » (Alekseï Chiropaév), « La dictature du capital commercial » (Serguéï Gorodnikov), « La compétitivité de la Russie à l’avenir » (Andréï Saveliev), « La quatrième guerre mondiale » (Vladimir Popov), « Le Temps et le poids de la Russie » (Valeriï Milovanov), « Est-ce que la Russie possède une armée apte à combattre ? » (Evguénii Morozov), « La situation géostratégique après la guerre froide » (Alexandre Bedritzki), « L’exposition aéronautique et astronautique à Joukovskii » (Serguéï Guérasioutine). Ce recueil contient aussi une partie analytique, des traductions, des critiques, des nouvelles et de brèves informations: « Qui Crée notre espace d’information? », « Le résultat des élections présidentielles », « Les droites en Europe Orientale » (d'après le livre de Paul Holenos La liberté de haïr) ; la discussion du livre d'Antony Sutton Comment l'Ordre organise les guerres et les révolutions avec la critique « Conflits à régler: vers un nouvel ordre mondial », les critiques du « Recueil de géopolitique russe » ; du livre de K. E. Sorokine « La géopolitique de l'époque contemporaine et la géostratégie de la Russie » et le numéro qui vient de paraître de la Revue militaire et aussi la réponse à deux calomniateurs russophobes: Walter Laqueur et Alexandre Yanov, suite à la parution de leur livre Les Cent-Noirs. Naissance de l’extrême droite en Russie et Après Eltsine. La Russie de Weimar. A côté de ces articles, il y a, dans le recueil, mon interview intitulé: « Les USA sont un monde qualitativement à part ».
J'attire votre attention sur le fait que c'est justement dans « La perspective russe 1996 » que l'on a osé la première tentative de formuler les objectifs fondamentaux de la « Quatrième guerre mondiale ». En effet, la troisième guerre mondiale (appelée « guerre froide ») contre l'URSS et le communisme mondial, s'est officiellement close le 20 avril 1996, avec la signature au niveau étatique le plus élevé, de la « Déclaration de la rencontre moscovite ». C'est de là que sont nés de nouveaux problèmes et que des questions ont été soulevées ; c'est de là également que vient l'actualité de notre travail que les analystes les plus clairvoyants ont défini comme « une attaque intellectuelle de la nouvelle génération des patriotes ».
8. Quelles sont vos opinions géopolitiques et leur influence sur les débats à la Douma ?
Mes opinions politiques ainsi que ma vision du monde sont en développement perpétuel. Mon intuition de départ et ma volonté sont assez simples. Tout ce qui est bénéfique pour la Russie, pour ma Patrie, me convient. Tout ce qui est contre les Russes et la Russie dans son ensemble est inacceptable pour moi. Méthodologiquement, je dérive mon argumentation de la multiplicité et de la hiérarchie de l'être unique indivisible, composé de plusieurs types d'espaces: personnel, sacré, physique, historique, économique, d'information, etc. Une telle typologie peut varier. L'important est de comprendre que nous, notre famille, notre people, notre histoire, nos intérêts, nous sommes à l'intersection de ces mondes. Si l'on me lance un défi, je suis obligé de répondre. De surcroît, je veux gagner même si la mort me menace. Je le veux tellement et je ferai tout pour que mon désir se réalise, devienne réel. Cela c'est la substance. Quant à la forme, mon modèle métahistorique et descriptif, si l'on peut le synthétiser au maximum, contient trois espaces, grands et complexes, et de type différent, qui pénètrent l'un dans l'autre:
1) La Croix russe (elle se forme à l'intersection du chemin historique « des Varègues aux Grecs », direction Nord-Sud et de l'artère trans-européenne qui s’étend dans toute la Russie de l'Ouest à l'Est, où se cristallise le noyau russe renouvelé et ethniquement compact).
2) L'axe trans-aryen (il traverse la partie méridionale de l'espace central depuis le Nord-Ouest au Sud-Est et crée une attraction entre le Nord et le Sud aryens).
3) Le bouclier euro-asiatique (l'espace le plus étendu et le plus hétérogène qui pourrait être constitué potentiellement par tous les Etats de notre continent avec les îles adjacentes; son but essentiel consiste à créer une large union de défense contre les forces de l'atlantisme occidental, du mondialisme et du sionisme international). Il est important de ne pas confondre ces trois grands espaces car c'est à l'intérieur de chacun d'entre eux que les problèmes particuliers trouvent leur solution.
C'est par un souci d'exactitude scientifique que je dois préciser que mes opinions en matière de géopolitique se sont formées sous l'influence des œuvres d'Alexandre Douguine, surtout de sa revue Elementy. Je souhaite également mentionner le travail de Robert Steuckers « Panorama théorique de la géopolitique » ( j'ai participé à sa traduction en russe), les études d'Evguéniï Morozov et de ses compagnons de lutte dans le Recueil géopolitique russe et aussi les recherches en matière de race et d'eugénisme de Vladimir Avdéev, mon ami, membre du conseil de rédaction de Naslédnié Predkov.
Actuellement, j'interprète les anciens problèmes d'une nouvelle façon, je complète et je précise mes études précédentes. Il est indispensable de tenir compte de ce qui a été publié par d'autres auteurs ces dernières années. C'est surtout les Principes de géopolitique de A. G. Douguine, la Géopolitique contemporaine de K. E. Sorokine, L'Europe unie: problèmes et perspectives de V. Wiedemann, les Manœuvres de la nouvelle géopolitique de A.V. Mitrofanov, l'étude critique de l'« eurocentrisme » de S. Kara-Mouzza. Ce qui différencie essentiellement mes anciennes vues des actuelles, c'est mon plus grand réalisme et le refus du schématisme occidental.
Vous me demandez quel est l'impact des projets géopolitiques sur les débats à la Douma. Je ne peux pas répondre avec précision à votre question car j'ai été au Comité de géopolitique seulement quelques fois (récemment, on y a présenté la revue Naslédnié Predkov). Toutefois, s'il faut s'en tenir à quelques démarches pratiques de l'administration actuelle des affaires étrangères du gouvemement d'Eltsine, signalons quelques points qui nous paraissent intéressants et positifs : une amitié préférentielle avec l'Allemagne, des rapports extrêmement chaleureux avec la France, un certain rapprochement avec le Japon, le fait d'accorder un plus grand poids au rôle de l'Espagne, l'intensification de la présence russe dans les Balkans malgré les menaces de la Turquie, et, en même temps, l'évident passage d’un stade à un autre : de l’alliance temporaire avec les USA, nous passons à un éloignement graduel par rapport aux Américains ; nous constatons aussi un rapprochement ostentatoire avec la Chine. La reprise de la lutte en faveur des anciens alliés dans le monde arabe, en Asie, en Amérique latine etc. On ne peut pas s'empêcher de remarquer les changements en faveur de mes amis politiques.
9. Comment voyez-vous la future collaboration entre les nouvelles droites en Russie et
en Europe occidentale ?
D'un point de vue géopolitique, ce qui m'intéresse ce n'est pas le fait d'être à droite ou à gauche, mais l'attitude réelle par rapport aux Russes, à la Russie, à notre passé, présent et futur. C'est cette vision qu’expriment mes amis espagnols, qui me disent: « Nous aimons les Russes indépendamment du fait qu’ils soient communistes ou monarchistes ». Ils incarnent l'idéal. Et ils ont raison car il y a non seulement des individus mais aussi des pays entiers qui changent leur orientation politique, bien que, malgré cela, les intérêts fondamentaux restent les mêmes dans le fond.
En définitive, je me sens beaucoup plus proche de la droite. Ce n'est pas par hasard que Naslédnié Predkov (« L'héritage de nos ancêtres »), possède un sous-titre « revue des perspectives de droite ». Mais la question est de savoir de quelle droite il s'agit. « Les anciennes droites » diffèrent entre elles, les « nouvelles droites » sont aussi hétérogènes. Chez nous en Russie, par exemple, il y a des tendances extrémistes qui n'ont pas de lien réel avec la tradition nationale. Ce sont les habituels extrémistes de gauche: soit par le fond, soit par le langage, soit par la forme. C'est pour cette raison que la première chose à faire consiste à s'entendre sur les questions principales et à chercher ensuite des alliés.
Mais il y a autre chose. L'Europe occidentale, actuellement, n’est pas satisfaite de l'influence excessive des USA dans sa région. Mais elle possède des intérêts russes. En effet, l’intégration des petits Etats de l’Europe orientale ou septentrionale dans le marché commun et l'OTAN etc l'arrange parfaitement car dans ce cas, le rôle de ces mêmes Etats d'Europe occidentale s'accroît et leur structure s'actualise et se dynamise. Il serait plus avantageux pour les Russes que ce processus de dynamisation se développe à l'Est et au Sud par le territoire russe. Mais ce sont justement les conflits militaires provoqués et artificiellement entretenus en Europe orientale qui l'empêchent.
Votre organisation a lancé l’initiative « Synergon/Synergies Européennes » avec laquelle je me suis familiarisé en lisant les pages de la revue Impérativ (n°2), dirigée par Vladimir Wiedemann. Le document qu’il y a publié contient des pensées remarquables et constructives et comme, on le dit dans ce cas, chargées d'optimisme. Je suis surtout frappé par l'appel des auteurs à la conservation de la mémoire historique, des cultures enracinées et développées, ayant des traditions spirituelles riches. Vous comprenez profondément les problèmes écologiques et économiques de l'époque actuelle, vous ouvrez des perspectives aux jeunes, aux innovateurs, aux forces dynamiques. Ce sont surtout notre politique d'information et votre intention de contribuer à la création des bases d'un système de soutien intellectuel réciproque entre ceux qui partagent les mêmes idées « sur toute l’étendue du Grand Ordre continental » qui n'ont intéressé. Si j'ai bien compris, il ne s'agit pas ici de l'Europe occidentale qui attire vers elle une partie des pays d'Europe orientale dans les intérêts de l’OTAN mais de la formation sur tout notre continent d'une communauté qualitativement différente pour toute l'Eurasie.
Quelle forme prendra cette nouvelle communauté géopolitique, c'est avec le temps que nous le verrons. S'agirait-il de cet Empire Sacré entièrement autonome auquel vous aspirez ou d'une nouvelle Sainte-Allianœ ou de l'héritière de l'Union Soviétique ? Pour le moment, il n'y a pas de réponse précise à cette question comme à beaucoup d'autres. Il est clair que le chemin vers le bloc continental ne sera pas facile et, à l'avenir, il ne faut pas s'attendre à une solution rapide et pacifique de tous les problèmes existants.
Qu'est-ce que l'on peut proposer de concret aux membres de la « Synergies européennes » ? Tout d'abord, il s'agira d’apprendre à se connaître en profondeur. Pour le moment, je ne connais pas bien l'UE et je ne suis prêt qu'à avoir un rôle d'observateur. En deuxième lieu, il s'agira d'un champ intellectuel et d'information. Il sera indispensable de comparer notre terminologie, nos valeurs, nos objectifs. Il ne faut pas se hâter de créer un « nouvel ordre », en imitant les modèles historiques qui n'ont pas fonctionné autrefois ou qui se sont auto-éliminés. La troisième étape pourrait être une conférence permanente apte à faciliter le passage de la solution des problèmes théoriques aux questions pratiques. Ensuite, on pourrait envisager la publication d'un périodique en plusieurs langues étrangères y compris le russe.
Mais actuellement la Russie n'offre que rarement le matériel, prêt à être publié, pour « Synergies Européennes ». C'est une situation anormale. Elle ne correspond pas à l'apport des Russes au développement du continent. Par conséquent, nous devons tout d'abord créer des conditions aptes à faire naître une collaboration réciproque et passer ensuite aux questions pratiques d'organisation et de droit.
Pour conclure, je voudrais remercier personnellement Robert Steuckers pour l'attention qu'il consacre à la Russie, au nouveau mouvement de droite, à la revue « L'Héritage de nos ancêtres » et aussi pour m'avoir offert l'occasion de m'exprimer sur les pages de votre publication. Pendant que l'on préparait l'interview à l'impression, Anatoli M. Ivanov m'a montré une sélection des numéros de «NdSE » et de «Vouloir» de ces dernières années. Je m'en félicite ! Vous publiez une revue tout à fait nécessaire et sérieuse. Ce sont surtout les éditions spéciales consacrées à l'idée russe et au bolchevisme national qui m'ont plu.
Permettez moi de souhaiter que nos rapports se développent ultérieurement sur la base d’un intérêt réciproque, d'une profonde compréhension mutuelle et des liens constructifs et amicaux. Ensemble, nous constituerons une force !
Pavel TOULAEV.
2 février 1998, rédaction : 15.10.98



 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998 Parmi les philosophes, mon premier maître à penser a été Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Pendant mon stage de boursier de thèse, j'ai été obligé d'étudier Les cahiers philosophiques de Lénine qui contiennent beaucoup d'extraits de la philosophie classique allemande. Je n'en suis pas resté là. M'étant armé de patience, j'ai consacré plusieurs mois à l'étude en autodidacte de la dialectique de l’absolu. J'ai étudié L'Encyclopédie philosophique, La
Parmi les philosophes, mon premier maître à penser a été Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Pendant mon stage de boursier de thèse, j'ai été obligé d'étudier Les cahiers philosophiques de Lénine qui contiennent beaucoup d'extraits de la philosophie classique allemande. Je n'en suis pas resté là. M'étant armé de patience, j'ai consacré plusieurs mois à l'étude en autodidacte de la dialectique de l’absolu. J'ai étudié L'Encyclopédie philosophique, La
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998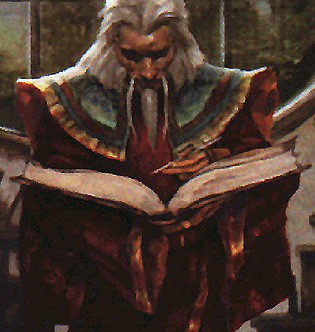 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992 AD: Pas tout à fait. La perestroïka est négative; elle est une catamorphose. Mais Zinoviev néglige l'action des forces occultes et ignore les lois cycliques. Nous, nous mettons l'accent sur les lois cycliques. Après la perestroïka, il adviendra un monde pire encore que celui du prolétarisme communiste, même si cela doit sonner paradoxal. Nous aurons un monde correspondant à ce que l'eschatologie chrétienne et traditionnelle désigne par l'avènement de l'Antéchrist incarné, par l'Apocalypse qui sévira brièvement mais terriblement. Nous pensons que la «deuxième religiosité» et les Etats-Unis joueront un rôle-clef dans ce processus. Nous considérons l'Amérique, dans ce contexte précis, non pas seulement dans une optique politico-sociale mais plutôt dans la perspective de la géographie sacrée traditionnelle. Pour nous, c'est l'île qui a réapparu sur la scène historique pour accomplir vers la fin des temps la mission fatale. Tout cela s'aperçoit dans les facettes occultes, troublantes, de la découverte de ce continent, juste au moment où la tradition occidentale commence à s'étioler définitivement. Sur ce continent, les positions de l'Orient et de l'Occident s'inversent, ce qui coïncide avec les prophéties traditionnelles pour lesquelles, à la fin des temps, le Soleil se lèvera en Occident et se couchera en Orient. C'est Djemal Haïdar qui, parmi nous, a été le premier à nous le faire remarquer. La perestroïka, pour nous, n'est pas envisageable sans le facteur Amérique qui en est le moteur invisible, sur les plans politique et métapolitique. Zinoviev omet d'étudier le facteur occulte "Amérique" qui, pour nous, est essentiel.
AD: Pas tout à fait. La perestroïka est négative; elle est une catamorphose. Mais Zinoviev néglige l'action des forces occultes et ignore les lois cycliques. Nous, nous mettons l'accent sur les lois cycliques. Après la perestroïka, il adviendra un monde pire encore que celui du prolétarisme communiste, même si cela doit sonner paradoxal. Nous aurons un monde correspondant à ce que l'eschatologie chrétienne et traditionnelle désigne par l'avènement de l'Antéchrist incarné, par l'Apocalypse qui sévira brièvement mais terriblement. Nous pensons que la «deuxième religiosité» et les Etats-Unis joueront un rôle-clef dans ce processus. Nous considérons l'Amérique, dans ce contexte précis, non pas seulement dans une optique politico-sociale mais plutôt dans la perspective de la géographie sacrée traditionnelle. Pour nous, c'est l'île qui a réapparu sur la scène historique pour accomplir vers la fin des temps la mission fatale. Tout cela s'aperçoit dans les facettes occultes, troublantes, de la découverte de ce continent, juste au moment où la tradition occidentale commence à s'étioler définitivement. Sur ce continent, les positions de l'Orient et de l'Occident s'inversent, ce qui coïncide avec les prophéties traditionnelles pour lesquelles, à la fin des temps, le Soleil se lèvera en Occident et se couchera en Orient. C'est Djemal Haïdar qui, parmi nous, a été le premier à nous le faire remarquer. La perestroïka, pour nous, n'est pas envisageable sans le facteur Amérique qui en est le moteur invisible, sur les plans politique et métapolitique. Zinoviev omet d'étudier le facteur occulte "Amérique" qui, pour nous, est essentiel.
 La philosophie néo-existentialiste du sénateur Bossi dépasse largement mes facultés d'intelligibilité. Personnellement, j'éprouve un élan affectif majeur dans une relation amoureuse plutôt que dans le rapport avec ma nation. De plus, j'ai le vilain défaut de ne pas adhérer aux principes de l'ethno-fédéralisme, peut-être parce qu'en dépit de tous mes efforts, je ne les comprends toujours pas. Par ma nationalité, je suis italien, mais cela ne me suffit pas pour reconnaître les Italiens comme un peuple ethniquement homogène. Je ne sais pas trop ce qu'est une nation ethnique mais je suis certain que si elle devenait cette nation, je partirais ailleurs. Je suis encore partisan de l'idée qu'un état ethnique ne peut pas être un état libre et démocratique. Mais je n'ai pas la prétention de convaincre les liguistes et je suis très curieux d'entendre leurs argumentations.
La philosophie néo-existentialiste du sénateur Bossi dépasse largement mes facultés d'intelligibilité. Personnellement, j'éprouve un élan affectif majeur dans une relation amoureuse plutôt que dans le rapport avec ma nation. De plus, j'ai le vilain défaut de ne pas adhérer aux principes de l'ethno-fédéralisme, peut-être parce qu'en dépit de tous mes efforts, je ne les comprends toujours pas. Par ma nationalité, je suis italien, mais cela ne me suffit pas pour reconnaître les Italiens comme un peuple ethniquement homogène. Je ne sais pas trop ce qu'est une nation ethnique mais je suis certain que si elle devenait cette nation, je partirais ailleurs. Je suis encore partisan de l'idée qu'un état ethnique ne peut pas être un état libre et démocratique. Mais je n'ai pas la prétention de convaincre les liguistes et je suis très curieux d'entendre leurs argumentations. Je ne connais pas le futur, mais je crains que la schématisation du conflit de civilisation, inventé par le politologue américain Samuel Huntington, puisse un jour prévaloir. Si on suivait ce type de raisonnement, tout le monde serait perdant, aussi bien les Européens que les Islamiques. En outre, il n'existe pas d'ensemble géopolitique spécifique pour la détermination du monde islamique et nous n'avons aucun intérêt à promouvoir sa création. Si je peux avancer une suggestion, je dirais qu'il faut éviter à tout prix que le rapport avec le monde arabe et le monde islamique soit géré par des soi-disant experts (largement rémunérés), qui nous empêchent d'entendre la véritable voix des Arabes et des Islamiques.
Je ne connais pas le futur, mais je crains que la schématisation du conflit de civilisation, inventé par le politologue américain Samuel Huntington, puisse un jour prévaloir. Si on suivait ce type de raisonnement, tout le monde serait perdant, aussi bien les Européens que les Islamiques. En outre, il n'existe pas d'ensemble géopolitique spécifique pour la détermination du monde islamique et nous n'avons aucun intérêt à promouvoir sa création. Si je peux avancer une suggestion, je dirais qu'il faut éviter à tout prix que le rapport avec le monde arabe et le monde islamique soit géré par des soi-disant experts (largement rémunérés), qui nous empêchent d'entendre la véritable voix des Arabes et des Islamiques.