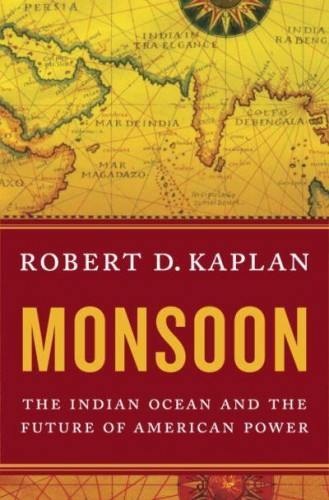Robert Steuckers:
Entretien accordé à Manuel Quesada
1.
Monsieur Steuckers, vous avez passé de nombreuses années à circuler dans l’espace défini comme “identitaire” voire “nationaliste” ou “néo-nationaliste”, de tendance “nouvelle droite”. Nous avons un ami commun, le Britannique Troy Southgate. Qu’est-ce qui vous a incité à choisir cet espace culturel et politique?
 Au départ, rien, mais absolument rien, ne me prédestinait à aller circuler dans ce milieu, qui a précédé puis fondé l’espace politico-culturel de la “nouvelle droite”. Aucune tradition familiale ne m’a incité à aller chercher du sens dans un tel espace: en effet, les agitations politiciennes relevaient, pour mon père, issu du paysannat limbourgeois-hesbignon, de la “folie des villes”. Sa devise était: “pour vivre heureux, vivons caché” et il la citait volontiers en français, qui n’était pas sa langue maternelle. Quant à ma mère, elle était issue d’une famille qui entendait vivre en parfaite autarcie par rapport à une société que mon grand-père, ancien combattant de 14-18, méprisait, quelles qu’en aient été les facettes. Quand on évoquait des grands problèmes sociaux, irrésolus, ma mère disait, en flamand: “’t is ver van mijn bed!” (“C’est loin de mon lit!”), sous-entendu, “je n’ai pas à m’en occuper”. Mon père a travaillé de 1938 à 1944, et de 1952 à 1978 pour le Comte Guillaume de Hemricourt de Grünne, l’oncle de Rodolphe de Hemricourt de Grünne, le héros de l’aviation franquiste pendant la guerre d’Espagne, où ce jeune et fringant aristocrate, issu du Collège Saint-Louis de Bruxelles, s’était porté volontaire pour s’affranchir d’une vie de dandy qui ne le satisfaisait plus. Les frères de Guillaume de Grünne, Eugène et Xavier, étaient eux aussi des héros militaires. Eugène, chantre du sacrifice du soldat chrétien (catholique), a d’ailleurs été tué à la guerre, aux côtés du beau-frère de mon père, à Maldegem, en mai 1940, fidèle aux préceptes qu’il énonçait, volontaire de guerre en première ligne à 57 ans! Xavier, alpiniste chevronné, puis sénateur rexiste, puis adversaire de Degrelle, puis fondateur d’une “Phalange belge” hostile tant aux Anglais qu’aux Allemands, mourra en déportation à Mauthausen, fidèle à la neutralité belge jusqu’à son dernier souffle, en dépit de tous les rapports de force! Un idéalisme d’une pureté inouïe qui s’est fracassé contre le “granit du pragmatisme”, comme aurait dit le regretté Dominique Venner!
Au départ, rien, mais absolument rien, ne me prédestinait à aller circuler dans ce milieu, qui a précédé puis fondé l’espace politico-culturel de la “nouvelle droite”. Aucune tradition familiale ne m’a incité à aller chercher du sens dans un tel espace: en effet, les agitations politiciennes relevaient, pour mon père, issu du paysannat limbourgeois-hesbignon, de la “folie des villes”. Sa devise était: “pour vivre heureux, vivons caché” et il la citait volontiers en français, qui n’était pas sa langue maternelle. Quant à ma mère, elle était issue d’une famille qui entendait vivre en parfaite autarcie par rapport à une société que mon grand-père, ancien combattant de 14-18, méprisait, quelles qu’en aient été les facettes. Quand on évoquait des grands problèmes sociaux, irrésolus, ma mère disait, en flamand: “’t is ver van mijn bed!” (“C’est loin de mon lit!”), sous-entendu, “je n’ai pas à m’en occuper”. Mon père a travaillé de 1938 à 1944, et de 1952 à 1978 pour le Comte Guillaume de Hemricourt de Grünne, l’oncle de Rodolphe de Hemricourt de Grünne, le héros de l’aviation franquiste pendant la guerre d’Espagne, où ce jeune et fringant aristocrate, issu du Collège Saint-Louis de Bruxelles, s’était porté volontaire pour s’affranchir d’une vie de dandy qui ne le satisfaisait plus. Les frères de Guillaume de Grünne, Eugène et Xavier, étaient eux aussi des héros militaires. Eugène, chantre du sacrifice du soldat chrétien (catholique), a d’ailleurs été tué à la guerre, aux côtés du beau-frère de mon père, à Maldegem, en mai 1940, fidèle aux préceptes qu’il énonçait, volontaire de guerre en première ligne à 57 ans! Xavier, alpiniste chevronné, puis sénateur rexiste, puis adversaire de Degrelle, puis fondateur d’une “Phalange belge” hostile tant aux Anglais qu’aux Allemands, mourra en déportation à Mauthausen, fidèle à la neutralité belge jusqu’à son dernier souffle, en dépit de tous les rapports de force! Un idéalisme d’une pureté inouïe qui s’est fracassé contre le “granit du pragmatisme”, comme aurait dit le regretté Dominique Venner!
Mais l’option catholique intransigeante, qui n’avait plus aucune représentation politique en Belgique dans les années 50, 60 et 70, était totalement refoulée, à l’époque bénie de mon enfance, sous l’impact du consumérisme, de la modernité, des modes un peu canailles (existentialisme sartrien, hédonisme à la Françoise Sagan, Beatles anglais, hippies, etc.). On ne parlait plus de politique. On cherchait d’autres choses, sans les trouver vraiment ou alors très furtivement, car ces “choses” étaient démodées déjà avant qu’on ne les ait comprises, tant dans leur aspect subversif que dans leur aspect superficiel de pure fabrication médiatique. Bref les adages que répétaient mes parents, à satiété, semblaient parfaitement de mise: mieux vaut ne pas s’occuper des folies modernes, mieux vaut s’occuper de ses propres affaires, gérer sa vie selon les principes immémoriaux (ma mère: “Ne t’occupe pas du chapeau de la gamine, pousse ta voiture!”), bref selon une forme modeste de “mos majorum”. Je ne me suis pas révolté contre cette limitation volontaire: je l’ai acceptée. Je n’avais pas le loisir de me payer le luxe d’une révolte fracassante comme les gamins des bourgeois nantis. Les modes et les chansonnettes m’horripilaient et j’aime toujours à regarder cette planche désopilante de Franquin, le créateur de “Gaston Lagaffe”, où le chef de bureau Prunelle, excédé par la niaiserie des paroles chantées, canarde à la carabine de chasse, suite à une maladresse technique de l’inénarrable gaffeur, les disques virevoltants qui reproduisaient bruyamment les chansonnettes ineptes et qui appartenaient à la vieille Tante Hortense de Lagaffe: c’est ce sentiment de Prunelle excédé que je partageais quand les filles passaient de tels disques lors de mes vacances franc-comtoises. Mais j’ai estimé, dès l’âge de quatorze ans, qu’on ne pouvait pas toujours vivre caché et qu’il y avait bien des choses passionnantes loin de mon lit...
En fait, vous me demandez un travail d’anamnèse un peu harassant: quels ont été chez moi les déclics qui, cumulés, ont provoqué le rejet du pandémonium dominant? D’abord, oui, cet univers cucu-la-praline des chansonettes des années 60, aussi navrantes que celles des années 30 (dont se rappelait ma mère, qui les écoutait en français à Bruxelles, sa ville natale); ensuite, le basculement du catholicisme sociologique vers des choses qui me paraissaient tout-à-fait inintéressantes; ce nouveau catholicisme abandonnait ce que la religion dominante avait auparavant d’exaltant: art, cathédrales somptueuses (qui, avec leurs rosaces, me fascinent toujours, me rappellent un culte michaélien et zoroastrien du soleil et de la lumière), esprit de croisade, etc. Nous vivions dans un porte-à-faux permanent en ce milieu belge du catholicisme sociologique dans les années 60, en pleine mutation, en plein passage d’un virilisme latin à la liquéfaction para-hippy. Certains instituteurs exaltaient le passé médiéval et bourguignon de la Belgique. D’autres n’avaient aucune vision historique. Un jour, quand une formidable bataille s’était déclenchée à la cour de récréation de mon école primaire, et que les élèves encourageaient les combattants comme autour d’un ring de boxe, le vicaire-aumônier B., pourtant haut en couleurs, est arrivé, en criant et en levant les bras au ciel: “Mais enfin, les enfants, est-il chrétien de se battre comme ça?”. J’ai répondu: “Et les croisés, monsieur l’Abbé?”. Le vicaire B. est resté sans voix et a tourné les talons. Deux ans plus tard, quand, pour rire et pour faire les malins devant les filles, nous nous bagarrions comme de vrais sauvageons dans l’autobus qui nous ramenait du prieuré où nous avions fait retraite quelques jours avant notre communion solenelle, le successeur du vicaire B., le frêle et triste abbé G., tentait de nous ramener à la raison, en posant la même question. J’ai eu exactement la même réponse. J’ai fait ma communion solenelle avec le front maquillé, enduit de fond de teint, car il était d’un bleu violacé, tout en laideur: un condisciple, Yves M., m’avait atteint le front d’un maître coup de catapulte tiré quasi à bout portant, alors que je donnais l’assaut à sa position, perché qu’il était au sommet d’une cage à poules. Ces joyeusetés étaient devenues tout-à-coup tabou. Interdites. On nous pressait de rentrer dans un moule étriqué, dans un monde aseptisé, sans joie, sans couleurs, tout de retenue, avec pour consolation, on allait le voir, des musiques et des glapissements fabriqués aux Etats-Unis et, avec mai 68, un an plus tard, une “libération sexuelle” sérialisée, sans danger ni piment dans la mesure où veillaient la pilule et la capote anglaise
Même glissement dans le mouvement scout. J’étais louveteau, selon les rituels de Baden-Powell, à huit ans sous l’autorité d’un Akéla extraordinaire, le fils de la famille Biswall des chocolats Côte-d’Or. On s’amusait comme des petits fous. On arpentaient les sentiers de la Forêt de Soignes. On se distribuait, dans la joie et sans rancune, moults horions et maîtres coups de bâton. Akéla-Biswall est parti à l’université, pour y étudier le droit, et a été remplacé par le fils compassé d’un gargotier du quartier, prolo mental, style démo-crétin, totalement coincé, qui a interdit tous les jeux collectifs un peu vigoureux, a supprimé les sorties dans la Forêt de Soignes. Un emmerdeur, pire, un emmerdeur compassé, car les tenants de l’idéologie dominante sont finalement tous des emmerdeurs. Il nous fallait, tout un après-midi, alors que le soleil était là, qu’une belle hêtraie verdoyante était à 300 m, mimer, à l’intérieur du local sans lumière, le vol de la petite abeille Maya. Je me suis enfui. Plus tard, grâce à une émission de la VRT ou de la RTBF, j’ai appris que l’animal qui avait voulu rendre le mouvement scout “politiquement correct” —ante litteram— n’était autre que le futur premier ministre Jean-Luc Dehaene, le patapouf qui a ruiné la Belgique, contracté des dettes pharamineuses, mis par terre la banque Dexia, endetté le pays et ses familles pour de nombreuses générations. Non seulement ces gens sont des emmerdeurs mais ils sont aussi des incapables.
Réflexion faite, je pense toutefois que c’est l’immersion dans l’univers héroïque du “De Viris Illustribus” simplifié que nous utilisions en deuxième année de latin en 1968-69 qui m’a conduit sur la voie d’une adhésion aux tréfonds de la culture européenne. J’ai racheté, il y a deux ou trois ans, un exemplaire quasi neuf de cette vieille méthode d’enseignement du latin, jetée bien sûr aux orties par les nouveaux pédagogues qui croient avoir trouvé la clef qui ouvrira aux élèves tous les secrets de l’univers. J’ai été stupéfait de constater combien de phrases, de règles, de schémas, d’exercices me revenaient à l’esprit en feuilletant cette méthode du Prof. Van Rijckevorsel. Il y avait là les Horaces et les Curiaces, l’enlèvement des Sabines, les oies du Capitole, Mucius Scaevola (mon préféré!) et surtout Cincinnatus, qui sauvait les “res publicae” et retournait tranquillement à sa charrue. La maturation politique, qui germait dans l’intériorité du pré-adolescent que j’étais, venait incontestablement de ces modèles: on ne pouvait être homme, “vir”, on ne pouvait faire de la politique, oeuvrer dans la Cité, que si l’on prenait ces héros de la Rome antique comme exemples! Après venaient les quelques copains —une toute petite minorité— qui, eux aussi, rejetaient et les niaiseries à la mode des années 60 —les stupides chansonnettes françaises prisées par la “Tante Hortense”— et l’esprit de la revue branchée “Salut les copains” que nous abominions au profit, bien sûr, tradition locale oblige, du journal “Tintin”, parce qu’il y avait notamment, dans ses pages, l’univers antique d’Alix, avec la Reine Adréa de Sparte et le sage commandant de sa “Garde Noire”, Astyanax... Les “modes” ne nous intéressaient pas, nous les détestions et dans le mot “mode”, il y a la racine du terme “moderne”. Est “moderne” au départ, celui qui ne prête plus attention aux fondements (politiques, religieux, philosophiques, ethnologiques, anthropologiques), ceux des “Anciens”, et s’entiche des dernières créations en vogue, toujours artificielles, toujours éphémères et vite remplacées par de nouveaux engouements: pérenniser cette succession ininterrompue d’historiettes et de radotages bricolés, dépourvus de fondements, est l’objectif de la modernité, est le noyau même de la démarche moderne qui fait de la disparition des fondements, des assises de toute civilisation, un “progrès”, accompagné du relativisme et des “petits récits” sans continuité de la postmodernité (qui n’a pas su prendre révolutionnairement le relais de la modernité libérale).
A notre pré-adolescence, donc, il fallait, nous semblait-il, penser en termes de fondements donc cultiver la “longue mémoire”, procéder par la méthode “généalogique” ou “archéologique”, qu’une lecture assez rapide de Nietzsche, vers quinze ans, aller conforter: certes, cette lecture peut s’avérer dangereuse et destructrice pour un jeune esprit, faire de lui un être hostile à la religion en général —à toute religion— ou un être dépourvu de tout sens moral ou éthique, s’estimant autorisé à commettre sans scrupules les actes les plus répréhensibles. On a pu relever, quelques fois, des dérapages dus à une lecture mal digérée de textes ou de citations de Nietzsche, non pas tant dans un quelconque espace politisé mais dans des bandes “à la mode” (encore!) qui se donnaient un style agressif, avec des oripeaux ou des coiffures de grande laideur, destinés à faire peur ou à se démarquer de toute bienséance, se marginalisant du même coup, rendant impossible la transposition de leurs quelques vagues idées “nietzschéennes” dans la réalité concrète des citoyens actifs de la Cité, ceux qui, avec abnégation et persévérence, affrontent en permanence les défis qui se présentent, dans toute leur concrétude. Les “sub-cultures”, qu’elles soient de gauche ou de droite, qu’elles se donnent des allures soft, comme les hippies, ou hard, comme les “blousons noirs” ou les “skinheads”, participent du système qui génère les modes parce que les modes font oublier les fondements de notre culture européenne (et japonaise au Japon, chinoise en Chine, etc.) et aussi et surtout parce qu’elles permettent, adroitement, de marginaliser les contestations puis de les récupérer ou de les diaboliser, justement parce qu’elles ont été “montées en spectacle”, visibilisées sous les feux de rampe médiatiques, par ce système aliénant moderne que Guy Debord, le situationniste, nommait la “société du spectacle”.
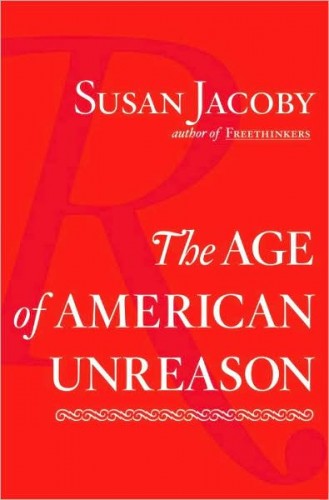
Cela nous ramène à l’actualité, quand l’historienne américaine des idées Susan Jacoby publie en 2008 son ouvrage de référence indispensable à assimiler pour bien gérer le combat métapolitique de la mouvance identitaire européenne actuelle, “The Age of American Unreason – Dumbing Down and the Future of Democracy” (Old Street Publishing, London, 2ème éd.). Dans ce livre, Susan Jacoby dénonce la culture populaire actuellement dominante, issue des fabriques à ahurir basées aux Etats-Unis. C’est une culture de la déraison totale, de la non-raison, que proposent paradoxalement une société et une superpuissance qui prétendent que leurs racines résident dans les “Lumières” du 18ème siècle, dans le savoir rationnel et pragmatique que ces “Lumières” ont induit pour contrecarrer les effets permanents et anciens d’une “tradition” (tout à la fois aristotélicienne et religieuse), tradition qu’elles posaient derechef comme irrationnelle et obscurantiste. Or, en bout de course, la superpuissance-guide de l’Occident “éclairé” générait chez elle et exportait partout dans le monde un “junk thought”, une “pensée-détritus” qui ne tenait plus compte de la pondération, de la rationalité, du bon sens, pour produire, via les médias, via le fondamentalisme religieux le plus stupide et via l’enseignement américain à la dérive, via, aussi, la crédulité entretenue du grand public, une sous-culture de l’“infotainment” (des loisirs via l’information médiatisée), qui ne mobilisait plus du tout l’esprit critique, nécessaire en permanence pour ne pas s’enliser dans les répétitions, pour être apte à répondre à tous les défis qui pourraient se présenter. Ce “junk thought” a-critique n’est pas vraiment assimilable aux irrationalismes d’antan ou aux formes philosophiques d’anti-intellectualisme ou d’anti-rationalisme: la “non-raison” qu’il répand à grande échelle engendre un déclin bien perceptible, d’abord dans l’enseignement et la transmission (devenue, sous toutes ses formes, “politiquement incorrecte” et sabotée par les pédagogues officiels, fonctionnaires des ministères); ensuite, cette “non-raison” s’infiltre dans le vaste public, toujours plus ignorant des tenants et aboutissants réels du monde passé et présent, un public devenu “reality-denier”, “négateur du réel”, et répétant des banalités sans fondements dans un langage codé par les médias. Susan Jacoby constate l’impasse dans laquelle les “Lumières” se sont fourvoyées en pariant, non pas, à terme, sur le despotisme éclairé des monarques politiques, mais sur le “moderne” (donc sur les “modes” inventées puis oubliées et remplacées). Il fallait qu’au nom d’une “liberté” faussement comprise, il débouche immanquablement sur le “junk thought”.
En 1975, je découvre le livre de Pierre Chassard, “La philosophie de l’histoire dans la philosophie de Nietzsche”, publié par le GRECE à Paris. J’ai passé l’été 1975 à lire non seulement ce livre mais à me référer à toutes les oeuvres de Nietzsche lui-même, citées dans les pages de Chassard. C’est ainsi que j’ai reçu ma formation nietzschéenne. Au même moment, Bernard Garcet, qui avait été cadre de “Jeune Europe” à l’Université de Louvain au début des années 60 avait réanimé, chez lui, une “école des cadres”, cette fois non politisée, et très “sciences po” dans ses exigences: il m’a forcé à lire Burke, Mannheim, Rougier et à structurer mes notes de lecture, à les couler dans un exposé cohérent. Etonnant personnage que ce Garcet, professeur de religion catholique, agréé par le vicariat diocésain, tout en se réclamant d’un catholicisme irlando-écossais du haut moyen âge en rupture de ban avec les dogmes habituels de l’Eglise et avec Vatican II sans adhérer au lefébvrisme, percevant le christianisme de Scot Erigène comme la continuation du druidisme païen... Un Garcet qui parlait d’Orwell dans son cours... Un Garcet qui sera aussi un redoutable professeur de “Thaï Boxing”, célèbre à Schaerbeek et environs. Un Garcet quinquagénaire qu’on avait muté dans une école de sages jeunes filles pour terminer sa carrière car il avait secoué un élève violent... le directeur avait ri sous cape...
Sur cette note un peu nostalgique, je termine tout de même ma réponse à votre question: c’est l’école primaire, puis l’école secondaire et l’université qui m’ont formé. C’est toujours dans leur cadre que j’ai appris les fondamentaux qui font aujourd’hui ma vision du monde. Si j’ai eu entre les mains le livre de Chassard et si j’ai fréquenté l’“école des cadres” de Garcet, c’est parce que des professeurs m’avaient mis sur la voie: comment ne pas évoquer avec tendresse le patriotisme bourguignon de l’instituteur M., très sévère et fils d’un résistant royaliste ardennais, et les cours de littérature allemande d’Albert D. (dont je narrerai un jour l’époustouflante biographie... qui fera jaser les “Vigilants”...).
2.
Vous défendez l’idée eurasienne. Pouvez-vous nous expliquer ce qu’elle est, ce qui en tient lieu de fondement, pour vous? Quelles sont de votre point de vue les racines de l’eurasismecontemporain?
J’ai toujours souligné, surtout dans l’introduction que j’ai rédigée pour le livre du géopolitologue croate Jure Vujic, que ma perspective “eurasienne” (et donc “eurasiste”), provient d’une lecture ancienne, celles des atlas historiques du Britannique Colin McEvedy. Cet historien, géographe et cartographe avait écrit de nombreux atlas historiques pour les écoles du Royaume-Uni. Dans son introduction au premier de ces précieux volumes, McEvedy ne réduit pas l’histoire proto-historique et antique d’un point de vue exclusivement européen actuel, donc euro-centrique au mauvais sens du terme, dans la mesure où il serait limité aux seuls pays européens actuels: pour lui, l’espace de déploiement des peuples européens (indo-européens) englobe certes l’ensemble du sous-continent européen mais aussi l’espace nord-africain, parce Rome s’y est imposé suite aux guerres puniques, le Levant jusqu’à la Mésopotamie, parce que les Empereurs romains y ont mené leurs légions. McEvedy va même plus loin: l’espace des peuples européens s’étend jusqu’aux montagnes du Pamir, là où ont buté les peuples cavaliers de souche européenne au seizième siècle avant l’ère chrétienne. Il inclut également l’Ouest de l’Iran actuel, là où les cavaliers indo-européens venus soit des hauts plateaux de l’Iran soit de l’aire mésopotamienne ont rencontré les peuples élamo-dravidiens. Je rappelle notamment que Dominique Venner, dans “Histoire et tradition des Européens – 30.000 ans d’identité” estimait que l’identité de nos peuples trouve ses racines dans ce lointain passé, dans ces quelques vingt-huit millénaires de proto-histoire et de haute antiquité. McEvedy dans la première édition de son Atlas historique du monde antique posait l’hypothèse d’une origine des peuples européens dans l’espace dit de la “culture swiderienne”, une culture préhistorique, datant de 12 ou 13 millénaires avant l’ère chrétienne. Cet espace se situait en lisière de la banquise glaciaire de l’époque, sur une bande territoriale d’une profondeur maximale de 250 km, située approximativement entre le Sud de la Finlande et la Thuringe. A partir de ce territoire matriciel, les pré-Européens auraient essaimé vers l’Est et l’Ouest, de l’Irlande au Pamir et de l’Espagne à l’Indus.

L’épopée des peuples cavaliers, de souche européenne, fait partie intégrante de notre héritage le plus ancien. Le chercheur ukrainien Iaroslav Lebedynsky publie la plupart de ses ouvrages en français à Paris, où il enseigne à l’“Institut national des langues et civilisations orientales”: on lui doit de remarquables monographies sur les Scythes, les Sarmates, les Saces, les Cimmériens, les Iazyges et les Roxolans, les Alains, etc. qui nous procurent un regard absolument inédit sur l’aventure extraordinaire de ces peuples de souche européenne sur un espace que l’on qualifie un peu vite d’ “asiatique” dans les atlas d’écoles primaires. Il n’y a pas de frontières naturelles entre l’Europe orientale et l’Asie sibérienne, expliquait le Général Heinrich Jordis von Lohausen dans son fameux traité de géopolitique de l’année 1979, que j’allais résumer dans le tout premier numéro des revues parues sous ma houlette. Les Monts Ourals ont une hauteur maximale de 1600 m, pas davantage que le Chasseral dans le Jura suisse. De la plaine hongroise, la Puszta, à la Mandchourie, il n’y a pas d’obstacles majeurs, si l’on évite les massifs montagneux du Pamir et de l’Altaï, du Danube pannonien au Don, de celui-ci à la Caspienne et de celle-ci à la Mer d’Aral et au Lac Balkach. C’est la future route de la soie menant d’Europe en Chine. Jusqu’à l’irruption des Huns, sur le Don face aux Goths, puis dans la plaine hongroise puis jusqu’aux Champs Catalauniques de Champagne, cet immense espace a été déterminé par des cultures de souche européenne, comme le prouvent aussi les momies du Tarim, découvertes par des archéologues il y a une trentaine d’années.
L’histoire européenne depuis les Champs Catalauniques est l’histoire d’un long et gigantesque combat pour reprendre l’initiative. Le Prof. Lebedynsky, suite sans doute aux ouvrages du professeur français René Gousset, le rappelle dans son dernier volume sur les peuples cavaliers de souche européenne, consacré aux Cosaques. Ce sont eux qui ont repris le contrôle de la Sibérie et empêché la réémergence de coalitions irrésistibles de cavaliers turco-mongols dans cet espace nomade. En Méditerranée, la flotte de Don Juan à Lépante en 1571, les armées de hussards ailés du Roi Jean III Sobieski en 1683 et les techniques militaires du Prince Eugène de Savoie-Carignan jusqu’en 1718 ont contenu définitivement les Ottomans, comme nous l’a très bien expliqué, dans plusieurs livres clairs, l’historien français, ancien officier de la Légion étrangère, Dominique Farale. A partir de ce moment-là seulement, quand les Ottomans étaient contenus en Méditerranée et dans les Balkans, et que les Cosaques surveillaient le territoire initial des Mongols en lisière de la Mandchourie, l’Europe a pu maîtriser le monde. La question qui se pose aujourd’hui est la suivante: vit-on à nouveau un ressac de la puissance européenne? Plusieurs historiens en vue dans le monde anglo-saxon, dont notamment John Darwin, auteur de “After Tamerlan” (2007), estiment d’ailleurs que la suprématie européenne de ces deux ou trois cents dernières années pourrait bien être une anomalie passagère de l’histoire, l’Inde et la Chine ayant constitué plus de 35% du commerce mondial dans la seconde moitié du 18ème siècle. Un autre historien britannique, Ian Morris, pense lui, au contraire, que la suprématie européenne, qui a certes connu des hauts et des bas, est un fait historique inscrit dans une assez longue durée et qu’elle explique la survie de la culture européenne, capable de réagir vite, même au bord du gouffre (cf. Ian Morris, “Why the West Rules – For Now – The Patterns of History and What They Reveal about the Future”, Profile Books, London, 2010-2011). Le débat est ouvert...
Dès les victoires autrichiennes du Prince Eugène et de ses successeurs contre les Ottomans dans les Balkans, l’Europe pense, avec la Russie désormais maîtresse de la Sibérie jusqu’aux côtes pacifiques, à avoir une frontière commune, favorisant les échanges directs, avec l’autre môle d’impérialité sur la masse continentale eurasienne, la Chine. Le philosophe, diplomate et mathématicien allemand Leibniz raisonnera en de tels termes et couchera sur le papier des réflexions géopolitiques qui conservent, en leur noyau, fraîcheur et actualité. Un peu plus tard, au 18ème siècle, nous avons une alliance tacite, eurasienne avant la lettre et assez conforme aux vues de Leibniz, entre la France de Louis XVI (réconcilié avec l’Autriche par son mariage avec Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine), l’Autriche de Marie-Thérèse puis de Joseph II et la Russie de Catherine II la Grande. Cette alliance tacite, étayée par les meilleurs diplomates (Vergennes par exemple), offrait un espace stratégique de la Bretagne atlantique, voire de l’Espagne des Bourbons éclairés notamment sous le règne de Carlos III, jusqu’aux confins pacifiques de la Sibérie orientale. Cette alliance eurasienne a permis, entre l’avènement de Louis XVI en 1774 et la révolution française, d’esquisser une unité géostratégique entre les trois principales puissances continentales européennes (où la France avait acquis une supériorité navale dans l’Atlantique Nord suite à la guerre d’indépendance des Etats-Unis).
En 1815, la Sainte-Alliance a voulu répéter cette unité, en y ajoutant l’Angleterre et la Prusse protestantes. La Prusse jouera le jeu jusqu’à l’éviction de Bismarck, qui rendra caduque l’alliance Berlin-Pétersbourg. L’Angleterre —en détachant progressivement la France de cette Sainte-Alliance, une France qui ne s’était pas vraiment guérie de son fondamentalisme jacobin et de ses folies révolutionnaires— fera émerger l’exception occidentale dès la guerre de Crimée, comme le constatera avec pertinence Dostoïevski dans son “Journal d’un écrivain”. L’espace stratégique eurasien s’étendra désormais du Rhin au Pacifique et non plus de l’Atlantique au Pacifique. L’Union des Trois Empereurs (Russie, Allemagne, Autriche) prendra le relais de la Sainte-Alliance, dont la puissance potentielle, et la présence sur le continent américain, en Alaska (jusqu’en 1867) et dans les Caraïbes (à Cuba jusqu’en 1898), avait contraint le Président américain Monroe à proclamer sa célèbre doctrine de “l’Amérique aux Américains”, visant d’abord à chasser l’Espagne du Nouveau Monde, pour être sûr que, dans son sillage, et au nom d’une unité “eurasienne”, les autres puissances européennes, unies dans leurs visées stratégiques, n’interviennent en Amérique, au départ d’une quelconque possession espagnole ou au départ de l’Alaska, russe à l’époque. Cette logique géopolitique nord-américaine a été tout de suite dénoncée par le ministre autrichien Hülsemann, qui a vu, avant tout le monde, émerger, sur l’autre rive de l’Atlantique, une puissance négatrice de l’excellence européenne, une “puissance-antipode”. D’autres verront également clair: le diplomate allemand Constantin Frantz constate, après la guerre de Crimée, que la Sainte-Alliance a péri et que l’Occident anglo-français est tout prêt à importer en Europe des querelles nées bien loin en dehors du sous-continent, matrice géographique des peuples européens. Ces querelles risquent de susciter des guerres en Europe pour des raisons étrangères à l’indispensable équilibre de l’Europe. Sans cet équilibre, l’Europe risque l’implosion. Et, privée de cet équilibre, elle a effectivement implosé dès 1914.
La Doctrine de Monroe, par la pression constante qu’elle a exercée, a conduit à l’effondrement définitif de l’Espagne impériale en 1898 et à la crise morale qui s’en est suivie. L’Espagne est, en ce sens, la première victime européenne de la Doctrine de Monroe. Tarabustée par une “légende noire” fort tenace, inventée par les fondamentalistes protestants hollandais et par l’Angleterre élizabéthaine, puis reprise par les Français de Richelieu, l’Espagne a été paralysée, depuis la fin du 16ème jusqu’à nos jours, par une légende négative, colportée ad infinitum: c’est là une technique de déstabilisation de l’adversaire, qu’ont utilisé les propagandistes protestants hier, les tenants de la “correction politique” et des vérités médiatiques aujourd’hui; cette technique propagandiste sera reprise et affinée pour éliminer et affaiblir en permanence l’Allemagne, suite aux deux guerres mondiales du 20ème siècle, tant et si bien que l’hebdomadaire britannique “The Economist” pouvait sortir un dossier récent (début juin 2013), consacré à l’Allemagne d’Angela Merkel; ce dossier, assez copieux, campait la superpuissance économique germanique en plein milieu de notre Europe comme un nain politique, à cause de son incapacité à surmonter sa propre “leyenda negra”. La Russie, à son tour, même après le communisme, est victime d’une autre “légende noire”, colportée et amplifiée depuis les diatribes du Marquis de Custines et la propagande anglaise lors de la Guerre de Crimée. Il conviendrait donc de réfléchir à annuler les effets de toutes les “leyendas negras”, par des efforts coordonnées, à l’échelle globale, dans tous les Etats européens, en Iran, au sein de toutes les puissances du BRICS.
L’eurasisme, à mon sens, doit être la reprise actualisée de l’alliance austro-franco-russe du 18ème, de la Sainte-Alliance (surtout telle qu’elle fut envisagée par Hülsemann) et de l’Union des Trois Empereurs, voire une résurrection des projets d’alliance franco-germano-austro-russe de Gabriel Hanotaux (1853-1944), avant 1914. On ne parle pas assez de ce Gabriel Hanotaux, qui deviendra ministre des affaires étrangères en France en 1894. Nationaliste de coeur, il a soutenu le programme de colonisation française en Afrique, en Algérie et à Madagascar, tout en s’opposant à la pénétration britannique au Soudan, où il a été un partisan de la fermeté au moment de la fameuse affaire de Fachoda en 1898, quand des forces françaises et britanniques s’étaient affrontées pour le contrôle du Nil soudanais. Selon certaines sources, qu’aimait citer l’eurasiste européiste Jean Parvulesco, malheureusement décédé en 2010, Hanotaux ne souhaitait pas l’alliance britannique, préférait à coup sûr l’alliance russe et aurait envisagé une réconciliation franco-allemande.
3.
Nous aimerions que vous nous révéliez vos idées sur l’éventuelle résolution des facteurs raciaux au sein de l’Eurasie, car celles-ci contient effectivement des peuples ethniquement et racialement très différents...
Mon concept d’Eurasie est synonyme d’une confédération solidaire de peuples de souche européenne qui devront, éventuellement, occuper des territoires où vivent d’autres peuples, pour des raisons essentiellement stratégiques. J’ai oublié de dire, en répondant à votre deuxième question, que l’idée eurasienne provient également du géopolitologue allemand Karl Haushofer, pour qui les puissances d’Europe et le Japon devaient unir leurs forces pour organiser en parallèle, selon des “corridors Nord-Sud” —des corridors eurafricain, russo-irano-indien, nippo-micronésien, sino-indochinois, tous bien délimités— la masse continentale entre Atlantique et Pacifique: il appelait cela la troïka germano-russo-japonaise, puis, après la consolidation en 1938 de l’Axe Rome-Berlin, le quadrige germano-italo-russo-japonais. Mis à part le Japon —qui devait se développer de préférence en direction du Sud et dans l’espace pacifique (après avoir hérité à Versailles de la Micronésie jadis espagnole puis devenue allemande), sans meurtrir la Chine— les autres puissances de la troïka ou du quadrige étaient européennes dans leur esprit, dérivé de Rome ou de la Troisième Rome byzantine (que représente la Russie). La vision ethno-différentialiste postule que les peuples non européens ne soient pas obligés de singer les Européens, de modifier leurs substrats naturels, que ce soit par fusion, par mixage ou par aliénation culturelle. Il me semble que l’URSS de Brejnev, dans sa constitution modifiée de 1977, ait quelque peu répondu à votre question, sans que nous ne soyons obligés, à l’heure actuelle, de reprendre en compte les archaïsmes et les schématismes communistes que cette constitution soviétique véhiculait.
La pensée des “autres Lumières” (celles que ne sont plus jugées “politiquement correctes” par la pensée dominante actuelle), notamment les “Lumières” qui ont promu la vision ethno-différentialiste de Herder, a donné le mouvement slavophile des “narodniki” en Russie, que le communiste n’a jamais pu éradiquer, tant et si bien, que, dès les années soixante, la culture soviétique, contrairement à l’Occident, retourne timidement, et parfois plus audacieusement, vers le passé slavophile. On a pu parler, fin des années 70, avec le dissident occidentaliste Yanov, réfugié en Californie, d’une “nouvelle droite” soviétique, bien ancrée dans les cercles académiques de l’URSS, déjà en phase d’implosion. Cet esprit herdérien a permis, même sous Staline (mutatis mutandis) de créer des républiques ethniques, parfois, hélas, avec des tracés aberrants. Généralement, les républiques ethniques finno-ougriennes et indo-européennes (comme les Ossètes), sont restées fidèles à l’URSS, puis à la Fédération de Russie. Certaines républiques turcophones ou tatars (ouralo-altaïques) aussi. On sait que la Doctrine Brzezinski visait à soulever tout le ventre mou de l’URSS, dès 1978, quand l’Afghanistan officiel avait opté pour une alliance afghano-soviétique. Pour soulever ce “ventre mou”, il fallait utiliser un levier: le seul levier possible était l’islam fondamentaliste, lequel pouvait évidemment bénéficier de la manne financière saoudienne.
 Toutefois, cette stratégie a échoué, comme l’avoue Brzezinski lui-même dans son dernier ouvrage de mars 2012, intitulé “Strategic Vision”. Pour le théoricien de la conquête de la “Route de la Soie” (“Silk Road”) et de l’inclusion de l’Ukraine dans l’OTAN, pour l’homme qui a suggéré l’armement des talibans contre les Soviétiques en Afghanistan, toutes ces strtatégies, qu’il a préconisées, ont échoué. Selon le regard nouveau qu’il propose de jeter sur l’échiquier international, il ne faut donc plus fragmenter la Russie à l’infini mais s’allier à elle, dans une sorte de grande alliance de l’hémisphère Nord, avec l’Amérique du Nord, l’Europe (Turquie comprise) et la Russie! Au soir de sa vie, à 84 ans, cet homme avoue sans état d’âme, sans s’effondrer mentalement, que ses projets n’ont pas abouti! Et propose exactement ce que propose un théoricien néo-droitiste français, tout à fait inclassable, comme Guillaume Faye! Ou que proposent aussi beaucoup de théoriciens nationalistes américains, partisans d’une “unité du monde blanc”! Brzezinski est devenu “Amereurasiste”! Apparemment, il n’est guère écouté Outre-Atantique, où l’“Administration Obama” poursuit les guerres de Bush et le contrôle des esprits dissidents ou contestataires aux Etats-Unis mêmes, avec une acribie encore plus frénétique.
Toutefois, cette stratégie a échoué, comme l’avoue Brzezinski lui-même dans son dernier ouvrage de mars 2012, intitulé “Strategic Vision”. Pour le théoricien de la conquête de la “Route de la Soie” (“Silk Road”) et de l’inclusion de l’Ukraine dans l’OTAN, pour l’homme qui a suggéré l’armement des talibans contre les Soviétiques en Afghanistan, toutes ces strtatégies, qu’il a préconisées, ont échoué. Selon le regard nouveau qu’il propose de jeter sur l’échiquier international, il ne faut donc plus fragmenter la Russie à l’infini mais s’allier à elle, dans une sorte de grande alliance de l’hémisphère Nord, avec l’Amérique du Nord, l’Europe (Turquie comprise) et la Russie! Au soir de sa vie, à 84 ans, cet homme avoue sans état d’âme, sans s’effondrer mentalement, que ses projets n’ont pas abouti! Et propose exactement ce que propose un théoricien néo-droitiste français, tout à fait inclassable, comme Guillaume Faye! Ou que proposent aussi beaucoup de théoriciens nationalistes américains, partisans d’une “unité du monde blanc”! Brzezinski est devenu “Amereurasiste”! Apparemment, il n’est guère écouté Outre-Atantique, où l’“Administration Obama” poursuit les guerres de Bush et le contrôle des esprits dissidents ou contestataires aux Etats-Unis mêmes, avec une acribie encore plus frénétique.
Personnellement, pour moi, il faudrait que l’Amérique du Nord revienne à une pensée aristotélicienne, renaissanciste (au sens où l’ntendait Julien Freund), débarrassée de tous les résidus de ce puritanisme échevelé, de cette pseudo-théologie fanatique où aucun esprit d’équilibre, de pondération et d’harmonie ne souffle, pour envisager une alliance avec les puissances du Vieux Monde. Le biblisme nord-américain s’exporte en Amérique ibérique, disloquant souvent les sociétés ibéro-améridiennes de ce continent. Cette propension à s’exporter vient de la nature messianique de cette pseudo-théologie, parfois laïcisée et transformée en une vulgate médiatique particulièrement nocive. Le Vieux Monde comprend trois ou quatre pôles civilisationnels: l’Europe (Russie comprise), car je ne retiens pas, pour l’Europe, le clivage entre, d’une part, un Occident catholico-protestant (où règnerait d’office la “bonne gouvernance”) et, d’autre part, une zone russo-byzantino-orthodoxe (où se maintiendraient des résidus d’autoritarisme) comme le faisait Samuel Huntington dans son “Choc des civilisations”; l’Inde et la Chine (ou le complexe sino-nippon bouddhisto-confucéano-taoisto-shintoïste). Ian Morris en voit deux, nés dès la fameuse période axiale de l’histoire, selon Karl Jaspers et Karen Armstrong: l’espace européen, ultérieurement marqué par Rome qui l’a unifié “impérialement”, et la Chine, unifiée et transformée en empire dès les Qing. Pour moi, aujourd’hui, il y en a quatre voire cinq: l’Europe, héritière de Rome et de la germanisation, par Prétoriens et Foederati interposés, dès le Bas Empire et pendant le haut moyen-âge (en Espagne, on peut parler de la “wisigothisation”); l’Iran post-avestique, pré-islamique, zoroastrien et islamisé selon un mode très différent de l’espace arabophone ou turcophone, avec une composante mystique et nationale; l’Inde, qui a retrouvé son identité grâce au mouvement métapolitique du RSS, né sous le “Raj” britannique en tant que mouvement contestataire de la colonisation et de l’exploitation sauvage du sous-continent indien; la Chine, monde en soi, rejetant tout messianisme, tout esprit de conversion et toute forme d’immixtion dans les affaires intérieures d’entités politiques tierces; le Japon, cinquième pôle, animé par la spiritualité shintoïste, également non messianique car intransmissible aux non Japonais. Ces entités ne constituent pas une menace pour l’Europe car elles ne sont pas animées par le messianisme américano-bibliste ou par l’effervescence wahhabite-salafiste, qu’elles considèrent comme de dangereuses aberrations, bouleversant équilibres et harmonies.
Il y a d’ailleurs alliance implicite du messianisme nord-américain bibliste et du messianisme saoudien, wahhabitico-salafiste. Ces anomalies dangereuses doivent être contrées par l’idée équilibrante et harmonieuse de l’auto-centrage des aires civilisationnelles.
4.
Ne serait-il pas plus correct de procéder à une extension du fait politique européen sur l’échiquier eurasiatique, en englobant la “Russie blanche” dans un ensemble européen homogène, plutôt que de parler d’Eurasie?
De toutes les façons, dans un cas comme dans l’autre, la Russie actuelle, la Fédération de Russie, présidée par Poutine ou Medvedev, est pour l’essentiel, de souche européenne: les autres ethnies, minoritaires, sont neutralisées par l’idéologie herdérienne, post-narodnikiste. Y compris les Tatars du Tatarstan et les Bachkirs du Bachkirtostan, dont les imams se sont farouchement opposés aux menées wahhabites, virulentes du temps où Brzezinski espérait encore disloquer la Russie en utilisant le levier wahhabite et saoudien. La seule exception semble être le Nord-Caucase tchétchène et daghestanais, travaillé par la propagande wahhabite. Nous avons là le seul front “chaud”, résidu de l’ancienne stratégie Brzezinski. Par ailleurs, le Président kazak Nazarbaïev n’a pas succombé aux tentations, auxquelles les Américains auraient bien voulu qu’il succombe: ni au fondamentalisme wahhabite ni aux sirènes du panturquisme/pantouranisme du temps du premier ministre turc Türgüt Özal. La géopolitique kazak actuelle est la négation même du “brzezinskisme”, la preuve vivante de sa faillite, la preuve que le tronçon central de la “Route de la Soie” n’est pas assimilable à la géostratégie offensive et disloquante de Washington sur l’échiquier eurasiatique. Et la preuve aussi qu’une géopolitique, portée par un peuple turcophone, asiatique et non européen, peut s’harmoniser parfaitement avec l’idée d’une troïka ou d’un quadrige haushoférien —et, partant, européen et euro-nippon— réactualisé.
5.
Quel est votre opinion sur l’Europe des ethnies?
Il y a deux visions de l’Europe des ethnies: celle qui veut la fragmentation du continent ad infinitum, de manière à le rendre aussi “invertébré” que l’Espagne après 1898, phénomène de dissolution dénoncé par Ortega y Gasset dans son fameux ouvrage “España invertebrada”, livre de chevet de Jean Thiriart, en même temps que “La révolte des masses”. Cette vision “invertébrée” ne retient pas l’idée impériale, pourtant respectueuse des diversités qui composent les grands ensembles transnationaux ou transethniques. La Suisse et l’Allemagne fédérale, tout comme l’Autriche, sont des entités fédérales, respectueuses des diversités régionales, sans que personne, au sein de ces Etats fédéraux, ne songe à ruiner l’unité. A côté des “ethnistes fragmenteurs”, il y a ce que je nommerais les “ethnistes impériaux”, qui couplent l’idée impériale-européenne au souci herdérien de l’enracinement des peuples dans leur propre culture. Quand on prend en compte les oeuvres politiques des mouvements ethnistes, on doit pouvoir distinguer entre, d’une part, les “fragmenteurs”, qui commettent un “politicide” dans la mesure où ils participent à la balkanisation de notre sous-continent au bénéfice des superpuissances hégémoniques et où ils prennent le relais des “petits-nationalismes” étriqués qui ont précipité l’Europe dans les guerres fratricides qui l’ont ruinée; et, d’autre part, les “impériaux” qui cherchent à unir les hommes réels, de chair et de sang, dans un vaste projet commun, où les réalités charnelles ne seront ni gommées ni oblitérées.
Certains mouvements ethnistes peuvent contribuer à ruiner des polities ou des républiques qui ont tendance, systématiquement, à se replier sur elles-mêmes et à se placer en position antagoniste, contre le reste du continent, contre leur propre aire civilisationnelle, au nom d’un égoïsme à courte vue ou d’un messianisme laïque complètement ridicule. C’est, au fond, l’opposition du 16ème siècle entre Charles-Quint, Impérial et soucieux du destin de l’Europe face au danger ottoman, et François I, qui s’allie à ces derniers pour satisfaire des appétits égoïstes, hostiles à l’harmonie de notre aire civilisationnelle. Dans cette même optique, toute velléité ethniste, dans un pays européen quelconque, qui vise à se détacher d’une forme ou l’autre d’Etat, dont l’existence est en contradiction avec le “testament de Charles-Quint” et qui aurait annexé des territoires ayant un jour fait partie, ou ayant un jour voulu faire partie, de la “Grande Alianza” (Bourgogne + Habsbourg + Castille-Aragon), est bien évidemment légitime: un peuple, ou un fragment de peuple, qui souhaite revenir dans le giron de la “Grande Alianza”, après en avoir été détaché par la force ou la contrainte, pose là une démarche “impériale” et non une démarche “fragmenteuse”. Je rappelle ici que Sud-Néerlandais, Autrichiens, Hongrois, Croates, Allemands, Espagnols, Italiens du Nord ne sont “vertébrés” politiquement, au sens où l’entendait José Ortega y Gasset, que s’ils gardent en tête le “testament de Charles-Quint”, base inamovible de toute véritable démarche européenne. S’ils n’ont pas ce “Testament” en tête, ils sont vecteurs de folie, de dissensus, de conflits civils, ils participent à la ruine de notre civilisation.
6.
Dans un entretien que vous avez naguère accordé aux animateurs du “Mouvement International Eurasiste” (“International Eurasian Movement”), vous évoquez la vision d’un monde multipolaire. Y a-t-il une possibilité réelle de faire émerger un tel monde, alors que la globalisation a déjà tout envahi? Cette multipolarité ne serait alors que le cache-sexe d’une globalisation parachevée, où le monde entier serait soumis aux intérêts de la haute finance...
Après l’effondrement de l’Union Soviétique suite à la perestroïka de Gorbatchev, que le dissident et philosophe Alexandre Zinoviev nommait la “catastroïka”, le monde semblait basculer vers l’unipolarité, centrée sur la seule “américanosphère”. Le penseur nippo-américain Francis Fukuyama annonçait la fin de l’histoire et l’entrée du monde dans l’ère de la parousie néo-libérale. Pour lui, avec l’avènement d’Eltsine suite à un putsch paléo-communiste avorté qui entendait chasser Gorbatchev du pouvoir, l’ex-URSS allait se fondre à son tour dans la “Globalia” néo-libérale. Eltsine plonge alors la Russie dans le marasme, Poutine l’en sortira. Moralité: les prévisions de Fukuyama se sont avérées fausses. L’histoire est revenue, d’abord avec les néo-conservateurs américains, trotskistes recyclés qui ont remplacé la “révolution permanente” théorisée par leur maître initial par la “guerre permanente” que doivent mener les Etats-Unis, instance étatique élue par Dieu (?) pour faire triompher le Bien sur la Terre, contre le reste du monde, y compris contre leurs propres alliés qu’ils espionnent avec ECHELON et, très récemment, avec le système d’écoute “Prism” de la NSA ou “Tempora” de leurs homologues britanniques. Les théoriciens néo-conservateurs comme Robert Kagan ont annoncé “le retour de l’histoire” et non pas son terminus, et, surtout, “la fin des rêves” (cf. R. Kagan, “The Return of History and the End of Dreams”, 2008). Evidemment, pour Kagan, seuls les Etats-Unis sont autorisés à retourner au chantier de l’histoire, à quitter le monde onirique des idéologies iréniques. Ils doivent combattre les môles de puissance irréductibles que sont la Russie, la Chine et l’Iran, tout en se méfiant de l’Inde. Ils considèrent l’Europe comme un espace neutralisé, gouverné par des pitres sans envergure (seul Poutine est considéré comme un “chien dangereux” selon les documents révélés par Assange lors de l’affaire “Wikileaks”), un espace émasculé que l’on peut piller à qui mieux-mieux via les systèmes d’espionnage satellitaires. Dans un ouvrage plus récent, un autre néo-conservateur américain, Robert D. Kaplan, rappelle qu’un empire —en l’occurrence, pour lui, l’empire américain— doit en permanence se souvenir des impératifs de la géographie (cf. R. D. Kaplan, “The Revenge of Geography – What the Map Tells Us about Coming Conflicts and the Battle Against Fate”, Random House, New York, 2012) quand il façonne ses stratégies. Dans cet ouvrage qui réhabilite complètement les démarches géopolitiques et passe en revue les fondements géographiques de chaque puissance eurasienne, avouant implicitement qu’il y a, de facto, une multipolarité, mais une multipolarité que les Américains, selon Kagan ou Kaplan, doivent affronter, dont ils doivent réduire les môles de puissance, contenir leurs éventuelles expansions.
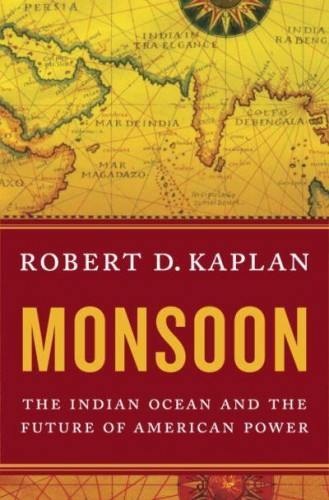
Kaplan est également l’auteur d’un ouvrage de géopolitique capital pour comprendre le monde d’aujourd’hui et les intentions de l’hyperpuissance américaine: ce livre est consacré à l’Océan du Milieu, en d’autres termes, l’Océan Indien. Il s’intitule “”Monsoon – The Indian Ocean and the Future of American Power” (Random House, 2010, 2nd ed., 2011). Kaplan rejette la projection géographique usuelle aux Etats-Unis, où l’hémisphère occidental, c’est-à-dire les deux Amériques, est placé au centre des cartes, escamotant du même coup l’Océan Indien, alors que cet espace océanique est véritablement central, qu’il offre à qui le contrôle la domination sur le “rimland” asiatique des moussons. Cette “Asie des moussons” a donné aux Britanniques la puissance la plus déterminante sur l’échiquier européen et mondial, dès la seconde moitié du 18ème siècle. Au 21ème siècle, il en sera de même, il faudra, pour détenir l’hyperpuissance sur la planète, contrôler l’espace de l’Océan des Moussons: les Etats-Unis, pour Kaplan, ont intérêt à contrôler ou à contenir rapidement les puissances, petites ou moyennes, de l’arc de l’Asie des moussons, soit l’Inde, le Pakistan, la Chine, l’Indonésie, la Birmanie/Myanmar, Oman, le Sri Lanka, le Bengla Desh et la Tanzanie. Car c’est là, précise Kaplan, dans cet espace fragmenté, bigarré, sans homogénéité raciale ou culturelle, vaguement rassemblé dans une “Association des pays riverains de l’Océan Indien pour une coopération régionale” (IOR-ARC), que la lutte planétaire pour la “démocratie” (évidemment!), pour l’indépendance énergétique (américaine) et pour la “liberté religieuse” (?) sera gagné ou perdu. La diplomatie américaine doit concentrer tous ses efforts sur cette partie du monde si Washington veut continuer à garder un certain hégémonisme sur la Terre. Les pères fondateurs de la géopolitique, Mackinder et Haushofer ne disaient rien d’autre... L’Océan Indien baigne un espace à pôles multiples: il est l’espace même d’une multipolarité divergente.
La mondialisation/globalisation procède certes par le truchement d’un mode de société toujours plus consumériste. Les Chinois commencent à consommer avec la même frénésie que les Américains et les Européens. La délocalisation de bon nombre d’industries manufacturières, qui ont quitté l’Amérique du Nord et l’Europe pour l’Asie et surtout pour la Chine, provoquant un chômage endémique dans nos pays, sanctionne finalement une “division du travail”, générant plus de problèmes qu’elle n’en résout. Il n’empêche que cette fusion apparente dans le creuset d’une globalisation économique laisse intacte les desseins géopolitiques et géostratégiques des “pôles” de la multipolarité.
Les sphères émergentes contestent l’hégémonisme américain, contestent aussi l’idéologie que cet hégémonisme véhicule. Le point commun de tous les pôles, sauf l’Europe, totalement neutralisée, est de refuser l’immixtion permanente des Etats-Unis, notamment par le biais de l’idéologie dite des “droits-de-l’homme”, inventée, ou plutôt ré-inventée, à l’époque de la Présidence de Jimmy Carter, pour subvertir l’Iran du Shah et l’URSS de Brejnev (à l’époque, la Chine maoïste était exemptée de tout immixtionnisme américain puisqu’elle venait de sceller une alliance anti-soviétique avec Washington). Les cibles demeurent les mêmes: l’Iran, la Russie, la Chine qui retrouve le rôle négatif qu’on lui avait attribué dans les années 50 et 60. L’Inde —qui, explique Kaplan dans “Monsoon” (op. cit.), cherche à s’étendre “horizontalement” (vers l’Est et vers l’Ouest) et non pas “verticalement” (du Nord vers le Sud) comme le fait au contraire la Chine qui, en outre, cherche à devenir une puissance bi-océanique, d’où la condamnation de ses stratégies par Washington aujourd’hui— est tantôt ménagée, parce qu’elle doit participer à l’endiguement (“containment”) de la Chine, tantôt fustigée, quand elle affirme son caractère hindou (avec le BJP) ou qu’elle conserve ses liens étroits avec la Russie. L’Inde se définit comme “un pont entre différents mondes”, sans se reconnaître dans aucun groupe d’Etats (sous-entendu, elle garde ses distances avec le fameux “Groupe de Shanghai”). Malgré le poids de leur hyperpuissance militaire, les Etats-Unis seront toujours incapables d’absorber et de neutraliser les pôles asiatiques ou eurasiatiques comme ils ont brisé l’Europe, en détruisant l’Allemagne d’abord, en contrôlant totalement l’UE ensuite, par l’importation d’un néo-libéralisme qui a empêché l’Europe de consolider ses velléités d’autarcie, d’ordo-libéralisme (de capitalisme patrimonial rhénan ou, au Japon, “samourai”) ou de socialisme bien conçu, disons de facture bismarcko-keynesienne, comme le voulaient ses pères fondateurs ou encore un Jacques Delors. L’Europe, que nous espérions voir devenir un pôle à part entière dans un monde recomposé et enfin sorti du bipolarisme figé du temps de la Guerre Froide, enfin émancipé complètement de la tutelle américaine, est, aujourd’hui plus que jamais, un espace neutralisé, au tissu industriel mité, aux sociétés disloquées par toutes sortes de facteurs au départ exogènes, un espace d’amnésie historique, un espace totalement “invertébré”, un espace qui vénère benoîtement la “norme” sans oser se doter de force (Zaki Laïdi); ces dernières semaines de juin 2013 nous apportent une preuve éloquente de cette déliquescence de tout un continent potentiellement puissant mais paralysé, quand la Commissaire à la justice Viviane Reding, qui avait capitulé sans condition devant les Américains et les Britanniques qui espionnent, avec les systèmes d’écoute “Prism” et “Tempora”, les autres Européens, au mépris des règles diplomatiques et internationales les mieux établies, tout en promettant, la pauvre bougresse, de prendre des “mesures”, qui ne viendront évidemment jamais ou resteront au stade de voeu pieux...
L’Europe-croupion, que nous avons devant les yeux, est une victime consentante de la globalisation voulue par l’hegemon américain. Les autres pôles ne le sont pas. Ils ont encore tous une pensée “vertébrée”, des traditions orthodoxes, hindouistes ou confucéennes intactes. En ce sens, l’Europe actuelle, sans “épine dorsale”, est effectivement soumise aux diktats de la haute finance internationale. Comme l’avait réclamé dans son recueil “Von rechts gesehen” (“Vu de droite”), Armin Mohler, théoricien de la “révolution conservatrice” allemande et ancien secrétaire de l’écrivain Ernst Jünger, écrivait que, pour se dégager des tutelles exogènes, l’Allemagne devait opter pour une alliance avec la France gaullienne —à l’époque une réalité, aujourd’hui disparue sous l’effet délétère des politiques aberrantes de Sarközy et de Hollande— et ne jamais hésiter à entretenir des relations avec les Etats que la propagande américaine nommait déjà les “Rogue States”. Armin Mohler et Jean Thiriart étaient au fond sur la même longueur d’onde. L’actualisation de leurs injonctions politiques postule évidemment, pour nous, de privilégier les rapports euro-BRICS ou euro-Shanghaï, de façon à nous dégager des étaux de la propagande médiatique américaine et du banksterisme de Wall Street, dans lesquels nous étouffons. La multipolarité pourrait nous donner l’occasion de rejouer une carte contestatrice à la Mohler et à la Thiriart en matières de politique extérieure.
7.
Aujourd’hui, 10% de la population vivant en Europe est musulmane et à ces 10% il faut ajouter l’installation en Europe de toute une série d’autres populations non indigènes; sans entrer dans les détails, je ne citerai qu’un exemple: la population européenne (de souche, toutes nationalités confondues) ne totalise qu’un tiers de la population de Londres aujourd’hui, elle est donc en état d’infériorité numérique par rapport aux autres “races” qui, de plus, ont un taux de natalité bien supérieur, le triple de la moyenne européenne. A quel phénomène faisons-nous face? Et comment le résoudre?
Vous savez bien qu’il est interdit de parler sereinement de ces phénomènes, surtout en France ou en Belgique où la liberté d’expression n’existe plus en ce domaine bien particulier. Vous pouvez blasphémer à qui mieux-mieux contre les religions autochtones, surtout le catholicisme lorsque des “femens” déchaînées et camées s’attaquent à Bruxelles à un archevêque qui, très timidement, veut ramener un tout petit peu de bon sens dans une église à la dérive depuis un demi siècle, vous pouvez vous moquer avec la plus extrême des méchancetés de toutes les traditions européennes, religieuses ou culinaires, historiques ou littéraires, artistiques ou philosophiques, vous pouvez fabriquer la pornographie la plus outrancière et la plus perverse, mais vous ne pouvez souffler mot sur le phénomène que certains polémistes français comme Renaud Camus appellent le “grand remplacement”. Depuis les émeutes de Paris et des grandes villes françaises en novembre 2005, depuis les émeutes de grande ampleur à Londres en août 2011, depuis les récentes émeutes de Suède en mai 2013, on sait que la situation va devenir très difficilement gérable dans la décennie à venir, surtout sur fond de crise économique et financière car la gestion de ces populations, précarisées du fait de leur non intégration, va coûter de plus en plus cher et l’argent n’est plus là, tout simplement. Ces installations irréfléchies de populations hétéroclites dans les grands centres urbains de l’Europe va, à terme, provoquer l’effondrement du système de sécurité sociale, laborieusement mis en place pendant les “Trente Glorieuses” et maintenu vaille que vaille durant les “Trente Piteuses”, effondrement dont pâtiront et les autochtones les plus précarisés et les migrants intégrés ou non, sans distinction.
Ce n’est évidemment pas ce seul phénomène “migratoire” qui va faire s’effondrer le système, bon dans ses principes organisationnels et dans ses intentions premières, mais malheureusement bâti sur du sable et non sur le réalisme politique et économique de la tradition aristotélicienne, bâti, hélas, sur le sable mouvant des “nuisances idéologiques” (Raymond Ruyer), qui sont nuisances justement parce qu’elles ignorent tout principe d’harmonie et d’équilibre, toute limite et toute pondération; parmi elles, il y a surtout l’emballement que provoque la forme dominante du néo-libéralisme, imposé depuis l’ère Thatcher & Reagan, depuis les années 1979 à 1982. Le néo-libéralisme en place est principalement une forme de capitalisme financier, et non industriel et patrimonial, qui a misé sur le court terme, la spéculation, la titrisation, la dollarisation, plutôt que sur les investissements, la recherche et le développement, le long terme, la consolidation lente et précise des acquis, etc. La crise de l’automne 2008 et la période de ressac que nous connaissons tous depuis lors, surtout dans les pays méditerranéens, en Grèce et en Espagne, sont l’aboutissement d’une idéologie fumeuse, inapplicable car irréelle, que mes amis et moi-même dénonçons depuis le moment même de son avènement: nous avons été des “voces clamantes in deserto”.
Cette crise va fragiliser les phénomènes connexes à cette globalisation néo-libérale, dont l’immigration-peuplement, surtout qu’il y a eu, en plus, “délocalisation” du tissu industriel donc perte massive d’emplois pour travailleurs peu qualifiés. Bon nombre d’auteurs, même en dehors du microcosme dit “identitaire”, ont pourtant tiré la sonnette d’alarme.
Je pense notamment au Français Jean-Paul Gourévitch qui, en 2007, énumérait quatre défis majeurs auxquels les pays accueillant de fortes minorités immigrées allaient être confrontés:
1) le vieillissement de la population européenne, observable déjà depuis les années 60, notamment par un historien comme Pierre Chaunu (père de l’“histoire sérielle”), est un phénomène très préoccupant d’implosion et de ressac qui n’a jamais été contré par une politique nataliste et volontariste, semblable à celle que Poutine tente de mettre en place en Russie; le recul des naissances, dans la logique d’une société de consommation, où le quantitatif prime le qualitatif, oblige à faire appel à des migrations comme palliatifs, des migrations d’abord bien encadrées, quand la bonne conjoncture des “Trente Glorieuses” le permettait encore, puis déversées dans nos villes de manière anarchique et incontrôlée;
2) la lutte difficile contre les inévitables discriminations, lutte amorcée en vue de faciliter l’intégration; ces difficultés sont dues, notamment, entre beaucoup d’autres pierres d’achoppement, à l’impossibilité d’étendre à l’infini le marché public du logement social, lequel se compose, notamment en France, d’appartements de quatre pièces, insuffisants pour abriter des familles extrêmement nombreuses, parfois polygames; le parc immobilier, mis à la disposition des plus démunis, exige des frais d’entretien énormes que les municipalités ne peuvent plus financer; les volontés de “mixité” sociale, exprimées par les pouvoirs publics, se heurtent tout à la fois à l’hostilité des autochtones, qui quittent les villes pour les périphéries, et des immigrés qui veulent rester entre eux, sans immixtion constante de fonctionnaires municipaux, dénués de raison vitale et adeptes de toutes les niaiseries idéologiques; les discriminations à l’emploi continuent à frapper les immigrés, en dépit de plus de deux décennies de propagande massive en faveur de l’intégration; on doit donc en conclure que les politiques d’intégration ont partout fait faillitte car elles ne sont acceptées ni des autochtones, qui restent silencieux et fuient les villes pour constituer une nouvelle catégorie démographique, celle des “néo-ruraux”, ni des immigrés, qui manifestent parfois bruyamment leur mécontentement, quand les subsides qui leur sont pourtant généreusement alloués leur semblent trop chiches (voir les récents événements de Suède).
3) Les Etats hôtes d’Europe occidentale n’ont pas pu maîtriser l’immigration clandestine qui, par le flux ininterrompu qu’elle représente, précarise, bien au-delà du simple regroupement familial préconisé depuis la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, les strates immigrées déjà présentes ou anciennes; elles rendent encore plus hétéroclites les masses non intégrées, créant de la sorte, en ce début de 21ème siècle, la situation aberrante que narre le mythe biblique de la “Tour de Babel”, où tous finissent pas fuir parce que s’instaure la confusion générale. Les flux hétérogènes, différents des premières vagues migratoires légales vers l’Europe, génèrent, de par leur illégalité, une exploitation cruelle, assimilable à une forme d’esclavage, n’épargnant pas les mineurs d’âge (50% des nouveaux esclaves!) et basculant largement dans une prostitution incontrôlable. A laquelle s’ajoutent aussi les trafics d’organes. Cette “économie” parallèle contribue à corrompre les services de police et de justice. Autre horreur: la réapparition de “murs” (après la disparition de celui de Berlin) le long de la frontière américano-mexicaine, en lisière des villes espagnoles de Ceuta et Melilla, et de murs “virtuels” sous forme de radars et de détecteurs en Mer du Nord et en Méditerranée, dispositifs chimiques pour détecter l’émission des gaz carboniques émis par les corps humains dissimulés, etc. Toutes ces infrastructures de dissuasion coûtent fort cher et mobilisent des budgets qui rognent sur ceux, utiles, de la sécurité sociale, de la recherche et du développement, du réarmement de l’Europe, de l’enseignement, etc. Ils contribuent ainsi à l’affaiblissement généralisé de l’Europe, citadelle aujourd’hui assiégée de toutes parts. Tous ces problèmes horribles, inouïs, et le sort cruel des exploités, des enfants réduits à une prostitution incontrôlée, les pauvres hères à qui on achète les organes, les travailleurs sans protection qu’on oblige à prester des travaux dangereux ne font pas sourciller les faux humanistes, qui se donnent bonne conscience en défendant les “sans papiers” mais qui sont, par là même, les complices évidents des mafieux —également “sans papiers” pour échapper à toute poursuite et à toute localisation. Ceux-ci peuvent ainsi tranquillement poursuivre leurs activités lucratives: en tant qu’“idiots utiles”, les humanistes à faux nez sont complices et donc coupables, co-auteurs, des crimes commis contre ces pauvres déracinés sans protection et que ne protègeront pas, bien entendu, les fameux “papiers” qu’on réclame pour eux. Nos angélistes aux discours tout de mièvrerie sont donc complices des forfaits commis, au même titre que les proxénètes, les négriers et les trafiquants. Sans la mobilisation des “bonnes consciences”, ces derniers ne pourraient pas aussi aisément poursuivre leurs menées criminelles.
4) Le quatrième défi, mis en évidence par Gourévitch, est celui de l’économie informelle, phénomène antérieur aux flux migratoires, mais que ceux-ci ont amplifiés, tout en alimentant la fraction, de plus en plus nombreuse, des populations migrantes qui ne parviennent pas à s’insérer dans le tissu social, en dépit des dispositifs d’intégration mis en place depuis trois bonnes décennies. La France a beau avoir mis en place la DILTI (“Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Travail Illégal”), l’OCDE a eu tout aussi beau jeu de tirer à son tour la sonnette d’alarme, l’ethnic business et l’économie souterraine, les recels et les locations de taudis insalubres, bref la totalité de l’économie informelle aurait brassé, selon l’enquête menée par Gourevitch en 2007 à plus de 300 milliards d’euro, soit 17 à 18% du PIB français. L’ampleur de cette économie informelle et l’opacité du milieu qui la génère rend les services de police et la justice totalement impuissants.
Nous faisons donc face à cette économie informelle, qui génère des “sociétés parallèles” (qu’appuie un certain Erdogan en Europe centrale, avec tout le poids de la diplomatie turque...) et à la démultiplication quasi à l’infini des frais sociaux, prévus par l’Etat-Providence. Cette démultiplication va entraîner très vite, dans les cinq à dix ans à venir, l’assèchement des caisses municipales (et autres...) et à l’impossibilité de lever de nouveaux impôts sur une classe moyenne considérablement appauvrie par la crise. La démesure babelienne que les intellos écervelés et les “croyeux” naïfs ont prise pour du “progressisme”, à grand renfort de propagande médiatique, va se muer en un bel éventail de facteurs non niables de “régressisme”, de régression sociale, de détricotage de tous les acquis sociaux et syndicaux. Selon l’adage: qui veut faire l’ange, fait la bête... Les négateurs de balises et de limites, qui voulaient tout bousculer au nom du “progrès” (qu’ils imaginaient au-delà de tout empirisme), vont provoquer une crise qui rendra leurs rêves totalement impossibles pour au moins une dizaine de générations, sauf si nous connaîtrons l’implosion totale et définitive... Quant aux solutions que nous pourrions apporter, eh bien, elles sont nulles car le système a bétonné toute critique: il voulait poursuivre sa logique, sans accepter le moindre correctif démocratique, en croyant que tout trouverait une solution. Ce calcul s’est avéré faux. Archi-faux. Donc tout va s’effondrer. Devant notre lucidité. Nous rirons de la déconfiture de nos adversaires mais nous pleurerons amèrement sur les malheurs de nos peuples.
8.
Si nous prenons en considération l’avancée profonde du matérialisme et de l’individualisme dans les pays occidentaux, ne devons-nous pas craindre d’être poussé vers une perte totale de spiritualité?
Nous avons déjà perdu toute spiritualité. Les traditionalistes, qui s’inspirent de Guénon et d’Evola, évoquent une ère de “Kali Yuga”, d’âge sombre, telle que l’entrevoit la tradition hindoue. C’est bien l’époque que nous vivons car Evola a signalé qu’en fin de cycle, les phénomènes de dégénérescence et de déclin vont en s’accélérant, plongeant les Empires et les Etats dans la déliquescence totale. En Europe, où nous n’avons même plus un Kagan ou un Kaplan pour nous rappeler quelques recettes élémentaires pour tenir un Empire, même à une époque de ressac. Le “Kali Yuga” est donc bien palpable de nos jours: la France, depuis Sarközy et Hollande (dit “Holl’andouille”) n’est plus que la caricature d’elle-même, et la négation de sa propre originalité politico-diplomatique gaullienne; l’Allemagne se cramponne à des idées fixes et n’ose pas s’affirmer, sous le règne d’une Angela Merkel qui n’a bien entendu ni le tonus ni la clairvoyance de ses prédécesseurs socialistes, d’un Schroeder ou d’un Schmitt. Votre question, si j’y répondais de manière exhaustive, exigerait la rédaction d’un livre tout entier. Je ne peux dire en quelques lignes ce qu’Evola, Schuon, Guénon ou d’autres traditionalistes ont dit en plusieurs dizaines de volumes, car, souvent, il n’y a pas grand chose à ajouter à leurs diagnostics, si ce n’est les traduire en un langage plus quotidien.
L’histoire de mon pays, la Belgique, nous fait entrevoir le désastre, rien que dans l’involution de la famille politique catholique, puis “démocrate-chrétienne”. Notre histoire politique montre donc que l’exigence morale des tenants de la “Jeune Droite” de Henry Carton de Wiart au début du 20ème siècle, puis des militants de l’ACJB (“Action Catholique de la Jeunesse Belge”), quelles qu’aient été leurs options ultérieures après l’émergence du rexisme de Léon Degrelle, que le souci éthique que le Prof. Marcel Decorte avait encore voulu réveiller dans les années 50, se sont bien vite évanouis au profit d’un technocratisme sans épaisseur éthique, importé par Paul Van Zeeland avant-guerre et poursuivi par toute une série de politiciens sans envergure ou sans scrupules après 1945 ou au profit d’un démocratisme du “je-ne-sais-quoi” et du “presque-rien” qui a débouché sur la mascarade puante d’un parti dirigé par des festivistes écervelés qui se donnent désormais l’étiquette d’“humanistes”. On se demande en quoi leurs salades sont “humanistes”: Erasme, qui était hypocondriaque mais un véritable humaniste renaissanciste, doit galoper plein tube vers un bassinet pour y vômir sa soupe aux légumes quand, du haut de son empyrée céleste, il jette un regard sur le spectacle que nous donne en permanence cette brochette de connards et de connasses qui ont galvaudé le terme même d’humanisme puis transformé, par leurs sottises, la principale force politique de la Belgique, en un parti estropié et minoritaire, à la remorque des socialistes, qui titubent d’une corruption à l’autre, pour chavirer ensuite dans une autre perversité. En Flandre, les excès de technocratisme, tourné en “plomberie” du temps de Dehaene, ont également ruiné le pôle démocrate-chrétien au profit d’une forme de pseudo-nationalisme, centré sur la vacuité et la vanité d’un gros bonhomme qui a maigri pour faire jacasser les médias, une formation idéologiquement filandreuse à relents festivistes, avec laquelle personne ne veut gouverner. Bref, l’absence d’éthique dans le pôle politique qui, précisément, entendait l’incarner, du moins jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, a provoqué l’implosion du pays. L’Europe et le reste du monde occidental présentent la même implosion, parfois en moins ridicule mais toujours sur un mode aussi navrant, aussi impolitique, aussi incapable de sortir notre aire civilisationnelle de l’ornière où elle s’est enlisée.
La disparition de toute épine dorsale éthique dans le monde occidental, le plus touché par la décadence, entraîne toute une série de maladies psycho-sociales, dont quelques universitaires dressent la cartographie, tout en étant complètement ignorés des “décideurs” politiques qui, comme on le sait, préfèrent la politique de l’autruche. Parmi ces universitaires, je ne citerai que le Flamand Dirk De Wachter, professeur à la KUL de Louvain, et l’Allemand Manfred Spitzer, directeur de la clinique psychiatrique de l’Université d’Ulm (cf. Dirk De Wachter, “Borderline Times – Het einde van de normaliteit”, Lannoo Campus, Tielt, 2012; Manfred Spitzer, “Digitale Demenz – Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen”, Droemer, München, 2012).
Le Prof. De Wachter voit disparaître toute forme de “normalité” et glisser nos populations vers ce qu’il appelle, en jargon de psychiatrie, le “borderline”, la “limite” acceptable pour tout comportement social intégré, une “borderline” que de plus en plus de citoyens franchissent malheureusement pour basculer dans une forme plus ou moins douce, plus ou moins dangereuse, de folie: en Belgique, 25% de la population est en “traitement”, 10% ingurgitent des anti-dépresseurs, de 2005 à 2009 le nombre d’enfants et d’adolescents contraints de prendre de la rilatine a doublé rien qu’en Flandre (de 15.000 à 30.000...); en 2007, la Flandre est le deuxième pays sur la liste en Europe quant au nombre de suicides par million d’habitants (161/un million). C’est là, on en conviendra, une brillante réussite de la politique régimiste! Bilan désastreux pour nos “progressistes” qui croyaient avoir trouvé toutes les formules pour faire le bonheur des masses! Pour le Prof. De Wachter, la solution réside dans un renouveau culturel, littéraire et artistique, basé sur des principes radicalement différents de ceux appliqués aujourd’hui dans les établissements d’enseignement: l’effondrement du niveau, où le prof doit se mettre au niveau des élèves et capter leur attention “no matter what” et la négligence des branches littéraires, artistiques et musicales, qui permettent à l’enfant de tenir compte d’autrui, font basculer les nouvelles générations dans une déshumanisation problématique, constate le Prof. De Wachter, en se réclamant du philosophe conservateur britannique Roger Scruton et de la “communautariste” américaine Martha Nussbaum, vigoureuse avocate du retour aux humanités classiques, à nos racines grecques et aristotéliciennes. Guérir notre société malade passe donc par une révolution culturelle, soit par un retour, par un “revolvere” aux fondements sûrs de notre civilisation, aux humanités classiques et aux bases identitaires. Sans identité, sans tradition, sans “centre” intérieur (Frithjof Schuon), on devient fou: tel est notre constat, schématisé ici de manière certes un peu abrupte, et il est corroboré par l’une des plus grandes sommités de la médecine psychiatrique de la célèbre université de Louvain. Ceux qui nous contrarient au nom de leurs chimères et de leurs délires, sont, par voie de conséquence, sans trop solliciter les faits, des fous qui veulent précipiter leurs contemporains au-delà de la “borderline”, où on ne survit qu’à grands renforts d’anti-dépresseurs ou d’euphorisants, à moins de passer dans la catégorie des 161 infortunés sur un million d’habitants qui recourent au suicide.

Quant à ce spécialiste des recherches sur le fonctionnement du cerveau qu’est le Prof. Manfred Spitzer, il s’est penché tout spécialement, dans son dernier livre (op. cit.) sur la “démence digitale”, où il dénonce l’utilisation abusive de médias digitalisés dans l’enseignement. Son ouvrage est une riposte à une dangereuse élucubration de la “Commission d’enquête” du Bundestag allemand, qui avait prévu d’offrir un “notebook” à tous les écoliers et de promouvoir la “pédagogie par jeux informatiques”: il paraît d’après ces délirants germaniques que cette bimbeloterie high tech et cette pédagogie de cornecul vont offrir “un meilleur avenir pour nos enfants” (gnagnagna...). Pour le Prof. Spitzer, nobelisable, ce délire témoigne d’une méconnaissance totale du fonctionnement du cerveau humain (surtout au stade de l’enfance et de l’adolescence) et d’un commercialisme sans scrupules (car les marchands d’ordinateurs et de logiciels ont sûrement graissé la patte des politicards et des pédagogogues). Pourtant, bon nombre d’études scientifiques ont prouvé que les médias digitalisés ne donnaient que de piètres résultats sur le plan pédagogique. Pire, ils endommagent les corps et les cerveaux, dans la mesure où la mémoire et la concentration en pâtissent. On entraîne ainsi les nouvelles générations dans la superficialité, dans l’a-socialité (les amis virtuels de “Facebook” ou de “Twitter” ne sont pas des amis de chair et de sang), dans la dépression (cf. De Wachter), due notamment à l’absence de sommeil cumulée sur des mois voire des années. Et dans les pages 276 à 281 de son livre, Spitzer pointe du doigt les coupables: les politiciens, tous partis confondus; citation: “Lors de conférences et de débats, on m’a souvent demandé d’aller parler aux hommes politiques. Je l’ai fait, à plusieurs reprises, notamment, il y a quelques années, lors d’un audit d’experts mandé par la Commission de la jeunesse du Bundestag. Cet audit a duré deux fois plus de temps que prévu et les députés ont trouvé formidable tout ce que nous leur disions. Après environ six semaines, on a pondu un long protocole qui concluait... qu’il n’y avait aucune raison d’agir... Le lobby médiatique, entretemps, n’avait pas perdu son temps”. Mieux: “Le sort des enfants n’est pas pris au sérieux par les responsables politiques. Ils les perçoivent plutôt comme du bétail et non pas comme des êtres en pleine croissance, comme de petits diamants que l’on doit traiter raisonnablement et avec respect”. Voilà donc l’avis de deux experts, issus de facultés de médecine prestigieuses, un avis que les politiciens ignorent... Et peuvent ignorer en toute tranquillité parce qu’il n’y a pas de structures de combat métapolitique dans nos quartiers pour contrer leurs agissements criminels et anti-sociaux dans nos assemblées municipales, dans nos écoles, dans nos comités de voisinage, etc. Il y a des dizaines de savants irréprochables, comme De Wachter et Spitzer, qui ne peuvent pas faire entendre leur voix parce qu’ils n’ont aucun relais dans la société civile, aucune association métapolitique pour leur venir en aide et faire triompher, dans chaque quartier, dans chaque bourg, leurs idées justes et bonnes.
9.
Quelles est votre opinion sur la montée ou sur les avatars des partis dits “nationalistes” en Europe aujourd’hui?
A partir de la perestroïka de Gorbatchev, au moment de la chute du Mur de Berlin, au début des années 90 du 20ème siècle, tous les espoirs étaient quasi permis: le communisme disparaissait en tant que partie prenante du duopole de Yalta. Sa fonction de croquemitaine pour imposer le libéralisme manchestérien à l’Europe occidentale s’évanouissait. On pouvait envisager ce que nous appellions, à l’ère du duopole, une “troisième voie” (Jean-Gilles Malliarakis à Paris) ou un “solidarisme” (Lothar Penz et Ulrich Behrenz à Hambourg). Rien n’est arrivé. Nos espoirs ont été totalement déçus. Les partis dits “nationalistes” sont apparus à la même époque: Le Pen prend son envol, grâce aux efforts de Stirbois à Dreux, dès 1984, un an avant l’accession de Gorbatchev au pouvoir. D’autres partis sortent de la marginalité ailleurs en Europe: le bilan de cette effervescence nouvelle à l’époque, je l’ai dressé, encore assez enthousiaste, avec le regretté Roland Gaucher, dans un numéro spécial sur les “nouveaux nationalistes” du célèbre mensuel parisien “Le Crapouillot” en 1994. C’était là une enquête minutieuse que j’avais pu mener allègrement, grâce, surtout, à la formidable documentation qu’avaient compilée Peter Dehoust, Heinz-Dieter Hansen et Wolfgang Strauss en Allemagne dans les colonnes de revues ou de bulletins comme “Nation Europa”, “DESG-Inform” ou “Staatsbriefe” (du Dr. Hans-Dieter Sander). Deux écueils expliquent la stagnation actuelle de toutes ces formations politiques, stagnation assortie par d’interminables querelles entre personnes: 1) le mirage du néo-libéralisme, dont ces formations ne se sont pas assez démarquées au profit d’un solidarisme nouveau, c’est-à-dire d’un socialisme comme aux temps héroïques, comme au temps de Georges Sorel ou de Roberto Michels, d’un socialisme débarrassé de toutes corruptions mais demeurant inébranlablement au service du peuple, ce qui n’est plus le cas d’un socialisme “diroupetté” ou “hollandouillé”; 2) l’incapacité à s’unir dans le domaine de la politique étrangère; on a vu certains partis faire l’apologie de Bush et du néo-conservatisme new-yorkais, au nom d’une islamophobie qui confondait l’islam avec les dérapages inacceptables du wahhabisme saoudien ou du salafisme nord-africain. Position aussi imbécile que celles des socialistes (corrompus) des vieilles sociales-démocraties usées d’Europe qui croyaient qu’Obama allait nous apporter une ère de paix diamétralement différente du bellicisme néo-conservateur! Alors qu’Obama poursuit, opiniâtre, le programme guerrier et pétrolier du père et du fils Bush!
Seule la FPÖ autrichienne offre, dans sa presse, des articles anti-impérialistes bien argumentés et documentés, dus à la plume d’un véritable héros contemporain de l’européisme sainement conçu, un héros modeste et effacé, le Dr. Bernhard Tomaschitz, que j’ai le vif plaisir de traduire assez souvent. En Italie, le quotidien de la “Lega Nord”, “La Padania”, offrait aussi de fructueuses analyses en politique étrangère et je me souviens, avec nostalgie, de ma coopération avec Archimede Bontempi, lors de la guerre de l’OTAN contre la Serbie. En dehors des partis représentés dans les hémicycles, le quotidien romain “Rinascita”, organe d’une “gauche nationale” offre chaque jour, grâce à un excellent réseau de correspondants dispersés dans le monde entier, des analyses de politique internationale qui devraient servir d’exemples à tous et faire honte à tous les cancres qui ne s’en inspirent pas...
En tant qu’admirateur de la clarté conceptuelle de Jean Thiriart, j’ai donc été déçu de ne pas voir les analyses de Tomaschitz, de Bontempi (et de ses amis) et de la formidable équipe de “Rinascita” être traduites en un militantisme offensif, tous azimuts, mobilisant les universités (si c’est encore possible, à l’heure de la démence digitalisée stigmatisée par le Prof. Spitzer...), les cercles culturels, para-politiques et métapolitiques, les débats parlementaires en commission des affaires étrangères, de manière à s’opposer systématiquement aux diktats de l’hegemon, non pas par une politique frontale, car nous n’en avons pas (encore) les moyens, mais par une stratégie des petits coups d’épingle constants et incessants, une stratégie dont les partis dits “nationalistes” auraient dû se faire le fer de lance, faute d’autres combattants représentatifs et à cause des scléroses mentales des formations d’extrême-gauche, pourtant plus férues de politique étrangère... Beaucoup n’ont pas opté pour ce combat constant et nécessaire... En attendant, l’Europe des tartuffes constate qu’elle est espionnée, que l’Oncle Sam a des yeux et des oreilles partout, jusque dans les chiottes du Parlement européen (pour parler comme Poutine...), grâce au système Prism et que John Bull fait de même, avec “Tempora”. Les cocus magnifiques... Nous n’avons pas attendu un tel scandale ni les révélations de Julian Assange ou d’Edward Snowden pour réagir, pour organiser un mini-pôle de rétivité. Une fois de plus, nous avons eu raison, mille fois raisons. Notre politique de refus de l’américanisme était la bonne. La seule qui soit politiquement rationnelle face à un hegemon malhonnête.
10.
Pour terminer cet entretien, je voudrais que vous expliquiez aux néophytes que nous sommes ce qu’a été le rôle de “Synergies Européennes”?
Vous pourrez consulter l’entretien que j’ai accordé au site scandinave “Oskorei” pour comprendre ce qu’a été “Synergies Européennes”. L’objectif était de faire travailler ensemble des Européens lucides et enracinés dans leur culture par des colloques, conférences et universités d’été communes et par une politique de traduction tous azimuts. Lors de mon intervention sur les ondes de la radio libre “Méridien Zéro” en juin 2012, l’animateur de service ce jour-là m’a bien avoué qu’il manque aujourd’hui en Europe une association “baldaquin” du genre que celle que j’ai animée jusqu’en 2004, avant de passer au virtuel comme tout le monde —ce qui n’est pas la même chose, hélas, que les rapports directs et personnels entre confrères— sur les sites http://euro-synergies.hautetfort.com puis http://vouloir.hautetfort.com et http://archiveseroe.eu . Mes textes personnels se trouvent sur http://robertsteuckers.blogspot.com . Si d’aucuns estiment opportune la renaissance d’une telle structure souple et ouverte, d’un tel baldaquin, que les volontaires se présentent au bureau de recrutement, avec leurs références, prouvant qu’ils savent travailler dans la constance et la détermination. Et tout redémarrera comme au premier jour.
11.
Merci d’ajouter les quelques mots de la fin pour nos lecteurs...
Méditez l’adage tiré de la fable de Lafontaine, “Le laboureur et ses enfants”: “Travaillez, prenez de la peine, c’est le fond qui manque le moins”.



 When the ban on D.H. Lawrence’s controversial novel, Lady Chatterley’s Lover, was finally lifted in 1960 it was a watershed moment for censorship in Britain. But many assume it was only Lawrence’s novels that suffered at the hands of the censors.
When the ban on D.H. Lawrence’s controversial novel, Lady Chatterley’s Lover, was finally lifted in 1960 it was a watershed moment for censorship in Britain. But many assume it was only Lawrence’s novels that suffered at the hands of the censors.
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg


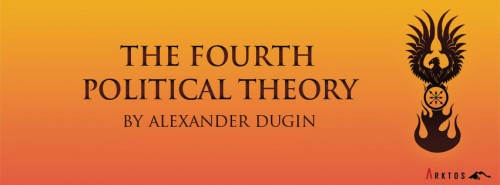

















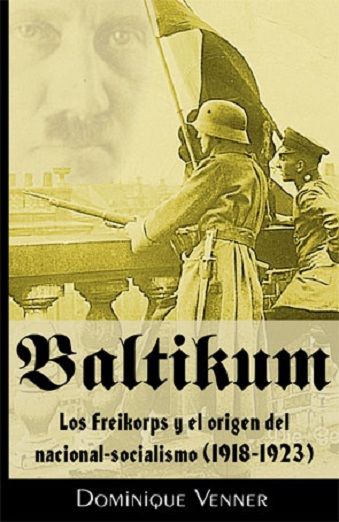

 Au départ, rien, mais absolument rien, ne me prédestinait à aller circuler dans ce milieu, qui a précédé puis fondé l’espace politico-culturel de la “nouvelle droite”. Aucune tradition familiale ne m’a incité à aller chercher du sens dans un tel espace: en effet, les agitations politiciennes relevaient, pour mon père, issu du paysannat limbourgeois-hesbignon, de la “folie des villes”. Sa devise était: “pour vivre heureux, vivons caché” et il la citait volontiers en français, qui n’était pas sa langue maternelle. Quant à ma mère, elle était issue d’une famille qui entendait vivre en parfaite autarcie par rapport à une société que mon grand-père, ancien combattant de 14-18, méprisait, quelles qu’en aient été les facettes. Quand on évoquait des grands problèmes sociaux, irrésolus, ma mère disait, en flamand: “’t is ver van mijn bed!” (“C’est loin de mon lit!”), sous-entendu, “je n’ai pas à m’en occuper”. Mon père a travaillé de 1938 à 1944, et de 1952 à 1978 pour le Comte Guillaume de Hemricourt de Grünne, l’oncle de Rodolphe de Hemricourt de Grünne, le héros de l’aviation franquiste pendant la guerre d’Espagne, où ce jeune et fringant aristocrate, issu du Collège Saint-Louis de Bruxelles, s’était porté volontaire pour s’affranchir d’une vie de dandy qui ne le satisfaisait plus. Les frères de Guillaume de Grünne, Eugène et Xavier, étaient eux aussi des héros militaires. Eugène, chantre du sacrifice du soldat chrétien (catholique), a d’ailleurs été tué à la guerre, aux côtés du beau-frère de mon père, à Maldegem, en mai 1940, fidèle aux préceptes qu’il énonçait, volontaire de guerre en première ligne à 57 ans! Xavier, alpiniste chevronné, puis sénateur rexiste, puis adversaire de Degrelle, puis fondateur d’une “Phalange belge” hostile tant aux Anglais qu’aux Allemands, mourra en déportation à Mauthausen, fidèle à la neutralité belge jusqu’à son dernier souffle, en dépit de tous les rapports de force! Un idéalisme d’une pureté inouïe qui s’est fracassé contre le “granit du pragmatisme”, comme aurait dit le regretté Dominique Venner!
Au départ, rien, mais absolument rien, ne me prédestinait à aller circuler dans ce milieu, qui a précédé puis fondé l’espace politico-culturel de la “nouvelle droite”. Aucune tradition familiale ne m’a incité à aller chercher du sens dans un tel espace: en effet, les agitations politiciennes relevaient, pour mon père, issu du paysannat limbourgeois-hesbignon, de la “folie des villes”. Sa devise était: “pour vivre heureux, vivons caché” et il la citait volontiers en français, qui n’était pas sa langue maternelle. Quant à ma mère, elle était issue d’une famille qui entendait vivre en parfaite autarcie par rapport à une société que mon grand-père, ancien combattant de 14-18, méprisait, quelles qu’en aient été les facettes. Quand on évoquait des grands problèmes sociaux, irrésolus, ma mère disait, en flamand: “’t is ver van mijn bed!” (“C’est loin de mon lit!”), sous-entendu, “je n’ai pas à m’en occuper”. Mon père a travaillé de 1938 à 1944, et de 1952 à 1978 pour le Comte Guillaume de Hemricourt de Grünne, l’oncle de Rodolphe de Hemricourt de Grünne, le héros de l’aviation franquiste pendant la guerre d’Espagne, où ce jeune et fringant aristocrate, issu du Collège Saint-Louis de Bruxelles, s’était porté volontaire pour s’affranchir d’une vie de dandy qui ne le satisfaisait plus. Les frères de Guillaume de Grünne, Eugène et Xavier, étaient eux aussi des héros militaires. Eugène, chantre du sacrifice du soldat chrétien (catholique), a d’ailleurs été tué à la guerre, aux côtés du beau-frère de mon père, à Maldegem, en mai 1940, fidèle aux préceptes qu’il énonçait, volontaire de guerre en première ligne à 57 ans! Xavier, alpiniste chevronné, puis sénateur rexiste, puis adversaire de Degrelle, puis fondateur d’une “Phalange belge” hostile tant aux Anglais qu’aux Allemands, mourra en déportation à Mauthausen, fidèle à la neutralité belge jusqu’à son dernier souffle, en dépit de tous les rapports de force! Un idéalisme d’une pureté inouïe qui s’est fracassé contre le “granit du pragmatisme”, comme aurait dit le regretté Dominique Venner!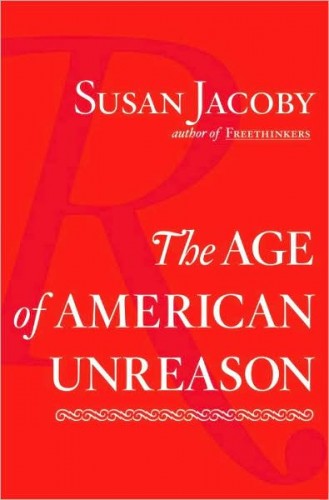

 Toutefois, cette stratégie a échoué, comme l’avoue Brzezinski lui-même dans son dernier ouvrage de mars 2012, intitulé “Strategic Vision”. Pour le théoricien de la conquête de la “Route de la Soie” (“Silk Road”) et de l’inclusion de l’Ukraine dans l’OTAN, pour l’homme qui a suggéré l’armement des talibans contre les Soviétiques en Afghanistan, toutes ces strtatégies, qu’il a préconisées, ont échoué. Selon le regard nouveau qu’il propose de jeter sur l’échiquier international, il ne faut donc plus fragmenter la Russie à l’infini mais s’allier à elle, dans une sorte de grande alliance de l’hémisphère Nord, avec l’Amérique du Nord, l’Europe (Turquie comprise) et la Russie! Au soir de sa vie, à 84 ans, cet homme avoue sans état d’âme, sans s’effondrer mentalement, que ses projets n’ont pas abouti! Et propose exactement ce que propose un théoricien néo-droitiste français, tout à fait inclassable, comme Guillaume Faye! Ou que proposent aussi beaucoup de théoriciens nationalistes américains, partisans d’une “unité du monde blanc”! Brzezinski est devenu “Amereurasiste”! Apparemment, il n’est guère écouté Outre-Atantique, où l’“Administration Obama” poursuit les guerres de Bush et le contrôle des esprits dissidents ou contestataires aux Etats-Unis mêmes, avec une acribie encore plus frénétique.
Toutefois, cette stratégie a échoué, comme l’avoue Brzezinski lui-même dans son dernier ouvrage de mars 2012, intitulé “Strategic Vision”. Pour le théoricien de la conquête de la “Route de la Soie” (“Silk Road”) et de l’inclusion de l’Ukraine dans l’OTAN, pour l’homme qui a suggéré l’armement des talibans contre les Soviétiques en Afghanistan, toutes ces strtatégies, qu’il a préconisées, ont échoué. Selon le regard nouveau qu’il propose de jeter sur l’échiquier international, il ne faut donc plus fragmenter la Russie à l’infini mais s’allier à elle, dans une sorte de grande alliance de l’hémisphère Nord, avec l’Amérique du Nord, l’Europe (Turquie comprise) et la Russie! Au soir de sa vie, à 84 ans, cet homme avoue sans état d’âme, sans s’effondrer mentalement, que ses projets n’ont pas abouti! Et propose exactement ce que propose un théoricien néo-droitiste français, tout à fait inclassable, comme Guillaume Faye! Ou que proposent aussi beaucoup de théoriciens nationalistes américains, partisans d’une “unité du monde blanc”! Brzezinski est devenu “Amereurasiste”! Apparemment, il n’est guère écouté Outre-Atantique, où l’“Administration Obama” poursuit les guerres de Bush et le contrôle des esprits dissidents ou contestataires aux Etats-Unis mêmes, avec une acribie encore plus frénétique.