lundi, 02 septembre 2013
L'antiracisme, prothèse de l'idéologie dominante...

L'antiracisme, prothèse de l'idéologie dominante...
par Robert Redeker
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Nous reproduisons ci-dessous un texte incisif de Robert Redeker, cueilli sur le blog de cet auteur et consacré à la mascarade antiraciste...
Professeur de philosophie, essayiste à l'origine classé à gauche, Robert Redeker vit depuis plusieurs années sous protection policière pour avoir publié dans le Figaro un texte hostile à l'slamisme.
L'antiracisme est une prothèse destinée à donner une illusion qui comble le vide politique. Il distille à ses intoxiqués l’illusion de la politique. Ce vide est aussi bien l'effet du temps, de l'usure de l’histoire, que d'une volonté fataliste : en finir avec les idéaux de la gauche et leur substituer une sorte de substitut ludique. L’antiracisme est un opium qui laisse croire qu'il est une réconciliation de la politique et de la morale. Alors qu'il n'est ni l'une ni l'autre, ni bien sûr leur synthèse.L'antiracisme permet de rejouer la politique. De la simuler. De jouer à la politique. Mais auparavant la politique aura été vidée de tous ses enjeux. D'un certain point de vue le concept marxiste d'idéologie décrit bien à l'antiracisme. D'un autre point de vue, il faut le compléter par celui, issu des écrits de Jean Baudrillard, de simulation. Chez Marx, l’idéologie – le noir barbu de Trêves vise surtout, à travers ce concept, la religion – est le dispositif par lequel la bourgeoisie masque la réalité de ses intérêts derrière les idées abstraites. Mais à la différence de la religion telle que Marx la perçoit, l'antiracisme masque moins des intérêts, qu'il ne conteste pas, qu'une disparition. Au contraire même, aux temps du triomphe de l'antiracisme, les intérêts sont, parallèlement, proclamés haut et fort. L'antiracisme est à la politique ce que le paintball est à la guerre. Il crée dans l'âme des naïfs et des rêveurs l’illusion que continuent d'exister des concepts, des analyses et des projets et des combats politiques, alors que toutes ces choses ont été jetées par-dessus bord.Qu'est-ce que la simulation ? Jean Baudrillard en propose une bonne définition : « L'ère de la simulation est ainsi partout ouverte par la commutabilité des termes jadis contradictoires ou dialectiquement opposés ». C'est l'époque mitterandienne qui a inauguré ces commutations, mères de l'âge de la simulation : capitalisme/gauche, argent roi/gauche, luxe/gauche, gestion/gauche. Il y a évidemment, tant qu'on s'en tient à la rationalité, à la dialectique, une opposition entre la super-caste privilégiée de la galaxie du show business et du sport, voire de la mode, d'une part, et la misère des cités de banlieue, d'autre part. Or, l'antiracisme, pour assurer sa propagande, les rend commutables, chanteurs, rappeurs, acteurs et sportifs (à l'image de Lilian Thuram, de Djamel Debouze, de Joey Starr) passant sans gêne d'un rôle à l'autre, se régalant d'être pris pour des jeunes de banlieue. Alors que la politique, la gauche, l'horizon révolutionnaire, étaient engendrés par la théorie, la pensée, l'antiracisme est engendré par l'univers du show-business et les industries du divertissent. Alors que les réformes sociales (par exemple celles de 1936) étaient imposées par la pression politique des masses, des luttes, des grèves, qui électrisaient toute la société, bref par l’Histoire, les mesures antiracistes sont imposées par le monde doré de la variété, du show-business, du cinéma, de la télévision et du sport, par les industries du divertissement, autrement dit par la simulation parodique de l'Histoire.Dans l'index (qui, sous la forme d'un vocabulaire philosophique occupe une quarantaine de pages) de la classique et monumentale Introduction à la philosophie marxiste due à la plume érudite et militante de Lucien Sève , philosophe communiste français officiel, le mot racisme se signale par son absence. Autrement dit, en 1980, le racisme ne passe pas encore pour un problème majeur du côté des marxistes, sans doute de la gauche en général. Aujourd'hui, il suffit d'écouter un responsable politique d'un parti de gauche, de parcourir les colonnes d'un journal de gauche, Libération ou L'Humanité, pour se rendre à l'évidence: les mot « immigré » a remplacé le mot « prolétariat », le mot « antiracisme » a remplacé le mot « communisme », le mot « racisme » a remplacé le mot « anticommunisme », le mot « islam » a remplacé l'expression « conscience de classe ». A l'insu de tous et de chacun, la gauche s'est dissoute dans l'antiracisme. Les mots « racisme », « antiracisme », « immigré », « sans-papiers » remplissent toutes les pages du quotidien communiste L'Humanité alors qu'il y a trente ans cet honneur était réservé au mot « prolétaire ».L'antiracisme simule et parodie les luttes sociales, il simule et parodie la gauche. Mais, si l'on sait ce que remplace l'antiracisme, il faut demander auparavant : que remplace ce à quoi dans l'imaginaire dominant l'antiracisme s'oppose, le racisme ? D'abord il se substitue à une réalité métaphysique dont notre temps, à tout le moins en Europe de l'ouest, se refuse à prononcer le nom : le mal. Plus justement : le mal moral. Les sociétés consuméristes et hédonistes, celles dont Herbert Marcuse et Gilles Lipovetsky ont dessiné les traits les plus remarquables, apparues dans le monde occidental à partir des années 60, refoulent l'usage explicite du concept de mal. « Racisme » est le mot qu'elles ont mis en circulation pour dire ce que jadis on appelait le mal moral. Une grande partie des fautes naguère rangées sous la catégorie de mal sont devenues soit anodines soit des qualités. Voici l'envie vantée par la publicité comme une vertu ! La chanson de geste de la luxure inonde les écrans et les gazettes. La trahison, l'infidélité, la perfidie sont, d'écran publicitaire en spot de réclame, de téléfilm en jeu d'avant prime-time, valorisées. La cupidité – gagnez, gagnez... - est élevée au rang de l'exemplarité morale. L'école elle-même enseigne aux élèves des lycées sous couvert de réussir à savoir ce vendre ; autrement dit impose aux jeunes générations un impératif prostitutionnel. Plus : elle laisse entendre que le bien dans la vie collective se résume à une sorte de prostitution généralisée, où tout le monde se vend. Réussir, voilà la seule misérable ambition qu'elle propose aux nouvelles générations ! La dégradation des mœurs – qu'il faut entendre, insistons sur ce point, dans toute sa force inédite : cette dégradation n'est pas le résultat de vices privés, cachés, recouverts par la honte, qui prendraient le dessus en assumant la réprobation qu'elle s'attirerait, non, cette dégradation est voulue, organisée, dirigée parce qu'elle est le moteur de la société de consommation - a vidé le mot mal de toute sa substance. C'est le souvenir de cette substance, de ce contenu, qui explique qu'un puissant tabou, plus sociétal que social, plane sur le concept de mal, paralysant son réemploi. Jusqu'ici n'existaient dans les sociétés qu'un seul temps durant lequel des conduites tenues pour vicieuses étaient louées comme vertueuses : le temps de la guerre (transformation du crime en vertu à l'origine de la désillusion de Freud devant l'homme). Tuer, violer, torturer, piller, mentir – ces crimes, en époque de suspension de la paix, deviennent dignes de louange. La société de la modernité tardive a inventé de l'inédit : ce n'est plus seulement de loin en loin que le vice devient officiellement vertu, c'est, sous les formes que nous venons d'exposer, en permanence. Sous l'aspect de la morale, la société de consommation est la guerre en temps de paix, elle entretient chez les hommes un état d'esprit de mercenaire sans foi ni loi en période de paix.L'antiracisme s'est substitué à l'engagement, à ce que les générations des décennies cinquante, soixante, soixante-dix, appelaient dans le sillage de Sartre l'engagement. Ce que les contemporains de Sartre désignaient sous ce vocable brisait le consensus social dominant. S'engager revenait à vivre dangereusement. De grands risques accompagnaient l’engagement, en particulier ceux de la mise-à-l’écart, de la marginalisation, de la censure. Des événements historiques – comme la guerre d'Algérie – faisaient planer sur l'engagement les menaces de la torture et d’exécution. La censure cherchait aussi àbâillonner l'engagement. Au contraire, jamais depuis que l'antiracisme s'est substitué àl'engagement politique aucune proclamation antiraciste n'a été censurée. Plus : ces proclamations ont toujours été mises en valeur à la fois par les services de l'Etat et par les médias. Elles ont toujours été relayées dans les écoles. L'engagement sartrien, parce qu'il n'était pas de nature parodique, n'a jamais bénéficié de pareilles largesses de la part du système social dominant. Pour s'engager, il fallait accepter de devenir un pestiféré. Le militantisme antiraciste ne court pas de pareils dangers. S'affirmer antiraciste revient à rejoindre le consensus dominant, adhérer à l'idéologie dominante ; s'engager revenait, inversement, à rompre, à divorcer d'avec cette idéologie dominante. Quand l’engagement des années quarante, cinquante, soixante, était âpre, le militantisme antiraciste contemporain est gratifiant, en procurant l'assurance de recevoir des approbations, voire d'être couvert de lauriers. Dans certaines professions, tout spécialement celles qui touchent à l’univers du spectacle, l’antiracisme est un passage obligé pour éviter de disparaître de l'affiche. De même, l'instituteur et le professeur verront leur enseignement couvert de louanges par les autorités académiques et les parents d'élèves s'il se moule dans de la propagande antiraciste. Le militantisme antiraciste est une parodie de ce que l'engagement a été.L'antiracisme est le fantôme décharné de ce que fut l'engagement. L'antiracisme vole aussi la place des luttes sociales. Il en usurpe le souvenir. Dans les années trente du siècle dernier la notion de classe est sortie victorieuse de son affrontement avec la notion de race. Après la seconde guerre mondiale, toute l'attention s'est focalisée sur la lutte des classes, à tel point que le concept de révolution, dans son acception marxiste, régnait sans partage sur les consciences. Les grandes idées de la gauche – transformation de la société à partir de la destruction de l'inégalité liée à la propriété, modification des rapports de production, etc...- ont été portées par des mouvements collectifs, des « masses-en-fusion » aurait dit Sartre, des révolutions (1848, 1917, la Commune de Paris, 1936, Budapest 1956), des partis politiques, des syndicats. L’antiracisme, lui, qui a pris le relais après l’évanouissement du projet révolutionnaire, est porté par le show-business. Avec beaucoup de cynisme, ce dernier s'est installé sans vergogne à la place du peuple. Il aime à parader dans le rôle de moteur du progrès moral, à condition que celui-ci ne risque pas de se muer en revendication de progrès social. Il lui vole la parole au peuple, il parle à sa place, il donne des leçons à sa place, des leçons de moraline ! Le show-business souffle à l'oreille du peuple ce qu'il faut penser : non que l'inégalité et les privilèges, l'exploitation abusive du travail d'autrui, c'est mal, mais que le racisme est le plus grands de tous les maux. L’antiracisme replace au centre des débats la notion qui avait été, par la gauche, écartée au profit de la notion de classe, la race. C’est pourquoi, viagra politique de la gauche, l'antiracisme occupe, sur un mode aussi parodique que stérile, la place qui fut naguère celle de lutte des classes.
Robert Redeker (Quand Redeker eut les cinquante-neuf ans, 10 août 2013)
00:05 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anti-racisme, robert redeker, philosophie, idéologie dominante, bourrage de crâne, totalitairsme, prêt-à-penser, conformisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 01 septembre 2013
L’HUMANISME EUROPEEN EST VIDE DE SON SENS

L’HUMANISME EUROPEEN EST VIDE DE SON SENS
SA LEGITIMITE EST MENACEE
Une refondation est-elle possible ?
Pierre Le Vigan
Ex: http://metamag.fr
Rémy Brague
 , qui l’aurait chassé du centre de l’Univers, puis Darwin, qui l’aurait détrôné du sommet des vivants, puis la psychanalyse, qui aurait chassé de sa propre âme la conscience. » Ainsi, la « mort de l’homme » ne désigne en fait rien d’autre que le constat (banal) que la conscience de l’homme ne résume pas le tout de l’homme, que le sujet n’est jamais totalement conscient et transparent à lui-même. On en conviendra bien volontiers.
, qui l’aurait chassé du centre de l’Univers, puis Darwin, qui l’aurait détrôné du sommet des vivants, puis la psychanalyse, qui aurait chassé de sa propre âme la conscience. » Ainsi, la « mort de l’homme » ne désigne en fait rien d’autre que le constat (banal) que la conscience de l’homme ne résume pas le tout de l’homme, que le sujet n’est jamais totalement conscient et transparent à lui-même. On en conviendra bien volontiers.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, humanisme, europe, affaires européennes, rémy brague |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 30 août 2013
Les aléas de la liberté de conscience
Les aléas de la liberté de conscience
 Refuser l’objection de conscience face aux réformes sociétales, c’est en revenir au principe totalitaire selon lequel l’État a toujours raison.
Refuser l’objection de conscience face aux réformes sociétales, c’est en revenir au principe totalitaire selon lequel l’État a toujours raison.
Le développement récent des réformes “sociétales” — c’est-à-dire concernant les moeurs, l’éthique, la liberté individuelle, la famille, le couple et les comportements — rend plus légitime encore qu’auparavant un questionnement sur la liberté de conscience et même sur l’objection de conscience. Car tout cela ressort au domaine de l’infiniment discutable, concerne l’intime et les convictions profondes sur ce qu’est un humain, ce qu’il lui faut, ce qu’il doit rechercher.
On peut avoir l’impression que nous sommes justement arrivés au bon moment de l’Histoire pour défendre la liberté de conscience. C’est le nazisme qui en est l’occasion. Voir ces bourreaux qui ont obéi comme des fantassins aveugles à des ordres barbares et qui se trouvaient capables, des dizaines d’années après, de légitimer encore leur allégeance, cela nous a révulsés au point de nous inciter à toujours défendre la conscience individuelle. La hantise du bourreau fidèle aux ordres a même suscité chez nous une méfiance instinctive du côté institutionnel des choses, à ce point que les groupes les plus conformistes se prétendent indépendants d’esprit. Nous vivons à une époque où tout le monde se prend pour Antigone.
Il est donc assez déconcertant de voir les réponses données à ceux qui en appellent à la liberté de conscience, et même à l’objection de conscience, face aux réformes sociétales dont le gouvernement actuel semble s’être fait une spécialité, et particulièrement face au mariage homosexuel. On leur rétorque qu’ils ne sont pas républicains, car allant à l’encontre de l’égalité républicaine, et aussi homophobes, évidemment. Nantis de ces tares rédhibitoires, ils n’ont évidemment pas droit à la décision individuelle, à vrai dire ils n’ont même pas de conscience, puisqu’ils s’opposent à la seule vérité sociopolitique.
Autrement dit, nous retournons subrepticement à ce que le combat antitotalitaire avait réussi à démanteler : le positivisme — c’est-à-dire l’idée selon laquelle l’État a toujours raison, parce qu’il est l’État. Dans notre cas, il faudrait plutôt dire : ce qui est consacré républicain (progressiste, égalitariste, émancipateur) a toujours raison.
Il faut bien rappeler que la conscience personnelle, celle d’Antigone, celle de l’objection de conscience, représente exactement le contraire du positivisme. Elle présuppose, si elle existe ou plutôt si elle est légitimée (car elle existe même si personne ne la reconnaît), qu’aucune instance supérieure ne peut prétendre avoir toujours raison. Et que le dernier mot, toujours particulier et relatif, revient à la conscience personnelle — ce qui suppose évidemment que l’être humain soit une personne et non un individu programmé par l’État, formaté par l’École.
C’est seulement dans ce cadre que la liberté de conscience existe : si l’idéal républicain, passe au second rang, après la conscience personnelle — autrement dit, si l’on imagine que le progressisme tout-puissant peut être jugé ! Faute de quoi nous en revenons au positivisme, qui était la tare principale des deux totalitarismes, donc du nazisme contre lequel nous ne cessons de lutter.
On ne peut pas porter les antifascistes sur le bouclier de la gloire et ne pas permettre aux maires de récuser le mariage gay en leur âme et conscience. Si la conscience d’Antigone existe et si elle doit être révérée, ce n’est pas seulement pour lutter contre le nazisme et contre les dictateurs exotiques. C’est aussi pour juger les croyances de notre République et dénoncer ses excès, ses abandons, ses lois scélérates. La conscience d’Antigone n’est pas un outil qu’on saisit quand cela nous arrange — pour fustiger Papon ou crier haro sur les accusés des tribunaux internationaux, complices de gouvernements criminels. Et qu’on mettrait sous le boisseau, réclamant dès lors l’obéissance absolue, quand cela nous sied — devant l’égalité républicaine, devant la souveraineté de la pensée d’État. Brandir une théorie pour ses adversaires et la décréter inepte dès qu’elle s’applique à soi : c’est la spécialité des imbéciles, et des idéologues.
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chantal delsol, liberté, liberté de conscience, philosophie, france, actualité, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 28 août 2013
Notes sur deux résistants antiSystème

Notes sur deux résistants antiSystème
Ex: http://www.dedefensa.org
Nous devons savoir et croire qu’à côté de l’exposé permanent des détails monstrueux de la menace qui pèse sur nous, avec la monstrueuse NSA notamment, ceux qui luttent contre cette menace avec un “rendement” inimaginable dans son rapport moyens-efficacité méritent bien autant, et même bien plus, d’être l’objet de notre attention. L’efficacité de leur action, leur courage, leur professionnalisme, leur habileté face au Système, constituent autant de motifs irrésistibles d’espoir dans l’accélération très rapide de l’effondrement du Système. Ces “héros de la Résistance”, bien connus ou parfois ignorés, sont non seulement un exemple du point de vue humain, mais encore plus un exemple du point de vue opérationnel. Ils démontrent l’extraordinaire vulnérabilité du Système, et, en quelque sorte, son espèce très particulière de bêtise, étrangement lié à la chose, donc aussi monstrueuse que la taille de la chose... (Parole de René Guénon, à toujours avoir à l’esprit : «On dit même que le diable, quand il veut, est fort bon théologien ; il est vrai, pourtant, qu’il ne peut s’empêcher de laisser échapper toujours quelque sottise, qui est comme sa signature…»)
Nous allons prendre comme référence solide et “diluvienne” en un sens, avec nombre de citations, un article d’une longueur considérable de Peter Maass, journaliste indépendant et auteur, que nous ne qualifierions pas de “dissident” complètement, mais qui n’est pas si loin de l’être. Maass a publié très récemment une interview de Edward Snowden dans le New York Times Magazine (voir notre texte du 16 août 2013), et c’est également dans ce NYTM du 18 août 2013 qu’est publié ce très long article sur le “couple” Greenwald-Poitras, mais surtout sur Laura Poitras.
La bohème Greenwald-Poitras au travail
Laura Poitras, cinéaste de films documentaires dont la substance est clairement antiSystème, qui a reçu de nombreuses récompenses et nominations pour ses travaux, est la cheville ouvrière de l’affaire Snowden, et peut-être la stratège de cette affaire, le deus ex machina. Bien qu’il soit inapproprié de proposer ce qui pourrait se rapprocher d’un classement entre Poitras et Greenwald, qu’il est bien préférable parce qu’honorable de les mettre côte-à-côté sans trancher là où il n’y a rien à trancher, il reste que Poitras apparaît, par ses méthodes, ses extraordinaires connaissances en matière de sécurité informatique, son comportement vis-à-vis des moyens d’identification et de répression du Système, beaucoup plus comme une résistante au sens opérationnel du terme que Glenn Greenwald. Il s’agit bien là d’un constat à la fois opérationnel et technique, et nullement d’un jugement de valeur sur leurs psychologies et leur engagements réciproques.

L’extrait ci-dessous, qui met en scène aussi bien ces rapports entre Poitras et Greenwald, que la “base opérationnelle” de Greenwald à Rio-de-Janeiro, rend compte d’une situation insolite par un autre aspect. Cette “base”, l’habitation où Greenwald, qui est homosexuel, vit avec son compagnon, dans un environnement qui a toutes les allures d’une jungle, avec dix chiens dissipés et un chat philosophe, ressemble à une sorte de bohème qui serait aussi une installation rudimentaire de résistance. Il y a à la fois du hippy et du Paul Léautaud (pour l’esprit de la chose et les animaux) dans la description de ce chaos domestique, parcouru par les hordes d’animaux, avec Greenwald en T-shirt, devant son ordinateur, qui hurle par instant pour obtenir un peu de silence dans ce contexte jacassant. C’est pourtant là que s’élaborent la stratégie et la tactique de la plus formidable opération antiSystème jamais réalisée, mettant en jeu une technicité et des technologies d’une extraordinaire puissance et qui demande des capacités tout aussi extraordinaires. (Il y a dans cette description presque candide d'une sorte de clandestinité connue de tous et ainsi exposée à tous, le paradoxe fondamental de la lutte à ciel ouvert, et nécessairement à ciel ouvert pour bénéficier de l'apport de la communication, de l'antiSystème contre le Système.)
Dans la jungle, avec dix chiens et un chat
«Greenwald lives and works in a house surrounded by tropical foliage in a remote area of Rio de Janeiro. He shares the home with his Brazilian partner and their 10 dogs and one cat, and the place has the feel of a low-key fraternity that has been dropped down in the jungle. The kitchen clock is off by hours, but no one notices; dishes tend to pile up in the sink; the living room contains a table and a couch and a large TV, an Xbox console and a box of poker chips and not much else. The refrigerator is not always filled with fresh vegetables. A family of monkeys occasionally raids the banana trees in the backyard and engages in shrieking battles with the dogs.
»Greenwald does most of his work on a shaded porch, usually dressed in a T-shirt, surfer shorts and flip-flops. Over the four days I spent there, he was in perpetual motion, speaking on the phone in Portuguese and English, rushing out the door to be interviewed in the city below, answering calls and e-mails from people seeking information about Snowden, tweeting to his 225,000 followers (and conducting intense arguments with a number of them), then sitting down to write more N.S.A. articles for The Guardian, all while pleading with his dogs to stay quiet. During one especially fever-pitched moment, he hollered, “Shut up, everyone,” but they didn’t seem to care.
»Amid the chaos, Poitras, an intense-looking woman of 49, sat in a spare bedroom or at the table in the living room, working in concentrated silence in front of her multiple computers. Once in a while she would walk over to the porch to talk with Greenwald about the article he was working on, or he would sometimes stop what he was doing to look at the latest version of a new video she was editing about Snowden. They would talk intensely — Greenwald far louder and more rapid-fire than Poitras — and occasionally break out laughing at some shared joke or absurd memory. The Snowden story, they both said, was a battle they were waging together, a fight against powers of surveillance that they both believe are a threat to fundamental American liberties.
»Two reporters for The Guardian were in town to assist Greenwald, so some of our time was spent in the hotel where they were staying along Copacabana Beach, the toned Brazilians playing volleyball in the sand below lending the whole thing an added layer of surreality. Poitras has shared the byline on some of Greenwald’s articles, but for the most part she has preferred to stay in the background, letting him do the writing and talking. As a result, Greenwald is the one hailed as either a fearless defender of individual rights or a nefarious traitor, depending on your perspective. “I keep calling her the Keyser Soze of the story, because she’s at once completely invisible and yet ubiquitous,” Greenwald said, referring to the character in “The Usual Suspects” played by Kevin Spacey, a mastermind masquerading as a nobody. “She’s been at the center of all of this, and yet no one knows anything about her.”
»As dusk fell one evening, I followed Poitras and Greenwald to the newsroom of O Globo, one of the largest newspapers in Brazil. Greenwald had just published an article there detailing how the N.S.A. was spying on Brazilian phone calls and e-mails. The article caused a huge scandal in Brazil, as similar articles have done in other countries around the world, and Greenwald was a celebrity in the newsroom. The editor in chief pumped his hand and asked him to write a regular column; reporters took souvenir pictures with their cellphones. Poitras filmed some of this, then put her camera down and looked on. I noted that nobody was paying attention to her, that all eyes were on Greenwald, and she smiled. “That’s right,” she said. “That’s perfect.”»
L’apprentissage de résistante de Laura Poitras
Pour une cinéaste qui voyage beaucoup, l’existence de Laura Poitras depuis au moins 9/11 est un calvaire du point de vue de ses déplacements. Elle a été placée sur une “liste sélective” de suspects, juste en-dessous de la liste des personnes interdites de vol. (Un agent de sécurité compatissant lui a indiqué un jour : «You’re flagged. You have a threat score that is off the Richter scale. You are at 400 out of 400.») Elle a renoncé à tenir la comptabilité des occurrences où elle a été retenue pendant deux, trois heures, interrogée par des groupes musclés et obtus de la sécurité des aéroports US, avec son matériel saisi, interdiction de prendre des notes puisque un stylo est considéré comme une arme, etc., – mais le nombre de ces “incidents” dépasse au moins la quarantaine.
«“It’s a total violation,” Poitras said. “That’s how it feels. They are interested in information that pertains to the work I am doing that’s clearly private and privileged. It’s an intimidating situation when people with guns meet you when you get off an airplane.”
»Though she has written to members of Congress and has submitted Freedom of Information Act requests, Poitras has never received any explanation for why she was put on a watch list. “It’s infuriating that I have to speculate why,” she said. “When did that universe begin, that people are put on a list and are never told and are stopped for six years? I have no idea why they did it. It’s the complete suspension of due process.” She added: “I’ve been told nothing, I’ve been asked nothing, and I’ve done nothing. It’s like Kafka. Nobody ever tells you what the accusation is.”»
Au long de ces années d’“expérience”, Poitras a donc appris à prendre ses précautions. Avant un déplacement aérien, elle confie son ordinateur à un compagnon de voyage si compagnon compatissant et complice il y a, elle laisse ses notes chez des amis ou dans des consignes, elle débarrasse son matériel électronique de toute information de quelque intérêt que ce soit, ou bien les encrypte pour les rendre inaccessibles aux services de sécurité. Il faut compter qu’un voyage lui demande un à deux jours de préparation pour prendre toutes ces précautions. Ainsi est-elle devenue une exceptionnelle experte des mesures de sécurité, aussi bien dans le comportement que dans le maniement et l’usage du matériel informatique.
Contact avec Snowden
Cette expérience dans les matières de sécurité a conduit Poitras a tenir effectivement un rôle central dans les premiers contacts puis les relations avec Snowden. Ses propres relations avec Greenwald avaient été établies après que le journaliste US, alors à Salon.com, avait publié un article sur le harcèlement sécuritaire dont elle faisait l’objet dans les aéroports. Snowden avait lu cet article et savait que Poitras travaillait sur un documentaire, dernier d’une trilogie qu’elle réalise depuis 2007 (les deux premiers documentaires achevés et primés), et celui-là spécifiquement sur les programmes de surveillance du gouvernement, – dont la NSA au premier rang, certes. Après un premier contact infructueux avec Greenwald, Snowden décida de contacter Poitras
«In April [2013], Poitras e-mailed Greenwald to say they needed to speak face to face. Greenwald happened to be in the United States, speaking at a conference in a suburb of New York City, and the two met in the lobby of his hotel. “She was very cautious,” Greenwald recalled. “She insisted that I not take my cellphone, because of this ability the government has to remotely listen to cellphones even when they are turned off. She had printed off the e-mails, and I remember reading the e-mails and felt intuitively that this was real. The passion and thought behind what Snowden — who we didn’t know was Snowden at the time — was saying was palpable.”
»Greenwald installed encryption software and began communicating with the stranger. Their work was organized like an intelligence operation, with Poitras as the mastermind. “Operational security — she dictated all of that,” Greenwald said. “Which computers I used, how I communicated, how I safeguarded the information, where copies were kept, with whom they were kept, in which places. She has this complete expert level of understanding of how to do a story like this with total technical and operational safety. None of this would have happened with anything near the efficacy and impact it did, had she not been working with me in every sense and really taking the lead in coordinating most of it.”»
Rencontre d’un “freluquet de 29 ans”
 La rencontre de Snowden met en évidence deux choses : la globalisation de la résistance avec ces trois citoyens US se déplaçant dans tous les sens, se rencontrant finalement à Hong Kong après des échanges à partir de diverses parties du monde, et ensuite eux-mêmes évoluant dans des pays étrangers, intervenant dans des médias non-US, etc... Et aussi, toujours avec le cas de Snowden, la jeunesse de cette résistance globalisée, avec ce “freluquet de 29 ans” (rencontre avant son anniversaire) qui en paraît à peine 20, que Greenwald-Poitras découvrent avec stupeur comme une sorte d’adolescent attardé porteur de certains des secrets les plus lourds du Système. Ils s’attendaient à voir un personnage d’entre 40 et 60 ans, chargé d’ans et d’expérience...
La rencontre de Snowden met en évidence deux choses : la globalisation de la résistance avec ces trois citoyens US se déplaçant dans tous les sens, se rencontrant finalement à Hong Kong après des échanges à partir de diverses parties du monde, et ensuite eux-mêmes évoluant dans des pays étrangers, intervenant dans des médias non-US, etc... Et aussi, toujours avec le cas de Snowden, la jeunesse de cette résistance globalisée, avec ce “freluquet de 29 ans” (rencontre avant son anniversaire) qui en paraît à peine 20, que Greenwald-Poitras découvrent avec stupeur comme une sorte d’adolescent attardé porteur de certains des secrets les plus lourds du Système. Ils s’attendaient à voir un personnage d’entre 40 et 60 ans, chargé d’ans et d’expérience...
La rencontre, l’arrangement et les circonstances diverses font douter grandement de deux choses : 1) de la capacité du Système de paralyser la résistance en la parcellisant, en l’emprisonnant par des interventions de surveillance constantes sur les communications électroniques autant que physiques ; et 2) de l’argument de ceux qui jugent que le Système a suffisamment formaté les jeunes générations pour boucler tout notre avenir dans le “Goulag électronique global”... Assange, Manning, Snowden, – faites la moyenne d’âge des trois “whistleblower” les plus fameux et les plus efficaces de la Résistance, et concluez quelle généralisation l’on peut faire à propos de telle ou telle génération. (Ajoutez-y, si vous le voulez, l’enthousiasme extraordinaire soulevé chez les jeunes et les étudiants par la candidature de Ron Paul en 2012...) La jeunesse actuelle n’est pas plus vertueuse que les précédentes, mais elle n’est pas plus conditionnée non plus, – mais elle maîtrise suffisamment les techniques de communication pour envisager des coups tels que celui de Snowden.
«There, they were to wait until they saw a man carrying a Rubik’s Cube, then ask him when the restaurant would open. The man would answer their question, but then warn that the food was bad. When the man with the Rubik’s Cube arrived, it was Edward Snowden, who was 29 at the time but looked even younger. “Both of us almost fell over when we saw how young he was,” Poitras said, still sounding surprised. “I had no idea. I assumed I was dealing with somebody who was really high-level and therefore older. But I also knew from our back and forth that he was incredibly knowledgeable about computer systems, which put him younger in my mind. So I was thinking like 40s, somebody who really grew up on computers but who had to be at a higher level.” [...]
»“It’s an incredible emotional experience,” she said, “to be contacted by a complete stranger saying that he was going to risk his life to expose things the public should know. He was putting his life on the line and trusting me with that burden. My experience and relationship to that is something that I want to retain an emotional relation to.” Her connection to him and the material, she said, is what will guide her work. “I am sympathetic to what he sees as the horror of the world [and] what he imagines could come. I want to communicate that with as much resonance as possible. If I were to sit and do endless cable interviews — all those things alienate me from what I need to stay connected to. It’s not just a scoop. It’s someone’s life.”»
L’action antiSystème oblige à réviser le sens des “valeurs”
Ces diverses précisions sur ces deux personnages, sur les contacts établis avec Snowden, etc., nous introduisent dans un nouveau monde du journalisme, où le mot de “journalisme” n’a d’ailleurs plus grand sens, où il faut s’en garder comme de la peste pour ses connexions incestueuses avec le Système (presse-Système)... Nous y sommes, finalement : il ne s’agit pas de journalistes, ni de reporteurs, ou bien il nous fat changer le sens des mots. Dans cette époque où le système de la communication est devenu le champ de la principale bataille, et d’une bataille sans merci et sans exemple avec cette entité nommée Système, – cette entité constitutive sans aucun doute pour nous d’une intention délibérée de destruction du monde comme jamais aucune force historique n’en a manifesté l’intention, au point où il faut la mettre dans le champ métahistorique, – dans un tel monde et dans le champ de la communication, il n’y a plus ni journaliste ni reporteur ... Il y a des collaborateurs au sens de “collabos” (et l’on voit les “collabos” de qui il s’agit) et il y a des “résistants”.
Ainsi vivent-ils et agissent-ils comme des résistants, les Greenwald-Poitras & Cie. Ils sont toujours en mouvement, incroyablement sophistiqués dans leurs actions et la sécurité dont ils se protègent, mais sachant aussi bien dans un degré de sophistication dans la contre-sophistication, se priver de ceux des moyens de sophistication dont nous sommes prisonniers dans le chef du Système. (Cette attention systématique de Poitras de ne pas utiliser de téléphone portable, même fermé et verrouillé, parce que aisément repérable par GPS.) Ils se battent comme les plus expérimentés des terroristes de la G4G dans le sens le plus général (ici, celui de l’internet), eux-mêmes combattants de la G4G engagée contre le Système. Ils se déclarent d’ailleurs (Greenwald surtout dans des déclarations, Poitras plus discrète à cet égard, mais significative, elle, dans ses actes) comme des “journalistes” absolument non-objectifs selon le sens que le Système donne au concept d’“objectivité”, à son avantage et pour nous emprisonner dans la prison de ses “valeurs”... (On en verra plus loin là-dessus.)
Dans la citation ci-dessous, on trouve des considérations décisives quant à leur comportement, leur souplesse d’action par rapport aux médias dont ils dépendent (voir leur réaction devant les hésitations de Guardian à les suivre, – ce qui en dit tout autant sur le Guardian, qui finalement a suivi, et qui est finalement bien plus dépendant de Greenwald que Greenwald n’est dépendant de lui)
Scènes d’opérationnalisation de la Résistance
«Poitras and Greenwald are an especially dramatic example of what outsider reporting looks like in 2013. They do not work in a newsroom, and they personally want to be in control of what gets published and when. When The Guardian didn’t move as quickly as they wanted with the first article on Verizon, Greenwald discussed taking it elsewhere, sending an encrypted draft to a colleague at another publication. He also considered creating a Web site on which they would publish everything, which he planned to call NSADisclosures. In the end, The Guardian moved ahead with their articles. But Poitras and Greenwald have created their own publishing network as well, placing articles with other outlets in Germany and Brazil and planning more for the future. They have not shared the full set of documents with anyone. [...]
»Unlike many reporters at major news outlets, they do not attempt to maintain a facade of political indifference. Greenwald has been outspoken for years; on Twitter, he recently replied to one critic by writing: “You are a complete idiot. You know that, right?” His left political views, combined with his cutting style, have made him unloved among many in the political establishment. His work with Poitras has been castigated as advocacy that harms national security. “I read intelligence carefully,” said Senator Dianne Feinstein, chairwoman of the Senate Intelligence Committee, shortly after the first Snowden articles appeared. “I know that people are trying to get us. . . . This is the reason the F.B.I. now has 10,000 people doing intelligence on counterterrorism. . . . It’s to ferret this out before it happens. It’s called protecting America.”
»Poitras, while not nearly as confrontational as Greenwald, disagrees with the suggestion that their work amounts to advocacy by partisan reporters. “Yes, I have opinions,” she told me. “Do I think the surveillance state is out of control? Yes, I do. This is scary, and people should be scared. A shadow and secret government has grown and grown, all in the name of national security and without the oversight or national debate that one would think a democracy would have. It’s not advocacy. We have documents that substantiate it.”
»Poitras possesses a new skill set that is particularly vital — and far from the journalistic norm — in an era of pervasive government spying: she knows, as well as any computer-security expert, how to protect against surveillance. As Snowden mentioned, “In the wake of this year’s disclosure, it should be clear that unencrypted journalist-source communication is unforgivably reckless.” A new generation of sources, like Snowden or Pfc. Bradley Manning, has access to not just a few secrets but thousands of them, because of their ability to scrape classified networks. They do not necessarily live in and operate through the established Washington networks — Snowden was in Hawaii, and Manning sent hundreds of thousands of documents to WikiLeaks from a base in Iraq. And they share their secrets not with the largest media outlets or reporters but with the ones who share their political outlook and have the know-how to receive the leaks undetected.
»In our encrypted chat, Snowden explained why he went to Poitras with his secrets: “Laura and Glenn are among the few who reported fearlessly on controversial topics throughout this period, even in the face of withering personal criticism, [which] resulted in Laura specifically becoming targeted by the very programs involved in the recent disclosures. She had demonstrated the courage, personal experience and skill needed to handle what is probably the most dangerous assignment any journalist can be given — reporting on the secret misdeeds of the most powerful government in the world — making her an obvious choice.”»
L’objectivité de l’antiSystème
Comme on l’a lu ci-dessus, ces “journalistes” ne sont pas du type dont on louerait l’objectivité. Greenwald fait, de ce point de vue, l’objet de nombreuses attaques de ses confrères férus de la vertu d’“objectivité” selon les critères du Système. La question est de savoir ce que viennent faire précisément dans cette bataille suprême ces “valeurs”, dont la fameuse “objectivité” telle qu’elle est entendue en général fait partie, alors qu’on sait combien leur manifestation dans les règles et sous le contrôle du Système ne peut avoir comme effet que de rouler pour le Système. C’est qu’alors, pour bien comprendre la chose, il faut s’employer à redéfinir les concepts.
La définition de l’“objectivité” est multiple. Il est inutile de se compliquer la tâche, parce que nous sommes ici dans des situations simples. On retiendra, du Wikipédia, deux versions de la définition de l’objectivité. En philosophie, «[L’]on entend habituellement par objectivité d'un objet ce en quoi consiste la réalité de cet objet. [...] Entendue au sens métaphysique d’une réalité de l'objet, l'objectivité s'oppose soit à ce qui n'est qu'apparence, illusion, fiction... [...]
»Dans le domaine de l'information et du journalisme, l'objectivité est un idéal difficilement atteint par les contraintes extérieures (économie, argent, pression). De ce fait, la manière dont les informations sont traitées, mais aussi du choix des informations traitées et de l'importance relative qui leur est accordée dépend de l'indépendance et du savoir de la source. Il est outre difficile pour le journaliste, comme pour tout rédacteur, de s'abstraire d'un certain nombre d'influences liées à son milieu, son éducation, son pays d'origine, etc. Mais, le journaliste, en tant que professionnel, est dans le devoir de faire abstraction de toute contrainte extérieure, pour que l'information soit aussi proche que possible de la vérité.»
On observera que dans le deuxième cas (celui du journalisme), le mot “vérité” est employé, alors que le mot “réalité” est utilisé dans l’extrait de la conception philosophique et métaphysique. La situation que nous envisageons implique que le mot “vérité” doit être impérativement utilisé dans le cas métaphysique, au détriment du mot “réalité”, qui doit être rejeté. En effet, dans tous ces cas, l’“objet“ de l’observation et de la réflexion (métaphysique) ou de l’information (journalisme) n’est pas autre chose que le Système qui est l’objet-absolu par définition dans notre époque, et le seul objet digne d’observation, et qui représente une vérité ultime dans le sens le plus bas, le plus maléfique possible, comme représentation du Mal. Cet “objet”, qui est bien entendu l’ennemi totalitaire de la vérité, représente donc et paradoxalement une vérité lorsqu’il est justement identifié, et lui-même étant la démonstration du contraire de ce qu’il entend nous faire penser en refusant absolument la vérité. (Il nous démontre par son existence même que la vérité existe, qui est son aspect maléfique absolu, alors que sa production veut nous imposer absolument l’inexistence de la vérité.) Devant la simplicité et l’évidence de cette situation qui dicte la voie de la vérité (de l’“objectivité” dans ce cas), il ne saurait être question d’autre chose que de se battre par tous les moyens possibles et avec toute l’habileté possible contre lui, – et le meilleur de ces moyens étant de retourner contre lui sa propre force (Sun Yi), ce qu’ils (nos résistants en question) font avec un art consommé...
L’argument dérisoire de l’absence d’“objectivité” par absence de respect des règles de la définition habituelle du mot selon des valeurs que le Système instrumente à son avantage ne mérite même pas un instant d’attention, y compris pour sa réfutation. Mais l’“objectivité” telle que nous l’avons re-définie dans ce cas n’est pas non plus ni engagement, ni choix partisan ou idéologique selon les références classiques des batailles intraSystème ; elle est l’évidence de l’acte à accomplir, de la bataille antiSystème. Par conséquent, Greenwald et Poitras, lorsqu’ils luttent, résistant offensivement contre le Système comme ils font, représentent la vertu même de l’objectivité en tant que mise à nu de la vérité, de la nature absolument perverse et maléfique du Système. Cet acte n’est même pas volontaire ni calculé, ni nécessairement conscient, il est naturel, il les dépasse littéralement, montrant ainsi combien la Résistance est une activité qui correspond à la nature impérative des choses et du monde, avec les affrontements impératifs qui vont avec, dans cette époque de crise catastrophique et d’effondrement du Système.
L’énigme du Système
La fin de l’article nous dévoile encore plus combien ces deux aventuriers de cette sorte si spécifique de la G4G antiSystème acquièrent la conscience qu'il y a une énigme au bout de leur mission telle que nous avons tenté de la décrire. Dans leurs dernières réflexions, chez eux qui, à l’instar de Snowden, ont sacrifié le reste de leur vie selon des normes de tranquillité et de stabilité, on trouve en effet une volonté de la recherche de la compréhension de l’abysse insondable qu’est le Système. Greenwald-Poitras ont la sensation effectivement de se trouver devant un mystère qu’il tentent de déchiffrer ; point d’affirmations, comme si souvent chez nos chroniqueurs ainsi assez éloignés du véritable esprit de la Résistance, sur les divers “complots“ en cours, sur les élites qui nous manipulent depuis un ou deux millénaires, sur la rationalité planificatrice de ceux qui nous dirigent, sur leurs manigances arrangés depuis si longtemps et avec une telle maestria.
Au contraire, chez eux le respect de la vérité qui reste encore à trouver devant ce monstre qui est à première vue incompréhensible dans sa démarche de déconstruction et de dissolution... Greenwald-Poitras ont la sensation de détenir une clef du mystère, mais ils ne prétendent pas pour autant comprendre ce mystère ; il leur faudrait ouvrir la porte, et peut-être qu’une seule clef ne suffirait pas, et ils ne prétendent pas savoir ce qu’il y a derrière la porte avant de l’avoir ouverte, s'ils y parviennent. On sent qu’il y a chez eux l’intuition qu’il se pourrait bien que les explications humaines soient insuffisantes. La Résistance bronze les âmes.
Pour le reste, les deux sont comme celui avec qui ils ont sorti cet énorme crise Snowden/NSA. Comme Snowden, ils ont accepté de bouleverser leurs vies.
«Poitras smiled [...] She is not as expansive or carefree as Greenwald, which adds to their odd-couple chemistry. She is concerned about their physical safety. She is also, of course, worried about surveillance. “Geolocation is the thing,” she said. “I want to keep as much off the grid as I can. I’m not going to make it easy for them. If they want to follow me, they are going to have to do that. I am not going to ping into any G.P.S. My location matters to me. It matters to me in a new way that I didn’t feel before.”
»There are lots of people angry with them and lots of governments, as well as private entities, that would not mind taking possession of the thousands of N.S.A. documents they still control. They have published only a handful — a top-secret, headline-grabbing, Congressional-hearing-inciting handful — and seem unlikely to publish everything, in the style of WikiLeaks. They are holding onto more secrets than they are exposing, at least for now. “We have this window into this world, and we’re still trying to understand it,” Poitras said in one of our last conversations. “We’re not trying to keep it a secret, but piece the puzzle together. That’s a project that is going to take time. Our intention is to release what’s in the public interest but also to try to get a handle on what this world is, and then try to communicate that.”
»The deepest paradox, of course, is that their effort to understand and expose government surveillance may have condemned them to a lifetime of it. “Our lives will never be the same,” Poitras said. “I don’t know if I’ll ever be able to live someplace and feel like I have my privacy. That might be just completely gone.”»
La légitimité de la Résistance
Ce long article vaut bien des analyses rationnelles des experts, y compris et particulièrement ceux qui se croient critiques du Système. Par leur parcours, les résistants Greenwald-Poitras alimentent pour nous un certain nombre d’hypothèses que nous avons toujours favorisées.
• Le Système est à la fois d’une puissance extraordinaire et d’un aveuglement à mesure, suivant par ce moyen l’équation surpuissance autodestruction. Sa surveillance est de chaque instant, mais elle s’exerce dans le vide, sans savoir pourquoi elle existe ni ce qu’elle cherche, avec une sorte d’aveuglement massif, presque obèse et certainement obscène, sans se soucier des effets et des dégâts, y compris pervers et contre-productifs. La bêtise du Système est une sorte de chef d’œuvre du domaine. Sa kolossal surveillance alerte celui qui est l’objet de cette surveillance si cette surveillance est justifiée dans son chef, ou bien elle le radicalise dans la résistance si cette surveillance n’est pas justifiée dans son chef. On peut dire que c’est le harcèlement automatisé du Système (Poitras est sur telle liste, Poitras est soumise au même traitement à chaque débarquement sur un aéroport US) qui a aguerri Poitras, qui l’a préparée à effectuer l’opération la plus délicate d’établir le contact avec Snowden, puis l’exploitation de ce contact, – en même temps que la contrainte qui lui était imposée formait sa psychologie à alimenter dans son esprit une philosophie de résistance antiSystème implacable.
• La G4G, puisqu’on peut utiliser cette formule en l’occurrence, est une méthode universelle ... On voit dans ce cas l’adaptation d’acteurs du drame à l’origine éminemment occidentalisés, sinon américanisés du bloc BAO, à une technique guerrière qui réfute la logique du Système dominant le bloc BAO. Cette adaptation favorise notamment l’exploitation de tous les attributs de la puissance du Système, pour sélectionner ceux qui lui sont favorables et les utiliser à son avantage, et pour sortir du contexte où évoluent ceux qui lui sont défavorables et retrouver des techniques surannées mais invisibles au monstre. La “guerrière” G4G Poitras est devenue une artiste incomparable de l’encryptage d’une part, mais elle se garde bien de transporter un téléphone portable et elle communique de la main à la main les email importants tirés sur papier plutôt que les expédier tels quels à Greenwald. La Résistance s’adapte d’instinct, sinon d’intuition et dans tous les cas d’expérience, à l’orientation qu’il faut donner à l’utilisation de tout ce technologisme qu’elle combat au fond, jusqu’à une utilisation qui est l’inversion même du technologisme ; elle fait de même avec la communication, dont elle use également de façons radicalement opposée selon les circonstances, toujours avec la même capacité d’adaptation. La résistance antiSystème réduit les deux piliers du Système à des outils dont il est si aisé de comprendre qu’on peut en obtenir ce qui importe si l’on est parvenu à donner un sens à l’action qu’on a entreprise.
• La tactique principale de l’antiSystème est nécessairement d’utiliser la force du Système contre le Système (Sun Tzu), ou de retourner la force du Système contre le Système. (Le 2 juillet 2012 : «L’opérationnalité de la résistance antiSystème se concentre naturellement dans l’application du principe fameux, et lui-même naturel, de l’art martial japonais aïkido : “retourner la force de l'ennemi contre lui...”, – et même, plus encore pour notre cas, “aider la force de cet ennemi à se retourner naturellement contre lui-même”, parce qu’il est entendu, selon le principe d’autodestruction, qu’il s’agit d’un mouvement “naturel”.») Le résultat est cet effet colossal, – en langage normal, dans ce cas, – de trois individus aussi insaisissables que des anguilles bien qu’ils évoluent en pleine lumière, qui tiennent dans leurs mains la formule à peine secrète d’un bouleversement à l’échelle de la toute-puissance du Système, et disposent d’assez d’énergie intelligente pour déclencher la dynamique qui va susciter ce bouleversement. Il ne s’agit pas de développer une force considérable et nécessairement aveugle, comme fait le Système, mais simplement de faire pression sur les quelques points vitaux ici et là, d’utiliser avec clairvoyance et régularité les documents disponibles (combien ? Trente, quarante déjà publiés sur des milliers qui attendent comme une énorme épée de Damoclès postmoderne), comme une cascade diluvienne mais contrôlée, d’ainsi obtenir par ces piqûres successives un effet de contrainte psychologique sur le monstre qui tonne, enrage, éclate de fureur aveugle, expose sa monstrueuse impuissance, jusqu’à des effets de rupture enchaînant les conséquences de sa propre déstabilisation.
La Résistance connaît bien son Gulliver. Elle ne l’enchaîne pas, certes pas, elle lui donne au contraire toutes les occasions possibles de se déchaîner et de montrer son vrai visage en brisant tout, en se découvrant dans toute sa fureur nihiliste. Le reste suit, comme un tricot se défait, en se détricotant par conséquent. Il y a, perceptibles dans l’article sur la fin, des moments de joyeuse complicité et même d’ironie jubilante entre Poitras et Greenwald. Ils sont, avec le freluquet-Snowden et d’autres compagnons de la même eau, des résistants qui devinent, s’ils ne le savent, qu’ils ont de leur côté le puissant adoubement de quelques principes fondamentaux. Ils sont légitimes. Salut aux héros de notre temps postmodernes, qui sauvegardent pour l’avenir le cimier principiel qui est nécessaire pour que ce qu’on nomme une civilisation le soit vraiment, et non l'imposture qui nous est offerte présentement.
00:08 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : résistance, anti-system, anti-système, laura poitras, edward snowden, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 27 août 2013
70. Geburtstag Panajotis Kondylis

70. Geburtstag Panajotis Kondylis
Ex; http://www.sezession.de
(Text aus dem Band Vordenker [2] des Staatspolitischen Handbuchs, Schnellroda 2012.)
von Adolph Przybyszewski
Der Philosoph Panajotis Kondylis hinterließ ein umfangreiches, gleichwohl Fragment gebliebenes Werk: Ein überraschender Tod riß ihn, nachdem er zahlreiche gewichtige Monographien, Übersetzungen und Aufsätze vorgelegt hatte, mitten aus der Arbeit an einem auf drei Bände geplanten Opus magnum.
Der Außenseiter des akademischen Betriebs ist zwar längst in der Fachwelt anerkannt, wird im intellektuellen Establishment aber noch immer als »Geheimtip« gehandelt. Ein Grund dafür liegt in der Kühnheit und Souveränität des analytischen Zugriffs von Kondylis: Seine Denkhaltung kennzeichnete er selbst als »deskriptiven Dezisionismus«, der jegliches Wertesystem als Funktion menschlichen Machtwillens mit tiefer Skepsis betrachtet, andererseits wissenschaftlich objektiver Erkenntnis mit großem Pathos verpflichtet ist. Seine Werke enthalten sich folglich ahistorischer normativer Urteile, um die Tugend des kalten, illusionslosen Blickes zu schulen.
Der Sohn eines Berufsoffiziers und einer Lehrerin war Sproß einer griechischen Oberschichtfamilie, zu der u. a. der 1936 gestorbene General und zeitweilige Minister Georgios Kondylis zählte. In Athen, wo er auch die Schule besucht hatte, studierte Panajotis Kondylis Philosophie und Klassische Philologie, absolvierte überdies noch vor Abschluß des Studiums seinen Militärdienst. Nach dem »Putsch der Obristen« im Jahr 1967 geriet er wegen seiner Befassung mit Marx und Engels in Verdacht, wurde aber nicht behelligt und konnte 1971 nach Deutschland gehen, um in Frankfurt am Main, vor allem aber in Heidelberg Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaften zu studieren. Gefördert wurde er dort von den kriegsgedienten Historikern Reinhart Koselleck und Werner Conze, promovierte jedoch 1977 bei Dieter Henrich als Philosoph.
Kondylis blieb als Autor, Leser und Mann des Gesprächs zeit seines Lebens Privatgelehrter, der in Athen wie in Heidelberg zu Hause war. Sein Hauptwerk schrieb der polyglotte Grieche auf deutsch, da er dieser Sprache eine dem Altgriechischen ähnliche begriffliche, grammatische und damit philosophische Potenz zumaß. Kondylis’ Denken geht aus von einer sozialhistorisch gesättigten Ideengeschichte, die zu systematischen philosophischen Einsichten destilliert und damit theoretisch fundiert wird. Seine Fragment gebliebenen »Gründzüge der Sozialontologie « (Das Politische und der Mensch, 1999) verstehen den Menschen als ein soziales Wesen von Grund auf. Seinsgeschichte hat Kondylis zufolge nicht beim Menschen als einzelnem anzusetzen, so seine Kritik an Heidegger, sondern beim agonalen Sozialwesen, das stets zwischen Konflikt, Konkurrenz und Kooperation ausgespannt ist.
In Macht und Entscheidung (1984) legt er dar, daß Identität auf vorbewußten Grundentscheidungen fußt; indem sich der Machtanspruch der »eigenen Identität innerhalb des mit ihr verwachsenen Weltbildes« entfaltet, sind geistige Operationen nicht weniger als handfeste Handlungen immerauch Funktionen des menschlichen Selbsterhaltungstriebs und daher stets polemisch angelegt. Das Ringen um die Köpfe ist elementarer Bestandteil des Kampfes um die eigene Stellung in der Welt.
 Beispielhaft entfaltet wird dies schon in Kondylis’ Dissertation über Die Entstehung der Dialektik (1979) bei Hölderlin, Schelling und Hegel und der damit zusammenhängenden Studie über Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus (1981), wo er zeigt, »wie sich ein systematisches Denken als Rationalisierung einer Grundhaltung und -entscheidung allmählich herauskristallisiert, und zwar im Bestreben, Gegenpositionen argumentativ zu besiegen«. Die Ausformung jener Dialektik, wie sie nach Hegel im Marxismus Ideologie einer weltgeschichtlich wirksamen Macht wurde, erweist sich als Teil eines konfliktreichen, schon im Spätmittelalter einsetzenden Prozesses der Ablösung von Weltbildern, in dem die formal-begrifflichen Strukturen der jeweils älteren Metaphysik stillschweigend übernommen und polemisch umgedeutet werden.
Beispielhaft entfaltet wird dies schon in Kondylis’ Dissertation über Die Entstehung der Dialektik (1979) bei Hölderlin, Schelling und Hegel und der damit zusammenhängenden Studie über Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus (1981), wo er zeigt, »wie sich ein systematisches Denken als Rationalisierung einer Grundhaltung und -entscheidung allmählich herauskristallisiert, und zwar im Bestreben, Gegenpositionen argumentativ zu besiegen«. Die Ausformung jener Dialektik, wie sie nach Hegel im Marxismus Ideologie einer weltgeschichtlich wirksamen Macht wurde, erweist sich als Teil eines konfliktreichen, schon im Spätmittelalter einsetzenden Prozesses der Ablösung von Weltbildern, in dem die formal-begrifflichen Strukturen der jeweils älteren Metaphysik stillschweigend übernommen und polemisch umgedeutet werden.
Kondylis’ Interesse galt daher einerseits solchen Denkfiguren, andererseits auch den konkreten Menschen und Schichten, die damit operieren. In diesem Sinne beschrieb und analysierte er die Formierung und Entwicklung der europäischen »Neuzeit« in seiner Studie über den Konservativismus (1986) und den Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform (1991), um schließlich konsequent mit der im 20. Jahrhundert etablierten nachbürgerlichen Massendemokratie auch die aktuellen Formen der Globalisierung in den Blick zu nehmen. Bereits Kondylis’ Deutung von Clausewitzens Theorie des Krieges (1988), deren Aneignung und Fortführung insbesondere in der Marxschen Tradition er untersuchte, belegt, daß er seine geistesgeschichtliche Arbeit nicht nur zur Fundierung einer Philosophie des Menschen als Sozialwesen betrieb: Sie läßt ihn als genuin politischen Denker erkennen, der sich vor allem Thukydides, Machiavelli, Thomas Hobbes, Carl Schmitt und Raymond Aron verpflichtet weiß.
Als besondere analytische Leistung von Lenins Clausewitz-Verständnis betont er etwa, daß diesem »die Politik nicht als das mäßigende Element erscheint, das den Krieg bändigen soll, sondern als ein Zustand permanenten Kampfes, woraus von Zeit zu Zeit Kriege entstehen müssen. Die Vorstellung vom Kampf steht im Mittelpunkt von Lenins politischem Denken «. Mit Clausewitz mißt Kondylis dem »Takt des Urteils« größte Bedeutung für jede angemessene »zukunftsorientierte Lagebeschreibung« zu: Dieser ist nicht als Metapher für Intuition, sondern als eine aus Erfahrung und Wissen gespeiste intellektuelle Urteilsfähigkeit zu verstehen. Dem entspricht Kondylis’ gesamtes Werk: Seine systematische und große Materialmassen bewältigende Durchdringung der Geschichte stellt das Rüstzeug bereit, die gegenwärtige Lage und das Potential künftiger Lageentwicklungen zu beurteilen. Frucht dieses politischen Denkens sind Kondylis’ zu einem Band zusammengefaßte Aufsätze über Das Politische im 20. Jahrhundert (2001), besonders aber seine Studie über die »Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg«. Hier wird eine Zukunft »als Form und Möglichkeit, nicht als Inhalt und Ereignis erkennbar«, in der globalisierte Verteilungskämpfe »das erschütterndste und tragischste Zeitalter in der Geschichte der Menschheit« jenseits aller Utopien erwarten lassen.
Schriften: Die Entstehung der Dialektik. Eine Analyse der geistigen Entwicklung von Hölderlin, Schelling und Hegel bis 1802, Stuttgart 1979; Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus, Stuttgart 1981; Macht und Entscheidung. Die Herausbildung der Weltbilder und die Wertfrage, Stuttgart 1984; Konservativismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang, Stuttgart 1986; Marx und die griechische Antike. Zwei Studien, Heidelberg 1987; Theorie des Krieges. Clausewitz – Marx – Engels – Lenin, Stuttgart 1988; Die neuzeitliche Metaphysikkritik, Stuttgart 1990; Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform. Die liberale Moderne und die massendemokratische Postmoderne, Weinheim 1991; Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg, Berlin 1992; Montesquieu und der Geist der Gesetze, Berlin 1996; Das Politische und der Mensch. Grundzüge der Sozialontologie, Bd. 1: Soziale Beziehung, Verstehen, Rationalität, aus dem Nachlaß hrsg. v. Falk Horst, Berlin 1999; Das Politische im 20. Jahrhundert. Von den Utopien zur Globalisierung, Heidelberg 2001; Machtfragen. Ausgewählte Beiträge zu Politik und Gesellschaft, Darmstadt 2006; Machiavelli, Berlin 2007.
Literatur: Jeroen Buve: Macht und Sein. Metaphysik als Kritik oder die Grenzen des Kondylischen Skepsis, Cuxhaven 1991; Falk Horst (Hrsg.): Panajotis Kondylis. Aufklärer ohne Mission, Berlin 2007; Adolph Przybyszewski: Autorenportrait Panajotis Kondylis, in: Sezession (2006), Heft 12.
Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de
URL to article: http://www.sezession.de/40287/70-geburtstag-panajotis-kondylis.html
URLs in this post:
[1] Image: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2013/02/9783935063562.jpg
[2] Vordenker: http://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/staatspolitisches-handbuch/33/staatspolitisches-handbuch-band-3-vordenker
00:05 Publié dans Hommages, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : panayotis kondylis, philosophie, grèce, philosophie politique, politologie, théorie politique, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 août 2013
Montaigne et l’indifférence active

Montaigne et l’indifférence active
par Claude BOURRINET
1) Dans les Essais, le discours n’est nullement l’enregistrement d’une existence mais le monologue d’une conscience qui se voit agir, qui s’accepte agissante sans pour cela paraître trop indulgente ni sans omettre de relever ce qui est digne d’être pris comme modèle. Il est donc tentant de soupçonner a priori une mauvaise foi latente dans tout ce qui est avoué, et d’autant plus que c’est avoué. Les relations qui existent entre Montaigne et son œuvre sont d’ordre dialectique. Dialogue socratique entre un homme qui voudrait être, sans plus (mais tâche ô combien ardue !) et une excroissance de cette essence problématique, monstrueuse (dans le sens du XVIe siècle) et inquisitrice, dont la tâche est d’établir un bilan sans concession et de ne cesser de rappeler qu’il est nécessaire d’accepter, pour être. De boire la coupe jusqu’à la lie. Une manière de conscience assumée, en quelque sorte, superlative, alternant entre lucidité aiguë et impératif pratique.
2) Le discours des Essais a ceci de singulier qu’il se détruit lui-même en avouant son incapacité à réformer la vie. C’est un anti-discours, comme celui des pyrrhoniens. Impression de n’en jamais tenir le bout, de perpétuel enlisement. Sa véritable sagesse, c’est l’absence de sagesse.
3) De vouloir trop appréhender l’homme Montaigne, malgré le prologue des Essais, c’est renouveler l’illusion réaliste dans l’art pictural.
4) Quand on lit et apprécie les Essais, on se sent délivré de tout scrupule à se réconcilier avec les mille travers de l’humaine condition, tellement ils nous semblent devenus naturels, mais aussi innocents, et l’un parce que l’autre (ce que rend bien le terme « naïf »). À vrai dire, il peut paraître excessif de prétendre cela. Mais ces travers ne sont ni mauvais, ni bons : ils sont ce que la nature et nous-mêmes les faisons, ce qui laisse une substantielle amplitude à la Fortune et à la volonté.
5) Inutilité des Essais en période vertueuse. Les cannibales en auraient-ils besoin ? Les Essais n’existent que parce que le siècle est corrompu.
6) Il faut prendre garde que Montaigne se veut hautement, ou bassement (au sens de basse continue) philosophe : « La moyenne région loge les tempestes, les deux extrêmes, des hommes philosophes et des hommes ruraus, concurrent en tranquillité et au bon heur ».
7) C’est à cette époque que les derniers feux de l’idée de croisade s’éteignent.
8 – L’intériorisation et la spiritualisation du sentiment de l’honneur tendent à remplacer son ostentation, même dans la dévotion. François de Salles fondera l’humble, l’orgueil de n’être que commun.
9) Montaigne change parfois de chaussures, mais c’est toujours pour aller sur la même voie et dans la même direction.
10) Écrire et publier sont deux fonctions qui appartiennent à des individus différents. Publier est affaire de vanité, de mensonge, de sincérité, de dévoilement, de témoignage, de générosité, d’égoïsme, d’intérêt bien compris, que sais-je encore ? Mais écrire est affaire d’être.
11) Le discours de Montaigne (pensée appuyée sur des expériences) n’est pas discours rationnel : « La plus part des instructions de la science à nous encourager ont plus de montre que de force, et plus d’ornement que de fruict (La Pléiade, p. 1026) ».
12) Dans les Essais, on ne trouve pas tout de la doctrine chrétienne, mais tout ce qu’on y trouve, on eût pu l’y chercher.
13) L’indifférence est un idéal asymptotique.
14) Il se peut que Montaigne ne se soit pas définitivement « corrigé », mais au moins s’est-il progressivement découvert, non abstraitement, mais dans sa chair, ce qui n’a pas été sans efforts et sans sacrifices. Il est tragique sans pathos.
15) Sacrifice du « vieil homme ». Se connaître, c’est connaître ce que Dieu a daigné que l’on soit. Loin d’être « impersonnel », le Montaigne « stoïcien » était résolument individualiste. Élaguer le moi de cette protubérance vaniteuse et ostentatoire, c’est redevenir véritablement « impersonnel », enfant de Dieu et de Fortune. Et là est atteinte la véritable personne.
16) La sagesse de Montaigne n’existe pas a priori, elle est Expérience, elle est Leçon, que l’on reçoit et donne. La sagesse est apprentissage.
17) Le siècle devient « comme un autre passé (La Pléiade, p. 1081) ». Il n’est plus ce présent indigne du passé : il devient une deuxième Antiquité. Passé, présent, futur sont identiques.
18) Montaigne n’est ni stoïcien, ni épicurien, ni pyrrhonien, ni quoi que ce soit de ce que la Grèce et Rome ont légué, mais un peu de tout cela. Il est avant tout Montaigne. Et, au demeurant, devrions-nous le classer à tout prix, il nous faudrait l’intégrer à cette longue lignée de philosophes chrétiens qui, jusqu’à l’humanisme dévot en train de naître, s’est évertué de replacer l’homme à sa juste place sans l’écraser.
19) Nous sommes si éloignés de la vie et de nous-mêmes que la redécouverte qu’en fait Montaigne nous semble une nouveauté miraculeuse.
20) Le Livre III des Essais, et surtout les derniers chapitres, sont parmi les expressions les plus pures du mysticisme baroque.
21) Il faut se garder de croire naïvement, malgré certains passages des Essais, que Montaigne préconise une vie médiocre, sans s’apercevoir en quoi cet idéal est utopique pour un homme tel que lui. Ces « ruraus », ce sont les cannibales de son terroir. Bien sûr, ils « vivent », et la bête elle-même manifeste pleinement la puissance d’être. Mais vivre, est-ce « exister » ? Avoir conscience de vivre, n’est-ce point doublement vivre ?
22) Les Essais sont une conquête personnelle du présent, du siècle et de l’instant. De la présence.
23) On ne peut parfois s’empêche de penser qu’il y a du « fumeur de haschisch, chez Montaigne. Moins l’orgueil.
24) En grand danger de nihilisme ? Dans un passage de l’Apologie de Raymond Sebond, il est dit en substance qu’il est dangereux de s’aventurer plus avant. Tzara : « Les réactions des individus contaminés par la destruction, sont assez violentes, mais ces réactions, épuisées, annihilées par l’insistance satanique d’un à quoi bon continuel et progressif, ce qui reste et domine est l’indifférence. »
25) L’indifférence active est la suprême conscience.
26) Ce même mouvement qui porte l’intérêt de Montaigne pour le passé et le présent a pour aboutissement la réconciliation et comme moyen la rupture. Il procède de la redécouverte émerveillée d’un monde que l’on croyait connaître.
27) Montaigne cherche à reconstituer un Nomos afin que, quelque combat qu’il mène, il se trouve toujours en situation de préserver les remparts de son être. Mais ces murailles, c’est le monde. Nomos équivaut à Kosmos.
28) Montaigne a eu besoin de son livre pour se réconcilier. La béance se sera élargie chez Cervantès, et la sagesse devra s’accorder avec la folie.
29) Il ne faut pas tomber dans le piège des justifications prétendument « sincères » de Montaigne, à propos des raisons qui l’ont poussé à écrire. Il n’est rien de plus renard que la sincérité. La littérature est mauvaise foi. Il faut douter de toute affirmation péremptoire de l’auteur. Écrit-il pour ses proches ? Par originalité ? Sait-on vraiment pourquoi il écrit ? Sait-on pourquoi l’on écrit ? Les Essais sont entre autre la cristallisation d’impératifs qu’il se donne, moraux ou non, et qu’il ne suit pas toujours. Ils sont comme un miroir, mais un miroir déformé et déformant, renvoyant une image redressée du monde et de lui-même, du moins ce que Montaigne se veut être en se surprenant. S’il y a sincérité, elle est dans la relation courageuse qu’il établit avec son livre, c’est-à-dire avec sa conscience.
30) Tout ce qu’il dit à propos des Essais n’est pas faux, mais dans le sens qu’il donne aux termes « mensonge » et « vérité », qui sont des modalités justifiées de l’être et de sa puissance.
31) Car si l’on s’en tient uniquement, et docilement, à ce qu’il dit de lui-même et de son œuvre, on risque d’être désabusé : il n’existe pas de livre, ni d’individu, de son aveu même, qui ne soient aussi farcis de contradictions, constat qui authentifie sa vérité, plus sûrement que toute démonstration.
32) On s’est souvent arrêté à la nonchalance de Montaigne, et on a trop négligé ce qu’elle supposait de luttes dramatiques, pas toujours victorieuses.
33) La « diversion » est-elle encore fiable dès lors que l’on s’attache volontairement à la mettre en pratique ? Il subsiste toujours un Montaigne rebelle aux effets de l’indifférence totale, un Montaigne, non certes angoissé, mais inquiet et roide, non point à cause d’une trop grande soif de lucidité, mais de cette lucidité même, d’une tension trop aiguë vers la réalisation de l’être.
34) La « lucidité » de Montaigne provient non d’un détachement radical du monde, mais d’une adhésion à sa nature profonde, à sa nécessité, fût-elle à fleur de peau.
35) L’ignorance consiste à concéder de la substance à la perception phénoménale du monde. La docte ignorance est de s’accommoder de cette substance, et d’avoir la sagesse d’en jouir.
Claude Bourrinet
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=3164
00:05 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montaigne, philosophie, 16ème siècle, lettres, littérature, littérature française, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 22 août 2013
Castoriadis : un penseur de notre temps

Pierre Le Vigan
Ex: http://metamag.fr
00:05 Publié dans Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : castoriadis, philosophie, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 juillet 2013
Stotternder Magus
Vor 225 Jahren gestorben: Königsberger Philosoph J. G. Hamann
 Königsberg war im 18. Jahrhundert deutsche Hauptstadt der Philosophie. Nicht nur Kant lebte und wirkte hier, sondern auch sein Antipode Johann Georg Hamann. Während der Aufklärer Kant die reine Vernunft lehrte, verurteilte Hamann diese Lehre als gewalttätig und despotisch und predigte stattdessen die Reinheit des Herzens.
Königsberg war im 18. Jahrhundert deutsche Hauptstadt der Philosophie. Nicht nur Kant lebte und wirkte hier, sondern auch sein Antipode Johann Georg Hamann. Während der Aufklärer Kant die reine Vernunft lehrte, verurteilte Hamann diese Lehre als gewalttätig und despotisch und predigte stattdessen die Reinheit des Herzens.
Gab es da etwa Anzeichen von Revierkämpfen? Wohl kaum. Königsberg war groß genug, um beide Denker zu verkraften, und Hamann ein zu kleines Licht, um Kant Konkurrenz zu bieten. Im Gegenteil, Kant verhalf dem mittelosen Kollegen 1767 zu einer Stelle im preußischen Staatsdienst bei der Königsberger Provinzal-Akzise und Zolldirektion. Was wie eine Strafversetzung erscheint, war für Hamann ein Glück, denn weil der am 27. August 1730 als Sohn eines Königsberger Baders und Wundarztes Geborene die Universität ohne jeden Abschluss verließ, hatte er nie – wie Kant – einen Anspruch auf einen Lehrstuhl. Im Gegensatz zu Kant war er Hobbyphilosoph, der aber dennoch von seinen Zeitgenossen wahrgenommen wurde. Goethe, der während seiner Studienzeit in Straßburg von Herder auf Hamann aufmerksam gemacht wurde, bekannte, dass ihm dessen geistige Gegenwart „immer nahe gewesen“ sei.
Für diese Anerkennung musste Hamann hart kämpfen. Nach seinem – vergeblichen – Studium der Theologie und Jurisprudenz schlug er sich als Hauslehrer im baltischen Raum durch, machte danach einige journalistische Versuche, ehe er auf Geheiß einer befreundeten Kaufmannsfamilie mit einem handelspolitischen Auftrag nach London reiste. Hier hatte der Lutheraner sein religiöses Erweckungserlebnis, indem er intensiv die Bibel studierte. Es war ein „Schlüssel zu meinem Herzen“, schrieb er.
Zurück in Königsberg blieb Hamann ein „Liebhaber der langen Weile“, von der er im Zollamt offenbar ausgiebig Gebrauch machte. Während der Dienststunden bewältigte er ein Lektürepensum, das ihn zu einem der letzten universal belesenen Polyhistoren reifen ließ. Seine Reflexionen über das Gelesene legte er in Gelegenheitsschriften und Briefen nieder, deren dunkler Redesinn oft schwer nachvollziehbar ist. Im Zentrum seines Denkens steht dabei das Verhältnis von Vernunft und Sprache. Da die menschliche Sprache mit Makeln behaftet sei, könne man mit ihrer Hilfe niemals zur höchsten Vernunft kommen. Das sokratische Nichtwissen blieb Hamanns letztes Wort.
Wer sich hier als Sprachphilosoph betätigte, hatte selbst einen Sprechfehler: Hamann stotterte sein Leben lang. So glaubte er einzig an das göttliche Wort, den Logos der Natur, in dem sich Gott offenbare. Den Stürmern und Drängern um Goethe kamen solche Gedanken gerade recht, wollten sie doch den Genie-Begriff der Aufklärer vom Sockel stoßen. Da sich Hamann bei seiner bibelfesten Argumentation wie die drei Magi aus dem Morgenland auf der Suche nach Christus begab, verlieh ihm der Darmstädter Geheimrat von Moser den ironischen Titel „Magus im Norden“.
Tatsächlich war Hamann nicht nur Wegweiser für den Sturm und Drang, sondern später auch für Philosophen wie Schelling und Kierkegaard oder Autoren wie Ernst Jünger. Einer seiner Bewunderer war auch der westfälische Landedelmann Franz Kaspar von Buchholtz, der Hamann, seine uneheliche Frau – eine Magd – und seine vier Kindern mit 4000 Reichstalern aus dem Fron beim Zollamt erlöste und ihn 1787 ins katholische Münster lotste. Nur ein Jahr später starb Hamann dort am 21. Juni 1788 – nur kurz vor einer geplanten Rückreise nach Königsberg.
Harald Tews
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : j. g. hamann, histoire, philosophie, 18ème siècle, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 09 juillet 2013
Plaidoyer pour une décroissance de l'éphémère
Plaidoyer pour une décroissance de l'éphémère
Chems Eddine Chitour*
Ex: http://metamag.fr







00:05 Publié dans Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 juillet 2013
LE PHILOSOPHE, LE VOYOU ET LE LEGIONNAIRE
Un parallèle risqué est-il possible ?
Michel Lhomme*
Ex: http://metamag.fr/


00:05 Publié dans Philosophie, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, réflexions personnelles, michel lhomme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 02 juillet 2013
Capitalisme de connards...
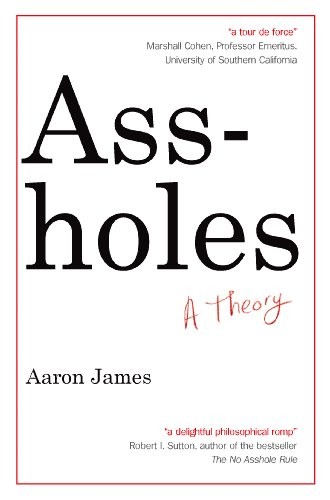 Surfant sur la vague de l’opuscule philosophique mi-sérieux mi-drôle (ou plutôt : traitant sérieusement d’un sujet à première vue saugrenu) comme le célèbre On Bullshit de Harry G. Frankfurt ou le récent Art of Procrastination de John Perry, Aaron James nous livre avec Assholes: A Theory une analyse d’un phénomène somme toute assez peu étudié : le connard (ma traduction de l’anglais “assholes”, même si celui-ci se traduit plus littéralement par “trou-du-cul” - j’espère que ce choix apparaîtra comme justifié à la lecture de ce qui suit ).
Surfant sur la vague de l’opuscule philosophique mi-sérieux mi-drôle (ou plutôt : traitant sérieusement d’un sujet à première vue saugrenu) comme le célèbre On Bullshit de Harry G. Frankfurt ou le récent Art of Procrastination de John Perry, Aaron James nous livre avec Assholes: A Theory une analyse d’un phénomène somme toute assez peu étudié : le connard (ma traduction de l’anglais “assholes”, même si celui-ci se traduit plus littéralement par “trou-du-cul” - j’espère que ce choix apparaîtra comme justifié à la lecture de ce qui suit ).Le paradoxe du connard
En effet, loin d’être un simple terme générique à caractère fortement dépréciatif, le mot “connard” réfère à un phénomène particulier et finalement paradoxal. Contrairement à la brute, au voleur, ou encore meurtrier, le mal imposé par le connard est généralement léger, qu’il nous grille la priorité dans une file d’attente ou nous coupe la parole au milieu d’une discussion. Et pourtant, le connard suscite des réactions épidermiques d’impuissance ou de rage dont l’ampleur ne saurait s’expliquer par le mal (souvent mineur) qu’il nous inflige. Bref, le connard nous pourrit la vie. Mais comment une personne dont le comportement, bien que fâcheux, a des conséquences bénignes, peut-elle déclencher un tel outrage ? C’est là le paradoxe du connard qui constitue le point de départ de l’enquête d’Aaron James.
La solution proposée par Aaron James au premier chapitre de son ouvrage est la suivante : le connard n’est pas simplement quelqu’un qui se comporte de manière injuste en bafouant les règles de la coopération sociale, mais quelqu’un qui se comporte de manière injuste et s’octroie des avantages injustifiés tout en étant persuadé d’être dans son bon droit . Plus précisément, le connard réunit trois caractéristiques : (i) il s’octroie certains avantages que les autres n’ont pas, (ii) tout en pensant que cela lui est dû et qu’il est dans son bon droit et (iii) le sentiment d’être dans son bon droit le rend imperméable aux plaintes de ses victimes .
Le connard partage la première caractéristique avec nombres d’autres figures : le voleur et le détourneur de fond s’octroient eux aussi certains avantages que les autres n’ont pas (comme celui de prendre ce qui n’est pas à eux). Cependant, ce qui distingue le connard des autres, c’est sa seconde propriété, le sentiment d’être dans son bon droit, car lui mérite d’avoir des avantages spéciaux. Le voleur peut voler tout en sachant que ce qu’il fait est mal, ou même en ne s’interrogeant guère sur la valeur morale de son acte – le connard, lui, pense faire ce qui est juste : il est normal et justifié que vous fassiez la queue pendant que lui passe en priorité. Plus précisément, il est juste qu’il bénéficie d’avantages spéciaux car il est lui-même spécial. C’est pourquoi la question permettant à coup sûr d’identifier un connard est le fameux : “Vous savez qui je suis ?”
Ce qui fait du connard un être si irritant n’est donc pas tant ce qu’il fait que le sentiment d’être spécial qui transpire dans ses actes : par son attitude, le connard met en doute l’idée fondamentale selon laquelle nous mériterions tous une égale considération morale. Ce faisant, le connard contredit un besoin fondamental : celui d’être reconnu comme un égal. La lutte contre le connard est une lutte pour la reconnaissance, mais une lutte pour la reconnaissance vaine et perdue d’avance, car la troisième caractéristique du connard est que son sentiment d’être dans son droit est tel qu’il le protège des plaintes des autres, qui ont forcément tort et n’ont de toute façon même pas le droit de remettre son statut en question. Se plaindre au connard mènera forcément notre amour-propre à être piétiné une seconde fois, quand notre discours sera rejeté comme même pas digne d’être entendu.
Bien entendu, il ne s’agit là que d’une théorie générale du connard et le connard vient en toutes sortes de variétés. Les chapitres 2 et 3, plus anecdotiques, égrènent ainsi différentes catégories de connards, sans proposer pour autant de typologie systématique. James y classe les connards selon la façon dont s’exprime leur vice (certains connards se caractérisent par leur grossièreté, d’autres par leur sentiment de supériorité – catégorie pour laquelle est nominé notre BHL national, d’autres par leur tendance à squatter nos écrans de télévision et à y prendre plaisir à humilier leurs interlocuteurs, et d’autres par leur tendance à agir sans se soucier de mettre les autres en danger), la fonction qui l’exacerbe (sont ainsi étudiés du moins puissant au plus influent le patron connard, le connard présidentiel et le connard royal) ou la cause supérieure qui leur permet de se sentir investis de droits spéciaux (est ainsi cité à titre d’exemple historique le connard colonialiste qui se sent justifié voir forcé de mettre sous tutelle les pays inférieurs pour leur bien, car tel est le fardeau de l’homme blanc). La liste se termine par une analyse de ce qui constitue probablement la pire variété de connard : le connard délirant (delusional) qui non seulement se trompe moralement en pensant que sa fonction ou ses talents lui donnent le droit à des avantages spéciaux, mais aussi tout simplement sur la nature de sa fonction et de ses talents (sont ainsi rapprochés Kanye West pour son incapacité à imaginer que ses talents de styliste ne sont peut-être pas aussi extraordinaires qu’il le pense et les banquiers de Wall Street pour leur étrange certitude de jouer un rôle clé et bénéfique dans l’économie mondiale).
Ainsi se résout dès les premiers chapitres le paradoxe du connard : si le connard suscite des réactions épidermiques, ce n’est pas à cause de ce qu’il fait, mais parce que son attitude semble supposer que nous sommes moins dignes de respect que lui et déclenche ainsi un farouche désir d’être reconnu. Cependant, cette théorie sur la nature du connard n’est pas sans soulever certaines questions, qui seront traitées dans les chapitres suivants.
La fabrique du connard
Etant donné qu’être un connard est une certaine attitude (voire même un certain style de vie), on peut se demander quelle est en la source : est-on connard par nature, ou est-ce une question de culture ? Pour l’auteur, il fait peu de doute qu’être un connard est principalement une affaire culturelle : pour preuve, certaines cultures produisent beaucoup plus de connard que d’autres (l’auteur contraste ainsi le Japon et l’Italie, le premier étant selon lui pauvres en connard tandis que la seconde en serait la terre de prédilections, Silvio Berlusconi étant cité comme le connard par excellence). Il en va de même pour les différences entre sexes : si, pour l’auteur, on trouve beaucoup plus de connards parmi les hommes que parmi les femmes (les secondes ayant plus tendances à être des salopes – en anglais : bitch ), c’est parce que les hommes sont plus souvent éduqués à s’affirmer et à se faire valoir, deux qualités indispensables à tout bon connard qui se respecte.
Cela pose bien évidemment le problème de savoir si le connard mérite d’être blâmé : si non content d’être moralement dans l’erreur (en pensant qu’il a le droit à des avantages spéciaux) et incurable (car immunisé aux arguments d’autrui ), le connard est aussi un produit culturel, peut-on encore le tenir pour responsable de ses actes et le blâmer ? Après de longues considérations sur le type de responsabilité qui justifie le blâme, l’auteur conclut que oui : le connard mérite d’être blâmé, justement parce qu’il pense comme un connard. Toute autre solution reviendrait à conclure que le connard ne peut pas être blâmé précisément parce qu’il est un connard, une solution somme toute très paradoxale.
Mais l’idée que la fabrique du connard est principalement culturelle pose un autre problème : celle des effets délétères de la multiplication des connards dans des cultures où chacun se sent dans son bon droit de biaiser les règles de la coopération à son propre avantage. Plus particulièrement, l’auteur s’intéresse dans le chapitre 6 à la dégradation possible de la culture capitaliste dans une forme dévoyée qu’il appelle le “capitalisme de connards” (asshole capitalism). Commençons par préciser que l’auteur est favorable au capitalisme, qu’il définit une “société capitaliste” comme une société qui s’appuie principalement sur les marchés pour la distribution des biens et des services et l’allocation du capital, et qu’il pense que ce système, si lui on adjoint les mécanismes correctifs adéquats, est un bon système si l’on se fixe comme objectif le développement de liberté, la prospérité de tous, et la maximisation des opportunités offertes à chacun. Ce qui le préoccupe, c’est la possibilité que, le nombre de connards augmentant de façon significative, le capitalisme puisse se “dégrader” en une forme instable, le “capitalisme de connards”. Selon l’auteur, le capitalisme est très sensible à la présence de connards : en effet, selon lui, le système capitaliste repose sur un certain nombre d’institutions et de règles que les partenaires doivent respecter pour que la coopération soit bénéfique au plus grand nombre. Parce qu’ils bénéficient du capitalisme, et donc de ces institutions, les partenaires les respectent généralement. Mais le connard, lui, se croit tout permis, et en particulier de contourner ces institutions voire de les détourner à son profit (par exemple en faisant payer les autres pour ses déficits et ses investissements absurdes) : il augmente ainsi considérablement le coût de la coopération pour les autres. “Modélisation mathématique” à l’appui (voir la seconde annexe de l’ouvrage), l’auteur soutient que la prolifération de connards conduit peu à peu les autres à ne plus coopérer, ce qui à terme provoque l’effondrement du système capitaliste.
Cette menace est prise d’autant plus au sérieux par l’auteur que, selon lui, les Etats-Unis sont peut-être déjà dans une telle situation. En effet, l’auteur considère que les Etats-Unis ont vu au cours de ces dernières années se développer une “culture du bon droit” (“entitlement culture”) selon laquelle chacun est spécial et justifié à chercher son enrichissement personnel et à contourner toutes les règles à cette fin. L’auteur passe en revue toute une série de contre-pouvoirs, qui auraient la possibilité de contrer l’influence de cette culture (la famille, la religion, la punition, la honte, la foi dans la justice et la coopération), mais conclut de façon pessimiste que ces contre-mesures sont soit irréalistes (une société dans laquelle les connards seraient punis verserait bien vite dans le totalitarisme) soit susceptibles d’être retournés (dans une société de connards où seuls les connards triomphent, les parents seraient vite tentés d’aider leur progéniture en les élevant en connards). L’auteur nous enjoint cependant à ne pas perdre espoir et à continuer à croire à la justice et à la coopération entre les hommes de bonne volonté (même si on est Italien).
Florian Cova
00:05 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : assholes, connards, livre, sociologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 29 juin 2013
In Search of Anti-Semitism
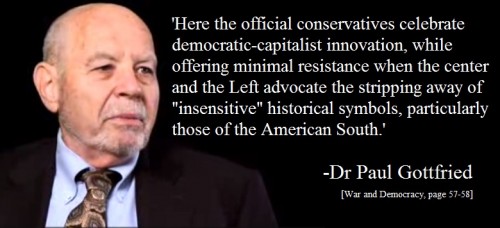
In Search of Anti-Semitism
By Paul Gottfried
Ex: http://neweuropeanconservative.wordpress.com/
Among those authors considered politically incorrect, and even those considered really politically incorrect, Kevin MacDonald holds a special place of honor or shame. A feature story in the May 9 (Los Angeles) Jewish Journal describes this small-boned, soft-spoken 64-year-old professor of psychology at California State University at Long Beach as “the professors anti-Semites love.” Alluding to the fact that university authorities have been trying to force the outspoken MacDonald out of his tenured position, the article complains about “the downside of academic freedom.” We also learn that this clinical psychologist is “considered the foremost anti-Semitic thinker by civil rights experts.”
It would be ridiculous to imagine the same ignominy would be visited on MacDonald if he were a black sociologist making critical remarks about white people. Assuming that he were a designated victim, he would be allowed to compose for profit and prestige diatribes against white Christian males, possibly from a cushy university post at whatever salary illustrious defamers of Euro-Americans are now earning. And if he were a Jew or Christian attacking Christians as the agents of human evil, the now browbeaten MacDonald could make a king’s ransom at some well-heeled institute or as a feature writer for The New Republic or New York Times.
Readers of this website are aware of the lunatic double standard that has been imposed on intellectuals throughout the Western world, almost always by Westerners themselves, for the purpose of determining who can criticize whom. (By now this has become a permanent aspect of “democratic” regimes.)
Plainly MacDonald is not playing by the establishment rules when he observes that Jews have worked at weakening those non-Jewish societies in which they have lived. Although this thesis seems to me to be a bit too generalized, I have no objection to letting MacDonald go on trying to prove it.
In his recently published anthology of essays, Cultural Insurrections, it would be proper to note that MacDonald makes assumptions here that I have questioned in my review of his three-volume, monumental work on the Jews since Moses. I continue to find some of the cognitive disparities he stresses between Ashkenazi Jews and Euro-Americans to be overstated or at least under-demonstrated. If they were in fact as stark as MacDonald insists they are, I would believe that Jews have a right to treat Euro-Americans as natural inferiors or as people probably unfit to sustain their civilization (or what remains of it) without a Jewish master class. I am also skeptical about the possibility of extrapolating from the way a particular Jewish subculture has behaved in the U.S., Canada, and parts of Europe in the twentieth and twenty-first centuries to how Jews have conducted themselves everywhere at all times.
It also seems that certain Jewish behavioral patterns MacDonald outlines are not uniquely Jewish. Other minorities such as Protestant non-conformists and later Irish Catholics in England (and in the U.S.), Huguenots in France, and Old Believers in Tsarist Russia, have shown exactly the same propensity for radical social causes, partly as acts of defiance against what they viewed as regimes that had failed to accord them full legal and/or social recognition.
Sephardic and German Jews who came to America in the eighteenth and nineteenth centuries seemed hell-bent on joining upper-class Protestants and they usually disappeared into the dominant gene pool within a few generations. I am not convinced that Jewish behavior toward Christians follows a biologically determined strategy aimed at the control of resources. My lifelong impression from being around them is that Jews don’t like Christians because of historical grievances, just the way Irish Catholics continue to rage against Protestant Yankees for real amd imaginary offenses inflicted on their ancestors.
Although friend-enemy distinctions are evident here, it is doubtful that these dividing lines operate strictly according to biological conditioning. And it seems even less likely that they are shaped by the natural desire to control resources, in competition against other groups. Much of what MacDonald cites as Jewish behavior is hostility, mixed with anxiety, rather than competitiveness. MacDonald is illustrating culturally subversive activities that go well beyond any attempt to achieve group competitive advantage measured by socio-economic success. Assailing the moral foundations of a Christian middle-class society as pathological and anti-Semitic, a tendency MacDonald proves Jewish intellectuals have repeatedly engaged in, is not simply an attack on the material resources of the dominant society. What MacDonald highlights looks like unfriendly behavior; and one may certainly question the biological reductionism used to explain it.
Having raised these critical points, I should also mention that MacDonald builds a thoroughly cogent case that the creation of “modernity” and the launching of a succession of indignant social crusades against bourgeois Christian civilization by Jewish intellectuals and political activists has usually betokened some degree of malice. But as I mentioned above, and as MacDonald is well aware, Jews are not the only minority that has attempted to subvert dominant outside cultures. They’re just better at doing this than any other group. Jewish intellectuals and activists excel at agitating in the name of some presumed moral high ground, acting like the cunning or resentful priestly class, to which Nietzsche compared the Jews in Genealogy of Morals. In Nietzsche’s analysis, Jews are good at transmitting “slave morality,” without being (immediately) infected themselves.
MacDonald’s newest anthology offers further evidence of what he understands as the Jewish practice of burrowing from within to weaken the cultural coherence of gentile societies. And he offers abundant proof that this burrowing has and is continuing to occur. Whether he is dealing with the predominantly Jewish Frankfurt School and its cultural influences, the role played by Jewish activists in opposing controls on immigration throughout the last hundred years, the penetration and takeover of the American Right by the neoconservatives, or the pressures placed on politicians and political parties by Zionist organizations, MacDonald creates the impression that Jews have worked collectively toward two ends: lessening the cohesion of gentile society and promoting specifically Jewish national ends.
An argument I have used in the past to counter his generalizations is that “not every Jewish community at all times and in all places have acted in this way”; nonetheless, MacDonald could respond to my objections by pointing out that his analysis applies to American Jews for at least the last several generations. And he offers evidence that the same behavioral patterns as the one he discerns among the predominantly Eastern European Jews in the U.S. could already be seen among the relatively assimilated German Jews since their emancipation in Europe.
The same radicalization could be perceived among German Jewish intellectuals going back to the beginnings of Marxian socialism. And the cultural Marxism that has now taken off in a big way had its origin among alienated or embittered German Jews of the interwar period, who later emigrated to the U.S. The present multicultural fixation that has taken Western Europe, Canada and the U.S. by storm was largely the creation of German Jews.
But the group MacDonald’s brief leaves me wondering about most is the white Christian majority: They are jerked around because they have accepted this role for themselves. My own works on the politics of guilt underlines this tendency: Euro-Americans have become emotionally and sociologically predisposed toward aggrieved minorities that condemn them for politically incorrect attitudes. But have Jewish priests been necessary to get the Christian majority to practice slave morality? My answer is that “it helps but isn’t absolutely necessary.”
The institution of learning at which I work and the German Anabaptist denomination to which it was long connected are paradigmatically PC. Furthermore, Lancaster County, where our college is located, registered the largest vote for Obama in the Democratic primary of any county in Pennsylvania that’s not predominantly black. This result was owed much to Church of the Brethren, whose members in their zany anti-racism and open-borders postures make Abe Foxman sound relatively sane. The chance that such radicalized Protestants, who live in their own social bubble, would have picked up their lunacies from any Jew (me perhaps?) is next to nil. They came by their madness on their own, as a “peace church,” and as late entrees into the modern age after having spent an eternity on isolated farms in the Pennsylvania countryside. Like Jimmy Carter, Jim Wallis, Bill Moyers, and most of the Catholic hierarchy on the question of immigration, these Anabaptists exemplify aspects of Christianity that are totally compatible with cultural Marxism and the politics of Western suicide. They do not need Jews, blacks, or North African Muslims to teach them self-destructive behavior, any more than Swedes or Spaniards need the villains in MacDonald’s script to hand over their countries to hostile Muslims from North Africa.
The most interesting point for me in MacDonald’s volume is his presentation of movement conservative goyim. He is absolutely on the money in documenting their servility in relation to their neoconservative puppet-masters. The most startling aspect of this relation is the degree to which the servile class allows itself to be instructed. Irving Kristol, Charles Krauthammer, Douglas Feith, and other neoconservative spokesmen have indeed convinced their pliant enablers that Israel is to be defended as an “ethno-cultural creation,” while the American nation is to be seen as possessing an “ideological identity,” founded on global human rights principles and on an expansionist foreign policy. MacDonald cites the remarkable tribute produced for neocon guru Leo Strauss by his admiring disciple Werner Dannhauser, a tribute that extols Strauss, the famous mentor to global democrats, as “a good Jew. He knew the dignity and worth of love of one’s own. Love of the good is higher than love of one’s own, but there is only one road to truth and it leads through love of one’s own.” MacDonald asks rhetorically whether Anglo-Saxon Protestant “conservatives” could express such sentiments about their own group without Jewish liberals or neocons attacking them as nativists or incipient Nazis.
McDonald cites the public letter drafted by William Kristol’s Project for the New American Century in 2002, calling for a “move against Saddam Hussein,” on the grounds that “Israel’s fight against terrorism is ours.” MacDonald calls special attention to the prominent Jewish neoconservatives who appended their signatures to this call for a war of aggression on behalf of Israel. But what is perhaps even more striking are the non-Jewish signatories, such as William J. Bennett, Frank Gaffney, Ellen Bork, and the professionally insecure, very young editor of National Review, Rich Lowry. In most of these cases one encounters demonstrations of fealty paid to the neoconservative barons who run FOX News, Wall Street Journal, Heritage Foundation, ISI, and the minds of a majority of Republican voters.
But pace MacDonald, these neocon lords and their servants are not the voices of the entire Likud coalition in Israel. They speak for Natan Sharansky, Benjamin Netanyahu, and others even further on the Israeli nationalist right, many of whom have been taught to mumble neocon gibberish about how “democracies have never fought wars” and about how “only democracies are legitimate governments.” A point Israeli political analysts Leon Hadar (see especially his book Sandstorm) and Martin van Creveld have argued for several years now is that neoconservatives and their gentile policy-think-tank hangers-on do not speak for the majority of Israelis, who certainly did not favor the American invasion of Iraq. (Iran might well be a different matter.) It was American neoconservatives, supported by the Christian Right and their Israeli contacts, who planned Bush’s Middle Eastern policy. In the end, MacDonald demonstrates the same when he investigates the Israeli associations of Richard Perle, Paul Wolfowitz, and Douglas Feith.
The Evangelical Cal Thomas and the “conservative Catholic” “theologian” Michael Novak invariably cite in their columns and speeches the alleged return of anti-Semitism on the antiwar left. When Novak came to speak at my college six years ago, he attacked movie producers in Hollywood—Jewish leftists to a man—as “anti-Semites.” The audience listened to him in understandable astonishment, for it could not escape even our news-averse trustees that Novak was saying something glaringly ridiculous.
Moreover, in their invectives against Obama’s pastor Jeremiah Wright, FOX News analysts and announcers played on Wright’s association with the “anti-Semitic Louis Farrakhan.” That Wright and Farrakhan don’t much like Jews and Judaism seemed to matter more than the more obvious fact that the pair hate the Jews specifically as subgroup of Whitey.
Such pandering may result from the fact that movement conservative gentiles are almost as infected as other gentiles by the politics of white Christian guilt. They can only embrace their country to the extent that it renounces an “ethnic-cultural” identity, a character that they happily concede to Jews and others, but which they have collectively renounced for the dubious honor of being a “propositional nation.” Naturally (what else?) the assumption of this contrived identity sets the stage for their country being overwhelmed by legal and illegal Third World immigrants. It also means waging whatever wars the neocon master race tells their gentile collaborators is “good for Israel” and/or helps to spread “democracy.” Unlike MacDonald, I see no compelling reason to blame this lunacy exclusively or even predominantly on the two percent of the population which is Jewish, without noticing that the majority group, including those who describe themselves as “conservatives,” have lost their cotton-picking minds.
Gottfried, Paul. “Homo Americanus.” Taki’s Magazine, 6 April 2009. <http://takimag.com/article/in_search_of_anti-semitism/print#ixzz2Wu4ZRqK6 >.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul gottfried, antisémitisme, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 28 juin 2013
Le désordre vertueux

Le désordre vertueux
Ex: http://www.dedefensa.org/
24 juin 2013 – Parmi les pays que nous classons hors-bloc BAO, celui qui nous paraît à la fois le plus engagé, le plus actif, et, sans doute paradoxalement pour certains jugement, le plus solide, est la Russie. La Russie a un niveau économique acceptable, une puissance de sécurité considérable (jusqu’à l’arsenal nucléaire), une population qui a une immense expérience des temps difficiles après des périodes socio-politiques terrifiantes, qui est caractérisée par un patriotisme résilient que structure un mysticisme puissant avec une dimension religieuse, par un très fort sentiment d’appartenir à l’histoire, voire à la grande Histoire, enfin par une référence permanente aux principes, notamment par rapport à la politique générale du pays. (Nous nous sommes assez souvent exprimés sur la Russie, tant à propos de sa capacité de résistance à l’“agression douce“, qui s’attaque aux principes, qu'à propos de sa politique syrienne, essentiellement principielle.) La Russie représente pour nous le pays qui est le plus fortement, le plus dynamiquement antiSystème, et son socle intérieur puissant (patriotisme et dimension mystique) lui assure à notre sens une stabilité intérieure remarquable, contrairement à ce qui est en général pronostiqué à la bourse des perspectives-Système du bloc BAO. De ce point de vue, l’histoire autant que les conditions générales du pays font que son cadre structurel, fortement principiel, est extrêmement résistant, surtout dans une époque si dangereuse qui a pour effet l'avantage paradoxal pour la Russie de mobiliser les énergies.
Nous suivons donc avec attention l’évolution de la Russie, tant dans sa capacité de résistance à l’“agression douce“, qui s’attaque aux principes, que dans sa politique syrienne, essentiellement principielle et plutôt de nature offensive. Malgré cela et comme nous l'avons déjà suggéré, et avec beaucoup de regrets conjoncturels, nous ne lui donnons pas une chance, essentiellement sur un point précis qui est nécessairement le but implicite de sa politique, – quoique ses dirigeants assurent et conçoivent. Ce pays par essence antiSystème n’a pas la capacité, par la seule action politique, même si cette action est dominante et victorieuse, même si elle est suivie par d’autres, de donner des résultats approchant du décisif contre le Système (contre la politique-Système). Cela n’a rien à voir spécifiquement avec la seule Russie et tout avec le Système, contre qui rien n’est fait tant que le décisif n’est pas accompli, et contre qui aucune force terrestre constituée ne peut accomplir ce décisif-là à cause de la puissance hermétiquement inviolable dudit Système par cette voie... (Dans les citations suivantes, il va de soi qu’en citant par exemple les USA, nous parlons du Système et de rien de moins.)
• Le 22 avril 2013... «Observons qu’il s’agit là d’une approche rationnelle et ultra-réaliste, bien dans la manière de Poutine pour la forme diversifiée de sa politique. La Russie développe une politique appuyée d’une part sur des principes intangibles [...] d’autre part sur une tactique flexible... [...] L’entêtement russe est proverbial et sans doute admirable mais n'est qu'humain et armé de la seule logique ; il est loin, très loin d’être dit qu’il sera suffisant face au phénomène du nihilisme par déstructuration et dissolution de l’action des USA, et à la constante puissance de la politique-Système qui anime le tout...»
• Le 5 juin 2013 : «Il est effectivement acquis, comme un premier fait objectif à leur avantage, que les Russes sont les maîtres du jeu, qu’ils sont désormais considérés comme les principaux acteurs dans la région ; mais le désordre général dans la région est un autre fait objectif très puissant sinon désormais structurel, qui échappe à leur maîtrise comme il échapperait en fait à quelque maîtrise humaine que ce soit.»
Dans l’actualité courante, on sait également que les événements de Turquie ont pris une place importante. Ils ne cessent pas (voir Russia Today le 22 juin 2013), montrant une résilience significative malgré des mesures constantes de dispersion de la part du gouvernement Erdogan. Nous avons déjà traité cette question à deux reprises (le 3 juin 2013 et le 10 juin 2013). Notre analyse est bien qu’Erdogan, avec sa “politique syrienne”, s’est délégitimé, après avoir assuré un gouvernement brillant jusqu’en 2011, fondé sur le respect des principes tels que la souveraineté, lui assurant une forte position antiSystème. Sa politique syrienne a renversé tout cela. Étant passé de facto dans le camp du Système à cause de cette politique syrienne, il a installé les conditions pour que le malaise général qui affecte tous les pays et toutes les situations se transforment en situation de désordre. (N.B. : peut-être est-il en train de changer ?)
• Le 3 juin 2013 : «Notre conviction est que cet aspect puissant de l’évolution turque et de l’évolution d’Erdogan joue un rôle fondamental dans la crise actuelle, où aspects intérieur et extérieur se mélangent pour organiser la perception d’un dirigeant politique légitime perverti dans la délégitimation, et instituer un jugement de condamnation que nourrit la psychologie ainsi orientée. C’est bien la dissolution puis l’entropisation de la légitimité d’Erdogan qui assurait son autorité, qui ont conduit par contraste à l’affirmation d’un autoritarisme illégitime, qui alimente la revendication et la colère populaires. [...] L’on voit donc que la crise turque, puisque crise il y a finalement, rejoint la cohorte des autres crises rassemblées et exacerbées par l’“insaisissable guerre syrienne”, comme une des expressions de la crise haute et, plus généralement, de la crise d’effondrement du Système...»
• Le 10 juin 2013 : «Adressées le 4 juin, le lendemain d’une chute de 10,5% de la bourse d’Ankara, à une assemblée de l’Association des Investisseurs Internationaux en Turquie, ces paroles du président Gül se voulaient ironiques et rassurantes à la fois… “Two years ago in London, cars were burned and shops were looted because of similar reasons. During revolts in Spain due to the economic crisis, people filled the squares. The Occupy Wall Street movement continued for months in the United States. What happens in Turkey is similar to these countries…”
»Tout cela est au fond très juste et particulièrement révélateur mais nous nous demandons avec un certain scepticisme et même un scepticisme certain s’il faut y voir de quoi rassurer les investisseurs d’un système en déroute erratique et chaotique. Qu’il l’ait réalisé ou pas, Gül signifiait à ses auditeurs que la Turquie est entrée en part très active dans la grande crise d’effondrement du Système, et l’on peut penser qu’il y a des nouvelles plus rassurantes que celle-là pour les investisseurs qui ont nécessairement partie liée avec le Système. Voilà donc la grande nouvelle, – “la Turquie entrée en part très active dans la grande crise d’effondrement du Système”. C’est bien entendu le principal enseignement de la crise turque, le seul qui vaille d’être reconnu et retenu à partir de notre posture d’inconnaissance, Erdogan ou pas, manœuvres américanistes et finaudes ou pas...»
Aujourd’hui, nous passons au Brésil, qui connaît depuis presque deux semaines des agitations sans précédent, drainant des foules énormes qui se décomptent par millions. La protestation s’appuie sur un argument en apparence mineur, qui est passé au second plan (l’augmentation des tarifs des transports en commun, mesure sur laquelle la présidente Rousseff est revenue), et sur un argument complètement inattendu : les dépenses considérables faites par le Brésil pour préparer la Coupe du Monde de football de 2014, alors que la population connaît une détresse considérable. Dans ce pays qui constitue évidemment le temple de l’adoration du football, cette réaction est tout aussi évidemment une surprise considérable. Même le roi-Pelé , la gloire nationale par excellence (mais recyclée-Système : «[T]he superstar turned MasterCard ambassador»), est en train de perdre son auréole... (Voir le Guardian du 21 juin 2013.)
«More than a million people took to the streets on Thursday night in at least 80 cities in a rising wave of protest that has coincided with the Confederations Cup. This Fifa event was supposed to be a dry run for players and organisers before next year's finals, but it is police and protesters who are getting the most practice... [...]
»But the mega-event has been the lightning conductor. Many protesters are furious that the government is spending 31bn reals (£9bn) to set the stage for a one-time global tournament, while it has failed to address everyday problems closer to home. “I'm here to fight corruption and the expense of the World Cup,” said Nelber Bonifcacio, an unemployed teacher who was among the vast crowds in Rio on Thursday. “I like football, but Brazil has spent all that money on the event when we don't have good public education, healthcare or infrastructure.”
»It was all very different in 2007 when Brazil was awarded the tournament. Back then, crowds in Rio erupted with joy and Ricardo Teixeira, president of the Brazilian Football Confederation, was hailed as he said: “We are a civilised nation, a nation that is going through an excellent phase, and we have got everything prepared to receive adequately the honour to organise an excellent World Cup.” In the outside world, few doubted the wisdom of the decision. Football belonged in Brazil. In the home of carnival and samba, it would be a party like no other.
»But euphoria has steadily faded as preparations for 2014 have drawn attention to the persistent ills of corruption, cronyism, inequality and public insecurity. Those who appeared to have the Midas touch in 2007 now seem cursed. Teixeira was forced to resign last year amid accusations of bribery. Former president Luiz Inácio Lula da Silva has been tainted by revelations of massive vote-buying by the ruling Workers party. Fifa too is mired in a series of corruption scandals that have led to the resignations of several senior executives.
»The renovation and construction of most of the 12 World Cup stadiums has been late and over budget. Several have been pilloried as white elephants because they are being built in cities with minor teams. The new £325m Mane Garrincha stadium in Brasília – which hosted the opening game of the Confederations Cup – has a capacity of 70,000, but the capital's teams rarely attract more than a few hundred fans.»
Les soubresauts de la crise d'effondrement du Système
Si nous avons mis ces trois pays en parallèle, alors que leurs situations sont apparemment différentes ou très différentes, c’est d’abord parce qu’ils appartiennent à une même catégorie. On pourrait dire, pour simplifier, des pays du type-BRICS ; certes, la Turquie n’en fait pas partie, mais elle constitue un modèle de pays qui correspond parfaitement au BRICS, et il fut à un moment question de son adhésion, comme il y a par ailleurs une plus grande proximité entre la Turquie et l’OCS, ou Organisation de Coopération de Shanghai (voir le 2 mai 2013), qui est un organisme d’esprit et de situation assez similaires au BRICS. (Deux membres du BRICS, la Russie et la Chine, font partie de l’OCS, et un troisième, l’Inde, y a le statut officiel d’“observateur” qui lui permet d’assister statutairement à toutes les réunions de l’OCS.)
... En rapprochant ces trois pays, après avoir rapidement survolé leurs situations et souligné les différences de ces situations, nous voulons justement ne tenir aucun compte de ces différences, qui sont celles de leurs situations spécifiques, pour conclure à une sorte d’unité de situation générale. (Au contraire, pour voir des analyses dans ce sens que nous rejetons complètement, on peut parcourir la presse en général en allant par exemple de WSWS.org, le 22 juin 2013, à Marianne.net, le 22 juin 2013. On y retrouvera l’atmosphère de la lutte des classes des années 1950-1970 ou bien l’atmosphère du débat sur l’immigration et l’islamisme à partir des années 1980-1990.)
Nous refusons en effet absolument le traitement spécifique de ces situations, qui est l’aliment évident du réductionnisme par quoi l’on évite d’aller au cœur du seul problème qui compte dans notre temps. Plus encore, nous estimons que ce que nous avons déterminé comme la “sorte d’unité de situation générale” de ces trois pays qui font partie d’un groupe spécifique qu’on juge plus ou moins, selon les circonstances et malgré les accidents (Turquie), de tendance antiSystème, ne doit en aucun cas être séparé de la situation générale des pays du bloc BAO telle que nous l’observons depuis au moins 2008. (Cette situation spécifique des pays du bloc BAO étant faite de protestations sporadiques de la population, sans aucune organisation oppositionnelle, donc sans offre d’alternative ; de directions politiques discréditées et impuissantes ; d’une politique générale favorisant tous les centres-Système de pouvoir, instaurant une politique de surveillance systématique de la population, etc. ; bref d’une instabilité grandissante et d’une crise générale en constante aggravation à mesure que les autorités-Système affirment lutter avec succès contre l’instabilité et la crise.)
Nous devons ajouter bien entendu que ces pays, qu’on juge effectivement plutôt de tendance antiSystème, sont nécessairement soumis au Système, ou dans tous les cas intégrés dans le Système, dans le chef des aspects financier, économique et social (avec une certaine réserve mais tout de même nullement décisive pour la Russie, dont l’exécutif fort, la tradition étatiste affirmée, etc., limitent certains aspects de la pénétration-Système aux niveau financier, économique et social). Cela implique pour ces pays plus ou moins antiSystème les maux habituels engendrés par le schéma capitaliste, et surtout de notre capitalisme-turbo actuel, de l’austérité aux restrictions de l’aide sociale, des spasmes de développement à la destruction de l’environnement, de l’accroissement de l’inégalité à la corruption, etc. Le schéma capitaliste, absolument déstructurant et dissolvant, est évidemment aussi destructeur, sinon plus dans ce type de pays, et il est universel puisqu’émanant directement du Système. Les autres pays peu ou prou dans la même catégorie, qui ne sont pas cités ici parce qu’ils ne sont pas dans l’actualité ou qu’ils ont un rôle moins affirmé que les trois cités, sont dans la même situation, – la Chine notamment, certes. La cause en est évidemment, selon notre point de vue fondamental, que le Système est “la source de toutes choses” selon les seules normes effectivement en cours dans notre “contre-civilisation” aujourd’hui, ce que nous rappelons systématiquement. Rien de construit, d’efficace à l’échelle de l’organisation d’une nation, ou d’un groupe de nations, ne peut se faire hors du Système, et par conséquent hors de ses règles... Quelques rappels à cet égard, pour affiner la définition et mieux définir la situation, avec citations de deux textes éloignés de deux ans, – où l’on voit, signe de l’affirmation et de l’approfondissement de notre point de vue, qu’“un système” est devenu “le Système” majusculé et exclusif.
• Le 10 septembre 2010 : «D’autre part, ce qui nous invite à procéder de la sorte est le constat que nous avançons sans la moindre hésitation que la manifestation fondamentale de cette civilisation arrivée au point où elle se trouve, se fait sous la forme d’un “système” extrêmement élaboré et complexe, dont nous parlons souvent et qui est le principal objet de notre étude. Ce “système” a l’unicité, la puissance, l’universalité qui en font la source de toutes choses dans le chef d’une civilisation dont on peut dire qu’elle est une “contre-civilisation” »)
• Le 29 septembre 2012 : «Le Système est complètement fermé… Il est hermétique, selon cette définition de base que nous offrions le 20 mai 2011 : “Le Système qui régit le monde aujourd’hui est […] dans une situation de surpuissance extraordinaire, une situation de surpuissance que nous qualifierions d’hermétique dans le sens où cette situation est bouclée et inexpugnable… […] Lorsque nous disons que le Système est hermétique, nous soulignons par là que sa surpuissance s’exprime dans les deux voies essentielles de la puissance aujourd’hui. Il y a d’une part la puissance brute du système du technologisme, qui est si grande que rien ne peut être fait de structurant qui ne passe par les outils de cette puissance que contrôle, voire qu’engendre le Système, comme seule source de puissance matérielle et technique dans le monde. Il y a d’autre part la puissance d’influence du système de la communication, qui détermine la perception unique, et donc l’état de la psychologie. Cette formule idéale détermine l’hermétisme du Système, qui fait que rien n’est possible hors du Système.” L’hermétisme du Système est donc d’abord l’hermétisme du au souffle de sa surpuissance qui vous cloue sur place, qui fixe les moyens de son hermétisme autour de lui, comme une centrifugeuse créant une atmosphère qui lui est propre et séparant hermétiquement son monde des autres, et réduisant à néant toutes les tentatives antiSystème élaborées, rationnelles, construites à l’intérieur du Système lui-même, en utilisant nécessairement certaines de ses normes...»
Ainsi, lorsque nous parlons d’actions ou de collectivités, de nations, etc., antiSystème, il est entendu que nous parlons d’entités qui sont à l’intérieur du Système mais qui, pour une raison ou l’autre, par tel moyen ou tel autre, parviennent à exercer une action antiSystème de l’intérieur du Système. Cela rejoint d’ailleurs notre appréciation principale du phénomène antiSystème, qui est d’une logique évidente, qui est que le système antiSystème ne peut s’organiser qu’en fonction du Système puisque tout est dans le Système. D’une façon générale, également, son action, que nous qualifions évidemment de “Résistance”, est impuissante en elle-même, en tant que telle, et elle acquiert au contraire toute son efficacité essentiellement en “jouant avec le Système” ; c’est-à-dire, en retournant contre lui la force du Système, notamment pour éventuellement exacerber son processus de surpuissance et accélérer prodigieusement sa transmutation en processus d’autodestruction.
(Voir par exemple le 2 juillet 2012 : «L’intérêt de la résistance est moins de détruire, ou d’espérer détruire le Système, que de contribuer à l’accélération et au renforcement de son autodestruction. [...] L’opérationnalité de la résistance antiSystème se concentre naturellement dans l’application du principe fameux, et lui-même naturel, de l’art martial japonais aïkido : “retourner la force de l'ennemi contre lui...”, – et même, plus encore pour notre cas, “aider la force de cet ennemi à se retourner naturellement contre lui-même”, parce qu’il est entendu, selon le principe d’autodestruction, qu’il s’agit d’un mouvement “naturel”.»)
Ainsi nous trouvons-nous, dans les trois cas évoqués, et malgré les différences parfois considérables entre ces trois cas, dans une même situation paradoxale et contradictoire. Ce n’est pas une surprise puisque, lorsqu’il s’agit du Système, de ses spasmes et de ses convulsions, nous sommes absolument dans une situation qui ne peut se définir que par le paradoxe et la contradiction. D’un côté, on peut juger dommageable que des pays qui semblent plus ou moins d’orientation antiSystème se trouvent confrontés à des troubles intérieurs (certains le regrettent tant qu’ils insinuent que la main de la CIA se trouve pour une part non négligeable dans les troubles au Brésil, – ce qui peut se concevoir, certes, mais pour partie et sans action fondatrice, selon la “doctrine” dite du “prendre le train en marche”, comme éventuellement, pour ce qui est de la “doctrine”, dans le cas turc pour ceux qui restent favorables à Erdogan). Au pire et dans le meilleur des cas pour notre conception, on peut juger dommageable qu’un pays nettement d’orientation antiSystème (la Russie) ne puisse espérer (selon nous) pousser sa politique pourtant brillante et surtout principielle jusqu’à une issue antiSystème achevée. Mais ce jugement conjoncturel est infondé sur le fond, puisque l’action de la Russie exacerbe effectivement la surpuissance du Système et la transmue presque simultanément en processus d'autodestruction (l’exemple de la Syrie est évident).
D’un autre côté, ces pays étant tout de même dans le Système, parce qu’il ne peut en être autrement, leurs troubles affectent le Système qui est un ensemble absolument universel, hermétique, fondé sur une intégration absolue et totalitaire de toutes les forces existantes. Le Système ayant comme objectif l’équation dd&e (déstructuration, dissolution & entropisation), son but est l’entropisation de tout ce qui figure en son sein, c’est-à-dire tout ce qui figure dans cette “contre-civilisation” complètement globalisée et à laquelle rien d’humain, ni rien de la nature des choses et du monde, ni rien de structurant finalement, ne doit pouvoir échapper dans son chef. Par conséquent, les parties de ce tout qui connaissent des troubles interférant sur la bonne marche de l’objectif dd&e vers l’entropisation, constituent un grave problème, voire un revers pour le Système. Par conséquent, ce qu’on pourrait interpréter comme des événements satisfaisant le Système puisque touchant des pays antiSystème, – notamment les troubles en Turquie et au Brésil, la position de la Russie qui semblerait susciter des forces à l’intérieur de ce pays conduisant à la mise à l’index de ce pays, dans tous les cas par rapport au bloc BAO, – tout cela constitue en réalité des préoccupations majeures pour le Système par définition, par rapport au fonctionnement des processus de globalisation. Même si la politique du Brésil, type-BRICS, est perçue avec une certaine hostilité par le Système, les troubles au Brésil le sont encore plus et conduisent le Système à souhaiter finalement que le gouvernement brésilien rétablisse le calme (éventuellement, ce serait encore mieux, en modifiant sa politique dans un sens pro-Système). Même si la politique de Poutine, notamment syrienne, est perçue avec une hostilité considérable par le Système, la Russie est tout de même nécessairement perçue comme faisant partie du Système évidemment, et tout est fait pour affirmer que la Russie évolue pour se rapprocher du bloc BAO, et tout le monde, du président-poire Hollande au Premier ministre Cameron, répète régulièrement que la Russie va être bientôt “des nôtres”. Leur sottise conjoncturelle à cet égard, – concernant la vérité des événements en cours, – répond de leur complète loyauté au Système reflétant l’emprise-Système sur leurs psychologies absolument épuisées et dévastées.
Pour prendre une référence évidente, par rapport à ce que l’on a nommé le “printemps arabe”, où l’enjeu paraissait clair face à des dirigeants-Système avérés jusqu’à la caricature grotesque, le cas présent est très différent. Les dirigeants de ces pays ne sont pas irrémédiablement des dirigeants-Système, tant s’en faut, et même pas du tout pour certains. Ils sont eux-mêmes coincés entre paradoxe et contradiction. La Brésilienne Rousseff, venue de la gauche extrême, après des années de prison et de torture de la part des militaires brésiliens commandités par la CIA, est au fond en bonne partie du côté des foules en colère. Elle ne manque pas de le dire, d’ailleurs, ce qui ne manque pas de donner un sel surréaliste à la situation. Elle lâche le plus qu’elle peut mais, arrivée à un certain point, se trouve bloquée par les sommes en jeu, les investissements, les programmes colossaux engagés pour la Coupe du Monde. Même les Russes, même un Poutine, rencontrent des limitations, bien qu’ils soient, avec l’appui de la puissance et de l’essence historique et fondée sur la Tradition de la Russie, les plus en avant dans l’audace antiSystème, presque jusqu’au défi et au mépris. Ces limitations sont celles du Système dont ils sont malgré tout partie prenante, en partie certes, dont ils ne peuvent pas ne pas tenir compte.
Ainsi en est-il de leur position dans ces pays à la fois antiSystème et dans le Système. Finalement, cette position n’est pas originale même si elles se distingue par les politiques affichées telles qu’on les a détaillées. De façon plus générale on dira que cette position, à des degrés d’intensité très différents, est finalement universellement partagée, dans tous les pays et dans tous les continents dominés nécessairement par le Système, mais où des explosions et des projets antiSystème, très visibles ou à peine identifiés, apparaissent tout aussi nécessairement, de plus en plus souvent à mesure de la dégradation du Système, de la surpuissance à l’autodestruction. Même les pays les plus totalement entités-Système, dans le bloc BAO nécessairement, sont néanmoins, également, prisonniers du Système, et laissent échapper ici et là des manifestations antiSystème ; les USA, on le sait bien assez, n’y échappent pas. Nous sommes dans un univers total où une bataille totale est en cours, mélangeant les uns et les autres, transcendant toutes les lignes conventionnelles, balayant toutes les étiquettes, à la mesure de la puissance extraordinaire du Système (surpuissance) et de sa crise d’d’effondrement (autodestruction). Simplement, on observera que l’épisode actuel, que nous analysons ici, avec les positions qu’on a dites, différant notamment du “printemps arabe”, marque une étape de plus, et éventuellement une avancée, dans la bataille autour du Système. Quoi qu’on fasse dans le sens des analyses spécifiques et réductionnistes, l’essentiel et l’unique chose qui compte est qu’il s’agit d’une bataille contre le Système, partout et de toutes les façons.
Il est donc impératif de considérer ces troubles pour ce qu’ils sont en vérité, comme reflet de l’infiniment complexe opérationnalité de la situation, et reflet de la terrible et bouleversante simplicité de la vérité de la situation. Les crises ou incertitudes dans les pays et groupes de pays auxquels on vient de s’intéresser, qui se retrouvent partout ailleurs sous des formes nécessairement différentes, sont accessoires dans leur signification pour tous ces pays et groupes de pays même si elles apportent un poids terrible de troubles, une quantité énorme de malheurs et de souffrances. Le fait est que tout cela marque d’abord, on serait presque tenté d’écrire exclusivement, les soubresauts terribles de la crise d’effondrement du Système.
00:05 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, désordre vertueux, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 20 juin 2013
Gustave Le Bon 1841-1931

1841-1931
- On ne se conduit pas avec son intelligence mais avec son caractère.
(Aphorismes du temps présent, p.155, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- On ne saurait juger des sentiments d'un être d'après sa conduite dans un cas déterminé. L'homme d'une circonstance n'est pas celui de toutes les circonstances.
(Aphorismes du temps présent, p.156, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Supposer chez les autres des sentiments identiques à ceux qui nous mènent, est se condamner à ne jamais les comprendre.
(Aphorismes du temps présent, p.157, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Quand on ne gêne pas par sa volonté, on nuit souvent par son inertie.
(Aphorismes du temps présent, p.157, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les oeuvres importantes résultent plus rarement d'un grand effort que d'une accumulation de petits efforts.
(Aphorismes du temps présent, p.157, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La vanité est pour les imbéciles une puissante source de satisfaction. Elle leur permet de substituer aux qualités qu'ils n'acquerront jamais, la conviction de les avoir toujours possédées.
(Aphorismes du temps présent, p.157, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Nul besoin d'être loué quand on est sûr de soi. Qui recherche la louange doute de sa propre valeur.
(Aphorismes du temps présent, p.158, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Appartenir à une école, c'est perdre sa personnalité ; ne pas appartenir à une école, c'est abdiquer toute possibilité de prestige.
(Aphorismes du temps présent, p.158, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les grandes pensées viennent de l'esprit et non du coeur comme on l'a soutenu, mais c'est du coeur qu'elles tirent leur force.
(Aphorismes du temps présent, p.158, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le caractère et l'intelligence étant rarement réunis, il faut se résigner à choisir ses amis pour leur caractère et ses relations pour leur intelligence.
(Aphorismes du temps présent, p.158, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- On n'est pas maître de ses désirs, on l'est souvent de sa volonté.
(Aphorismes du temps présent, p.159, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une volonté forte a le plus souvent un désir fort pour soutien. Le désir est l'âme de la volonté.
(Aphorismes du temps présent, p.159, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- En matière de sentiment, l'illusion crée vite la certitude.
(Aphorismes du temps présent, p.161, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les sentiments simulés finissent quelquefois par devenir des sentiments éprouvés.
(Aphorismes du temps présent, p.161, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les diverses formes de logiques : mystique, sentimentale et rationnelle n'ont pas de commune mesure. Elles peuvent se superposer mais non se concilier.
(Aphorismes du temps présent, p.161, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Ce qu'on fait par orgueil est souvent supérieur à ce qu'on accomplit par devoir.
(Aphorismes du temps présent, p.161, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Démontrer qu'une chose est rationnelle ne prouve pas toujours qu'elle soit raisonnable.
(Aphorismes du temps présent, p.162, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'homme ne possède que deux certitudes absolues : le plaisir et la douleur. Elles orientent toute sa vie individuelle et sociale.
(Aphorismes du temps présent, p.163, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les grands manieurs d'hommes furent toujours des créateurs de désirs. Les réformateurs ne font que substituer un désir à un autre désir.
(Aphorismes du temps présent, p.164, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Selon les divers ordres d'activité, la femme est inférieure ou supérieure à l'homme. Elle est rarement son égale.
(Aphorismes du temps présent, p.166, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La femme ne pardonne pas à l'homme de deviner ce qu'elle pense à travers ce qu'elle dit.
(Aphorismes du temps présent, p.167, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Dominer ou être dominée, il n'y a pas, pour l'âme féminine, d'autre alternative.
(Aphorismes du temps présent, p.167, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'homme ne croit guère la femme que quand elle ment. Il la condamne ainsi souvent à mentir.
(Aphorismes du temps présent, p.167, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- En amour, quand on demande des paroles, c'est qu'on a peur d'entendre les pensées.
(Aphorismes du temps présent, p.167, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'amitié est plus souvent une porte de sortie qu'une porte d'entrée de l'amour.
(Aphorismes du temps présent, p.168, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- On n'est pas toujours digne de l'amour qu'on provoque, on l'est généralement des amitiés qu'on inspire.
(Aphorismes du temps présent, p.169, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'amour devenu clairvoyant est bien près de finir.
(Aphorismes du temps présent, p.169, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une opinion peut avoir des origines affectives, mystiques ou rationnelles. L'origine rationnelle est la plus rare.
(Aphorismes du temps présent, p.170, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le milieu crée nos opinions. Les passions et l'intérêt les transforment.
(Aphorismes du temps présent, p.170, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Il faut posséder un esprit très indépendant pour se créer cinq ou six opinions personnelles dans le cours de l'existence.
(Aphorismes du temps présent, p.171, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Il n'y a guère aujourd'hui de journaux assez indépendants pour permettre à leurs rédacteurs des opinions personnelles.
(Aphorismes du temps présent, p.172, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- En politique, les choses ont moins d'importance que leurs noms. Déguiser sous des mots bien choisis, les théories les plus absurdes, suffit souvent à les faire accepter.
(Aphorismes du temps présent, p.174, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Chez beaucoup d'hommes, la parole précède la pensée. Ils savent seulement ce qu'ils pensent après avoir entendu ce qu'ils disent.
(Aphorismes du temps présent, p.175, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La contagion mentale est le plus sûr agent de propagation des opinions et des croyances. Les convictions politiques ne se fondent guère autrement, on tâche ensuite de leur donner un aspect rationnel pour les justifier.
(Aphorismes du temps présent, p.176, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'art des grands meneurs est de susciter chez ceux qu'ils entraînent des personnalités nouvelles.
(Aphorismes du temps présent, p.177, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Pour acquérir une autorité momentanée, il suffit généralement de persuader qu'on la possède.
(Aphorismes du temps présent, p.177, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- On domine plus facilement les peuples en excitant leurs passions qu'en s'occupant de leurs intérêts.
(Aphorismes du temps présent, p.177, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une erreur, auréolée de prestige, exercera toujours plus d'action qu'une vérité sans prestige.
(Aphorismes du temps présent, p.178, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Vouloir imposer nos institutions, nos coutumes et nos lois aux indigènes d'une colonie, c'est prétendre substituer au passé d'une race le passé d'une autre race.
(Aphorismes du temps présent, p.182, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Créer des idées qui influenceront les hommes, c'est mettre un peu de soi-même dans la vie de ses descendants.
(Aphorismes du temps présent, p.183, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La foule ne retient guère des évènements que leur côté merveilleux. Les légendes sont plus durables que l'histoire.
(Aphorismes du temps présent, p.186, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le poids du nombre tend chaque jour à se substituer au poids de l'intelligence. Mais si le nombre peut détruire l'intelligence, il est incapable de la remplacer.
(Aphorismes du temps présent, p.188, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les foules comprennent rarement quelque chose aux évènements qu'elles accomplissent.
(Aphorismes du temps présent, p.188, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les grandes assemblées possèdent les principales caractéristiques des foules : Niveau intellectuel médiocre, excitation excessive, fureurs subites, intolérance complète, obéissance servile aux meneurs.
(Aphorismes du temps présent, p.189, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'homme médiocre augmente sa valeur en faisant partie d'un groupe ; l'homme supérieur la diminue.
(Aphorismes du temps présent, p.190, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'élite d'un peuple crée ses progrès, les individus moyens font sa force.
(Aphorismes du temps présent, p.193, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les progrès d'un peuple ne sont déterminés ni par les gouvernements ni par les révolutions, mais par la somme des efforts des individus qui la composent.
(Aphorismes du temps présent, p.194, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les hommes en société ne pouvant vivre sans tyrannie, la plus acceptable est encore celle des lois.
(Aphorismes du temps présent, p.196, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les lois stabilisent les coutumes, elles peuvent rarement en créer.
(Aphorismes du temps présent, p.196, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une loi qui ne sanctionne pas simplement la coutume, c'est-à-dire l'expérience du passé, ne fait que codifier notre ignorance de l'avenir.
(Aphorismes du temps présent, p.197, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Croire, comme les politiciens, à la puissance transformatrice des lois, c'est oublier que derrière les phénomènes visibles, se trouvent toujours des forces invisibles qui les déterminent.
(Aphorismes du temps présent, p.197, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Un délit généralisé devient bientôt un droit.
(Aphorismes du temps présent, p.197, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Dès qu'on possède la force, on cesse d'invoquer la justice.
(Aphorismes du temps présent, p.199, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- On ne peut opposer le droit à la force, car la force et le droit sont des identités. Le droit est de la force qui dure.
(Aphorismes du temps présent, p.199, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une vertu pratiquée sans effort est une qualité, non une vertu.
(Aphorismes du temps présent, p201., Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La morale s'apprend seulement par la pratique. Elle fait partie, comme les arts, de ces connaissances que ne sauraient enseigner les livres.
(Aphorismes du temps présent, p.201, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le même sentiment peut être appelé vice ou vertu suivant son utilité sociale. Étendu à la famille, à la tribu, à la patrie, l'égoïsme individuel devient une vertu. L'orgueil, défaut individuel, est également une vertu collective.
(Aphorismes du temps présent, p.202, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Possible entre individus, la tolérance ne l'est jamais entre collectivités.
(Aphorismes du temps présent, p.203, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'intolérance représente souvent dans la vie des peuples une vertu nécessaire à l'action.
(Aphorismes du temps présent, p.203, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Excuser le mal, c'est le multiplier.
(Aphorismes du temps présent, p.203, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Dans le domaine moral, l'homme moderne détruit plus vite qu'il ne bâtit.
(Aphorismes du temps présent, p.203, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les gens vertueux se vengent souvent des contraintes qu'ils s'imposent par l'ennui qu'ils inspirent.
(Aphorismes du temps présent, p.204, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- On ne peut rien sur l'homme dont l'idéal est de sacrifier sa vie pour une croyance.
(Aphorismes du temps présent, p.205, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Incapable de vivre sans certitude, l'homme préférera toujours les croyances les moins défendables aux négations les plus justifiées.
(Aphorismes du temps présent, p.208, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'intolérance de certains libres penseurs, résulte fréquemment de la religiosité inconsciente dont l'atavisme a rempli leurs âmes.
(Aphorismes du temps présent, p.208, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La libre pensée ne constitue souvent qu'une croyance, qui dispense de la fatigue de penser.
(Aphorismes du temps présent, p.208, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La raison crée le progrès, mais les bâtisseurs de croyances mènent l'histoire. Du fond de leurs tombeaux, de grands hallucinés comme Bouddha et Mahomet, courbent encore des millions d'hommes sous l'enchantement de leurs rêves.
(Aphorismes du temps présent, p.209, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les peuples survivent rarement à la mort de leurs dieux.
(Aphorismes du temps présent, p.209, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Comme la politique, l'art est guidé par quelques meneurs, suivis d'une foule de menés.
(Aphorismes du temps présent, p.210, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le beau, c'est ce qui nous plaît, et ce qui nous plaît se détermine moins par le goût personnel, que par celui des personnes influentes, dont la contagion mentale impose le jugement.
(Aphorismes du temps présent, p.211, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le véritable artiste crée, même en copiant.
(Aphorismes du temps présent, p.212, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La force des rites est telle, qu'ils survivent longtemps à la foi qui les avaient [sic] fait naître.
(Aphorismes du temps présent, p.214, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- On rencontre rarement un homme acceptant d'exposer sa vie pour une vérité rationnelle. On en trouve aisément des milliers prêts à se faire tuer pour une croyance.
(Aphorismes du temps présent, p.217, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Lorsqu'une question soulève des opinions violemment contradictoires, on peut assurer qu'elle appartient au cycle de la croyance et non à celui de la connaissance.
(Aphorismes du temps présent, p.217, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'intolérance est la compagne nécessaire des convictions fortes. Entre sectateurs de croyances voisines, elle est beaucoup plus accentuée qu'entre défenseurs de dogmes sans parenté.
(Aphorismes du temps présent, p.218, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'hypothèse est une croyance souvent prise pour une connaissance.
(Aphorismes du temps présent, p.218, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une croyance n'étant ni rationnelle, ni volontaire, aucune des absurdités qu'elle peut enseigner ne saurait nuire à sa propagation.
(Aphorismes du temps présent, p.218, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Ne pas croire les choses possibles, c'est les rendre impossibles. Une des forces de la foi est d'ignorer l'impossible.
(Aphorismes du temps présent, p.219, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'éducation est l'art de faire passer le conscient dans l'inconscient.
(Aphorismes du temps présent, p.220, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Instruire n'est pas éduquer. L'instruction enrichit la mémoire. L'éducation crée chez l'homme des réflexes utiles et lui apprend à dominer les réflexes nuisibles.
(Aphorismes du temps présent, p.221, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Quelques années suffisent pour instruire un barbare. Il faut parfois des siècles pour l'éduquer.
(Aphorismes du temps présent, p.221, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Développer chez l'homme la réflexion, le jugement, l'énergie et le sang-froid, serait autrement nécessaire que de lui imposer l'insipide phraséologie, qui constitue l'enseignement scolaire.
(Aphorismes du temps présent, p.221, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Confiner l'esprit dans l'artificiel et le rendre incapable d'observation, est le plus sûr résultat des méthodes théoriques ne montrant le monde qu'à travers les livres.
(Aphorismes du temps présent, p.221, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Canalisée par une bonne méthode, l'intelligence la plus faible arrive à progresser.
(Aphorismes du temps présent, p.222, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Acquiérir une méthode, c'est posséder l'art d'économiser le temps, et, par suite, d'en accroître la durée.
(Aphorismes du temps présent, p.222, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Vouloir enseigner trop de choses empêche l'élève d'en apprendre aucune. Ce principe fondamental semble ignoré ou méconnu de notre Université.
(Aphorismes du temps présent, p.222, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une des grandes illusions de la démocratie est de s'imaginer que l'instruction égalise les hommes. Elle ne sert souvent qu'à les différencier davantage.
(Aphorismes du temps présent, p., Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Notre système d'éducation classique a fini par créer une aristocratie de la mémoire, n'ayant aucun rapport avec celle du jugement et de l'intelligence.
(Aphorismes du temps présent, p.223, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le choix d'un système d'éducation a plus d'importance pour un peuple que celui de son gouvernement.
(Aphorismes du temps présent, p.223, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Des hommes d'élite réunis en groupe ne constituent plus une élite. Pour garder son niveau, l'esprit supérieur doit rester solitaire.
(Aphorismes du temps présent, p.224, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'élite crée, la plèbe détruit.
(Aphorismes du temps présent, p.225, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Des trois conceptions possibles de la vie : optimiste, pessimiste, résignée, la dernière est peut-être la plus sage, mais aussi la moins génératrice d'action.
(Aphorismes du temps présent, p.227, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'évolution de la philosophie rationnelle consiste surtout à discuter en termes nouveaux des problèmes fort anciens.
(Aphorismes du temps présent, p.227, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Chaque phénomène a son mystère. Le mystère est l'âme ignorée des choses.
(Aphorismes du temps présent, p.228, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le matérialisme a prétendu se substituer aux religions, mais aujourd'hui la matière est devenue aussi mystérieuse que les dieux qu'elle devait remplacer.
(Aphorismes du temps présent, p.231, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une des supériorités du savant sur l'ignorant est de sentir où commence le mystère.
(Aphorismes du temps présent, p.231, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le besoin de certitude a toujours été plus fort que le besoin de vérité.
(Aphorismes du temps présent, p.235, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La valeur pratique d'une vérité se mesure au degré de croyance qu'elle inspire.
(Aphorismes du temps présent, p.235, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Revêtir l'erreur d'une forme séduisante, suffit souvent pour la faire accepter comme vérité.
(Aphorismes du temps présent, p236., Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- C'est nuire à la découverte de la vérité que de l'apprécier, comme les pragmatistes, d'après son degré d'utilité.
(Aphorismes du temps présent, p.236, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une vérité est une étape provisoire sur une route qui n'a pas de fin.
(Aphorismes du temps présent, p.237, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Il y a des vérités absolues dans le temps mais non dans l'éternité.
(Aphorismes du temps présent, p.237, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Présentée sous forme mathématique, l'erreur acquiert un grand prestige. Le sceptique le plus endurci attribue volontiers aux équations de mystérieuses vertus.
(Aphorismes du temps présent, p.237, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une illusion tenue pour vraie agit comme une vérité.
(Aphorismes du temps présent, p.237, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La valeur attribuée à une doctrine dépend beaucoup moins de la justesse de cette doctrine que du presige possédé par celui qui l'énonce.
(Aphorismes du temps présent, p.238, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une vérité trop claire cesse bientôt d'être une vérité féconde.
(Aphorismes du temps présent, p.238, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'intelligence fait penser. La croyance fait agir.
(Aphorismes du temps présent, p.241, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Si l'homme avait commencé par penser au lieu l'agir, le cycle de son histoire serait clos depuis longtemps.
(Aphorismes du temps présent, p.241, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Illusoires ou réelles, les certitudes sont génératrices d'action. L'homme privé de certitudes serait comme un vaisseau sans gouvernail, une machine sans moteur.
(Aphorismes du temps présent, p.241, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'absurde et l'impossible n'ont jamais empêché une croyance suffisamment forte de faire agir.
(Aphorismes du temps présent, p.241, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Savoir ce qu'on doit faire n'est pas du tout savoir ce qu'on fera.
(Aphorismes du temps présent, p.242, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les propositions admises sans discussion deviennent rarement des mobiles d'action.
(Aphorismes du temps présent, p.242, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La pensée sans action est un vain mirage, l'action sans pensée un vain effort.
(Aphorismes du temps présent, p.243, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Contrairement aux idées démocratiques, la psychologie enseigne que l'entité collective, nommée Peuple, est très inférieure à l'homme isolé.
(Aphorismes du temps présent, trad. #551 &Le démocratique besoin de paraître est le plus coûteux et le moins profitable des besoins. *(, p.244, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La soif d'égalité n'est souvent qu'une forme avouable du désir d'avoir des inférieurs et pas de supérieurs.
(Aphorismes du temps présent, p.245, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'imprécision des doctrines socialistes est un élément de leur succès. Il importe pour un dogme de ne se préciser qu'après avoir triomphé.
(Aphorismes du temps présent, p.247, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Substituer l'initiative et la responsabilité collective à l'initiative et à la responsabilité individuelles, c'est faire descendre l'homme très bas sur l'échelle des valeurs humaines.
(Aphorismes du temps présent, p.249, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Reculer devant l'effort qu'on croit inutile, est renoncer d'avance à tout succès.
(Aphorismes du temps présent, p.250, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les seules révolutions durables sont celles de la pensée.
(Aphorismes du temps présent, p.252, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'être vraiment malheureux est celui à qui on persuade que son était est misérable. Ainsi procèdent les meneurs pour faire les révolutions.
(Aphorismes du temps présent, p.253, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les révolutions qui commencent résultent le plus souvent de croyances qui finissent.
(Aphorismes du temps présent, p.255, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La première phase d'évolution d'une démocratie triomphante est de détruire les anciennes aristocraties, la seconde d'en créer de nouvelles.
(Aphorismes du temps présent, p.258, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Un peuple qui réclame sans cesse l'égalité est bien près d'accepter la servitude.
(Aphorismes du temps présent, p.259, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Toute la politique se ramène à ces deux règles, savoir et prévoir.
(Aphorismes du temps présent, p.260, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Un gouvernement n'est pas le créateur d'une époque, mais sa création.
(Aphorismes du temps présent, p.260, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Juger un évènement inévitable, c'est en faire une fatalité.
(Aphorismes du temps présent, p.261, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- En politique, comme dans la vie, le succès appartient généralement aux convaincus et rarement aux sceptiques.
(Aphorismes du temps présent, p.261, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- En politique, il est moins dangereux de manquer d'idées directrices que d'en avoir de fausses.
(Aphorismes du temps présent, p.262, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le plus sûr moyen de détruire le principe d'autorité est de parler à chacun de ses droits et jamais de ses devoirs. Tous les hommes sont prêts à exercer les premiers, très peu se préoccupent des seconds.
(Aphorismes du temps présent, p.264, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le rôle du savant est de détruire les chimères, celui de l'homme d'État de s'en servir.
(Aphorismes du temps présent, p.265, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'homme supérieur sait utiliser la fatalité, comme le marin utilise le vent, quelle que soit sa direction.
(Aphorismes du temps présent, p.268, Les amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le nombre des soldats victimes de la grande guerre est connu. Celui des idées et des croyances détruites par elle reste encore ignoré.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.282, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La vérité, pour la grande majorité des hommes, étant ce qu'ils croient, c'est surtout avec leurs croyances qu'on doit gouverner les peuples.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.283, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une des graves difficultés de la politique est l'obligation de gouverner avec des idées tenues pour vraies par les multitudes alors que ces idées sont erronées.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.283, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Quel que soit le mode de gouvernement, il aboutit toujours à une oligarchie : permanent dans le régime monarchique, éphémère dans le régime démocratique.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p284., Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Reculer devant un danger a pour résultat certain de le grandir.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.285, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Un ministre ne saurait être le même homme au pouvoir et hors du pouvoir. Au pouvoir, il s'occupe nécessairement des intérêts généraux. Hors du pouvoir, il perçoit seulement ses intérêts personnels, dont le plus essentiel est de remonter au pouvoir.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.285, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Si destructive que soit une croyance politique, elle trouve toujours pour la défendre des intellectuels dont les ambitions dépassaient les capacités.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.289, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Dès qu'elles atteignent un certain degré, les croyances mystiques, religieuses ou politiques, deviennent fatalement destructives.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.290, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une des forces du convaincu est de ne pas discuter la valeur rationnelle de sa croyance.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.290, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- En politique et en religion, le rêve des convaincus fut toujours de pouvoir massacrer sans pitié les hommes qui ne pensent pas comme eux.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.291, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- En politique, une vérité indiscutée n'est souvent qu'une erreur suffisamment répétée.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.291, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Constituer un parti politique revient généralement à revêtir de noms nouveaux des choses fort anciennes.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.293, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une des plus fréquentes sources d'erreurs politiques est d'attribuer à des causes uniques des événements de causes nombreuses et compliquées.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.296, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La crainte des électeurs, la peur des responsabilités, la préoccupation exclusive de l'heure présente, constituent pour un homme politique moderne trois sources d'erreur auxquelles il est difficile d'échapper.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.296, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Suivre toujours l'opinion mobile des multitudes, c'est se résigner à ne rien prévoir, rien empêcher, rien pouvoir.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.297, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Bien que la politique soit certainement l'art dont la pratique exigerait le plus de jugement, c'est celui où il s'en dépense le moins.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.297, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Depuis les origines de l'histoire, les relations entre peuples faibles et peuples forts furent exactement celles du gibier avec le chasseur.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.305, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'idée finit quelquefois par dominer le canon, mais privée de la protection du canon elle reste sans force.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.305, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Ce n'est pas à la liberté mais à la servitude que beaucoup de révolutionnaires modernes aspirent sans le savoir. La liberté n'est conçue par eux que sous forme de soumission à un maître dont les moindres paroles sont des oracles. Toutes les révolutions modernes se terminent par la création d'un autocrate.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.313, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- En politique internationale, les coups d'épingle répétés finissent par engendrer des coups de canon.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.317, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Un allié trop puissant est parfois aussi redoutable qu'un ennemi déclaré. L'alliance d'un peuple faible avec un peuple fort ne constitue généralement pour le peuple faible qu'une forme atténuée de la servitude.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.323, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Dès que le principe d'autorité s'introduit dans une science, le développement de cette science s'arrête.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.328, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une des erreurs démocratiques les plus répandues est de croire que les lois peuvent établir des coutumes. En réalité, les coutumes engendrent finalement des lois, mais les lois ne créent que rarement des coutumes.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.329, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La force ne prime pas le droit, mais le droit ne se démontre que par la force.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.330, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le droit sans force est comparable aux décors de forteresse peints sur les toiles d'un théâtre. Incapables de résister au moindre choc, ils ne conservent leur aspect que si l'on n'y touche pas.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.330, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'extrémisme observé chez tous les partis révolutionnaires est un état mental où l'homme, dominé par une idée fixe, devient incapable de percevoir les réalités et leurs conséquences.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.336, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les extrémistes de toutes opinions possèdent, malgré la divergence des buts poursuivis, des caractères identiques. L'extrémiste sincère est mystique, violent et borné.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.336, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Un extrémiste qui possèderait quelque trace de jugement, de sens critique et de clairvoyance cesserait aussitôt d'être extrémiste.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.336, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le socialisme aux États-Unis diffère totalement du socialisme européen. L'idéal du travailleur américain est de devenir patron, alors que l'ouvrier latin rêve surtout la suppression du patron.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.339, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Si la jalousie, l'envie et la haine pouvaient être éliminés de l'univers, le socialisme disparaîtrait le même jour.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.339, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La discipline rigide acceptée par les adeptes du syndicalisme montre à quel point il deviendra despotique. On peut se demander si l'esclavage total de l'individu ne constitue pas l'aboutissement nécessaire de l'évolution démocratique.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.342, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La liberté n'est, le plus souvent, pour l'homme que la faculté de choisir sa servitude.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.347, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La prédominance actuelle de la technique confère à l'ingénieur et à l'ouvrier une autorité comparable à celle des hommes d'Église pendant le moyen âge.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.349, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Bien des révolutions seront, sans doute, encore nécessaires pour prouver que les changements d'institutions politiques ont une influence très faible sur la vie des nations. C'est la mentalité des peuples et non les institutions qui détermine leur histoire.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.352, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les livres d'histoire révèlent surtout les croyances de leurs auteurs.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.357, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Des ententes provisoires sont supérieures aux alliances parce qu'une alliance, quelle que soit sa forme, ne survit pas à l'évanouissement des intérêts qui la firent naître.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.359, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le grand talent des historiens doués de prestige est de rendre vraisemblables les invraisemblances de l'histoire.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.359, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les découvertes de la psychologie suffisent à montrer que l'histoire classique est le récit d'évènements aussi incompris de leurs auteurs que des écrivains qui les racontèrent.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.359, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Vouloir interpréter au point de vue rationnel un sentiment ou une croyance, c'est s'interdire de les comprendre. Le rationnel dont le rôle se montre si grand dans la genèse des découvertes exerce une très faible influence dans la vie des peuples.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.360, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les contes, les légendes, les oeuvres d'art, les romans même, sont beaucoup plus véridiques que les livres d'histoire. Ils expriment la sensibilité d'une époque, alors que le langage rationnel des historiens ne la fait pas connaître.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.361, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Notre opinion des choses doit naturellement varier avec l'évolution de ces choses. L'ignorant seul possède des opinions invariables.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.361, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Il est aussi difficile de vivre avec les hommes ne changeant jamais d'idées qu'avec ceux qui en changent constamment.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.362, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- On trouve plus facilement mille hommes prêts à obéir qu'un seul capable de prendre une initiative.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.364, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Ne nous plaignons pas trop de voir l'hypocrisie gouverner les hommes. Le monde deviendrait vite un enfer si l'hypocrisie en était bannie.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.364, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'être qui ne sait pas dominer ses impulsions instinctives devient facilement esclave de ceux qui lui proposent de les satisfaire.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.365, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une des grandes causes de faiblesse des peuples latins tient à ce que tout le personnel dirigeant est issu d'examens universitaires prouvant la mémoire des candidats, mais nullement les qualités de caractère qui font la valeur de l'homme dans la vie.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.366, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La raison se met facilement au service des sentiments, alors que ces derniers se mettent rarement au service de la raison. Cette loi psychologique explique l'origine de guerres qu'aucun argument rationnel ne pourrait justifier.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.368, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'habitude, permettant de canaliser les intuitions et réfréner les impulsions, constitue un guide de la vie plus sûr que tous les enseignements des livres.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.369, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La nourriture intellectuelle donnée par l'instruction est comparable à la nourriture matérielle. Ce n'est pas ce qu'on mange qui nourrit, mais seulement ce qu'on digère.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.371, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Beaucoup de nos idées sociales seront transformées lorsqu'on découvrira qu'un ouvrier habile est intellectuellement fort supérieur à un bachelier médiocre.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.371, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Il n'est d'éducation utile que celle cultivant les aptitudes spéciales de chaque être. On obtient alors tout ce que l'élève peut donner sans exiger un inutile travail.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.371, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- En imposant à tous les élèves une instruction identique, on obtient un minimum de rendement avec un maximum d'efforts.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.371, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La discipline peut remplacer bien des qualités. Aucune ne remplace la discipline.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.373, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le jugement sans volonté est aussi inutile que la volonté sans jugement.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.373, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les foules et les individus de mentalité inférieure possèdent ce caractère commun d'être fortement influencés par les évènements présents et très peu par leurs conséquences, si inévitables qu'elles puissent être.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.377, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'erreur individuelle est tenue pour vérité dès qu'elle devient collective. Aucun argument rationnel ne peut alors l'ébranler.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.377, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Une collectivité n'a d'autre cerveau que celui de son meneur.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.378, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Croyances politiques et croyances religieuses ont un même mécanisme de propagation. L'affirmation, la répétition, le prestige et la contagion suffisent à créer des suggestions auxquelles les collectivités résistent rarement.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.378, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La mentalité grégaire des foules permettra toujours aux meneurs d'imposer une doctrine quelconque. Les plus absurdes croyances ne manquèrent jamais d'adeptes.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.379, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les découvertes individuelles transforment les civilisations. Les croyances collectives régissent l'histoire.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.381, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La grande force des décisions collectives réside dans le pouvoir mystique que le nombre exerce sur l'âme des multitudes. C'est pour cette raison que les chefs d'État sont obligés de paraître s'appuyer sur l'opinion populaire.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.381, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Si la publicité des journaux constitue un moyen de persuasion très efficace, c'est que peu d'esprits se trouvent assez forts pour résister au pouvoir de la répétition. Chez la plupart des hommes, elle crée bientôt la certitude.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.383, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- En matière scientifique, pour être cru il faut prouver. En politique, les discours d'un orateur doué de prestige suffisent à créer d'imaginaires certitudes.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.384, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La presse canalise l'opinion beaucoup plus qu'elle ne la dirige. Elle sert aussi à condenser en termes nets des milliers de petites opinions fragmentaires trop incertaines pour être clairement formulées.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.384, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- C'est s'illusionner sur les hommes d'État que s'imaginer qu'ils apporteront dans leurs actes l'énergie manifestée dans leurs discours.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.384, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Croire qu'on doit croire, c'est déjà croire.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.393, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les chrétiens qualifiant d'absurde l'adoration du crocodile par les Égyptiens ou du serpent par les Hindous ne se doutent pas que leurs descendants jugeront aussi absurde l'adoration d'un Dieu jugeant nécessaire de laisser crucifier son fils pour racheter une désobéissance à ses ordres.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.396, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le vrai miracle du Christiannisme est d'avoir pu faire accepter pendant vingt siècles à des esprits capables de raisonner la prodigieuse légende d'un Dieu condamnant son fils à un dégradant supplice et fabricant un enfer éternel pour y punir ses créatures.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.397, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Vouloir comprendre trop vite est se condamner à ne jamais comprendre.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.399, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Vivre c'est changer. Le changement est l'âme des choses.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.400, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Le savant est souvent embarrassé pour déterminer les causes d'un phénomène. L'ignorant ne l'est jamais.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.401, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les hommes se passent facilement de vérités. Ils n'ont jamais vécu sans certitudes.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.402, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Il faut parfois longtemps pour qu'une vérité démontrée devienne une vérité acceptée.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.404, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les faits scientifiquement démontrés restent immuables mais leur explication varie avec les progrès de la connaissance. [...] L'atome, jadis miracle de simplicité, est devenu miracle de complexité.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.404, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La mort intellectuelle commence dès que les opinions deviennent trop fixées pour changer. L'homme, même resté jeune, entre alors dans le domaine des morts. Le présent et l'avenir ne sont plus concevables pour lui qu'enveloppés de passé.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.408, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'espérance de posséder les choses rend-elle plus heureux que la possession de ces choses ? Répondre à cette question impliquerait la connaissance d'un thermomètre du bonheur.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.410, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La hardiesse sans jugement est dangereuse ; le jugement sans hardiesse, inutile.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.410, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Savoir sans vouloir ne crée pas de pouvoir.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.411, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- La vieillesse représente souvent une forme peu atténuée de la servitude.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.411, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- L'injustice dont on profite devient vite de la justice.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.411, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
- Les idées fixes rendent impossible la perception des réalités les plus visibles. Bien voir est souvent aussi difficile que prévoir.
(Les incertitudes de l'heure présente (extraits), p.413, Les Amis de Gustave Le Bon, 1978)
00:05 Publié dans Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustave le bon, sociologie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
125. Geburtstag Emanuel Hirsch
125. Geburtstag Emanuel Hirsch
Karlheinz Weißmann
(Text aus dem Band Vordenker [2] des Staatspolitischen Handbuchs, Schnellroda 2012.)
Selbst seinem theologischen und politischen Hauptgegner, Karl Barth, erschien er als außergewöhnlich »gelehrter und scharfsinniger Mann«, und für Wolfgang Trillhaas, einen der wenigen, die sich mit ihm wissenschaftlich befaßten, als »der letzte Fürst der … evangelischen Theologie «. Sonst ist der Tonfall der Urteile über Emanuel Hirsch im allgemeinen negativ und scharf verurteilend.
Denn Hirsch erscheint als lebender Widerspruch zu der These, daß der Faschismus bzw. Nationalsozialismus per se geistfeindlich und theorieunfähig gewesen sei. Der »Nazi-Intellektuelle « (Robert P. Ericksen) hatte sich 1933 – wie sonst nur noch Heidegger, Schmitt oder Benn – rückhaltlos auf die Seite Hitlers und des NS-Regimes gestellt und anders als die Genannten seine Position auch nicht mehr revidiert. Als junger Dozent und seit 1921 als Professor für Kirchengeschichte galt Hirsch in erster Linie als Träger der von seinem Lehrer Karl Holl eingeleiteten »Lutherrenaissance «. Allerdings war bei Hirsch in der Nachkriegszeit schon eine gewisse Akzentverschiebung zu erkennen, die man im Grunde nur als Neuaufnahme liberaler Vorstellungen deuten konnte. Er betonte jedenfalls, daß es notwendig sei, zwischen der »Dialektischen Theologie« und dem »jungen Luthertum« zu vermitteln.
Ein Grund für seine Bemühungen in diese Richtung war weniger theologischer, eher politischer, im Grunde theologisch-politischer Natur. Denn Hirsch gehörte zu denen, die nicht nur unter der Kriegsniederlage und dem Versailler Vertrag litten, sondern die auch nicht verwanden, daß das Augusterlebnis von 1914 ohne bleibende Bedeutung für die Volksgemeinschaft geblieben war. Schon in seinem 1920 erschienenen Buch Deutschlands Schicksal – das bis 1925 drei Auflagen erlebte – hatte er seine Position unmißverständlich zum Ausdruck gebracht und sich als Vertreter der Konservativen Revolution zu erkennen gegeben. Allerdings war Hirschs Kritik der Weimarer Republik in der Hinsicht gemäßigt, daß er die Legitimität der neuen Verhältnisse prinzipiell anerkannte, vorausgesetzt, sie erwiesen sich tüchtig, den Deutschen zum Wiederaufstieg zu verhelfen. Bis zum Beginn der dreißiger Jahre hielt Hirsch an dieser Position fest und galt neben dem ihm eng verbundenen Paul Althaus als führender Kopf der Jungkonservativen im deutschen Protestantismus.
Öffentlich bekannte er sich bis 1932 zur DNVP, nahm dann allerdings vor der Reichspräsidentschaftswahl gegen Hindenburg und für Hitler Stellung. Der Vorgang erregte Aufsehen und führte zu scharfen Angriffen auf Hirsch, die ihn aber unbeeindruckt ließen. Er begründete in dem Buch Von christlicher Freiheit (1934) seinen Schritt theologisch und verwies auf die Notwendigkeit der wagenden Entscheidung. Zwischen Hirschs theologischen Auffassungen und denen einiger seiner schärfsten Gegner bestand allerdings nicht selten eine strukturelle Ähnlichkeit. Denn es gab bei ihm nicht nur die Nähe zu allen, die darauf beharrten, daß Gottes Handeln für den Christen in der Geschichte ablesbar bleiben müsse, sondern auch eine Art Deckungsgleichheit mit dem Programm der »Entmythologisierung« und der Vorstellung vom »mündigen Christentum«.
Was den ersten Punkt betrifft, so hat Hirsch nicht nur dezidiert zugunsten Bultmanns Stellung genommen und verlangt, daß jene »mythenzerstörende Reflexion« vorangetrieben werde, die mit der historischen Bibelkritik ihren Anfang genommen habe. Es gibt bei ihm auch Formulierungen, die fast denen Bonhoeffers gleichen, der im Kern wie Hirsch davon ausging, daß sich das »Wahrheitsverständnis« seit der Aufklärung ein für allemal verändert habe und die tradierten Vorstellungen von Gott, Kirche und Glaube nicht mehr aufrechtzuerhalten seien. Daß das alles gemeinhin übersehen wird, hat in erster Linie damit zu tun, daß die theologische Entwicklung Hirschs in den dreißiger und frühen vierziger Jahren verdeckt wird durch die Hartnäckigkeit, mit der er an seiner Auffassung von Gottes Tat an Hitler und dem Nationalsozialismus festhielt und die Vorstellung verteidigte, daß sich mit Hilfe der »Glaubensbewegung Deutsche Christen« (DC) der notwendige kirchliche Neuansatz bewerkstelligen lasse.
Tatsächlich war Hirsch – abgesehen von Gerhard Kittel – der einzige evangelische Theologe von Rang, der zur DC hielt, und in seiner Zeit als Dekan der Göttinger Theologischen Fakultät, wo er 1936 den Lehrstuhl für Systematik übernommen hatte, versuchte er auch das Programm des Reichskirchenministeriums gegen alle Widerstände der »Bekennenden« durchzusetzen. Nach seinem Rücktritt als Dekan, 1939, zog Hirsch sich zwar weitgehend auf die wissenschaftliche Arbeit zurück, aber daraus kann nicht auf einen Gesinnungswandel geschlossen werden. Das gute Dutzend Bücher, das er zwischen 1933 und 1943 abfaßte, diente vor allem dem Zweck, eine Bilanz der Entwicklung des Christentums zu ziehen und die Frage zu klären, welche Wege in Zukunft noch gangbar seien. In diesen Zusammenhang gehört auch das für jeden Theologen bis heute unverzichtbare Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik (1937).
Man muß die außerordentliche Leistung Hirschs auch angesichts der Tatsache würdigen, daß er schon in seiner Jugend ein Auge verloren hatte und auf dem anderen seit Beginn der dreißiger Jahre erblindet war. Als er am 30. Mai 1945 einen Antrag stellte, wegen Dienstunfähigkeit aus dem Amt zu scheiden, war der eigentliche Grund allerdings, daß er die Entnazifizierung umgehen wollte. Es gab später Versuche, ihn regulär zu emeritieren, die aber alle fehlschlugen. Hirsch hat trotzdem seine wissenschaftliche – und in steigendem Maß – seine schriftstellerische Tätigkeit fortgesetzt.
Abgesehen davon, daß seine Hauptwerke wegen ihres Rangs immer weiter erschienen und einige neuere Arbeiten – etwa die magistrale, fünf Bände umfassende Geschichte der neueren evangelischen Theologie (1949– 1954) oder Hauptfragen christlicher Religionsphilosophie (1963) – ohne Zögern von großen Verlagen in deren Programm aufgenommen wurden, hatte Hirsch eine Art »Gemeinde« (um den Verlag »Die Spur«), die auch eine ambitionierte, bis in die Gegenwart fortgesetzte Gesamtausgabe vorantrieb, und ähnlich wie Schmitt einen »Hof« und einen engeren Kreis von Anhängern, die sich um den großen Verfemten sammelten und mehr oder weniger offen zu ihm bekannten.
Schriften: Fichtes Religionsphilosophie im Rahmen der philosophischen Gesamtentwicklung Fichtes, Göttingen 1914; Christentum und Geschichte in Fichtes Philosophie, Tübingen 1920; Deutschlands Schicksal, Göttingen 1920; Die gegenwärtige geistige Lage, Göttingen 1934; Christliche Freiheit und politische Bindung, Hamburg 1935; Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik, 1937 (4. Aufl. 2002); Die Umformung des christlichen Denkens in der Neuzeit, Tübingen 1938; Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens, 5 Bde., Gütersloh 1949–54 (5. Aufl. 1975); Hauptfragen christlicher Religionsphilosophie, Berlin 1963.
Literatur: Ulrich Barth: Die Christologie Emanuel Hirschs, Berlin 1992; Robert P. Ericksen: Theologen unter Hitler: Das Bündnis zwischen evangelischer Dogmatik und Nationalsozialismus, München 1986; Joachim Ringleben (Hrsg.): Christentumsgeschichte und Wahrheitsbewußtsein: Studien zur Theologie Emanuel Hirschs, Berlin 1991.
Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de
URL to article: http://www.sezession.de/39342/125-geburtstag-emanuel-hirsch.html
URLs in this post:
[1] Image: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2013/02/9783935063562.jpg
[2] Vordenker: http://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/staatspolitisches-handbuch/33/staatspolitisches-handbuch-band-3-vordenker
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théologie, emanuel hirsch, allemagne, révolution conservatrice, christologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 13 juin 2013
P. Gottfried: My Meetings with Herbert Marcuse
00:05 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, herbert marcuse, paul gottfried, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Anarchie et Christianisme de Jacques Ellul
"Anarchie et Christianisme" de Jacques Ellul
Ex: http://cerclenonconforme.hautetfort.com/
 Anarchie et Christianisme, deux gros mots pour certains, deux mots inconciliables pour d’autres. Jacques Ellul ne s’y trompe pas et l’écrit lui-même en introduction:
Anarchie et Christianisme, deux gros mots pour certains, deux mots inconciliables pour d’autres. Jacques Ellul ne s’y trompe pas et l’écrit lui-même en introduction:
« La question ici posée est d’autant plus difficile que les certitudes à ce sujet sont établies depuis longtemps, des deux côtés, et jamais soumises à la moindre interrogation. Il va de soi que les anarchistes sont hostiles à toutes religions (et le christianisme est de toute évidence classé dans la catégorie), il va non moins de soi que les pieux chrétiens ont horreur de l’anarchie, source de désordre et négation des autorités établies. » (p.7)
Jacques Ellul aborde ici deux sujets qui lui tiennent à cœur. L’auteur est surement un des plus brillants intellectuels d’après-guerre. Spécialiste de Marx il prend pourtant parti pour la mouvance anarchiste. Protestant, il brosse une vision d’un christianisme qui se rapproche du christianisme des origines, ce « bolchevisme de l’Antiquité » qu’a tant fustigé la Nouvelle Droite. Il demeure aussi un spécialiste du droit romain et un critique de la pensée bourgeoise et de la technique. Il est l’auteur, à la suite de Léon Bloy, d’Exégèse des nouveaux lieux communs (1966).
Anarchie et Christianisme est un livre assez court, 160 pages environ dans l’édition dont je dispose. Encore une fois, il est assez appréciable de pouvoir lire des livres synthétiques, sans que cela dénature la pensée ou le propos de l’auteur. Deux grandes parties structurent cet ouvrage. Tout d’abord le Chapitre Ier : L’anarchie du point de vue d’un chrétien puis le Chapitre II : La Bible, source d’anarchie.
L’auteur commence par poser les bases de son anarchisme : « Si j’écarte l’anarchisme violent, reste l’anarchisme pacifiste, antinationaliste, anticapitaliste, moral, antidémocratique (c'est-à-dire hostile à la démocratie falsifiée des Etats bourgeois), agissant par des moyens de persuasion, par la création de petits groupes et de réseaux, dénonçant les mensonges, les oppressions, avec pour objectif le renversement réel des autorités quelles qu’elles soient, la prise de parole par l’homme de la base, et l’auto-organisation. Tout cela est très proche de Bakounine. » (p.24)
Cette partie est d’ailleurs remarquablement intéressante car Jacques Ellul plaide pour des actions de rupture avec la société. L’auteur donne un certain nombre de domaines : refus de l’enseignement obligatoire, du service militaire, des vaccinations, de la police, retour à la terre, … et donne l’exemple d’un ami à lui, persécuté par l’administration pour avoir refusé de vacciner son bétail… Lorsque nous voyons le chemin parcouru depuis, avec les normes toujours plus drastiques de l’UE, soutenu par les lobbies pharmaceutiques, chimiques, etc…, on ne peut que saluer la clairvoyance de ces quelques lignes. D’ailleurs, la profondeur de sa pensée s’exprime en ces quelques mots : « Bien attendu, ce ne sont que des petites actions, mais si on en mène beaucoup, si on est vigilant, on peut faire reculer l’omniprésence de l’Etat. Compte tenu que la « décentralisation » menée à grand bruit par Defferre a rendu la défense de la liberté beaucoup plus difficile. Car l’ennemi ce n’est pas l’Etat central aujourd’hui, mais l’omnipotence et l’omniprésence de l’administration. » (p.28). Décédé en 1994, Jacques Ellul n’aura pas eu le temps de mesurer les effets dévastateurs du traité de Maastricht soutenu par la gauche (y compris Mélenchon). Lui le pourfendeur de l’administration et des techniciens… traité qui rajoute des contraintes à celles dénoncées par Ellul dans l’action des mouvements dissidents. Par ailleurs, comme le rappelle l’auteur « qui paie, commande ! » (p.29). Une phrase qui devrait restée gravée dans les esprits, car elle est non seulement au cœur du rapport de domination capitaliste, mais également plus largement dans la plupart des rapports de domination entre les hommes.
Ces quelques pages sur l’anarchisme sont très vivifiantes pour accroître certaines réflexions quant aux façons d’agir. Jacques Ellul aura écrit avant l’avènement d’internet, qui constitue aujourd’hui un formidable moyen de contournement de l’Etat et de diffusion des idées comme le sont les radios internet (Méridien Zéro) ou les différents blogs (Novopress, Zentropa, …). La technologie peut avoir du bon…
La deuxième partie, La Bible, source d’anarchie défend la thèse selon laquelle le message du Christ, puissamment révolutionnaire, s’oppose aux différentes formes de domination de l’homme par l’homme selon le sens composé à partir du grec an-arkhé. Cette partie se présente donc comme une forme d’exégèse et s’attarde aussi sur la Bible hébraïque, problématique de ce point de vue, en raison de l’omniprésence des figures royales. Jacques Ellul fait aussi œuvre d’historien, en replaçant le message christique dans son contexte et particulièrement dans celui de l’affrontement avec le pouvoir romain et le pouvoir hérodien, dépendant des Romains. Un élément est particulièrement intéressant dans cette partie du livre, la réflexion sur le Diable, bâti sur le terme grec diabolos, qui signifie « le diviseur ». Pour Ellul, « l’Etat et la politique sont facteurs de division entre les hommes ». Cette réflexion pourrait faire écho à cet extrait de l’Epitre aux Galates de Paul de Tarse : « Il n’y a plus ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n’y a plus l’homme et la femme ; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus-Christ. » Un chrétien doit donner sa priorité à la Foi et tenter de rompre les barrières qui divisent l’humanité. La sous-partie Apocalypse est d’ailleurs très claire sur ces différents points d’après l’auteur : « […] il y’a une opposition radicale entre la Majesté de Dieu et toutes les puissances et pouvoirs de la terre (d’où l’erreur considérable de ceux qui disent qu’il y’a continuité entre le pouvoir divin et les pouvoirs terrestres, ou encore, comme sous la monarchie, qu’à un Dieu unique, tout-puissant, régnant dans le ciel, doit correspondre sur Terre un Roi unique, également tout-puissant ; l’Apocalypse dit exactement le contraire !) »
Nous ne doutons pas que cette seconde partie, dont nous vous laissons découvrir l’intégralité de la réflexion, pour éviter les raccourcis, suscitera des débats autant au sein des Chrétiens, qu’au sein de tous ceux qui sont attachés à leur terre, à leur patrie.
Ce qui me frappe dans la lecture de ce petit livre, c’est qu’on y trouve une pensée qui s’oppose en bien des points à ce qui fut celle de la Nouvelle Droite et en particulier de celle de Dominique Venner qui notait dans le Choc de l’histoire ou encore dernièrement dans son testament politique que l’Europe n’avait pas de religion identitaire (à l’inverse, par exemple, de l’Inde). La ND proclame une pensée très marquée par le paganisme et l’importance de la hiérarchie (aristocraties), là où Ellul en chrétien sincère s’y oppose. Pourtant, je dois bien admettre que la pensée d’Ellul est fortement « séduisante » car elle présente un christianisme qui s’oppose dans ses bases au monde dans lequel nous vivons et qui offre l’espérance.
Que l’on s’intéresse à la pensée anarchiste, au christianisme ou qu’on cherche quelques « cartouches intellectuelles », la lecture d’Anarchie et Christianisme s’impose. C’est aussi un moyen d’entrer en contact avec la pensée de Jacques Ellul avec ce qu’elle a de plus profonde : sa foi chrétienne.
Jean
Note du C.N.C.: Toute reproduction éventuelle de ce contenu doit mentionner la source.
00:05 Publié dans Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anarchie, christianisme, jacques ellul, philosophie, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 12 juin 2013
Prophetisches bei Ernst von Lasaulx

Prophetisches bei Ernst von Lasaulx
von Michael Rieger
Ex: http://www.sezession.de
Ernst von Lasaulx (1805 bis 1861) gehört nicht eben zu den Autoren, die einem ständig unterkommen. Nur zwei Seiten und zwei kurze Erwähnungen finden sich zu „Spenglers Vorgänger“ in Othmar Spanns Geschichtsphilosophie von 1932. Doch diese kurzen Passagen haben es in sich – sie regen an zur genaueren Lektüre, erscheinen sie doch heute als geradezu prophetisch.
In seinem 1856 veröffentlichten Neuen Versuch einer alten auf die Wahrheit der Thatsachen gegründeten Philosophie der Geschichte [2] entwirft Lasaulx ein Modell des Verfalls von Völkern. Im Rückgang der Zeugungskraft (dem nisus formativus, dem Bildungs- und Reproduktionstrieb) wird der Verfall sichtbar: „Es stocken die Säfte, die Zeugungskraft beginnt zu erlöschen, das Leben sinkt, und seine Formen zerfallen, sichtbar von außen nach innen, weil unsichtbar im Innern die Triebkraft aufgehört hat.“
Nehmen wir es ganz wörtlich: Es ist kein Geheimnis, dass die Fruchtbarkeitsrate in Deutschland seit etwa 1965 gesunken ist. 1965 lag sie noch bei 2,5 Kindern pro Frau, seit etwa 40 Jahren liegt sie jetzt relativ stabil bei 1,3 Kindern pro Frau. Sie hat sich also nahezu halbiert. Mögen auch in anderen Ländern „die Säfte stocken“, Deutschland ist mit 8,2 Geburten auf 1000 Einwohner das Schlusslicht in der Europäischen Union.
Lasaulx führt aus, dass der Verfall den Verlust der „sprachbildenden Kraft“ einschließt. Sprache sei „nicht bloss das Organ des Denkens“, sondern „sie ist mit dem Denken selbst zusammengewachsen, die Vollendung des Denkens“. Verlöscht die sprachbildende Kraft, ist es ums Denken schlecht bestellt. So banal es klingt – die beständig und wirkungslos kritisierten Anglizismen belegen den aktuellen Rückgang der sprachbildenden Kraft. Anstatt eine eigene Sprache zu bilden, zu „er-zeugen“ und eventuell sogar zu pflegen, werden Worte aus einer anderen Sprache übernommen. Das ist weitaus bequemer, man muss sich keine eigenen Gedanken mehr machen, Kreativität wird nicht abgefordert, sondern abgetötet.
So sind wir Eyecatchern, Sales Managern, Facility Managern, Mobbing und Gamern bis zum Erbrechen ausgesetzt. Was im Alltag bereits eine Katastrophe ist, wird nicht besser, wenn wir nach der „poetischen Kraft im Leben der Künste“ fragen. Wie es um die poetische Dimension der Sprache bestellt ist, kann nicht so einfach beantwortet werden, wie der uns medial überflutende sprachliche Verfall nur noch zu diagnostizieren bleibt. Dennoch: ein spezifisches Kennzeichen der Literatur seit den 1960er Jahren ist in der Öffnung für das Profane zu sehen. Zeitweise wurde das eigentlich Poetische ersetzt durch bloß reproduktiven Dokumentarismus. Es gibt sie noch die Sprachartisten, aber unbestreitbar hat sich das platt Parteipolitische, Plebejische und Primitive mit und in der Folge von Günter Grass, Hubert Fichte und Rainald Goetz sein literarisches Terrain erobert (Aus dem Tagebuch einer Schnecke, Die Palette, Irre).
Lasaulx Vorstellung des Völkerverfalls bezieht natürlich auch den Verlust „der religiösen Glaubenskraft“ mit ein. Der Rückgang der traditionellen Bekenntnisse lässt sich leicht an einer Stadt wie Hamburg ablesen. Wer Hamburg noch als „typisch protestantisch“ abgespeichert hat, hängt Erinnerungen an. Waren gegen Ende des 19. Jahrhunderts beinahe 95% der Hamburger Protestanten, so sind es heute noch nur noch etwa 28%. Nimmt man nun die 10% Katholiken hinzu, dann lautet das Ergebnis: 60% aller in Hamburg lebenden Menschen bekennen sich nicht zum Christentum. Das sieht im Bundesdurchschnitt anders aus. Im Moment bekennen sich noch 60% der Bevölkerung zur römisch-katholischen oder zur evangelischen Kirche. Die Entwicklungstendenz ist jedoch eindeutig vorgezeichnet.
Wo die Zeugungskraft abnimmt, die Sprache sorglos auf den Hund gekommen ist, der Literaturbegriff längst für Werbetexte und Klosprüche geöffnet wurde, die Religion allgemein im Schwinden begriffen ist – wie steht es da um die „politische Lebensenergie“? Sie steht Angela Merkel so sehr ins Gesicht geschrieben wie den Herren Gabriel oder Steinbrück. Dazu sehr passend Ernst von Lasaulx: „Wie das Kränkeln Hinwelken Verdorren der Blätter und Äste eines Baumes ein Zeichen ist, dass die Wurzel krank sei: so müssen auch bei sinkenden und zerfallenden Völkern die äusseren Erscheinungen als die Folgen einer inneren Erschlaffung betrachtet werden.“
Angesichts dieser politischen Klasse mag man gar nicht fragen nach dem Stand der „nationalen Sittlichkeit“, dem „Product der religiösen und der politischen Ideale“. Wer wollte heute überhaupt noch sprechen von etwas so Reaktionärem wie Sittlichkeit oder den Romantizismen politischer Ideale? Und was könnte darunter zu verstehen sein? Meinungsfreiheit? Fragen wir Norbert Geis. Oder ein plurales Europa der Regionen? Dafür sorgt unbeirrbar Martin Schulz. Und wo werden diese Ideale wahrgemacht? In Kirchweyhe? Womit wir wieder bei der Sittlichkeit wären.
Was Lasaulx an den oben ausgeführten Punkten festgemacht hat, setzt sich fort „bis der ganze Organismus, nur auf die Befriedigung der materiellen Bedürfnisse reducirt, seelenlos auseinanderfällt“.
Lasaulx Neuen Versuch einer alten auf die Wahrheit der Thatsachen gegründeten Philosophie der Geschichte kann man hier zum Selbststudium erwerben [2].
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, ernst von lasaulx, allemagne, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 10 juin 2013
LA POSMODERNIDAD: NUEVO RÉGIMEN DE VERDAD, VIOLENCIA METAFÍSICA Y FIN DE LOS METARRELATOS
LA POSMODERNIDAD: NUEVO RÉGIMEN DE VERDAD, VIOLENCIA METAFÍSICA Y FIN DE LOS METARRELATOS
de Dr. Adolfo Vasquez Rocca
(Universidad Católica de Valparaíso – Universidad Complutense de Madrid)
Ex: http://rinabrundu.com/
1.- De la destotalización del mundo a la obsesión epistemológica por los fragmentos.
Lo que se denomina “posmodernidad” aparece como una conjunción ecléctica de teorías. Esa amalgama va desde algunos planteamientos nietzscheanos e instintivistas hasta conceptos tomados del Pragmatismo anglosajón hasta pasar por retazos terminológicos heideggerianos, nietszcheanos y existencialistas. Se trata, pues, de un tipo de pensamiento en el que caben temáticas dispersas y, a menudo, conjuntadas sin un hilo teórico claro.
La posmodernidad no es una época que se halle después de la modernidad como etapa de la historia. El “post” de la posmodernidad, a juicio de Gianni Vattimo[1], es “espacial” antes que “temporal”. Esto quiere decir que estamos sobre la modernidad. La Posmodernidad no es un tiempo concreto ni de la historia ni del pensamiento, sino que es una condición humana determinada, como insinúa Lyotard en La condición postmoderna[2].
El término posmodernidad nace en el domino del arte y es introducido en el campo filosófico hace tres décadas por Jean Lyotard con su trabajo La condición postmoderna[3].
Jean-Francois Lyotard explica la Condición postmoderna de nuestra cultura como una emancipación de la razón y de la libertad de la influencia ejercida por los “grandes relatos”, los cuales, siendo totalitarios, resultaban nocivos para el ser humano porque buscaban una homogeneización que elimina toda diversidad y pluralidad: “Por eso, la Posmodernidad se presenta como una reivindicación de lo individual y local frente a lo universal. La fragmentación, la babelización, no es ya considerada un mal sino un estado positivo” porque “permite la liberación del individuo, quien despojado de las ilusiones de las utopías centradas en la lucha por un futuro utópico, puede vivir libremente y gozar el presente siguiendo sus inclinaciones y sus gustos”.
La posmodernidad, dice Lyotard, es una edad de la cultura. Es la era del conocimiento y la información, los cuales se constituyen en medios de poder; época de desencanto y declinación de los ideales modernos; es el fin, la muerte anunciada de la idea de progreso.
2.- De los grandes relatos a las petites histoires.
El término posmodernidad puede ser identificado, como lo hace Habermas, con las coordenadas de la corriente francesa contemporánea de Bataille a Derrida, pasando por Foucault, con particular atención al movimiento de la deconstrucción de indudable actualidad y notoria resonancia en la intelectualidad local. Las oposiciones binarias que rigen en Occidente -sujeto/objeto, apariencia/realidad, voz/escritura, etc. construyen una jerarquía de valores nada inocente, que busca garantizar la verdad y sirve para excluir y devaluar los términos inferiores de la oposición. Metafísica binaria que privilegia la realidad y no la apariencia, el hablar y no el escribir, la razón y no la naturaleza, al hombre y no a la mujer. Hace falta una deconstrucción completa de la filosofía moderna y una nueva práctica filosófica.
La era moderna nació con el establecimiento de la subjetividad[4] como principio constructivo de la totalidad. No obstante, la subjetividad es un efecto de los discursos o textos en los que estamos situados[5]. Al hacerse cargo de lo anterior, se puede entender por qué el mundo postmoderno se caracteriza por una multiplicidad de juegos de lenguaje que compiten entre sí, pero tal que ninguno puede reclamar la legitimidad definitiva de su forma de mostrar el mundo.
Con la deslegitimación de la racionalidad totalizadora procede lo que ha venido en llamarse el fin de la historia. La posmodernidad revela que la razón ha sido sólo una narrativa entre otras en la historia; una gran narrativa, sin duda, pero una de tantas. Estamos en presencia de la muerte de los metarrelatos, en la que la razón y su sujeto –como detentador de la unidad y la totalidad– vuelan en pedazos. Si se mira con más detenimiento, se trata de un movimiento de deconstrucción del cogito y de las utopías de unidad. Aquí debe subrayarse el irreductible carácter local de todo discurso, acuerdo y legitimación. Esto nos instala al margen del discurso de la tradición literaria (estética) occidental. Tal vez de ahí provenga la vitalidad de los engendros del discurso periférico, en Los Margenes de la Filosofía[6] como dirá Derrida.
La destotalización del mundo moderno exige eliminar la nostalgia del todo y la unidad. Como características de lo que Foucault ha denominado la episteme[7] posmoderna podrían mencionarse las siguientes: deconstrucción, descentración, diseminación, discontinuidad, dispersión. Estos términos expresan el rechazo del cogito que se había convertido en algo propio y característico de la filosofía occidental, con lo cual surge una “obsesión epistemológica” por los fragmentos.
La ruptura con la razón totalizadora supone el abandono de los grands récits, es decir, de las grandes narraciones, del discurso con pretensiones de universalidad y el retorno de las petites histoires. Tras el fin de los grandes proyectos aparece una diversidad de pequeños proyectos que alientan modestas pretensiones. Aquí se insiste en el irreductible pluralismo de los juegos de lenguaje, acentuando el carácter local de todo discurso, y la imposibilidad de un comienzo absoluto en la historia de la razón. Ya no existe un lenguaje general, sino multiplicidad de discursos. Y ha perdido credibilidad la idea de un discurso, consenso, historia o progreso en singular: en su lugar aparece una pluralidad de ámbitos de discurso y narraciones.
Además de señalar que la desmitologización de los grandes relatos es lo característico de la posmodernidad, es necesario aclarar que estos metarrelatos no son propiamente mitos, en el sentido de fábulas. Ciertamente tienen por fin legitimar las instituciones y prácticas sociales y políticas, las legislaciones, las éticas. Pero, a diferencia de los mitos, no buscan esta legitimación en un acto fundador original, sino en un futuro por conseguir, en una idea por realizar. De ahí que la modernidad sea un proyecto.
Los metarrelatos son las verdades supuestamente universales, últimas o absolutas, empleadas para legitimar proyectos políticos o científicos. Así por ejemplo, la emancipación de la humanidad a través de la de los obreros (Marx), la creación de la riqueza (Adam Smith), la evolución de la vida (Darwin), la dominación de lo inconsciente (Freud), etc.
El mundo postmoderno ha desechado los metarrelatos. El metarrelato es la justificación general de toda la realidad, es decir, la dotación de sentido a toda la realidad. Ninguna justificación puede alcanzar a cubrir toda la realidad, ya que necesariamente caerá en alguna paradoja lógica o alguna insuficiencia en la construcción (especialmente en la completitud o en la coherencia) y que desdicen sus propias pretensiones onmiabarcantes. El hombre postmoderno no cree ya los metarrelatos, el hombre postmoderno no dirige la totalidad de su vida conforme a un solo relato, porque la existencia humana se ha vuelto tan enormemente compleja que cada región existencial del ser humano tiene que ser justificada por un relato propio, por lo que los pensadores postmodernos llaman microrrelatos.
El microrrelato tiene una diferencia de dimensión respecto del metarrelato, pero esta diferencia es fundamental, ya que sólo pretende dar sentido a una parte delimitada de la realidad y de la existencia. Cada uno de nosotros tiene diferentes microrrelatos, probablemente desgajados de metarrelatos, que entre ellos pueden ser contradictorios, pero el ser humano postmoderno no vive esta contradicción porque él mismo ha deslindado cada una de esta esfera hasta convertirlas en fragmentos. El hombre postmoderno vive la vida como un conjunto de fragmentos independientes entre sí, pasando de unas posiciones a otras sin ningún sentimiento de contradicción interna, puesto éste entiende que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero esto no quiere decir que los microrrelatos no sean cambiables sin mayor esfuerzo, ya que los microrrelatos responden al criterio fundamental de utilidad, esto es, son de tipo pragmáticos.
Ahora bien, si no hay metarrelatos tampoco hay utopías. La única utopía posible –si acaso pudiera todavía haber una– es la huida del mundo y de la sociedad y por la conformación del espacio utópico en el seno de la intimidad, con determinados elementos degradados de las tradiciones orientales, de los los nuevos orientalismos. Es una utopía fragmentada para un mundo fragmentado, una religión muy propia de la Posmodernidad, sin sacrificios y sin privaciones.
¿En qué punto nos encontramos ahora? Sin duda en el dominio de la interpretación y la sobreinterpretación. Las interpretaciones dotan de sentido a los hechos. La interpretación es una condición necesaria para que podamos conocer la realidad, para que nos podamos relacionar con ella. La interpretación cuaja en la tradición y es el conocimiento de nuestras formas de interpretación el objeto de la ciencia central de la Posmodernidad: la Hermenéutica. La Hermenéutica tiene sus orígenes en los principios del conocimiento humano, no en vano Aristóteles escribe una tratado sobre la interpretación. Con Gadamer[8] la Hermenéutica cobra un nuevo giro, ya no pretende aprehender el verdadero y único sentido del texto, sino manifestar las diversas interpretaciones del texto y las diversas formas de interpretar. Hemos aludido por primera vez a un elemento fundamental del pensamiento postmoderno: el texto.
En la posmodernidad, si la entendemos como Filosofía del Lenguaje o Teoría Literaria el texto se independiza del autor hasta tal punto de que el autor puede ser obviado. En la posmodernidad hay dos tendencias muy marcadas y contradictorias sobre la autoría, la que la desprecia por centrarse únicamente en el texto y la que quiere explicar el texto como trasunto del autor. No cabe hablar propiamente de un autor, pues el autor del texto se ha perdido, como también se ha perdido el ser humano como sujeto, es decir, como director libre de sus acciones.
Gianni Vattimo, por su parte, define el pensamiento posmoderno con claridad: en él lo importante no son los hechos sino sus interpretaciones. Así como el tiempo depende de la posición relativa del observador, la certeza de un hecho no es más que eso, una verdad relativamente interpretada y por lo mismo, incierta. La posmodernidad, por más polifacética que parezca, no significa una ética de carencia de valores en el sentido moral, pues precisamente su mayor influencia se manifiesta en el actual relativismo cultural. La moral posmoderna es una moral que cuestiona el cinismo religioso predominante en la cultura occidental y hace hincapié en una ética basada en la intencionalidad de los actos y la comprensión inter y transcultural de corte secular de los mismos. En este sentido la posmodernidad abre el camino, según Vattimo, a la tolerancia, a la diversidad. Es el paso del pensamiento fuerte, metafísico, de las cosmovisiones filosóficas bien perfiladas, de las creencias verdaderas, al pensamiento débil, a una modalidad de nihilismo débil, a un pasar despreocupado y, por consiguiente, alejado de la acritud existencial.
Vattimo ha elaborado la idea de un pensamiento débil[9] como portavoz de la sospecha, se trata de un pensamiento eminentemente crítico, no tolera ninguna pretensión totalitaria sobre la realidad, ningún pensamiento que quiere trascender los límites del microrrelato. Detrás de cada intención totalitaria, de cada metarelato como pretensión de interpretación última y definitiva sobre la realidad y el sentido del mundo se esconde un interés del poder, de un poder manifiesto u oculto, que, a través del lenguaje ontologizado y ontologizante –metafísico y/o teológico, quiere someter la realidad a una visión univoca y normativa, anulando y vaciando la potencialidad humana de hacer y crear mundos.
Debemos situar el punto de partida de este paradigma –del asalto a la razón – en la filosofía de Nietzsche, aunque ubicado poco antes, contemporáneo al Iluminismo, debemos hacer justicia al Romanticismo,corriente continental que inició la crítica de la Modernidad poniendo énfasis, ya no en la razón, sino en la intuición, la emoción, la aventura, un retorno a lo primitivo, el culto al héroe, a la naturaleza y a la vida, y por sobre todas las cosas una vuelta al panteísmo. Nietzsche se encargará de revitalizar estos motivos casi un siglo más tarde, imprimiéndole su sello propio, una filosofía cuyos rasgos esenciales han de ser el individualismo, un relativismo gnoseológico y moral, vitalismo, nihilismo y ateísmo, todo esto sobre un telón de fondo irracionalista.
Gianni Vattimo tiene razón cuando ve en Nietzsche el origen del postmodernismo, pues él fue el primero en mostrar el agotamiento del espíritu moderno en el ‘epigonismo’. De manera más amplia, Nietzsche es quien mejor representa la obsesión filosófica del Ser perdido, del nihilismo triunfante después de la muerte de Dios.
El postmodernismo aparece, pues, como resultado de un gran movimiento de des-legitimación llevado a cabo por la modernidad europea, del cual la filosofía de Nietzsche sería un documento temprano y fundamental.
La posmodernidad puede ser así entendida como una crítica de la razón ilustrada tenida lugar a manos del cinismo contemporáneo. Baste pensar en Sloterdijk y su Crítica de la razón cínica[10], donde se reconoce como uno de los rasgos reveladores de la Posmodernidad el anhelo por momentos de gran densidad crítica, aquellos en que los principios lógicos se difuminan, la razón se emancipa y lo apócrifo se hermana con lo oficial, como acontece según Sloterdijk con el nihilismo desde Nietzsche, y aun desde los griegos de la Escuela Cínica.
La ruptura con la razón totalizadora aparece, por un lado como abandono de los grandes relatos –emancipación de la humanidad–, y del fundamentalismo de las legitimaciones definitivas y como crítica de la “totalizadora” ideología sustitutiva que sería la Teoría de Sistemas.
La posmodernidad ha impulsado –al amparo de esta crítica– “un nuevo eclecticismo en la arquitectura, un nuevo realismo y subjetivismo en la pintura y la literatura, y un nuevo tradicionalismo en la música”[11]. La repercusión de este cambio cultural en la filosofía ha conducido a una manera de pensar que se define a sí misma, según he anticipado, como fragmentaria y pluralista, que se ampara en la destrucción de la unidad del lenguaje operada a través de la filosofía de Nietzsche y Wittgenstein.
Lo específicamente postmoderno son los nuevos contextualismos o eclecticismos. La concepción dominante de la posmodernidad acentúa los procesos de desintegración. Subyace igualmente un rechazo del racionalismo de la modernidad a favor de un juego de signos y fragmentos, de una síntesis de lo dispar, de dobles codificaciones; la sensibilidad característica de la Ilustración se transforma en el cinismo contemporáneo: pluralidad, multiplicidad y contradicción, duplicidad de sentidos y tensión en lugar de franqueza directa, “así y también asa” en lugar del univoco “o lo uno o lo otro”, elementos con doble funcionalidad, cruces en lugar de unicidad clara Un singular “Ni sí ni no, sino todo lo contrario. El último reducto posible para la filosofía” –como señalará Nicanor Parra en su Discurso de Guadalajara[12].
Así, con la posmodernidad se dice adiós a la idea de un progreso unilineal, surgiendo una nueva consideración de la simultaneidad, se hace evidente también la imposibilidad de sintetizar formas de vida diferentes, correspondientes a diversos patrones de racionalidad.
La posmodernidad, como proceso de descubrimiento, supone un giro de la conciencia, la cual debe adoptar otro modo de ver, de sentir, de constituirse, ya no de ser, sino de sentir, de hacer. Descubrir la dimensión de la pluralidad supone descubrir también la propia inmersión en lo múltiple.
La Modernidad confundió la razón, entendida como facultad, con una forma de racionalidad concreta. Toda la razón había quedado recluida al ámbito de la razón científica natural y matemática. Ignorado otras formas de racionalidad y de pensamiento, a las que se les consideraba menores o irracionales, especialmente a la racionalidad propia del pensamiento estético y literario.
3.- El crepúsculo del deber, la ética indolora y las ‘consignas’ cosméticas.
En la cultura posmoderna se acentúa un individualismo extremo, un “proceso de personalización” que apunta la nueva ética permisiva y hedonista: el esfuerzo ya no está de moda, todo lo que supone sujeción o disciplina austera se ha desvalorizado en beneficio del culto al deseo y de su realización inmediata, como si se tratase de llevar a sus últimas consecuencias el diagnóstico de Nietzsche sobre la tendencia moderna a favorecer la “debilidad de voluntad”, es decir la anarquía de los impulsos o tendencias y, correlativamente, la pérdida de un centro de gravedad que lo jerarquiza todo: “la pluralidad y la desagregación de los impulsos, la falta de un sistema entre ellos desemboca es una “voluntad débil”. Asociaciones libres, espontaneidad creativa, no-directividad, nuestra cultura de la expresión, pero también nuestra ideología del bienestar estimulan la dispersión en detrimento de la concentración, lo temporal en lugar de lo voluntario, contribuyen al desmenuzamiento del Yo, a la aniquilación de los sistemas psíquicos organizados y sintéticos.
La Posmodernidad es un momento de ‘consignas’ cosméticas: mantenerse siempre joven, se valoriza el cuerpo y adquieren auge una gran variedad de dietas, gimnasias de distinto tipo, tratamientos revitalizantes y cirugías estéticas.
En la posmodernidad los sucesos pasan, se deslizan. No hay ídolos ni tabúes, tragedias ni apocalipsis, “no hay drama” expresará la versión adolescente postmoderna.
La condición postmoderna es, sin embargo, tan extraña al desencanto, como a la positividad ciega de la deslegitimación. ¿Dónde puede residir la legitimación después de los metarrelatos? El criterio de operatividad es tecnológico, no es pertinente para juzgar lo verdadero y lo justo. ¿El consenso obtenido por discusión, como piensa Habermas? Violenta la heterogeneidad de los juegos de lenguaje. Y la invención siempre se hace en el disentimiento. El saber postmoderno no es solamente el instrumento de los poderes. Hace más útil nuestra sensibilidad ante las diferencias, y fortalece nuestra capacidad de soportar lo inconmensurable. No encuentra su razón en la homología de los expertos, sino en la paralogía de los inventores[13].
4.- De la Estética del Simulacro a la Incautación de lo Real.
El “ser” ya no cuenta, el valor deviene en “parecer”[14], lo que se conoce como la “cultura del simulacro”[15].
Los escritos de Baudrillard[16], otro de los profetas de la posmodernidad, tributan a una obsesión por el signo y sus espejos, el signo y su producción febril en la sociedad de consumo, la virtualidad del mundo y La transparencia del mal[17]. La mercancía y la sociedad contemporánea están consumidas por el signo, por un artefacto que suplanta y devora poco a poco lo real, hasta hacerlo subsidiario. Lo real existe por voluntad del signo, el referente existe porque hay un signo que lo invoca. Vivimos en un universo extrañamente parecido al original –las cosas aparecen replicadas por su propia escenificación– señala Baudrillard.
La Posmodernidad, en contraste con la Modernidad, se caracteriza por las siguientes notas: nihilismo y escepticismo, reivindicación de lo plural y lo particular, deconstrucción, relación entre hombres y cosas cada vez más mediatizada, lo que implica una desmaterialización de la realidad (Lyotard). Con respecto a esto Jean Baudrillard habla de un “asesinato de la realidad”. En su libro El crimen perfecto, presenta metafóricamente cómo se produce en las postrimerías de siglo esta desaparición de la realidad mediante la proliferación de pantallas e imágenes, transformándola en una realidad meramente virtual: “Vivimos en un mundo en el que la más elevada función del signo es hacer desaparecer la realidad, y enmascarar al mismo tiempo esa desaparición”.
No existe ya la posibilidad de una mirada, de una mirada de aquello que suscita la mirada, porque, en todos los sentidos del término, aquello otro ha dejado de mirarnos. El mundo ya no nos piensa, Tokio ya no nos quiere[18]. Si ya no nos mira, nos deja completamente indiferentes. De igual forma el arte se ha vuelto por completo indiferente a sí mismo en cuanto pintura, en cuanto creación, en cuanto ilusión más poderosa que lo real. No cree en su propia ilusión, y cae irremediablemente en el absurdo de la simulación de sí mismo.
Baudrillard intuye la evolución de fin de milenio como una anticipación desesperada y nostálgica de los efectos de desrealización producidos por las tecnologías de comunicación. Anticipa el despliegue progresivo de un mundo en el que toda posibilidad de imaginar ha sido abolida. El feroz dominio integral del imaginario sofoca, absorbe, anula la fuerza de imaginación singular.
Baudrillard localiza precisamente en el exceso expresivo el núcleo esencial de la sobredosis de realidad. Ya no son la ilusión, el sueño, la locura, la droga ni el artificio los depredadores naturales de la realidad. Todos ellos han perdido gran parte de su energía, como si hubieran sido golpeados por una enfermedad incurable y solapada[19]. Lo que anula y absorbe la ficción no es la verdad, así como tampoco lo que deroga el espectáculo no es la intimidad; aquello que fagocita la realidad no es otra cosa que la simulación, la cual secreta el mundo real como producto suyo.
Baudrillard exhausto de la esperanza del fin certifica que el mundo ha incorporado su propia inconclusibilidad. La eternidad inextinguible del código generativo, la insuperabilidad del dispositivo de la réplica automática, la metáfora viral[20]. La extinción de la lógica histórica ha dejado el sitio a la logística del simulacro y ésta es, según parece, interminable.
El momento postmoderno es, como se ve, un momento antinómico, en el que se expresa una voluntad de desmantelamiento, una obsesión epistemológica con los fragmentos o las fracturas, y el correspondiente compromiso ideológico con las minorías políticas, sexuales o lingüísticas.
Es necesario, a este respecto, tener presente que en la expresión “momento postmoderno” la palabra momento ha de tomarse literalmente[21] – como un parpadeo, como un “abrir y cerrar de ojos” y, por decirlo paradójicamente, como categoría fundamental de una conciencia de época, claramente posthistórica.
La complejidad del momento postmoderno no es sólo una cuestión de perspectiva histórica –o más bien de falta de ella–, sino que viene dada por el propio movimiento de repliegue sobre sí mismo característico de la posmodernidad (frente a los desarrollos lineales de la periodización moderna o clásica) lo que la dota de un espacio histórico informe y desestructurado donde han caído los ejes de coordenadas, a partir de los cuales se establecía el sentido y el discurso de la escena histórico-cultural de una época.
La caída de los discursos de legitimación que vertebraban los diferentes meta-relatos de carácter local y dependiente, ha producido –como se ha señalado – una nivelación en las jerarquías de los niveles de significación y la adopción de prácticas inclusivistas e integradoras de discursos adyacentes, paralelos e incluso antagónicos.
La posmodernidad es aquel momento en que las dicotomías se difuminan y lo apócrifo se asimila con lo oficial.
Desde un determinado punto de vista, la “revolución de la posmodernidad” aparece como un gigantesco proceso de pérdida de sentido que ha llevado a la destrucción de todas las historias, referencias y finalidades. En el momento postmoderno el futuro ya ha llegado, todo ha llegado ya, todo está ya ahí. No tenemos que esperar ni la realización de una utopía ni un final apocalíptico. La fuerza explosiva ya ha irrumpido en las cosas. Ya no hay nada que esperar. Lo peor, el soñado final sobre el que se construía toda utopía, el esfuerzo metafísico de la historia, el punto final, está ya entre nosotros. Según esto, la posmodernidad sería una realidad histórica–posthistórica ya cumplida, y la muerte de la modernidad ya habría hecho su aparición.
En este sentido, el artista postmoderno se encuentra en la misma situación de un filósofo: el texto que escribe, la obra que compone, no se rigen en lo fundamental por reglas ya establecidas, no pueden ser juzgadas según un canon valorativo, esto es, según categorías ya conocidas. Antes bien, son tales reglas y categorías lo que el texto o la obra buscan. De modo que artista y escritor trabajan sin reglas, trabajan para establecer las reglas de lo que habrá llegado a ser. La negación progresiva de la representación se vuelve aquí sinónimo de la negación de las reglas establecidas por las anteriores obras de arte, que cada nueva obra ha de llevar a cabo de nuevo.
Todo esto ya se encuentra prefigurado en las vanguardias artísticas de comienzo del siglo pasado.
5.- Del metarelato a la Posmodernidad estética; discurso y producción.
Ahora bien, el postmodernismo como ideología puede ser entendido como un síntoma de los cambios estructurales más profundos que tienen lugar en nuestra sociedad y su cultura como un todo o, dicho de otra manera, en el modo de producción.
Esta constatación del modo diferente de construcción de la realidad va seguida de la distinción entre una estetización “superficial” y una profunda: la primera refiere a fenómenos globales como el embellecimiento de la realidad, lo cosmético y el hedonismo como nueva matriz de la cultura y la estetización como estrategia económica; el segundo incluiría las transformaciones en el proceso productivo conducidas por la nuevas tecnologías y la constitución de la realidad por los medios de comunicación. Dentro de este escenario global es que debe analizarse lo que ha estado gestándose en los últimos doscientos años, nos referimos a la “estetización epistemológica” o como he querido llamarlo[22] el giro estético de la epistemología[23]. Este se inicia con el establecimiento de la estética como disciplina epistemológica basal, que pasa por la configuración nietzscheana del carácter estético-ficcional del conocimiento y termina en el siglo XX con la estetización epistemológica que puede rastrearse en la nueva filosofía analítica y el establecimiento de la hermenéutica – las interpretación que dota de sentido a los hechos – como ciencia central de la Posmodernidad, de allí que surjan como categorías fundamentales – en el modo de hacer filosofía – el texto y el discurso. Con Gadamer la Hermenéutica cobra un nuevo giro, ya no pretende aprehender el verdadero y único sentido del texto, sino manifestar las diversas interpretaciones del texto y las diversas formas de interpretar. Hemos aludido por primera vez a un elemento fundamental del pensamiento postmoderno: el texto.
La Posmodernidad, si la entendemos como Filosofía del Lenguaje, es una reflexión sobre el lenguaje escrito, en contraposición con la tendencia anglosajona que se centra en el lenguaje oral. El texto se independiza del autor hasta tal punto de que el autor puede ser obviado. El texto se independiza de su autor, porque con cada lectura tiene lugar una reelaboración, que es en sí misma una reinterpretación; no tiene sentido intentar encontrar lo que el autor ha querido decir, sino lo que los lectores, a lo largo de la historia, han dicho que el texto quería decir. La verdad se transforma en verdad interpretativa o verdad hermenéutica.
6.- Deconstrucción de la noción de “autor”
La noción de “autor” –como creador individual de una obra artística o literaria– se puede situar histórica y culturalmente en el tránsito de la modernidad a la posmodernidad, la noción de creador individual empieza a problematizarse desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, donde la noción se hace insostenible.
Tal como lo refiere Michel Foucault , el autor que desde el siglo XIX venía jugando el papel de regulador de la ficción, papel característico de la era industrial y burguesa, del individualismo y de la propiedad privada, habida cuenta de las modificaciones históricas posteriores, no tuvo ya ninguna necesidad de que esta función permaneciera constante en su forma y en su complejidad.
Para Foucault el autor es una producción cultural que mediante la experiencia de una subjetividad replegada sobre sí –fragmentada– da lugar al yo individual, a la personalidad que difumina la conciencia de pertenecer a un colectivo. Así, la pérdida de la experiencia colectiva modifica la noción misma de relato y con ello el sentido colectivo de la escritura, esto es, como memoria e inconsciente que se escribe.
De este modo se intentará abolir al autor, así como a cualquier otra forma de institucionalización de la escritura. Por ello el discurso no será considerado más que en sus descentramientos y sus desterritorializaciones. Al dar por cierta la desaparición del sujeto, el discurso que funda la subjetividad no puede mantener los mismos niveles de coherencia más que como una forma de ejercer poder.
Todas las operaciones que designan y asignan las obras deben ser consideradas siempre como operaciones de selección y de exclusión. “Entre los millones de huellas dejadas por alguien tras su muerte, ¿cómo se puede definir una obra?”. Responder la pregunta requiere una decisión de separación que distingue (de acuerdo con criterios que carecen tanto de estabilidad como de generalidad) los textos que constituyen la “obra” y aquellos que forman parte de una escritura o una palabra “sin cualidades” y que, por ende, no han de ser asignados a la “función de autor”.
Debe considerarse además que estas diferentes operaciones –delimitar una obra (un corpus), atribuirla a un autor, producir su comentario– no son operaciones neutras. Ellas están orientadas por una misma función, definida como “función restrictiva y coercitiva” que apunta a controlar los discursos clásicos, ordenándolos y distribuyéndolos.
Tal como lo refiere Michel Foucault , el autor que desde el siglo XIX venía jugando el papel de regulador de la ficción, papel característico de la era industrial y burguesa, del individualismo y de la propiedad privada, habida cuenta de las modificaciones históricas posteriores, no tuvo ya ninguna necesidad de que esta función permaneciera constante en su forma y en su complejidad.
Como sucesor del autor, el escritor ya no tiene pasiones, humores, sentimientos, impresiones, sino un rol bifurcador de discursos propios y ajenos, en una intertextualidad que prolifera hasta perder los lindes del yo, hasta la escisión de la identidad o su fragmentación esquizoide en la escritura.
La muerte del autor responde, de este modo, al proyecto de desubjetivación, que intenta eliminar la referencia a un sujeto originario sustentador de la verdad y el sentido del texto. En efecto, el sujeto que comienza a pensarse en la escritura, es un sujeto deudor de las citas de la cultura que tejen su obra. El entramado que constituye al texto posee una referencialidad infinita, que multiplica desde distintas vertientes elementos refractarios de otras. Aquello que preexiste de trasfondo es la muerte de un referente máximo que establezca los linderos –los alcances– de las miradas; es la proliferación de las perspectivas.
De este modo en el pensamiento contemporáneo ha tenido lugar un acoso sistemático a las nociones de sujeto y verdad, tal como la tradición científica y filosófica las concibió, decretando su expulsión de los reductos de la psicología, la historia, la antropología y la sociología. La pretensión de objetividad por parte de un sujeto que no puede sino ser contingente ha generado una serie de dudas y sospechas en torno a la noción misma de sujeto que sustenta los discursos científicos y filosóficos desde la modernidad.
Un planteamiento interesante en torno las relaciones conflictuadas entre autor, texto y lector, así como de la cuestión anteriormente planteada respecto de las nociones de autor y autoría, es la de Juan Luis Martínez . La propuesta del poeta es la de una autoría transindividual, que quiere superar desde oriente la noción de intertextualidad según se ha entendido en occidente, donde los textos de base están presentes en las transformaciones del texto que los procesa; pero en J. L. Martínez ésta [intertextualidad] parece resolverse en la negación de la existencia de las individualidades en la literatura, al hacer fluir bajo nombres distintos una misma corriente, que es y no es él. El ideario poético con el que J. L. Martínez aparece comprometido es el de emanar una identidad velada, en sus palabras “no sólo ser otro sino escribir la obra de otro”. Fue Flaubert quien dijo que “un autor debe arreglárselas para hacer creer a la posteridad que no ha existido jamás”. Palabras que calaron hondo en Juan Luís Martínez poeta secreto como pocos. El poeta debe saber andar sobre sus pasos y borrar sus propias huellas.
En la Posmodernidad hay dos tendencias muy marcadas y contradictorias sobre la autoría, la que la desprecia por centrarse únicamente en el texto y la que quiere explicar el texto como trasunto del autor. No cabe hablar propiamente de un autor, pues el autor del texto se ha perdido, como también se ha perdido el ser humano como sujeto, hoy son los sistemas de producción de signos los que reclaman para sí la atención y esto esta dado en lo que Debord llamará La Sociedad del Espectáculo, o Lipovetsky el Imperio de lo Efímero. De allí que fenómenos en apariencia banales como el el cine, la moda, el diseño y la arquitectura, entendidos éstos como sistemas productores de signos, o de narratividades -de acuerdo a su modo de constitución- influyen de manera decisiva en el modo de ser, en el ethos postmoderno, el cual puede ser entendido desde dentro de su proceso de gestación sólo a partir de las claves hermenéuticas que nos proporciona el paradigma estético.
7.- Las obras de arte como organizaciones imaginarias del mundo
Así Lyotard al utilizar los términos “relato”, “grandes relatos” y “metarrelato” se dirige a un mismo referente: los discursos legitimadores a nivel ideológico, social, político y científico. “Un metarrelato es, en la terminología de Lyotard, una gran narración con pretensiones justificatorias y explicativas de ciertas instituciones o creencias compartidas.”[24] Un Léxico último –si se quiere emplear la terminología de Rorty–. El discurso legitimador se caracteriza no por ser prosa narrativa sino principalmente prosa argumentativa. Todo intento que realizar políticamente un sistema ideológico tienen en su interior el germen del totalitarismo, la determinación de la pluralidad a partir de un solo punto de vista que se impone por todos los medios posibles. En cambio, los microrelatos, las narraciones literarias -por ejemplo- no tienen la intención de dar cuenta de hechos verdaderos sino que su consistencia artística deriva de su verosimilitud, es decir, de la capacidad del texto para hacerse creíble dentro de su contexto y del mundo que ha creado.
De este modo las obras de arte no son, pues, objetos específicos –aislados del mundo y de su acontecer–, sino más bien organizaciones imaginarias del mundo, las que para ser activadas requieren ser puestas en contacto con un modo de vida, por particular que este sea, con un fenómeno concerniente al ser humano, de modo tal que, como se hace evidente en la posmodernidad, arte, producción y vida se codeterminan y se copertenecen.
El estallido de los grandes relatos es de este modo el instrumento de la igualdad y de la emancipación del individuo liberado del terror de los megasistemas, de la uniformidad de lo Verdadero, del derecho a las diferencias, a los particularismos, a las multiplicidades en la esfera del saber aligerado de toda autoridad suprema, de cualquier referencia de realidad. La operación del saber posmoderno, es la de la heterogeneidad y dispersión de los lenguajes al modo de Babel, de las teorías flotantes, todo lo cual no es más que una manifestación del hundimiento general -fluido (líquido) y plural- que nos hace salir de la edad disciplinaria y amplía la continuidad democrática e individualista que dibuja la originalidad del momento posmoderno, es decir el predominio de lo individual sobre lo universal , de lo psicológico sobre lo ideológico , de la comunicación sobre la politización , de la diversidad sobre la homogeneidad, de lo permisivo sobre lo coercitivo.
- REFERENCIA: Versión actualizada y ampliada del Artículo originalmente publicado en 2011
VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo, “La Posmodernidad. Nuevo régimen de verdad, violencia metafísica y fin de los metarrelatos”, En NÓMADAS, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas – Universidad Complutense de Madrid, NÓMADAS. 29 | Enero-Junio, 2011 (I), pp. 285-300
http://www.ucm.es/info/nomadas/29/avrocca.pdf
BIBLIOGRAFÍA:
- ANDERSON, Perry, Los orígenes de la posmodernidad. Anagrama. Madrid, 2000. ISBN 84-339-0591-0
- BAUDRILLARD, Jean (1995). La ilusión del fin. La huelga de los acontecimientos. Barcelona: Anagrama.
- BAUDRILLARD, Jean (1998). Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós.
- BECK, Ulrich (1998). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Paidós.
- BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas (1997). Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. La orientación del hombre moderno. Barcelona: Paidós.
- DERRIDA, Jacques : Espectros de Marx: el Estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva Internacional, Trotta, 1995.
- DEBORD, Guy, La sociedad del espectáculo, Editorial Pre-textos, Valencia 1999
- JAMESON, Fredric. Teoría de la posmodernidad. Madrid: Trotta, 1996.
- JAMESON, Fredric : El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Paidós, 1991.
- FOUCAULT, Michel, Las palabras y las cosas, Ed. Gallimard, París, 1966
- RICOEUR, Paul, Historia y narratividad, Editorial Paidós, Barcelona, 1999
- LIPOVETSKY, Gilles. La era del vacío. Barcelona, Anagrama: 1986.
- LIPOVETSKY, Gilles. (1992), El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos, Anagrama. Colección Argumentos: Barcelona, 1996
- LIPOVETSKY, Gilles, El imperio de lo efímero, Editorial Anagrama, Madrid, 1990.
- LYOTARD, Jean-François., La Condition Postmoderne. Paris: Minuit, 1979
- LYOTARD, Jean F. La condición postmoderna. Madrid: Cátedra S.A. 1987.
- LYOTARD, Jean F. La condición postmoderna. Buenos Aires: Teorema, 1989.
- VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo, “El Giro Estético de la Epistemología; La ficción como conocimiento, subjetividad y texto”, En Revista AISTHESIS, PUC, Nº. 40, 2006, pp. 45-61.
- INNERARITY, Daniel, Dialéctica de la Modernidad, Ediciones Rialp, Madrid, 1990.
- HABERMAS, Jürgen, El discurso filosófico de la modernidad, en El pensamiento posmetafísico. Taurus. Madrid, 1990. ISBN 84-306-1300-5
- HABERMAS, Jürgen, El pensamiento postmetafisico, Editorial Taurus, Madrid, 1990
- HABERMAS, Jürgen (1991). Conciencia moral y acción comunicativa. Barcelona: Península.
- RUBERT DE VENTÓS, X. De la modernidad. Ensayo de filosofía crítica. Península. Barcelona, 1982. ISBN 84-297-1669-6
- KOSELLECK, Reinhart (1993). Futuro pasado. Contribución a la semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Paidós.
- LYON, David (1996). Postmodernidad. Madrid: Alianza.
- LYOTARD, Jean-François (1989). La condición postmoderna. Informe sobre el saber. Madrid: Cátedra.
- LYOTARD, Jean-François, La condición posmoderna: Informe sobre el saber (La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir. 1979). ISBN 84-376-0466-4
- LYOTARD, Jean-François (1995). La posmodernidad (explicada a los niños). Barcelona: Gedisa.
- VATTIMO, Gianni (1994). La sociedad transparente. Barcelona: Paidós.
- G. VATTIMO, J. M. Mardones, I. Urdanabia… [et al.]. En torno a la posmodernidad. Anthropos. Barcelona. 1990. ISBN 84-7658-234-X
- SLOTERDIJK Peter, Critica de la razón cínica I y II, Madrid: Ed. Siruela, 2004.
- WELLMER, Albrecht, Sobre la Dialéctica de la modernidad y la posmodernidad, Editorial Visor, Madrid, 1993.
- ŽIŽEK, Slavoj : “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional”, en Fredric Jameson y Slavoj Žižek: Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Paidós, 1998, págs. 137-188.
[1] VATTIMO, Gianni, El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna / La fine della modernità (1985); Milán, Garzanti.
[2] LYOTARD, Jean-François, La condición postmoderna. Madrid: Cátedra S.A. 1987. Originalmente: La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir, Editions de Minuit, París, 1979.
[3] LYOTARD, Jean-François, La condición postmoderna. Madrid: Cátedra S.A. 1987. Originalmente: La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir, Editions de Minuit, París, 1979.
[4] HABERMAS, Jürgen, El pensamiento postmetafisico, Editorial Taurus, Madrid, 1990, p. 85.
[5] El dominio del sujeto se ve subvertido por el hecho de que siempre nos encontramos situados de antemano en lenguajes que no hemos inventado (donde la Razón es equiparada a una subjetividad dominante, a una voluntad de poder) y que necesitamos para poder hablar de nosotros mismos y del mundo.
[6] DERRIDA, Jacques, Márgenes de la filosofía. Madrid, Cátedra, l988
[7] “La épistémè no es una teoría general de toda ciencia posible o de todo enunciado científico posible, sino la normatividad interna de las diferentes actividades científicas tal como han sido practicadas y de lo que las ha hecho históricamente posibles”. Cf. FOUCAULT, Michel, “La vie: L’expèrience et la science”, en Revue de Métaphysique et de Morale, 1 enero-marzo de 1985, R. 10.
“En una cultura en un momento dado, nunca hay más que una sola épistémè, que define las condiciones de posibilidad de todo saber. Sea el que se manifiesta en una teoría o aquel que está silenciosamente envuelto en una práctica”. FOUCAULT, Michel, Las palabras y las cosas, Ed. Gallimard, París, 1966, p. 179.
[8] GADAMER, Hans-Georg, El giro hermenéutico, Madrid, Cátedra, 1990.
[9] VATTIMO, Gianni, El pensamiento débil / Il pensiero debole (1983); editado por G. Vattimo y P. A. Rovatti, Milán
[10] SLOTERDIJK Peter, Critica de la razón cínica I y II, Ed. Siruela, Madrid, 2004.
[11] INNERARITY, Daniel, Dialéctica de la Modernidad, Ediciones Rialp, Madrid, 1990, p. 114.
[12] “Ni sí ni no, sino todo lo contrario. El último reducto posible para la filosofía”, Discurso de Guadalajara, en “Nicanor PARRA tiene la palabra”, Compilación de Jaime Quezada, Editorial Alfaguara, Santiago, 1999.
[13] LYOTARD, Jean F. La condición postmoderna. Madrid: Cátedra S.A. 1987.
[14] Jean BAUDRILLARD establece la diferencia entre disimular y simular. Lo primero es fingir no tener lo que se tiene. Quien disimula, intenta pasar desapercibido. Pero quien simula, aparenta ser quien no es, o poseer lo que no tiene; busca crear una imagen de algo inexistente. El disimulo no cambia la realidad, sólo la oculta o enmascara, en cambio la simulación muestra como verdadero algo que no lo es. Uno remite a una presencia, lo otro a una ausencia, a una nada. Ahora el problema actual es la simulación, concluye BAUDRILLARD. De este modo Ahora el simulacro produce una disociación entre lo que se muestra y la realidad, entre el ser y el parecer.
[15] LIPOVETSKY, Gilles. (1992), El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos, Anagrama. Colección Argumentos: Barcelona, 1996
[16] VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo, “Baudrillard; de la metástasis de la imagen a la incautación de lo real”, En EIKASIA. Revista de Filosofía, OVIEDO, ESPAÑA. ISSN 1885-5679, año II, Nº 11 (julio 2007) pp. 53-59.
[17] BAUDRILLARD, Jean, La transparencia del mal, Ed. Anagrama, Barcelona, 2001
[18] LORIGA, Ray, Tokio ya no nos quiere, Plaza & Janes. Colección Ave Fénix. Barcelona, 1999.
[19] BAUDRILLARD, Jean, Cultura y simulacro, Ed. Kairós, Barcelona, 1993
[20] VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo, “W. Burroughs; La metáfora viral y sus mutaciones antropológicas” En Almiar MARGEN CERO, Revista Fundadora de la ASOCIACIÓN DE REVISTAS DIGITALES DE ESPAÑA – Nº 46 – 2009.
[21] ‘Augenblick’ puede traducirse como parpadeo, “abrir y cerrar de ojos”.
[22] VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo, “La ficción como conocimiento, subjetividad y texto”; de Duchamp a Feyerabend, En Psikeba Revista de Psicoanálisis y Estudios Culturales, Nº 1- 2006, Buenos Aires.
[23] VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo, “El Giro Estético de la Epistemología; La ficción como conocimiento, subjetividad y texto”, En Revista AISTHESIS, INSTITUTO DE ESTÉTICA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, PUC, Nº. 40, 2006 , pp. 45-61.http://www.puc.cl/estetica/html/revista/pdf/Adolfo_Vssquez.pdf
[24] DIÉGUEZ, Antonio (2006). “La ciencia desde una perspectiva postmoderna: Entre la legitimidad política y la validez epistemológica”. II Jornadas de Filosofía: Filosofía y política (Coín, Málaga 2004), Coín, Málaga: Procure, 2006, pp. 177-205.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, modernité, postmodernité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 09 juin 2013
Pour une critique populiste de la gauche
00:02 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gauche, philosophie, pierre le vigan, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 08 juin 2013
Conférence de Pierre Le Vigan sur la pensée de Michéa
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude michéa, pierre le vigan, philosophie, sociologie, gauche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 06 juin 2013
L'image antimoderne de la modernité

L'image antimoderne de la modernité
par Jure Georges Vujic
(Tiré de son dernier livre, "La modernité à l'épreuve de l'image-Essai sur l'obsession visuelle de l'Occident", éditions l'Harmattan)
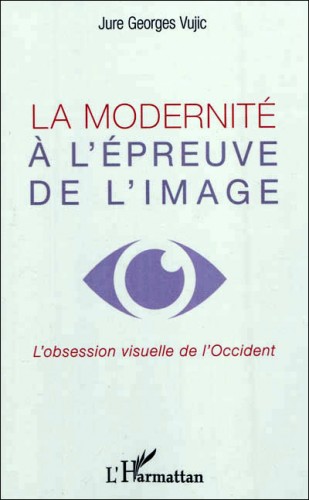 L'antimodernisme, tel qu'il nous est légué par la tradition philosophique et intellectuelle représentée par J.Evola, L.Klages, T.S. Eliot, D.H. Lawrence, F.Nietzsche, M.Heidegger, R.Wagner, E.Junger, E.Pound, R.M. Rilke, Ortega et Gasset, bien qu'ancré dans une critique épistémologique du projet révolutionnaire progressiste et illuministe des Lumières, n'en demeure pas moins contaminé de l'intérieur par un sytéme de pensée et de valeurs qui appartient éminement á la modernité. Ainsi, même si l'antimodernisme se réclame de l'héritage intellectuel et spirituel romantique et d'un certain pessimisme tragique á l'égard d'une modernité mobilisatrice, ce courant d'idée, in fine, ne partage pas les affinités passéistes et pré-modernes du courant contre-révolutionnaire.
L'antimodernisme, tel qu'il nous est légué par la tradition philosophique et intellectuelle représentée par J.Evola, L.Klages, T.S. Eliot, D.H. Lawrence, F.Nietzsche, M.Heidegger, R.Wagner, E.Junger, E.Pound, R.M. Rilke, Ortega et Gasset, bien qu'ancré dans une critique épistémologique du projet révolutionnaire progressiste et illuministe des Lumières, n'en demeure pas moins contaminé de l'intérieur par un sytéme de pensée et de valeurs qui appartient éminement á la modernité. Ainsi, même si l'antimodernisme se réclame de l'héritage intellectuel et spirituel romantique et d'un certain pessimisme tragique á l'égard d'une modernité mobilisatrice, ce courant d'idée, in fine, ne partage pas les affinités passéistes et pré-modernes du courant contre-révolutionnaire.
Même si le modèle épistémologique antimoderniste se fonde sur l'exaltation de l'irrationalité (en opposition á la raison des Lumières et au technicisme), sur les figures vitalistes, morpho-historiques et mythologiques, il n'en demeure pas moins que son „modus operandi“ dialectique, est par excellence moderne et hegelien, ce qui résulte d'une vision binaire (couple origine-modernité, décadence-âge d'or …) et sur la possibilité toujours sous-jacente d'une synthése-dépassement métapolitique salutaire et eschatologique, résultant du schéma nietzchéen : retour á l'origine-modernité-eschaton, qui corrobore le schéma hegelien thèse-antithèse-synthèse. Ainsi, il existe une modernité de l'anti-modernité, une sorte de modernité „á rebours“, qui s'exprime par l'influence du modèle conceptuel et dialectique qu'exerce la modernité sur le contenu du discours polémique et critique anti-moderne. De même, la modernité impose-t-elle et oriente-t-elle, en quelque sorte, les réactions et les discours critiques de l'antimodernisme, en créant les thèmes exploités par la critique conservatrice et anti-moderniste. La pensée antimoderniste reste ainsi dépendante des mouvements, des processus socio-politiques et des progrès scientifiques de la modernité. Toute légitimation idéologique de l'antimodernisme trouve paradoxalement sa source dans la critique épistémique de la modernité. Ainsi l'avènement du nationalisme et de l'idée de la Nation-État au XIXe siècle a-t-elle suscité les thèses alternatives antimodernistes, sur l'impératif du retour á l'État organique pré-moderne. La pensée moderne et les successives phases de modernisation interpellent et orientent le discours anti-moderniste sur le modéle binaire action-réaction. La construction de la „totalité“ épistémologique de la pensée antimoderniste qui s'articule en référence à des „contre-mondes“ originels et eschatologiques, est directement induite par la modernité, de même que la rhétorique organiciste et hiérarchisante d'un Guénon et d'un Evola ainsi que le discours vitaliste et mobilsateur de Junger, ne constituent que des contre-valeurs face á „l'anarchie-désordre moderne. “D'autre part, il convient de rappeler combien le vitalisme (d'un Klages ou d'un Jünger) et le biocentrisme antimodernistes supposent la connaissance et l'acceptation d'un certain héritage du progrés moderniste. Ainsi l'antimodernisme ne constitue-t-il qu'un conservatisme „hyperbolique“ dont les matrices modernistes sont toujours latentes et se manifestent au travers une rhétorique de négation radicale.
Intellectualisme anti-intellectuel
Ce qui parait d'autre part commun aux „visons du monde“ modernistes et anti-modernistes et plus particulièrement lorsqu'elles s'attachent à critiquer le nihilisme moderne ou postmoderne, c'est paradoxalement un certain „anti-intellectualisme intellectuel“. Ces „visions du monde“ qui en tant que contre-points métaphoriques restituent paraboliquement les fragments brisés et dispersés du passé, du présent et du futur proches, aussi bien dans le roman historique d'un Theodor Fontane, dans le journal intime d'un Junger ou d'un Gide, que dans le théâtre engagé de Brecht et le roman existentialiste de Sartre. On assiste ici à une nouvelle forme de synesthésie philosophique et littéraire qui au-delà de la structure conceptuelle et syntaxique projette des images-clés (Leitbilder) qui s'inscrivent dans la réalité empirique. Gerhard Nebel[1] parle à propos de cette „vision du monde“, de dislocation de l'ancienne structure conceptuelle ordonnée autour d'un centre, et de l'avènement de „particularisme“ pluriel.
Nihilisme et retournement
Pour Philippe Forrest, « le nihilisme est expérience du néant. Il se situe ainsi à l’horizon tragique de toute existence. Aucune pensée, aucune époque, aucune civilisation n’est en mesure ni d’en réclamer l’exclusive propriété ni de s’en déclarer miraculeusement préservée. On peut certes le relier en Occident à cette problématique de la « mort de Dieu » qu’annoncent Zarathoustra et le Gai savoir, et voir en lui l’essence même du moderne. Mais rien n’interdit de le confondre avec l’histoire tout entière de la métaphysique, de la technique, de l’oubli de l’être. La cohérence du concept souffre de cette infinie plasticité du sens qui accueille en elle les interprétations les plus contradictoires. Dans le dédale de son oeuvre inachevable, Nietzsche distingue au moins trois formes de nihilisme (passif, actif, extatique). Il arrive à Heidegger de risquer une formule plus synthétique et opératoire (c’est elle qu’on retiendra ici). Dans la célèbre Lettre sur l’humanisme, on lit du nihilisme qu’il est la non-pensée du néant. » ( article Philippe Forrest, « Le roman, le rien, A propos de Michel Houellebecq et du nihilisme »-http://lmsi.net/Le-roman-le-rien). Dans le nihilisme antimoderniste, tout commme dans le nihilisme posthumaniste, une place prépondérante est donnée à la destruction, qui loin d'être un phénomène négatif est au contraire considerée comme un phénomène salvateur. La destruction s'inverse en création-dans un processus de „retournement („Umschlag“).
Chez les nihilistes antimodernistes et modernistes, on ne peut maîtriser l'évolution foudroyante de l'époque moderne et de la technologie , en l'esquivant ou en la freinant, soit au contraire en l'accélérant, en la poussant à l'extrême , un extrême qui devrait provoquer le phénomène de „retournement“. Ce type de „nihilisme“ constructiviste et trans-épochale est vérifiable chez Jünger et son frère Friedrich Georg, chez lesquels l'exaltation de la technique et de la vitesse ont pour toile de fond une volonté de dépassement du nihilisme contemporain. D'autre part, l'attitude d'observateur et de commentateur, désabusé, sarcastique et cynique du monde contemporain que l'on retrouve dans les romans de Houellebecq ou Cioran s'inscrit dans une tradition „réaliste héroïque“ proche d'un Léon Bloy qui proclamait que „tout ce qui arrive est adorable“, et surtout d'un Jünger. « Ainsi dans Les Particules élémentaires, Houellebecq se livre á une démonstration littéraire postnihilistique en avançant la possibilité d'une utopie post-sexuelle.
Ce roman mène ses protagonistes de la découverte puérile de la réalité traumatisante du désir (la haine de la sexualité maternelle, l’humiliation des dortoirs et des cours de récréation, les frustrations de l’adolescence, le vieillissement des corps et l’impuissance, etc.) jusqu’à la dissolution de cette même réalité dans l’idylle d’une humanité scientifiquement débarrassée du fardeau de sa condition (l’un des héros permet l’invention d’une forme de clonage délivrant l’espèce de la nécessité de se reproduire et lui assurant du même coup l’immortalité) »( ibid. article Michel Forrest). L’expérience de la misère sexuelle disparaît par la grâce de l’expérimentation scientifique, ce qui n'est pas sans rappeler les thèmes chers aux transhumanistes. Cette attitude ne serait ni moderne ni antimoderne, elle serait tout simplement a-moderne, se référant plutôt a une anthropologie esthétique plutôt qu'a une catégorie morale, et constituerait une acceptation stoïque et „joyeuse“ de la réalité et du présent immédiat comme leitmotiv de l'imperfection humaine. L'homme étant considéré comme ni bon ni mauvais mais comme faisant partie d'un „Tout“, d'un ensemble. Le nihilisme – quel que soit le qualificatif dont il s’affuble – se caractérise par la croyance en sa capacité à être surmonté. Les héros des Particules élémentaires, comme les figures de proue des transhumanistes, soupirent après une surhumanité que leur assurerait la science.
Néanmoins, il convient de dire que le nihilisme postmoderne contemporain, incapable de soutenir la pensée du néant, commande logiquement chez les individus un irrésistible désir de signification retrouvée qui prend les formes les plus diverses et les plus dangereuses : du repli suicidaire sur les vieilles valeurs religieuses (intégrisme, secte, New Age) jusqu’à l’appel combatif aux valeurs démiurgiques réinventées (toutes les variantes de ce qu’il faut bien nommer un néo-fascisme). Le projet d’un nihilisme héroïquement surmonté, le souhait d’une société lavée de la souillure sexuelle, toute cette mythologie de la pureté reconquise, de la corruption vaincue sont constitutifs de l’imaginaire même du fascisme antimoderniste ou futuriste comme du reste du totalitarisme scientiste transhumaniste. Il est extravagant d’avoir à dire encore comment le « déprimisme » de toutes les « générations perdues » dans la modernité comme dans l'antimodernité a été prompt à nourrir les plus illusoires engagements politiques. À ce titre, Philippe Forest[2] parle pour qualifier le mouvement littéraire et philosophique contemporain néo-nihiliste ou postnihiliste de „retour du refoulé du dix-neuvièmiste“, ce qui jette la lumière sur la filiation philosophique entre modernisme et antimodernisme: “C’est en vérité tout le refoulé barrésien de la culture française qui, sous le masque de la mode, déferle. Houellebecq a pris un peu d’avance sur ses camarades.
Avec les Particules élémentaires, sans le savoir, il a déjà signé sa version sexuelle des Déracinés. Comme celui de son aîné, son gros roman post-naturaliste dénonce le désastre d’une modernité qui arrache l’individu au cocon originel protecteur (de la famille, de la tradition, c’est-à-dire de la terre et du sang) pour le jeter prématurément dans un univers hostile. Son livre est nourri d’Auguste Comte plutôt que de Taine et de Renan, mais il repose sur les mêmes postulats scientistes, sur une même vision déterministe biologisante de l’homme. À son horizon brille la même lumière douteuse éclairant une société parfaite où la notion d’« individu » n’existerait plus qu’à la façon d’un préjugé voué à disparaître au sein d’une conception fusionnelle et mystique du corps social. Quant aux autres écrivains (ceux qui ont choisi Houellebecq pour maître), ils en sont encore à publier artisanalement des taches d’encre. Sous l’oeil des barbares, se délectant de la décadence de leur temps, ils cultivent extatiquement le goût aristocratique des lettres et s’émerveillent de la singularité incomparable de leur Moi. »
On parle de dix-neuviémisme pour déterminer un courant d’idée qui mêle le naturalisme, le populisme au nihilisme. « Dans un magistral essai (Le XIXe siècle à travers les âges) auquel on ne peut ici que renvoyer, Philippe Muray en avait révélé la nature. Socialisme et occultisme, souterrainement liés l’un à l’autre, constituaient cette idéologie de fond et, à l’horizon du temps historique, posaient l’hypothèse d’une humanité enfin réconciliée avec elle-même. La caractéristique essentielle du dix-neuviémisme consistait en un « vouloir-guérir » qui commanderait ultérieurement le glissement de notre propre siècle vers les différentes formes de l’utopie totalitaire. C’est ce même « vouloir-guérir » qui se manifeste aujourd’hui dans toutes les pseudo-entreprises de dépassement du nihilisme. Mais du mal comme du néant, l’homme n’a pas à guérir. Lorsqu’il croit en triompher, il en devient la dupe et la proie. La littérature renonce alors à l’incessant questionnement du négatif qui fait son essence, elle s’enchante des fausses certitudes dont l’histoire sera libre de faire l’usage le plus barbare. Sous une forme assez sentimentalement mièvre et idéologiquement récupérable pour être socialement acceptable, le nouveau nihilisme (c’est son mérite et sa limite) réintroduit dans le champ culturel la question du néant (qu’avec moins de succès médiatique et plus de réussite esthétique, les vraies œuvres littéraires ne cessent de poser) »( ibid, article Philippe Forrest).
La critique postmoderne se fonde á priori sur l'anticipation de la „fin de la modernité“ (Vattimo), alors que dans une perspective anti-moderne, notre époque correspondrait à l'exacerbation et à une phase finale de la modernité. Cependant, il serait simpliste d'établir une étroite corrélation entre la critique postmoderniste et antimoderniste, dans la mesure où la critique postmoderne de la modernité ne se fonde nullement sur les analyses de la critique antimoderne. En effet, la critique postmoderne se fonde sur les prémisses réformistes du „développement durable“, sur les théories écologistes revisitées à la lumière de la globalisation, sur la critique du pouvoir „sociétal“, ainsi que sur une volonté de réforme et „d'humanisation“ du système libéral et capitaliste dominant, avec l'affirmation d'un possibilisme politique alternatif, comme que le prône Giddens avec une nouvelle „troisième voie“ social-démocrate. Dans l'interprétation spenglerienne cyclique anti-moderniste de l'histoire, le commencement (l'origine) est étroitement lié á la chute inéluctable. J. Evola et G. Benn parlent de „mondes“, de „civilisations traditionnelles“ en tant qu'entités organiques et spirituelles, á la fois immanentes et transcendentales et trnashistoriques, alors que Nietzche dans la Naissance de la Tragédie parle de l'instinct originel appollono-dyonisiaque voué à la dégénerescence depuis l'avènement de „l'homme théorique“ socratique et l'optimisme Euridipien. Le schéma interprétatif eschatologique antimoderniste de l'antimodernité qui recouvre les paradigmes Evoliens et Guénoniens de „l'âge sombre“, Schuleriens de „ la vie fermée“ se parachêve par la dialectique Heidegerienne entre le „Dasein“ et le „Sein“, l'établissement d'une correspondance entre le „déclin de l'Occident“ Spenglerien et „l'oubli de l'être“ Heidegerien. Le monde des origines de “l'Age d'or“ serait caracterisé par la „découverte de l'être“, l'avènement de la modernité qui coinciderait avec „l'oubli de l'être“ et la possibilitée d'une résurrection eschatologique avec le „renaissance de l'être“. La même approche „décadentiste“ antimoderniste se retrouve chez des théoriciens et écrivains éminemment modernes.
C'est ainsi que l'on note chez Thomas Stearns Eliot dans la Terre vaine des proto-figures antithétiques et synecdoctiques qui rappellent les contre-mondes mytholigiques de l'anti-modernité. C'est ainsi qu'Eliot, au même titre que Spengler, Evola et Junger, parle dans son oeuvre, dans un language moderniste et à travers l'évocation de la „grande ville“, des épisodes érotiques dans le monde bureaucratique et commercial, des visions théologiques augustiniennes et sanskrites de la „déliquescence de la civilisation“, du „chaos de la réalité contemporaine“, dont les accents rappellent „l'or du rhin“ de Wagner ou les évocations mythologiques de Jessie, Pound (dans les Cantos), Weston, Verlaine ou James Frazer. L'intertextualitée d'un Eliot ou d'un D.H Lawrence établit une correspondance entre les contre-mondes non-mondernes et le monde „infernal et machiniste“ de la modernité. On verra que la nostalgie des origines se retrouve chez des écrivains modernes tels C. Castaneda ou bien D.H Lawrence , qui est à la recherche d'une „unité cosmique“ á travers l'astrologie chaldéenne, ou bien Thomas Mann qui atteint les sommets paysagistes pré-modernes à l'aide de contre-mondes artistiques non-modernes tels que les toiles de Arnold Bocklin. Ainsi, les correspondances thématiques, paraboliques et philosophiques qui existent entre la „doxa“ antimoderniste et la pensée moderne mettent à nue leur parenté epistémologique dialectal-antithétique qui se fonde sur un possibilisme totalisant et synthétisant.
En effet, la totalité anti-moderne comme solution finale des contradictions et déviations de la modernité décadente se fonde sur une conception gelstatienne de la totalité (le tout étant supérieur aux parties), une vision structuraliste et organiciste de la société (qui puise ses sources dans l'enseignement de Husserl, Felix Klein, dans la biologie théorique de Jakob von Uexkull), comme unique remède á l'illuminisme progressiste des Lumières, qui se fonde, lui, sur la raison instrumentale constructiviste et mécaniciste. Cependant, l'approche antimoderne gelstatienne totalisante et l'approche moderne constructiviste progressiste sont l'une comme l'autre soumises à la tentation „systémiste“ et structuraliste [3] qui ne prend pas en compte les modes d'être autonomes et transversaux, lesquels échappent aux carcans des systèmes d'idées orthodoxes. Au mieux, les deux modèles modernes et anti-modernes ne peuvent alors qu’aboutir à un "holisme collectiviste", pour reprendre une expression de V. Descombes. Ce type de holisme ne connaît de totalité ou d’ensemble que sous la forme d’une collection d’individus, c’est-à-dire d’une "réunion physique ou mentale d’éléments" simples, (sans autre principe de composition entre eux que celui d’une commune appartenance à l’ensemble sur la base d’une identité raciale, nationale, communautaire partagée dans le schéma anti-moderniste, soit sur la base de’une identiteé individuelle partagée dans le schéma moderne).
Une démarche résolument supra-moderne produirait et entretiendrait une chaîne réversible d'opérateurs, traversant la distance de la réalité à sa représentation. La justification – le référent – sera ici pluriel, intérieur et transversal, et non pas comme dans les modèles traditionnels moderne ou anti-moderne « à deux pôles », extérieur et latéral. Cette démarche a-moderne ou non-moderne (comme le suggère Latour) permettrait d’éviter l’écueil du systémisme et de la mise en synthèse des potentialités virtuelles. Cioran affirmait avec raison que : « la pire forme de despotisme est le système, en philosophie et en tout ». C’est en raison de ce « systémisme », que la tradition vivante s’est transformée en « traditionalisme » et que la « modernité » ayant elle-même générée une contre-modernité, s’est transformée en nouvelle « théologie séculaire ». Libérée du possibilisme structuraliste et synthétisant, cette pensée supra-moderne permettrait tout juste d’appréhender, de libérer et de potentialiser les divers devenirs collectifs et individuels tout comme les virtualités créatrices présentes et disparates, sans arrière pensée systémique.
[1] Gerhard N ebel, « Tyrannis und Freiheit », Dusseldorf 1947, dans Armin Mohler, La Revolution conservatrice en Allemagne 1918.-1932, Pardes, Paris 1993.
[2]Le roman, le rien, à propos de Michel Houellebecq et du nihilisme. de Philippe Forest. 1999, Par Leo Scheer, mercredi 24 octobre 2007.
[3] On distingue le structuralisme comme méthode et le structuralisme comme idéologie ou philosophie qui a été développée notamment par M. Marc-Lipiansky (1973) qui montre l’ambivalence de Lévi-Strauss sur ce point ainsi que par J. Parain-Vial (1969) qui n’hésite pas à ranger pêle-mêle L. Althusser, M. Foucault et J. Lacan dans la catégorie du structuralisme purement idéologique. Pour sa part, V. Descombes distingue entre le structuralisme classique de "la méthode de l’analyse".
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jure vujic, philosophie, modernité, anti-modernité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 04 juin 2013
Louis Pauwels, ovvero la scoperta che il fantastico è l’invisibile nascosto dietro il visibile
di Francesco Lamendola
Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]
 Che cos’è il fantastico?, si chiedeva lo scrittore e giornalista belga Louis Pauwels, fondatore, insieme al suo amico e collega francese Jacques Berger (il cui vero nome era Jakov Mikhailovic Berger, nativo di Odessa), del cosiddetto realismo fantastico.
Che cos’è il fantastico?, si chiedeva lo scrittore e giornalista belga Louis Pauwels, fondatore, insieme al suo amico e collega francese Jacques Berger (il cui vero nome era Jakov Mikhailovic Berger, nativo di Odessa), del cosiddetto realismo fantastico.
Il realismo fantastico, per Pauwels e Berger, è una scuola e un metodo di lavoro intellettuale; esso prende le mosse dalla scoperta che il fantastico non si nasconde nei sobborghi della realtà, ma che l’intelligenza, per poco che si sforzi di cercare, lo trova nel centro stesso della realtà: ed è un fantastico che non invita all’evasione, ma ad una più profonda e consapevole adesione alle cose e alla vita.
Per loro, autori del fortunatissimo libro «Il mattino dei maghi», scienza ed esoterismo possono e debbono collaborare nell’indagine sulla natura del reale: si tratta di due vie difformi, ma entrambe legittime ed anzi necessarie, per giungere ad una comprensione più piena del mondo e ad una maggiore e più intensa partecipazione al reale da parte dell’uomo. A torto le si è credute, per molto tempo, incompatibili: invece sono entrambe fruttuose, così come credevano i grandi maghi-scienziati del Rinascimento, fra i quali spicca il nome di Paracelso, prima che, nel XVII secolo, le due forme di sapere prendessero direzioni opposte e inconciliabili.
Louis Pauwels, prima di fondare la “scuola” del realismo fantastico – che può ricordare il movimento letterario del “realismo magico”, ma, ovviamente, non ha niente a che fare con esso -, era stato un seguace delle dottrine esoteriche di Georges Ivanovic Gurdjiev e un amico di André Breton e dei surrealisti, dei quali aveva, per un certo tempo, condiviso le idee e con i quali collaborato attivamente.
Jacques Berger, da parte sua, nella propria vita avventurosa aveva praticamente sperimentato tutto: ingegnere chimico, aveva studiato la Kabbalah presso i rabbini ucraini, prima di essere costretto a fuggire dalla Russia in preda alla guerra civile; aveva poi studiato matematica e fisica ed era diventato assistente del chimico nucleare André Helbronner, assassinato dalla Gestapo verso la fine della seconda guerra mondiale; era stato perfino avvicinato dall’enigmatico Fulcanelli, l’alchimista di cui si diceva che avesse scoperto ed applicato su se stesso l’elisir di lunga vita, tanto da essere nessun altri che il famoso conte di Sain-Germain, attivo alla corte francese del XVIII secolo – o, almeno, questo Berger sosteneva.
Del libro «Il mattino dei maghi», che voleva essere il manifesto della nuova scuola di pensiero e che fu recepito dalla critica e dal pubblico come una specie di “summa” dell’esoterismo, si è detto tutto il bene e tutto il male possibili: gli intellettuali di formazione neo-positivista, in genere, ne hanno sottolineato, con maggiore o minore irritazione, ingenuità e debolezze (che non sono poche); quelli d’ispirazione teosofica, occultista e vagamente “alternativa” – oggi si direbbe: di tendenza New Age – si sono sprecati nelle lodi, anche se gli uni e gli altri, probabilmente, hanno passato il segno e anche se non sono mancate le eccezioni: di estimatori della tendenza scientista (perché, in fondo, gli autori sembravano ridurre il mistero a una serie di problemi non ancora scientificamente chiariti), e di detrattori di tendenza esoterica (per la stessa ragione degli altri, vista però, da essi, in chiave decisamente negativa).
E poi, diciamo la verità, il successo strepitoso del libro aveva a che fare soprattutto con la vasta sezione in esso dedicata al nazismo esoterico: un campo allora sconosciuto al grande pubblico e che sarebbe poi stato esplorato da storici e politologi di professione, come Giorgio Galli con il suo importante «Hitler e il nazismo magico», del 1989. Come si vede, ci son voluti quasi trent’anni per “sdoganare” un simili argomento da parte dell’ambiente accademico; e non sono mancati, neanche allora, gli intellettuali superciliosi che hanno storto il naso, convinti che la storia sia una scienza e che il marxismo sia la super-scienza per antonomasia, se si vogliono comprendere i fenomeni politici e sociali, oltre che quelli economici. «Altro che nazismo magico, Società Thule e rituali di occultismo: questa è materia da film o da romanzi di terz’ordine; robaccia che non ci abbassiamo a prendere in considerazione, perché ininfluente per spiegare l’avvento del nazismo!».
Così hanno pensato, e talvolta hanno detto, non pochi signori dell’establishment culturale. Sono gli stessi che si tengono la pancia dalle risate ogni volta che qualcuno si azzarda a nominare, sia pure con tutta la serietà e con tutta la cautela dello studioso aperto e non prevenuto, l’Atlantide di Platone, non solo come mito, ma come possibile realtà storica; la presenza di testimonianze archeologiche e paleontologiche assolutamente anomale e dalle datazioni “impossibili”; l’eventualità di contatti avvenuti in passato, e che forse avvengono anche nel presente, tra la specie umana e delle razze aliene intelligenti, provenienti dalle profondità cosmiche o, forse, da altre dimensioni spazio-temporali.
A noi, qui, non interessa riaprire quella vecchia discussione, suscitata dal saggio di Pauwels e Berger (vecchia ormai di oltre mezzo secolo, dato che il libro apparve nel lontano 1960 e dunque, per molti aspetti, ormai irrimediabilmente datata), quanto svolgere una breve riflessione sul concetto del realismo fantastico. Ed ecco con quali parole Louis Pauwels presentava il suo punto di vista, nella «Introduzione» a «Il mattino dei maghi» (titolo originale: «Le matin des magiciens», Paris, Librairie Gallimard, 1960; traduzione dal francese di Pietro Lazzaro, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1963, 1971, pp. 30-33):
«Le danze, così veloci e incoerenti, delle api disegnano, sembra, nello spazio, figure matematiche precise e costituiscono un linguaggio. Io sogno di scrivere un romanzo in cui tutti gli incontri che un uomo fa nella sua esistenza, fugaci o notevoli, dovuto a ciò che chiamiamo caso o alla necessità, disegnino anch’essi figure, esprimano ritmi, siano ciò che forse sono: un discorso sapientemente costruito, indirizzato ad un’anima perché raggiunga la sua compiutezza, e di cui essa non afferrava, nel corso di una intera vita, che qualche parola slegata.
Mi sembrava, a volte, di afferrare il senso di questo balletto umano, attorno a me, di indovinare che mi si parla attraverso il movimento degli esseri che si avvicinano, si fermano o si allontanano. Poi perdo il filo, come tutti, fino alla prossima grande e tuttavia frammentaria evidenza. Un’amicizia molto viva mi legò ad André Breton. Fu per mezzo suo che conobbi René Alleau, storico dell’alchimia. Un giorno, mentre cercavo, per una collezione di opere di attualità, un divulgatore di argomenti scientifici, Alleau mi presentò Bergier. Si trattava di lavoro fatto per vivere, e poco m’importava la scienza volgarizzata o no. Ora, quell’incontro del tutto fortuito era destinato ad ordinare per un lungo periodo la mia vita, a riunire e orientare tutte le grandi influenze intellettuali o spirituali esercitate su di me, da Vivekananda a Guénon, da Guénon a Gurdjiev, da Gurdjiev a Breton, e a ricondurmi nella maturità al punto di partenza: mio padre.
In cinque anni di studi e di riflessioni, durante i quali i nostri spiriti, molto diversi, furono costantemente felici di essere insieme, mi sembra che abbiamo scoperto un punto di vista nuovo e ricco di possibilità. Ciò che, alla loro maniera, i surrealisti facevano trent’anni fa. Però, a differenza dei surrealisti, non abbiamo cercato nella direzione del sonno e del’infracoscienza, ma all’estremo opposto: nella direzione dell’ultracoscienza e della veglia superiore. Abbiamo battezzato la scuola da noi seguita, scuola del realismo fantastico. Essa non ha nulla a che fare col gusto del’insolito., dell’esotismo intellettuale, del barocco, del pittoresco. […] È per difetto di fantasia che letterati e artisti cercano il fantastico fuori della realtà, nelle nuvole. Non ne ricavano che un sottoprodotto. Il fantastico, come le altre materie preziose, deve essere estratto dalle viscere della terra, dal reale. E la fantasia autentica è ben altra cosa che una fuga verso l’irreale. “Nessuna facoltà dello spirito si immerge e scava più della fantasia: essa è il grande palombaro”.
Generalmente il fantastico viene definito come una violazione delle leggi naturali, come una apparizione dell’impossibile. Per noi non è affatto questo. Il fantastico è come una manifestazione delle leggi naturali, un effetto del contatto con la realtà, quando essa viene percepita direttamente e non filtrata attraverso il velo del sonno intellettuale, attraverso le abitudini, i pregiudizi, i conformismi. La scienza moderna ci insegna che dietro il visibile semplice c’è dell’invisibile complicato. Un tavolo, una sedia, il cielo stellato, sono in realtà radicalmente diversi dall’idea che ce ne facciamo: sistemi in rotazione, energie non esaurite. È in questo senso che Valéry diceva che, nella scienza moderna, “il meraviglioso e il positivo hanno stretto una sbalorditiva alleanza”. Freud spiega tutto, “Il Capitale” spiega tutto., ecc. Quando diciamo pregiudizi,dovremmo dire superstizioni. Ve ne sono di antiche e di moderne. Per certe persone nessun fenomeno di civiltà è comprensibile se non si ammette, alle origini, l’esistenza di Atlantide. Per altre il marxismo basta a spiegare Hitler. […]
“Su scala cosmica (la fisica moderna ce l’insegna) solo il fantastico ha possibilità di essere vero” dice Teilhard de Chardin. Ma per noi anche il fenomeno umano deve misurarsi su scala cosmica. È ciò che affermano i più antichi testi di saggezza.[…] Un metodo di lavoro non è un sistema di pensiero. Noi non crediamo che un sistema, per quanto geniale, possa illuminare completamente la totalità del vivere che ci occupa. Si può indefinitamente manipolare il marxismo senza arrivare a integrare il fatto che Hitler ebbe più volte coscienza, con terrore, che il Superiore Sconosciuto era andato a visitarlo.»
La concezione di Pauwels e Berger è, dunque, assai vicina, almeno nella “diagnosi”, a quella dei poeti e degli scrittori decadentisti, della quale si può considerare un prolungamento, o piuttosto una nuova versione, aggiornata e corretta: dietro la superficie delle cose, c’è il mistero; la scienza materialista e meccanicista, così come è intesa e praticata ordinariamente, non è in grado di penetrare in esso, perché non possiede gli strumenti adatti, né una struttura logica adeguata: essa non si occupa che del mondo visibile e ignora o, addirittura, nega tutto ciò che non è sperimentabile, verificabile, misurabile e riproducibile.
Fatta la diagnosi, differiscono le conclusioni: per i decadentisti, solo il poeta possiede la capacità di penetrare il mistero, spingendosi al di là dell’apparenza delle cose, al di là della loro superficie ingannevole e illusoria; e ciò per mezzo degli stati alterati di coscienza, naturali o anche artificiali (cioè realizzati con l’assunzione di sostanze stupefacenti): il sogno, la visione, l’allucinazione; avvicinandosi, nel loro approccio, alle tecniche sciamaniche dell’estasi, miranti a realizzare il “viaggio astrale” ed altre esperienze extra-corporee ed extra-razionali (ma non, di per sé, irrazionali, come la cultura scientista pretendeva e pretende tuttora).
Per la scuola del realismo fantastico, si tratta di creare una collaborazione e una sintesi fra le posizioni più avanzate della scienza post-newtoniana, specialmente della fisica quantistica, e le antiche tecniche della magia e dell’occultismo, sperimentate da generazioni di sapienti e di studiosi che erano anche, nello stesso tempo, scienziati, i quali non pensavano affatto di perseguire un sapere alternativo a quello della scienza, ma profondamente integrato con essa. Pauwels, infatti, non crede che il fantastico sia qualcosa di estremo e di irreale, ma che si annidi nel quotidiano e nell’ordinario; e che solo la nostra distrazione, il nostro conformismo, la nostra pigrizia intellettuale ci impediscono di accorgercene e di trarne tutte le meravigliose conclusioni.
È una posizione condivisibile, questa? A nostro avviso, sì, almeno nelle linee generali; anche se poi si tratta di vedere, caso per caso, nello studio dei fenomeni, naturali ed extra-naturali, quale sia la strada migliore da percorrere e in quale misura servirsi dell’una o dell’altra prospettiva: perché il segreto è tutto qui, nel giusto equilibrio fra esse, cosa estremamente delicata e complessa e nella quale vengono impietosamente a nudo tutti i dilettantismi, tutte le approssimazioni di chi vuol cimentarsi nella ricerca, pur essendo sprovvisto di un serio bagaglio culturale e, ancor più, di una seria preparazione intellettuale e di una adeguata consapevolezza spirituale.
Perché il problema, alla fine, non è di tecniche e nemmeno di filosofie, ma di retta intenzione: chi cerca con mente sgombra e con animo puro, alla fine troverà; mentre gli altri, non troveranno nulla.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis pauwels, matin des magiciens, fantastique, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Aux origines de la théorie du «gender»

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil!
Michel Maffesoli


Michel Maffesoli
00:05 Publié dans Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, michel maffesoli, gender, gender studies, philosophie, actualité, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 03 juin 2013
La economía no es el destino
La economía no es el destino
Archivio 1979 - Ex: http://www.nuevaderecha.org/
«Las únicas realidades que cuentan para nuestro futuro son de orden económico», declaraba durante un debate un ministro, que es también, al parecer, el mejor economista de Francia. «Estoy totalmente de acuerdo con usted», le replicaba el adversario político al que se oponía, pero usted es un gestor muy malo y somos más fuertes que usted en economía.
Diálogo revelador.
Como Nietzsche, sepamos descubrir a los falsos sabios bajo la máxima de «especialistas», destrocemos los ídolos, pues la falsa ciencia –la metafísica también– de nuestra época, y la primera de sus ídolos, es la economía.
«Vivimos en sociedades, anota Louis Pauwels, para las cuales la economía es el único destino. Limitamos nuestros intereses a la historia inmediata, y limitamos ésta a los hechos económicos». Nuestra civilización, por supuesto –que no es más una «cultura»– está fundada sobre una concepción del mundo exclusivamente económica. Las ideologías liberales, socialistas o marxistas, se unen en su interpretación «economista» del hombre y de la sociedad. Postulan todas que el ideal humano es la abundancia económica individual; aunque se diferencian por los medios de cómo llegar a ese estado, admiten unánimemente que un pueblo no es más que una «sociedad», reducen su destino a la exclusiva consecución del bienestar económico, explican su historia y elaboran su política sólo a través de la economía.
Es lo que en el GRECE negamos. Rechazamos esta reducción de lo humano a lo económico, esta única dimensión de la Historia. Para nosotros, los pueblos deben primero asegurar su destino: es decir su duración histórica y política y su especificidad. La historia no está determinada, y menos con relaciones y mecanismos económicos. La voluntad humana hace la historia. No la economía.
La economía para nosotros no debería ser ni una contradicción ni una teoría, sino una estrategia, indispensable, pero subordinada a lo político. Administrar los recursos de una comunidad según criterios primero políticos, ese es el sitio de la economía.
Entonces, entre las opciones liberales o socialistas y nosotros, no hay entente posible. Anti-reduccionistas, no creemos que la «felicidad» merezca ser un ideal social exclusivo. Al igual que los etólogos modernos, pensamos que las comunidades humanas sólo sobreviven físicamente si tienen un destino espiritual y cultural.
Podemos incluso demostrar que privilegiando la economía y la búsqueda del bienestar personal, llegamos a sistemas tiranos, a la desculturización de los pueblos, y a corto plazo, a una mala gestión económica. Ya que la economía funciona mejor cuando no ocupa el primer lugar, cuando no usurpa la función política.
Por lo tanto hay que asumir un cambió intelectual en economía, como en otros campos. Otra visión de la economía, según los desafíos contemporáneos, y ya no fundada sobre axiomas de burgueses del siglo XIX, será posiblemente la Economía Orgánica, objeto de nuestras investigaciones actuales.
La revuelta «en el sentido que Julius Evola da a este término» se impone contra esta dictadura de la economía, fruto de una dominación de los ideales burgueses y de una hipertrofia de una función social. Para nosotros europeos del oeste, es una revuelta contra el liberalismo.
«Nuestra época –escribía ya Nietzsche en Aurora– que tanto habla de economía es muy derrochadora; derrocha el espíritu». Fue profeta: hoy, un Presidente de la República se atreve a declarar: «El problema mayor de nuestra época, es el consumo». El mismo, a estos «ciudadanos» reducidos a simples consumidores, afirmar que desea el «nacimiento de una inmensa clase media, unificada por el nivel de vida». También el mismo se ha felicitado de la sumisión de la cultura a la economía mercante: «La difusión masiva –esta palabra que tanto le gusta– del audiovisual lleva a la población a compartir los mismos bienes culturales. Buenos o malos, es otra cuestión (sic) pero en todo caso por primera vez los mismos».
Clara apología, del jefe de fila de los liberales, del rebajamiento de la cultura al tráfico. Así, lo político desciende hasta el nivel de la gestión, fenómeno bien descrito por el politólogo Carl Schmitt. El dominio obsesivo de las preocupaciones económicas no corresponde, sin embargo, al antiguo psiquismo de los pueblos europeos. En efecto, las tres funciones sociales milenarias de los indoeuropeos, funciones de soberanía política y religiosa, de guerra, y en tercer lugar de fecundidad y de producción, supondrían un dominio de los valores de las dos primeras funciones, hechos puestos a la luz por G. Dumézil y E. Benveniste. Pero, no sólo la función de producción se encuentra hoy dominada por una de sus sub-funciones, la economía, sino que ésta, a su vez, está dominada por la sub-función «mercante». Por consiguiente el organismo social está, patológicamente, sumiso a los valores que produce la función mercante.
Según los conceptos del sociólogo F. Tonnies, este mundo al revés pierde su carácter «orgánico» y vivo y se convierte en «sociedad mecánica». Tenemos que reinventar una «comunidad orgánica». Así el liberalismo económico y su colaborador político adquieren su significado histórico: esta ideología ha sido la coartada teórica de una clase económica y social para «librarse» de toda tutela de la función soberana y política, e imponer sus valores –sus intereses materiales– en vez y en lugar del «interés general» de la Comunidad entera.
Solamente la función soberana y sus valores propios pueden asegurar el interés general. La única revolución ha sido la del liberalismo, que ha usurpado la soberanía en interés de la función económica, revindicando primero la «igualdad» con los otros valores, pretexto para marginarlos después.
Según un proceso cercano al marxismo, el liberalismo ha construido un reduccionismo económico. Los hombres sólo son significativos para él como participantes abstractos en el mercado: clientes, consumidores, unidades de mano de obra; las especificidades culturales, étnicas, políticas, constituyen tantos obstáculos, de «anomalías provisionales» hacia la Utopía a realizar: el mercado mundial, sin fronteras, sin razas, sin singularidades; esta utopía es más peligrosa que la del igualitarismo «comunista» ya que es más extremista todavía, y más pragmática. El liberalismo americano y su sueño de fin de la Historia en el mismo way of life comercial planetario, constituye la principal amenaza.
Así señalamos claramente a nuestro enemigo. Tenemos costumbre de designar como «sociedad de mercado» a la realizada según la ideología liberal; podemos señalar que el marxismo y el socialismo nunca han conseguido, ellos, a realizar su proyecto igualitario, la «sociedad comunista», y aparecen así menos revolucionarios que el liberalismo, menos «reales».
Esta «sociedad de mercado» se nos aparece pues como el objeto actual y concreto de crítica y de destrucción. Nuestra sociedad es «de mercado», pero no especialmente mercantil. La república de Venecia, las ciudades hanseáticas vivían de un sistema económico mercantil pero no constituían sociedades «de mercado». Pues el término «mercado» no designa estructuras socioeconómicas sino una mentalidad colectiva, un sistema de valores que caracteriza no sólo la economía pero todas las instituciones.
Los valores del mercado, indispensables a su único nivel, determinan el comportamiento de todas las esferas sociales y de Estado, e incluso la función puramente productiva de la economía.
Se juzga –y al Estado en primer lugar– desde un punto de vista totalmente mercantil. Esto no quiere decir que dominación mercante signifique «dominación por el dinero», no planteamos una condena moral del dinero no del beneficio del empresario. Hay que admitir el comportamiento mercantil o provechoso si acepta subordinarse a otros valores. No hay que ver pues en nuestra posición un «odio de la economía» o un nuevo reduccionismo opuesto a la ganancia y a la función mercantil como tales. No somos moralizadores cristianos. Sociedad de mercando significa pues sociedad donde los valores sólo son mercantiles. Podemos clasificarles en tres figuras «mayores»: la mentalidad determinista, el espíritu de cálculo y la dictadura del bienestar económico individual.
La mentalidad determinista, útil sólo para la única actividad mercantil, tiende a eliminar los riesgos y a minimizar los vaivenes. Pero, adoptada por el conjunto de una sociedad y en particular por los decididotes políticos y económicos, la mentalidad determinista se convierte en coartada intelectual para no actuar ni arriesgar. Sólo el mercante (comerciante) puede por derecho, para maximizar sus ganancias, subordinar sus actos a determinismos: leyes del mercado, coyunturas, curvas de precios, etc… Pero el poder político, no más que la economía nacional no deberían, como un comerciante, someterse o «dejarse llevar» por una racionalidad excesiva que dispensa de todo «juego de riesgo». La sociedad mercante se «administra» a corto plazo, bajo la hegemonía de las «previsiones económicas» pseudos científicas (la industrialización «ineludible» del Tercer Mundo, la mundialización de la competencia internacional, la tasa de crecimiento de las rentas y del PNB, etc.), pero paradójicamente no tiene en cuenta las más elementales de las evoluciones políticas a medio plazo: por ejemplo el oligopolio de los poseedores del petróleo.
Por lo tanto, nada menos «independiente» que las naciones mercantes. Los gestores liberales van en el sentido de lo que creen mecánicamente determinado (por estar racionalmente formulado) haciendo la economía de la imaginación y de la voluntad.
En el siglo de la perspectiva, de la previsión estadística e informática, nos dejamos llevar por el corto plazo y se prevé menos que los soberanos de los siglos pasados. Todo pasa como si las evoluciones sociales demográficas, geopolíticas no existieran y no fuesen a tener efectos mayores. Lo igual en todos los sitos – según la fórmula estúpida de los economistas liberales- solamente son tomadas en cuenta por los que deciden las restricciones o pseudos previsiones económicas a corto plazo. (original francés Toutes choses égales par allieurs –selon la formule stupide des économistes libéraux- seules son prises en compte par les décideurs, les contraintes ou pseudo-prévisions économiques à court terme)
La sociedad mercante es pues ciega. Sometida a las evoluciones y a las voluntades exteriores, porque cree en el determinismo histórico, trata a los pueblos europeos como objetos de la historia.
Segundo rasgo de la mentalidad mercante: el espíritu de cálculo. Adaptado al comerciante, este espíritu no conviene a los comportamientos colectivos. Hegemonía de lo cuantificable sobre lo cualificable, es decir, sobre los valores, dominio de lo mecánico sobre lo orgánico, el espíritu de cálculo aplica a todo la tabla única del valor económico. No pensamos que el «dinero» se haya convertido en la norma general: sino que todo lo que no se puede medir «ya no cuenta».
Se pretende calcularlo todo, incluso lo no-económico: se «programan» los momentos de jubilación, las horas de trabajo, los tiempos de ocio, los salarios, en el mismo nivel –pero mucho antes– los niños que van a tener. Existe incluso un «coste de la vida humana» tomado en cuenta para ciertas inversiones. Pero todo lo que escapa al cálculo de los costes, es decir precisamente lo que más importa, es rechazado, los aspectos incontables económicamente de los hechos socio-culturales (como los costes sociales de la pérdida de raíces resultante de la inmigración) llegan a ser indescifrables e insignificantes para los «tecnomercantes».
Incluso en economía, el exceso de cálculo perjudica: ¿cuántas inversiones útiles a largo plazo, pero que un cálculo de previsión declara no rentables a corto plazo, son abandonadas?
El individuo, seguro, «calcula» su existencia, pero ya no piensa en su herencia, en su descendencia. Los Estados obsesionados por la gestión a corto plazo, sólo toman en consideración los aspectos «calculables» y cifrables de su acción. Estos «hombres de negocios» demagogos sólo actúan ahí donde se pueden «rendir cuentas» y sobre todo en lo inmediato, incluso si es necesario falsificando algunas cifras.
¿Una región muere de anemia cultural? ¿Qué importa si por el turismo de masas, su tasa de crecimiento es positiva? Y, entre adversarios políticos, el argumento político se reduce a batallas de porcentajes.
Esta superficialidad de la «gestión tecnocrática» (ersatz mercante de la función soberana) puede incluso desembocar en el «marketing político», reducción de la política al «negocio» comercial. Hoy, Francia o Alemania, son más o menos asimiladas por sus gobiernos a sociedades anónimas por acciones. La Casa Francia con sus ciudadanos asalariados. Ni que decir que, también, la política exterior e incluso la política de defensa, están determinadas por intereses de salidas comerciales inmediatas. Incluso para la economía no es lo mejor ya que este mercantilismo a corto plazo resulta ser aleatorio y no sustituye una política económica. Cuando los Jefes de Estado en visita se convierten en V.R.P., como verdaderos VRP, se rinden bajo la dependencia de sus clientes. (original francés pone V. R. P. ¿qué es eso)
La sociedad de mercando puede describirse como una «dictadura del bienestar individual» según los términos de Arnold Huelen; dictadura porque el individuo, obligado a entrar en el sistema providencialista del Estado, ve desintegrarse su personalidad en el ambiente consumista. Paradójicamente, el Estado-providencia liberal castiga la iniciativa productiva (cargas sociales excesivas) y desanima indirectamente la iniciativa individual. Asegurados sociales, asalariados, parados remunerados: ya no dominan su destino. Inmenso desprecio de su pueblo por el Estado-providencia, el «monstruo frío» de Nietzsche. Tiranía suave.
¿Cómo extrañarse entonces que se desprecie un soberano transformado en dispensador de entretenimientos? El Politólogo Julián Freund habla justamente del fallecimiento político del Estado.
El liberalismo produce un doble reduccionismo: por una parte el Estado y la sociedad sólo deben responder a las necesidades económicas de los pueblos; y, por otra, estas necesidades son reducidas al «nivel de vida» individual. En el liberalismo mercante se prohíbe, en parte por interés, juzgar si estas necesidades son deseables o no: sólo cuentan los medios técnicos a poner en marcha para conseguirlas.
De ahí el predominio político del nivel de vida y por necesidad igualitaria: sueño burgués – y americano– de pueblos nivelados e igualados por el mismo nivel de vida.
Los pueblos y los hombres siendo todos semejantes para un liberal, la única desigualdad subsistente es la del poder adquisitivo: para obtener la igualdad, es pues suficiente difundir a través del mundo el modo de vida mercante. Así, ahí están reconciliadas milagrosamente (la mano invisible de Adam Smith) el humanismo universalista y los «negocios», la justicia y los intereses, como confesaba puerilmente Jimmy Carter; Bible and Business.
Los particularismos culturales, étnicos, lingüísticos, las «personalidades», son obstáculos para la sociedad mercantil. Lo que explica que la ideología moralizadora de los liberalismos políticos lleva al universalismo, a la mezcla de los pueblos y de las culturas, y a las diversas formas de centralismo.
La sociedad mercantil y el modelo americano amenazan a todas las culturas de la Tierra. En Europa o en Japón la cultura ha sido reducida a un «modo de vida» («way of life») que es justo lo inverso a un estilo de vida.
El hombre es así clasificado, es decir reducido a las cosas económicas que compra, produce o recibe, según el mismo proceso (pero más intensamente aún) que en los sistemas comunistas. Su personalidad se acaba en los bienes económicos que solos estructuran su individualidad. Cambiamos de personaje cuando cambiamos de moda. Ya no estamos caracterizados por nuestros orígenes (reducidas al «folclore») ni por nuestras obras, sino por nuestros consumos, nuestro «standing». En el sistema mercantil, los modelos cívicos dominantes son el consumidor, el asegurado, el asistido; y no el productor, el inversor, el empresario. No hablemos de los tipos no-económicos: el jurista, el médico, el soldado, que se han convertido en tipos sociales secundarios.
La sociedad mercantil difunde un tipo de valores cotidianos perjudiciales respecto al trabajo como tal: vender y consumir el capital parece más importante que construirlo. Y no hay nada más igualitario que la función de consumo. Los productores, los empresarios, se diferencian por sus actos; ponen en juego capacidades desiguales. Pero consumir, es el no-acto al que todo el mundo, sean sus capacidades las que sean, o su origen, puede acceder. Una economía de consumo se mete en una vía inhumana en la medida en que el hombre es etológicamente un ser de acción y de construcción. Así, paradójicamente la alta productividad de las industrias europeas subsiste a pesar de la sociedad liberal mercantil y no a causa de ella. ¿Por cuánto tiempo? Hay que precisar que nuestra crítica de la sociedad mercantil no es un rechazo, muy al contrario, de la industrialización o de la tecnología. La noción de comunidad orgánica, que oponemos a la sociedad mercantil, no tiene nada que ver con la «sociedad de convivencia original francés: conviviale» de los neo-rousseanistas (Illich, etc…)
La técnica es para nosotros una adquisición cultural europea, pero debe ser considerada como una herramienta de poder y de dominio del medio y ya no como una droga al servicio del bienestar. Entonces no compartimos las críticas izquierdistas con resonancia bíblica, sobre la «maldición del dinero» y sobre la «voluntad de poder» de la sociedad contemporánea. La sociedad mercantil no afirma ninguna voluntad, ni en el nivel del destino global, ni siquiera en el de una estrategia económica.
Las consecuencias de esta civilización de la economía son graves para el destino de nuestra especie, y al mismo tiempo, para nuestro futuro político y económico. Honrad Lorenz ve en la «unidad de los factores de selección», todos de naturaleza económica, una amenaza de empobrecimiento humano. «Una contra-selección está en marcha –revela Lorenz en Nouvelle Ecole– que reduce las diversidades de la humanidad y le impone pensar exclusivamente en términos de rentabilidad económica a corto plazo. Las ideologías economistas, que son tecnomórficas, hacen del hombre una máquina manipulable. Los hombres, unidades económicas, son cada vez más iguales, como máquinas precisamente».
Para Lorenz, la subordinación de los valores no económicos es una catástrofe, no sólo cultural sino biológica. El consumir constituye una amenaza psicológica para los pueblos. Lorenz, como médico, habla de patología colectiva. Morimos de arteriosclerosis. La civilización del bienestar económico nos lleva lentamente, según Lorenz, hacia la muerte templada. Escribe: «hipersensibles al no placer, nuestras capacidades de gozar se debilitan».
La neofilia, este gusto siempre insatisfecho de nuevos consumos, tiene, para los antropólogos, efectos biológicos nefastos y desconocidos. Pero, ¿qué es la supervivencia de la especie al lado de la subida del precio de los croissants de mantequilla? En fin, si nadie piensa en estos problemas, nosotros sí.
Muerte templada, pero también declive demográfico. La dictadura de la economía ha hecho de nosotros europeos unos pueblos corto-vivientes según el análisis de Raymond Ruyer. Atacados a nuestras preocupaciones económicas inmediatas, nos hemos convertido en objetos y en victimas de la historia biológica.
Nuestros economistas son sensibles al declive demográfico solamente porque comprometerá la financiación de la jubilación. «Nuestra civilización economista –escribe Raymond Ruyer– es por esencia anti-natalista y suicida porque es, por esencia, anti-vital, anti-instintiva».
Pero el consumo de masas ha convertido a la cultura en «primitiva». Los mercaderes de bienes de consumo poseen un poder cultural, que se ejerce en el sentido de un desarraigo, y de una masificación igualitaria. No son los consumidores quienes eligen su estilo de vida –mito democrático querido por los liberales– sino son firmas mercantes quienes crean comportamientos de masa destruyendo las tradiciones específicas de los pueblos. Mediante el «marketing», mucho más que por la propaganda política, se impone casi científicamente un nuevo comportamiento, jugando sobre el mimetismo de las masas desculturizadas. Una sub-cultura mundial está naciendo, proyección del modelo americano. Se orientaliza o se americaniza a voluntad. Desde el final de la primera guerra mundial, del «new look» a la moda «disco», un proceso coherente de condicionamiento sub-cultural está en marcha. El rasgo común: el mimetismo de los comportamientos lanzados por los mercantes americanos. Así, la economía se ha convertido en uno de los fundamentos cualitativos de la nueva cultura, sobrepasando ampliamente su función de satisfacción de las necesidades materiales.
Incluso en el plano estrictamente económico, que no es, según nuestro punto de vista, capital, el fracaso del sistema mercantil dado hace algunos años es patente. No hablemos ya del paro y de la inflación, sería muy fácil. Jean Fourastié anota: «la indigencia de las ciencias económicas actuales, liberal o marxista» y las acusa de usurpación científica. «Asistimos – dice– sobre todo desde 1973, a la carencia de los economistas y al inmenso naufragio de su ciencia». Añade: «los economistas liberales o socialistas han pensado siempre que sólo lo racional permitía conocer lo real. Sus modelos matemáticos se han construido sobre la ignorancia o el odio de las realidades elementales. Ahora bien, en cualquier ciencia, lo elemental es lo más difícil. Se llega a ser despreciarlo porque no se presta a los ejercicios clásicos sobre los que los economistas universitarios se otorgan sus diplomas. Fourastié concluye: «Nuestro pueblo, nuestros economistas, nuestros dirigentes viven sobre las ideas del siglo XIX. Los impasses de la racionalidad empiezan a ser visibles. El hombre vive al final de las ilusiones de la inteligencia».
Un reciente premio Nobel de economía, Herbert Simon, acaba de demostrar que en sus comportamientos económicos u otros, el hombre, a pesar del ordenador, no podría optimizar sus elecciones y comportarse racionalmente. Así, la «Teoría de los Juegos y del Comportamiento Económico» de Von Neumann y Morgenstern, una de las bases del liberalismo, se revela falsa. La elección razonada y óptima no existe. Herbert Simon ha demostrado que las elecciones económicas eran primer término, al azar, arriesgadas, voluntaristas.
Estas ilusiones de la inteligencia han causado a los liberales graves fracasos; cojamos algunos al azar: El sistema liberal mercante despilfarra la innovación y utiliza mal la acción técnica. Esto es, como lo había visto Wagemann, porque la contabilidad en términos de provecho financiero a corto plazo (y no en términos de «excedente» global) frena cualquier inversión y cualquier innovación no vendible y no rentable a corto plazo.
Otro fracaso, con consecuencias incalculables: la llamada a la inmigración extranjera masiva. Los provechos inmediatos, estrictamente financieros, resultado de una mano de obra explotable y maleable es los que ha contado frente a los «costes sociales» a largo plazo de la inmigración, que nunca han sido considerados por el Estado y por la patronal. La codicia inmediata de los importadores de mano de obra no ha hecho pensar en lo «que no se gana» en términos de «no modernización» provocado por esa elección económica absurda.
El responsable de una gran empresa me decía recientemente con un tono despectivo que su ciudad estaba «rellena de inmigrantes» y que esto le molestaba personalmente. Pero después de algunos minutos de conversación, me confesaba con muy buena conciencia que diez años antes, había «sondeado» en el extranjero para «importar» mano de obra que fuese barata. Tal inconsciencia se asemeja a una nueva esclavitud. Es impresionante constatar que incluso la ideología marxista, a pesar de su desprecio a las diversidades culturales y étnicas, no se ha atrevido, como el liberalismo, a utilizar para su provecho el desenrazamiento masivo de las poblaciones rurales de los países en vías de desarrollo.
Gobiernos irresponsables y una patronal ignorando las realidades económicas, y desprovistos del menor sentido cívico y ético, han garantizado una práctica neo-esclavista cuyas consecuencias políticas, culturales, históricas –e incluso económicas– son incalculables (precisamente) para los países de acogida y sobre todo para los países que proporcionan la mano de obra.
Más preocupados de los «negocios» y del «bienestar», los liberales no se han enfrentado a los desafíos más elementales: crisis de la energía, crisis del patrón dólar, subida de los costes europeos y competencia catastrófica de los países del Este y de Extremo-Oriente.
¿Quién se preocupa de ello? ¿Quién propone una nueva estrategia industrial? ¿Quién piensa en que el final de la prosperidad ya ha empezado? La respuesta a los desafíos gigantes del final del siglo sólo es posible en contra de las prácticas liberales. Solamente una óptica económica fundada en las elecciones de un espacio económico europeo semi-autárquico, de una planificación de una nueva política de sustitución energética a medio plazo, y de una retirada del sistema monetario internacional, se adaptaría a las realidades actuales.
Los dogmas liberales o «libertarios» del libre intercambio, de la división internacional del trabajo, y del equilibrio monetario se revelan no solamente económicamente utópicos (y estamos dispuestos a demostrarlo técnicamente) sino también incompatibles sobre todo con la elección política de un destino autónomo para Europa.
Como para los nuevos filósofos que se contentaban en reactualizar a Rousseau, hay que tomar conciencia de la impostura de la operación publicitaria de los «nuevos economistas».
No se trata ni más ni menos que de una vuelta a las tesis bien conocidas de Adam Smith. Pero los nuevos economistas franceses (Jenny, Rosa, Fourcans, Lepage) no son nada por ellos mismos y sólo vulgarizan las tesis americanas. Miremos del lado de sus maestros.
Partiendo de una crítica pertinente, es verdad, del «Welfare State» (el Estado providencia burocrático aunque neoliberal), la escuela de Chicago, monetarista y conservadora, con Friedmann, Feldstein, Moore, etc., predica un retorno a la ley micro-económica del mercado, rechaza cualquier obligación del Estado hacia grandes empresas, reencontrando así la despreocupación de los liberales del siglo XIX hacia el paro y las cuestiones sociales. Y la escuela de Virginia, con Rothbard, David Friedman, Tullock, etc… quiere ser «anarco-capitalista», partidaria del estallido del Estado y de la reducción total de la vida social y política a la competencia y a la única búsqueda del provecho mercantil.
Se puede criticar estas tesis, conocidas y «recalentadas» desde el punto de vista económico. Pero que sea suficiente decir que, para nosotros europeos, incluso realizable y «próspero», un programa tal significa la muerte definitiva como pueblos históricos. Los «friedmanianos» y los «libertarios» nos proponen la sumisión al sistema del mercado mundial dominado por leyes que favorecen a la sociedad americana pero que son incompatibles con la elección que debemos tomar, de permanecer como naciones políticas y pueblos evolucionando en sus historias específicas.
La economía orgánica no quiere ser una Teoría. Sino una estrategia, que se corresponde únicamente con la elección, en la Europa del siglo XX, de sociedades donde el destino político y la identidad cultural se sitúan antes que la prosperidad de la economía. Subsidiariamente, la función económica es además mejor dominada.
Reflexionamos, en el GRECE, sobre esta nueva visión de la economía, a partir de los trabajos de Tomar Spann y de Ernst Wagemann en Alemania, Johan Akerman en Suecia y François Perroux en Francia. Wagemann compara la economía liberal a un cuerpo sin cerebro, y la economía marxista a un cerebro subido en zancos. La economía orgánica, modelo práctico que no pretendemos exportar, quiere adaptarse a la tradición trifuncional orgánica de los europeos. Según los trabajos de Bertalanffy sobre los sistemas, la función económica se consideraba como un organismo parcial del organismo general de la comunidad. Según los sectores y las coyunturas, la función económica puede estar planificada o actuar según las leyes del mercado. Adaptable y flexible, admite el marcado y el beneficio, pero los subordina a la política nacional. El Estado deja a las empresas, en el marco nacional, actuar según las restricciones del mercado pero puede, si las circunstancias lo exigen, imponer con medios no económicos la política de interés nacional.
Las nociones irreales de «macro y micro economía» dejan paso a la realidad de la «economía nacional», también las nociones de sector público y privado pierden sentido, ya que todo es a la vez «privado» en el nivel de la gestión y «público» en el sentido de la orientación política.
Los bienes colectivos duraderos son preferibles, y no la producción de bienes individuales obsoletos y energéticamente costosos. Los mecanismos y manipulaciones económicos son considerados como poco eficaces para regular la economía con respecto a la búsqueda psicológica del consenso de los productores.
La noción contable de excedente y de coste social sustituye los conceptos criticables de «rentabilidad» y de «provecho». Por su elección de centros económicos autoritariamente descentralizados, y de un espacio europeo de gran escala y semi-autárquico (caso de los EE. UU. de 1900 a 1975) la economía orgánica puede pretender una potencia de inversión y de innovación técnica superior a lo que autoriza el sistema liberal, frenado por las fluctuaciones monetarias y la competencia internacional total (dogma reduccionista del libre intercambio según el cual la competencia exterior sería siempre estimulante).
En última instancia, la economía orgánica prefiere el empresario al financiero, el trabajador al asistido, el político al burócrata, los mercados públicos y las inversiones colectivas, al difícil mercado de los consumidores individuales. Más que las manipulaciones monetarias, la energía del trabajo nacional de un pueblo específico nos parece como lo único capaz de asegurar a largo plazo el dinamismo económico.
La economía orgánica no es en sí misma la finalidad de su propio éxito. Pero quiere ser uno de los medios de asegurar a los pueblos europeos el destino, entre otros posibles (lit: parmi d´autres posibles), de pueblos con larga vida.
Para concluir, habría que citar la conclusión que el economista Sombart ha dado en su tratado El Burgués, pero sólo mencionaremos el pasaje más profético: «En un sistema fundado en la organización burocrática, donde el espíritu de empresa habrá desaparecido, el gigante convertido en ciego estará condenado a arrastrar el carro de la civilización democrática. A lo mejor asistiremos entonces al crepúsculo de los dioses y el Oro será devuelto a las aguas del Rin».
François Perroux ha escrito también que deseaba el fin del culto de Mamón que «brilla hoy con una prodigiosa luz».
Hemos elegido contribuir al fin de este culto (francés: Nous avons choisi de contribuir à la fin de ce culte), asegurar el relevo del último hombre, el de la civilización de la economía, de la que el Zaratustra de Nietzsche decía:
«¿Amor, creación, deseo, estrella?
¿Qué es eso?
Así pregunta el último hombre y guiña el ojo.
La tierra se hará más exigua y sobre ella saltará el último hombre, este que reduce todo.
Hemos inventado la Felicidad, dicen los últimos hombres.
Y guiñan el ojo».
00:05 Publié dans Economie, Nouvelle Droite, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume faye, nouvelle droite, théorie politique, politologie, économie, sciences politiques, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook





