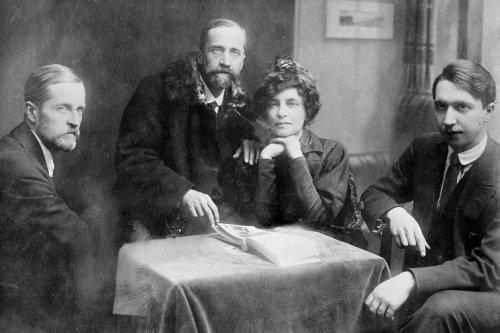jeudi, 03 mars 2022
Arrogance américaine et réaction russe: écoutez les paroles du général Marco Bertolini

Arrogance américaine et réaction russe: écoutez les paroles du général Marco Bertolini
par Eugenio Palazzini
Source: https://www.ilprimatonazionale.it/esteri/arroganza-usa-reazione-russia-leggere-parole-generale-bertolini-224970/?goal=0_5b66923a54-9657225476-437176193&mc_cid=9657225476&mc_eid=dc220ae7bc
Rome, 23 février - Lire avec un grain de sel les textes et les communiqués sur la très délicate crise ukrainienne, en constante évolution, n'est pas à la portée de tous. Ces derniers jours, de nombreuses analyses et déclarations bizarres ont été émises, dictées par une ignorance substantielle, même par ceux qui occupent des rôles institutionnels de premier plan. Au contraire, le général Marco Bertolini, ancien chef du Haut Commandement Interforce, propose une analyse prudente et réfléchie, également à la lumière des précédents historiques.
Général Bertolini : "La volonté américaine de gagner"
"Le fait que Poutine ait reconnu les deux républiques du Donbass change certainement la situation. Le général a expliqué à Adnkronos qu'"il existe d'illustres précédents historiques dans le camp opposé, la même chose s'est effectivement produite au Kosovo de notre côté, et malgré les remontrances russes au moment où nous avons reconnu l'autonomie du Kosovo par rapport à la Serbie, la Russie ne s'y est finalement pas opposée. C'est une situation très délicate, je pense que la Russie essaie maintenant de nous mettre devant le fait accompli, un peu comme ce qui s'est passé avec la Crimée, que la Russie a reprise et où nous n'avons pas réagi, sur la base également d'un plébiscite dans la région".
Mais pourquoi semble-t-il maintenant que nous ayons atteint un point de non-retour en Ukraine ? "Je crois que la Russie, comme nous, a été victime de la volonté américaine de gagner", déclare Bertolini. "Les États-Unis n'ont pas seulement gagné la guerre froide, ils voulaient aussi humilier la Russie en prenant tout ce qui se trouvait dans sa zone d'influence. Ils ont soutenu l'autonomisation ou l'indépendance des pays baltes, de la Pologne, de la Roumanie et de la Bulgarie : face à l'Ukraine qui lui enlève toute possibilité d'accès à la mer Noire, la Russie a réagi".
L'arrogance d'acculer la Russie et les risques pour l'Italie
Le Kremlin ne peut donc pas assister sans réagir aux avancées continues de l'OTAN vers l'est, sous peine de perdre définitivement le contrôle de ce qu'il considère comme sa "voisine étrangère", assorti du sentiment consécutif d'un encerclement ingérable à long terme. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés", déclare Bertolini, "il y avait un peu d'arrogance à pousser les Russes dans un coin, alors, maintenant, ils ont réagi. Nous espérons désormais qu'elle se limitera aux deux républiques du Donbass et qu'il n'y aura rien d'autre, mais il y a aussi le problème de la stabilité du régime en Ukraine, où une situation a été créée avec un président plutôt improbable, qui vient du monde du show-business.
Ce sont toutes des questions que le gouvernement italien ne peut ignorer, car notre nation risque de lourds revers économiques causés par la poursuite du bras de fer qui est en cours. "C'est un moment très dramatique. L'Italie est impliquée d'un point de vue énergétique, car si la Russie ferme les robinets ce soir, nous nous cuirons nos repas sur des feux de bois et non sur des cuisinières à gaz", a noté le général. Mais ce n'est pas tout, puisque "nous sommes également impliqués d'un point de vue opérationnel, car les Global Hawks qui survolent l'Ukraine partent de Sigonella, l'Italie étant en grande partie une base militaire américaine. Le risque est là, il est présent et réel. Nous espérons une rencontre entre Draghi et Poutine, à ce stade les jeux sont déjà faits et je ne pense pas qu'ils auront une grande marge de manœuvre, mais s'il y a une chance de faire entendre notre voix, c'est certainement une chose importante.
Lire aussi : Ukraine, soldats et drones de Sigonella : comment Washington "exploite" l'Italie d'Alessandro Della Guglia: https://www.ilprimatonazionale.it/esteri/ucraina-soldati-e-droni-da-sigonella-cosi-washington-sfrutta-litalia-224921/
15:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, europe, affaires européennes, politique internationale, otan, général marco bertolini |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 02 mars 2022
Sur la vie et l'oeuvre de Dmitri Merezkovsky

Sur la vie et l'oeuvre de Dmitri Merezkovsky
Antonio Rossiello
Ex: http://www.italiasociale.org/
L'écrivain et critique littéraire Dmitri Sergèyevich Merezkovskij est né à Saint-Pétersbourg dans la Russie tsariste le 14 août 1865, ou le 2 août 1865 dans le calendrier julien alors utilisé en Russie. Dmitri était le fils d'un modeste fonctionnaire, un fonctionnaire de la cour de Saint-Pétersbourg. De 1884 à 1889, il étudie l'histoire et la philologie à l'université de Saint-Pétersbourg, obtenant un diplôme en histoire et en philosophie avec une thèse de doctorat en philologie sur Montaigne. Merezhkovsky a fait ses débuts en littérature, étant un disciple du poète symboliste S. Nadon, avec ''Stichotvorenija (1883 -1887)'', ( Poèmes), en 1888. Il a rencontré Zinaida Nikolevna Gippius, (née le 20 novembre, c'est-à-dire le 8 novembre 1869 dans le calendrier julien, à Belyov, en Russie), sa future épouse, en mai 1888 lors d'un séjour à Borhoni / Borzhom dans le Caucase ; ils se sont mariés en janvier 1889, à l'âge de 23 ans, lui, et de 19 ans, elle.

Le couple s'est installé à Saint-Pétersbourg, où dans les décennies qui ont suivi leur mariage, ils sont devenus les animateurs d'un salon, lançant une société religieuse, accueillant des intellectuels et des artistes, un point de rencontre pour la scène intellectuelle du début du siècle dans la capitale. En 1891, Dmitri se rend à Vienne et à Venise. Ses sources de revenus sont dues au soutien de sa famille au cours des premières années, notamment lorsqu'il a assumé la responsabilité de prendre en charge les déplacements pour des raisons médicales de sa femme. En 1892, il publie son deuxième recueil ''Simvoly, pesni i poemy'' (Poèmes, symboles), qui peut être considéré comme une sorte de ''manifeste'' poétique de la nouvelle sensibilité décadente et symboliste.
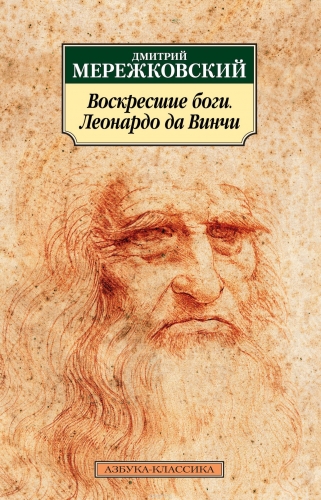
Merezhkovsky y subit l'influence de Poe et de Baudelaire, introduisant des thèmes et des motifs qui reviendront plus tard dans l'œuvre d'autres symbolistes : pessimisme lugubre, affirmation orgueilleuse de son propre individualisme, condition de l'homme en tant qu'"enfant de la nuit", prisonnier de ce monde et aspirant à "l'autre", dichotomie entre le culte païen de la beauté terrestre et les aspirations mystico-religieuses. Merezhkovsky a publié un recueil d'articles, ''O pricinach upadka i o novych tecenijach sovremennoj russkoj literatury'' (Sur les causes de la décadence et les nouvelles tendances de la littérature russe contemporaine), en 1893, qui constitue la première ''déclaration d'intention'' du décadentisme russe.
Dans ce document, Merezhkovsky appelle à la création d'un "nouvel art idéal", qui remplacerait le "réalisme utilitaire vulgaire" en Russie. À la lumière de cette conception idéaliste, qui prendra avec le temps des connotations nettement métaphysiques et religieuses, Merezhkovsky ressent le besoin de "revisiter" l'héritage littéraire des grands écrivains du passé et se consacre à la critique littéraire. Il était un penseur mystique chrétien et tirait ses revenus de la rémunération de ses écrits philosophiques, historiques, religieux et biographiques, ainsi que de sa poésie. Il a publié des nouvelles, des poèmes et des articles dans des périodiques littéraires et artistiques ; des livres dont il a reçu des droits d'auteur et des redevances. Il a toujours été un écrivain connu, puisqu'il publiait en Russie et gagnait beaucoup d'argent.
Pour les traductions, il recevait occasionnellement des droits d'auteur. Comme il n'existe pas en Russie d'accord international correspondant, les éditeurs étrangers sont libres de rémunérer ou non leurs traductions d'auteurs russes. Ces considérations s'appliquent à la période où il a vécu à l'étranger. Dans ses lettres, Zinaida décrit les conditions de vie comme n'étant pas toujours faciles. Leurs réserves étaient limitées. Le jeune couple a mené une vie dans de meilleures conditions à Saint-Pétersbourg grâce à leurs écrits. Ils n'ont pas eu d'enfants pour des raisons inconnues. Leur mariage orageux est devenu ouvertement un ménage à trois à partir de 1901, Dmitri Vladimirovich Filosofov (1872-1940) vivant avec eux dans la même maison. Dmitri Filosofov (Philosophoff- photo, ci-dessous) et Vladimir Zlobin (1894-1967) étaient ses secrétaires, éditeurs et co-auteurs.
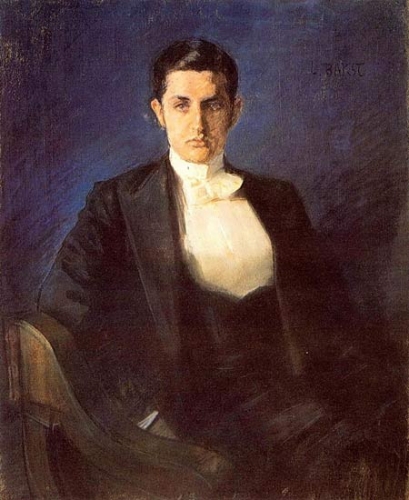
De gauche à droite: Filosofov, Merezhkosky, Zinaida Gippius, Zlobine.
Merezhkovsky admirait beaucoup Dostoievsky et Soloviev, qu'il a rencontré. Dans les années qui suivent 1890, il popularise le symbolisme français en Russie. La tradition naturaliste de Tolstoï à Dostoïevski est alors décadente, supplantée par la tendance mystique/religieuse, vers laquelle s'oriente Merezhkovski. Il a soutenu que les auteurs naturalistes n'avaient pas été tels, mais mystiques. Merezhkovsky s'est accrédité en initiant le symbolisme russe et l'âge d'or russe. Le symbolisme était une réaction au naturalisme et au réalisme. Un cri de spiritualité contre la pensée matérialiste russe consécutive. La peinture symboliste russe privilégie les figures mystérieuses dans lesquelles elle dépeint de manière suggestive une sorte de spiritualité à laquelle elle s'intéresse. Ils sont arrivés à une sorte de mélancolie élégiaque.
Les symbolistes ont adopté une vision spirituelle du monde. Ils ont mené une guerre contre l'utilitarisme général et une vision positiviste du monde, parmi lesquels ils n'incluaient ni l'art ni la philosophie, remplacés par de nouvelles exigences de valeurs éternelles. Les premiers symbolistes russes avaient compris qu'une synthèse entre le monde matériel et corrompu et les valeurs éternelles n'était pas possible. Ils ont rejeté la croyance que l'art pouvait servir le progrès social. Ils ont positionné l'artiste comme une figure divine libre dans laquelle la vie et l'œuvre pouvaient pointer vers une vie élevée et spirituelle. Ils voyaient l'artiste comme un médiateur des forces entre le monde phénoménal et le monde nouménal (intellectuel). Merezhkovski représentait les écrivains comme lui-même comme des voyants de deux mondes différents, la chair et l'esprit. Ce type de pensée s'est développé dans ''Le Christ et l'Antéchrist''. Les Merezhkovski étaient des figures de proue de l'âge du silence. Zinaida Gippius était une poétesse prolifique, auteur de romans et d'essais, de mémoires, de critiques, de comédies ; elle a écrit de nombreux essais critiques sur la littérature, la religion et la politique. Ils ont été publiés dans des magazines et journaux littéraires de Moscou et de Saint-Pétersbourg sous divers pseudonymes, dont Anton Krajny et Roman Arensky.
L'âme est religieuse dès le départ, le sentiment de solitude dans le monde est intolérable s'il n'y a pas de Dieu'' et (Zinaida Gippius). La religion est liée à toutes sortes d'églises, y compris l'église orthodoxe, elle ne s'y est pas conformée, ni son mari. Dmitri a cherché sa propre voie vers le divin comme Fiodor Dostoïevski. Il a stimulé l'idée d'un nouveau christianisme ; une nouvelle Église, où la personne et Dieu sont égaux. Ils ont exprimé leur néo-christianisme dans les paroles et les actes d'une vie scandaleuse. Leur triple union avec le philosophe, publiciste et critique Dimitri Filosofov a joué un rôle important dans l'union artistique du monde de l'art. Cette union, ou famille élargie, montrait absolument la nouvelle union spirituelle, mais la société considérait cela avec arrogance comme une continuation de son poème scandaleux : ''Je ne peux pas obéir à Dieu si j'aime Dieu... Nous ne sommes pas des esclaves mais des enfants de Dieu, et les enfants sont libres comme Lui''.
 En 1900, l'immense empire russe s'était industrialisé grâce à des emprunts financiers étrangers au moyen de prêts monétaires, sans aucune modernisation de sa structure sociale. Aucune perspective n'était donnée à l'indicible misère de sa population paysanne, soit sans terre à la merci des propriétaires, soit indépendante mais écrasée par les gigantesques taxes destinées à pourvoir au paiement de l'endettement russe (les propriétaires ne payaient pas d'impôts). L'immense sous-classe prolétarienne, qui vit dans des conditions misérables, afflue dans les villes et les centres industriels. L'énorme croissance de la population a permis de compenser les soldats dans l'armée, les ouvriers dans l'industrie, les travailleurs coloniaux sibériens et dans les campagnes. L'Empire est secoué par une politique désordonnée. Des grèves, des manifestations et des affrontements avec la police ont eu lieu dans plusieurs villes. Les radicaux de gauche ont repris le terrorisme politique. Les structures autoritaires rigides de l'autocratie semblaient incapables de réagir ou de saisir ce qui se passait.
En 1900, l'immense empire russe s'était industrialisé grâce à des emprunts financiers étrangers au moyen de prêts monétaires, sans aucune modernisation de sa structure sociale. Aucune perspective n'était donnée à l'indicible misère de sa population paysanne, soit sans terre à la merci des propriétaires, soit indépendante mais écrasée par les gigantesques taxes destinées à pourvoir au paiement de l'endettement russe (les propriétaires ne payaient pas d'impôts). L'immense sous-classe prolétarienne, qui vit dans des conditions misérables, afflue dans les villes et les centres industriels. L'énorme croissance de la population a permis de compenser les soldats dans l'armée, les ouvriers dans l'industrie, les travailleurs coloniaux sibériens et dans les campagnes. L'Empire est secoué par une politique désordonnée. Des grèves, des manifestations et des affrontements avec la police ont eu lieu dans plusieurs villes. Les radicaux de gauche ont repris le terrorisme politique. Les structures autoritaires rigides de l'autocratie semblaient incapables de réagir ou de saisir ce qui se passait.
Tolstoï a été excommunié de l'Église orthodoxe. Après 1900, Merezhkovsky a activement propagé une ''nouvelle conscience religieuse'', animant un groupe de ''chrétiens spirituels'' qu'il appelait les chercheurs de Dieu (Hogoiskateli), ou les décadents. Les Bogoiskatjeli, ou chercheurs de Dieu, étaient un courant qui rassemblait des personnes connues sous le nom de Société russe de 1900. Ce groupe comprenait sa femme Zinaida Gippius et Dimitri Filosofov, Vasily Rozanov, V. Ternavcev et d'autres. Il était le directeur du mouvement spiritualisé, avec la poétesse Zinaida Kippius, Balmont, Brjusou, Sollogub à ses côtés dans la direction. À partir de novembre 1901, Merezhkovsky a projeté des discussions entre les "chrétiens spirituels" et les "chrétiens officiels" (représentant de l'Église orthodoxe).
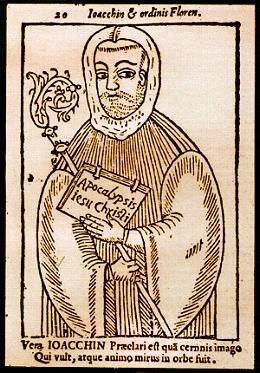 En 1901, Merezhkovsky et son ami Dmitri V. Filosofov, sont devenus les animateurs d'un mouvement philosophique religieux, dont le but était de promouvoir une ''nouvelle conscience religieuse'' en Russie, en fondant la Société philosophico-religieuse, dont l'instrument de diffusion était la revue ''Novyi put'' (La nouvelle voie), qui reflétait leurs idées métaphysiques. Ces réunions régulières étaient connues sous le nom d'Assemblées religieuses de Saint-Pétersbourg et ont duré de 1901 à 1903. Penseur religieux et mystique, il envisage l'avènement d'un nouveau monde de liberté et d'épanouissement chrétien qui s'accomplirait avec la réalisation du Royaume de l'Esprit, invoqué par Joachim de Fiore. L'attente du Troisième Royaume lui impose la nécessité de mener une action concrète, qu'il tente à plusieurs reprises, lors de conférences religieuses et philosophiques en 1901 qui sont mémorables dans l'histoire de la culture russe contemporaine.
En 1901, Merezhkovsky et son ami Dmitri V. Filosofov, sont devenus les animateurs d'un mouvement philosophique religieux, dont le but était de promouvoir une ''nouvelle conscience religieuse'' en Russie, en fondant la Société philosophico-religieuse, dont l'instrument de diffusion était la revue ''Novyi put'' (La nouvelle voie), qui reflétait leurs idées métaphysiques. Ces réunions régulières étaient connues sous le nom d'Assemblées religieuses de Saint-Pétersbourg et ont duré de 1901 à 1903. Penseur religieux et mystique, il envisage l'avènement d'un nouveau monde de liberté et d'épanouissement chrétien qui s'accomplirait avec la réalisation du Royaume de l'Esprit, invoqué par Joachim de Fiore. L'attente du Troisième Royaume lui impose la nécessité de mener une action concrète, qu'il tente à plusieurs reprises, lors de conférences religieuses et philosophiques en 1901 qui sont mémorables dans l'histoire de la culture russe contemporaine.
En avril 1903, ces assemblées philosophico-religieuses ont été interdites par l'Église (par Pobedonoscev, Procurateur du Synode sacré, ministre russe de l'Église orthodoxe).
Il a perdu de nombreux lecteurs et a eu des problèmes financiers après le mouvement hostile de l'Eglise à partir d'avril 1903. Merezhkovsky a cherché d'autres contributeurs, les nouveaux idéalistes. En 1904, ''Novy Put'' a été suspendu. Merezhkovsky et sa femme ont voyagé au plus profond de la Russie, au-delà de la Volga, pour rendre visite à des mystiques russes reclus dans des monastères. Ils ont rencontré des représentants de plusieurs sectes mystiques. Merezhkovsky a entretenu une correspondance avec certains de ces gnostiques russes. Gippius a écrit une histoire, décrivant les rituels secrets de la communauté gnostique khlystique avec une grande perspicacité dans la connaissance. Les auteurs qu'il a examinés sont analysés selon une procédure "antithétique" qui trouve son origine dans une opposition fondamentale qui, selon Merezhkovsky, a déterminé toute l'histoire humaine : l'antithèse entre la religion de la chair et la religion de l'esprit, entre le paganisme et le christianisme. Et dans l'histoire littéraire russe, les ''archétypes'', les incarnations parfaites de ces deux principes opposés seraient Tolstoï (''voyant de la chair'') et Dostoïevski (''voyant de l'esprit''). Cette antithèse est également à la base de l'une des œuvres les plus importantes de Merezhkovsky, publiée entre 1896 et 1905 et intitulée la trilogie de récits historiques ''Christos i Antichrist'', ''Christo et Antichrist'', un best-seller européen, composée des romans ''Smert'' bogov. Yulian Otstupnik", (Mort des dieux. Julien l'Apostat) de 1896, "Voskressie bogi. Leonardo da Vinchi (1899-1900)'', (La résurrection des dieux. Léonard de Vinci)'' en 1901, et ''Antikhrist : Pyotr i Aleksej'', (L'antéchrist : Pierre et Alexis) en 1905 .
Dans cet ouvrage, construit selon un dessein philosophique précis et ambitieux, Merezhkovsky a concentré son attention sur trois moments historiques où, selon lui, le pressentiment du Troisième Royaume était le plus fort, de cet âge d'or où l'humanité pourra parvenir à une conciliation et une synthèse entre le paganisme et le christianisme. Avec cette trilogie, il a fait renaître le roman historique en Russie. Ses trois parties, situées à des époques et des zones géographiques distinctes, révèlent une érudition historique et servent de véhicule aux auteurs d'idées historiques et théologiques. Sur les questions brûlantes de la Russie contemporaine, ceux qui cherchaient Dieu n'avaient pas de réponse ou d'attitude claire. Leur mysticisme était simplement romantique, ils montraient peu de potentiel pour soulever des questions politiques et apporter des solutions politiques. Sa trilogie est contemporaine de ses voyages à Rome et à Constantinople. C'est sa période la plus lucide sur le plan intellectuel, au cours de laquelle le pouvoir expressif du langage atteint son acmé.

Chez Julien, il y avait l'élan vivifiant de nombreuses images, la blanche et froide Aphrodite amaudienne, née de l'écume, sans honte dans sa méditation, devant laquelle le futur empereur, sous les traits du moine chrétien, l'âme macérée par le doute, s'incline, stupéfait par la lumière soudaine qui l'éveille à la vie - c'est l'actif du triomphe païen. Opposant actif au positivisme, prédominant dans la culture russe, il fait évoluer sa spéculation en termes d'antinomianisme et de vulgarisation ; au pathos de Tolstoï, brillant voyant païen et panthéiste de la chair, il oppose l'œuvre de l'excellent voyant de l'esprit qu'était Dostoïevski, révélation de l'esprit chrétien au sens propre. La trilogie du roman historique "Le Christ et l'Antéchrist", œuvre moderniste, est antinomique, où l'on oppose l'histoire de "Julien l'Apostat, ou la mort des dieux", en 1896, à "Léonard de Vinci, ou la résurrection des dieux", en 1901 ; "Pierre et Alexis", en 1905, dont l'idée centrale est l'opposition entre la conception grecque de la sainteté de la chair et la conception chrétienne de l'esprit, le choc entre le Christ et l'Antéchrist.
L'antéchrist acquiert une terrible évidence dramatique dans la lutte racontée dans un troisième roman, ''Pierre et Alexis'' de 1905, qui fut suivi d'une autre trilogie historique, représentant la lutte historique entre les mêmes principes (le Christ et l'antéchrist) en relation avec le futur destin de la Russie : composé du drame ''Pavel I'', (La mort de Paul I) de 1908 ; et des romans ''Alexandre I (1911-'12) Pervyj'', (Les secrets d'Alexandre I) de 1911 ; ''Perventsy svobody. Istorija vosstanija 14 - go Dekabrja 1825", (La conspiration des décabristes) de 1917. Il élargit cette vision antinomique et la repropose, comme une révélation, dans ses autres perspectives d'histoire et de critique. L'histoire a été pensée comme un processus qui se déroule dans l'opposition antinomique entre le règne du père, dans l'Ancien Testament, et le règne du fils, mis en œuvre dans le christianisme.
Il n'a pas réussi à donner à cet antinomianisme une véritable fonctionnalité dialectique, à le valider comme principe du dynamisme interne de la vie et de l'histoire. Un ordre extérieurement inchangé et immuable a été effectivement corrodé, alors que la hache de la révolution soviétique est tombée sur la Sainte Russie - la Russie du Tsar, de la vision messianique de l'Empire, de la Troisième Rome. La mission impliquée dans l'inscription gravée dans la salle du tsar ''le soleil a rencontré son ouest, et c'était la nuit'' est passée entre des mains qui en ont inversé le sens et l'ont brandie jusqu'en 1989, année de la chute du communisme soviétique. Merezhkovsky a ensuite écrit d'autres ouvrages historiques, dans lesquels l'histoire était de plus en plus artificiellement "interprétée" et destinée à des fins démonstratives spécifiques par l'écrivain.
En 1896, il a publié ''Novyj e stijkhotvorenija. (1891 - '95)" ; en 1897, "Vechnye sputniki. Portrety iz vsemirnoj literatury", ("Compagnons éternels"), un recueil d'essais sur divers écrivains, et en 1901-'03 "Tolstoy i Dostoevsky", ("Tolstoy as man and artist : with an essay on Dostoevsky"). L'essai critique "Tolstoy and Dostoevsky (1901 - '03)" suit la maturation et l'insertion de Merezhkovsky dans le grand courant dostoevskien de la fin du XIXe siècle, avec sa contribution personnelle. Il a été publié en série dans le périodique ''World of Art'' à partir de 1901. Vladimir Pozner a écrit que c'était le livre de Merezhkovsky le plus profond et le plus vivant de l'histoire de la critique littéraire russe. Il a exposé sa perspective métaphysique, sa vision des événements humains basée sur l'avènement du Regnum, l'harmonie supérieure dans laquelle l'éternelle lutte entre le Bien et le Mal est résolue par la résolution des extrêmes opposés - lorsque les deux moitiés de la vérité, la chrétienne et la païenne, sont mûres pour l'intégration ou la réunion.
Piotr Kogan a écrit que l'histoire de l'humanité est présentée par Merezhkovsky comme un pressentiment du futur Royaume qui unira le principe païen et le principe chrétien. Merezhkovsky appréciait les moments où le pressentiment de l'avenir se manifestait, quand au milieu du christianisme triomphant ou du paganisme triomphant, c'est-à-dire au milieu du triomphe de l'une des deux moitiés de la vérité intégrale, apparaissaient les chercheurs de Dieu, les insatisfaits, incapables de découvrir les vérités intérieures et incapables de se contenter d'une vérité incomplète. Ils recherchaient une vérité totale, intégrale, absolue. Sur l'interprétation antithétique entre Tolstoï, poète de la chair, et Dostoïevski, poète de l'esprit. Il a été suivi en 1904 par ''Sobranie stikhov. 1883-1903, ( Collection poétique ) ; ''Gogol' i chort. Isledovanie.'', ('Gogol' et le diable') de 1906 ; ''Probok russkoj revoljatsii. Kjubileja Dostoevskogo'', (Le prophète de la révolution russe) de 1906, toujours sur Dostoevsky ; des essais dans ''Grjaduscij Cham'', (Le Cam qui vient) de 1906 ; en 1906 ''Grjadushij kham. Chekhov i Gorkij'' ; en 1908 ''Ne mir, no mech'' ; en 1910 ''Bol'naja rossija'', (La Russie malade) ''Lermontov poète sverkhchelovechestvagogol, tvorchestvo, hizo, religija'', (Lermontov, le poète de la surhumanité) de 1909 sur Lermontov. En 1911-15 "Polnoc sobranie sochinenij" ; en 1904 "Dafnis i chloa. Povest-lotusa'', en 1904 ''Ljubov' sil'nee smerti-ital'janskaja novella XV veka'', en 1915 ''Bylo i budet. Dnevnik 1910-1914'', en 1915 ''Dve tajny russkoj poezii. Nekrasov i tjutchev'' ; en 1916 ''Budet radost, p'esa'' ; en 1917 ''Nevoennyj dnevnik. 1914-1916'' ; en 1917 ''Romantiki. P'esa'' ; alors que les ouvrages en russe antérieurs à 1915 étaient publiés à Saint-Pétersbourg, ceux d'après 1917 ont été publiés sous le nouveau nom de la même capitale, Petrograd.
 Merezhkovsky soutient la monarchie russe, à laquelle il attribue une institution divine. Il a résisté aux critiques sévères des écrivains progressistes. Il a fait l'objet de moqueries dans un article imprimé dans ''Osvobozhdenie'' en 1902, un périodique clandestin publié à l'étranger, en rapport avec sa comparaison de l'autocratie russe à un ordre mystique dans son livre sur Dostoïevski, signalant que le département de la police, les règlements sur les contrôles étaient intensifiés ; dans ''Moskovskie vedomosti'', ''Grazhdanin'', ''Cossack'', des sarcasmes ont été faits sur les convocations et les potences et autres attributs de protection : étaient-ils également des objets de l'ordre mystique ? Ils contenaient le secret indescriptible de Dieu. Mysticisme oblige. Si l'idée de la monarchie n'est que mystique et qu'elle est promue, non pas comme un son de cloche, mais avec respect et crainte, une telle conviction oblige à lutter furieusement contre l'ordre policier russe. L'autocratie est une idée religieuse, mais la défense d'une telle idée est un argument pour Dieu, et non pour le service de police. Quelles que soient les souffrances et la misère du peuple, le régime tsariste a maintenu son prestige grâce à l'expansion de l'empire russe. Le Caucase, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, des provinces absorbées au XIXe siècle. Au début du 20e siècle, la situation a brutalement changé. Dans la guerre de l'Est, l'impérialisme russe et le Japon modernisé s'affrontent.
Merezhkovsky soutient la monarchie russe, à laquelle il attribue une institution divine. Il a résisté aux critiques sévères des écrivains progressistes. Il a fait l'objet de moqueries dans un article imprimé dans ''Osvobozhdenie'' en 1902, un périodique clandestin publié à l'étranger, en rapport avec sa comparaison de l'autocratie russe à un ordre mystique dans son livre sur Dostoïevski, signalant que le département de la police, les règlements sur les contrôles étaient intensifiés ; dans ''Moskovskie vedomosti'', ''Grazhdanin'', ''Cossack'', des sarcasmes ont été faits sur les convocations et les potences et autres attributs de protection : étaient-ils également des objets de l'ordre mystique ? Ils contenaient le secret indescriptible de Dieu. Mysticisme oblige. Si l'idée de la monarchie n'est que mystique et qu'elle est promue, non pas comme un son de cloche, mais avec respect et crainte, une telle conviction oblige à lutter furieusement contre l'ordre policier russe. L'autocratie est une idée religieuse, mais la défense d'une telle idée est un argument pour Dieu, et non pour le service de police. Quelles que soient les souffrances et la misère du peuple, le régime tsariste a maintenu son prestige grâce à l'expansion de l'empire russe. Le Caucase, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, des provinces absorbées au XIXe siècle. Au début du 20e siècle, la situation a brutalement changé. Dans la guerre de l'Est, l'impérialisme russe et le Japon modernisé s'affrontent.
Une guerre éclate au sujet de l'influence des zones en Corée et en Mandchourie.
Les attaques japonaises contre la flotte russe à Porth Arthur en février 1904 ont assiégé la ville et infligé une sévère défaite à l'armée russe dans des batailles gigantesques et sans merci impliquant plus de 500.000 soldats et annonçant les combats de tranchées de la Première Guerre mondiale. Porth Arthur est devenu japonais en janvier 1905 et la nouvelle de sa chute a secoué la Russie. Les succès militaires ont permis de justifier l'autocratie du tsar. En janvier 1905, une foule de 200.000 personnes s'est approchée du palais de Saint-Pétersbourg pour adresser une pétition au tsar. Ce peuple a été cruellement abattu par les gardes, faisant des centaines de morts, et des protestations et des grèves ont éclaté. La libération de la Russie s'accompagne du déclenchement d'une guerre contre le Japon qui s'étend sur la moitié du globe, de la mer Baltique à la mer du Japon. En guise de contre-offensive, la flotte russe est coulée par l'armada navale japonaise en mai 1915, près de l'île de Tsushima.

Cela a aggravé l'insurrection populaire. En août 1905, le tsar, sous la pression de la rue, accorde au peuple une assemblée parlementaire de la Douma, qu'il sabordera au cours des deux années suivantes. Merezhkovsky, qui avait été un partisan de la monarchie russe, a changé d'avis pendant la révolution de 1905, qu'il a ouvertement soutenue. Sa femme et lui sont devenus des révolutionnaires zélés, et il a écrit de nombreux vers politiques. Avec l'échec de la révolution, le couple émigre à Paris. Ils y ont vécu pendant deux ans entre 1906 et 1907, puis sont revenus. Dmitri a dépeint le soulèvement de 1905 comme un événement religieux, révélant une révolution religieuse dont il est devenu un prophète de confiance.
En 1907, Dmitri et Zinaida Gippius, avec l'aide d'un cercle d'amis (Ern, Pavel Florenskii, Sergei Bulgakov Brikhnichev) ont fondé un journal à Moscou appelé ''Zhivaia Zhizn''. Merezhkovsky et Gippius ont divisé l'histoire de l'humanité et son avenir en trois phases. Le règne de Dieu le Père, le règne de l'Ancien Testament ; le règne de Jésus-Christ, le règne du Nouveau Testament, la phase actuelle qui était close ; et le règne du Saint-Esprit ou l'ère du Troisième Testament, qui était maintenant à l'aube, révélant progressivement un message à l'humanité. Dans ces révélations, les événements de 1905 étaient un message de transformation. Le Royaume de l'Ancien Testament avait l'autorité divine comme suprême ; le Royaume du Nouveau Testament avait l'amour comme autorité suprême ; et le Royaume du Troisième Testament pouvait révéler un hymne à la liberté comme autorité suprême. Ce cheminement heureux dans le monde reflétait le bonheur de la vie de Merezhkovsky, un jeune homme important, auteur, célèbre en Europe, suffisamment riche pour disposer librement de sa vie.
Les royaumes envisagés symbolisaient un changement dans la conscience humaine ; ainsi, le royaume final du Troisième Testament annonçait une nouvelle conscience religieuse, la genèse d'une Nouvelle Humanité. Le troisième testament devait résoudre les antithèses actuelles - sexe et ascétisme, individualisme et société, esclavage et liberté, athéisme et religiosité, haine et amour. L'énigme de la terre et du ciel, de la chair et de l'esprit pouvait être résolue dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pourrait racheter le monde, donnant à l'humanité une nouvelle vie de paix, d'harmonie et d'amour. L'Un trinitaire a été réalisé dans l'Un, et la chrétienté spirituelle a pu être amenée à s'ouvrir.
En propageant leur Cause de la Trinité dans l'Un, Gippius et Merezhkovsky espéraient une révolution religieuse, une métamorphose spirituelle de l'homme pour le préparer au Troisième Royaume. Gippius a accordé le but du développement de l'ensemble de l'universel historique, de l'humanité et du monde dans leur forme actuelle à travers la Révélation. Seule la venue du Christ pouvait unir l'humanité dans l'amour fraternel et l'harmonie de la vie familiale. Dans l'évolution spirituelle de l'humanité, l'Église apocalyptique pourrait être établie non pas comme un temps, mais comme une nouvelle expérience de Dieu dans la conscience et l'âme humaines. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en août 1914, les troupes russes entrent en Allemagne. Merezhkovsky a vu la Première Guerre mondiale comme une bataille pour la culture, qui était, pour la Russie, contre le militarisme allemand. Après des victoires initiales, l'offensive russe retourne à Saint-Pétersbourg. Les troupes russes ont perdu tout le territoire allemand qu'elles avaient gagné, puis la Pologne et la Lituanie.

En 1916, l'armée russe, entièrement démoralisée et mal commandée, perd régulièrement du terrain. La population se plaint de l'impératrice d'origine allemande et de son guérisseur préféré Grigori Raspoutine. Saint-Pétersbourg croule sous le poids des réfugiés de guerre et de la misère des énormes classes inférieures. La société se désintégrait lentement. Dans la classe supérieure, les hommes sont attirés par les jeunes filles appauvries et le nombre de divorces augmente. Au début de la guerre, la capitale a été rebaptisée du nom non allemand de Petrograd. Zinaida Gippius l'a surnommée Chertograd, la ville du diable, car l'ambiance de la ville était effrayante. Après la catastrophe militaire de la défaite et la perte définitive du prestige du tsar qui s'ensuit, la désintégration de l'État, la révolution renverse le tsar en mars 1917.
Un régime démocratique a été érigé, Merezhkovsky était un fervent partisan de la jeune démocratie russe. La nouvelle Russie est allée combattre l'Allemagne. Saint-Pétersbourg est mis à genoux, Berlin joue la carte des soulèvements populaires au sein de la Russie. Un petit groupe subversif, les bolcheviks, s'y répand avec des moyens financiers avec la mission de prendre le pouvoir après la cession d'un immense territoire à l'Empire allemand. Le leader bolchevik juif Vladimir Ilijc Ulianov, connu sous le nom de Lénine, est envoyé en Russie dans un train militaire allemand afin d'affaiblir les défenses russes alors que les révolutionnaires communistes remplissent leur mission. En fait, ils ont organisé un coup d'État et pris le pouvoir en novembre 1917 (la révolution d'octobre) et ont signé un armistice avec l'Allemagne en décembre 1917. Ils signent le traité de paix de Brest-Litovsk avec l'Allemagne en mars 1918, par lequel ils renoncent à l'Ukraine, au Belarus et à la Finlande, qui passent sous influence allemande.
Les bolcheviks ont ensuite construit un régime totalitaire monstrueux, régnant par la terreur, exécutant des milliers de personnes dans les premiers mois de son existence. Ils ont établi une mainmise sur l'industrie en nationalisant les usines (souvent étrangères) et en dénonçant toute dette étrangère. Ils ont assuré le contrôle de l'armée en assignant un "gardien" communiste à chaque bureau. Lorsque l'empire allemand est tombé en novembre 1918, vaincu par les États-Unis, le régime bolchevique a intelligemment survécu en Russie en autarcie, en s'appuyant sur ses propres forces selon les principes marxistes-léninistes du camarade Staline. Merezhkovsky rejette la nouvelle dictature communiste comme une caricature impie du gouvernement de Dieu, comme il l'appelle, et s'y oppose activement. Les puissances démocratiques occidentales (France et Angleterre) ont soutenu, par opportunisme en tant qu'États capitalistes, les troupes s'opposant au bolchevisme dans le but de récupérer leurs avoirs - dettes et facilités déjà accordées au régime corrompu des tsars - et de rétablir un gouvernement démocratiquement élu.
Au cours de l'année 1919, les ''armées blanches'' pour la démocratie ont poussé dans les profondeurs de la Russie. L'"Armée rouge" a contre-attaqué victorieusement en octobre 1919 et a pris le contrôle de Petrograd. En décembre 1919, Merezhkovsky abandonne la Pologne voisine. Déjà partisan des soulèvements de 1905, dans lesquels il voulait voir le début de la ''révolution religieuse'' qui précéderait l'avènement du Royaume de l'Esprit en Russie, il a également soutenu la révolution de février 1917, mais ses espoirs de renouveau se sont finalement effondrés avec la révolution d'octobre 1917, qu'il considérait comme contre-révolutionnaire, et la prise du pouvoir par les bolcheviks.

En avril 1920, les troupes bolcheviques attaquent l'armée polonaise (elles s'aventurent donc loin du Dniepr), atteignent la Vistule et sont à deux doigts de conquérir Varsovie en août 1920. Grâce à l'intervention de l'Occident, les armées russes ont été vaincues, maintenant la Pologne dans un état de survie.
En 1919, les Merezhkovsky ont quitté la Russie et en octobre 1920, ils ont émigré en exil à Paris, en France. Ils ont décrit le bolchevisme dans ''Tsarevich Aleksej'', publié en 1920, (Le Tsarevic Aleksej) et dans ''Tsarstvo antikhrista'', publié en 1921 à Munich, (Le Royaume de l'Antéchrist. La Russie et le bolchevisme) et d'autres ouvrages traduits ultérieurement en plusieurs langues. Il était l'auteur de quelques pamphlets féroces contre le régime communiste soviétique. Dmitri a publié deux récits historiques sous le titre universel de ''Rozhdenie Bogoy'' entre 1924 et 25, (Naissance des Dieux), une bilogie ''Rozhdenie Bogov. Tutankhamon na krite'', publié à Prague et en 1925 : ''Messija'' (Le Messie ou Akhenaton, roi d'Égypte ou ''Akhenaton, joie du soleil'', 1927), publié à Paris. La Naissance des dieux, (un roman global de l'œuvre de Merezhkovsky, également car le temps de l'action se situe à l'origine des trois trilogies).
Pozner a résumé le sens de l'entreprise littéraire de Merezhkovsky : ''Après des années de positivisme empreint de médiocrité et d'hubris, le ton prophétique de Merezhkovsky, son érudition, son intérêt pour les phénomènes de la vie spirituelle et religieuse, lui ont assuré les premières places de sa génération, faisant de lui un écrivain dont l'importance a dépassé les frontières d'un pays. En 1925, "Tajna trekh. Egipet i vavilon", (Les mystères de l'Orient), publié à Prague, un roman sur des sujets égyptiens, dont l'action se déroule dans l'Égypte pharaonique. Les histoires étaient centrées sur le pharaon égyptien Akhenaton, le fondateur et l'une des premières religions monothéistes connues et éphémères. Ils ont dépeint Akhenaton comme un Messie, au sens chrétien, comme une ancienne manifestation du Christ. Les deux romans partagent l'idée centrale de la continuité et de l'intégrité du monde pré-chrétien et chrétien.
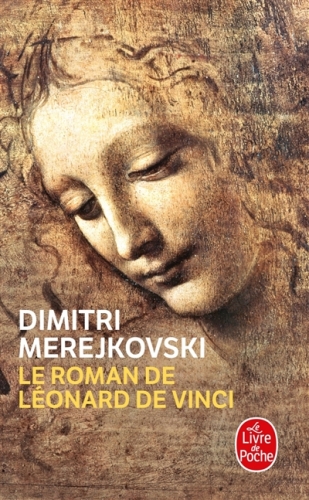
Le tournant de 1919-'20 a été le test critique pour les Merezhkovsky. Dès lors, Gippius a produit des œuvres furieuses contre les bolcheviks, très amères. Sa dernière œuvre était si subjective et capricieuse qu'elle a été remarquée plus pour sa forme que pour son contenu. Merezhkovsky est devenu très pessimiste. L'avenir heureux d'un troisième âge de la liberté et le Saint-Esprit de sa vie dandy et élégante à Saint-Pétersbourg ont émergé. Il est devenu le prophète de malheur, prédisant une fin du monde imminente dans ''Atlantis - Europe''. Le secret de l'Ouest'' en 1930. Les Merezhkovsky ont réussi à animer un salon littéraire russe dans leur maison pendant leur exil parisien. "Tajna zapada". Atlantica - Evropa'', (Le mystère de l'Occident : Atlantide - Europe), publié à Belgrade et traduit en italien sous le titre ''Atlantida'', publié par Hoepli en 1937 à Milan. En 1932-34, "Iisus neizvestnyj" ("Jésus inconnu"), publié à Belgrade ; en 1934, "Jésus, der kommende", publié à Frauenfeld ; en 1935, "Tod und auferstehung" ; en 1936, "Pavel, Augustin" ; en 1938, ''Franz von Assisi'', publié à Munich ; en 1938, ''Ark's Fang'', publié à Berlin ; en 1939, ''Dante'', publié à Paris ; en 1942, ''Calvin'', publié à Paris ; en 1933, ''Napoléon'', publié à Belgrade ; ''Nirvana''. Ses œuvres sont allées de pair avec sa vie. La tristesse slave était marquée par une aspiration à la transcendance.
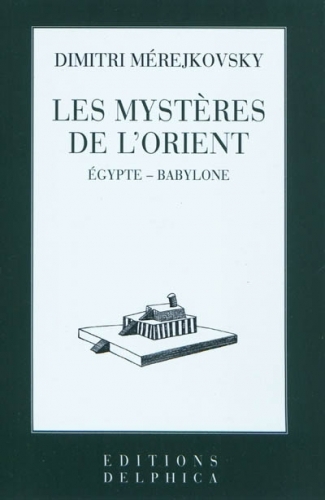
La troisième trilogie dans laquelle, après avoir surmonté les moments amers des premières années d'exil, sa plume redevient l'instrument fervent de sa religiosité, de son inépuisable spiritualité - de ses tentatives de plier les hommes et les événements pour les amener plus dociles dans le sillon de sa vision prophétique. Telle était sa limite, comme le soutient Prampolini : ''l'idéologue recourt au roman pour illustrer sa propre pensée, et la création artistique souffre des intentions sociales dominantes. Les tableaux sont arbitraires, car ils sont préconçus, l'art du narrateur est soumis aux intentions du théoricien''. Merezhkovsky était un "chercheur" sincère et passionné du divin ; au milieu des années 1920, il était le plus célèbre des écrivains russes du 20e siècle, alors que la culture des exilés russes antibolcheviques ou de ceux du Goulag avait été dispersée. Car Jean Chuzeville était devenu désavoué. Merezhkovsky a orienté l'attention d'un secteur des intellectuels russes vers le domaine de la religiosité et de l'éthique, contribuant à retisser les traditions littéraires russes abandonnées après la mort de Dostoïevski. L'histoire est considérée comme une titanomachie, et les personnalités brillantes au centre de ses romans sont dans un solipsisme absolu.
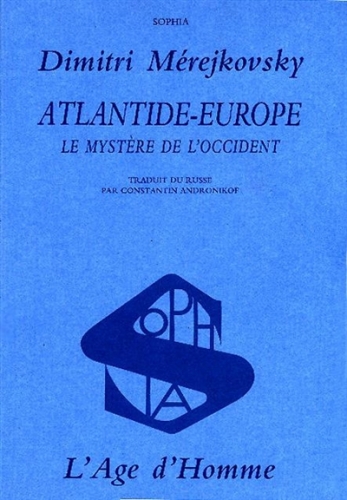
En août 1927, ils ont fondé un cercle littéraire appelé ''La Lumière verte'' avec ses réunions de jeunes et vieux écrivains russes et un nombre respectable de membres. En 1933, Merezhkovsky est nommé pour le prix Nobel de littérature en raison de la faveur dont bénéficie sa trilogie Le Christ et l'Antéchrist. " Prophète " inouï, Merezhkovsky a continué à écrire jusqu'à sa mort, se contentant de diffuser, de manière fatiguée et fumante, les conceptions philosophiques et critiques qu'il avait développées au cours des décennies précédentes. Plus tard dans sa vie, Merezhkovsky estimait que Benito Mussolini et Adolf Hitler étaient des leaders capables d'éradiquer le communisme. Il est décédé à Paris le 09 décembre 1941 à Paris, France, ou le 26 novembre 1941 du calendrier julien et a été enterré dans le cimetière de Saint-Geneviève-des-Bois, le même cimetière dans lequel sa femme, décédée le 09 septembre 1945 à Paris, sera enterrée. Il a été oublié dans l'édition italienne, en fait, seul "Julien l'Apostat" a été traduit et publié.
La morte degli Dei'' (La mort des dieux), seuls de rares exemplaires de 'Leonardo' (La résurrection des dieux) et le troisième volume de la trilogie 'L'Anticristo' (Pierre et Alexis) sont introuvables. D'autres écrits publiés en Italie dans les années 30 sur les saints Augustin, Paul et François sont introuvables. L'édition révolutionnaire ou radicale d'extrême droite s'est toujours transmise oralement, en ciblant les nostalgiques. Le militant national-révolutionnaire ou national-populaire reste en 1968 un cas psychiatrique, sans base doctrinale, lié à des états d'âme et influencé par la télévision et les jeux sans écologie, sociologie et éthologie, avec une inadéquation totale. Les années 68 et leur défaite générationnelle ont eu pour conséquence que, en raison d'obstacles financiers, cette culture a été restreinte à un environnement fermé, ce qui a entraîné une stagnation du marché, freinant la planification éditoriale à long terme. La culture différente de la culture marxiste ou anarcho-secrète a fait le reste.
Merezhkovsky représente la conscience du progrès ou du rapprochement après la protestation juvénile de 68 pour favoriser l'achèvement progressif d'une formation politique/culturelle organique. Un écrivain dépassé dans l'Italie d'aujourd'hui, avec son mysticisme flamboyant et son engagement social et politique anti-bolchévique. Cet engagement s'est traduit par sa collaboration avec le magazine russophone Sovremennyja Zapiski (Annales contemporaines) pendant ses années d'exil à Paris. Ses appels amers et urgents à ses contemporains, exprimés dans des lettres ouvertes à Wells, Nansen et Hauptmann, ont pris une valeur prophétique. Il fallait écraser le règne de la Bête qui avait son repaire entre les murs du Kremlin : ni la foi ni les armes n'y auraient contribué. Dans le sillage mystique et existentiel de Dostoïevski et de Solov'ev. L'effort intellectuel de renouveau l'a fait se hisser au rang de l'exposant mystique actuel.
Antonio Rossiello
15/04/2007
18:00 Publié dans Biographie, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, biographie, dmitry merezhkovsky, zinaida hippius, russie, lettres, lettres russes, littérature, littérature russe, histoire, révolution bolchevique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Mourir à 50 ans dans une église orthodoxe ou à 70 ans dans un supermarché occidental: tel est le choix de la ménagère ukrainienne !

Mourir à 50 ans dans une église orthodoxe ou à 70 ans dans un supermarché occidental: tel est le choix de la ménagère ukrainienne !
par Frédéric Andreu
Ce qui motive en premier lieu les masses humaines, guidés par des élites débiles, résident au niveau du bas-ventre. Les Ukrainiens se trouvent devant un choix de civilisation et identitaire que leur imposent, ni la Russie, ni l'Europe européenne, mais les forces otanesque de la division. Ils sont partagés entre, d'un côté, la perspective d'un salaire à 200 Euros qu'impliquerait le rattachement au contre-Empire du grand frère russe et de l'autre, les paillettes lucifériennes de l'Occident...
Le problème, c'est que la stratégie impériale des Etats-Unis et de l'Otan oblige à ce faux choix. Elle pose un limes entre votre âme et votre ventre. Cela c'est la victoire postume de Brzezinski, le merlin noir des élites étatuniennes.
A ce jeux-là, il n'est pas impossible que l'Ukraine connaisse un partage géopolitique en deux, au niveau du fleuve Dniepr. Mais cela rimerait alors avec le martyr des minorités de part et d'autre. Cette politique serait la victoire des puissances atlanto-sionistes qui sont derrière ce scénario diabolique.
L'un des rares politiques français qui ne s'y résigne pas n'est pas issu des rangs de la droite. C'est Jean-Luc Mélanchon, ancien député socialiste, certes, mais pas plus ni moins que ne l'était Marcel Déat avant guerre... En fait, la classe politique embourgeoisée et technocratique qui règne en France et à Bruxelles, capables des pires traîtrises et des pires non-sens historiques, déclarent en coeur: “avec nos sanctions, nous allons isoler la Russie !”.
L'hôpital se moque vraiment de la Charité ! Ces idiots utiles de l'Amérique pensent isoler un pays-continent 35 fois plus vaste que la France, allié de surcroît à la Chine et à l'Inde, pays dont le réservoir démographique correspond à la moitié de la population mondiale !
Résultat de cette stupidité sans nom est le suicide de l'Europe : c'est la petite péninsule européenne et non la Russie qui serait isolée comme une tête isolée du corps.
L'Europe aurait alors pour seule perspective d'être une annexe du grand marché américain. Bien sûr, que les démographes se rassurent, l'Afrique pourra toujours suppléer au manque démographique des Européens : les populations noires déracinées pourront se déverser, toujours plus nombreuses, sur le Vieux Continent, avec la bénédiction d'un pape tiers-mondiste et des élites européennes panmixistes.
Quand cette classe de Libéraux-traitres non élue qui dirige l'Union Européenne parle de paix, il faut entendre LGBTISME, pensée unique, matérialisme pratique, MacDonaldisation souriante de la société. Avec la mise au ban de la Russie, l'Europe sera en “paix” à la puissance dix. Voici le contenu du mot “paix” pour la génération à venir ! Adieu Homère et Pic de la Mirandole ; bonjour le clown multicolore Mac Do !
Les partisans du réel savent au contraire que l'Europe a tout intérêt à s'ouvrir à cette Russie frappée de l'aigle à deux têtes, l' ”empire bicéphale” reliant notre présent à la grande politique transcontinentale des derniers Bourbons.
En effet, on ignore trop souvent, dans le pays régicide qui a coupé la tête à Louis XVI, que le projet du Bon Roi était non seulement de lier alliance avec la maison des Habsbourg par le mariage avec Marie Antoinette, mais aussi de créer une alliance commerciale, voire plus, avec la Russie de Catherine II. A l'époque les élites russes et européennes ne parlaient pas seulement en terme de taux d'inflation et de statistique, ils ne parlaient pas dans un anglais d'aéroport mais dans le français de Molière. Ils parlaient de philosophie, de découverte des îles, de voyage, de vin et de belles lettres.
On ne sait généralement pas, non plus, que cette politique que les derniers Bourbons ont incarné par des mariages et des liens diplomatiques, est dans les faits, le même tropisme que Napoléon Bonaparte a suivi mais que l'Empereur a été contraint de faire par la guerre...
Les deux tentatives ont échoué, mais c'est pourtant ce flambeau-là qu'il faudrait reprendre car il est inscrit dans le destin même de la France, à la fois politique et spirituel. Il s'agit aussi de faire passer l'oxygène du poumon gauche (l'Europe) au poumon droit (la Russie) et vice-versa. Ce futur est tout simplement inscrit dans le critérium géographique de la terre puisque la France commence le Grand Continent et la Russie le termine, preuve que le plan spirituel et matériel ne s'opposent pas. Cela, Louis XVI et Catherine II le savaient, lui le catholique pratiquant ; elle, l'orthodoxe, lorsqu'elle déclara que la France devait être “nation privilégiée de la Russie”. La Révolution dite “française”, fomentée en réalité par des agents anglais, allait mettre un terme à ce rêve.
Et si le rêve de la Monarchie et de l'Empire napoléonien se réalisait finalement par un socialiste franc-maçon d'inspiration révolutionnaire ? Dans ce cas, Jean-Luc Mélanchon resterait dans l'Histoire d'abord et avant tout comme Français !
17:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ukraine, réflexions personnelles, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
France - La Dictature En Marche : les candidats prorusses privés de parrainages ?

France
La Dictature En Marche : les candidats prorusses privés de parrainages ?
Nicolas Bonnal
Nous affrontons en France l’an V de la dictature. Régis de Castelnau a rappelé :
« La campagne de l’élection présidentielle 2022 est un grand révélateur de la déshérence politique dans laquelle se trouve notre pays. En 2017, un trio constitué de la haute fonction publique d’État, de l’oligarchie économique et de la magistrature politisée, a organisé de longue main un coup d’État pour faire élire à la magistrature suprême un parfait inconnu.
S’appuyant sur l’essentiel de l’armature politique du Parti socialiste, Emmanuel Macron a ainsi réalisé un hold-up mettant la dernière main à la destruction des institutions républicaines. Une Constitution en lambeaux, plus de séparation des pouvoirs, plus de mécanismes de contrôle démocratique, corps intermédiaires mis hors-jeu, multiplication des règles et des initiatives proprement liberticides : la France, si elle ne peut être qualifiée de dictature, ne peut plus être considérée aujourd’hui comme une démocratie… »
En réalité il me semble que le coup d’Etat en France a commencé avant (s’il n’est, comme dirait Mitterrand, permanent) : arrivée du syndic de faillite Lagarde aux affaires, élection du pion yankee Sarkozy et surtout l’élection de Hollande qui avec Macron et Valls a tout pourri dans ce qui nous restait de république.
Comme on sait l’absence de résistance rend les tyrans plus fous et plus sanguinaires. Tel joueur de tennis (Monfils) flingué par le vaccin sera vilipendé par les médias ; tel gosse vacciné mais dépourvu de son masque, fût-ce en faisant un effort sportif, sera viré de son école sous les applaudissements de ses petits camarades ; tel dirigeant russe occupant une région martyr sans tirer un coup de feu sera comparé à Hitler ravageant la Pologne. Mais comme la Russie n’est pas la Lybie et que l’armée US ne vaut plus tripette (cf. Scott Ritter), il n’est pas question de lui faire la guerre. On reparle de sanctions jusqu’au jour mérité où la Russie asphyxiera les Européens prostrés et anesthésiés et filera son gaz aux Asiatiques plus fiables, plus riches et moins moralistes. Car « la vieille race blanche » des boomers et des bobos commence à nous les gaver.
Cela n’empêche pas l’animal blessé de devenir fou et dangereux. Il se venge alors sur les gilets jaunes et sur les petits candidats qui sont dépourvus de signatures s’ils sont jugés prorusses. Philippe Grasset a écrit :
« Face à Macron, sur ce sujet, une étrange ligne de bataille : Le Pen-Mélenchon-Zemmour. Peut-être se trouvera-t-il un grand esprit pour considérer que ces trois-là, qui représentent à peu près 40% des votants selon les chuchotements sondagiers, doivent subir les foudres d'une justice quasi-divine pour les punir d’être compréhensifs pour le Diable, en étant interdits des 500 signatures qui leur permettraient d’être candidats. Je pense que c’est bien la sorte d’état d’esprit qui conduit les raisons cannibalisées de ceux qui sont toute inconscience-toute innocence, au Culte de la Doxa, ou divinum lumen. Avec eux le Déluge, comme disait Noé. »
En effet nous allons nous retrouver sans candidats d’opposition (même contrôlée, mais ce n’est pas la question ici), et avec un Macron réélu face à Artaud et Hidalgo, à charge pour la Pécresse de fournir un feu d’artillerie verbale dont on sait qu’elle a le secret.
Pour moi la république est une farce tranquille et je pense comme l’Auteur de la controverse de Sion que depuis qu’elle est républicaine la France est la terre du fiasco récurrent (the land of recurrent fiasco, p. 603). Ce n’est pas une raison pour bouder son plaisir et c’en est une (de raison) de rappeler qu’au pays du passe et du masque éternel, du vaccin pour tous et de la presse orwellienne, il est bon de relire Drumont : ne fût-ce, comme dirait Bloy, que pour exaspérer les imbéciles.
« Les Français sont admirablement dressés à toute cette organisation fiscale (NDLR : ou autre) ; ils sont comme les méharis qui s’agenouillent pour qu’on puisse les charger plus facilement ou comme les chevaux de renfort d’omnibus qui, leur besogne faite, vont tout seuls rejoindre leur place en bas dans la montée et attendent là qu’on les attelle de nouveau. »

Et Drumont ne les avait pas vus dans le métro ou à la pizzéria, codés, vaccinés et masqués.
La réélection de Macron sur fond de candidats et d’électeurs cocufiés, de passe éternel et de triplement du prix de l’électricité et de réforme des retraites enchantera au moins les rares Français lucides. Le petit nombre des victimes (Léon Bloy encore) ne tempèrera pas notre joie cette fois. Car Macron réélu jettera à la poubelle avec leurs occupants neuf millions de maisons jugés polluantes. On espère que flics et gendarmes sauront montrer alors leur zèle coutumier.
Et le reste est littérature.
Sources principales :
https://www.revuemethode.org/m101828.html
https://www.dedefensa.org/article/la-montagne-qui-rugissait
https://ia800304.us.archive.org/35/items/LaControverseDeS...
https://www.rt.com/op-ed/547526-us-power-biden-ukraine/
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW...
https://www.bfmtv.com/immobilier/renovation-travaux/sous-...
16:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : emmanuel macron, france, présidentielles françaises, europe, affaires européennes, dictature |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pino Rauti et la méthode de la politique

Pino Rauti et la méthode de la politique
Source: https://vendemmietardive.blogspot.com/search?updated-max=2022-02-07T23:16:00-08:00&max-results=7
Sur la crise russo-ukraino-américaine, il y a quelques jours, constatant l'habituel réflexe atlantiste de notre droite italienne, fruit d'un conditionnement perpétuellement matraqué, et constatant ensuite avec un profond découragement que, par rapport à il y a trente ans, il n'y a pas eu le moindre pas en avant, j'ai évoqué et presque invoqué le nom de Pino Rauti. Les réactions ont été de trois types : ceux qui ont exprimé les mêmes sentiments que moi, ceux qui ont critiqué ma position, en insistant sur les erreurs politiques du secrétaire du MSI, et enfin ceux qui, s'appuyant sur des sources fallacieuses, ont reproduit les accusations qu'une certaine gauche conspirationniste avait faites autrefois, en alléguant des compromis avec des pouvoirs forts et des complots plus ou moins obscurs.
La troisième perspective est de loin la plus imparfaite. Elle serait vraiment répréhensible si elle n'était que le fait de quelqu'un y croit réellement. Mais il y a là une erreur de méthode : on ne peut accepter des thèses sans examiner leur contenu polémique et les déformations dont elles font l'objet par rapport à l'inimitié politique radicale et à la haine fanatique que cette inimitié peut parfois susciter. Une fois cela fait, on peut évaluer leur incohérence réelle et les reléguer au chapitre de la psychopathologie politique, en invitant ceux qui les ont acceptés de bonne foi à ne plus tomber dans de tels pièges.
La deuxième thèse, concernant les erreurs politiques de Pino Rauti, est certainement plus grave. La longue carrière politique de l'homme politique calabrais peut faire l'objet de critiques. Il y a eu quelques mauvais choix dans les années 1960 et 1970, mais surtout, la grande occasion gâchée de prendre le secrétariat du MSI en 1990-91 a représenté un point de non-retour pour tout un milieu de militants, de dirigeants, de politiciens et d'intellectuels. Pris dans un tourbillon de tactiques pour leur propre intérêt, dans un contexte de faiblesse électorale du parti, avec des alliés prêts à prendre sa place, il a fini par commettre la plus grosse erreur de toutes, qui n'a pas été de perdre sa position de leader du parti, mais de ne laisser aucun témoignage auquel ses partisans pourraient se raccrocher dans l'avenir. D'où, par exemple, la position profondément erronée sur la guerre dans le Golfe. L'erreur était de taille, précisément parce que Rauti n'a pas réussi, à ce moment-là, à suivre le style politique qu'il avait lui-même cultivé auparavant et communiqué à son cercle de référence, préférant un coup d'échecs inutile à une action ayant un fort attrait symbolique et une profonde valeur historique et culturelle.
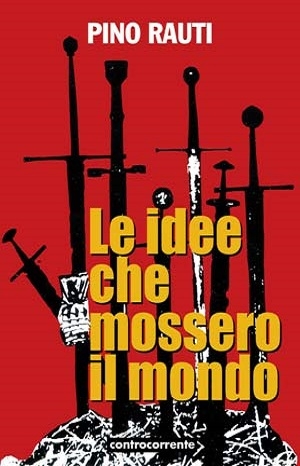
Sur cette question, cependant, la possibilité même de détecter son erreur la plus évidente, il faut le reconnaître, est à mettre sur le compte de sa grandeur. Et ici, nous devons comprendre ce qu'était l'enseignement de Pino Rauti. Pour résumer, nous pouvons utiliser le titre de l'un de ses textes, Le idee che mossero il mondo (Les idées qui ont fait bouger le monde). Il a inoculé à un milieu de militants politiques le merveilleux sérum d'un idéalisme particulier. Le moteur de l'histoire réside dans l'élaboration d'une vision du monde et de la vérité capable de s'imprimer dans la réalité, entraînant d'abord les hommes puis, avec eux, les choses. Il n'y a rien de plus radicalement antithétique à la modernité et à son matérialisme général. Il y a ce qu'il a appelé une "utopie lucide" à promouvoir et à ancrer dans le temps et l'expérience de notre peuple. Nous allons ici au-delà du volontarisme idéologique qui a connu un certain succès au XXe siècle, se montrant même compatible avec les élaborations matérialistes. Ici, au contraire, nous pouvons parler de la politique comme d'une science de l'esprit. Seule une révolution intérieure, commençant par la culture d'une idéosphère historico-philosophico-scientifique, peut produire non pas tant l'accès au pouvoir d'une élite à la place d'une autre, mais un changement radical dans la direction du chemin historique de notre civilisation. Se préparer à ce grand projet, se mouvoir à l'aise dans les grandes questions du temps et du monde, et en même temps apprendre le dur métier de l'homme politique (je me réfère, bien sûr, à Weber) au service de son propre peuple dans le petit et le quotidien : c'est le style que Rauti a communiqué à son peuple, et c'est précisément cela qui l'a rendu, comme nous tous, critiquable.
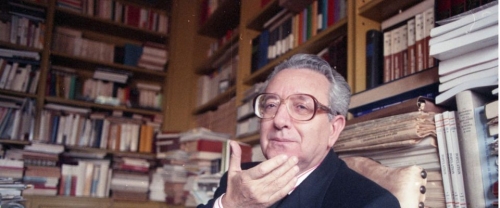
Et c'est précisément parce que nous pouvons être critiqués que nous n'avons pas peur de critiquer, surtout ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a pas de plus grand plaisir que d'affirmer les raisons de la pensée contre ceux qui pensent avoir raison uniquement en vertu de la position de pouvoir qu'ils occupent... et de là, on avancera peut-être l'argument risible d'une éthique de la responsabilité omniprésente (bien au-delà de ce que Weber lui-même lui avait accordé). Il n'y a rien que nous ayons stigmatisé avec plus de conviction : rester au pouvoir et demander lâchement de la compréhension pour ses mécanismes "irrésistibles", raconter aux gouvernés le conte de fées de l'impuissance "irrésistible" des gouvernants et, pendant ce temps, profiter des avantages personnels de cette usurpation impuissante. Voici donc le "feu au quartier général" de l'appel d'en bas pour que les élites se lèvent, qui n'est pas une faction mais un soutien, qui n'est pas une conspiration mais un activisme révolutionnaire qui appelle les élites à leur devoir, même difficile, ne renonçant pas à offrir leur aide. On dira qu'il s'agit en soi d'une formulation idéalisée. Certes, mais c'est sans doute le style que nous avons essayé d'incarner sous la direction de Pino Rauti et dans le sillage de son expérience. Et ce style est désespérément nécessaire à la droite d'aujourd'hui, à une époque de croissance et, si vous voulez, de succès social et médiatique. Parce que la scène politique italienne et européenne est pleine de météores, de droites et de droites de gouvernement et de gouvernement aussi, mais si Giorgia Meloni veut être quelque chose de différent, elle doit puiser dans cet héritage éthique et politique, en écoutant attentivement sa sacro-sainte critique et en en tirant le meilleur parti, peut-être en partant des questions internationales les plus urgentes.
Publié par Massimo Maraviglia
https://vendemmietardive.blogspot.com/search?updated-max=2022-02-07T23:16:00-08:00&max-results=7
15:55 Publié dans Histoire, Hommages, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, italie, pino rauti, hommage, msi, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 01 mars 2022
La guerre en Europe et l'autodestruction de l'Occident

La guerre en Europe et l'autodestruction de l'Occident
Stefan Schubert
https://kopp-report.de/krieg-in-europa-und-die-selbstzerstoerung-des-westens/
Alors que les hommes politiques allemands se sont confortablement installés dans leur monde parallèle aux couleurs de l'arc-en-ciel, monde dans lequel des licornes en train de brouter peuvent décider chaque jour si elles préfèrent être aujourd'hui une femelle ou un mâle, les armes parlent à nouveau en Europe. Avec un projet planifié à long terme, mis en œuvre avec autant d'habileté stratégique que d'absence de scrupules, Poutine a mis fin brutalement à l'une des plus longues périodes de paix du continent européen. Et la seule chose que les politiciens allemands, incapables de gérer la crise, parviennent à faire en cette heure historique, c'est de débiter des phrases creuses et d'éclairer en bleu et jaune la porte de Brandebourg.

Dans ce texte, il ne sera pas question de la violation du droit international ou de l'agenda mondialiste de l'OTAN, mais de la destruction de l'Allemagne, de la destruction de son identité et de la modification délibérée de la composition de sa population. Certes, de nombreux réseaux internationaux agissent depuis l'étranger, mais le plus grand ennemi du citoyen allemand aujourd'hui se cache dans son propre pays.
Alors que le principal objectif des gouvernements occidentaux est de rééduquer leur propre population et de la transformer en une masse conformiste sans défense (notamment avec les mesures décidées suite à l'apparition du coronavirus), d'autres pays créent des faits. Nous ne connaissons la chute de l'Empire romain que par les livres d'histoire, or nous assistons non seulement en direct à l'effondrement historique du monde occidental, et nous nous trouvons en plein dedans.
Alors qu'en Allemagne, le gouvernement fédéral le plus incompétent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a commencé son œuvre de destruction, les absurdités des élites berlinoises s'empilent chaque jour un peu plus. Une ministre des Affaires étrangères qui n'est même pas capable de manipuler son propre CV et son livre de bonnes manières pour qu'ils résistent à un simple examen et qui, pour l'une de ses premières interventions lors de son entrée en fonction, baragouine quelque chose à propos d'une "politique étrangère féministe". Et puis, il y a cet homme portant une perruque et des vêtements de femme qui a obtenu un mandat au Bundestag grâce aux quotas de femmes chez les Verts.
Et une ministre de l'Intérieur qui s'enfonce de plus en plus dans les marécages de l'extrême gauche antifa, diffame les promeneurs pacifiques (ndt: qui contournent les interdictions de manifester) et est sur le point de pousser à une nouvelle immigration de masse incontrôlée. De plus, des responsables de parti occupant les plus hautes fonctions de l'État, le président de la Cour constitutionnelle fédérale et le président de la protection constitutionnelle fédérale, donnent l'impression, dans leurs interventions et leurs décisions, d'avoir déclaré la guerre à une partie de leur propre peuple.
En outre, dans la soi-disant "lutte contre la droite", les autorités des forces de sécurité sont soumises à de telles vagues d'épuration que la police et l'armée ne sont plus que l'ombre des jours précédents et ont été privées de leur capacité opérationnelle.
Cet État de gauche détruit systématiquement la capacité de défense de cette génération et des suivantes et veut les rééduquer pour en faire une jeunesse unitaire gauche-verte : végétalienne, antiraciste et activiste pour le climat. Une jeunesse qui finit par appliquer une à une toutes les directives du gouvernement - sans réfléchir par elle-même. Les mesures arbitraires, l'obligation de porter un masque à l'extérieur, etc. sous prétexte de l'épidémie du coronavirus, servent ici de modèle pour les années à venir.
Parallèlement, le gouvernement de gauche lance une véritable campagne de destruction de l'industrie allemande. A cause de l'idéologie verte, maquillée en tournant énergétique, de grands secteurs économiques risquent de perdre leur compétitivité internationale, de faire faillite ou de voir leur production partir à l'étranger. Sur l'autel de cette idéologie, on renonce en outre à des prix abordables pour l'électricité et le gaz, ainsi que la sécurité énergétique des 83 millions de citoyens de ce pays. Les black-out sont aussi certains que les amen à l'église. Parlons-en de l'Église: au lieu de fournir un soutien moral et une foi solide en ces temps difficiles, les institutions ecclésiales allemandes (protestantes et catholiques) se perdent dans un marécage sordide, fait d'enrichissements personnels et d'abus pédophiles. Cette liste est loin d'être exhaustive, mais elle illustre la chute délibérée d'une nation autrefois si fière.
L'Occident - préoccupé par lui-même, sans défense et sans projet
Cette destruction de l'intérieur par une idéologie de gauche ne se limite pas à l'Allemagne. On l'observe de la même manière en Amérique, en France, en Grande-Bretagne et dans de nombreux autres pays. Alors que l'Occident est détruit par les réseaux mondialistes à la suite de la "grande réinitialisation", des pays et des groupes concurrents reconnaissent sa faiblesse et l'exploitent pour défendre leurs propres intérêts. La Chine, la Russie et la fuite humiliante devant les talibans d'Afghanistan ne sont qu'une partie de ce nouvel ordre mondial.
Alors que la stupidité est récompensée par des postes ministériels en Allemagne, Poutine crée des faits. Les slogans répétés de l'Occident et les innombrables menaces de sanctions ne provoquent plus qu'un haussement d'épaules en dehors des élites occidentales. Moscou et Pékin semblent s'être concertés sur leur approche, la Chine critiquant ouvertement les États-Unis et annonçant qu'elle ne se joindra à aucune des sanctions occidentales. Au contraire, le pays demande publiquement la levée de celles-ci. Et comme l'Europe et l'Amérique dépendent du flux économique constant de la Chine dans tous les domaines de la vie, l'Occident a été relégué au rang de spectateur sur la scène mondiale.
L'armée allemande a été systématiquement détruite par les politiques et le ministère de la Défense a été transformé en dispensaires pour politiciennes usées. Les noms des fossoyeurs au féminin de notre armée sont: Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer et Christine Lambrecht. Si vous essayez de survivre à une telle direction, vous n'avez pas besoin d'une guerre d'usure sur le front de l'Est pour vous rendre sans défense. Et non, il ne s'agit pas de fake news - Ursula von der Leyen a fait modifier les chars allemands pour que les femmes enceintes puissent également les conduire dans la cour de la caserne. La révélation publique de la Bundeswehr est complétée par le plus haut gradé de l'armée de terre allemande, l'inspecteur de l'armée de terre Alfons Mais (photo), qui dénonce la négligence de la préparation opérationnelle pendant des années. Dans la crise ukrainienne, la Bundeswehr est "plus ou moins à sec", ce sont ses mots exacts.

L'ère de l'Occident et de sa suprématie sur le monde est désormais définitivement révolue. Après la fuite humiliante devant des guerriers de Dieu à la belle barbe bien fournie en Afghanistan, c'est maintenant un Waterloo à l'est du continent européen. Les impacts se rapprochent et les secousses actuelles sont déjà perceptibles à Berlin.
"Accéder au canal Telegram de l'auteur Stefan Schubert : le point de situation de Schubert, https://t.me/SchubertsLM
19:03 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, europe, affaires européennes, politique internationale, déclin européen |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La Russie: la lutte contre la Turquie passe par l'Ukraine

La Russie: la lutte contre la Turquie passe par l'Ukraine
Emanuel Pietrobon
Source: https://it.insideover.com/guerra/russia-se-il-contrasto-alla-turchia-passa-dall-ucraina.html
L'Ukraine est le doigt, la transition multipolaire est la lune. Le changement de régime en Ukraine est un faux-fuyant, la réécriture du système de sécurité européen est l'objectif. Cette guerre n'est pas une affaire isolée, dont le déclenchement s'est produit soudainement et du jour au lendemain, mais un chapitre clé de la nouvelle guerre froide. Un chapitre dans lequel les intérêts et les voies de la Russie et des États-Unis s'affrontent, dans lequel l'Union européenne est paralysée et l'Empire céleste sur le qui-vive, et qui, de surcroît, est le dernier reliquat des nouvelles guerres russo-turques.
Kiev, berceau de la Russie et rêve de la Turquie
L'Ukraine, veine exposée du Vieux Continent et ligne de fracture inter-civilisationnelle depuis la nuit des temps, c'est seulement ici que la plus grave crise entre l'Ouest et l'Est de l'après-guerre froide aurait pu éclater. Et, de fait, elle a éclaté.
Convoitée par tous, des Polonais aux Mongols, l'Ukraine est un lieu qui, au-delà des apparences et des stéréotypes, a une histoire complexe et une identité plurielle. Pour les Russes, c'est l'un des berceaux de la civilisation orthodoxe slave, en tant que foyer de la plus ancienne organisation étatique des Slaves orientaux - la Rus' de Kiev. Pour les Polonais, c'est la fille prodigue de leur plus importante constitution impériale : la République dite des Deux Nations. Pour les Américains, les derniers arrivés, c'est le "pivot géopolitique" de l'Eurasie - le nœud territorial décisif dont dépend l'hégémonie sur l'Europe et la vassalisation de l'Europe par le rejet définitif de la Russie à l'est, sa transformation en empire asiatique.
Mais l'Ukraine a joué et continue de jouer un rôle clé, tant sur le plan politique qu'historique, pour une autre puissance: la Turquie. Prolongement du monde turc (Türk dünyası) depuis l'invasion mongole de 1223, l'Ukraine est dans les tranchées des guerres russo-turques depuis la bataille de Kalka et a façonné l'imaginaire collectif des habitants de la Sublime Porte pendant des siècles, leur ayant donné Roxelana et le mythe de la Petite Tatarie.

Il ne faut pas s'étonner, à la lumière de l'histoire, que la Turquie ait vu dans l'Euromaïdan une occasion de prendre pied dans un ancien domaine, populairement connu sous le nom de Hanshchyna, et qu'elle y ait fait des paris et des investissements importants, en particulier pendant la présidence Zelensky, étendant ses tentacules dans divers domaines : de l'industrie au commerce, en passant par la sécurité régionale, la défense et les affaires religieuses.
Un compte rendu ?
L'avancée des forces armées ukrainiennes dans le Donbass en 2021 n'aurait pas été possible sans l'utilisation des nouveaux Janissaires mortels du ciel, les drones Bayraktar TB2. Et la transformation de la minorité tatare en un pilier de l'ordre post-Euromaidan, avec ses bataillons de combattants volontaires actifs entre Donetsk et Lugansk, ne se serait pas produite aussi rapidement sans la médiation anatolienne.
Le Kremlin n'a jamais caché qu'il ressent un fort sentiment d'agacement, parfois à la limite de l'animosité ouverte, à l'égard de l'ordre du jour turc en Ukraine. Parce que Recep Tayyip Erdoğan était et est l'un des chefs de file du mouvement contre la reconnaissance de la souveraineté russe sur la péninsule de Crimée. Il était et reste parmi les principaux financiers de l'économie ukrainienne - 7 milliards de dollars d'échanges commerciaux au total en 2021, contre 4 milliards en 2019. Et il figurait parmi les principaux fournisseurs d'armements aux forces armées ukrainiennes, à la réorganisation desquelles la Turquie a également contribué.
Le lien entre l'Ukraine et la Turquie est devenu si solide sous l'ère Zelensky qu'en août 2020, le chef du Marinsky avait inauguré les travaux pour l'adhésion du pays au Conseil turc en tant que membre observateur. Un lien solide, certes, mais qui prendrait fin inévitablement si la Fédération de Russie parvenait à re-satelliser l'Ukraine.
Trois indices font une preuve
Les preuves que l'attaque de Moscou contre Kiev est également à considérer dans le contexte des nouvelles guerres russo-turques ne manquent pas : il y en a au moins trois, mais d'autres pourraient être ajoutées étant donné l'évolution constante de la situation. Et puisque, selon Agatha Christie, un indice est un indice, deux indices sont une coïncidence, mais trois indices font une preuve, l'affaire mérite d'être approfondie.
Le premier indice est le fait que c'est la deuxième fois en deux mois que la Russie envoie ses soldats sur un théâtre contesté avec la Turquie : au début de l'année, c'était le Kazakhstan. Dit de cette façon, il est clair que cela ne peut qu'apparaître comme un étirement basé sur l'attraction, mais l'image est incomplète. Car en Turquie, curieusement, l'intervention éclair au Kazakhstan par le biais de l'Organisation du traité de sécurité collective a été reçue très froidement et interprétée par certains comme un avertissement, un message subliminal adressé au Conseil turc.
Le deuxième élément de preuve est le bombardement d'un navire marchand turc au large d'Odessa, qui s'est produit de manière éloquente dans les heures qui ont suivi le déclenchement de la guerre. Un bombardement symbolique, en ce sens qu'il s'est terminé sans blessés ni morts, et qui, du moins dans l'immédiat, a eu l'effet escompté : réduire considérablement l'exposition de la Turquie au conflit.

Le troisième indice, qui pour l'instant est aussi le dernier, est l'arrivée en Ukraine d'une petite armée de Tchétchènes - composée de dix mille à douze combattants (photo, ci-dessus) - sous le commandement de Ramzan Kadyrov, fidèle de Poutine et ennemi juré d'Erdoğan. On ne sait pas quelles sont les véritables raisons de l'intervention tchétchène en Ukraine, mais une chose est plus que certaine : l'utilisation de ces effectifs contre les Ukrainiens aurait un impact négatif sur le soutien de l'opinion publique à la guerre - qui est déjà faible, comme en témoignent les protestations pacifistes qui ont explosé comme une traînée de poudre dans toute la Fédération -, il est donc possible qu'on lui ait délégué la tâche de régler des comptes avec les agents turcs sur place, à savoir les islamistes et les djihadistes, en échange d'une carte blanche dans la chasse aux dissidents anti-Kadyrov.
Peu de choses ont été écrites sur l'alliance profane entre l'Ukraine post-Euromaidan et l'islam radical, mais cela ne signifie pas qu'il s'agisse d'un phénomène sans importance et insignifiant. Deux bataillons d'islamistes tchétchènes combattent les séparatistes pro-russes dans le Donbass depuis 2014. Des éléments djihadistes ont été capturés par le FSB, accusés de travailler pour les services secrets ukrainiens. Et les islamistes du Hizb al-Tahrir, une organisation légale dans certains pays mais interdite dans d'autres, dont la Russie, ont transformé l'Ukraine en un maxi-camp de recrutement, convertissant les Tatars à leurs croyances fondamentalistes.
Qu'est-il advenu de ces guérilleros et islamistes, dont l'implication dans le sabotage d'infrastructures critiques est bien connue, dont la présence dans le Donbass a été constatée et dont les liens avec les djihadistes internationaux ont fait l'objet de rumeurs et, dans d'autres cas, ont été prouvés ? Nous n'entendons pas parler d'eux, car ils sont loin des projecteurs, mais ils existent, ils sont nombreux - des milliers - et c'est à eux que le Kremlin, via Kadyrov, pourrait maintenant vouloir donner la chasse.
La vision de Poutine contre le plan de Biden
Les garanties de sécurité proposées par le Kremlin à l'Alliance atlantique ces derniers mois, qui avaient une forme difficilement acceptable mais un fond tout-à-fait compréhensible - pour ceux qui avaient des oreilles pour entendre - ont été conçues dans le but d'ouvrir une table de négociation : partir de 100, en sachant que l'autre partie offrait 0, pour arriver à un 50 avantageux.
La concentration de troupes aux confins de l'Ukraine était un moyen de parvenir à une fin: un levier de pression utilisé par le Kremlin dans l'espoir d'impressionner, ou plutôt d'intimider, la Communauté euro-atlantique et de la persuader d'entamer une action attendue depuis longtemps, à savoir les travaux d'une nouvelle conférence de Yalta. Remodeler la forme et l'objectif de l'architecture défensive-offensive euro-atlantique, en réduisant son potentiel de pénétration stratégique au cœur de la Russie européenne. Œuvrer pour un "diviser pour régner" mutuellement bénéfique, car il s'appuie sur les principes de non-ingérence et de sphères d'influence. Créez, si possible, un mécanisme de concertation sur le modèle du Congrès de Vienne de 1815.
Aux États-Unis, où le parti de la diplomatie triangulaire - s'ouvrir à la Russie pour isoler la République populaire de Chine - n'a toutefois jamais réussi à prendre pied dans la salle de guerre, c'est pourquoi l'intense séance de négociation a connu une issue malheureuse. La vision du parti qui règne depuis l'ère Obama, le parti du "double endiguement", a prévalu, sentant le retour de bâton potentiel de cette arme à double tranchant qu'est la diplomatie de la canonnière. Retirer cette force potentielle cyclopéenne sans avoir obtenu quoi que ce soit, pas même une lueur d'ébauche, était tout simplement devenu impossible - le point de non-retour était inévitablement passé - et aurait représenté une défaite tonitruante pour Poutine à différents niveaux : contractualité, crédibilité, image.
Et c'est ainsi, au milieu de refus clairs, de non ambigus et de portes fermées à tous les bâtisseurs de ponts en puissance - au premier rang desquels Emmanuel Macron - que l'administration Biden a fait tomber Poutine dans le piège machiavélique : rendre l'évitable inévitable, transformer l'option la plus éloignée en la seule viable. Pour gagner sans combattre. Faire d'une pierre deux coups : l'Union européenne, en lui faisant oublier l'autonomie stratégique et la détente, et la Russie, entraînée dans une guerre fratricide pleine d'embûches.
18:23 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : diplomatie, politique internationale, russie, ukraine, turquie, tchétchènes, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Modèles géopolitiques comparés

Modèles géopolitiques comparés
Par Daniele Perra
Source: https://www.eurasia-rivista.com/modelli-geopolitici-a-confronto/
L'article suivant est la suite idéale d'une autre contribution intitulée "L'ennemi de l'Europe", parue sur le site "Eurasia" ( https://www.eurasia-rivista.com/il-nemico-delleuropa/ - version française: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/02/10/l-ennemi-de-l-europe-6365403.html ). Dans le cas présent, nous tenterons de mettre en évidence les principales différences entre deux modèles contrastés d'application de la science géopolitique à la lumière de la recrudescence actuelle de la crise ukrainienne: le modèle russe "traditionnel" (ou classique) et le modèle "moderne" (ou peut-être serait-il plus correct de dire "techno-financier") des États-Unis et de l'OTAN.
Le théoricien chinois Wang Huning (photo, ci-dessous) a été l'un des premiers à avancer la thèse selon laquelle pour comprendre la stratégie nationale américaine, il faut d'abord comprendre la façon dont les Américains sont une nation: c'est-à-dire observer attentivement leur mode de vie avant d'accorder du crédit à ce qui apparaît dans les publications "géopolitiques" de leurs groupes de réflexion [1].

Lors de son séjour aux États-Unis dans la seconde moitié des années 1980, Huning est arrivé à la conclusion que le fondement du mode de vie américain est l'idée de richesse ou de prospérité. Cette prospérité (apparente ou réelle) n'est maintenue que par le flux continu de capitaux internationaux dans les coffres américains. Et, pour que ce flux de capitaux reste constant, il est nécessaire que la position hégémonique du dollar ne soit pas ébranlée de quelque manière que ce soit. C'est la véritable source de pouvoir qui maintient les États-Unis forts et prospères pour le moment.

Cela soulève bien sûr la question suivante : comment a-t-il été possible d'atteindre une telle position ? La réponse se trouve dans l'histoire contemporaine. Au début de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont l'un des pays les plus endettés au monde. À la fin du conflit, cependant, les États-Unis étaient un créancier mondial. En 1917, l'Entente reçoit une ligne de crédit de 2,3 milliards de dollars de Washington. Au cours de la même période, l'Allemagne, vaincue à la bataille navale du Jutland (1916) et déjà soumise à un blocus naval britannique, a reçu un peu plus de 27 millions de marks d'aide étrangère.
En fait, les États-Unis ont été parmi les premiers à comprendre la guerre exclusivement comme une entreprise économique à une époque où les empires européens traditionnels, toujours convaincus que la victoire serait déterminée uniquement et exclusivement par la force des armées sur le terrain (ce qui n'était possible que dans le cas de la "Blitzkrieg"), étaient devenus incompatibles avec la base économique du capitalisme. La Première Guerre mondiale est donc également le premier conflit dans lequel le flux de capitaux a joué un rôle plus important que le flux de sang au sens littéral du terme. Les États-Unis eux-mêmes ne sont intervenus que lorsqu'il était certain qu'il n'y aurait pas de différence substantielle entre les vainqueurs et les vaincus (qui sont tous sortis du conflit avec les os brisés).
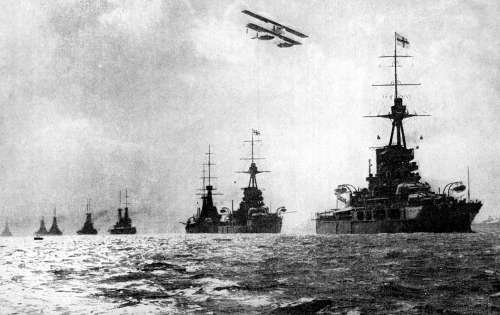
En effet, le véritable objectif était d'évincer la Grande-Bretagne de son rôle de puissance thalassocratique hégémonique au niveau mondial. Cet objectif ne sera atteint qu'après la Seconde Guerre mondiale et après que la Grande-Bretagne elle-même (grâce à celui que l'on définit peut-être à tort comme un grand politicien et stratège, Winston Churchill) ait contribué de manière décisive à son suicide et à celui de l'Europe.
Le 15 août 1971 est une autre date clé dans l'histoire contemporaine et, surtout, pour les besoins de cette analyse. Ce jour-là, le président Richard Nixon a annoncé la fermeture de la "fenêtre dorée", rompant ainsi le lien entre le dollar et l'or et trahissant ainsi délibérément le système créé à Bretton Woods. Depuis cette date, les États-Unis ont acquis le pouvoir théorique d'imprimer des dollars à volonté. De plus, à la suite du conflit israélo-arabe de 1973 et d'un accord avec l'OPEP, les États-Unis ont ancré le dollar dans le commerce mondial du pétrole, faisant de leur monnaie la seule monnaie de règlement international du commerce du pétrole. Ce faisant, ils ont imposé au monde le principe selon lequel il faut des dollars pour acheter du pétrole. Ainsi, si un pays a besoin de pétrole, il a également besoin de dollars pour l'acheter. La mondialisation économique, dans ce sens, a été le résultat inévitable de la mondialisation du dollar.
En ce sens, les États-Unis, selon l'ancien général de l'armée de l'air de l'Armée de libération du peuple, Qiao Liang, ont créé la première "civilisation financière" en transformant toutes les monnaies du monde en accessoires du dollar [2]. De plus, depuis les années 1970, ils délocalisent les industries manufacturières de bas et moyen niveau vers les pays en développement (encourageant la consommation et la dégradation de l'environnement et des ressources), ne gardant sur leur territoire que celles à haute valeur ajoutée technologique.
Les effets néfastes de ces politiques se sont reflétés dans l'économie américaine elle-même lorsque la crise de 2007 a mis en évidence sa nature exclusivement "virtuelle" face à la mise à zéro du secteur manufacturier. Une tendance que les administrations Obama et Trump ont toutes deux tenté (et échoué) à contrebalancer. Par conséquent, la fortune des États-Unis reposera encore longtemps sur la capacité de Washington à concentrer les flux de capitaux internationaux sur son territoire, générant des crises géopolitiques et éliminant les concurrents potentiels.
En d'autres termes, les États-Unis ont créé un "empire vide" totalement parasitaire (en 2001, 70% de la population américaine travaillait dans le secteur financier et les services connexes) basé sur la production de dollars, tandis que le reste du monde produit les biens qui sont échangés contre des dollars. "La mondialisation", dit Qiao Liang (photo, ci-dessous), "n'est rien d'autre qu'une lubie financière prise en otage par le dollar américain" [3].

Dans l'article précédent, que je cite ci-dessus et intitulé L'ennemi de l'Europe, il était largement fait référence à la guerre du Kosovo comme à un "conflit américain au cœur de l'Europe" visant à polluer le climat d'investissement sur le Vieux Continent et à tuer dans l'œuf un rival potentiellement dangereux : l'euro. En fait, avant la guerre du Kosovo, rapporte l'ancien général chinois, 700 milliards de dollars erraient en Europe sans pouvoir être investis nulle part [4]. Une fois la guerre commencée avec le soutien des gouvernements collaborationnistes européens (celui de l'Italie en particulier), 400 milliards de dollars ont été immédiatement retirés du sol européen. 200 milliards sont retournés directement aux États-Unis. Une autre tranche de 200 milliards est allée à Hong Kong, où certains spéculateurs optimistes visaient à utiliser la ville comme tremplin pour accéder au marché de la Chine continentale. C'est à ce moment précis qu'a eu lieu le bombardement "accidentel" de l'ambassade de Chine à Belgrade par des "missiles intelligents" de l'OTAN. Le résultat final : les 400 milliards ont tous coulé dans les caisses américaines.
En novembre 2000, Saddam Hussein a annoncé que les exportations de pétrole irakien seraient réglementées en euros. Le premier décret du gouvernement irakien établi par (et sous) les bombes américaines stipulait le retour immédiat à l'utilisation du dollar pour le commerce du pétrole brut.

Le même argument peut facilement être appliqué à la crise ukrainienne de 2014, qui a éclaté à un moment où les États-Unis (comme aujourd'hui) ne souhaitaient en aucun cas que les capitaux restent ou soient investis en Europe. La meilleure façon d'empêcher cela était de créer une crise régionale. Une crise qui a également contraint l'Europe à se joindre aux États-Unis pour imposer des sanctions à la Russie.
À ce jour, le seul pays qui a contré ce jeu nord-américain en essayant d'intercepter le flux de capitaux est la Chine. Cela devrait expliquer en partie pourquoi il y a eu une intensification substantielle des crises régionales autour du géant asiatique, de Hong Kong à Taiwan.
Cependant, la recrudescence actuelle de la crise ukrainienne appelle également un autre type de réflexion. En effet, indépendamment de la volonté occidentale d'exacerber au maximum la crise par les provocations (et les opérations "false flag"/"fausse bannière"), la propagande et le non-respect des accords de Minsk, nous assistons à la confrontation de deux modèles opposés d'interprétation de la géopolitique. Dans l'article déjà mentionné, L'ennemi de l'Europe, il était fait référence à l'utilisation des crises géopolitiques par les États-Unis comme instruments subordonnés à la politique monétaire. Par conséquent, dans le cas ukrainien, nous sommes confrontés à un double niveau de manipulation : géographique/idéologique et financier. La crise géopolitique n'a pas seulement la tâche (cachée) de faire circuler les capitaux vers Washington en affaiblissant la reprise économique de l'Europe post-pandémique, mais elle est également utilisée comme un outil pour maintenir l'Europe dans une condition de "captivité géopolitique" au sein de l'invention géographique/idéologique de l'Occident.
Or, étant donné que la mise en œuvre des stratégies globales des grandes puissances dépend toujours de la force (c'est Staline qui a déclaré "tous les traités sont des vieux papiers, ce qui compte c'est la force"), il faudra faire la distinction entre un modèle de géopolitique subordonné à la finance (il ne faut pas oublier que l'abattage d'un avion russe grâce aux systèmes de l'OTAN en Turquie a également entraîné une fuite des capitaux qui ont quitté Moscou et Ankara en 2015) et un modèle classique ou traditionnel qui reste (volontairement ou non) lié à l'idée d'Élisée Reclus selon laquelle la géographie n'est rien d'autre que l'histoire dans l'espace [5] et à la notion de Lebensraum développée par Friedrich Ratzel (photo).
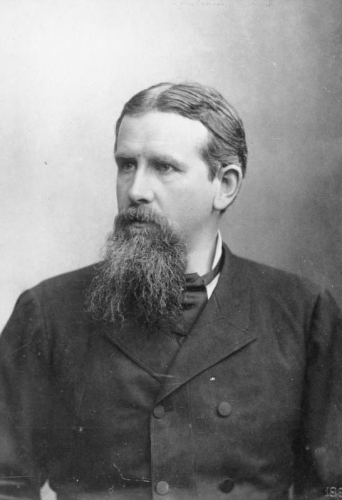
Ce concept mérite un bref développement, étant donné l'interprétation erronée dont il a fait l'objet afin de présenter la géopolitique comme une sorte de pseudo-science nazie (une opération qui n'a déjà pas beaucoup de sens si l'on considère que Ratzel est mort en 1904) (ndt: et ne développait nullement des théories qualifiables de "racistes", cf. http://robertsteuckers.blogspot.com/2013/10/friedrich-ratzel.html ). Le Lebensraum (espace de vie) est profondément lié à la relation entre l'homme/les gens et le sol/l'espace. L'espace de vie, dans la théorie de Ratzel, se développe selon deux lignes de croissance (Wachstum) qui incluent tous les phénomènes détectables dans l'espace : une croissance verticale et une croissance horizontale. Les phénomènes sont les signes vitaux du lien entre l'homme et le sol : champs cultivés, mais aussi lieux de culte, écoles, œuvres d'art et industries. Cette connexion génère l'idée politique, le ciment spirituel de l'État et l'expression la plus élevée de la croissance verticale, c'est-à-dire de l'État lui-même en tant qu'organisme spirituel. La croissance horizontale, en revanche, est liée à la pure expansion militaire et à l'État en tant qu'organisme biologique. Toutefois, cette expansion doit suivre les phénomènes sur le territoire, dans le sens de préférer la direction qui permet une plus grande continuité entre le centre et la périphérie [6]. Il est évident qu'une telle élaboration théorique se traduit directement par une condamnation de l'impérialisme moderne, qui ne connaît pas de frontières mais uniquement et exclusivement des zones de sécurité.
La géopolitique subordonnée à la finance, en fait, est fondée non pas sur la sauvegarde du limes, mais sur le contrôle et la gestion des flux de capitaux (même en recourant à la force militaire pour les manipuler) comme moyen de contrôler le flux des ressources à travers les carrefours géopolitiques (par exemple, le canal de Suez ou le détroit de Malacca). La géopolitique classique, au contraire, est basée sur le contrôle logistique du voisin immédiat comme espace de projection et d'influence. En ce sens, par exemple, on pourrait interpréter la colonisation grecque de l'espace autour de la mer Noire (qui était crucial pour l'accès aux céréales produites par les Scythes et les Sarmates) dans l'Antiquité [7].
Aujourd'hui, l'annexion de la Crimée par la Russie (alors qu'elle n'a été incluse dans les frontières ukrainiennes que dans les années 1950), outre le fait que le droit international est souvent interprété toujours à l'avantage de la puissance hégémonique qui l'a créé, peut et doit également être interprété dans un sens traditionnel. Empêcher que cet avant-poste (après la réduction progressive de la marge de manœuvre suite à l'effondrement de l'URSS) ne passe sous le contrôle de l'OTAN a à la fois un sens purement stratégique et une valeur en termes de lien spirituel entre la terre et les gens et, par conséquent, de réaffirmation de l'espace vital russe. La Russie a également besoin de transporter ses ressources naturelles vers le marché et de promouvoir son économie. La coupure des gazoducs et des oléoducs (ce que les États-Unis tentent de faire par le biais de la crise ukrainienne elle-même) aurait (et a) donc un impact non seulement sur l'économie russe mais aussi (et peut-être même de manière plus décisive) sur le destinataire final : l'Europe occidentale [8].
Ici, une autre considération entre également en jeu. La reconnaissance russe des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (qui en soi ne peut être critiquée par ceux qui, par exemple, ont créé de toutes pièces le Kosovo ou le Sud-Soudan par simple opportunisme géopolitique) a une double valeur. Ceci est lié à la fois au discours précédent sur la réaffirmation de l'espace vital russe (et comme l'achèvement d'un processus commencé en 2014 après le coup d'État atlantiste à Kiev), et à un projet plus large d'accélération vers la reconstruction de l'ordre mondial. Il semble clair que le choix russe s'impose également comme un défi ouvert au modèle unipolaire. Le Kremlin, en effet, à l'heure où la coopération eurasiatique ne cesse de se renforcer (grâce surtout au travail diplomatique de la Chine et de l'Iran), montre qu'il ne craint absolument pas un nouveau régime de sanctions (principal instrument de l'unipolarité) qui, comme déjà prévu (et malgré les timides efforts du président français Emmanuel Macron pour sauver le Vieux Continent du resserrement de l'étau atlantique), se ferait surtout au détriment du seul vrai perdant de cette crise : une Europe incapable de sauvegarder son propre intérêt et de devenir un pôle autonome et indépendant.
À cet égard, une dernière considération s'impose pour tous ceux qui, en Europe occidentale, regardent la Russie avec un espoir excessif. Bien que la Russie soit un exemple d'opposition à l'idée unipolaire, elle poursuit naturellement son propre intérêt national. Ce n'est pas la Russie (également beaucoup trop patiente à cet égard) qui sauvera l'Europe. Toutefois, dans le cas ukrainien, Moscou a le mérite de mettre l'Europe devant le fait accompli et de souligner davantage le rôle néfaste de l'Alliance atlantique en tant qu'instrument de coercition du Vieux Continent.
NOTES:
[1] Voir Wang Huning America against America, Shanghai Arts Press, Shanghai 1991.
[2] Qiao Liang, L’arco dell’impero con la Cina e gli Stati Uniti alle estremità, LEG Edizioni, Gorizia 2021, p. 101.
[3] Ibidem, p. 63.
[4] Ibidem, p. 109.
[5] "La géographie n'estrien d'autre que l'histoire dans l'espace, tout comme l'histoire est la géographie dans le temps". Cette phrase apparaît, mise en exergue, dans chacun dessix volumes de l'oeuvre monumzentale du géographe français, L’homme et la terre (Hachette, Parigi 1906-1908).
[6] Voir F. Ratzel, Politische Geographie, R. Oldenbourg, Monaco-Lipsia 1897.
[7] Il ne faut pas oublier le fait qu'aujourd'hui encore, la Russie et l'Ukraine sont parmi les principaux exportateurs de blé au monde. 50% du blé importé par Israël, par exemple, vient d'Ukraine.
[8] De la même façon, la Chine, avec la Nouvelle Route de la Soie, cherche à construire un modèle eurasien de coopération et de développement, aussi pour donner une force propulsante à sa propre production économique intérieure. Le fait de fomenter des crises le long du parcours de cette route de la soie nuit non seulement à l'économie chinoise mais aussi à tous les pays d'Asie centrale et méridionale qui, via ce projet infrastructurel, visent à améliorer leurs propres capacités de développement.
17:27 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, russie, chine, affaires européennes, affaires asiatiques, eurasie, eurasisme, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Groupe de travail Feniks (Flandre) : Finies les guerres fratricides !
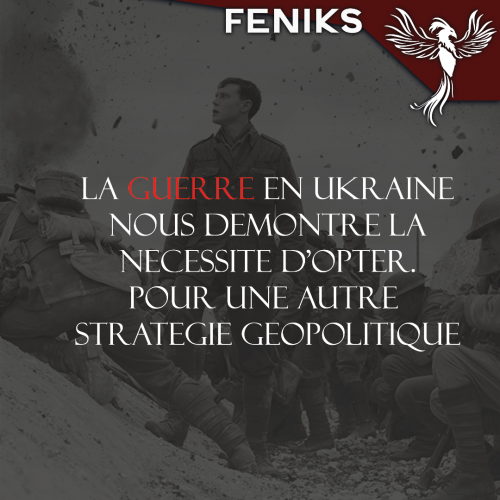
Groupe de travail Feniks (Flandre) : Finies les guerres fratricides !
En ce moment, toute notre civilisation réagit avec indignation face à l'invasion russe en Ukraine. Une guerre que personne n'aime voir éclater si près de nous, en Europe. De nombreux postes sur la frontière ont été franchis, ce qui viole l'intégrité territoriale de l'Ukraine elle-même. Toutes les victimes dans cette guerre sont regrettables, et pire, toutes auraient pu être évités.
Il y a maintenant une surenchère de condamnations et de sanctions contre la Russie, qui a lancé les opérations cette semaine. De manière réaliste, la plupart des gens se rendent compte que cela ne résoudra pas le conflit. Aucune sanction économique, et certainement aucun bâtiment illuminé en bleu et jaune, ne fera changer d'avis les Russes. Par impuissance, nous crions notre dépit à travers des déclarations sur les médias sociaux et dans la presse, même si nous devons admettre qu'aucun d'entre nous ne veut voir son propre pays partir en guerre.
Nous devons toujours tirer les leçons de l'histoire pour nous tourner vers l'avenir, y compris et surtout dans le cas présent.
Ce qui a provoqué cette invasion est facilement oublié, voire délibérément nié. Les politiciens occidentaux aiment se laver les mains dans l'affaire et blâmer Poutine de manière unilatérale. Cependant, la raison de cette invasion pose problème sur la scène internationale depuis un certain temps et fait constamment surface depuis 2014. En 2014, la politique occidentale a soutenu l'opposition ukrainienne de l'époque dans la révolution de Maidan, qui réclamait un cours pro-occidental, pro-UE et pro-OTAN et surtout anti-russe. Entre autres, notre ancien Premier ministre Guy Verhofstadt s'est rendu à Kiev pour jeter un peu plus d'huile sur le feu (contre une belle rémunération bien sûr).
Les accords précédents entre l'OTAN et la Russie ont été davantage mis en péril. Un accord (entre l'Occident, l'OTAN, et la Russie) selon lequel l'OTAN ne s'étendrait pas dans les anciens pays ayant été sous tutelle soviétique. Pour les Russes fraîchement désoviétisés, il s'agissait d'éviter à la Russie d'être encerclée par des bases hostiles de l'OTAN dans son voisinage direct. Depuis la promesse américaine selon laquelle l'Ukraine pourrait rejoindre l'OTAN en 2008, la Russie a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes, mais l'Occident s'est retranché derrière la souveraineté nationale de l'Ukraine, alors qu'il cherchait, à grand renfort d'argent, à rapprocher l'Ukraine de l'UE et de l'OTAN. Ce jeu a été bien perçu par les Russes comme une menace directe pour leur grand pays.
Nous pouvons envisager ce conflit de deux façons. Soit nous réagissons d'un point de vue ethnocentrique et blâmons unilatéralement la Russie, ce qui entraînera des sanctions longues et sévères et l'envoi de troupes supplémentaires à l'Est. Ou bien nous essayons d'avoir une vue d'ensemble et de penser le long terme. Alors peut-être devrions-nous accepter le fait patent que le temps où l'Occident fixait unilatéralement les termes de la politique internationale est désormais derrière nous, et que certains lobbyistes occidentaux tels les néoconservateurs, comme feu John Mccain, et les libéraux comme Guy Verhofstadt ne servent pas du tout les intérêts de l'Europe qui ne pourra s'épanouir que dans la paix.
La guerre en Ukraine montre que nous avons besoin d'une stratégie géopolitique différente. Avons-nous, en tant qu'Européens, le courage de nous regarder et de défendre nos propres intérêts ? Prenons-nous notre défense en main au lieu de la négliger comme nous l'avons fait au cours de ces 30 dernières années ? Ne pourrions-nous pas commencer par développer une force de paix européenne continentale dans une zone déclarée neutre au lieu de réclamer (et de pérenniser) des frontières dures entre l'OTAN d'une part et, par exemple, la Russie (ou la Chine, ou, à l'avenir, la Turquie) d'autre part ? Ou bien allons-nous réagir avec grande indignation pendant quelques semaines seulement, en portant encore davantage préjudice à notre propre économie et en ne faisant rien pour qu'à la prochaine crise, nous soyons tout aussi impuissants ?
Pour aller plus loin dans la réflexion :
https://m.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4
https://synergon-info.blogspot.com/2022/02/oorlog-in-euro...
https://ejmagnier.com/2022/02/25/poetins-oorlog-met-oekra...
https://m.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4
https://ejmagnier.com/2022/02/24/putins-war-on-ukraine-cu...
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/civilized-nations...

16:32 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affaires européennes, europe, paix, neutralité, géopolitique, politique internationale, ukraine, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 février 2022
Souvenir de Giorgio Locchi, qui a pressenti le "mal américain" avant les autres
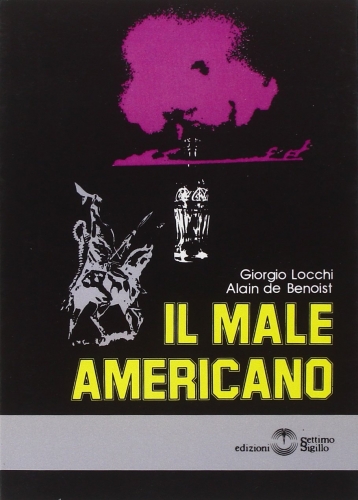
Souvenir de Giorgio Locchi, qui a pressenti le "mal américain" avant les autres
par Antonio Pannullo
Ex : http://www.secoloditalia.it
Giorgio Locchi est décédé à Paris, où il vivait depuis les années 50, le 25 octobre 1992. Aujourd'hui, Giorgio Locchi, journaliste, essayiste et écrivain, n'est plus très connu en Italie, surtout des jeunes, mais il est l'un des penseurs qui ont eu le plus d'impact sur la communauté anticommuniste européenne (il n'aimait pas le terme "droite") à partir des années 1970. On sait peu de choses de sa vie privée, et ce que l'on sait, on le doit à la fréquentation systématique de ses "disciples" italiens, des jeunes hommes issus du mouvement missiniste (MSI) des années 1970. Ces jeunes hommes, enflammés par le feu sacré de la politique et le désir de changer ce monde, se rendent à Paris, à Saint-Cloud, où Locchi vit et gagne sa vie comme correspondant du quotidien romain Il Tempo. Parmi ces jeunes hommes, nous nous souvenons certainement de Gennaro Malgieri, Giuseppe Del Ninno, Mario Trubiano, Marco Tarchi et d'autres. Quoi qu'il en soit, bien que méconnu en Italie, Giorgio Locchi a été en quelque sorte le "père noble" des grands bouleversements culturels européens dans la mouvance de la droite (nous n'écrivons le mot "droite" que par convention), lorsque de ce néofascisme missiniste pur est née la dimension culturelle, incarnée par une Nouvelle Droite, comme on l'a appelée en fait plus tard. Cette Nouvelle Droite regardait au-delà du régime fasciste mais pensait plutôt au potentiel, partiellement mis en pratique, de cette philosophie et doctrine européiste et anti-égalitaire, bien que modernisatrice, qui aurait encore beaucoup à dire et à donner à notre civilisation quelque peu décadente (pour être généreux). Ensuite, la figure de Giorgio Locchi a été révélée en France, mais grâce aux Italiens, comme le rappelle Del Ninno. Locchi était l'un des fondateurs du G.R.E.C.E., le Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, créé en 1968 notamment avec Alain de Benoist, un intellectuel et journaliste français bien connu, qui était avec Locchi dès le début, même si de Benoist était plus jeune.
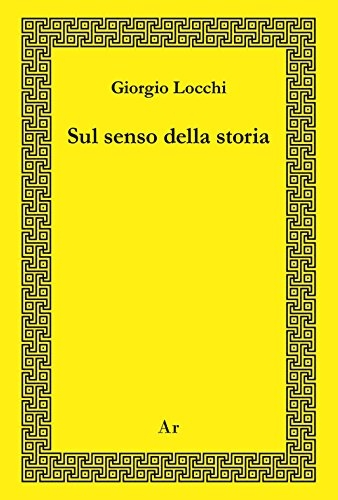
Giorgio Locchi a vécu à Paris pendant de nombreuses années. Il est toutefois né à Rome en 1923, sa famille avait des liens avec le monde du cinéma et du doublage, il était lui-même un ami de la famille de Sergio Leone ; il a fait ses études à l'école classique nazaréenne où, bien que totalement non-catholique, il a gardé son estime et sa gratitude pour les pères piaristes, qui ont toujours respecté sa liberté de pensée et qui lui ont toujours garanti une autonomie maximale de jugement et de critique. Il a poursuivi ses études, notamment en germanistique, musique, sciences politiques, mais surtout en civilisation indo-européenne, sujet sur lequel il nous a laissé un livre et de nombreux écrits.
Les jeunes du Fronte della Gioventù et du MSI des années 1970 et 1980 ont été littéralement foudroyés par son livre Il male americano (Lede editrice), dans lequel Locchi prédisait tout ce qui ne devait pas arriver mais qui nous arrive encore. Pour Locchi, le fait d'avoir été vaincu par une guerre dévastatrice n'annihile pas les idées qui ont conduit à cette guerre. Ils survivent sous les formes et les nuances les plus disparates. Après la création du G.R.E.C.E., que nous appellerions aujourd'hui un think tank, la Nouvelle Droite a commencé à se faire un nom non seulement en France et en Italie, mais dans toute l'Europe occidentale. Et en parlant d'Europe, Locchi voulait se rendre à Berlin à l'époque de la réunification allemande. À partir de ce moment, la signature de Locchi, qui utilisait également le pseudonyme Hans-Jürgen Nigra, a commencé à apparaître dans des magazines proches de la Nouvelle Droite, tels que Nouvelle Ecole, Eléments, Intervento, la Destra, l'Uomo libero et bien sûr notre quotidien Secolo d'Italia. Entre-temps, il a fourni de précieuses informations aux lecteurs italiens avec une superbe correspondance sur les événements en Algérie, sur les Français de 68, et aussi sur la naissance de l'existentialisme.
Comme l'a clairement écrit Gennaro Malgieri dans son admirable hommage à Giorgio Locchi (1923-1992) dans Synergies européennes en février 1993 (ndt: dans la revue Vouloir, pour être exact), les idées de Locchi étaient en fait les idées d'une Europe qui n'existe plus, mais ce n'était pas une raison pour ne pas en défendre ou en illustrer les principes. Ces idées portent sur cette Europe éternelle à laquelle l'Europe économique de notre période d'après-guerre ne ressemble en rien. Par exemple, note encore Malgieri, l'attitude de Locchi à l'égard du fascisme n'est pas une simple nostalgie ou une protestation, mais il a recueilli dans le ferment culturel de cette époque et de cette expérience toutes les idées et initiatives qui n'étaient pas et ne sont pas obsolètes. "Il nous a fait part de ses réflexions à ce sujet dans son ouvrage intitulé L'essence du fascisme (Il Tridente, 1981). Il fait référence à la vision du monde qui a inspiré le fascisme historique, mais qui n'a pas disparu avec la défaite de ce dernier. Ce livre est encore un prodigieux "discours de vérité" au sens grec du terme, qui cherche à écarter du fascisme toutes les explications fragmentaires qui sont faites actuellement et toutes les formes de diabolisation visant à générer des préjugés". Giorgio Locchi a également écrit un livre sur le "mythe surhumaniste".
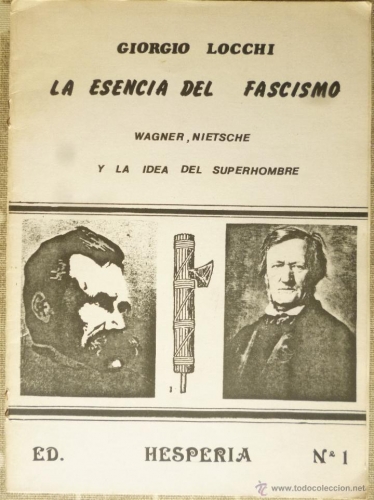
Dans son enquête, Locchi affirme qu'il n'est pas possible de comprendre le fascisme si l'on ne réalise pas qu'il est la première manifestation politique d'un phénomène spirituel plus large, dont il fait remonter les origines à la seconde moitié du XIXe siècle et qu'il appelle "surhumanisme". Les pôles de ce phénomène, qui ressemble à un énorme champ magnétique, sont Richard Wagner et Friedrich Nietzsche qui, à travers leurs œuvres, ont mélangé le nouveau principe et l'ont introduit dans la culture européenne à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Sur ce, Locchi a écrit le livre Wagner, Nietzsche et le mythe surhumaniste (éditions Akropolis), difficile mais extrêmement lucide, qui a eu les éloges du critique musical Paolo Isotta dans les colonnes du Corriere della Sera.
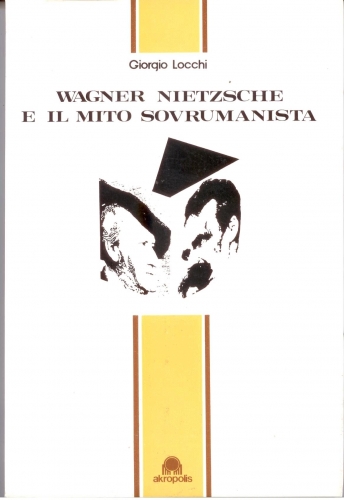
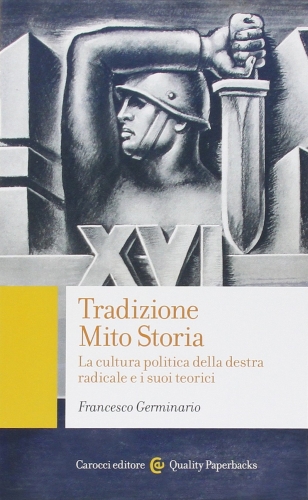
Locchi nous a laissé des livres peu nombreux mais importants. Sa vie témoigne d'un engagement cohérent, profond et crucial, qu'il serait bon d'explorer davantage aujourd'hui. Il y a quelques années, Francesco Germinario lui a consacré un livre, Tradizione, Mito e Storia (éditions Carocci), dans lequel l'auteur définit les caractéristiques de la droite radicale, en s'attardant sur ses exposants les plus significatifs. Il y a deux ans, au siège romain de Casapound, s'est tenue une conférence sur Giorgio Locchi en présence de son fils Pierluigi et d'Enzo Cipriano, également ami et disciple de Locchi depuis des années.

16:53 Publié dans Hommages, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio locchi, nouvelle droite, philosophie, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Guerre en Ukraine : le suicide de l'Europe

Guerre en Ukraine : le suicide de l'Europe
par Luigi Tedeschi
Source : Italicum & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/guerra-in-ucraina-le-responsabilita-dell-europa-zombie-atlantica
L'invasion de la Russie est arrivée, l'attaque contre l'Ukraine s'est déroulée selon les prédictions (et les souhaits) de Biden. En fait, les avertissements répétés d'invasion, l'état d'alerte de l'OTAN et les sommets récurrents avec les dirigeants européens avaient un but précis : réaligner l'Occident face à l'ennemi absolu du moment, en tant que menace pour le nouvel ordre mondial orchestré par les États-Unis. Après la fuite humiliante d'Afghanistan, avec l'état de guerre civile qui perdure aux Etats-Unis, avec la crise économique post-pandémique et le retour corrélatif de l'inflation, la présidence Biden, qui s'est avérée très faible et qui connait une forte baisse de soutien interne, était à la recherche d'une nouvelle urgence, afin de rallier l'opinion publique nationale et les alliés de l'OTAN contre un nouvel ennemi absolu. Et cela s'est incarné dans la figure de Poutine, déjà défini comme un "criminel" au début de sa présidence. La figure de l'ennemi irréductible, de la menace perpétuelle pour la sécurité des Etats-Unis, pour les valeurs de l'Occident, est un mantra récurrent de la politique étrangère américaine. La perspective d'un ennemi à combattre et à vaincre constitue donc un mythe fondateur, assumé de temps à autre pour justifier idéologiquement le rôle dominant de la puissance mondiale américaine.
Du point de vue américain, il ne s'agissait pas de défendre l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'indépendance de l'Ukraine, mais d'imposer à la Russie l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. En réalité, l'expansion progressive de l'OTAN en Europe de l'Est a représenté une phase décisive de la stratégie de pénétration en Eurasie, avec le démembrement consécutif de la Russie : il s'agissait de reproduire, à grande échelle, la même stratégie du chaos déjà expérimentée dans l'ex-Yougoslavie, après la dissolution de l'URSS. Cette politique expansionniste de l'OTAN a toutefois été entravée par la réaction de la Russie de Poutine qui, dès 2014, avec l'occupation de la Crimée et du Donbass, a réussi à s'opposer à l'occidentalisation de l'Ukraine suite à la "révolution colorée" (c'est-à-dire le coup d'État) de Maïdan, qui a retiré l'Ukraine de la sphère d'influence russe.

Poutine s'oppose à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN car il veut préserver les besoins de sécurité de la Russie. Mais il existe un précédent historique bien connu : lorsque l'URSS a voulu installer ses bases de missiles à Cuba, la menace de guerre nucléaire de l'Amérique de Kennedy a contraint l'Union soviétique à abandonner ses plans.
On peut donc se demander comment Biden entendait protéger l'Ukraine de l'invasion russe, puisqu'il n'a accepté aucune négociation avec Poutine qui permettrait d'éviter la poursuite de l'expansion de l'OTAN vers l'est et qu'il a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas autoriser une intervention militaire américaine en Ukraine. L'Occident s'est borné à déclarer verbalement qu'il n'était pas prévu que l'Ukraine rejoigne l'OTAN dans un avenir proche, mais Biden a refusé de conclure un quelconque accord officiel avec Poutine sur la question. En outre, la confiance de Zelenski lui-même dans le soutien européen et américain est totalement incompréhensible à la lumière des résultats des conflits précédents en Afghanistan, en Géorgie et au Kurdistan (pour n'en citer que quelques-uns), où les Américains se sont retirés et ont toujours abandonné leurs alliés à leur sort.
Mais les États-Unis poursuivent des objectifs bien différents dans le conflit ukrainien. L'invasion russe de l'Ukraine est une excellente occasion pour les États-Unis de rompre les relations entre l'Europe et la Russie et de tuer dans l'œuf toute velléité d'autonomie européenne vis-à-vis de l'OTAN et des États-Unis. Des divisions européennes internes apparaissent au sujet des sanctions contre la Russie. Une grave crise énergétique pourrait réduire la puissance économique de l'Allemagne et de l'Europe et placer l'Europe dans une position subordonnée dans la zone d'influence atlantique. Cependant, l'UE s'est alignée sur la russophobie américaine. Scholz, en représailles à l'invasion russe, a bloqué le démarrage du gazoduc Nord Stream 2. Biden a été exaucé. En effet, les États-Unis ont l'intention de libérer l'Europe de la dépendance énergétique russe afin de lui imposer la dépendance énergétique américaine.

L'imposition même de sanctions à la Russie est contestée en Europe. Tant en matière d'approvisionnement énergétique que dans le domaine économique et financier. En excluant la Russie du système des transactions rapides internationales, l'intention est de provoquer l'isolement et l'effondrement économique ultérieur de la Russie. Mais la Russie possède déjà son propre système de paiement et pourrait également utiliser les systèmes alternatifs fournis par la Chine. Dans ce cas, il y aurait une restriction mondiale significative de la zone dollar. Le blocage du système de paiement swift entraînerait également une grave crise du système bancaire et économique européen. Les banques françaises et italiennes sont exposées à la Russie à hauteur de plus de 50 milliards d'euros, l'Italie dépend à 50 % du gaz russe et ses exportations vers la Russie s'élèvent à environ 8 milliards d'euros par an. La mondialisation a conduit à l'interdépendance mondiale des marchés. L'Occident est maintenant la victime du système même qu'il voulait imposer au monde.
Depuis Obama, les États-Unis prévoient de réduire le rôle de l'économie européenne dans le monde. Mais la fin des échanges entre l'Occident et la Russie n'aurait pour effet que de renforcer l'axe russo-chinois (qui se targue déjà d'un volume d'échanges de 140 milliards), en opposition ouverte avec l'Occident. L'Occident, en outre, a supprimé sa propre mémoire historique. Si, pendant la guerre froide, l'URSS et la Chine de Mao avaient été alliées, quel aurait été le sort de l'Occident ?

L'invasion russe de l'Ukraine aurait-elle pu être évitée ? La réponse est affirmative. Les accords de Minsk, qui prévoyaient l'autonomie des régions russophones du Donetsk et de Luhank (Lugansk) et les laissant sous la souveraineté ukrainienne, auraient pu être mis en œuvre. Mais l'Ukraine a refusé. Les rencontres diplomatiques entre les dirigeants russes et occidentaux se sont révélées être un dialogue de sourds, étant donné le refus américain préjudiciable à tout accord avec Poutine (qui fait déjà l'objet de sanctions occidentales depuis 2014) sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Jusqu'à la veille de l'invasion, Zelenski avait réitéré sa position en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et à l'OTAN, telle qu'elle est inscrite dans sa constitution.
Mais surtout, c'est l'Europe qui est responsable du triste sort de l'Ukraine, soumise à l'invasion dévastatrice de la Russie. On peut pécher en pensée, en parole, en acte et par omission. Et les péchés d'omission commis par cet ectoplasme atlantique qu'est l'Europe sont irrémédiables. En fait, l'Europe aurait pu proposer une négociation autonome avec la Russie, impliquant l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe, mais pas à l'OTAN. Cela aurait permis de préserver l'intégrité de l'Ukraine en imposant sa neutralité en tant que pays-pont nécessaire dans les relations entre l'Europe et la Russie. Le rôle de l'OTAN en tant qu'avant-poste armé aurait au contraire condamné l'Ukraine à la dépendance économique et militaire de l'Occident.
Dans ce contexte, l'Europe se serait désengagée de l'Alliance atlantique. Mais cette perspective est rejetée par l'Europe, car elle signifierait que l'Europe assume le rôle d'un acteur autonome par rapport aux États-Unis dans la géopolitique mondiale. Dans l'UE actuelle, l'OTAN s'identifie et se superpose à l'Europe. Tous les anciens membres du Pacte de Varsovie, qui étaient russophobes, sont devenus membres de l'UE, comme ils appartiennent à l'OTAN. L'européanisme actuel coïncide donc avec l'atlantisme. En conclusion, l'UE existe en tant qu'organe européen supranational au sein de l'Alliance atlantique.
Dans cette perspective atlantiste (et l'unité européenne au sein de l'OTAN est continuellement réaffirmée par tous les dirigeants des États membres de l'UE), l'Europe ne peut que subir, tant économiquement que politiquement, les conséquences du conflit entre les États-Unis et la Russie, seuls véritables protagonistes de la crise ukrainienne. Comme l'a déclaré Alberto Negri dans son récent article "Poutine et les Européens unis dans le paradoxe", cette situation présente également des aspects paradoxaux : "Mais le meilleur est encore à venir. L'augmentation de la consommation et des investissements en 2021 et d'autres facteurs ont contribué à la multiplication par quatre du prix du gaz en Europe. Ainsi, la Russie a également multiplié le chiffre d'affaires de Gazprom, alors qu'elle a considérablement réduit ses approvisionnements. En outre, Moscou reste le plus grand fournisseur unique de pétrole en Europe, avec une part de 25 %. En bref, le moteur de l'économie européenne est entre les mains de Poutine et l'argent européen finance l'effort de guerre russe. Est-ce qu'on va s'en sortir ?" Ou assisterons-nous, comme tout le suggère, au suicide de l'Europe ? Mais un zombie, c'est-à-dire un mort-vivant, peut-il se suicider ?
16:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, politique internationale, union européennes, affaires européennes, russie, ukraine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Guerre en Ukraine : le point de non-retour - 32 points sur la question ukrainienne

Guerre en Ukraine : le point de non-retour
32 points sur la question ukrainienne
par Roberto Buffagni
Source : Roberto Buffagni (28 fév. 2022) & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/guerra-in-ucraina-il-punto-di-non-ritorno
Je résume aussi brièvement que possible le déroulement des événements passés et propose une hypothèse interprétative des événements futurs.
1. La cause profonde de la guerre est la décision stratégique américaine d'étendre l'OTAN à l'Est. L'expansion a commencé avec l'administration Clinton, après l'effondrement de l'URSS. George Kennan, Henry Kissinger, John Mearsheimer - pour ne citer que les principales personnalités américaines dans le domaine des relations internationales - l'ont considéré comme une erreur de première grandeur, annonciatrice de graves conséquences.
2. Le sommet de l'OTAN de 2008 à Bucarest a déclaré que la Géorgie et l'Ukraine rejoindraient l'OTAN. La France et l'Allemagne s'y opposent mais cèdent à la pression américaine. Le résultat est un compromis : aucune date d'entrée n'est spécifiée.
3. La Russie fait immédiatement savoir que l'entrée de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'OTAN est inacceptable. La raison sous-jacente est que la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN deviendraient des bastions militaires occidentaux à la frontière russe. Immédiatement après le sommet de Bucarest, la Russie envahit la Géorgie pour l'empêcher de rejoindre l'OTAN. Elle n'est ni politiquement ni militairement capable de faire de même avec l'Ukraine.

4. En 2014, les États-Unis orchestrent un coup d'État en Ukraine et installent un gouvernement qui leur plaît et qui met le désir de rejoindre l'OTAN dans la constitution.
5. En 2021, les États-Unis et les pays de l'UE commencent à armer sérieusement les Forces Armées ukrainiennes.
6. Fin 2021, la Russie ouvre des discussions diplomatiques avec les États-Unis. Le point clé de la proposition russe est la signature d'un traité garantissant que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Contre la coutume diplomatique, la Russie rend le projet de traité public.
7. Les États-Unis refusent de garantir par écrit que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN, car cela reviendrait à renoncer au rôle décisionnel "superiorem non recognoscens" dans l'ordre international unipolaire qu'ils détiennent depuis l'effondrement de l'URSS. Ils font immédiatement savoir qu'ils n'interviendront PAS militairement pour défendre l'Ukraine en cas d'attaque russe. Une grande puissance nucléaire n'affronte une autre grande puissance nucléaire sur le terrain que lorsque ce qui est en jeu est un intérêt vital pour les deux. L'Ukraine est un intérêt vital pour la Russie, elle n'est PAS un intérêt vital pour les États-Unis.
8. Lors de la conférence de Munich, le chef du gouvernement ukrainien annonce que l'Ukraine envisage d'acquérir des armes nucléaires tactiques. Les plus petites armes atomiques tactiques peuvent effacer une division blindée de la surface de la terre.
9. Peut-être à cause de cette annonce, la Russie accélère. Elle reconnaît les républiques du Donbass, envahit l'Ukraine. Elle mène la guerre de la manière la plus susceptible d'épargner la vie des civils, en vue de la réconciliation/stabilisation de l'Ukraine. L'objectif stratégique russe ne comprend PAS la conquête totale ou partielle du pays, mais sa neutralisation, la reconnaissance des républiques du Donbass et de Crimée, la démilitarisation de l'Ukraine.

10. Les États-Unis - plus précisément, l'establishment qui dirige leur politique étrangère et qui est en mesure d'influencer fortement toute administration - décident de mettre en œuvre une stratégie de guerre indirecte, dans le but de provoquer un "changement de régime" en Russie, et utilisent les pays de l'UE comme un instrument politique, en assumant le rôle d'"OTAN politico-économique".
11. Des sanctions économiques majeures sont imposées à la Russie par les États-Unis et les pays de l'UE, y compris le gel, c'est-à-dire la saisie, des actifs de la Banque nationale russe détenus dans les pays occidentaux (un acte de guerre).
12. Des mesures draconiennes sont également décidées par les pays de l'UE, qui sont aussi de véritables actes de guerre : l'UE finance et envoie à l'Ukraine des systèmes d'armes non seulement défensifs mais aussi offensifs (avions de chasse). La distinction entre les systèmes d'armes offensifs et défensifs, qui n'a aucune valeur sur le champ de bataille, est toutefois pertinente sur le plan juridique. Envoyer des systèmes d'armes défensifs à un pays en guerre ne constitue pas un acte de guerre contre son ennemi, envoyer des systèmes d'armes offensifs oui.
13. La Suède et la Finlande, pays neutres limitrophes de la Russie, annoncent qu'ils envisagent de rejoindre l'OTAN.
14. L'Allemagne annonce un vaste programme de réarmement.
15. L'envoi de systèmes d'armes à l'Ukraine ne change pas l'issue du conflit en Ukraine, car il ne modifie pas l'équilibre des forces entre les protagonistes, qui penche fortement en faveur de la Russie. Il s'agit d'une provocation adressée à la Russie. Elle la met au défi de réagir à des actes de guerre réels, sachant qu'une réaction militaire russe contre des pays de l'UE, qui sont également des pays de l'OTAN, provoquerait un conflit ouvert OTAN-Russie. L'intention de la provocation est de démontrer l'impuissance russe : "Vous avez mordu plus que vous ne pouvez mâcher", et ainsi déstabiliser le gouvernement de la Fédération de Russie.
16. Le gouvernement russe lève l'alerte nucléaire. C'est un cas de "escalade pour désescalade". Par l'escalade, un message est envoyé à l'adversaire : "Sachez que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, y compris au conflit nucléaire. Désescaladez ou subissez les conséquences".
17. Les premiers entretiens entre les représentants des gouvernements ukrainien et russe sont annoncés pour ce matin.
18. L'opération de "changement de régime" en Russie exploite toutes les failles du conflit en Russie, en premier lieu les nationalismes des États qui composent la Fédération. Le scénario envisagé par les planificateurs est similaire à celui déjà mis en œuvre dans l'ex-Yougoslavie : guerre civile, fragmentation de la Fédération de Russie, implosion de l'État fédéral, nouveaux gouvernements dirigés par des politiciens acceptables pour l'Occident, et le président fédéral russe V. Poutine, déjà décrit par les médias occidentaux comme un gangster mentalement dérangé, comme le président yougoslave Milosevic accusé devant le Tribunal international de La Haye.
19. Il est très clair, d'après ce qui précède, que la Russie NE PEUT PAS reculer. S'il le fait, le gouvernement sera déstabilisé et la deuxième phase de l'opération de changement de régime sera déclenchée : des révolutions colorées dans les États constitutifs de la Fédération de Russie. En outre, l'Ukraine est la dernière ligne de défense militaire et politique de la Fédération de Russie, qui est dos au mur et défend sa survie.
20. Je rappelle que pour éviter la situation actuelle très dangereuse, il aurait suffi de deux choses : a) garantir par écrit que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN; b) qu'un seul pays de l'UE propose, avant le début des hostilités, une révision du système de sécurité européen tenant compte des intérêts russes, orientée vers la neutralisation de l'Ukraine.
21. Je prédis que les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie ne donneront aucun résultat. Le gouvernement ukrainien est dirigé par les États-Unis. Il est dans l'intérêt des États-Unis, en vue de l'opération de changement de régime, de gagner du temps et d'accroître la pression sur le gouvernement russe.

22. L'attitude actuelle des pays de l'UE n'est dans l'intérêt d'aucun pays européen, y compris les voisins de la Russie. En fait, la Russie n'a PAS l'intention de s'étendre, ni en Ukraine ni ailleurs (elle n'en a pas la capacité politico-militaire). La Russie défend son intégrité politique et sa survie en tant qu'État unitaire.
23. L'attitude actuelle des pays de l'UE fait courir un grand risque à tous les pays européens. Elle est dictée par les États-Unis, qui peuvent ainsi mener une politique de "guerre courte" contre la Russie à coût zéro. Le coût économique et politique est payé par les peuples d'Europe.
24. L'attitude actuelle des pays de l'UE laisse soupçonner que leurs dirigeants ne se rendent pas compte de la gravité des actes qu'ils posent, ni de leurs éventuelles conséquences.
25. En effet, je répète que la Russie NE PEUT PAS faire marche arrière, et que ses objectifs ne sont pas expansionnistes ou impérialistes, mais strictement défensifs. La Russie les considère comme des intérêts vitaux, qu'elle doit sécuriser pour survivre.
26. La Russie est une grande puissance nucléaire. Personne au monde, à part Dieu ou le recul, ne sait quelles pourraient être les conséquences d'une opération réussie de changement de régime en Russie, car personne ne peut savoir qui contrôlerait l'arsenal nucléaire russe, ou des parties de celui-ci, plus que suffisantes pour provoquer une destruction catastrophique.
27. De plus, un échec définitif de l'opération de changement de régime après son succès partiel et temporaire pourrait encourager un comportement désespéré et irrationnel de la part des dirigeants politiques russes, qui, je le rappelle encore une fois, ont le sentiment de se battre pour la survie de la Russie.
28. La décision allemande de réarmer, et d'envoyer en Ukraine des armes qui tueront les soldats russes, combinée à la présence en Ukraine de formations qui rappellent le national-socialisme, ne peut que rappeler aux Russes ce qui s'est passé lors de la deuxième guerre mondiale, lorsque les Allemands ont tué 22 millions de civils russes, et qu'une partie des Ukrainiens s'est rangée du côté des nazis contre l'URSS. Les Russes appellent la seconde guerre mondiale la "Grande guerre patriotique", célèbrent solennellement son souvenir, se rassemblent autour d'elle. Le patriotisme et le nationalisme sont une force très puissante en Russie. Les émotions qu'ils suscitent lorsque la survie de la nation est jugée en danger peuvent dépasser la rationalité.
29. Très important : à partir de maintenant, il est absolument nécessaire de prendre au pied de la lettre, et de croire du premier au dernier mot, les avertissements et menaces officiels adressés à l'Occident par les dirigeants russes. En effet, les dirigeants politiques russes n'ont non seulement aucune raison de mentir ou de proférer des menaces vides de sens, mais ils ont absolument besoin d'être clairs, sincères et cohérents dans leurs déclarations officielles à l'Occident. C'est en effet le seul instrument à sa disposition pour contrôler rationnellement le cours des événements et éviter qu'ils ne deviennent incontrôlables et ne précipitent une catastrophe. Penser que les dirigeants russes bluffent est une recette pour le désastre.
30. Il est très important que ceux qui partagent cette lecture des événements transmettent, du mieux qu'ils peuvent, aux parlementaires italiens leur désaccord inquiet pour l'attitude de notre gouvernement et de l'UE. Il convient de rappeler que seul le Parlement peut légitimement décider des actes de guerre et que l'article 11 de la Constitution italienne "répudie la guerre comme instrument d'offense à la liberté des autres peuples et comme moyen de régler les différends internationaux". Il s'agit d'un différend international, qui peut être réglé rapidement en garantissant la neutralité de l'Ukraine.
31. En conclusion, rappelons qu'une attitude agressive et intransigeante, et pire, la collaboration à l'opération de "changement de régime" en Russie, peut précipiter l'Ukraine dans l'abîme. L'issue militaire du conflit, compte tenu des forces sur le terrain et de l'incapacité de la Russie à faire marche arrière, est prédéterminée. Le seul effet réel d'une agression intransigeante pourrait être une augmentation de la pression militaire russe pour conclure rapidement les opérations. Cela impliquerait l'adoption d'un style de guerre beaucoup plus violent et une augmentation spectaculaire des pertes civiles. Si les événements devenaient incontrôlables et débouchaient sur une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, une attitude agressive et intransigeante pourrait également plonger les nations européennes dans l'abîme.
32. De nombreuses personnes suivent le déroulement de cette affaire comme s'il s'agissait d'une série télévisée. Ce n'est pas une série télévisée, c'est la réalité. Nous ne sommes pas à Disneyland, nous ne sommes pas au pays des merveilles. Nous ne sommes pas des enfants : il n'est pas vrai que Papa USA, qui est si fort et si juste, nous protège et veillera à ce que tout se termine de la meilleure façon possible. Soyons des adultes responsables. Une fois cette crise passée, nous discuterons à nouveau des valeurs, des modèles de société, des raisons et des torts, qui sont très importants. Mais avant de discuter des valeurs et des modèles de société, nous devons savoir comment vivre et survivre.
15:48 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, europe, ukraine, russie, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Examen d'un rapport de la RAND Corporation: "Overextending and Unbalancing Russia"

Examen d'un rapport de la RAND Corporation: "Overextending and Unbalancing Russia"
Pavel Kiselev
Source: https://www.geopolitica.ru/en/article/overextending-and-unbalancing-russia-rand-corporation?fbclid=IwAR0IGXyuVEcYVNB9fIOlXPyQriLpXqYa1KpFuDStTvY8kgxz_pAS_TzaZ24
La provocation à la guerre qui sévit aujourd'hui sur le territoire de l'Ukraine a été planifiée par les États-Unis depuis longtemps, et cela leur semble être la meilleure étape à franchir pour obtenir la destruction de la Russie.
En 2019, le think tank américain RAND Corporation a publié un rapport sur le programme d'affaiblissement et de démoralisation de la Russie intitulé Overextending and Unbalancing Russia. Les informations sont disponibles gratuitement sur le site Web de RAND.
Le rapport contient beaucoup de choses intéressantes concernant les stratégies visant l'affaiblissement de l'économie russe, le matraquage idéologique de la population avec les valeurs libérales, et ainsi de suite. Mais dans la situation actuelle, nous sommes intéressés par les points relatifs à la pression politique et militaire sur notre pays. Voici une liste de ces points :
- Fournir une aide létale à l'Ukraine permettrait d'exploiter le plus grand point de vulnérabilité externe de la Russie. Mais toute augmentation des armes et des conseils militaires américains à l'Ukraine devrait être soigneusement calibrée pour augmenter les coûts auxquels la Russie devrait consentir pour maintenir son engagement actuel sans provoquer un conflit beaucoup plus large dans lequel la Russie, en raison de la proximité, aurait des avantages significatifs.
- Augmenter le soutien aux rebelles syriens pourrait mettre en péril d'autres priorités politiques américaines, comme la lutte contre le terrorisme islamique radical, et risquerait de déstabiliser davantage toute la région. En outre, cette option pourrait même ne pas être réalisable, étant donné la radicalisation, la fragmentation et le déclin de l'opposition syrienne.
- Promouvoir la libéralisation en Biélorussie n'aboutirait probablement pas et pourrait provoquer une forte réaction russe, qui entraînerait une détérioration générale de l'environnement sécuritaire en Europe et un recul de la politique américaine.
- Étendre les liens dans le Caucase du Sud - rivaliser économiquement avec la Russie - serait difficile en raison de la géographie et de l'histoire.
- Réduire l'influence russe en Asie centrale serait très difficile et pourrait s'avérer coûteux. Un engagement accru a peu de chances de nuire à la Russie sur le plan économique et risque d'être disproportionnellement coûteux pour les États-Unis.
- Agiter la Transnistrie et expulser les troupes russes de la région serait un coup dur pour le prestige russe, mais cela permettrait également à Moscou d'économiser de l'argent et, très probablement, d'imposer des coûts supplémentaires aux États-Unis et à leurs alliés.
Comme le montre la liste, la déstabilisation de l'Ukraine et l'assistance aux nationalistes ukrainiens en matière d'armement constituent une tâche prioritaire pour affaiblir l'influence de la politique étrangère de la Russie sur l'étranger proche, car le reste des actions envisagées par le Pentagone nécessite un tout autre alignement des forces autour de la Russie.
La déstabilisation des relations entre la Russie et l'Ukraine est le premier grand pas vers la destruction de l'État russe, ainsi que l'encerclement de toute la frontière russe par des conflits militaires dans les territoires environnants. L'essentiel est de provoquer un affrontement, d'allumer le feu de la guerre, d'enserrer la Russie dans un cercle ardent de chaos.
Les Etats-Unis visent à faire de l'ensemble du territoire bordant la Russie du côté européen un tremplin pour désamorcer le potentiel militaire russe. Le rapport poursuit en disant que les bombardiers, les chasseurs, les armes nucléaires et les installations antimissiles de l'OTAN doivent être relocalisés à portée de main des principales installations stratégiques russes. L'expansion de l'OTAN réduira les risques et les coûts pour les États-Unis en attirant d'autres pays dans l'économie de l'alliance et rendra les défenses de la Russie plus vulnérables.
Les points stratégiques de ce plan ont déjà commencé à être mis en œuvre par les États-Unis en 2021. Les experts du centre analytique ont souligné que pour étendre l'influence de l'OTAN, il est nécessaire de mener des exercices des armées de l'Alliance de l'Atlantique Nord dans des territoires tampons qui ne font pas partie de l'OTAN. Le gouvernement de Kiev et les dirigeants de l'alliance ont organisé des exercices militaires sur le territoire de l'Ukraine afin de montrer leur "approche provocatrice envers la Russie".
Les États-Unis voulaient vraiment provoquer la Russie jusqu'au moment où les forces de l'OTAN atteindraient les frontières de la Russie ou, pire encore, entoureraient les murs du Kremlin. Mais la partie russe, comme d'habitude, "s'attelle longtemps, mais roule vite". Les provocations sans fin, les actions terroristes dans les territoires de la RPD et de la RPL ne pouvaient pas durer longtemps. Nous ne pouvions pas attendre que les États-Unis jouent suffisamment la diplomatie et étendent leur hégémonie à l'est de l'Europe jusqu'aux terres russes. Les actions de notre armée en Ukraine aujourd'hui sont le seul moyen de contenir une guerre plus sanglante, de réconcilier deux pays frères et de stopper la politique expansionniste des Etats-Unis.
A propos de l'auteur :
Kiselev Pavel - traducteur, linguiste, membre de l'Union eurasienne de la jeunesse.
13:08 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, actualité, politique internationale, rand corporation, états-unis, stratégie, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Dimitri nous a quittés. Retour sur le parcours de Guy Mouminoux
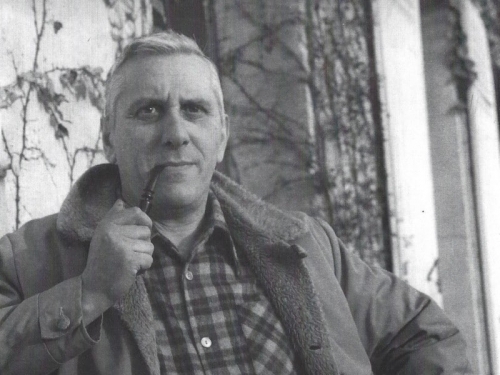
Dimitri nous a quittés. Retour sur le parcours de Guy Mouminoux
par Kristol Séhec
Source: https://www.breizh-info.com/2022/02/28/180572/dimitri-nous-a-quittes/
Décédé le 11 janvier 2022, Guy Mouminoux reste connu pour son seul roman, le récit de guerre autobiographique Le Soldat oublié (sous le pseudonyme de Guy Sajer) ainsi que pour ses bandes dessinées humoristiques ou historiques (sous le pseudonyme de Dimitri).
Guy Mouminoux est né à Paris le 13 janvier 1927. En 1916, son père, un poilu fait prisonnier à Verdun, avait rencontré sa mère pendant sa détention en Allemagne. Guy vit sa jeunesse en Alsace et est passionné par la lecture des revues de bandes dessinées humoristiques pour enfants. Il a le don du dessin et rêve d’en faire son métier. Mais en 1940, lorsque cette région est annexée par l’Allemagne, il rejoint les camps de jeunesse allemands. En 1943, comme d’autres « malgré-nous », enrôlé dans la division Grossdeutschland de la Wehrmacht, il participe, à seulement seize ans, aux combats sur le front de l’Est.
* Les bandes dessinées pour enfants.
Dans la première partie de sa carrière, sans avoir fait d’études aux Beaux-Arts, Guy Mouminoux se consacre à la bande dessinée pour enfants, l’une de ses passions de jeunesse. Fin 1946, il publie Les Aventures de Mr Minus, sa première bande dessinée humoristique. C’est le début d’une longue participation aux illustrés pour la jeunesse, d’obédience catholique (Cœurs vaillants…) ou communiste (Vaillant). Il faut se souvenir qu’en octobre 1945, alors que Cœurs vaillants est provisoirement interdit de publication le temps de contrôler s’il a « collaboré », les communistes lancent leur propre journal pour la jeunesse, Vaillant, en jouant sur la confusion des titres. A partir de 1959, il reprend dans Cœurs vaillants la série Blason d’argent, contant les aventures d’Amaury, preux chevalier combattant l’injustice. Il se fait alors un nom dans le monde de la bande dessinée.
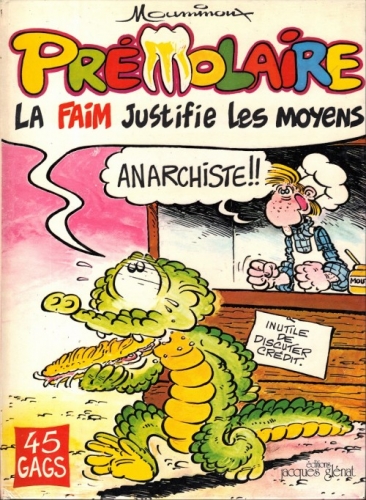
Guy Mouminoux participe également dans le journal Spirou aux Belles histoires de l’oncle Paul, courts récits historiques pour enfants. Au journal Spirou, il rencontre Jijé, auteur majeur de la bande dessinée chrétienne, qui devient l’un de ses meilleurs amis. Ils réaliseront ensemble, au milieu des années 1960, quelques tomes de la série Les Aventures de Jean Valhardi. En 1964, pour le magazine Pilote, il crée une série humoristique, Goutatou et Dorauchaux, imaginant que deux chats constituent l’équipage d’un remorqueur. On découvre alors son style caractéristique qu’il reproduira pour la série Le Goulag. De 1970 à 1980, il crée pour Tintin, la série humoristique Rififi, jeune moineau turbulent, chassé du nid par ses frères à cause des punitions qu’il leur attire.
* Le soldat oublié.
En 1967, Mouminoux publie Le Soldat oublié chez Robert Laffont, qui obtient en 1968 le Prix des Deux Magots. Traduit en près de 40 langues, vendu à près de trois millions d’exemplaires, ce récit autobiographique décrit sa participation aux combats au sein de l’armée allemande. On découvre que Guy est mis au service du Reich allemand, dans le cadre de l’Arbeitsdienst. Il participe au ravitaillement des troupes sur le front de l’Est. Durant l’hiver 1942, le froid est intense. Son unité n’arrive pas à rejoindre à Stalingrad la 6e armée allemande de Paulus. Elle recule de Kharkov à Kiev. Début 1943, après une permission à Berlin où il rencontre Paula, il se porte volontaire pour être incorporé dans la division Grossdeutschland. Il participe alors à la bataille de Koursk, avant de reculer jusqu’au Dniepr. Tentant de repousser l’avancée soviétique, il combat aux côtés des enfants et des vieillards du Volkssturm. En avril 1945, il se rend aux Anglo-américains. Prisonnier de guerre, il est rapidement libéré du fait de son origine française.
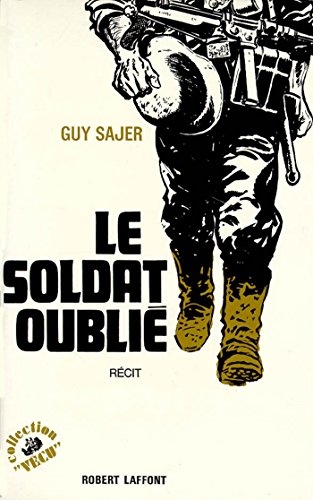
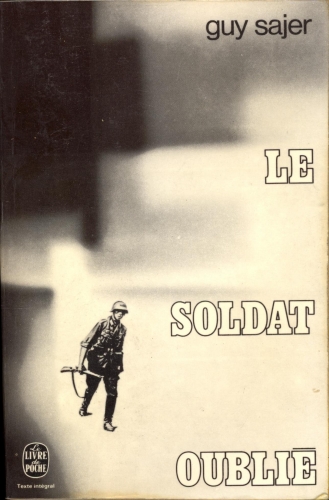
Dans ce récit, il révèle la forte camaraderie au sein de l’armée allemande. Il décrit dans le détail les conditions de vie du soldat allemand. On découvre le terrible hiver russe (−40 °C), provoquant gelures et amputations. Mais bien que Mouminoux ait pris soin de signer ce roman sous pseudonyme, Guy Sajer (d’après le nom de jeune fille de sa mère), le monde de la bande dessinée découvre la véritable identité de l’auteur, qui reste fasciné par le courage de ces soldats prêts à donner leur vie pour une cause. Dès lors, Guy Mouminoux est parfois rejeté par certaines maisons d’édition.
* Le goulag.
En 1975, Guy Mouminoux prend le pseudonyme de Dimitri. Il réalise alors sa principale série, Le goulag, qui paraît dans les magazines Hop !, fanzine, Charlie mensuel, L’Hebdo de la BD, L’Écho des savanes, L’Événement du jeudi et Magazine hebdo. Il y rencontre Wolinski, Cavanna, Cabu, Gébé, Choron… et Reiser, qui devient l’un de ses meilleurs amis. Le personnage principal du Goulag, Eugène Krampon, flegmatique ouvrier parisien émigré en Union soviétique, est interné au goulag 333 en Sibérie à la suite d’un malentendu. Il vit alors de surprenantes aventures, devenant pilote d’essai, soldat à la frontière sino-russe, champion de football… Il découvre qu’à la chute de l’empire soviétique, la Russie s’ouvre au capitalisme. Les hamburgers remplacent la bonne cuisine russe ! Mais il ne pense qu’à retrouver sa belle Loubianka. En s’adressant à un public plus adulte, Dimitri accède alors à la reconnaissance. Il expliquait que « Le Goulag, pour moi c’est la vie. Il nous entoure, nous sommes en plein dedans. On peut en pleurer mais aussi en rire. C’est un peu comme à la guerre » (Le Choc du Mois, nov. 1990, p. 54). Si Dimitri dénonce avec humour le régime communiste, il reste très attaché au peuple russe.
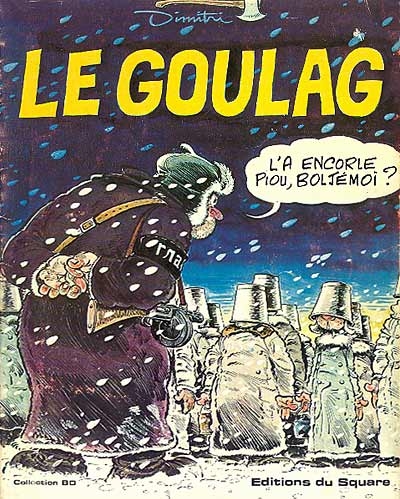
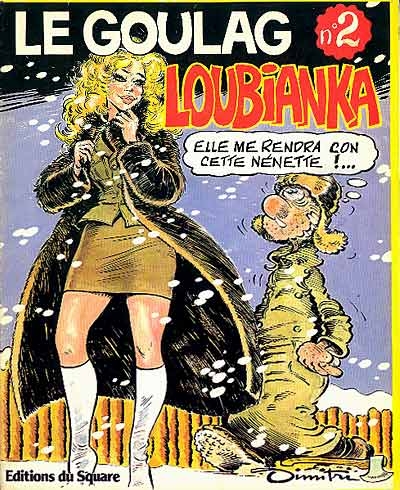
Après la disparition de René Goscinny, en 1977, Mouminoux est même pressenti par Georges Dargaud, alors en conflit avec Albert Uderzo, pour poursuivre la série Astérix le Gaulois.
Durant cette période, la gauche le soupçonne d’être d’extrême-droite et la droite l’accuse de fréquenter la gauche.
* La période d’humour grinçant.
Dimitri réalise au début des années 1980 de nombreuses bandes dessinées satiriques.
Deo Gratias (1983), composée d’histoires courtes à l’humour noir grinçant, révèle le constat désespéré de Dimitri sur la civilisation moderne. Sa critique du féminisme, une femme exigeant de livrer un combat de boxe à un homme, est particulièrement féroce. Le noir et blanc lui convient très bien.
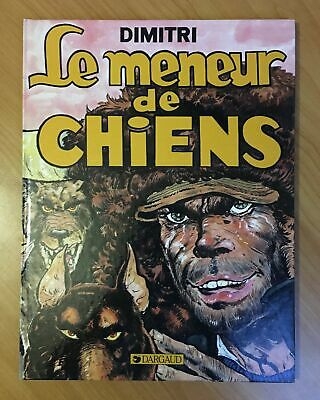
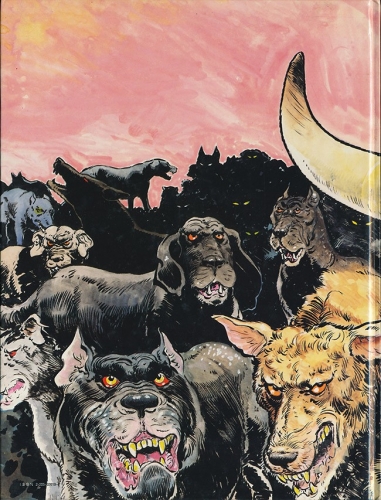
Dans Le Meneur de chiens (1984), un homme détestant la civilisation moderne s’apprête à se suicider. Mais il découvre alors qu’il a le pouvoir de parler aux chiens. Il va mener une meute de chiens féroces à l’assaut d’humains sans défense. Il leur ordonne de les tuer et de les manger. Dans cet album impitoyable, les attaques sont si sanglantes qu’il s’agit presque d’une bande dessinée d’horreur.
Les Mange-merde (1985) décrit une société gangrenée par l’insécurité et le chômage. La révolte gronde. Un jeune chef d’entreprise est ruiné. Il croise la route d’un jeune inventeur. Ensemble, ils rentrent dans un bistrot, qualifié de « dernier refuge gaulois ». Ils vont fuir une bande de racketteurs. De nouveau, Dimitri use de son humour noir féroce pour révéler l’état de la société.
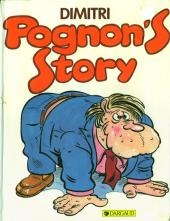 Pognon’s story (1986) est une étonnante satire socio-politique teintée d’humour grinçant. Qu’on en juge. Un homme, en vacances au bord de la mer, va tenter de gagner de l’argent en déformant son corps pour prendre l’aspect d’animaux. Puis il intègre l’équipage d’un bateau en partance pour l’Amérique centrale. Il y rencontre une aventurière nymphomane qui cherche à acheter frauduleusement des véhicules militaires au Honduras. Puis un ermite lui révèle le secret d’une pierre magique qui rend leur lucidité à ceux qui se l’accrochent aux testicules ! Mais ce pouvoir inquiète le gouvernement…
Pognon’s story (1986) est une étonnante satire socio-politique teintée d’humour grinçant. Qu’on en juge. Un homme, en vacances au bord de la mer, va tenter de gagner de l’argent en déformant son corps pour prendre l’aspect d’animaux. Puis il intègre l’équipage d’un bateau en partance pour l’Amérique centrale. Il y rencontre une aventurière nymphomane qui cherche à acheter frauduleusement des véhicules militaires au Honduras. Puis un ermite lui révèle le secret d’une pierre magique qui rend leur lucidité à ceux qui se l’accrochent aux testicules ! Mais ce pouvoir inquiète le gouvernement…
Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, la bande dessinée Les Consommateurs (1987), à l’humour caustique, n’est pas une critique de la société de consommation. Un faux médecin se retrouve sans cabinet. Il accepte de se rendre au chevet d’un escroc international protégé par les services secrets. Après s’être fait piquer les fesses par une arête de barracuda ensorcelée, celui-ci se transforme en salamandre et ne peut vivre que dans une baignoire.
Dans La Grand’messe (1988), un éboueur veut changer de métier. Après un accident de voiture, il devient le sosie d’un ministre et le remplace pour déclamer des discours politiques vides de sens. Dimitri critique ici les politiciens qui méprisent leurs électeurs, qu’ils soient de gauche, de droite ou du centre.
L’abattoir (1989) lui vaut son éviction de chez Dargaud. Dimitri imagine qu’un homme au bout du rouleau s’enrôle dans la police. C’est l’occasion pour lui de dénoncer le lynchage d’une police désarmée et son abandon par le pouvoir judiciaire. Il affirme qu’ « on voudrait instaurer le désordre et le chaos qu’on ne s’y prendrait pas autrement » (Le Choc du Mois, nov. 1990, p. 54).
* Les récits historiques.
A partir des années 1980, Dimitri participe au grand succès de la bande dessinée historique, avec des récits particulièrement poignants. Ce sont les conditions extrêmes qui l’inspirent. Pour chacun de ces albums, Dimitri se documente très sérieusement. Il achète des maquettes pour dessiner les modèles sous tous les angles.
La Seconde Guerre mondiale reste son thème de prédilection. Son chef d’œuvre reste sans doute Kaleunt (1988). Il raconte le parcours de Heinrich Schonder, commandant de l’Unterseeboot 200, qui ne montre guère d’intérêt pour le régime national-socialiste. On prend conscience de la terrifiante vie des sous-mariniers, jusqu’à ce que ce sous-marin soit coulé le 24 juin 1943. Le dessin expressif et la colorisation sont superbes.
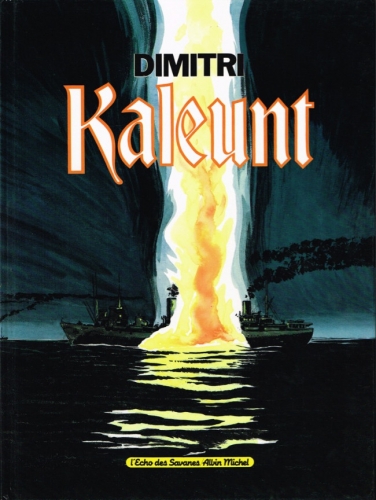
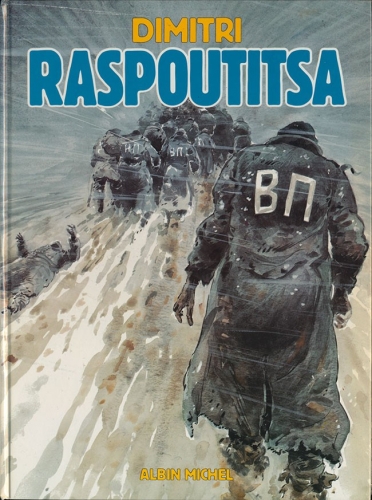
L’année suivante, dans Raspoutitsa (1989), Dimitri retrace, après la bataille de Stalingrad, la captivité d’un soldat allemand. Il illustre parfaitement son désespoir, marchant dans la neige au sein de colonnes de prisonniers rejoignant les camps de Sibérie.
D’autres bandes dessinées ont pour cadre la seconde guerre mondiale. Dans D-LZ129 Hindenburg (1999), Dimitri envisage l’hypothèse qu’un complot est à l’origine de l’embrasement du dirigeable Hindenburg, lors de son atterrissage le 6 mai 1937.
Dans Kursk tourmente d’acier (2000), Dimitri décrit, avec une multitude de commentaires, le parcours d’un soldat de l’armée allemande engagé dans la bataille de Kursk, lequel va être témoin de l’atrocité de la guerre. Kamikazes (1997) décrit la psychologie d’un jeune aviateur nippon sacrifiant sa vie pour sa patrie. Dimitri montre que son sens de l’honneur est le même que celui des samouraïs.
Dans le tome 2 de Sous le feu ! (2011), Dimitri prône le sens de l’honneur d’un jeune officier nippon descendant d’une famille de samouraïs. Au cours de la bataille de Malaisie (décembre 1941), il se bat avec bravoure et respecte ses prisonniers. Mais, sanctionné par un officier supérieur, il doit maintenant surveiller des prisonniers anglais chargés de construire un pont. Malgré le sabotage du pont, il continue de défendre les prisonniers de guerre anglais. Cet esprit chevaleresque envers l’ennemi lui évitera la prison en 1945. Dans tous ces récits de guerre, Dimitri explore la conscience tourmentée du guerrier. Mais Dimitri endosse également le point de vue des alliés. Le Convoi (2001) révèle ainsi l’angoisse des marins américains, livrant des armes à l’armée russe, toujours sous la menace des bombardiers et sous-marins allemands.
A titre exceptionnel, Dimitri réalise en 2008 le scénario du tome 1 de la série Les oubliés de l’Empire. Il raconte le parcours d’Üdo Sajer, un jeune wurtembergeois de 16 ans. En 1805, fasciné par l’armée napoléonienne, celui-ci parvient à s’engager, quitte le Saint-Empire romain germanique, et suit une formation militaire. Mais dès sa première bataille, le jeune Sajer découvre l’horreur de la guerre… Dimitri semble ainsi s’amuser à imaginer son parcours s’il était né deux siècles plus tôt, remplaçant ainsi la Wehrmacht par l’armée Napoléonienne.
* La fascination pour la forêt et la mer.
Dès qu’il avait un moment de libre, Dimitri partait se promener en forêt. Il s’y réfugiait lorsqu’il était contrarié, déprimé. Il a célébré son amour pour la forêt dans la bande dessinée Hymne à la forêt (1994). A la fin du premier millénaire, un chevalier errant fuit au coeur de la forêt profonde de la Saxe. Il détient une pierre noire qui va lui donner d’étranges pouvoirs. Après bien des péripéties, il se métamorphose en un beau guerrier solaire à l’armure magique… Sorti en 2007, La Malvoisine s’inspire du Roman de Renard. Dimitri imagine les mésaventures d’un vieux sage, qui tente de faire régner l’ordre et la justice entre les humains et les animaux, et de sa voisine guerrière qui considère que l’homme doit dominer le monde animal. Pour cette histoire, il reprend le dessin animalier de sa jeunesse. Mais ces deux légendes médiévales sont cependant décevantes.
Également fasciné par la mer, Dimitri était un fidèle des fêtes maritimes internationales de Brest. Dans nombre de ses récits, il montre la dureté de la vie en pleine mer.
Meurtrier (1998) évoque la dramatique vie d’un pauvre orphelin, qui après avoir perdu ses parents à l’âge de cinq ans, est pris en charge par une sinistre institution, condamné à une peine de prison pour meurtre, puis devient fantassin pendant la première guerre mondiale. Cet album permet à Dimitri de dessiner de terrifiantes tempêtes maritimes.
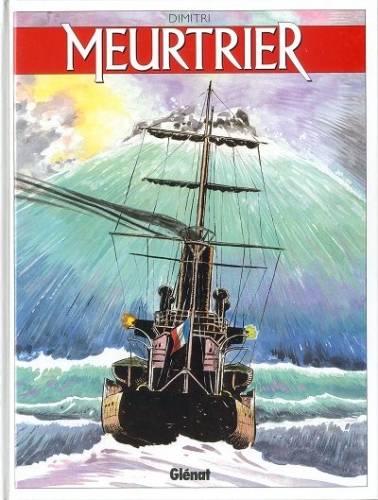
Dans Haute Mer (1993), Dimitri décrit, à l’aube de la première guerre mondiale, le parcours d’un baleinier qui va s’aventurer dans les eaux de l’arctique. Prêt à affronter tous les dangers, le commandant recherche en mer une créature mythique. Le dessin réaliste de Dimitri est si soigné qu’on a l’impression d’être immergé en haute mer.
Dans Sous le pavillon du Tsar (1995), Dimitri nous dévoile la bataille navale de Tsushima, opposant les 27 et 28 mai 1905 les forces russes du Tsar Nicolas II aux japonais. On découvre le quotidien des marins de la flotte russe ainsi que l’horreur d’une bataille navale moderne.
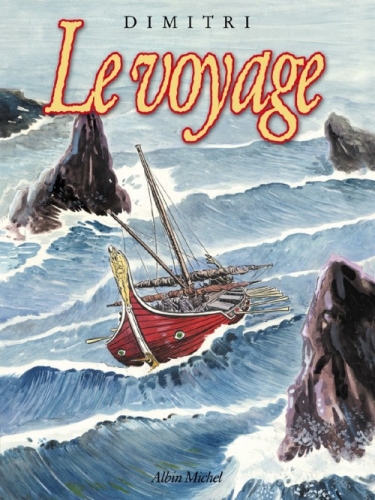
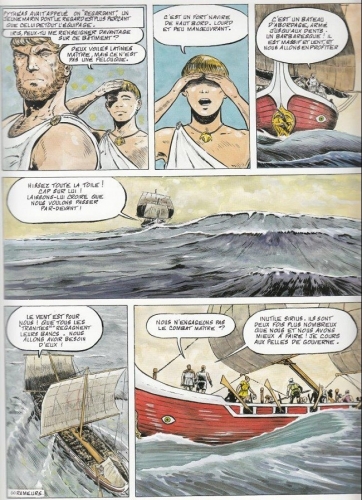
Le récit de Dimitri le plus surprenant reste sans doute Le Voyage (2003) publié chez Albin Michel en 2003. Aux alentours de 330 avant J.C, le savant Pytheas, originaire de la colonie grecque de Massalia (Marseille), prend la mer pour explorer l’Europe nordique. Il passe les Colonnes d’Hercule (détroit de Gibraltar) et découvre le phénomène des marées, alors inconnu des Grecs. Parvenant à éviter des pirates maures, il pousse plus au nord et atteint l’Armorique et ses mégalithes. Après le pays des Pictes, il parvient à l’île de Thulé, située sur le cercle arctique. Cédant la place à l’imaginaire, Dimitri n’hésite à conter une rencontre entre Pytheas et les dieux antiques puis le peuple atlante. Relire cette bande dessinée après la mort de Dimitri reste un moment émouvant…
Dimitri se définissait comme un européen, ne se sentant en Europe nulle part dépaysé (Le Choc du Mois, fév. 1989, p. 68). Il paraissait très calme, aux manières policées. Mais sa vie restait marquée par son expérience de combattant pendant la seconde guerre mondiale. Il s’exprimait ainsi : « Il m’arrive encore de sauter du lit la nuit. Les trente mois que j’ai passé dans l’armée représentent pour moi 75 % de mon expérience vitale. Le reste de mon existence me semble, en comparaison, si aimable, si facile… Et c’est peut-être monstrueux à dire, mais cette période atroce de ma vie constitue, en même temps, toute ma richesse. Quoi que je fasse, quoi que je cherche comme source d’inspiration, je tombe invariablement là-dessus » (Vécu, juin 2000, p. 85).
Sur le plan artistique, Dimitri avait appris son métier sur le tas. Auteur complet, il réalisait le scénario et le dessin. C’est peut-être la raison pour laquelle son dessin rond, au trait de pinceau nourri, racé et viril, était si caractéristique. Il dessinait avec ses tripes. On retrouvait toujours dans ses bandes dessinées l’idée dramatique qu’on n’échappe pas à son destin. Mais cette idée était souvent portée avec humour.
Conseils de lecture (parmi les œuvres encore éditées) :
– Le soldat oublié, 784 pages, 12 euros, Tempus Perrin.
– Récits de guerre t. 1 (Sous le pavillon du Tsar, Kamikazes, Meurtrier), 144 pages, 16 euros, Glénat.
– Le Voyage, 56 pages, 12,75 euros. Albin Michel BD.
Kristol Séhec
[cc] Breizh-info.com, 2022, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine
10:42 Publié dans Bandes dessinées, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dimitri, guy sajer, guy mouminoux, bandes dessinées, hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 27 février 2022
Guerre en Ukraine: la spirale autoréalisatrice
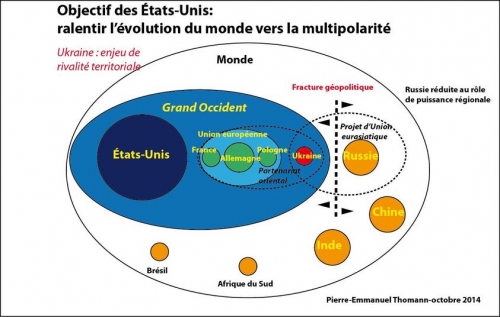
20:12 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, actualité, géopolitique, politique internationale, russie, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La guerre en Ukraine et les querelles intra-européennes

La guerre en Ukraine et les querelles intra-européennes
Vincenzo Bovino
SOURCE : https://medium.com/@thegreatgame/the-war-in-ukraine-and-the-contest-of-europe-3602fe9dba7b
L'Europe est le continent le plus important, le plus convoité en termes de prestige culturel, de situation géographique et vu les compétences étendues de ses habitants. Le fait économique ne suffit pas à décrypter les enjeux de la planète, les puissances impériales regardent l'Europe pour se jauger. Les Chinois en sont bien conscients et se concentrent sur l'Europe pour perturber la mondialisation en cours et saper la supériorité américaine.
L'Europe est au cœur du différend, la crise ukrainienne découle de ce fait, la politique étrangère des États-Unis semble capricieuse et imprévisible, pourtant un fil conducteur relie l'attitude de tous les gouvernements de l'ensemble du spectre politique américain du siècle dernier : l'hostilité envers une puissance rivale dans l'espace eurasien. Le contrôle de l'Europe passe par l'endiguement de la Russie et la politique de Biden poursuit également un autre objectif : ralentir, retarder et éventuellement saboter l'autonomie stratégique européenne, en évitant la soudure de l'Allemagne, de la France et peut-être un peu de l'Italie, avec les Russes.
L'Ukraine s'est retrouvée dans un jeu plus vaste, le lieu où se croisent des tendances et des mentalités opposées. Sur le champ de bataille, les troupes et les véhicules blindés se déplacent, mais il ne s'agit pas seulement d'un conflit régional visant à affirmer des sphères d'influence, mais d'une attaque qui affaiblit l'Europe, prise entre les feux croisés d'impérialismes opposés.
La crise ukrainienne n'a pas été soudaine, elle a une origine historique, culturelle et politique séculaire qui s'est ravivée à partir de 2014, lorsque le dernier gouvernement pro-russe le plus fiable a été submergé par les manifestations de rue et les manœuvres politiques euro-atlantiques.
La Russie tente de regagner de l'influence dans son voisinage étranger et la question ne concerne pas seulement les armements de l'OTAN et leur destination. Kiev devient un symbole : le premier noyau étatique slave est attesté entre la fin du 9e et le début du 10e siècle, lorsque la Rus' de Kiev, fondée par un certain Rjurik, probablement un chef viking, commence son ascension.
Au fil des siècles, l'émergence de différentes identités a polarisé la société ukrainienne, qui est divisée en fractures sociales, ethniques et linguistiques. Le territoire ukrainien est divisé en deux, la partie nord et ouest ukrainophone est sentimentalement plus proche de l'Europe centrale, tandis que l'est russophone regarde vers sa patrie.
Pour en revenir à l'actualité, la question ukrainienne est une énigme, pas trop difficile à résoudre si l'on prend quelques données sans se laisser berner par les apparences d'antagonismes plus fictifs que réels.
Commençons par une question : l'Ukraine est-elle stratégiquement importante pour les États-Unis ? Non. Et c'est encore plus clair maintenant, puisqu'il n'y a eu aucune volonté d'envoyer des soldats pour contrer les Russes. L'Ukraine a été approvisionnée en armements et rien de plus, elle est (scandaleusement) considérée comme un pion consommable, elle a été abandonnée à elle-même, comme en témoigne la décision des Américains de retirer les formateurs présents sur le territoire et de transférer leur personnel diplomatique à Lviv, dans la zone la plus occidentale, jouxtant la Pologne, dans la Galicie, province anti-russe par excellence.
Le sale jeu des prétendants
Les Américains concentrent leurs attentions sur l'Indo-Pacifique, déterminés à contenir la Chine, ils n'ont pas besoin d'encercler davantage la Russie, déjà confinée dans un espace imposant des mouvements qui ne sont qu'étroits. Biden n'a jamais voulu négocier une réorganisation de l'architecture de sécurité européenne avec Poutine, mais il s'est montré prêt à faire des concessions modérées, étant donné que la configuration actuelle garantit toujours un contrôle substantiel sur le vieux continent. Biden a préparé un piège, Poutine a calculé chaque mouvement, suivant d'abord la voie politique puis choisissant l'option militaire, prenant même en compte le risque de sanctions qui ne l'affectent guère si l'on pense aux énormes réserves de liquidités dont il dispose.
La tentative européenne
Emmanuel Macron avait immédiatement compris le plan anti-européen des Américains et avait agi bien avant les autres chancelleries européennes. Il avait pressenti les intentions mal dissimulées de Biden et s'est consacré avec abnégation à l'objectif de la détente. La France, titulaire de la présidence tournante du Conseil de l'Europe, ainsi que l'Allemagne, ont tenté de proposer une médiation entre Washington et Moscou, afin d'agir comme une troisième force.
Macron s'était montré prêt à évaluer les garanties de sécurité données par le Kremlin à l'Alliance atlantique et à garantir une position neutre à l'Ukraine. Les États-Unis, au cours des trois derniers mois de négociations serrées, même après les entretiens de Biden et de Poutine à Genève le 10 janvier, ont fait preuve de bonne volonté mais ont refusé certaines demandes spécifiques de l'adversaire, concernant la fermeture des installations de missiles en Roumanie et les démantèlement de celles qui sont actuellement en construction en Pologne.
Macron a joué toutes ses cartes de médiateur pour éviter que l'Union européenne ne soit acculée par les deux prétendants. Les Russes et les Américains avaient-ils vraiment la volonté de parvenir à un compromis ?
Biden est en train de gagner sans tirer un coup de feu, Poutine a choisi la voie la plus difficile. Le conflit militaire déclenché par le Kremlin, motivé par une justification bon marché, telle que la restauration des conditions démocratiques (rappelant certaines hypocrisies linguistiques américaines), a pour seul objectif de plier l'Ukraine à sa volonté. Le choix de la date de la première attaque, le matin du 24 février, anniversaire de la fuite du dernier président pro-russe de Kiev, Viktor Yanukovich, en 2014, est également symbolique. "La Russie est une tempête" a écrit le poète Aleksandr Blok en 1918 et la tempête est servie.
La guerre peut être gagnée sur le terrain, mais à moyen et long terme, une victoire stratégique est nécessaire et, en ce moment, parallèlement à la douleur, le sentiment nationaliste ukrainien s'intensifie dans une fonction anti-russe. Il est impossible pour les soldats russes de rester sur le terrain pendant de nombreux mois, en raison du manque de personnel militaire, de l'extension complexe du territoire et des coûts considérables que génèrerait un conflit de basse intensité. Dans quelque temps, la Russie sera probablement confrontée aux mêmes problèmes avec ses nombreux voisins, temporairement endormis et réfléchissant à leur vengeance.
Une autre triste vérité demeure, l'indécision des nations européennes, le contraste interne entre des forces plus autonomes et d'autres plus alignées sur les positions américaines, entravent l'affirmation d'une Europe plus puissante et souveraine.
Vincenzo Bovino
14:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, europe, politique internationale, géopolitique, russie, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
BELGIUM. NATO. UKRAINE. Expert Debates
BELGIUM. NATO. UKRAINE. Expert Debates
14:01 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ukraine, otan, europe, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'esclavage numérique et la fin de l'enseignement

L'esclavage numérique et la fin de l'enseignement
Carlos X. Blanco
Nous nous dirigeons vers un nouvel esclavage. Plus grand, si possible, que celui d'autres époques où l'on fouettait le dos nu et où l'on attachait le cou, les chevilles et les poignets avec des entraves, des anneaux et des chaînes. Aujourd'hui, le fer n'est pas nécessaire. Il existe d'autres technologies de contention. Il s'agit des technologies de l'information, de la communication et du contrôle.
Il ne s'agit pas vraiment de technologies au sens strict. Ce dont nous parlons n'est pas une "connaissance" ou un discours raisonné (logos) sur la technologie (techné). Nous parlons plutôt d'un ensemble d'appareils basés sur l'électronique et l'informatique qui permettent au fournisseur, sous prétexte de "nous faciliter la vie" avec leurs applications, de disposer d'énormes quantités de données sur la vie privée, les propensions, les affinités, les goûts, les habitudes (allant du commerce du sexe aux bibelots inutiles).
Les entreprises fournisseuses proposent leurs applications aux particuliers, aux entreprises et même aux établissements d'enseignement de manière apparemment gratuite et avec l'attrait de nous épargner du travail physique et intellectuel. Les consommateurs, de l'écolier qui entre dans une salle de classe virtuelle à l'adulte qui achète en ligne des cadeaux et des livres, par exemple, croient sincèrement qu'avec eux leur vie est "plus facile", qu'ils gagnent du temps, évitent les déplacements, évitent de stocker des objets physiques, apprennent plus vite et plus efficacement. La société qui nous fournit les applications est souvent liée à certains des géants des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). En réalité, la vie devient plus compliquée et s'appauvrit.
Le monde de l'éducation a été totalement happé par l'engouement pour la numérisation. A l'occasion de la pandémie, le GAFAM s'est frotté les mains. De manière anarchique d'abord, puis, formellement ou non, de concert avec les administrations, les géants technologiques ont profité du choc pandémique (la "Shock Doctrine" de Naomi Klein s'applique ici à la perfection) pour usurper les fonctions pédagogiques qui n'appartiennent qu'aux parents, aux instituteurs et aux professeurs.

L'"État Papa", dans un autre cas flagrant de négligence de ses fonctions, loin de répondre aux besoins éducatifs des étudiants dans une situation de crise, dans une occasion totalement hors du commun, a confiné tout le monde chez soi et a prolongé indûment la fermeture des écoles et des universités, remplaçant la fourniture d'un service essentiel comme l'Éducation par une consommation obligatoire, compulsive et sans cervelle de ressources numériques et d'applications cybernétiques privées. Les GAFAM ont non seulement obtenu des millions de données supplémentaires sur les mineurs, mais aussi de nouveaux accros à leurs plateformes et un degré de dépendance à leurs "services" qui aura des effets dévastateurs à long terme. Toute une génération académique a ainsi été perdue, et a fourni de la sorte la base sociale de l'effondrement éducatif et culturel imparable et irréversible de l'Espagne.
A ce jour, alors que le risque de contagion dans les écoles est minime et que l'utilité et le sens de ces classes numériques et plateformes en ligne sont plus que discutables, les administrations éducatives sont toujours déterminées à promouvoir ce pseudo-enseignement. Les enseignants sont plus ou moins contraints de se "recycler" avec des cours (souvent en dehors de leurs heures de travail) sur la numérisation. Ces cours, comme cela s'est déjà produit dans d'autres secteurs tels que la banque et la vente, seront précisément la ruine de ceux qui les suivent et mettront en pratique leur formation, car la sauvegarde des emplois et le remplacement de l'enseignant par un système d'algorithmes qui quantifieront les "progrès" des étudiants seront imposés plus tôt que prévu. Avec un entêtement moutonnier, de nombreux enseignants s'enthousiasment pour cette "révolution numérique", en s'aveuglant sur l'évidence : c'est la mort même de la figure de l'enseignant et la fin de l'éducation telle que nous l'avons comprise depuis les temps de la Grèce et de Rome jusqu'à hier.
Les élèves interagissent avec un réseau, dont ils sont de plus en plus esclaves. Les enseignants et les parents sont absents du processus éducatif. L'État-providence, qui comprend un État formellement engagé dans le travail d'éducation, est également en recul. Un monde régi par les machines et une "révolution numérique" au service de puissances mondiales qui "éduqueront" à leur manière et à leur profit exclusif. L'esclavage numérique est là.
12:01 Publié dans Actualité, Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : école, enseignement, éducation, numérique, enseignement numérique, actualité, digitalisation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La revue de presse de CD - 27 février 2022

La revue de presse de CD
27 février 2022
EN VEDETTE
Si vous pensez autrement, vous êtes un terroriste !
Il va devenir difficile de distinguer ce qui fait le charme un peu rude des dictatures orientales de la soyeuse bonté des démocraties occidentales : chaque jour qui passe accroît l’évaporation rapide des principes fondamentaux de nos démocraties et tout indique qu’on se dirige vers un monde où penser de travers vaudra sinon mise à mort physique, au moins mise à mort sociale… Pour étayer ce constat, on pourrait par exemple jeter un œil au dernier bulletin produit par le Homeland Security, l’administration américaine en charge de la sécurité intérieure du pays, et qui a récemment explicité comment elle entendait lutter contre les menaces terroristes qu’elle voit manifestement partout.
Contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/02/21/422090-si-vous-pe...
AFRIQUE
Mali : les éthers idéologiques expliquent l’éviction de la France
Le vendredi 18 février 2022, la junte militaire au pouvoir à Bamako a exigé que le départ des forces de « Barkhane » se fasse immédiatement, et non pas par étapes, comme l’avait annoncé le président Macron. Comment en sommes-nous arrivés à une telle situation et à une telle rupture ? Explications de Bernard Lugan.
Synthèsenationale
http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2022/02/2...
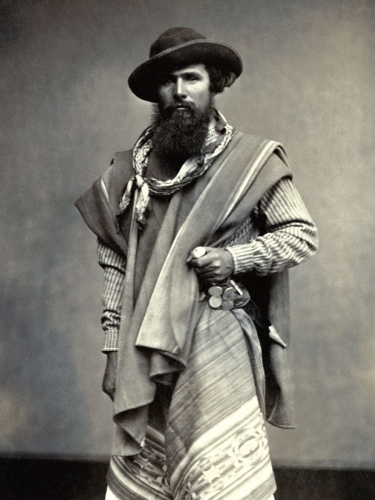
AMÉRIQUE DU SUD
Un regard sud-américain
Dans les années 1970, Jorge Luis Borges se plaignait déjà que les éditeurs américains ne voulaient pas publier ses romans et ses nouvelles parce qu'il n'appelait pas l'homme noir "homme de couleur" et l'aveugle "malvoyant".
À cette époque, les intellectuels yankees ont commencé à utiliser ce que l'on appelle aujourd'hui le "langage inclusif" : l'utilisation de la rhétorique inappropriée et la répétition de locutions généralisantes telles "tout le monde", "garçons et filles" ; "travailleurs", etc. En Yanquilandia, ce langage n'est plus utilisé mais, comme d'habitude, il est arrivé vingt ans plus tard en Amérique du Sud où les progressistes l'ont adopté comme une nouveauté.
Euro-synergies
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/02/21/s...
DÉSINFORMATION/CORRUPTION
Wikipédia est-il fiable ou orienté idéologiquement ?
Mise à jour au 23/02/2022 : l’actualité récente remet à la une Wikipédia, surnommée “Wokipédia” par de mauvaises langues, dans un contexte de guerre d’édition que se livrent partisans et opposants à Éric Zemmour sur sa biographie. Devinez lesquels ont été exclus ? L’occasion de remettre en avant un article d’août 2020) que nous avions consacré à l’encyclopédie, pas aussi libre qu’elle le prétend.
Ojim.fr
https://www.ojim.fr/wikipedia-est-il-fiable-ou-oriente-id...

ÉCOLOGIE
Pourquoi la forêt française a besoin d’un traitement de fond
Les conclusions des Assises nationales de la forêt et du bois, lancées par le gouvernement en octobre 2021 avec pour objectif de « penser la forêt française de demain », devraient être rendues dans les prochains jours. Un des axes majeurs de cette réflexion concernait le renforcement de la résilience des forêts et la préservation de la biodiversité. Car la forêt française est aujourd’hui en crise : depuis deux décennies, on assiste en effet à une mortalité croissante des peuplements forestiers et à une baisse globale de leur productivité.
The conversation.com
FRANCE
La Cordée, exemple d’une école privée hors contrat : ça marche !
J’aimerais vous parler de La Cordée. Cette école privée hors contrat de Roubaix a ouvert ses grilles en septembre 2015 avec sept élèves. À la fin de cette première année scolaire, ils étaient déjà vingt, et en septembre dernier, ce sont quatre-vingts élèves répartis en huit classes allant de la grande section de maternelle à la 5e qui y faisaient leur rentrée.
Contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/02/24/301077-la-cordee-...
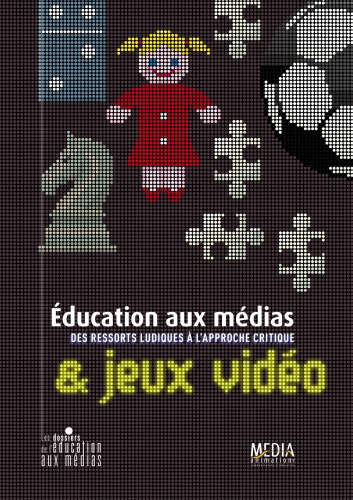
GAFAM
Éducation aux médias et à l’information : la généralisation, et après ?
Depuis 2018, l’éducation des jeunes et des adultes aux médias numériques et à l’information en général fait l’objet d’un regain d’intérêt remarquable, dû à l’urgence de la lutte contre les infox et la circulation des discours de haine. Cela s’est traduit par une salve de textes officiels. Devenue une obligation pour les États membres dans la Directive service des médias audiovisuels (DSMA), l’« Éducation aux médias et à l’information », ou « EMI », hors et dans l’école, est mentionnée comme un des piliers du Plan d’action contre la désinformation de l’Union européenne. L’OTAN en a fait l’objet de sa « diplomatie culturelle ».
Theconversation.com
Facebook News arrive en France
Après les États-Unis en 2020, le Royaume-Uni et l’Allemagne en 2021, Facebook News a fait son arrivée en France courant janvier 2022. Suivant la voie par la signature, en octobre 2020, d’un accord entre Google et l’Alliance pour la presse d’information générale (APIG) sur les droits voisins, il se présente comme une fonctionnalité supplémentaire offrant un résumé de l’actualité par des titres majeurs de la presse nationale française. Néanmoins, comme nous pouvions nous y attendre, ce « résumé » est soumis à quelques critères bien connus…
Ojim.fr
https://www.ojim.fr/facebook-news-france/?utm_source=news...
ISLAMISME
Pourquoi le voilement du corps des femmes est au cœur du projet des islamistes
Au Maghreb, durant l’année 2021, des cérémonies incitant les adolescentes et les étudiantes à se voiler ont été organisées. En Tunisie et en Algérie des jeunes filles fraîchement voilées ont été récompensées dans une ambiance festive. Une campagne pro-hijâb a également été récemment mise en place au sein du Conseil de l’Europe par les organisations fréristes (Frères musulmans) européennes. Autant d’évènements qui semblent témoigner d’une recrudescence de l’activisme islamiste qui fait du voile son fer de lance.
Theconversation.org
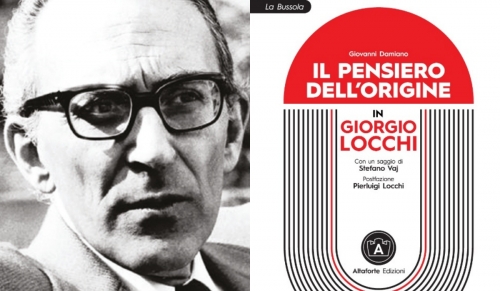
RÉFLEXION
Giorgio Locchi et la philosophie de l'origine
Giorgio Locchi est un nom familier pour ceux qui ont appris à penser dans les années 1970. Le dernier ouvrage de Giovanni Damiano, consacré à l'exégèse de la contribution théorique de Locchi, a le mérite incontestable de raviver l'intérêt pour ce philosophe, dont la pensée vise à dépasser l'état actuel des choses. Nous nous référons à, Il pensiero dell'origine in Giorgio Locchi (La pensée de l'origine chez Giorgio Locchi), en librairie grâce à une belle initiative des éditions Altaforte Edizioni. Le texte est enrichi par un essai de Stefano Vaj, qui lit la contribution du philosophe en termes transhumanistes, et par la postface de Pierluigi Locchi, le fils du penseur (pp. 145, euro 15,00).
Euro-synergies
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/02/20/g...
RUSSIE
Crise ukrainienne : la géographie, ça sert d’abord à faire la guerre
La débandade américaine en Afghanistan après une guerre de 20 ans a-t-elle marqué la fin d’un cycle historique entamé avec la chute de l’URSS en 1991 ? Vladimir Poutine a reconnu hier officiellement l’existence de Donetsk et Louhansk, les deux républiques séparatistes pro-russes de la région ukrainienne du Donbass. Cette décision à la fois prévisible et inattendue lui permettrait-elle d’obtenir mieux que l’acceptation de ses demandes écrites adressées aux Etats Unis ? En 1974, la Turquie membre de l’OTAN avait envahi Chypre, pays indépendant au prétexte d’une tentative de coup d’État à Nicosie. La « communauté internationale », à savoir les États-Unis et les pays européens n’avaient pas bougé. Cela fait 48 ans que ce pays est coupé en deux et ce n’est pas près de changer. Cette durée montre le basculement auquel nous allons être confrontés avec les décisions de Vladimir Poutine. Basculement qui va complètement structurer ce qui va se passer dans cette partie du monde.
Vududroit.com
https://www.vududroit.com/2022/02/crise-ukrainienne-la-ge...
Vladimir Poutine : un coup plus loin
L’intervention militaire russe en Ukraine constitue une surprise et il est nécessaire d’apporter quelques compléments à l’article que nous avons publié il y a deux jours. Nous entrons probablement dans une phase d’accélération comme l’Histoire en a toujours connu. Mais qui plonge justement dans un inconnu difficilement prévisible
Vududroit.com
https://www.vududroit.com/2022/02/vladimir-poutine-un-cou...
SANTÉ/MENSONGES/LIBERTÉ
Covid, vaccins, omicron : questions sans réponses
Il y a 10 jours, dans un billet sur omicron et l’Afrique du Sud qui sortait de sa vague, je signalais quelque chose qui me paraissait anormal, à confirmer avec le temps. C’est maintenant confirmé. Cette chose, ce sont des décès anormaux, surtout tardifs. Non seulement ce qui semblait pointer est confirmé pour l’Afrique du Sud, mais cela apparaît dans des pays comme la France et Israël…
Covid-factuel.fr
https://www.covid-factuel.fr/2022/02/20/covid-vaccins-omi...

Viral 2 / L'immunité face au Covid façon Olivier Veran
Mise en œuvre cette semaine, la modification des conditions d'attribution du pass vaccinal devrait conduire des millions de Français à s'en voir privés, faute de rappel et en application de la nouvelle doctrine immunitaire d'Olivier Véran. Il l'a présentée sur BFM TV le 2 février en répondant à la question d'une certaine Sabrina qui lui demandait quelle publication scientifique justifiait de réduire le délai entre deux doses de vaccins de 6 à 4 mois pour l'octroi du précieux sésame. En guise de réponse, le ministre a déclaré que notre système immunitaire se devait d'être « stimulé au moins trois fois », soit par une infection au covid, soit par une injection vaccinale. Car « une infection égale une injection », affirmait-il, après avoir précisé qu'il faudrait tout de même « au minimum une dose de vaccin » ?!
Blast-info.fr
https://www.blast-info.fr/articles/2022/viral-2-limmunite...
Les géants de la Big Tech s’apprêtent à dégrader davantage notre système de santé
« C’est comme Uber, mais pour les infirmières. » Cela vous effraie ? Ça devrait. Les hôpitaux privés conjuguent de plus en plus leurs forces avec la Silicon Valley afin de rendre le système de santé américain encore plus opportuniste.
Les-crises.fr
https://www.les-crises.fr/les-geants-de-la-big-tech-s-app...
Père Castex raconte nous des histoires
Nous allons vérifier les propos de Père Castex avec des données publiques provenant de l’État. L’exploit était pourtant de taille. Comment faire tenir 6 contradictions dans un seul discours de 20 minutes ? Défis pourtant réussis haut la main par Jean Castex dans son discours du 20 janvier 2022. Il faut dire qu’il a commencé très fort avec des phrases invraisemblables comme « la levée des restrictions […] à la faveur du pass vaccinal », alors que le pass vaccinal est une restriction. Ou encore « le variant omicron est beaucoup plus dangereux, mais moins sévère que ses prédécesseurs ». Une très remarquable et implacable vidéo.
Contrepoints.org
https://www.contrepoints.org/2022/02/21/422020-pere-caste...
CONSEIL de l'EUROPE
Le Conseil de l’Europe propose d’enseigner l’histoire de “l’islam d’Europe”
Le Conseil de l’Europe propose d’enseigner l’histoire de “l’islam d’Europe”, de renforcer la participation politique des communautés musulmanes, de satisfaire leurs exigences religieuses… C’est une « pépite » qu’a dévoilé le site Fdesouche, et qui montre encore une fois tout le gouffre qui sépare les technocrates de Bruxelles des populations européennes. Dans un document (voir ici) daté du 1er mars 2022, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe a dressé un état des lieux et émis 60 recommandations pour lutter contre le “racisme antimusulman” à l’attention des 47 États membres du Conseil de l’Europe.
Breitz-info.com
https://www.breizh-info.com/2022/02/25/180555/le-conseil-...
11:47 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, europe, france, médias, journaux, presse |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 février 2022
Katechon et Antikeimenos, la bataille géopolitique et spirituelle

Katechon et Antikeimenos, la bataille géopolitique et spirituelle
Lorenzo Maria Pacini
Source: https://www.geopolitica.ru/it/article/katechon-e-antikeimenos-la-battaglia-geopolitica-dello-spirito
Il ne s'agit pas d'une guerre qui a commencé en Ukraine il y a quelques heures, ni d'une vicissitude parmi d'autres vicissitudes entre deux nations qui sont déjà en conflit depuis des années. Nous assistons à un affrontement plus général entre deux visions du monde: d'une part, la vision postmoderne, techno-fluide, de l'empire matériel, de la démocratie importée à coup de bombes, des droits de l'homme et des révolutions de couleur qui se révèlent tyrannie, de big tech et de big pharma, de la destruction des identités et de l'assujettissement des masses aux élites du pouvoir oligarchique, soit le Great Reset ; d'autre part, la vision qui affirme l'autodétermination, la liberté, les identités de chaque peuple, la Tradition, les droits fondés sur l'ontologie, l'indépendance financière et la politique visant le bien commun, le Grand Réveil. Il s'agit d'un affrontement apocalyptique, intrinsèquement eschatologique, et ne pas comprendre la portée métaphysique de cette bataille revient à ignorer le cœur de ce qui est là, devant nous, en train de se passer.
Il ne s'agit pas, répétons-le, d'une guerre de simples intérêts, avec d'un côté l'Occident atlantiste qui tente, comme il l'a toujours fait, d'étendre son empire et d'écraser les peuples libres, actuellement représentés par la Russie en tant que leader d'un petit reste dans le monde ; nous ne sommes pas non plus simplement confrontés à deux visions politiques, l'une de la tyrannie libérale et l'autre du national-socialisme démocratique ; nous nous trouvons à un carrefour évolutif pour l'ensemble de l'humanité, une étape qui marque déjà une prise de position et un profond discernement entre ceux qui soutiennent et alimentent l'involution de la grande réinitialisation mondialiste et ceux qui, au contraire, sont les pionniers d'un monde nouveau qui jaillira de l'éveil global des consciences.

La confusion méphistophélique avec laquelle on communique sur ce qui se passe est si grande qu'elle laisse désorienté, mais cela aussi est utile, car seuls les esprits les plus fins parviennent à passer à travers les mailles de ce filet qui sépare l'ivraie du bon grain. C'est plutôt avec le cœur qu'il faut décider quel côté prendre, car ce n'est qu'à travers le cœur que le monde peut changer.

La Russie est actuellement le rempart contre l'hégémonie de l'Occident perverti, qui a trahi ses origines, sa Foi, qui a subjugué la majorité du monde par la violence, les guerres ouvertes et secrètes, la colonisation culturelle et militaire. Avec les autres États qui n'ont plié devant aucun maître politique et qui ont préservé leur identité et leur tradition, il existe une lumière venue d'Orient qui, dans l'effondrement de la dualité de ce monde, agit comme un contrepoids dans l'histoire et nous demande de choisir un camp. Ex oriente lux, disaient les anciens, et c'est précisément ce salut préconçu que nous pouvons reconnaître allégoriquement dans ce moment tragique.
Soyons clairs : la guerre n'est pas le moyen de faire la paix. Pas de guerre, d'aucune sorte. La guerre est un acte qui ne peut engendrer autre chose que la guerre, avant ou après, appelant la vengeance dans le sang même des peuples qui la font et qui la subissent. Ce n'est pas en alimentant davantage cette gigantesque monstruosité que le monde changera, quel que soit le camp dans lequel on décide de se placer. Ce que nous nourrissons vit, donc si nous continuons à nous faire la guerre, le monde ne peut être que guerre.
Or, c'est précisément par le biais de conflits à l'échelle mondiale que, selon les récits eschatologiques des différentes religions, s'établit d'abord le règne du Mal, puis triomphe le règne du Bien ; ce n'est que par l'effondrement total de ce monde tel que nous l'avons construit qu'il sera possible d'en bâtir un nouveau.
Tout ce qui a été prédit doit s'accomplir, c'est pourquoi nous sommes au milieu d'un conflit d'époque, inévitable pour le passage entre deux époques et deux mondes comme celui que nous traversons. C'est la bataille des Katechon contre les Antikeimenos (leurs adversaires qui s'exaltent et se révèlent "accélérationnistes" et eschtologistes, ndt), et les destins sont déjà écrits dans l'un ou l'autre camp.
19:32 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : katechon, religion, théologie, théologie politique, tradition, traditionalisme, philosophie, antikeimenos |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La crise ukrainienne et l'Occident: la dimension idéologique

La crise ukrainienne et l'Occident: la dimension idéologique
Alexandre Douguine
Source: https://www.geopolitica.ru/en/article/ukrainian-crisis-and-west-ideological-dimension
La crise autour des événements d'Ukraine a des dimensions à la fois géopolitiques et idéologiques. Dès le début de l'aggravation de la situation aux frontières orientales de ce pays, diverses forces politiques aux États-Unis et en Europe ont évalué différemment le déroulement des événements. Les libéraux et les mondialistes ont soutenu Kiev, les représentants d'autres mouvements idéologiques ont adopté une position plus favorable à la Russie. Le début des hostilités à grande échelle contre le régime actuel de Kiev de la part jouée par la Russie a provoqué diverses réactions : de l'hystérie de la part des libéraux, à la condamnation avec un appel à entamer immédiatement un dialogue de la part des conservateurs.
Pôle libéral : bataille idéologique
Indépendamment du pays, les partisans les plus zélés de "l'indépendance ukrainienne" ont été les libéraux et les mondialistes. Pour eux, le conflit ukrainien est une confrontation entre la Russie "autoritaire" et l'"Ukraine démocratique". Pour le célèbre pseudo-historien gay et transhumaniste israélien Yuval Noah Harari, la résolution de "la question fondamentale de l'avenir de l'histoire et de l'avenir de l'humanité" dépend de l'Ukraine. Selon le pseudo-philosophe libéral français Bernard-Henri Lévy, l'Occident devrait déclarer au moins une "guerre froide" à la Russie.
Francis Fukuyama, l'un des chefs de file des néoconservateurs, Bill Kristall, et d'autres intellectuels libéraux, tant aux Etats-Unis qu'en Europe, ont lancé des appels pour imposer des sanctions immédiates et sévères contre la Russie avant même le début de l'opération militaire du 24 février. Leur point de vue est clairement exprimé dans l'un des articles de Francis Fukuyama: "L'Ukraine est aujourd'hui un État avancé dans la lutte géopolitique mondiale entre la démocratie et l'autoritarisme. Les Européens qui tiennent à la démocratie libérale pour eux-mêmes doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas être des spectateurs dans ce conflit. Les ambitions de Poutine vont bien au-delà de l'Ukraine ; il a clairement indiqué ces dernières semaines qu'il aimerait inverser les gains démocratiques européens réalisés depuis 1991 et créer une sphère d'influence russe dans l'ensemble de l'ancien Pacte de Varsovie. En dehors de l'Europe, les Chinois surveillent de près la réponse de l'Occident à cette crise, pesant leurs perspectives de réincorporation de Taïwan. C'est pourquoi la défense de l'Ukraine doit être d'une importance urgente pour tous ceux qui se soucient de la démocratie mondiale."

Cette partie de l'éventail politique préfère ne pas remarquer que la "démocratie" ukrainienne révèle des tons ultra-nationalistes. Ou, comme l'explique le politologue allemand Andreas Umland, ce processus de confrontation avec la Russie, fait que l'on passe rapidement à l'accusation de "fascisme" adressé à la Russie et à la comparaison de Poutine avec Hitler.
Pour les libéraux, le début d'une opération militaire russe en Ukraine exige une intervention occidentale immédiate, y compris une intervention militaire. En particulier, selon Francis Fukuyama : "Nous avons maintenant besoin de quelque chose de plus que des sanctions".
Le même point de vue est partagé par les dirigeants libéraux des États-Unis, du Canada et des pays d'Europe occidentale. Parmi les figures politiciennes, la position la plus anti-russe est occupée par les libéraux de gauche - les Verts européens. Ainsi, Yannick Jadot, le candidat des Verts à l'élection présidentielle française, a condamné les réactions plutôt "molles" d'Eric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon face à la décision de la Russie de reconnaître les deux Républiques du Donbass et a appelé à la défense de la "démocratie" en Ukraine.
La droite
Si les libéraux offrent un modèle clair pour comprendre ce qui se passe autour de l'Ukraine ("la démocratie contre l'autoritarisme", "le monde global de l'avenir" contre le "passé", "le progrès contre la régression"), il n'existe pas une telle interprétation à droite comme à gauche. La droite et la gauche populistes ont tendance à soutenir la Russie ou à adopter une position neutre, appelant au dialogue. La "droite" traditionnelle, en règle générale, s'aligne sur la position des libéraux.
Aux États-Unis, la crise ukrainienne a divisé le parti républicain
La plupart des républicains du Congrès ont soutenu la décision de Joe Biden d'imposer des sanctions à la Russie. Certains ont même loué les actions de Biden, comme le déploiement de plus de troupes américaines en Europe de l'Est pour renforcer les défenses de l'OTAN.

Mais des sections influentes de l'establishment républicain, dont le sénateur Josh Hawley, le présentateur de Fox News Tucker Carlson et le candidat au Sénat de l'Ohio J. D. Vance (photo), s'opposent à l'ingérence américaine en Ukraine. Ils soutiennent que l'extension de l'engagement américain dans l'OTAN est une erreur et que le président devrait plutôt se concentrer sur la lutte contre la Chine et la sécurisation de la frontière sud de l'Amérique.
L'ex-président Trump lui-même, commentant les décisions du président de la Russie, l'a qualifié de "brillant". "Oh, c'est merveilleux", a déclaré Trump à ce sujet. En même temps, l'homme politique n'a pas manqué de déclarer que déjà sous sa présidence, un tel développement des événements aurait été impossible. L'ancien président américain utilise la situation ukrainienne pour critiquer Joe Biden. Après le 24 février, la rhétorique de Trump n'a pas changé. De plus, pendant le début de l'opération militaire russe, alors que d'autres grandes chaînes de télévision américaines sonnaient l'appel, Douglas McGregor, un colonel retraité de l'armée américaine, qui a été nommé par Trump au poste d'ambassadeur des États-Unis en Allemagne, déclarait: "La première chose que nous devons faire est de reconnaître que le principal point de vue de Poutine - pas seulement son point de vue, mais aussi le point de vue du gouvernement russe, qu'ils défendent depuis 25 ans, est valable. Ils ne veulent pas de troupes américaines, de missiles et de troupes de l'OTAN juste de l'autre côté de la frontière dans l'est de l'Ukraine". Selon McGregor (photo, ci-dessous), les États-Unis devraient s'entendre avec la Russie sur la neutralité de l'Ukraine afin d'éviter tout conflit.

L'idéologue populiste américain Stephen Bannon a également évalué les actions de la Russie de manière plutôt positive. Selon lui, "la situation dans les régions orientales russophones de l'Ukraine, cette crise est créée à 100 % par les actions de l'administration Biden."
La droite propose également une évaluation idéologique de ce qui se passe. Pour les libéraux, la reconnaissance de la RPD et de la RPL, suivie du déploiement de troupes russes sur place, est un coup porté à l'ordre mondial libéral. Les conservateurs populistes américains évaluent les conséquences mondiales de ce mouvement de manière similaire, mais de manière positive.
Selon les mots du blogueur et commentateur conservateur populaire Steve Posobik, "C'est l'effondrement complet de l'ordre mondial néolibéral. C'est une situation où tout revient au modèle des sept civilisations de Sam Huntington. ... Il s'est avéré que les civilisations, les intérêts nationaux et le réalisme l'ont emporté".
Après le début de l'opération militaire en Ukraine, les médias et les commentateurs libéraux et néo-conservateurs ont commencé à persécuter Stephen Bannon, qui a parlé positivement de Poutine dans l'une des émissions avec le fondateur de Blackwater, Eric Prince.
Les données des sociologues montrent qu'à l'heure actuelle, l'électorat du parti républicain américain est le moins enclin à soutenir les aventures anti-russes de Biden. Ainsi, seuls 43 % des électeurs républicains ont soutenu les démarches de Biden visant à transférer des troupes américaines en Europe, contre 56 % des indépendants et 70 % des démocrates, selon un sondage de l'université Quinnipiac. Pour une partie importante de l'électorat du Parti républicain, les problèmes internes sont importants, pas une crise dans une autre partie du monde.
En France, la position la plus "anti-russe" sur le flanc droit a été prise par Valérie Pécresse, une candidate du parti républicain de droite. Elle s'est en fait ralliée à la position du président libéral Emmanuel Macron, qui prône à la fois la pression sur la Russie et le dialogue avec elle. "Il faut avoir un vrai dialogue avec la Russie, et je soutiendrai ce dialogue, mais ce n'est pas un dialogue de soumission aux positions russes", a déclaré Mme Pécresse. Après le début de l'opération militaire en Ukraine, la candidate a déclaré sa "pleine solidarité" avec l'Ukraine et a proposé de prendre des "mesures sévères" contre la Russie.
Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, a qualifié la décision du président Poutine d'"acte extrêmement regrettable" mais a déclaré que "tout doit être fait pour retrouver la voie du dialogue afin d'assurer la paix en Europe". Elle prône le retrait des troupes russes du Donbass, mais la reconnaissance de la Crimée comme étant russe.
Après le début de l'opération militaire de la Russie en Ukraine, la position de Mme Le Pen n'a pas changé. Elle prône le retrait des troupes russes et l'ouverture d'un dialogue avec Moscou. Selon elle, la France devrait prendre l'initiative d'organiser une réunion diplomatique sous l'égide de l'ONU avec la participation des États-Unis, de la Russie, de l'Ukraine, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, ainsi que de la Pologne, de la Roumanie, de la Hongrie et de la Slovaquie, États limitrophes de l'Ukraine,
A son tour, Eric Zemmour, parlant de positions similaires à celles de Donald Trump, critiquant les actions de la Russie, a noté que l'OTAN et la politique d'expansion de l'alliance contre les intérêts de la Russie sont à blâmer pour la violation des frontières de l'Ukraine.
En général, la position de Zemmour n'a pas changé depuis le 24 février. Selon lui, la France devrait initier un accord de l'OTAN avec la Russie pour arrêter l'expansion de l'alliance.
En général, la position de la partie droite des populistes français est à retenir. La condamnation rituelle de la Russie est compensée par des déclarations sur la nécessité d'un dialogue.
En Allemagne, le parti populiste de droite "Alternative pour l'Allemagne" (AfD) s'est initialement prononcé en faveur des actions de la Russie. Le leader de l'AfD, Tino Chrupalla (photo, ci-dessous), a souligné que les résidents de la DPR et de la LPR ont le droit de décider eux-mêmes à quel pays ils appartiennent.

Dans une déclaration au nom du parti, l'AfD a toutefois déclaré qu'il exprimait des "regrets" quant aux développements actuels. La situation actuelle est une conséquence de "l'expansion de l'OTAN vers l'est, qui a été promue contrairement à tous les accords avec Moscou". Ainsi, l'Occident a "violé les intérêts légitimes de la Russie en matière de sécurité." À son tour, le politicien berlinois de l'AfD, Gunnar Lindemann (photo, ci-dessous), a posté des feux d'artifice sur Twitter en l'honneur de la reconnaissance des républiques populaires par la Russie.

L'opération militaire de la Russie en Ukraine a été condamnée par l'AfD : Alice Weidel, chef de la faction au Bundestag, et Tino Chrupalla ont déclaré que "la Russie doit immédiatement arrêter les hostilités et retirer ses troupes d'Ukraine."
En Italie, le chef du parti de la Ligue, Matteo Salvini, a condamné la "violation" des frontières de l'Ukraine, mais s'est opposé à l'imposition de sanctions contre la Russie.
La gauche
En France, la plupart des candidats de gauche à la présidentielle se sont manifestés pour condamner les actions russes dans le Donbass. Ainsi, Christiane Taubira, ex-ministre de la Justice, a déclaré que "La solidarité des États européens avec l'Ukraine ne doit pas faiblir", le chef du Parti communiste français (PCF) Fabien Roussel a souligné que : "La reconnaissance par le Président de la Russie de l'indépendance des deux républiques séparatistes d'Ukraine est une décision extrêmement grave et dangereuse ! Tout doit être fait pour désamorcer cette guerre qui s'embrase aux portes de l'Europe !
Les mêmes politiciens ont condamné l'opération militaire de la Russie en Ukraine.
Même Jean-Luc Mélenchon, le leader du mouvement populiste de gauche France Insoumise, qui avait auparavant une attitude positive envers la Russie, a déclaré que "quoi que l'on pense des arrière-pensées ou de la logique de la situation, néanmoins, c'est la Russie qui a pris la responsabilité de cet épisode".
Le 24 février, l'homme politique de gauche a condamné le recours à la force par la Russie et a appelé à la mobilisation des forces de défense de l'UE et de la France. Selon lui, la France devrait promouvoir un dialogue pacifique.
En Allemagne, le parti de gauche a déclaré qu'il condamnait unanimement les actions de la Russie comme étant contraires au droit international. Dans une déclaration commune, les dirigeants du parti et du groupe parlementaire Susanne Hennig-Wellow, Janine Wissler, Amira Mohamed Ali et Dietmar Bartsch ont accusé le président russe de reconnaître les "républiques populaires" de Louhansk et de Donetsk et perçoivent l'"invasion" y associée des troupes russes en Ukraine comme étant "contraires au droit international, violant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine et augmentant le danger d'une guerre majeure en Europe". Ces gauchistes patentés exigent le retrait des troupes russes du Donbass. Sevim Dagdelen et Gregor Gysi, des députés de gauche du Bundestag qui ont précédemment exprimé des positions pro-russes et accusé l'OTAN d'alimenter le conflit en Ukraine, ont appelé à prévenir une guerre entre la Russie et l'OTAN. Dans le même temps, Mme Dagdelen (photo, ci-dessous) a accusé la Russie de violer le droit international.

Bien que Gysi et Dagdelen soient opposés aux sanctions contre la Russie, le parti compte de fortes voix de gauche qui accusent la Russie d'un chauvinisme et d'un nationalisme de grande puissance et qui soutiennent l'approche libérale qui veut des sanctions.
Sarah Wagenknecht, une représentante de l'aile populiste de la gauche, a également condamné les actions de la Russie, les qualifiant de "violation claire des accords de Minsk".
Le 24 février, Die Linke a publié une déclaration officielle affirmant que "le bombardement et l'invasion des troupes russes en Ukraine constituent un nouveau niveau d'agression de la part de Poutine, que nous condamnons dans les termes les plus énergiques possibles".
En Italie, le ministre des affaires étrangères du parti populiste de gauche "5 étoiles", Luigi Di Maio, a condamné la Russie, appelant à des sanctions "proportionnelles" contre la Russie.
Libéralisme contre réalisme
En général, aux États-Unis et dans les pays européens, les populistes de gauche et de droite sont plus susceptibles d'agir à partir de la position consistant à "comprendre" les actions de la Russie et à promouvoir le dialogue avec elle, plutôt que de soutenir carrément ses actions. Les positions des parties "gauche" et "droite" du spectre populiste dans cette situation dans chaque pays sont pratiquement similaires, à l'exception des Etats-Unis, où il n'existe pas de pôle populiste sérieux au sein du parti démocrate. Aux États-Unis également, les populistes considèrent le plus ouvertement que la crise du Donbass "ne regarde pas les États-Unis".
En Europe, à son tour, parmi les pays qui ont un impact sérieux sur l'agenda international, c'est au Royaume-Uni que l'éventail politique est le plus uni sur des bases anti-russes. Il n'y a pas non plus de structures populistes sérieuses dans la politique de ce pays. Plus ou moins proches de la position des populistes continentaux sont les idées de Nigel Farraj, l'ancien chef du UK Independence Party (UKIP), qui considère qu'il faut adopter un moratoire sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et ne pas surenchérir l'hystérie sur "l'invasion" de l'Ukraine par la Russie.
En général, malgré la condamnation rituelle de la Russie, les forces populistes, de gauche comme de droite, considèrent la crise sous l'angle de la théorie du réalisme dans les relations internationales (RI). Pour eux, elle n'a pas de contenu idéologique, et malgré la différence d'intérêts possible, le dialogue avec la Russie est possible, même s'ils ne saluent pas les actions militaires de Poutine. Les libéraux (y compris les libéraux de droite et de gauche) comprennent le conflit ukrainien différemment : tout d'abord, comme une confrontation idéologique (la théorie libérale des RI), qui exclut tout dialogue.
En général, on s'attend à une pression informationnelle massive à court terme, peut-être même à des tentatives d'engager des poursuites pénales sous des prétextes farfelus contre des populistes de gauche et de droite dans les pays occidentaux. Les libéraux utilisent la situation en Ukraine pour faire pression sur leurs rivaux. Ce faisant, ces rivaux seront également contraints de s'adapter au discours anti-russe ambiant. Cependant, les éventuels succès de la Russie et les échecs et gaffes des gouvernements libéraux de l'Occident, au contraire, apporteront des arguments aux mouvements et dirigeants populistes qui insistent sur une vision réaliste de la politique mondiale. Dans une large mesure, l'alignement politique des pays occidentaux dépendra des perspectives de l'opération militaire russe en Ukraine.
19:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, idéologies politiques, partis politiques, europe, ukraine, russie, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Afghanistan: Une frontière sans "date de péremption"
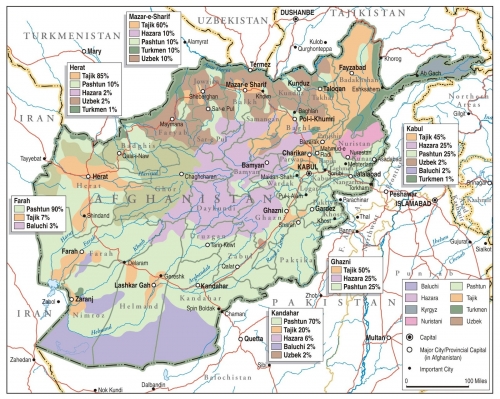
Afghanistan: une frontière sans "date de péremption"
Victor Dubovitsky
Aujourd'hui, le mot Afghanistan est sur toutes les lèvres, même pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout aux affaires internationales, et encore moins à la politique : nous avons assisté à une défaite trop inattendue et trop honteuse pour ce pays que sont les Etats-Unis, et pour l'"Occident uni". La défaite des forces britanniques lors de la première guerre anglo-afghane (1838-1842) a peut-être été bien plus dévastatrice, mais l'absence d'Internet et de télévision a sauvé les Britanniques de la honte. Cependant, Jalalabad (où le seul survivant des 16.000 hommes de la garnison de Kaboul, l'Anglais William Bryden, est parvenu le 13 janvier 1842), ainsi que le passage de Khyber tout proche, étaient et sont des lieux largement connus à l'époque et aujourd'hui : mais au 19ème siècle, les intérêts de Kaboul et d'Islamabad s'opposaient.
Échappée d'une "pension honoraire"
L'histoire des revendications mutuelles, qui font aujourd'hui trembler la frontière afghano-pakistanaise, a commencé pendant l'hiver 1879, curieusement à plus d'un demi-millier de kilomètres de Kaboul - dans le Turkestan russe. Le mardi 9 Muharram, 1297 de l'Hégire, ce qui correspond au 11/23 décembre 1879, quatre cavaliers sont partis de Samarkand vers l'est - vers la vallée de Fergana. Les chevaux turkmènes Argamaks-Akhalteke aux jambes fines transportaient le prétendant au trône de l'émir d'Afghanistan (Abdurahman Khan / photo ci-dessous) et ses plus proches associés dans l'obscurité hivernale qui précédait l'aube. Cet événement, peu remarqué par les personnes non informées, a marqué le début d'une nouvelle phase dans l'histoire de ce pays.

Le départ de l'héritier du trône, âgé de trente-cinq ans, qui vivait avec sa famille depuis plus de dix ans dans une "pension de famille honoraire", gérée par les autorités russes en Asie centrale, a été mis en scène comme une évasion : il fallait endormir la vigilance des "marins éclairés", qui craignaient l'apparition en Afghanistan d'un prétendant au trône populaire, mais indésirable pour eux. Pour la Russie, l'arrivée au pouvoir à Kaboul d'un "retraité honoraire" était extrêmement importante : lorsqu'en novembre 1879, la nouvelle de la déposition de l'émir Muhammad Yaqub Khan est arrivée d'Afghanistan, il est devenu clair en Russie que les Britanniques entendaient gérer le démembrement de l'Afghanistan. Leur prochaine étape aurait été d'envoyer leurs mandataires dans les provinces indépendantes et semi-indépendantes de Kunduz, Darwaz et Badakhshan, ou (ce qui était particulièrement indésirable) de tenter une occupation directe de ces terres.
La position de la Russie en Asie centrale et de son allié, le khanat de Boukhara, aurait alors été menacée. N'aurait-il pas été préférable d'écarter les rivaux les plus dangereux d'"Albion" et de placer à la tête de ces régions un homme qui avait bénéficié de l'hospitalité russe pendant dix ans ? Car le descendant direct des émirs d'Afghanistan - Abdurahman Khan - avait le droit de revendiquer le pouvoir au moins dans les territoires du nord de la rive gauche de l'Amu Darya, portant le nom commun de Chor-Viloyat.
Lorsqu'il prend le pouvoir à Kaboul au printemps 1880, il mène une politique très indépendante, annexant de vastes territoires par le feu et l'épée. Le nouvel émir a définitivement considéré toutes les terres peuplées de Pachtounes comme des territoires inféodés à sa personne. Mais l'est du Pachtounistan ("pays pachtoune"), d'une superficie d'environ 150.000 kilomètres carrés, qui faisait partie de l'empire Durrani jusqu'en 1819, a été conquis par les souverains sikhs du Punjab, puis par les Britanniques après l'effondrement de leur empire. Dans cette situation, la réaction de Londres n'était pas difficile à prévoir : l'indépendance dont a fait preuve l'ancien "retraité" a obligé "Foggy Albion" à soulever la question d'une frontière bien définie entre l'Afghanistan et la plus grande des colonies britanniques.
L'Indian Bureau of Surveying (une organisation servant à des opérations de reconnaissance plutôt qu'à organiser des expéditions scientifiques) s'est rapidement saisi de l'affaire, envoyant des équipes de géomètres militaires au Pachtounistan. À l'automne 1893, les cartes anglaises ont révélé une ligne brisée complexe s'étendant sur 2670 km (1660 miles), et 12.000 km (7460 miles). Le 12 novembre 1893, un traité entre l'émir afghan, Abdurahman Khan, et le secrétaire aux affaires étrangères de l'administration coloniale britannique, Lord Henry Mortimer Durand, a établi une nouvelle frontière qui est devenue internationalement connue sous le nom de ligne Durand.

Il est difficile de dire à ce stade ce qui a poussé l'énergique émir afghan à accepter une telle frontière, qui divisait le Pashtunistan dans son intégralité. Cependant, connaissant les réalités politiques de la fin du 19ème siècle, on peut très probablement supposer qu'il considérait cette frontière comme une ligne temporaire balisant son autorité territoriale (le "mouvement frontalier" constant en Afghanistan dans toutes les directions, de Herat et Kattagan aux Pamirs, en est la confirmation). Cela est indirectement indiqué par le fait que les autorités afghanes ultérieures n'ont pratiquement jamais reconnu la ligne Durand comme une frontière d'État légitime. Néanmoins, les réalités politiques du Moyen-Orient ont changé de manière spectaculaire avec l'apparition de cette frontière : un État doté d'une frontière légale en vertu du droit européen est apparu entre l'Inde britannique (c'est-à-dire la Grande-Bretagne) et l'Empire russe. À l'époque, il semblait peu important qu'il n'y ait aucune démarcation nulle part - les bornes pourraient être établies encore plus tard. Ainsi, le "retraité honoraire" avait accompli sa tâche.
Un héritage scandaleux
Aujourd'hui, il existe douze provinces afghanes (Nimroz, Helmand, Kandahar, Kabul, Paktika, Khost, Paktia, Logar, Nangarhar, Kunar, Nuristan et Badakhshan) et trois unités administratives afghanes (province du Baloutchistan, province de Khyber Pakhtunkhwa et région du Gilgit-Baltistan) qui se trouvent le long de la ligne Durand du côté pakistanais (parties de l'ancienne Inde britannique). Sur le plan géopolitique et géostratégique, la "ligne" proverbiale est l'une des frontières les plus dangereuses au monde.
En juillet 1949, l'Afghanistan a officiellement déclaré qu'il ne reconnaissait pas la ligne Durand ; depuis lors, pas un seul gouvernement afghan, y compris même le régime des Talibans, lié au Pakistan, n'a osé le faire. Ainsi, la question de la frontière entre l'État afghan et le Pakistan, qui reste à ce jour la plus aiguë dans les relations entre les deux pays, a également été "suspendue". Les Pachtounes, qui ont dirigé l'Afghanistan pendant presque toutes les périodes de son histoire, sont animés par le désir tenace de réunir toutes leurs tribus en un seul État (le projet du "Grand Pachtounistan") ; ce facteur, quelles que soient les circonstances, persistera, entretenant la suspicion et la méfiance dans les relations afghano-pakistanaises.
Le Pakistan, quant à lui, a été et reste inflexible sur le fait que l'Afghanistan doit reconnaître le traité de la ligne Durand qu'il a signé il y a plus d'un siècle et respecter la frontière entre les deux pays. Islamabad ignore ainsi la revendication des Afghans selon laquelle la frontière tracée par les Britanniques pendant la période de domination coloniale a de facto privé l'Afghanistan de l'ensemble de ses terres ancestrales pachtounes sous contrôle pakistanais. Ces approches diamétralement opposées de la frontière ne pouvaient que conduire à une confrontation politique (et sporadiquement militaire) entre Kaboul et Islamabad.
En 1976, le président afghan de l'époque, Sardar Mohammed Daud Khan, a reconnu la ligne Durand comme la frontière internationale entre le Pakistan et l'Afghanistan. Il a fait cette déclaration, qui a gravement porté atteinte à sa réputation dans son pays, lors de sa visite officielle à Islamabad.
Après le retrait soviétique d'Afghanistan et, par la suite, la chute du gouvernement laïc du pays (effectivement à partir de l'automne 1994), on a assisté à une augmentation de l'aide apportée aux Talibans par les forces armées, les services de renseignement et les agences de sécurité du Pakistan. L'organisation islamique militante, fondée par les services de renseignements militaires pakistanais, contrairement à l'Alliance des Sept, créée pour combattre les Soviétiques, était inconditionnellement subordonnée aux Pakistanais. Après l'entrée des combattants talibans dans Kaboul (fin septembre 1996), Islamabad a tenté de servir de médiateur entre les dirigeants talibans et leurs opposants.
En 1996, le Pakistan a immédiatement reconnu le gouvernement formé par les talibans à Kaboul. Il s'est avéré être le premier et le seul gouvernement dans l'histoire de l'Afghanistan à trouver son soutien total. Le gouvernement taliban a essentiellement agi sous la dictée des dirigeants militaires et politiques pakistanais, qui cherchaient à renforcer leur position stratégique dans la région.

Il convient de noter que la transformation du territoire pakistanais en un refuge pour les groupes armés afghans a créé des problèmes aigus pour Islamabad lui-même. La crise de 1979-1989 (associée à la présence des troupes soviétiques en Afghanistan, puis à l'intensification des opérations des moudjahidines contre le gouvernement du président Najibullah) a créé un ensemble de problèmes pour le Pakistan qui a considérablement compliqué la situation intérieure du pays. Les tendances négatives qui ont alors émergé persistent à ce jour. Les déchirements ethniques, tribaux et sectaires ne s'arrêtent pas d'un coup au Pakistan. Les sunnites tuent les chiites et les membres de la secte Ahmadiyya. En conséquence, le rêve des pères fondateurs du Pakistan, Mohammad Ali Jinnah et Alam Iqbal, est plus insaisissable que jamais.
Changement de vecteur ?
Les relations du Pakistan avec l'Afghanistan voisin sont restées très tendues depuis le renversement du régime taliban en 2001. La question non résolue de la frontière coloniale est restée une pierre d'achoppement dans les relations bilatérales. Compte tenu de l'ouverture de la frontière et de la possibilité de circuler librement dans les deux sens, les autorités afghanes pro-occidentales ont souvent accusé leurs homologues pakistanais d'être de connivence avec l'infiltration de combattants sur le territoire afghan (qui, selon elles, est l'une des principales causes de la déstabilisation constante de l'Afghanistan), et parfois de la favoriser. De leur côté, les autorités pakistanaises ont déclaré que ces affirmations étaient grotesques. En particulier, Kaboul a vivement critiqué les accords de trêve conclus en 2005-2006 par Islamabad avec les talibans locaux au Sud et au Nord du Waziristan, ainsi que les accords similaires conclus au printemps 2008. Du point de vue des autorités afghanes, ces manœuvres politiques ont permis aux talibans de gagner du répit et de regrouper leurs forces. Il y a eu de plus en plus de cas où le Pakistan a été ouvertement accusé de soutenir directement les talibans opérant en Afghanistan afin d'influencer directement le cours de la situation et de l'utiliser dans le sens des intérêts d'Islamabad.
Enfin, le mois d'août 2021 est arrivé et les talibans soutenus par le Pakistan ont pris le pouvoir, transformant l'État islamique d'Afghanistan en Émirat d'Afghanistan. Les nouveaux maîtres de Kaboul, malgré les nombreuses années d'aide d'Islamabad à leur mouvement, sont restés inflexibles sur la non-reconnaissance de leur frontière orientale. Le fait qu'ils aient vaincu un Occident uni leur a également donné confiance. Commençant par la démolition de poteaux frontaliers et de clôtures en fil de fer, ils sont rapidement passés à la destruction de postes frontières, puis à des fusillades.
Les reportages sur les affrontements armés le long de la ligne Durand, non seulement dans la ceinture pachtoune mais aussi dans la ceinture baloutche du sud, ont abondé pendant l'hiver 2021-2022. Des dizaines de soldats pakistanais et de combattants de l'Armée de libération du Baloutchistan étaient déjà en train de se mobiliser. Cela signifie que non seulement le Pakistan et l'Afghanistan, mais aussi l'Iran, étaient en difficulté. La question du "Grand Baloutchistan", éclipsée par le conflit afghan depuis trente ans, devient un véritable problème pour les trois États à la fois.


Il y a trois ou quatre mois, les propagandistes pakistanais faisaient, dans tous les sens du terme, l'éloge des talibans afghans et se réjouissaient activement de leur retour au pouvoir à Kaboul. Aujourd'hui, les utilisateurs pakistanais des médias sociaux sont de plus en plus désillusionnés par leurs "amis talibans", car le boomerang du djihad qu'Islamabad a lancé plus tôt contre Kaboul semble revenir à son point de départ. Par exemple, les attaques contre les forces de sécurité pakistanaises et les fonctionnaires civils se produisent presque quotidiennement dans les districts du Sud et du Nord du Waziristan depuis des mois. Les principaux responsables sont les militants du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un parti affilié aux talibans afghans, également interdit en Russie. Les terroristes talibans pakistanais ont attaqué des barrages routiers et des véhicules appartenant à l'armée pakistanaise et aux agences de renseignement.


Les militants ont de plus en plus recours à la tactique du sniper, utilisant des armes de fabrication occidentale abandonnées dans la panique du départ des Américains et des Britanniques. Le nombre de victimes parmi les militaires, les policiers et les civils dans le Pachtounistan pakistanais est devenu si élevé que les autorités officielles ont classé ces statistiques. On estime qu'au moins vingt membres du personnel de sécurité pakistanais sont tués chaque mois dans la seule région de Khyber Pakhtunkhwa. Les tentatives d'Islamabad (l'officiel) de négocier la paix avec les talibans pakistanais ont échoué, malgré la médiation active du réseau Haqqani, la faction dominante au sein des talibans afghans qui entretient des liens étroits avec l'ISI du Pakistan.
Plus récemment, l'armée pakistanaise a tenté d'attaquer les chefs de "leurs talibans" qui se cachent dans la province de Kunar, dans l'est de l'Afghanistan, à l'aide de drones, mais avec apparemment peu de succès. Dans le même temps, les attaques du Pakistan contre les colonies afghanes ont suscité des réactions de plus en plus négatives, voire agressives, de la part de nombreux combattants et commandants de terrain des talibans afghans. Ces derniers sont déjà ouvertement favorables à l'idée de "poursuivre le djihad" par son "transfert" de l'Afghanistan au Pakistan.
Un tel niveau de gâchis suggère qu'une véritable guerre est en train de prendre de l'ampleur dans les provinces pakistanaises du Baloutchistan et de Khyber Pakhtunkhwa. Elle est menée contre l'armée et le gouvernement pakistanais par les militants du TTP ainsi que par les partisans de la lutte armée pour l'indépendance du Baloutchistan, qui ont réussi à établir une infrastructure arrière dans les zones frontalières du Pakistan en Afghanistan et en Iran.
Certains analystes politiques estiment même que dans les prochaines années, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan n'auront pas à s'inquiéter de la sécurité de leurs frontières : le vecteur d'agression du nouveau gouvernement de Kaboul s'est déplacé vers le sud-est. Il convient toutefois de rappeler que le Pakistan est un État défaillant typique, qui possède néanmoins des armes nucléaires. On peut se demander ce qui se passerait si un arsenal nucléaire tombait entre les mains de fanatiques religieux. En outre, une telle évolution entraînerait inévitablement dans le conflit les deux plus grands rivaux du sud de l'Eurasie, la Chine et l'Inde, qui possèdent également des armes nucléaires. L'adhésion commune de quatre des cinq rivaux à l'OCS va pimenter la situation géopolitique.
La Thalassocratie doit-elle être si satisfaite de la gabegie qu'elle a générée dans la région?
17:37 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ligne durand, afghanistan, baloutchistan, pakistan, waziristan, zones tribales, talibans, géopolitique, politique internationale, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La Russie entre dans une nouvelle phase de confrontation avec l'Occident

La Russie entre dans une nouvelle phase de confrontation avec l'Occident
Leonid Savin
Source: https://katehon.com/ru/article/rossiya-vstupaet-v-novuyu-fazu-protivostoyaniya-s-zapadom
La reconnaissance de la DPR et de la LPR, ainsi que l'opération de maintien de la paix en Ukraine, était nécessaire pour un certain nombre de raisons
La décision des dirigeants russes de reconnaître la DPR et la LPR était une mesure forcée et prévisible. Bien que près de huit ans se soient écoulés depuis les référendums organisés dans les anciens oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, cette reconnaissance par Moscou a suscité un soutien public non seulement dans les républiques déjà légitimées, mais aussi en Russie, au Belarus, en Serbie et dans plusieurs autres pays.
Kiev s'est rendu coupable non seulement d'une planification de génocide contre le peuple russe en Ukraine au fil des ans, mais aussi d'une glorification irrationnelle et stupide du nazisme et d'une politique étrangère clairement destructrice qui a inclus une militarisation outrancière avec l'aide des pays occidentaux, assortie de tentatives actives d'adhésion à l'OTAN.
Ces facteurs ont été fondamentaux dans la décision, bien que Moscou ait espéré jusqu'au dernier moment que l'Ukraine applique correctement les accords de Minsk. Cela ne s'est malheureusement pas produit, de sorte qu'un retournement contre l'Ukraine, comme celui de ces derniers jours, était tout simplement nécessaire. Principalement pour des raisons humanitaires.
Il faut également prêter attention à la situation stratégique qui s'est installée autour de l'Ukraine. Après le coup d'État de 2014, les dirigeants biélorusses, notamment, ont été fidèles au régime de Petro Porochenko, puis à celui de Vladimir Zelenski. Ce n'est qu'après une tentative de coup d'État similaire au Belarus même qu'Alexandre Loukachenko a commencé à mener une politique clairement pro-russe. Et à la veille de la reconnaissance de la DNR et de la LNR, un exercice militaire conjoint avec la Russie s'est tenu sur le territoire du Belarus. Les dirigeants biélorusses ont également annoncé leur intention d'acheter un certain nombre de systèmes d'armes de fabrication russe, notamment des avions de combat et des systèmes de défense aérienne.
Par conséquent, le rôle du Belarus dans l'opération conjointe de maintien de la paix est désormais très important. Kiev ne s'est pas seulement retrouvé sous un blocus économique de la part de la Russie et du Belarus. L'une des directions d'avancée vers Kiev a été choisie à partir de cette position stratégique.

Il est maintenant nécessaire d'examiner la procédure de reconnaissance de la RPD et de la RPL du point de vue du droit international. Déjà le 21 février, et même avant, alors que les politiciens occidentaux étaient hystériques à propos de l'"invasion" imminente de la Russie, les représentants du cartel néolibéral de l'OTAN parlaient d'une seule voix de la violation du droit international. Mais l'ont-ils fait ? Et qu'entendent-ils par droit international ?
Il suffit de rappeler que le bombardement de la Yougoslavie en 1999 et la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo ont violé les accords d'Helsinki sur l'inviolabilité des frontières politiques en Europe. Mais l'Occident n'y a pas prêté attention. Comme le droit de précédent s'applique en Occident, ces événements ont effectivement ouvert la voie à de telles actions.
Mais encore plus tôt, en 1994, les États-Unis ont envahi Haïti sous des prétextes fallacieux, alors qu'ils avaient reçu l'approbation des Nations unies. Cela a été relativement facile à faire dans le sillage immédiat de l'effondrement de l'URSS, surtout si l'on considère qu'à l'époque Andrei Kozyrev était ministre des Affaires étrangères et écoutait les instructions de Washington. L'administration de Bill Clinton a motivé sa décision d'occuper Haïti par la nécessité de protéger les citoyens américains dans ce pays.
Ces deux cas, et plus tard le bombardement de la Libye en 2011, sont connus sous le nom de doctrine de la responsabilité de protéger (R2P). Cette doctrine a été développée directement en Occident. Entre-temps, elle a été mise en œuvre à l'ONU en 2005 à la demande du Canada, qui l'avait rédigée en 2001 [i]. L'implication est que la souveraineté n'est pas seulement un droit, mais aussi une obligation. Et si certains gouvernements manquent à leur devoir de respecter les droits et libertés de leurs citoyens, ils doivent être punis.
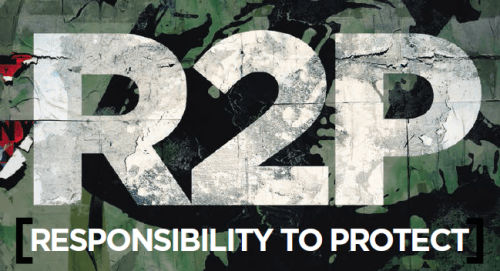
Une autre association apparaît avec la partition du Soudan. Le Sud-Soudan a obtenu son indépendance par un référendum en juillet 2011, qui faisait suite à un accord entre le gouvernement et les rebelles du sud [ii]. Le processus a été directement supervisé par des politiciens américains de haut rang, qui voyaient dans la partition un intérêt pour les États-Unis, notamment l'accès aux ressources pétrolières. De manière révélatrice, cette préoccupation de Washington n'a pas sauvé le Sud-Soudan - il a plongé dans une nouvelle guerre civile en 2013.

Une question légitime se pose : le gouvernement ukrainien a-t-il réussi à garantir les droits de la population russophone sur le territoire ukrainien depuis le coup d'État de février 2014 ?
Tout d'abord, le gouvernement lui-même peut difficilement être qualifié de légitime, car après le coup d'État, une alliance de néonazis et d'Occidentaux s'est lancée dans une politique d'intimidation et de chantage. Et les décisions prises par le parlement ukrainien après le 22 février 2014 ne peuvent être considérées comme des actes juridiques.
Deuxièmement, lorsque la polarisation politique a clairement mis en évidence les deux camps opposés, des tentatives ont-elles été faites pour résoudre pacifiquement les différends par le biais de négociations ? Non, la junte de Kiev a envoyé non seulement des unités des forces de l'ordre et des services spéciaux, mais aussi des formations militaires dans les régions qui défendaient leurs droits (notamment en parlant leur langue maternelle). Donetsk et Luhansk ont subi des raids aériens et des tirs d'artillerie.
Par conséquent, l'Ukraine, en tant qu'État, a perdu son droit à la souveraineté. Et lorsque la Russie vient protéger les civils dans un pays voisin dont la population est liée historiquement, culturellement et spirituellement par des traditions séculaires, elle a bien plus le droit de parler de "responsabilité de protéger" que les États-Unis et les pays de l'OTAN, qui ont envahi d'autres pays sous des prétextes farfelus. Enfin, ni la Yougoslavie, ni Haïti, ni l'Irak, ni la Libye, ne représentaient une menace existentielle pour les États-Unis. Mais l'Ukraine, transformée par l'Occident en un pays carrément hostile à la Russie, représente certainement une telle menace.
Nous avons donc affaire à deux poids, deux mesures. Et si l'on prête attention au fait que c'est à la Russie que l'Occident refuse de prendre la défense (on se souvient de la réaction à l'opération visant à contraindre la Géorgie à la paix en août 2008), alors cela suggère une certaine forme de racisme.
Après tout, il s'avère que ce sont les Russes qui ne sont pas autorisés à venir en aide à leurs compatriotes ou à d'autres peuples. C'est presque comme Orwell, où dans son œuvre "La Ferme des animaux", les cochons qui ont pris le pouvoir ont déclaré que tous les animaux sont égaux, mais que certains sont plus égaux que d'autres. Cela n'est pas explicitement indiqué, mais clairement sous-entendu.
De plus, les États-Unis refusent le droit non seulement de prendre la défense de ces populations harcelées, mais aussi de critiquer, de signaler les violations et d'établir des comparaisons - tout cela est déclaré faux par le département d'État américain, tandis que les satellites de Washington s'emploient activement à informer et à laver psychologiquement le cerveau de leur propre population et de la population russe par le biais d'agents étrangers, des médias sociaux et de divers programmes de subventions par le biais de missions diplomatiques.
La médisance des politiciens occidentaux à l'égard des pays non-occidentaux relève également clairement du double standard. Prenez, par exemple, le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a déclaré que la décision de Moscou de reconnaître la LNR et la DNR était inacceptable. "Nous appelons les parties à se laisser guider par le bon sens et à respecter le droit international", a déclaré le président turc [iii].
La présence de l'armée turque en Syrie et en Irak ne viole-t-elle pas le droit international? Ont-ils reçu une invitation des autorités de ces pays? Bien sûr que non. Et la situation en Chypre du Nord ne correspond clairement pas aux normes dont parle Erdogan.
À propos, pendant des décennies, la République de Chypre du Nord n'a été reconnue que par la Turquie pour des raisons évidentes. Et la DNR et la LNR ont déjà été reconnues non seulement par la Russie, mais aussi par la RCA. La Syrie, qui a déjà soutenu la décision du président Poutine, est la prochaine [iv]. Des reconnaissances officielles suivront sûrement de la part de la Biélorussie, du Venezuela et du Nicaragua, dont les dirigeants ont soutenu la décision de Moscou. Et aussi d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud.
Bien sûr, Erdogan est préoccupé par la question kurde, car la population kurde de Turquie augmente chaque année, ce qui entraînera inévitablement des déséquilibres politiques à terme. Mais Erdoğan lui-même mène plutôt dans son pays une politique répressive sous couvert de lutte contre le terrorisme, puisque le Parti des travailleurs du Kurdistan y est reconnu comme une organisation terroriste.
Toutefois, le rôle de la Turquie pourrait être plus destructeur en direction de l'Ukraine - où des drones de combat Bayraktar ont déjà été livrés, qui pourraient être utilisés contre les habitants du Donbass [v]. Et les combattants sans scrupules utilisés par la Turquie à Idlib en Syrie ou en Libye pourraient également se déployer après les Bayraktars [vi]. Au moins, la possibilité d'un tel scénario doit être envisagée. D'autant plus qu'il a déjà été fait état du recrutement de combattants de Bosnie-Herzégovine, d'Albanie et du Kosovo pour les envoyer en Ukraine [vii].
En résumé, on peut conclure clairement que la Russie est du bon côté de l'histoire. Il sera difficile de briser le blocus de l'information et de faire connaître la vérité aux citoyens d'autres pays, notamment ceux de la communauté euro-atlantique. Bien qu'il y ait là aussi des médias et des politiciens adéquats. Il sera également difficile de surmonter les nouvelles mesures de sanctions qui concernent la dette souveraine de la Russie et sa capacité à opérer sur les marchés occidentaux.
Mais, d'un autre côté, cela nous oblige à continuer à développer notre propre stratégie mondiale, où il n'y aura pas de place pour le totalitarisme occidental. Par conséquent, la reconnaissance de la DNR et de la LNR est un autre pas vers la multipolarité émergente [viii].
Sources:
[i] https://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.shtml
[ii] https://ria.ru/20210109/sudan-1591607931.html
[iii] https://www.forbes.ru/society/456553-erdogan-nazval-nepriemlemym-resenie-putina-priznat-dnr-i-lnr
[iv] https://ria.ru/20220221/siriya-1774191571.html
[v] https://www.mk.ru/politics/2022/02/21/eksperty-ocenili-ugrozu-ot-tureckikh-bayraktarov-na-donbasse.html
[vi] https://ru.armeniasputnik.am/20200122/Idlib-kak-zhertva-voenno-politicheskoy-avantyury-Turtsii-pochemu-Erdogan-zhaluetsya-Putinu-21797766.html
[vii] https://rg.ru/2022/02/21/zapadnye-specsluzhby-verbuiut-boevikov-dlia-otpravki-na-ukrainu.html
[viii] https://katehon.com/ru/article/liberalizm-umiraet-priblizhaetsya-mnogopolyarnost
16:50 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, europe, russie, ukraine, politique internationale, géopolitique, multipolarité, leonid savin |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 25 février 2022
Patrick Buchanan médite sur le "géopolitique du coucher du soleil" en Europe
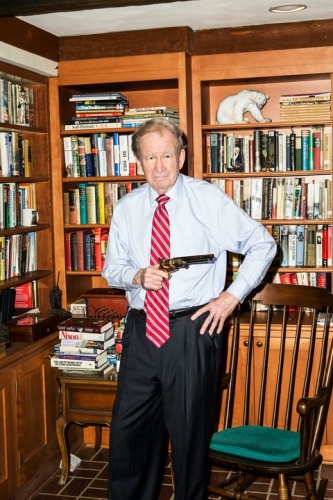
Patrick Buchanan médite sur le "géopolitique du coucher du soleil" en Europe
par Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/blogi/
"Pendant des siècles, jusqu'au 20e siècle, l'Europe semblait être le centre bien visible de l'histoire du monde", rappelle le vétéran de la politique américaine Patrick J. Buchanan.
Puis vint la grande guerre civile de l'Occident, la "deuxième guerre de Trente Ans" (1914-1945), au cours de laquelle toutes les grandes puissances d'Europe - la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Russie - et presque tous les autres pays ont livré l'une des plus grandes batailles de l'histoire.
À la suite de ce carnage, les plus grandes nations d'Europe ont toutes été battues. Tous les empires européens sont tombés; les peuples coloniaux ont été largement libérés et ont commencé à émigrer vers leur mère patrie. "L'Europe était également divisée entre l'Occident dirigé par les États-Unis et le bloc soviétique dirigé par Moscou", explique Buchanan.
Pourtant, même pendant cette guerre froide qui a duré quatre décennies, l'Europe était considérée comme le vainqueur de la bataille.
À la fin de la guerre froide, avec la victoire du "monde libre", une Union européenne calquée sur celle créée par les États-Unis d'Amérique a vu le jour, et presque tous les anciens États du bloc de l'Est ont commencé à rejoindre l'Alliance de défense de l'Atlantique Nord, l'OTAN.
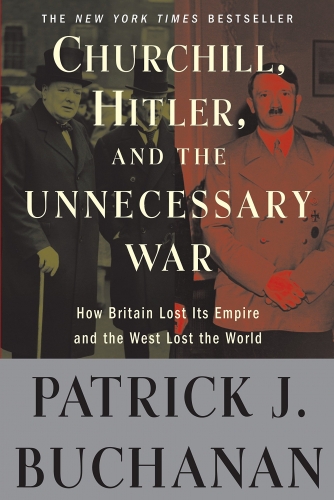
Toutefois, M. Buchanan affirme qu'aujourd'hui, on a le sentiment que "le rôle de l'Europe dans l'histoire mondiale est en phase de transition, que l'orientation des États-Unis vers la Chine et le Pacifique est à la fois historique et permanente, et que le passé appartient à l'Europe mais l'avenir à l'Asie".
L'Asie abrite les nations les plus peuplées du monde, la Chine et l'Inde, six des neuf puissances nucléaires du monde et la quasi-totalité des grands États musulmans: Indonésie, Inde, Pakistan, Bangladesh, Turquie et Iran, ainsi que les plus grandes économies du monde en dehors des États-Unis: la Chine et le Japon.
Qu'adviendra-t-il du rêve euro-fédéraliste des "États-Unis d'Europe", d'une Europe fédérale? En 2016, le Royaume-Uni a voté pour quitter l'UE. Cet été, les Britanniques se sont joints aux Australiens et aux Américains dans l'accord AUKUS, qui a mis fin à l'accord sur les sous-marins défendu par la France.
Paris y voit une "trahison", un "coup de poignard dans le dos" des alliés, que le général Charles De Gaulle avait qualifiés d'"Anglo-Saxons". Mais la nouvelle alliance anglo-américaine était également une déclaration indéniablement claire de la façon dont les Australiens voyaient leur avenir, non pas aux côtés de la France, mais aux côtés des États-Unis et de la Grande-Bretagne.
"Pourtant, c'était le pire affront américain à notre allié français depuis que le président Dwight Eisenhower a ordonné aux Britanniques et aux Français de quitter Suez", a historicisé Buchanan.

Pour protester contre le traitement réservé par la France au commerce des sous-marins, le président Emmanuel Macron a rappelé son ambassadeur aux États-Unis, ce qui n'a jamais été fait depuis que la France a reconnu les colonies américaines et leur est venue en aide pendant les guerres d'indépendance.
En effet, l'affaire des sous-marins a forcé l'annulation d'une grande fête à l'ambassade de France à Washington pour marquer le 240e anniversaire de la bataille du Cap.

Il s'agit d'une bataille navale franco-britannique cruciale à l'embouchure de la rivière Chesapeake en 1781, au cours de laquelle la marine française a remporté la victoire et a pu fournir une couverture à l'armée du général George Washington lorsqu'elle a encerclé, bombardé et forcé la reddition de l'armée du général Lord Cornwallis à Yorktown.
Mais si les Britanniques se sont retirés de l'UE et les Français se sont aliénés leurs alliés de l'OTAN, l'Allemagne a tenu ses élections fédérales fin septembre, au cours desquelles l'alliance chrétienne-démocrate de Konrad Adenauer, Helmut Kohl et Angela Merkel est arrivée, pour la première fois de son histoire, à un quart des voix.
Après des mois de négociations, le nouveau dirigeant allemand pourrait être le leader des sociaux-démocrates et des Verts. Buchanan pensait que ce gouvernement ne pourrait être composé avant la Noël.
Aucun des futurs candidats chanceliers de l'Union chrétienne-démocrate ou du Parti social-démocrate n'aura l'autorité de Merkel en tant que leader; l'avenir sera probablement plus gris et plus "euro-bureaucratique" ?
"Dans le passé, l'OTAN a été saluée comme l'alliance la plus réussie de l'histoire parce qu'elle a empêché les invasions soviétiques de l'Europe solidifiée par l'OTAN tout au long de la guerre froide", spécule Buchanan.
En 2001, l'OTAN a invoqué l'article V, qui stipule que "une attaque contre l'un est une attaque contre tous", et s'est alliée aux Américains dans leur plongée dans le bourbier d'Afghanistan sous prétexte des attentats du 11 septembre. L'alliance militaire n'a jamais été au cœur de l'action, mais a toujours bombardé des adversaires plus faibles.
En août de cette année, vingt ans plus tard, l'ensemble de l'"alliance occidentale" dirigée par Washington s'est retirée, l'armée afghane s'est effondrée et le régime fantoche installé par l'Occident en Afghanistan s'est écroulé. "Nos alliés de l'OTAN ont ainsi partagé les conséquences honteuses du retrait et de la défaite des États-Unis", déclare Buchanan.
Le centre de gravité politique des États-Unis se déplace de l'Europe vers l'Asie et l'unité européenne semble appartenir au passé.
La Grande-Bretagne a quitté l'UE et l'Écosse envisage de quitter l'Angleterre. La Catalogne envisage toujours de se séparer de l'Espagne. La Sardaigne envisage de se séparer de l'Italie. La Pologne et la Hongrie sont en désaccord avec l'UE sur les réformes de politique intérieure. La Pologne a fait valoir que son propre droit prime sur le droit communautaire et la Hongrie est d'accord.

La principale préoccupation des voisins méridionaux de l'UE et de l'OTAN, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, n'est pas tant l'invasion russe que l'afflux de réfugiés d'Afrique et d'Asie occidentale à travers la Méditerranée.
Alors que Buchanan réfléchit à ces questions de politique mondiale à la lumière de l'histoire, la Fondation Rockefeller, qui représente les mondialistes et les élites financières de l'Occident, a élaboré une "feuille de route" pour mettre fin à la "pandémie du Covid 19" "d'ici la fin de 2022".
L'observateur politique le plus cynique pourrait à juste titre se demander si même le jeu géopolitique des grandes puissances qui se déplace constamment devant nous a un sens concret dans un monde en réseau où un petit pourcentage des plus riches réalise ses projets obscurs tandis que les États jouent le jeu bon gré mal gré ?
15:22 Publié dans Actualité, Actualité, Affaires européennes, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick buchanan, actualité, europe, affaires européennes, déclin européen, déclin occidental |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Poutine, architecte du nouvel ordre mondial en Ukraine

Poutine, architecte du nouvel ordre mondial en Ukraine
par Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2022/02/24/putin-uuden-maailmanjarjestyksen-arkkitehtina-ukrainassa/
"La Russie a envahi l'Ukraine", crient les gros titres. Étant donné que les journalistes des médias grand public ne donnent qu'un récit anti-russe et pro-occidental sur le sujet, je vais écrire, moi, du point de vue de la realpolitik.
L'affaire ukrainienne ne se résume pas à renverser l'un des régimes fantoches de l'Occident, à venger les torts des huit dernières années, ni même à protéger la population russe durement éprouvée dans l'est de l'Ukraine. L'affaire ukrainienne crée un nouvel ordre mondial.
Les analystes politiques occidentaux s'empressent de montrer que Poutine tente de renverser l'ordre mondial existant - du moins en ce qui concerne l'architecture de sécurité de l'Europe et du continent.
En réalité, cette architecture a été brisée par les États-Unis, qui occupent toujours les pays européens et n'ont pas accepté les demandes de sécurité raisonnables de la Russie. L'OTAN prévoit déjà des contre-mesures, mais je doute qu'elle ose entreprendre une action militaire directe contre la Russie. La Russie n'est pas la Yougoslavie, l'Irak ou la Libye.
La période qui a suivi la Première Guerre mondiale a consisté, selon les mots du président Woodrow Wilson, à "rendre le monde sûr pour la démocratie". Au nom de la démocratie, les soldats américains ont frappé partout où ils le pouvaient et, plus tard, l'alliance militaire de l'OTAN a procédé à de nombreux bombardements au nom des intérêts occidentaux. Les frontières des États ont été déplacées de manière arbitraire.
Tant Poutine que le président chinois Xi Jinping ont clairement indiqué qu'ils pensaient que le but ultime de l'Amérique était de renverser les gouvernements russe et chinois. Les mouvements "pro-démocratie" locaux, souvent financés et formés par l'Occident, agissent comme des chevaux de Troie pour les puissances anglo-américaines. Nous devons donc cesser de jouer selon les règles truquées des atlantistes.

James M. Dorsey affirme que ce que Poutine, Xi et une foule d'autres dirigeants mondiaux - tels que Narendra Modi en Inde, Recep Tayyip Erdoğan en Turquie et Viktor Orbán en Hongrie - ont en commun, c'est qu'ils définissent les frontières de leurs nations en termes "civilisationnels" plutôt qu'en termes de droit international.
C'est ce dont parlait Poutine en début de semaine lorsqu'il a annoncé les raisons de la reconnaissance par la Russie des deux républiques séparatistes d'Ukraine. Le cours d'histoire de 90 minutes de Poutine a défini les frontières civilisationnelles de ce qu'il a appelé le "monde russe", le "grand espace" schmittien, en termes de présence de Russes ethniques dans une région donnée.
C'est également dans ce contexte que Poutine affirme que l'Ukraine n'a pas de véritable État ni de tradition. Avec la révolution des couleurs de l'Occident, ce territoire de l'ancienne Union soviétique représente également une menace constante pour la Russie moderne. Elle doit donc être ramenée dans la sphère d'influence de la mère patrie.
La reconnaissance par la Russie des deux républiques séparatistes de Géorgie en 2008, l'annexion de la péninsule de Crimée à la Russie en 2014, son soutien aux rebelles séparatistes dans les régions de Donetsk et de Lougansk dans l'est de l'Ukraine et la présence de troupes russes en Biélorussie renforcent le plan de Poutine.
Dorsey fait valoir que depuis 2014, Poutine a également parlé du Kazakhstan de la même manière qu'il a parlé de l'Ukraine. Quelques semaines avant que les troupes russes n'interviennent dans les manifestations antigouvernementales massives au Kazakhstan au début de l'année, M. Poutine a déclaré à la télévision kazakhe que "le Kazakhstan est un pays russophone au plein sens du terme".

Le porte-parole de Poutine, Dmitry Peskov (photo), a récemment déclaré que les politiques intérieure et extérieure du président n'étaient qu'"un point de départ". La suggestion de Peskov selon laquelle "il y a une demande dans le monde pour des leaders spéciaux, souverains et décisifs" était un signe que Poutine était considéré comme un tel leader et l'architecte du changement dans l'ordre mondial.
L'opinion de Poutine sur l'importance centrale de l'Ukraine pour garantir la position de la Russie sur la scène mondiale était partagée par les ennemis de longue date de la Russie.
Zbigniew Brzezinski, conseiller en sécurité nationale d'origine polonaise du président Jimmy Carter et initié à l'élite dirigeante de l'Occident, a déclaré dans les années 1990 que "sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire, mais une fois l'Ukraine subjuguée, la Russie redevient automatiquement un empire".
Ce qui se passera ensuite pour atteindre l'objectif de Poutine est une question de personne. Les patriotes russes, les eurasistes et les communistes ne sont pas dérangés par les actions de Poutine, mais les déçus de sa politique étrangère pensent maintenant pouvoir compenser les compromis honteux faits par le régime technocratique libéral envers l'Occident.
Malgré les affirmations contraires, Poutine n'est pas un tyran imprévisible et maniaque. Au contraire, il s'est révélé être un brillant tacticien. Le dirigeant russe sait que son appel à la fin de l'expansion de l'OTAN vers l'est ne sera pas pris au sérieux si le Kremlin n'ose pas passer des paroles aux actes.
En reconnaissant les républiques séparatistes d'Ukraine, il a montré qu'il ne s'inquiète pas des sanctions américaines et européennes. La Russie a constitué des réserves de quelque 600 milliards de dollars et a réduit le commerce en dollars à 50%.
Par conséquent, Poutine peut jusqu'à présent considérer l'émergence de la crise ukrainienne et la réponse à celle-ci comme un succès, même si une partie du monde condamne l'"agression" de la Russie, comme l'a montré le débat du Conseil de sécurité de l'ONU.
Le partenaire stratégique qu'est la Chine s'est montré prudent dans ses sorties sur la situation ukrainienne. Elle a ses propres relations commerciales avec l'Ukraine, des entreprises chinoises opèrent déjà dans le pays et Kiev est impliquée dans le projet d'infrastructure Belt and Road.
Aujourd'hui, la situation évolue, mais officiellement, la Chine affirme que l'opération militaire russe n'affectera pas les relations entre les deux pays. La question qui se pose est de savoir si la Chine va réintégrer la "province indisciplinée" de Taïwan dans la Chine continentale au moment même où la Russie opère en Ukraine.
En plus d'envoyer un message glaçant à l'Occident et aux anciennes républiques soviétiques, Poutine a exposé les faiblesses de l'Occident à un moment où la démocratie libérale est en crise : à l'ère du coronavirus, l'Occident est devenu un État sécuritaire biofasciste qui opprime ses citoyens, et les excès et les injustices n'ont pas été traités.
Poutine a peut-être donné un nouvel élan à l'Alliance de l'Atlantique Nord et à la solidarité occidentale, mais les États-Unis et l'Europe n'ont pas montré qu'ils étaient à la hauteur du défi lancé par le Kremlin. La Russie joue habilement un jeu géopolitique à long terme qui n'est pas ralenti par les politiques identitaires qui polarisent les sociétés occidentales.
Il est peu probable que les sanctions empêchent Poutine de créer son nouvel ordre dans les pays de l'ancienne Union soviétique, en Ukraine et au Belarus, à partir desquels il peut créer des avant-postes et des zones tampons dans le glacis occidental du monde russe.
Poutine pourrait toutefois être confronté à des États-Unis différents d'ici la fin de l'année si le président Biden perd le Sénat et/ou la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat. Dans quelques années, la situation pourrait changer à nouveau si Donald Trump - qui a qualifié de "brillante" l'action de Poutine en Ukraine - fait son retour à la présidence.
De même, en Europe, Poutine pourrait entrer en contact avec un dirigeant français plus empathique si un candidat pro-russe défiant Macron est élu comme nouveau président du pays lors des élections d'avril.
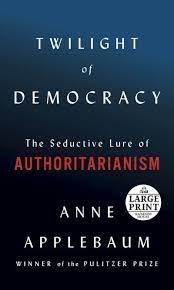 "Ce sont de grandes ambitions, et peut-être pas réalisables", espère la critique américaine de Poutine, Anne Applebaum, qui estime que le dirigeant russe tente de supprimer la démocratie dans le monde.
"Ce sont de grandes ambitions, et peut-être pas réalisables", espère la critique américaine de Poutine, Anne Applebaum, qui estime que le dirigeant russe tente de supprimer la démocratie dans le monde.
L'ancienne Union soviétique avait également de grandes ambitions : Lénine, Staline et leurs successeurs voulaient créer une révolution internationale pour que le monde entier finisse par se retrouver sous le socialisme soviétique. "Au final, ils ont échoué", soupire Applebaum.
Le pragmatique Poutine n'a peut-être pas de tels plans, mais au moins une sorte de monde d'intérêts géopolitiques, de grandes régions ou de "blocs", pourrait bien être une réalité à l'avenir, et c'est la direction dans laquelle d'autres acteurs se dirigent. Les dirigeants russes actuels sont-ils en train de construire un "État civilisé" ?
Il y a beaucoup d'opinions sur l'action militaire en Ukraine, mais parfois je pense que tout cela se passe comme si c'était un scénario et que les puissances en coulisses se sont déjà mises d'accord sur certaines choses. Nous sommes passés en douceur de la crise du coronavirus à un conflit militaire et un autre élément est peut-être commodément laissé de côté.
En tout cas, l'ordre mondial est en train d'être remodelé, d'abord par la "pandémie" et maintenant par la "guerre". Assistons-nous vraiment à une redistribution géopolitique et économique ? Quelle sera l'issue et qu'adviendra-t-il des banques et de la crise financière ? La Finlande occidentalisée tentera-t-elle de rejoindre l'OTAN ? La proposition d'une identité numérique se concrétisera-t-elle ?
Il a fallu à Poutine plus de deux décennies au pouvoir avant qu'il ne commence à répondre aux pires attentes des décideurs et analystes occidentaux. Reste à savoir s'il ne s'agit que d'un psychodrame politique, ou si nous verrons encore le bloc atlantique dirigé par les États-Unis humilié et évincé.
15:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, vladimir poutine, europe, affaires européennes, ukraine, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook