El neoliberalismo tocó fin definitivamente con la crisis estallada en 2008. No hay vuelta atrás. El mercado, por sí mismo, es autodestructivo. Necesita soportes y contenedores. La sociedad capitalista, arbitrada por el mercado, o bien se depreda, o bien se distiende. No tiene perspectivas de largo plazo.
Después de 30 años de neoliberalismo ocurrieron las dos cosas. La voracidad del mercado llevó a límites extremos la apropiación de la naturaleza y la desposesión de los seres humanos. Los territorios fueron desertificados y las poblaciones expulsadas. Los pueblos se levantaron y la catástrofe ecológica, con un altísimo grado de irreversibilidad, comenzó a manifestarse de manera violenta.
Los pueblos se rebelaron contra el avance del capitalismo bloqueando los caminos que lo llevaban a una mayor apropiación. Levantamientos armados cerraron el paso a las selvas; levantamientos civiles impiden la edificación de represas, la minería intensiva, la construcción de carreteras de uso pesado, la privatización de petróleo y gas y la monopolización del agua. El mercado, solo, no podía vencer a quienes ya estaban fuera de su alcance porque habían sido expulsados y desde ahí, desde el no-mercado, luchaban por la vida humana y natural, por los elementos esenciales, por otra relación con la naturaleza, por detener el saqueo.
El fin del neoliberalismo inicia cuando la medida de la desposesión toca la furia de los pueblos y los obliga a irrumpir en la escena.
Los cambios de fase
La sociedad capitalista contemporánea ha alcanzado un grado de complejidad que la vuelve altamente inestable. De la misma manera que ocurre con los sistemas biológicos (Prigogine, 2006), los sistemas sociales complejos tienen una capacidad infinita y en gran medida impredecible de reacción frente a los estímulos o cambios. El abigarramiento con el que se edificó esta sociedad, producto de la subsunción pero no eliminación de sociedades diferentes, con otras cosmovisiones, costumbres e historias, multiplica los comportamientos sociales y las percepciones y prácticas políticas a lo largo y ancho del mundo y abre con ello un espectro inmenso de sentidos de realidad y posibilidades de organización social.
La potencia cohesionadora del capitalismo ha permitido establecer diferentes momentos de lo que los físicos llaman equilibrio, en los que, a pesar de las profundas contradicciones de este sistema y del enorme abigarramiento que conlleva, disminuyen las tendencias disipadoras. No obstante, su duración es limitada. En el paso del equilibrio a la disipación aparecen constantemente las oportunidades de bifurcación que obligan al capitalismo a encontrar los elementos cohesionadores oportunos para construir un nuevo equilibrio o, en otras palabras, para restablecer las condiciones de valorización del capital. Pero siempre está presente el riesgo de ruptura, que apunta hacia posibles dislocamientos epistemológicos y sistémicos.
Los equilibrios internos del sistema, entendidos como patrones de acumulación en una terminología más económica, son modalidades de articulación social sustentadas en torno a un eje dinamizador u ordenador.
Un eje de racionalidad complejo que, de acuerdo con las circunstancias, adopta diferentes figuras: en la fase fordista era claramente la cadena de montaje para la producción en gran escala y el estado en su carácter de organizador social; en el neoliberalismo el mercado; y en el posneoliberalismo es simultáneamente el estado como disciplinador del territorio global, es decir, bajo el comando de su vertiente militar, y las empresas como medio de expresión directa del sistema de poder, subvirtiendo los límites del derecho liberal construido en etapas anteriores del capitalismo.
Los posneoliberalismos y las bifurcaciones
La incertidumbre acerca del futuro lleva a caracterizarlo más como negación de una etapa que está siendo rebasada. Si la modalidad capitalista que emana de la crisis de los años setenta, que significó una profunda transformación del modo de producir y de organizar la producción y el mercado, fue denominada por muchos estudiosos como posfordista; hoy ocurre lo mismo con el tránsito del neoliberalismo a algo diferente, que si bien ya se perfila, todavía deja un amplio margen a la imprevisión.
Posfordismo se enuncia desde la perspectiva de los cambios en el proceso de trabajo y en la modalidad de actuación social del estado; neoliberalismo desde la perspectiva del mercado y del relativo abandono de la función socializadora del estado. En cualquiera de los dos casos no tiene nombre propio, o es un pos, y en ese sentido un campo completamente indefinido, o es un neo, que delimita aunque sin mucha creatividad, que hoy están dando paso a otro pos, mucho más sofisticado, que reúne las dos cualidades: posneoliberalismo. Se trata de una categoría con poca vida propia en el sentido heurístico, aunque a la vez polisémica. Su virtud, quizá, es dejar abiertas todas las posibilidades de alternativa al neoliberalismo -desde el neofascismo hasta la bifurcación civilizatoria-, pero son inciertas e insuficientes su fuerza y cualidades explicativas.
En estas circunstancias, para avanzar en la precisión o modificación del concepto es indispensable detenerse en una caracterización de escenarios, entendiendo que el espectro de posibilidades incluye alternativas de reforzamiento del capitalismo -aunque sea un capitalismo con más dificultades de legitimidad-; de construcción de vías de salida del capitalismo a partir de las propias instituciones capitalistas; y de modos colectivos de concebir y llevar a la práctica organizaciones sociales nocapitalistas.
Trabajar todos los niveles de abstracción y de realidad en los que este término ocupa el espacio de una alternativa carente de apelativo propio, o el de alternativas diversas en situación de coexistencia sin hegemonismos, lo que impide que alguna otorgue un contenido específico al proceso superador del neoliberalismo.
El posneoliberalismo del capital
Aun antes del estallido de la crisis actual, ya eran evidentes los límites infranqueables a los que había llegado el neoliberalismo. La bonanza de los años dorados del libre mercado permitió expandir el capitalismo hasta alcanzar, en todos sentidos, la escala planetaria; garantizó enormes ganancias y el fortalecimiento de los grandes capitales, quitó casi todos los diques a la apropiación privada; flexibilizó, precarizó y abarató los mercados de trabajo; y colocó a la naturaleza en situación de indefensión. Pero después de su momento innovador, que impuso nuevos ritmos no sólo a la producción y las comunicaciones sino también a las luchas sociales, empezaron a aparecer sus límites de posibilidad.
Dentro de éstos, es importante destacar por lo menos tres, referidos a las contradicciones inmanentes a la producción capitalista y su expresión específica en este momento de su desarrollo y a las contradicciones correspondientes al proceso de apropiación y a las relaciones sociales que va construyendo:
1. El éxito del neoliberalismo en extender los márgenes de expropiación, lo llevó a corroer los consensos sociales construidos por el llamado estado del bienestar, pero también a acortar los mercados. La baja general en los salarios, o incluso en el costo de reproducción de la fuerza de trabajo en un sentido más amplio, fue expulsándola paulatinamente del consumo más sofisticado que había alcanzado durante el fordismo.
La respuesta capitalista consistió en reincorporar al mercado a esta población, cada vez más abundante, a través de la producción de bienes precarios en gran escala. No obstante, esta reincorporación no logra compensar ni de lejos el aumento en las capacidades de producción generadas con las tecnologías actuales, ni retribuir las ganancias esperadas. El grado de apropiación y concentración, el desarrollo tecnológico, la mundialización tanto de la producción como de la comercialización, es decir, el entramado de poder objetivado construido por el capital no se corresponde con las dimensiones y características de los entramados sociales. Es un poder que empieza a tener problemas serios de interlocución.
2. Estas enormes capacidades de transformación de la naturaleza en mercancía, en objeto útil para el capital, y la capacidad acumulada de gestión económica, fortalecida con los cambios de normas de uso del territorio y de concepción de las soberanías, llevaron a una carrera desatada por apropiarse todos los elementos orgánicos e inorgánicos del planeta. Conocer las selvas, doblegarlas, monopolizarlas, aislarlas, separarlas en sus componentes más simples y regresarlas al mundo convertidas en algún tipo de mercancía fue -es- uno de los caminos de afianzamiento de la supremacía económica; la ocupación de territorios para convertirlos en materia de valorización. Paradójicamente, el capitalismo de libre mercado promovió profundos cercamientos y amplias exclusiones. Pero con un peligro: Objetivar la vida es destruirla.
Con la introducción de tecnologías de secuenciación industrial, con el conocimiento detallado de genomas complejos con vistas a su manipulación, con los métodos de nanoexploración y transformación, con la manipulación climática y muchos otros de los desarrollos tecnológicos que se han conocido en los últimos 30 años, se traspasó el umbral de la mayor catástrofe ecológica registrada en el planeta. Esta lucha del capitalismo por dominar a la naturaleza e incluso intentar sustituirla artificialmente, ha terminado por eliminar ya un enorme número de especies, por provocar desequilibrios ecológicos y climáticos mayores y por poner a la propia humanidad, y con ella al capitalismo, en riesgo de extinción.
Pero quizá los límites más evidentes en este sentido se manifiestan en las crisis de escasez de los elementos fundamentales que sostienen el proceso productivo y de generación de valor como el petróleo; o de los que sostienen la producción de la vida, como el agua, en gran medida dilapidada por el mal uso al que ha sido sometida por el propio proceso capitalista. La paradoja, nuevamente, es que para evitar o compensar la escasez, se diseñan estrategias que refuerzan la catástrofe como la transformación de bosques en plantíos de soja o maíz transgénicos para producir biocombustibles, mucho menos rendidores y tan contaminantes y predatorios como el petróleo.
El capitalismo ha demostrado tener una especial habilidad para saltar obstáculos y encontrar nuevos caminos, sin embargo, los niveles de devastación alcanzados y la lógica con que avanza hacia el futuro permiten saber que las soluciones se dirigen hacia un callejón sin salida en el que incluso se van reduciendo las condiciones de valorización del capital.
3. Aunque el neoliberalismo ha sido caracterizado como momento de preponderancia del capital financiero, y eso llevó a hablar de un capitalismo desterritorializado, en verdad el neoliberalismo se caracterizó por una disputa encarnizada por la redefinición del uso y la posesión de los territorios, que ha llevado a redescubrir sociedades ocultas en los refugios de selvas, bosques, desiertos o glaciares que la modernidad no se había interesado en penetrar. La puesta en valor de estos territorios ha provocado una ofensiva de expulsión, desplazamiento o recolonización de estos pueblos, que, evidentemente, se han levantado en contra.
Esto, junto con las protestas y revueltas originadas por las políticas de ajuste estructural o de privatización de recursos, derechos y servicios promovidas por el neoliberalismo, ha marcado la escena política desde los años noventa del siglo pasado. Las condiciones de impunidad en que se generaron los primeros acuerdos de libre comercio, las primeras desregulaciones, los despojos de tierras y tantas otras medidas impulsadas desde la crisis y reorganización capitalista de los años setenta-ochenta, cambiaron a partir de los levantamientos de la década de los noventa en que se produce una inflexión de la dinámica social que empieza a detener las riendas sueltas del neoliberalismo.
No bastaba con darle todas las libertades al mercado. El mercado funge como disciplinador o cohesionador en tanto mantiene la capacidad desarticuladora y mientras las fuerzas sociales se reorganizan en correspondencia con las nuevas formas y contenidos del proceso de dominación. Tampoco podía ser una alternativa de largo plazo, en la medida que la voracidad del mercado lleva a destruir las condiciones de reproducción de la sociedad.
El propio sistema se vio obligado a trascender el neoliberalismo trasladando su eje ordenador desde la libertad individual (y la propiedad privada) promovida por el mercado hacia el control social y territorial, como medio de restablecer su posibilidad de futuro. La divisa ideológica del "libre mercado" fue sustituida por la "seguridad nacional" y una nueva fase capitalista empezó a abrirse paso con características como las siguientes:
1. Si el neoliberalismo coloca al mercado en situación de usar el planeta para los fines del mantenimiento de la hegemonía capitalista, en este caso comandada por Estados Unidos, en esta nueva fase, que se abre junto con la entrada del milenio, la misión queda a cargo de los mandos militares que emprenden un proceso de reordenamiento interno, organizativo y conceptual, y uno de reordenamiento planetario.
El cambio de situación del anteriormente llamado mundo socialista ya había exigido un cambio de visión geopolítica, que se corresponde con un nuevo diseño estratégico de penetración y control de los territorios, recursos y dinámicas sociales de la región centroasiática. El enorme peso de esta región para definir la supremacía económica interna del sistema impidió, desde el inicio, que ésta fuera dejada solamente en las manos de un mercado que, en las circunstancias confusas y desordenadas que siguieron al derrumbe de la Unión Soviética y del Muro de Berlín, podía hacer buenos negocios pero no condiciones de reordenar la región de acuerdo con los criterios de la hegemonía capitalista estadounidense. En esta región se empieza a perfilar lo que después se convertiría en política global: el comando militarizado del proceso de producción, reproducción y espacialización del capitalismo de los albores del siglo XXI.
2. Esta militarización atiende tanto a la potencial amenaza de otras coaliciones hegemónicas que dentro del capitalismo disputen el liderazgo estadounidense como al riesgo sistémico por cuestionamientos y construcción de alternativas de organización social no capitalistas. Sus propósitos son el mantenimiento de las jerarquías del poder, el aseguramiento de las condiciones que sustentan la hegemonía y la contrainsurgencia. Supone mantener una situación de guerra latente muy cercana a los estados de excepción y una persecución permanente de la disidencia.
Estos rasgos nos llevarían a pensar rápidamente en una vuelta del fascismo, si no fuera porque se combinan con otros que lo contradicen y que estarían indicando las pistas para su caracterización más allá de los "neos" y los "pos".
Las guerras, y la política militar en general, han dejado de ser un asunto público. No solamente porque muchas de las guerras contemporáneas se han enfocado hacia lo que se llama "estados fallidos", y en ese sentido no son entre "estados" sino de un estado contra la sociedad de otra nación, sino porque aunque sea un estado el que las emprende lo hace a través de una estructura externa que una vez contratada se rige por sus propias reglas y no responde a los criterios de la administración pública.
El outsourcing, que se ha vuelto recurrente en el capitalismo de nuestros días, tiene implicaciones muy profundas en el caso que nos ocupa. No se trata simplemente de privatizar una parte de las actividades del estado sino de romper el sentido mismo del estado. La cesión del ejercicio de la violencia de estado a particulares coloca la justicia en manos privadas y anula el estado de derecho. Ni siquiera es un estado de excepción. Se ha vaciado de autoridad y al romper el monopolio de la violencia la ha instalado en la sociedad.
En el fascismo había un estado fuerte capaz de organizar a la sociedad y de construir consensos. El estado centralizaba y disciplinaba. Hoy apelar al derecho y a las normas establecidas colectivamente ha empezado a ser un disparate y la instancia encargada de asegurar su cumplimiento las viola de cara a la sociedad. Ver, si no, los ejemplos de Guantánamo o de la ocupación de Irak.
Con la reciente crisis las instituciones capitalistas más importantes se han desfondado. El FMI y el Banco Mundial son repudiados hasta por sus constructores. Estamos entrando a un capitalismo sin derecho, a un capitalismo sin normas colectivas, a un capitalismo con un estado abiertamente faccioso. Al capitalismo mercenario.
El posneoliberalismo nacional alternativo
Otra vertiente de superación del neoliberalismo es la que protagonizan hoy varios estados latinoamericanos que se proclaman socialistas o en transición al socialismo y que han empezado a contravenir, e incluso revertir, la política neoliberal impuesta por el FMI y el Banco Mundial. Todas estas experiencias que iniciaron disputando electoralmente la presidencia, aunque distintas entre sí, comparten y construyen en colaboración algunos caminos para distanciarse de la ortodoxia dominante.
Bolivia, Ecuador y Venezuela, de diferentes maneras y con ritmos propios, impulsan políticas de recuperación de soberanía y de poder participativo, que se ha plasmado en las nuevas Constituciones elaboradas por sus sociedades.
La disputa con el FMI y el Banco Mundial ha determinado un alejamiento relativo de sus políticas y de las propias instituciones, al tiempo que se inicia la creación de una institucionalidad distinta, todavía muy incipiente, a través de instancias como el ALBA, el Banco del Sur, Petrocaribe y otras que, sin embargo, no marcan una pauta anticapitalista en sí mismas sino que apuntan, por el momento, a constituir un espacio de mayor independencia con respecto a la economía mundial, que haga propicia la construcción del socialismo. Considerando que, aun sin tener certeza de los resultados, se trata en estos casos por lo menos de un escenario posneoliberal diferente y confrontado con el que desarrollan las potencias dominantes, es conveniente destacar algunos de sus desafíos y paradojas.
1. Para avanzar en procesos de recuperación de soberanía, indispensable en términos de su relación con los grandes poderes mundiales --ya sea que vengan tras facetas estatales o empresariales--, y para emprender proyectos sociales de gran escala bajo una concepción socialista, requieren un fortalecimiento del estado y de su rectoría. Lo paradójico es que este estado es una institución creada por el propio capitalismo para asegurar la propiedad privada y el control social.
2. Los procesos de nacionalización emprendidos o los límites impuestos al capital transnacional, pasándolo de dueño a prestador de servicios, o a accionista minoritario, marca una diferencia sustancial en la capacidad para disponer de los recursos estratégicos de cada nación. La soberanía, en estos casos, es detentada y ejercida por el estado, pero eso todavía no transforma la concepción del modo de uso de estos recursos, al grado de que se estimulan proyectos de minería intensiva, aunque bajo otras normas de propiedad. Para un "cambio de modelo" esto no es suficiente, es un primer paso de continuidad incierta, si bien representa una reivindicación popular histórica.
3. El reforzamiento del interés nacional frente a los poderes globales o transnacionales va acompañado de una centralización estatal que no resulta fácilmente compatible con la plurinacionalidad postulada por las naciones o pueblos originarios, ni con la idea de una democracia participativa que acerque las instancias de deliberación y resolución a los niveles comunitarios.
4. Las Constituyentes han esbozado las líneas de construcción de una nueva sociedad. En Bolivia y Ecuador se propone cambiar los objetivos del "desarrollo" por los del "buen vivir", marcando una diferencia fundamental entre la carrera hacia delante del desarrollo con la marcha horizontal e incluso circular del buen vivir, que llamaría a recordar la metáfora zapatista de caminar al paso del más lento. La dislocación epistemológica que implica trasladarse al terreno del buen vivir coloca el proceso ya en el camino de una bifurcación societal y, por tanto, la discusión ya no es neoliberalismo o posneoliberalismo sino eso otro que ya no es capitalista y que recoge las experiencias milenarias de los pueblos pero también la crítica radical al capitalismo. Los apelativos son variados: socialismo comunitario, socialismo del siglo XXI, socialismo en el siglo XXI, o ni siquiera socialismo, sólo buen vivir, autonomía comunitaria u horizontes emancipatorios.
Ahora bien, la construcción de ese otro, que genéricamente podemos llamar el buen vivir, tiene que salirse del capitalismo pero a la vez tiene que transformar al capitalismo, con el riesgo, siempre presente, de quedar atrapado en el intento porque, entre otras razones, esta búsqueda se emprende desde la institucionalidad del estado (todavía capitalista), con toda la carga histórica y política que conlleva.
El posneoliberalismo de los pueblos
Otro proceso de salida del neoliberalismo es el que han emprendido los pueblos que no se han inclinado por la lucha electoral, fundamentalmente porque han decidido de entrada distanciarse de la institucionalidad dominante. En este proceso, con variantes, se han involucrado muchos de los pueblos indios de América, aunque no sólo, y su rechazo a la institucionalidad se sustenta en la combinación de las bifurcaciones con respecto a la dominación colonial que hablan de rebeliones larvadas a lo largo de más de 500 años, con las correspondientes a la dominación capitalista. Las naciones constituidas en el momento de la independencia de España y Portugal en realidad reprodujeron las relaciones de colonialidad interna y por ello no son reconocidas como espacios recuperables.
La resistencia y las rebeliones se levantan a veces admitiendo la nación, más no el estado, como espacio transitorio de resistencia, y a veces saltando esta instancia para lanzarse a una lucha anticapitalista-anticolonial y por la construcción-reconstrucción de formas de organización social simplemente distintas.
Desde esta perspectiva el proceso se realiza en los espacios comunitarios, transformando las redes cotidianas y creando condiciones de autodeterminación y autosustentación, siempre pensadas de manera abierta, en interlocución y en intercambio solidario con otras experiencias similares.
Recuperar y recrear formas de vida propias, humanas, de respeto con todos los otros seres vivos y con el entorno, con una politicidad libre y sin hegemonismos. Democracias descentradas. Este es el otro camino de salida del neoliberalismo, que sería muy empobrecedor llamar posneoliberalismo porque, incluso, es difícil de ubicar dentro del mismo campo semántico. Y todos sabemos que la semántica es también política y que también ahí es preciso subvertir los sentidos para que correspondan a los nuevos aires emancipatorios.
Lo que viene después del neoliberalismo es un abanico abierto con múltiples posibilidades. No estrechemos el horizonte cercándolo con términos que reducen su complejidad y empequeñecen sus capacidades creativas y emancipatorias. El mundo está lleno de muchos mundos con infinitas rutas de bifurcación. A los pueblos en lucha toca ir marcando los caminos.
Bibliografía
Acosta, Alberto 2008 "La compleja tarea de construir democráticamente una sociedad democrática" en Tendencia N° 8 (Quito).
Prigogine, Ilya 2006 (1988) El nacimiento del tiempo (Argentina: Tusquets).
Constitución de la República del Ecuador 2008.
Asamblea Constituyente de Bolivia 2007 Nueva Constitución Política del Estado (documento oficial)





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg










 François Bayrou, président du
François Bayrou, président du

 Het begin van weer eens een verkiezingsronde in dit land is volop begonnen. Dat is niet te merken aan de lawine ideeën en ideologische inzichten door het politieke profitariaat naar onze hoofden geslingerd. Neen, het is alleen te merken aan hoe de kopstukken van de respectieve partijen zichzelf aan het verkiezen zijn om zo zichzelf en hun naaste vrienden (of familieleden) op topplaatsen te wringen. Dat noemen die politieke creaturen dan de eerste stap in een democratisch proces: "Hoe wring ik mezelf op een verkiesbare plaats?" Het is meteen een van de belangrijkste fasen van de partijwerking geworden als men de kranten erop naleest.
Het begin van weer eens een verkiezingsronde in dit land is volop begonnen. Dat is niet te merken aan de lawine ideeën en ideologische inzichten door het politieke profitariaat naar onze hoofden geslingerd. Neen, het is alleen te merken aan hoe de kopstukken van de respectieve partijen zichzelf aan het verkiezen zijn om zo zichzelf en hun naaste vrienden (of familieleden) op topplaatsen te wringen. Dat noemen die politieke creaturen dan de eerste stap in een democratisch proces: "Hoe wring ik mezelf op een verkiesbare plaats?" Het is meteen een van de belangrijkste fasen van de partijwerking geworden als men de kranten erop naleest.
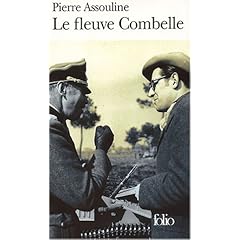








 « Le libre-échange est responsable de la crise dans laquelle nous sommes plongés. Il tire les salaires vers le bas et attise les conflits sociaux. Il faut sortir de ce système, mais de façon réfléchie, en se donnant du temps. Je ne suis pas un dogmatique buté. Aujourd'hui, c'est le libre-échange, avec sa théorie des avantages comparatifs, qui nous conduit à la guerre. Le protectionnisme est l'antidote à la guerre.
« Le libre-échange est responsable de la crise dans laquelle nous sommes plongés. Il tire les salaires vers le bas et attise les conflits sociaux. Il faut sortir de ce système, mais de façon réfléchie, en se donnant du temps. Je ne suis pas un dogmatique buté. Aujourd'hui, c'est le libre-échange, avec sa théorie des avantages comparatifs, qui nous conduit à la guerre. Le protectionnisme est l'antidote à la guerre.