Communiqué public du Laboratoire Européen d’Anticipation Politique (LEAP), du 15 novembre 2010

Comme l’avait anticipé le LEAP dans sa lettre ouverte aux leaders du G20 publiée dans l’édition mondiale du Financial Times le 24 Mars 2009, à la veille du sommet de Londres, la question d’une réforme fondamentale du système monétaire international est bien au cœur de toute tentative de maîtrise de la crise actuelle.
Mais hélas, ainsi que vient de le démontrer à nouveau l’échec du sommet du G20 de Séoul, la fenêtre d’opportunité pour réussir pacifiquement une telle réforme s’est bien refermée après l’été 2009 et elle ne se rouvrira plus avant 2012/2013 (1).
Le monde est en effet bien engagé dans la phase de dislocation géopolitique mondiale dont nous avions annoncé le début pour la fin 2009 et qui se traduit, moins d’un an plus tard, par la multiplication rapide des mouvements, des difficultés économiques, des défaillances budgétaires, des conflits monétaires… prémices de chocs géopolitiques majeurs.
Avec le sommet du G20 de Séoul, qui marque la prise de conscience planétaire de la fin de la domination américaine sur l’agenda international et de son remplacement par un « chacun pour soi » généralisé, une nouvelle étape de la crise vient de s’ouvrir qui incite l’équipe du LEAP à lancer une nouvelle alerte.
En effet, le monde est en train de franchir un seuil critique de la phase de dislocation géopolitique globale. Comme tout franchissement de seuil critique dans un système complexe, cela va générer dès le premier trimestre 2011 un cortège de phénomènes non-linéaires, c’est-à-dire, d’évolutions échappant aux « règles habituelles » et aux « projections traditionnelles » tant en terme économiques que monétaires, financiers, sociaux et politiques.
Dans ce [numéro], en plus de l’analyse des six principales transitions qui marquent le franchissement de ce seuil critique de la dislocation géopolitique mondiale, notre équipe présente de nombreuses recommandations pour faire face aux conséquences de cette nouvelle étape de la crise. Elles concernent notamment l’ensemble Devises/Taux d’intérêt/Or & Métaux précieux, la préservation de richesse et le remplacement de sa mesure par rapport au Dollar US, les « bulles » des classes d’actifs libellés en Dollars US, les bourses et les catégories d’entreprises particulièrement fragiles dans cette phase de la crise.
Le LEAP y présente aussi les « trois réflexes simples » à adopter pour mieux comprendre et anticiper le nouveau monde en gestation. Par ailleurs, dans ce numéro, notre équipe décrit le double choc électoral franco-allemand de 2012/2013. Enfin, nous présentons un extrait du Manuel d’Anticipation Politique écrit par Marie-Hélène Caillol, présidente du LEAP, qui vient de paraître en Français, Anglais, Allemand et Espagnol aux éditions Anticipolis.

Balances commerciales des pays du G20 (prévisions 2010) - Source : Spiegel, novembre 2010 (cliquer sur l'image pour l'agrandir)
Dans ce communiqué public, notre équipe a choisi de présenter trois des six transitions qui caractérisent le seuil critique que le monde est en train de franchir.
La crise que nous vivons est caractérisée par une évolution d’ampleur planétaire qui se déroule à deux niveaux certes corrélés mais différents dans leurs natures.
D’une part, la crise traduit les mutations profondes de la réalité économique, financière et géopolitique de notre monde. Elle accélère et amplifie des tendances de fond à l’œuvre depuis plusieurs décennies, tendances que nous avons décrites régulièrement (…) depuis (…) début 2006.
Et d’autre part, elle reflète la prise de conscience collective progressive de ces mutations. Cette prise de conscience est en soi un phénomène de psychologie collective planétaire qui façonne également le développement de la crise et qui induit notamment de brusques coups d’accélérateurs de son évolution.
Ces dernières années, nous avons à plusieurs reprises anticipés des « points d’inflexion » de la crise qui correspondaient justement à des « sauts brusques » dans cette prise de conscience collective des transformations en cours.
Or, nous considérons qu’un faisceau évènementiel de « rupture » s’est concrétisé autour du sommet du G20 de Séoul qui concourt à faire passer une étape fondamentale à la conscience collective globale en ce qui concerne la dislocation géopolitique mondiale. C’est ce phénomène qui conduit le LEAP à identifier un franchissement de seuil critique et à lancer une alerte sur les conséquences de ce franchissement à partir du premier trimestre 2011.
Autour de la date du sommet du G20 de Séoul, le LEAP a ainsi identifié un faisceau évènementiel de « rupture ». Passons en revue les principaux évènements concernés (2) ainsi que leurs conséquences chaotiques.

Actifs de la Réserve fédérale des Etats-Unis (2008-2010) - Sources : Federal Reserve of Cleveland / New York Times, octobre 2010 (cliquer sur le graphique pour l'agrandir)
Suite et fin du « Quantitative Easing » : la Fed entre en « résidence surveillée »
La décision de la Réserve Fédérale américaine de lancer son « Quantitative Easing II » (avec le rachat de 600 milliards de dollars de bons du Trésor US d’ici juin 2011) a provoqué, pour la première fois depuis 1945, une critique générale et souvent virulente de la part de la quasi-totalité des autres puissances mondiales : Japon, Brésil, Chine (3), Inde, Allemagne, pays de l’Asean (4)… (5) Ce n’est pas la décision de la Fed qui marque une rupture, c’est le fait que pour la première fois, la banque centrale US se fait littéralement « assommer » par le reste du monde (6), et d’une manière très publique et déterminée (7).
On est loin en effet de l’ambiance feutrée de Jackson Hole et des réunions de banquiers centraux. La menace de Ben Bernanke à ses collègues, dont le LEAP s’était fait l’écho, n’aura donc pas eu l’effet escompté par le patron de la Fed.
Le reste du monde a clairement signifié, en novembre 2010, qu’il ne comptait plus laisser la Réserve Fédérale US imprimer à volonté des Dollars US pour essayer de résoudre les problèmes des Etats-Unis sur le dos des autres pays de la planète (8).
Le Dollar est en train de redevenir ce que devrait être toute devise nationale : la monnaie, et donc le problème, du pays qui l’imprime. En cette fin 2010, nous venons ainsi de vivre la fin de l’époque où le Dollar était la monnaie des Etats-Unis et le problème du reste du monde comme l’avait fort bien résumé John Connally en 1971 lors de la décision unilatérale US de supprimer la convertibilité en or de la devise américaine.
Pourquoi ? Tout simplement parce que la Réserve Fédérale doit désormais compter avec l’opinion du monde extérieur (9). Elle n’est pas encore mise sous tutelle, mais elle entre en « résidence surveillée » (10).
Selon le LEAP, on peut ainsi déjà anticiper qu’il n’y aura pas de « Quantitative Easing III » (11), quelles que soient les opinions des dirigeants américains sur le sujet (12), ou bien qu’il se déroulera fin 2011 sur fond de conflit géopolitique majeur et d’effondrement du Dollar US (13) .
Austérité européenne : multiplication des résistances sociales, montée des populismes, risque de radicalisation des générations montantes et hausses d’impôts
De Paris à Berlin (14), de Lisbonne à Dublin, de Vilnius à Bucarest, de Londres à Rome… les manifestations et les grèves se multiplient. La dimension sociale de la dislocation géopolitique globale est bien au rendez-vous de l’Europe de cette fin 2010. Si ces évènements ne parviennent pas pour l’instant à perturber les programmes d’austérité décidés par les gouvernements européens, ils traduisent une évolution collective significative : les opinions publiques sont en train de sortir de leur torpeur du début de la crise en prenant conscience de sa durée et de son coût (social et financier) (15).
Les prochaines élections devraient donc faire payer un coût élevé à toutes les équipes au pouvoir, qui ont perdu de vue que sans équité, l’austérité ne bénéficierait d’aucun soutien populaire (16). Pour l’instant, les équipes au pouvoir continuent essentiellement à appliquer les recettes de la période d’avant la crise (à savoir des solutions néo-libérales, à base de réductions d’impôts pour les ménages les plus aisés et d’augmentation d’impôts indirects en tout genre).
Mais la montée en puissance des conflits sociaux (qui est inévitable selon le LEAP) et les changements politiques qui vont apparaître dans les prochaines élections nationales pays après pays, vont générer une remise en cause de ces solutions… et une montée brutale des partis populistes et extrémistes (17) : l’Europe va se « durcir » politiquement.
Parallèlement, devant ce qui apparaît de plus en plus comme une tentative inconsciente de la génération « babyboomer » de faire payer l’addition aux générations montantes, on peut anticiper une multiplication des réactions brutales des jeunes générations (18). Pour notre équipe, on devra faire face à leur radicalisation si la situation leur paraît sans issue, faute de compromis. Or, sans évolution à la hausse des recettes fiscales, le seul compromis crédible à leurs yeux sera une baisse des retraites actuelles plutôt qu’une hausse des coûts de l’éducation.
Aujourd’hui est toujours un compromis entre hier et demain, en particulier en matière fiscale ! D’ailleurs, les conséquences fiscales probables de ces évolutions seront une hausse des impôts sur les hauts revenus et les revenus du capital, de nouvelles taxations des banques et un volontarisme communautaire nouveau en matière de protection douanière des frontières (19). Les partenaires commerciaux de l’UE devraient en prendre conscience très rapidement (20).

Besoins de financement de certains Etats (2010-2011) - Sources : FMI / Wall Street Journal, octobre 2010
Japon : derniers efforts pour résister à l’orbite chinoise
Depuis plusieurs semaines, Tokyo et Pékin se livrent un conflit diplomatique d’une rare intensité. Sous divers prétextes (bateau chinois ayant pénétré dans les eaux territoriales japonaises (21), achats chinois massif d’actifs japonais faisant s’apprécier le Yen…), Pékin et Tokyo échangent des mots très durs, limitent leurs relations de haut niveau, appellent à témoin l’opinion internationale…
La visibilité mondiale de cette querelle sino-japonaise est surtout révélatrice aux yeux des pays de la région par son grand absent, à savoir les Etats-Unis. En effet, si ces querelles illustrent clairement la volonté croissante de Pékin de s’affirmer comme la puissance dominante d’Asie de l’Est et du Sud-Est et la tentative du Japon de s’opposer à cette hégémonie chinoise régionale, personne ne peut ignorer que la puissance censée être dominante dans cette région du monde depuis 1945, à savoir les Etats-Unis, est étrangement absente du conflit.
On peut donc considérer qu’on assiste à un test grandeur réelle, de la part de la Chine, pour mesurer son influence nouvelle sur le Japon ; et, de la part du Japon, pour évaluer ce qu’il reste de capacité d’action américaine en Asie face à la Chine.
Les évènements montrent ces dernières semaines qu’empêtrée dans sa paralysie politique et sa dépendance économique et financière par rapport à la Chine, Washington préfère rester aux abonnés absents. Nul doute que, dans toute l’Asie, ce spectacle contribue à une prise de conscience accélérée qu’une étape vient d’être franchie en terme d’ordre régional (22) ; et qu’au Japon, enlisé dans une récession sans fin (23), les intérêts économiques liés au marché chinois en sortent renforcés.

Aperçu des mutations mondiales en cours - Evolution massive du trafic portuaire mondial au profit de l'Asie (1994-2009) - Sources : Transport Trackers / Clusterstock, octobre 2010 (cliquer sur le schéma pour l'agrandir)
Pour conclure, ce faisceau d’évènements, centrés autour d’un sommet du G20 qui s’avère clairement incapable de résoudre les sources de conflits économiques, financiers et monétaires entre ses principaux membres, a contribué à faire passer une étape décisive dans la prise de conscience collective mondiale du processus de dislocation géopolitique global en cours.
Et cette prise de conscience accrue va elle-même accélérer et amplifier, dès le début 2011, les mutations qui affectent le système international comme nos différentes sociétés, générant des phénomènes non linéaires, chaotiques comme ceux décrits dans ce numéro et les précédents.
Comme nous l’avons souligné en septembre 2010, nous insistons sur le fait que le principal d’entre eux va être l’entrée des Etats-Unis dans une ère d’austérité à partir du Printemps 2011. Sans ignorer qu’une des surprises des dix-huit mois à venir, peut être tout simplement l’annonce que l’économie chinoise aura dépassé celle des Etats-Unis dès 2012, comme l’indique le Wall Street Journal du 10 novembre 2010, rapportant les analyses du Conference Board (24).
——————-
Notes :
(1) Ces dates correspondent notamment à la période de renouvellement de la majorité des dirigeants des pays les plus importants du G20, qui est une condition nécessaire (mais pas suffisante , bien entendu, car rien n’est assuré, même après 2012/2013 : il s’agira juste d’une nouvelle fenêtre d’opportunité) pour espérer une approche et une volonté commune de réforme du système monétaire mondial. D’ici là, selon le LEAP, on n’assistera qu’à des tentatives avortées et/ou des tests d’idées qui ne pourront pas aboutir avant ce changement quasi-général de dirigeants mondiaux. Et parmi les idées sans avenir, on notera celle d’une régulation des excédents des pays exportateurs. C’est une idée de pays en pleine déroute commerciale, ou plus exactement une idée de pays en position de faiblesse, donc sans aucune chance de pouvoir s’imposer. Sa pertinence (très douteuse comme le précise bien Asia Times du 27 octobre 2010) n’entre même pas en ligne de compte. Pour la fenêtre d’opportunité 2012/2013, voir [les numéros] précédents et les anticipations et scénarios du livre de Franck Biancheri « Crise mondiale : en route pour le monde d’après » pour plus de détails sur le sujet. Source : Anticipolis.
(2) Les abonnés du LEAP ont pu les anticiper depuis de nombreux mois.
(3) Avec une hausse des prix officiellement à 4,4% (un plus haut niveau depuis plus de deux ans), Pékin ne va pas rester sans réagir aux risques inflationnistes exportés par la Fed. Sources : China Daily, 27 octobre 2010 ; China Daily, 11 novembre 2010
(4) Même les Philippines, ancienne colonie américaine sous influence directe de Washington, ont exprimé clairement leur mécontentement. Le président Begnino Aquino a même déclaré qu’au-delà des Philippines, même Singapour et la Thaïlande ressentent les conséquences négatives de la décision de la Fed. Source : BusinessInquirer, 05 novembre 2010
(5) Les autres partenaires européens sont restés d’un silence éloquent devant ce flux de critiques. Et c’est d’ailleurs un autre enseignement de cette réaction négative à la décision de la Fed : même les alliés traditionnels des Etats-Unis ont réagi négativement, certains comme l’Allemagne ou les pays de l’Asean étant même parmi les plus agressifs. Ainsi, même les éditorialistes britanniques du Telegraph, pourtant très attachés au « Grand Frère » américain, expriment-ils désormais leurs doutes publiquement sur la pertinence des décisions de la Fed et prédisent dorénavant la fin de l’ère Dollar. Sources : Telegraph, 04 novembre 2010 ; Telegraph, 05 novembre 2020
(6) Ainsi, à l’image de nombreuses économies en risque de surchauffe, l’Australie continue à accroître ses taux d’intérêt pour lutter contre l’ « effet Fed » provoquant une hausse du Dollar australien par rapport au Dollar US ; comme pour le Dollar canadien et le Franc suisse, la devise australienne casse la barrière de la parité avec une devise américaine en pleine déconfiture. L’Inde a agit de même que l’Australie. Sources : Telegraph, 02 novembre 2010 ; Wall Street Journal, 02 novembre 2010
(7) Cela illustre parfaitement le remarquable article de Michael Hudson dans CounterPunch du 11 octobre 2010, intitulé « Pourquoi l’Amérique a lancé une nouvelle guerre financière mondiale… et comment le reste du monde va riposter ».
(8) Comme l’écrit Doug Noland le 05 novembre 2010 dans son toujours excellent Credit Bubble Bulletin, « les décideurs mondiaux doivent désormais être exaspérés ». Et ils le sont. On est bien au-delà d’une simple confrontation sino-américaine comme pourrait le laisser penser cet amusant clip de rap sur le thème du conflit Dollar-Yuan. Source : NMA World Edition, 10 novembre 2010.
(9) Et on doit aussi mentionner les voix de plus en plus nombreuses (y compris au sein de la Fed) qui s’inquiètent du bilan dégradé de la banque centrale américaine. Le graphique ci-dessus montre ainsi que ses « actifs » sont plus que douteux : hypothèques détenues par Fannie Mae et Freddie Mac ainsi que leurs titres, actions d’AIG et Bear Stearns… Ce sont des « actifs-fantômes » dont la valeur est quasi-nulle. Pour le reste, si la Fed avait l’habitude de se contenter de demander l’avis de ses « primary dealers » pour estimer le volume de ses opérations d’achats de Bons du Trésor, elle va devoir apprendre à demander l’avis des autres banques centrales. Source : Bloomberg, 28 octobre 2011
(10) Comme l’a décrit fort justement Liam Halligan, dans le Telegraph du 06 novembre 2010, avec une image que le LEAP n’aurait pas désavouée : les Etats-Unis sont en train de vivre leur « Suez économique ». Il fait bien entendu référence à l’épisode de 1956 quand les deux puissances coloniales historiques, Royaume-Uni et France, ont tenté d’empêcher militairement la nationalisation du Canal de Suez par le Colonel Nasser… et qu’elles ont dû s’arrêter net quand les Etats-Unis et l’URSS, affirmant leur nouveau statut de maitres du monde, leur ont signifié qu’ils étaient opposés à cette intervention. « Suez » marqua la prise de conscience généralisée que l’époque coloniale était terminée et que les puissances d’hier ne seraient pas celles de demain. Le parallèle que fait Liam Halligan avec notre époque est donc très pertinent.
(11) Et ils sont loin d’être tous d’accord avec Ben Bernanke. Ainsi le président de la Réserve fédérale de Dallas dit clairement qu’il estime que la politique actuelle de la Fed est une erreur. Source : 24/7 WallStreet, 08 novembre 2010
(12) Et Goldman Sachs estime à 4.000 Milliards USD le besoin de « Quantative Easing » pour pallier les déficiences de l’économie US. Le prix de l’austérité et de la contrainte extérieure va donc être gigantesque. Source : ZeroHedge, 24 octobre 2010
(13) Même à l’intérieur des Etats-Unis, les inquiétudes se font jour sur le caractère éminemment dangereux de la politique de la Fed, posant même la question de savoir si la Fed ne va pas déclencher une nouvelle Guerre de Sécession. Source : BlogsTimeMagazine, 19 octobre 2010
(14) Même en Allemagne donc, qui pourtant est moins affectée que d’autres par les conséquences de la crise. Source : Reuters, 13 novembre 2010
(15) C’est également le cas des collectivités locales, qui, comme en France avec les départements, commencent à affronter des situations budgétaires intenables. Source : L’Express, 20 octobre 2010
(16) C’était une recommandation de notre équipe dès le printemps dernier.
(17) Voir dans ce [numéro] les éléments à ce sujet dans le chapitre sur le double choc électoral franco-allemand de 2012/2013.
(18) Sources : Spiegel, 26 octobre 2010 ; MarketWatch, 12 novembre 2010 ; RiaNovosti, 10 novembre 2010 ; Irish Times, 11 novembre 2010 ; NewropMag, 18 novembre 2010
(19) L’Europe va en effet voir son score en matière de protection douanière faire un bond en avant dans le très instructif palmarès des mesures affectant le commerce mondial réalisé par Global Trade Alert.
(20) Source : Le Figaro, 11 novembre 2010
(21) C’est l’incident des îles Senkaku/Diaoyutai. Source : Global Research, 06 octobre 2010
(22) Et d’autres éléments symboliques s’accumulent au-delà du niveau régional comme la récente revendication par la Chine de la première place en matière de super-ordinateurs, position ravie aux Etats-Unis qui la détenaient depuis les débuts de l’informatique dans l’après Seconde Guerre Mondiale. Source : Le Monde, 28 octobre 2010
(23) En octobre 2010, les ventes de voitures neuves ont été les pires depuis 42 ans. Source : Asahi Shimbun, 03 novembre 2010
(24) Fondée sur la parité de pouvoir d’achat, cette analyse s’accorde avec les analyses de l’équipe du LEAP qui [il y a deux mois] estimait que le PNB US est surestimé désormais d’environ 30%.




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg


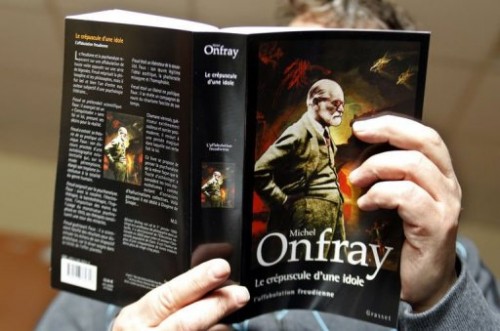

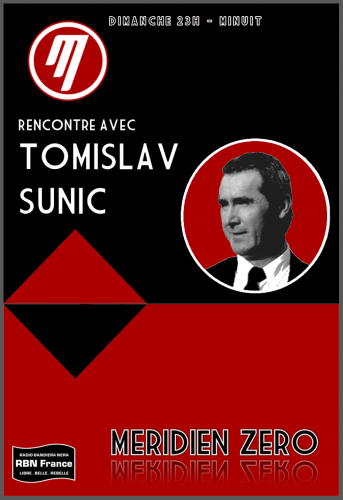
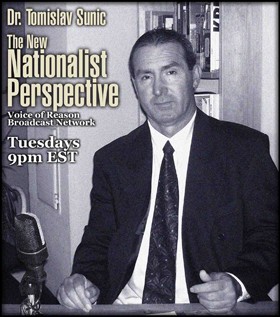 In 1993, upon my return from the USA, I became a diplomat in charge of cultural promotion in the early Tudjman government. I gave hundreds of speeches all over America and Europe regarding Croatia’s place in the world, the fallacy of multiculturalism, the fraud of modern historiography, etc. Disillusion and feelings of betrayal s00n followed. I had seriously thought that the legacy of communism was going to be removed, along with is former architects. Instead, the war in ex-Yugoslavia turned into an ugly war between similar ethnic groups. One thing I learned though: never get carried away too much even with your own political or philosophical ideas—they can backfire. Now, 15 years later, it seems to me that the whole Balkan chaos was cooked up by former Yugoslav communist elites—who in a twinkle of an eye decided to become either good liberals or petty nationalist rabble-rousers.
In 1993, upon my return from the USA, I became a diplomat in charge of cultural promotion in the early Tudjman government. I gave hundreds of speeches all over America and Europe regarding Croatia’s place in the world, the fallacy of multiculturalism, the fraud of modern historiography, etc. Disillusion and feelings of betrayal s00n followed. I had seriously thought that the legacy of communism was going to be removed, along with is former architects. Instead, the war in ex-Yugoslavia turned into an ugly war between similar ethnic groups. One thing I learned though: never get carried away too much even with your own political or philosophical ideas—they can backfire. Now, 15 years later, it seems to me that the whole Balkan chaos was cooked up by former Yugoslav communist elites—who in a twinkle of an eye decided to become either good liberals or petty nationalist rabble-rousers. Derrière un titre un peu racoleur, « 2030, la fin de la mondialisation » est en réalité un ouvrage technique, rédigé dans le cadre de l’Institut de Stratégie Comparée, répondant lui-même à une commande de la Délégation aux Affaires Stratégiques du Ministère de la Défense. L’étude repose sur un postulat : étant donné qu’il est impossible de prévoir les ruptures radicales technologiques, on admettra par hypothèse qu’il n’y en aura pas. Il s’agit, dans ce cadre prédéfini, de voir où en sera la question de la sécurité mondiale, en 2030, dans l’hypothèse où aucune innovation technologique soudaine et, à ce stade, imprévisible, ne viendrait bouleverser la donne.
Derrière un titre un peu racoleur, « 2030, la fin de la mondialisation » est en réalité un ouvrage technique, rédigé dans le cadre de l’Institut de Stratégie Comparée, répondant lui-même à une commande de la Délégation aux Affaires Stratégiques du Ministère de la Défense. L’étude repose sur un postulat : étant donné qu’il est impossible de prévoir les ruptures radicales technologiques, on admettra par hypothèse qu’il n’y en aura pas. Il s’agit, dans ce cadre prédéfini, de voir où en sera la question de la sécurité mondiale, en 2030, dans l’hypothèse où aucune innovation technologique soudaine et, à ce stade, imprévisible, ne viendrait bouleverser la donne.

 Le idee politiche sono paragonabili a quei fiumi “carsici” che nei loro tortuosi e rapidi percorsi sprofondano nelle viscere delle montagne per riaffiorare, poi e a distanza di molti chilometri, improvvisamente e più impetuosi di prima.
Le idee politiche sono paragonabili a quei fiumi “carsici” che nei loro tortuosi e rapidi percorsi sprofondano nelle viscere delle montagne per riaffiorare, poi e a distanza di molti chilometri, improvvisamente e più impetuosi di prima. 

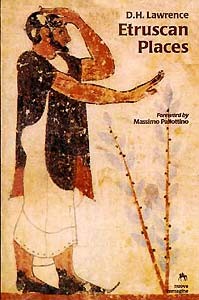 C’est à la fin du VIIe siècle avant la naissance du Christ qu’apparaît en Toscane une population que les Latins appelleront Tusci ou Etrusci, dont les origines continuent de rester énigmatiques. On suggère aujourd’hui que la culture étrusque est née d’un ancien substrat local qui s’est lentement modifié au cours des différentes vagues de population s’installant en Italie, tandis que l’hypothèse qui prévalait au début du siècle passé rejoignait le récit d’Hérodote, d’après lequel ce peuple serait venu par la mer de Lydie.
C’est à la fin du VIIe siècle avant la naissance du Christ qu’apparaît en Toscane une population que les Latins appelleront Tusci ou Etrusci, dont les origines continuent de rester énigmatiques. On suggère aujourd’hui que la culture étrusque est née d’un ancien substrat local qui s’est lentement modifié au cours des différentes vagues de population s’installant en Italie, tandis que l’hypothèse qui prévalait au début du siècle passé rejoignait le récit d’Hérodote, d’après lequel ce peuple serait venu par la mer de Lydie.  Lawrence, suivant en cela la leçon d’un nombre incalculable d’auteurs mais sans toutefois tomber dans le délire de certains qui, comme Keyserling, fonda à Darmstadt en 1920 une École de la Sagesse dénonçant les limites de la culture occidentale et puisant son enseignement de pacotille dans une Inde fantasmée, confère au monde ancien une vertu éminente : au contraire de ce que nous pouvons constater à notre époque de spécialistes qui poussent de grands cris dès qu’un esprit un peu audacieux essaie de créer des passerelles entre plusieurs domaines de savoir, le monde ancien ne craignait pas d’établir des parentés symboliques, donc réelles, entre les êtres vivants et les choses, reliés par un flux souterrain de sang (5). «Merveilleux monde, écrit ainsi Lawrence, qu’était sans doute ce monde ancien où toutes choses semblaient vivantes, luisantes dans l’ombre crépusculaire du contact qui les faisait se toucher, un monde où chaque chose n’était pas seulement une individualité isolée prise au piège de la lumière diurne; où chaque chose apparaissait en son clair contour, visuellement, mais qui du sein de sa clarté même était reliée par des affinités émotionnelles ou vitales à d’autres choses étranges, une chose surgissant d’une autre, mentalement contradictoires qui fusionnaient dans l’émotion, si bien qu’un lion pouvait au même instant être aussi une chèvre, et ne pas être une chèvre [Lawrence a évoqué précédemment la chimère en bronze d’Arezzo, conservée au musée de Florence et qui fut en partie restaurée par Benvenuto Cellini)» (p. 142).
Lawrence, suivant en cela la leçon d’un nombre incalculable d’auteurs mais sans toutefois tomber dans le délire de certains qui, comme Keyserling, fonda à Darmstadt en 1920 une École de la Sagesse dénonçant les limites de la culture occidentale et puisant son enseignement de pacotille dans une Inde fantasmée, confère au monde ancien une vertu éminente : au contraire de ce que nous pouvons constater à notre époque de spécialistes qui poussent de grands cris dès qu’un esprit un peu audacieux essaie de créer des passerelles entre plusieurs domaines de savoir, le monde ancien ne craignait pas d’établir des parentés symboliques, donc réelles, entre les êtres vivants et les choses, reliés par un flux souterrain de sang (5). «Merveilleux monde, écrit ainsi Lawrence, qu’était sans doute ce monde ancien où toutes choses semblaient vivantes, luisantes dans l’ombre crépusculaire du contact qui les faisait se toucher, un monde où chaque chose n’était pas seulement une individualité isolée prise au piège de la lumière diurne; où chaque chose apparaissait en son clair contour, visuellement, mais qui du sein de sa clarté même était reliée par des affinités émotionnelles ou vitales à d’autres choses étranges, une chose surgissant d’une autre, mentalement contradictoires qui fusionnaient dans l’émotion, si bien qu’un lion pouvait au même instant être aussi une chèvre, et ne pas être une chèvre [Lawrence a évoqué précédemment la chimère en bronze d’Arezzo, conservée au musée de Florence et qui fut en partie restaurée par Benvenuto Cellini)» (p. 142).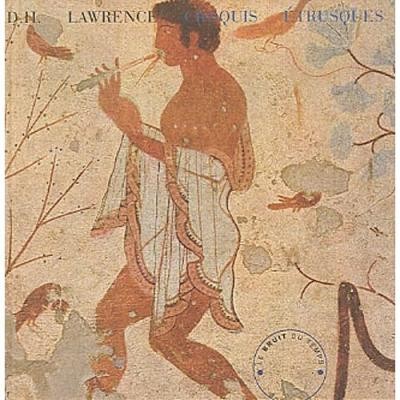 C’est dans un chapitre inachevé, resté à l’état de manuscrit et qui, peut-être, eût pu servir à Lawrence de conclusion pour ses Croquis étrusques, intitulé Le musée de Florence, que l’auteur va systématiser ses intuitions sur le thème d’une déperdition, au travers des siècles, d’une force rayonnante qui s’échappe désormais inéluctablement des œuvres des hommes. Ainsi, selon Lawrence, nous devons bien comprendre que les religions elles-mêmes de nos ancêtres les plus magnifiques, comme le sont, à ses yeux, les Étrusques, ne sont que des bribes d’un savoir immémorial ayant précédé les plus anciennes civilisations : «Ce qu’il nous faut saisir lorsque nous contemplons des œuvres étrusques, c’est que celles-ci nous révèlent les derniers feux d’une conscience cosmique humaine – disons, la tentative d’hommes aspirant à la conscience cosmique – différente de la nôtre. L’idée qui veut que notre histoire soit issue des cavernes ou de précaires habitats lacustres est puérile. Notre histoire prend corps à l’achèvement d’une phase précédente de l’histoire humaine, une phase prodigieuse et comparable à la nôtre. Il est bien plus vraisemblable que le singe descende de nous que nous du singe» (p. 225). Renversement de perspective qui a dû faire bondir les esprits scientistes ou chagrins, c’est tout un, qui lurent les Croquis étrusques lorsqu’ils furent publiés ! On se demande même comment l’auteur n’a semble-t-il pas été traité de réactionnaire. Il l’a peut-être été, à la réflexion, tout comme on n’a pas manqué de lui reprocher son manque de sérieux scientifique (cf. la réception du livre, pp. 272-278). Citons donc longuement ce très beau passage, toujours extrait du même texte qui ne fut pas recueilli en livre par Lawrence, où il semble sérieusement douter de la théorie de l’évolution, l’homme ayant toujours été un homme, l’homme ne provenant pas du singe comme nous l’avons vu mais l’homme, pourtant, depuis qu’il s’est coupé de ses plus profondes racines de savoir symbolique, paraissant en revanche devoir dégénérer, dévoluer : «Les civilisations apparaissent comme des vagues, et comme des vagues elles s’évanouissent. Tant que la science, ou l’art, n’aura pu saisir le sens dernier de ces symboles flottant sur l’ultime vague de la période préhistorique, c’est-à-dire cette période qui précède la nôtre, nous ne serons pas en mesure d’instituer la juste relation avec l’homme en ce qu’il est, en ce qu’il fut, en ce que toujours il sera.
C’est dans un chapitre inachevé, resté à l’état de manuscrit et qui, peut-être, eût pu servir à Lawrence de conclusion pour ses Croquis étrusques, intitulé Le musée de Florence, que l’auteur va systématiser ses intuitions sur le thème d’une déperdition, au travers des siècles, d’une force rayonnante qui s’échappe désormais inéluctablement des œuvres des hommes. Ainsi, selon Lawrence, nous devons bien comprendre que les religions elles-mêmes de nos ancêtres les plus magnifiques, comme le sont, à ses yeux, les Étrusques, ne sont que des bribes d’un savoir immémorial ayant précédé les plus anciennes civilisations : «Ce qu’il nous faut saisir lorsque nous contemplons des œuvres étrusques, c’est que celles-ci nous révèlent les derniers feux d’une conscience cosmique humaine – disons, la tentative d’hommes aspirant à la conscience cosmique – différente de la nôtre. L’idée qui veut que notre histoire soit issue des cavernes ou de précaires habitats lacustres est puérile. Notre histoire prend corps à l’achèvement d’une phase précédente de l’histoire humaine, une phase prodigieuse et comparable à la nôtre. Il est bien plus vraisemblable que le singe descende de nous que nous du singe» (p. 225). Renversement de perspective qui a dû faire bondir les esprits scientistes ou chagrins, c’est tout un, qui lurent les Croquis étrusques lorsqu’ils furent publiés ! On se demande même comment l’auteur n’a semble-t-il pas été traité de réactionnaire. Il l’a peut-être été, à la réflexion, tout comme on n’a pas manqué de lui reprocher son manque de sérieux scientifique (cf. la réception du livre, pp. 272-278). Citons donc longuement ce très beau passage, toujours extrait du même texte qui ne fut pas recueilli en livre par Lawrence, où il semble sérieusement douter de la théorie de l’évolution, l’homme ayant toujours été un homme, l’homme ne provenant pas du singe comme nous l’avons vu mais l’homme, pourtant, depuis qu’il s’est coupé de ses plus profondes racines de savoir symbolique, paraissant en revanche devoir dégénérer, dévoluer : «Les civilisations apparaissent comme des vagues, et comme des vagues elles s’évanouissent. Tant que la science, ou l’art, n’aura pu saisir le sens dernier de ces symboles flottant sur l’ultime vague de la période préhistorique, c’est-à-dire cette période qui précède la nôtre, nous ne serons pas en mesure d’instituer la juste relation avec l’homme en ce qu’il est, en ce qu’il fut, en ce que toujours il sera.
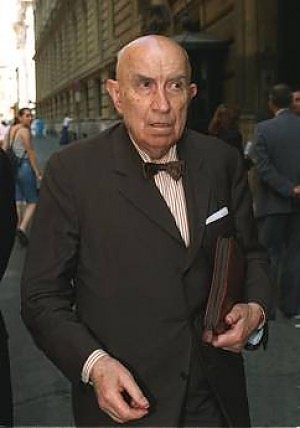 GIANFRANCO MIGLIO
GIANFRANCO MIGLIO



 On connaît le refrain, il scande un demi-siècle d’antifascisme parodique. On le croyait inusable, mais il a vieilli. Il faut dire que la bête immonde a profondément mué. Elle ne porte plus des cornes, mais des Ray Ban. La chirurgie esthétique a adouci ses traits. Chemin faisant, on est passé des années 40 au CAC 40. C’est beaucoup plus fun. Il manquait un nom à cette nouvelle bête. Raffaele Simone lui en a trouvé un, c’est « le Monstre doux », titre de son dernier livre***, qui a fait pas mal de remous en Italie à sa sortie en 2009, dans un pays berluscosinistré. L’ouvrage n’est pas sans intérêt, même s’il n’apporte rien de nouveau, en tout cas rien qui n’ait déjà été dit par Tocqueville. Ce monstre doux, c’est l’Occident qui virerait à droite, selon Simone, mélange de Big Brother et de Mickey Mouse.
On connaît le refrain, il scande un demi-siècle d’antifascisme parodique. On le croyait inusable, mais il a vieilli. Il faut dire que la bête immonde a profondément mué. Elle ne porte plus des cornes, mais des Ray Ban. La chirurgie esthétique a adouci ses traits. Chemin faisant, on est passé des années 40 au CAC 40. C’est beaucoup plus fun. Il manquait un nom à cette nouvelle bête. Raffaele Simone lui en a trouvé un, c’est « le Monstre doux », titre de son dernier livre***, qui a fait pas mal de remous en Italie à sa sortie en 2009, dans un pays berluscosinistré. L’ouvrage n’est pas sans intérêt, même s’il n’apporte rien de nouveau, en tout cas rien qui n’ait déjà été dit par Tocqueville. Ce monstre doux, c’est l’Occident qui virerait à droite, selon Simone, mélange de Big Brother et de Mickey Mouse.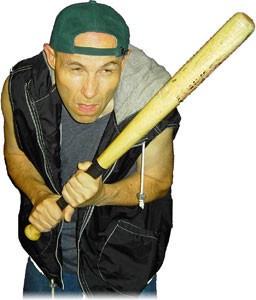 Eine Einbürgerung kann in Deutschland künftig auch wieder rückgängig gemacht werden, wenn der eingebürgerte Ausländer die Behörden getäuscht hat. Etwa über seine kriminelle Vergangenheit. Wer den Behörden bei der Einbürgerung verschweigt, dass er ein Krimineller ist, der kann selbst dann wieder ausgebürgert werden, wenn er dadurch staatenlos wird. Geklagt hatte ein Geschäftsmann, der den Behörden bei seiner Einbürgerung in Deutschland verschwiegen hatte, dass in seinem Geburtsland Ermittlungen wegen Betruges gegen ihn liefen. Der 54-Jährige sitzt in Deutschland eine sechs Jahre währende Haftstrafe wegen Anlagebetruges ab. Vor zehn Jahren war er hier eingebürgert worden. Aber er war eben auch schon in seinem Herkunftsland kriminell in Erscheinung getreten, hatte das bei den deutschen Behörden aber nicht angegeben. Die Leipziger Richter des Bundesverwaltungsgerichts, die ihn nun mit ihrer Entscheidung zum Staatenlosen machten, entschieden sogar, ihr Vorgehen sei mit dem Europarecht vereinbar. Nach dieser Entscheidung könnten nun viele Migranten, die straffällig geworden sind und das bei ihrer Einbürgerung verschwiegen haben, wieder ausgebürgert werden.
Eine Einbürgerung kann in Deutschland künftig auch wieder rückgängig gemacht werden, wenn der eingebürgerte Ausländer die Behörden getäuscht hat. Etwa über seine kriminelle Vergangenheit. Wer den Behörden bei der Einbürgerung verschweigt, dass er ein Krimineller ist, der kann selbst dann wieder ausgebürgert werden, wenn er dadurch staatenlos wird. Geklagt hatte ein Geschäftsmann, der den Behörden bei seiner Einbürgerung in Deutschland verschwiegen hatte, dass in seinem Geburtsland Ermittlungen wegen Betruges gegen ihn liefen. Der 54-Jährige sitzt in Deutschland eine sechs Jahre währende Haftstrafe wegen Anlagebetruges ab. Vor zehn Jahren war er hier eingebürgert worden. Aber er war eben auch schon in seinem Herkunftsland kriminell in Erscheinung getreten, hatte das bei den deutschen Behörden aber nicht angegeben. Die Leipziger Richter des Bundesverwaltungsgerichts, die ihn nun mit ihrer Entscheidung zum Staatenlosen machten, entschieden sogar, ihr Vorgehen sei mit dem Europarecht vereinbar. Nach dieser Entscheidung könnten nun viele Migranten, die straffällig geworden sind und das bei ihrer Einbürgerung verschwiegen haben, wieder ausgebürgert werden.
 Thus the first priority was to keep these people as safe as possible from another slaughter. At the same time, Pétain hoped for a future renaissance through a “national revolution.” He has been attacked for that. Admittedly, all would be mortgaged by the Occupation. But really he had no choice. The “national revolution” was not premeditated. With all its ambiguities, it emerged spontaneously as a necessary remedy to the evils of the previous regime.
Thus the first priority was to keep these people as safe as possible from another slaughter. At the same time, Pétain hoped for a future renaissance through a “national revolution.” He has been attacked for that. Admittedly, all would be mortgaged by the Occupation. But really he had no choice. The “national revolution” was not premeditated. With all its ambiguities, it emerged spontaneously as a necessary remedy to the evils of the previous regime.


