AUßENPOLITISCHES
Globale Verschuldung steigt auf 325 % der Wirtschaftsleistung
Studie zu sozialer Ungleichheit
Acht Menschen reicher als Hälfte der Welt
Wirtschaftsgipfel in Davos
Die vier Krankheiten des Kapitalismus
Die größte Sorge der Elite sind fallende Börsenkurse - normalerweise. Doch beim Wirtschaftsforum in Davos ist 2017 alles anders. Was Manager und Politiker diesmal umtreibt, ist viel schlimmer.
IWF-Bericht
Griechenlands Schuldenlast langfristig "explosiv"
Wagenknecht für Nato-Auflösung und Sicherheitsbündnis mit Rußland
"Das Jahr der Patrioten" - Treffen EU-kritischer Parteien in Koblenz (JF-TV Reportage)
Obamas Knieschuß
von Thomas Fasbender
„Das Zittern der Kollaborateure“ – FPÖ-Außenpolitiksprecher Dr. Johannes Hübner im ZUERST!-Gespräch
Alexander Van der Bellen
Österreichs neuer Präsident bekennt sich zu Europa
Frankreich
Rücktritt bei Anklage
Fillons rote Linie
Tschechiens Innenminister will Waffenzugang für Bürger erleichtern
Spezialeinheiten der Polizei nahmen in Wien Terrorverdächtigen fest
Gewalt in Großbritannien
Insel des Hasses
Großbritannien ist das Land mit den meisten Hassverbrechen in Europa. Die Leute sind dort aber gar nicht schlimmer als anderswo. Spielen Polizei und Staatsanwaltschaft ihr eigenes Spiel?
Bundeswehr im Nato-Einsatz
Panzertruppe bricht nach Litauen auf
Die Nato rüstet im östlichen Bündnisgebiet massiv auf, um Russland militärisch abzuschrecken. Die Bundeswehr verlegt aus diesem Grund eine Panzertruppe nach Litauen. Die Linke warnt vor einer Eskalation.
Mindestens 35 Tote bei Angriff auf Nachtclub Reina in Istanbul
Large Explosion Reported in Turkish City of Izmir
Turkey reinforcing its presence in al-Shahba
Nach dem Fall Aleppos
Der Syrienkrieg wird nicht enden, aber er ändert sich
"Was Sie über Aleppo hören, ist bestenfalls ein kleiner Teil der Wahrheit"
Interview mit dem Konfliktforscher Jan Oberg, der die Befreiung Aleppos als "weltgeschichtliches" Ereignis einstuft
Israelische Kampfflugzeuge greifen syrische Armee in Damaskus an
Syrien
IS zerstört Teile der antiken Stadt Palmyra
Während im Nordwesten von Syrien mehrere Dutzend Anhänger der Terrormiliz bei einem Luftangriff getötet werden, wird bekannt, dass die Extremisten neue Teile der antiken Stadt Palmyra zerstört haben.
Moderater Islam
Kampf gegen Kriminelle: Marokko verbietet Burkas
Fort Lauderdale: Der Mörder ist ein Islamist
Der 26-jährige Islamist Esteban Santiago hat am Flughafen Fort Lauderdale in Florida mindestens fünf Menschen erschossen und neun weitere verletzt.
Friedensnobelpreisträger Obama warf im letzten Amtsjahr 26.171 Bomben ab
(Zur Zeit nach Obama und zu den internationalen Eliten)
Me, Myself and Media 30 - Cheops, deine Zeit ist um!
Kommentar zu Trump
Der Anti-Achtundsechziger
Make thinking logical again
Der Schock über die Wahl Trumps lag wie ein Biberdamm im Gefühlsstrom der Deutschen. Doch nun bricht sich scheinbar etwas Bahn, was acht Jahre lang als gezähmtes und „differenziertes“ Rinnsal durch deutsche Gemütsschluchten und Blätterwälder kroch: Der latente linke Antiamerikanismus.
„Antifa“-Terror gegen Trump
Diesen kriminellen Abschaum kennen wir aus Deutschland zur Genüge. „Antifa“-Fahnen, Vermummung, Schlagwerkzeuge – damit wird in den USA unter Trump jetzt aufgeräumt!
Wahlkampfversprechen eingelöst
Trump kündigt Handelsabkommen TPP auf
Trump streicht Abtreibungslobby die Mittel
Nato
Trump wird Merkel nicht von der Angel lassen
Mit Goebbels‘ Sekretärin gegen Trump
Den deutschen Medienschaffenden sind in diesen Tagen im Umgang mit Donald Trump die letzten Schamgrenzen abhanden gekommen. Die jüngste Wunderwaffe gegen die „dritte Inkarnation des Teufels“ nach Napoleon und Hitler („Bild“ über Trump) heißt Brunhilde Pomsel, die am Freitag in einem Altenheim mit 106 Jahren starb. Sie war eine der ältesten Frauen Deutschlands. Im Zweiten Weltkrieg arbeitete sie als Sekretärin im Büro von Propagandaminister Joseph Goebbels.
Wahlleugner
Die Trump-Hasser, darunter ein Grossteil der Medien, kommentieren das Geschehen, als sei ein irrer Putschgeneral am Wüten.
Kredite für Enkel
US-Rentner müssen 67 Milliarden Dollar Studiengebühren abstottern
Fast drei Millionen Amerikaner über 60 Jahre sind verschuldet, weil sie Studiengebühren zurückzahlen müssen. Die meisten haben die Kredite für Kinder oder Enkel aufgenommen.
Millennials
Junge weiße Amerikaner verdienen viel weniger als ihre Eltern
Sie haben ein geringeres Einkommen, weniger Vermögen und seltener ein Haus: Jungen Weißen in den USA geht es heute schlechter als ihren Eltern in den Achtzigern. Anders ist die Lage bei Schwarzen und Latinos.
Proteste in Mexiko
Wut auf die Eliten, Angst vor der Zukunft
Nach Protesten in Mexiko steht das Land kurz vor einer Revolution und niemand spricht darüber
INNENPOLITISCHES / GESELLSCHAFT / VERGANGENHEITSPOLITIK
Kanzlerin erinnert an Werte
Merkel stellt unmissverständlich klar: "Wir alle sind das Volk"
Staatsversagen. Schmerzhafte Erkenntnisse
Merkels Rechtsbruch? Unglaubliches zur Grenzöffnung & zur Migrationswelle - Flüchtlinge 2017
2017: Vier Kämpfe, vier Fronten
von Wolfgang Hübner
Neujahrsansprache Dr. Frauke Petry (AfD)
Die Unruhe der Etablierten
von Karlheinz Weißmann
(Polit-Satire)
Zwischenruf von der Grünen Couch – Folge 1
Patrick Schenk zu den Zeitläufen
Erika Steinbach verlässt die CDU und wirft Merkel Rechtsbruch vor
(Zu Norbert Lammert)
Volk als Fiktion
von Karlheinz Weissmann
Außenminister nimmt in Frankfurt den Ignatz-Bubis-Preis entgegen
Steinmeier warnt vor "völkischem Denken"
In Frankfurt nimmt der Außenminister und wahrscheinliche nächste Bundespräsident den Ignatz-Bubis-Preis an. Steinmeier sieht die Auszeichnung auch als Auftrag.
(Broder rechnet mit der medialen und politischen Kaste ab)
Henryk M Broder: "Kölner Silvesternacht - Es war ein Pogrom!" / Bürgerliche Freiheit in Gefahr
(Zu Martin Schulz)
Das Establishment hat seinen Populisten
von Thomas Fasbender
2017 - Jahr der Entscheidung
Martin Schulz – der größte Abkassierer von allen?
Nicolaus Fest zum Kanzlerkandidaten Martin Schulz
Terrorismus
BKA warnt vor Anschlägen mit Chemie-Waffen
Bundestagswahl
Spitzenkandidaten: Grüne spielen Demokratie
Das grüne Dilemma
von Björn Schumacher
Online-Petition
Grünen-Mitglied fordert Talkshow-Verbot für Rainer Wendt
Oberhausen: Polizei rechnet Einbruchszahlen runter
Verdacht der Bestechlichkeit
Staatsanwalt ermittelt auch gegen ehemaligen Regensburger OB
In der Parteispendenaffäre um den Regensburger SPD-Oberbürgermeister Wolbergs ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen dessen Vorgänger. Auch dem CSU-Politiker Schaidinger wird Bestechlichkeit vorgeworfen.
Berlin: Unser Dorf soll schöner werden
Die Hauptstadtpresse bejubelt ihren neuen Bürgermeister, der der alte ist und uralte Ideen verfolgt - die aus der Hauptstadt der DDR. Der Staat kann alles, der Bürger nichts, außer Rad fahren.
Nach Rede zum Holocaust-Mahnmal
AfD-Chefin Petry: „Höcke ist eine Belastung für die Partei“
Björn Höcke und das »Denkmal der Schande«
Persönliche Erklärung von Björn Höcke zu seiner Dresdner Rede
Meinung
Höckes Bärendienst
von Michael Paulwitz
Nach Holocaust-Rede
AfD-Chef Meuthen hält Streit um Höcke für erledigt
Nach Höcke-Rede
Gabriel fordert Verfassungsschutz-Beobachtung der AfD
Nach kritisierter Rede
AfD-Vorstand leitet Ordnungverfahren gegen Höcke ein
AfD-Führung, es reicht!
Von Wolfgang Hübner
Die Rückkehr der sozialen Frage
(ebenfalls zur sozialen Frage)
Die soziale Frage
„Stolperstein in der Geschichte“
Uni Greifswald streicht ihren Beinamen „Ernst Moritz Arndt“
Mühlheim
Bogen zur Gegenwart konsequent gespannt
Schüler stellen Auschwitz-Projekt vor

LINKE / KAMPF GEGEN RECHTS / ANTIFASCHISMUS / RECHTE
Identitäre Bewegung
Die neuen Rechten - hip und völkisch
Keine Glatzen mit Springerstiefeln, sondern smarte Jungs in Sneakern. Die Identitäre Bewegung gibt sich modern. Ihr Spielfeld: Facebook und Twitter. Ihre Haltung: national. Ihr Feind: der Islam.
(Die "antifaschistische" Journalistin Andrea Röpke bekommt mal wieder den WDR als Bühne zur Verbreitung ihrer Thesen gegen die "Identitären" zur Verfügung gestellt)
Das braune Netzwerk
Ein Film von Caterina Woj und Andrea Röpke
(…und eine Antwort auf Röpke von Martin Sellner)
Hausdurchsuchung bei Aktivisten der Identitären Bewegung Schwaben
PI-News
Undercover-Reporter reist mit Rechtspopulisten – und ist schockiert
(Links beeinflusste Amtskirchen…)
Meinung
Wider den Weltverbesserungsplan
von Karlheinz Weißmann
Bayern-Präsident Hoeneß hetzt gegen AfD
Der Fußball als Büttel der Antifa-Politik
Eintracht-Funktionäre wettern gegen AfD und Trump
Kardinal Marx zieht rote Linie zur AfD
Ingo Kramer
Arbeitgeberpräsident: AfD ist „tödlich für unsere Volkswirtschaft“
Nach kritischer Mail SPD-Mann Lauer outet Sparkassen-Mitarbeiter als AfD-Fan
Christopher Lauer ist immer wieder rechter Hetze ausgesetzt. Nun hat der SPD-Mann die Mail eines AfD-Anhängers veröffentlicht, abgesendet von dessen Sparkassen-Account.
(SPD-Politiker Christopher Lauer)
Der Schmalspur-Denunziant
von Michael Paulwitz
(Zu Saskia Esken, Christopher Lauer, Rainer Faus…)
Unbelehrbare Denunzianten
von Michael Paulwitz
(Zu Andrej Holm)
Linker Staatssekretär absolvierte Schulungskurs für Stasi-Laufbahn
Berlin
Müller entläßt Stasi-belasteten Staatssekretär Holm
„Arglistige Täuschung“
Humboldt-Universität entläßt Andrej Holm
(Zu Lalon Sander)
Auf einen Bubble Tea mit der „taz“
von Felix Krautkrämer
(Zur Erinnerung hier nochmals etwas zur Ideologie von Lalon Sander…)
Rassismus in der „taz“
Sahra Wagenknechts Freischwimmen gegen Rechts
(Der "Links-Staat"…)
Doku „Der Links-Staat“
Bayerischer Rundfunk geht gegen unliebsame DVD vor
Historisches Urteil in Karlsruhe
Bundesgerichtshof entscheidet: NPD wird nicht verboten
Rechte unter Artenschutz
Kommentar: NPD wird nicht verboten
(Geld möglichst nur für etablierte Parteien…)
NPD-Urteil
Beuth will Finanzierung der Partei überprüfen
Reichsbürger im Visier
Razzien gegen mutmaßliche Rechtsextremisten in mehreren Bundesländern
(Wenn mal wieder von "jungen Leuten" die Rede ist…)
Hanau
Suppe aus der "Volxküche"
Autonomes Kulturzentrum feiert 30-jähriges Bestehen
Thema "Geschlechterforschung"
Proteste gegen AfD-Vorlesung an der Magdeburger Uni
An der Universität Magdeburg ist eine geplante Veranstaltung der AfD von Studenten gestoppt worden. Die Rechtspopulisten um André Poggenburg verließen nach Randalen den Raum.
Linksextreme dürfen an Universität Blockaden üben
Wenn sich im Sommer die mächtigsten Staatschefs der Welt in Hamburg treffen, werden auch diverse Linksextreme demonstrieren. An der Hamburger Uni dürfen sie für ihr Training die Räumlichkeiten nutzen.
TU Dortmund: Öffentliche Gründung der „Anarchistischen Hochschulgruppe“ an Nationalisten gescheitert!
Berlin
Linksextremisten bekennen sich zu Steinwürfen auf Polizei

EINWANDERUNG / MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT
(Zur Lobbyorganisation Pro Asyl)
Pro Asyl – Migrationsnetzwerk und Meinungsmacht
Starker Anstieg der Migrationsbereitschaft in Nordafrika
Asyl in Deutschland
Familiennachzug um 50 Prozent gestiegen
Das Auswärtige Amt erteilte im vergangenen Jahr 105.000 Visa. Dabei waren besonders viele Syrer und Iraker. Zudem nahm Deutschland mehr als 12.000 Asylbewerber zurück.
Bundespolizist: Grenze zu NRW „offen wie ein Scheunentor“
Generation haram
(Die taz gibt Tipps zur Scheinehe für Einwanderungswillige…)
taz.gazete-Ratgeber
Welcome to Almanya
Sie leben in der Türkei und wollen nach Deutschland migrieren? Das wird nicht einfach. Hier sind fünf Möglichkeiten zur Auswanderung, vier davon legal.
Papiere? Der Eritreer schüttelt den Kopf
Keine Handy-Kontrolle von Asylbewerben ohne Papiere
Generalstaatsanwaltschaft ermittelt - Syrische Botschaft in Berlin verkauft angeblich Pässe
Geburtsdatum 1. Januar
Flüchtlinge werden volljährig: Asylkosten für Kommunen explodieren
(Ein Beispiel aus dem Ausland)
Israel zieht Gehalt von Asylbewerbern ein
Özdemir fordert Visa-Erleichterung für Maghreb-Staaten
Zeichen der Wiedergutmachung
Brandenburg schiebt Opfer „rechter Gewalt“ nicht mehr ab
Mehr als 5.000 abgelehnte Asylsuchende
Brandenburg schiebt kaum ab
Erneute Sammelabschiebung
Bloß nicht abschieben
von Moritz Schwarz
Mitarbeiterin zeigte 300 Asyl-Sozialbetrüger an – Gegen den Willen der Aufnahmebehörde
Braunschweig
Scheinidentitäten: Ermittlungen in 100 Betrugsfällen
Haushalt 2016
21,7 Milliarden Euro für Flüchtlinge
Migrationspolitik - Jedes Unrecht beginnt mit einer Lüge
Merkels Rechtsbruch? Unglaubliches zur Grenzöffnung & zur Migrationswelle - Flüchtlinge 2017
(Die nächste Kunst-Propaganda-Aktion zur Beeinflussung von Schülern)
Ideen gegen Menschenfeindlichkeit
Demokratie trifft Street-Art
(Sie sind offenbar gekommen, um deutschen Rentnern den Po zu putzen…)
Vorstoß von Hermann Gröhe
Flüchtlinge sollen Pfleger werden
Polizeigewerkschaft sucht nordafrikanische Polizeischüler
Gesellschaft im Wandel
Immer mehr Polizisten mit Migrationshintergrund
(Einwanderungshelfer klagen…)
PEGIDA-Bachmann hat schon wieder einen neuen Prozess am Hals
Flüchtlinge 300 Euro für Taxifahrt zum Sozialamt!
Integration soll gefördert werden
Ansturm auf Fahrschulen durch Asylbewerber
Integrationspolitik
Ex-Lageso-Chef fordert Lotsen für jeden Flüchtling
90 Prozent wollen bleiben
Milliarden für Integration von Zuwanderern notwendig
Kripo-Chef kritisiert Bund nach massenhaftem Sozialbetrug durch Asylbewerber
Flüchtlinge sind nicht krimineller als Deutsche –
sie begehen nur mehr Straftaten: Das Ergebnis meines Aufrufs zur statistischen "Tiefenbohrung" vom 8. Dezember 2016
von Michael Klonovsky
(Auch ein Lösungsversuch… Mehr rot-grüne Pädagogen mit vom Steuerzahler finanzierten Arbeitsstellen versorgen…)
Erzieher: Polizisten allein schaffen es nicht
Damit junge Flüchtlinge nicht zu Kriminellen werden, braucht Deutschland mehr Erzieher.
90 Prozent arbeitslos
Österreich: Immer mehr Anzeigen gegen Asylbewerber
(Nachtrag zur Rezeption des Berlin-Attentats)
Von Leichenfledderer zu Leichenfledderer
Attacke auf Weihnachtsmarkt
Wagenknecht gibt Merkel Mitschuld an Terroranschlag
Nach Protesten: Gedenkminute in Berlin für Anschlagsopfer
(Zum Berliner Attentat)
Eine widerwillige „Schwamm drüber Stimmung“
Andere Länder, andere Sitten: die Opfer des Attentates am Stade de France von Paris wurden mit einem bewegenden Staatsbegräbnis beigesetzt. (…)In den letzten drei Wochen wurde nicht bekannt, dass Spitzenpolitiker die Verletzten des Berliner Attentats im Krankenhaus besucht hätten. (…)
Weihnachtsmarkt-Anschlag Berlin, eine Stadt ohne Mitgefühl
Behörden wußten von IS-Terroristen im Flüchtlingsstrom
Deutschland im Jahr 2017: Ein Kommentar von Claus Strunz
Libanesische Familienclans beherrschen im Ruhrgebiet ganze Straßenzüge
Parallelwelten? "No-Go-Areas"? Wie die Sicherheitslage im Gelsenkirchener Süden aussieht, schildert ein Polizist vor einem U-Ausschuss im Landtag. Von mafiösen Strukturen ist die Rede.
Berlin-Neukölln
Auto an Silvester abgefackelt: Tatverdächtige sind wieder frei
»Das Verschweigen hat System« Kositza im COMPACT-Gespräch
Ellen Kositza sprach für die aktuelle COMPACT-Ausgabe mit Jürgen Elsässer über ihr Buch Die Einzelfalle und das dröhnende mediale Schweigen zum Frauenhaß muslimischer Zuwanderer.
(So etwas muss ja auch erst einmal mit Steuerzahlergeld erklärt werden…)
Senat startet Postkartenaktion "Nein heißt Nein"
Kurz vor Silvester startet Gleichstellungssenatorin Dilek Kolat eine Aktion, um die Strafbarkeit sexueller Belästigung aufmerksam zu machen.
Silvester in Köln
Große Gruppen von Nordafrikanern irritieren die Polizei
Simone Peter und die Polizei
Die Wirklichkeit drängt ans Licht
von Karlheinz Weißmann
Kommentar
Neujahrsnacht hinterlässt bitteren Nachgeschmack
Schwarzer: Nordafrikanern ging es um Machtprobe
Silvesternacht
„Klientel von 2015“: Warum zog es erneut mehr als 1000 Nordafrikaner zum Dom?
Silvesternacht
Polizist schildert Einsatz: „Die haben Konfrontation gesucht“
Die herbeifantasierte „Realität“ der Frankfurter Rundschau
Linker Kampfjournalismus, einmal näher betrachtet
(Das hat eigentlich alles gar nichts mit Nordafrikanern zu tun…)
Ausländerbeirat lobt Kölner Beamte
„Dankeschön an Polizei“
Kontrolle von Nordafrikanern
Köln: Polizei verteidigt Silvestereinsatz
Kölner Polizei distanziert sich von „Nafri“-Tweet
Zahlreiche Sex-Attacken an Silvester
Frankfurter Polizei meldet Festnahmen wegen sexueller Belästigung
Die Frankfurter Polizei hat in der Silvesternacht mehrere Männer festgenommen. Gegen alle fünf sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Auch andernorts in Hessen gab es Zwischenfälle.
Silvester in Deutschland
Im Belagerungszustand
von Michael Paulwitz
Grüner Realitätsverlust, Terror und Nafri-Debatte im Jahr der Entscheidung
(Der "Spiegel"-Kommentator Christian Neeb versucht naseweis nachzutreten und die Polizei zu maßregeln…)
Meinung
von Thomas Fasbender
Typisch deutsche Autoaggression
Safia S. zu sechs Jahren Haft verurteilt
Betonpoller sollen Karneval sichern
Hamburg
Sexueller Übergriff: Polizei fahndet nach Afrikanern
(Ein weiteres Argument für mehr Migranten im Polizeidienst…)
Ermittler-Azubis rasten aus
Wilde Schlägerei an Polizeiakademie
Wuppertal und die Brandstifter
Für die Justiz in Nordrhein-Westfalen ist der Anschlag auf eine Synagoge ein Akt der Kritik an Israel
Godshorn
Polizei Langenhagen sucht Täter Zwei Räuber überfallen schwangere Frau
Nach einem Raubüberfall auf eine sichtbar schwangere Frau sucht die Polizei nun mithilfe eines Phantombildes einen der beiden Täter. Das 37 Jahre alte Opfer war bei der Tat in Godshorn verletzt worden und musste ins Krankenhaus.
Kleve
Vater fasst möglichen Vergewaltiger seiner Tochter
("leicht dunkler Teint"…)
15-Jähriger in Pforzheim brutal ausgeraubt
Täter wollte Opfer mit Hepatitis anstecken
Polizeibekannter Vergewaltiger aus Pakistan kann nicht abgeschoben werden
Uni München: Mutmaßlicher Vergewaltiger gefaßt
München
Bande attackiert und beraubt drei Jugendliche
Schülergewalt in Neumünster
Gewalt in DaZ-Klassen: Landtagsabgeordneter Volker Dornquast im Interview
Migrantenterror in Göteborg, oder wie eine No-Go-Zone entsteht
Tat gefilmt
Mutmaßliche Vergewaltigung: Schwedische Polizei nimmt Verdächtige fest

KULTUR / UMWELT / ZEITGEIST / SONSTIGES
(Marx-Monument für Trier. Wann folgen Lenin und Stalin?)
Geschenk aus China
Das ist der Mega-Marx für Trier
(Jahrhunderte alter Kunststreit)
Figuren und Theater
Geklaute Buddha-Statuen und provozierende "Trostfrauen"-Skulpturen: Südkorea und Japan streiten sich derzeit um gleich mehrere Skulpturen. Und nun sorgt ein Gerichtsurteil für neuen Ärger zwischen den beiden Nationen.
Sanierung: Schaut auf diese Schulen!
Übel riechende Toiletten, defekte Dächer, Schimmel an den Wänden – Deutschlands Schulen ähneln Ruinen. Bisher hielt man das für ein ästhetisches Problem. Dabei geht es weit darüber hinaus, wie man an einer Schule in Berlin sieht.
LGBTQ: Auch Transgender-Jungen dürfen Pfadfinder sein
In den USA können alle Jungen Mitglied der Boy Scouts werden. Egal, welches Geschlecht in ihrer Geburtsurkunde steht. Bei den Pfadfinderinnen ist das schon Alltag.
Not to be normal
Das "Normale" wird gemacht. Endlich mal ein Phänomen, bei dem unstrittig ist, daß wir es mit sozialer Konstruktion zu tun haben und nicht mit Naturgegebenheiten, nicht wahr?
(Zum Online-Angebot "Funk")
Funky Business
Von Akif Pirincci
Top Zehn der „Fake News“ 2016
Die Deutungshoheit wackelt
„First Draft Partner Network“
Deutsche Medien treten Bündnis gegen „Fake News“ bei
(Wenn Claus Kleber mit von der Partie ist, wird sicher alles gut…)
Kampf gegen gefälschte Meldungen
Facebook setzt im Kampf gegen „Fake News“ auf Correctiv
Die inszenierte Wirklichkeit
Von der TV-Schnulze bis zur Geschichtsdoku: Wie ARD und ZDF die Wahrheit verfälschen
(Zu "Fake News")
Ein Gott, ein Recht, keine Wahrheit
von Thomas Fasbender
Medien
Gouvernanten in der Krise
von Michael Paulwitz
Merkel-Selfie
Flüchtling zieht wegen Hetze bei Facebook vor Gericht
Das Bild eines Flüchtlings, der mit der Kanzlerin ein Selfie macht, ging um die Welt. Unbekannte unterstellen dem Mann später Straftaten – verbreiteten Fake News. Jetzt klagt er.
Wenn Journalisten nach Zensur rufen
(Zur "Fake-News"-Kontrolle)
Feuchter Alptraum
von Maximilian Krah
(Die linke Jury hat mal wieder etwas passendes herausgesucht…)
Diffamierende Sprache
"Volksverräter" ist das Unwort des Jahres 2016
Sprachwissenschaftler haben das Unwort des Jahres bekannt gegeben: Sie entschieden sich für den Begriff "Volksverräter", mit dem rechte Pöbler oft Politiker beschimpfen.
Wieder mal ein politisch einseitiges "Unwort des Jahres"
Die Bürger Für Frankfurt machen alternative Vorschläge
Am Meinungs- PRANGER ---- RE-UP
Politische Korrektheit führt zur geistigen Knechtschaft
Von Norbert Bolz
„Nazi“ ist das global erfolgreichste deutsche Wort
Identität
Was es heute heißt, deutsch zu sein
Volk – Aufgabe statt Konstrukt
von Martin Sellner
Warum man das Deutsche Volk schwach halten will
Von Andreas Popp
S.P.O.N. - Der Schwarze Kanal In der Identitätsfalle
Der Kolumnist hat den Finanzminister einen Schwaben genannt - das schreit nach Strafe. Halb Baden schickt Leserbriefe. Was verrät die Empörung über unser Heimatgefühl? Kann man seine Identität ändern, wenn man lang genug in Stuttgart lebt?
Eine Kolumne von Jan Fleischhauer
Demokratie als Religion?
Über die erschreckenden Hintergründe eines Dogmas
von Andreas Popp
Briefwechsel zwischen Claus Leggewie und Götz Kubitschek
Umbruchszeiten
Hans-Dietrich Sander ist tot
London
Zu eurozentrisch
Studenten wollen weiße Philosophen von Lehrplan verbannen
(Belästiger werden es in Zukunft einfacher haben…)
Gender-Debatte
Grüne planen Unisex-WCs in Berliner Behörden
(Schräg…)
Berlin: Anti-Trump Feminists chant "Allahu Akbar" at "Women's March" against Inauguration
Political Correctness
Vom Medienphantom zum rechten Totschlagargument. Die sonderbare Geschichte der Political Correctness
Praktische Alternativen fürs Volk
von Felix Menzel
Was glauben Sie, wieviel Geld bei den Anhängern der patriotischen Opposition „herumliegt“? Mit „herumliegt“ ist gemeint, daß es jederzeit verfügbar ist, aber gegenwärtig nicht gebraucht wird.
(THRIVE Deutsch) GEDEIHEN: Was Auf Der Welt Wird es Brauchen?
(Die nächste Hakenkreuz-Horror-Boulevardmeldung…sofort bei Amazon bestellen…)
Swastikas im Schnee - Winterstiefel hinterlässt Hakenkreuz-Abdrücke
(…und endlich. Erleichterung macht sich breit.)
US-Firma nimmt Hakenkreuz-Schuhe vom Markt
(Nun dürfen sich alle freuen, und diese Akte kann endlich ad acta gelegt werden…)
Alois Brunner starb in Damaskus
Nazi-Kriegsverbrecher hauste in Kellerloch
Alles eine LÜGE! - die echten Kriegsursachen von 1939
Generalmajor a.D. Gerd Schultze-Rhonhof spricht in München über die Kriegsursachen 1939
Frankfurter Polit-"Tatort" über Sprachchaos
"Nafris" gegen "Nazi Bitches"
(Dazu…)
Das war's. Diesmal mit: gewaltverherrlichendem Sauerteig und der umfänglichen Naziszene in Frankfurt
(Ebenfalls zur "Tatort"-Propaganda)
Danke ARD - die 3 besten Lügen im Identitären – Tatort
(Zum Linksdrall und der Selbstkorrumpierung der Kunst- und Kulturszene)
Macht, Kunst, Geld
Oscarverleihung
Rassismus in Hollywood?
Messertanz
von Johannes Konstantin Poensgen
Der Schnitt durch unser Volk wurde mir nie so fühlbar, wie in dem interessantesten und kultiviertesten Gespräch, das ich seit langem geführt habe. Während einer Bahnfahrt von Koblenz nach Trier begegnete ich einem, ja was eigentlich?
Fußball
Real Madrid entfernt Kreuz aus Emblem
Änis Ben-Hatira
Fußball-Profi verteidigt Salafisten-Verein
Neue Mönche im Kloster Neuzelle
Heiligenkreuz/Neuzelle – 199 Jahre nach der Säkularisation des Klosters Neuzelle in Brandenburg haben die Mönche von Stift Heiligenkreuz in ihrer Kapitelsitzung am 10. November 2016 entschieden, eine Wiederbesiedelung des Klosters Neuzelle zu wagen.
Nicolas Cage gibt Dino-Schädel zurück
Reiche Amerikaner kaufen geschmuggelte Fossilien / Jetzt wehrt sich die Mongolei.
Sollen Katzenbesitzer für ihre Tiere Steuern zahlen?
(Ein Hund, der ein Schaf sein sollte… Leserkommentare beachten)
Dieser dreiste Steuertrick löste einen Polizeieinsatz aus
Syrien wie alles begann
Die Anstalt
Niemand ist sicher: "Mister"!
Das Warten hat ein Ende: Nach fast acht Jahren und dem Umweg über drei (!) verschiedene Verlage ist der dystopische Roman Mister aus der Feder Alex Kurtagićs endlich in deutscher Übersetzung erhältlich!
Berlin und Potsdam 1945 (in Farbe und HD 1080p)




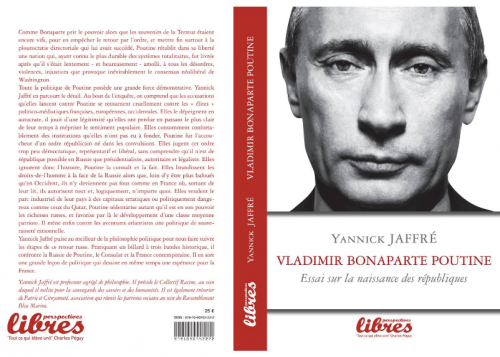

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg


 The useful idiots are all over the place, but that’s exactly what they are, mere stage extras. They are impressionable adolescents, Hollywood airheads, middle-aged women who want to “assert themselves,” perpetually incited racial minorities, and Muslim activists. Many of them can be mobilized at the drop of a pin to “march for tolerance,” however that term is interpreted by those who organize the march and by politicians, like Chuck Schumer and Nancy Pelosi, who seek to increase their influence through well-prepared displays of “righteous indignation.” Please note that Schumer’s obstructionist tactics in the Senate, blocking or delaying cabinet nominees and threatening to shoot down Trump’s Supreme Court nominee, have been applied to the accompaniment of non-stop anti-Trump protests. Only a fool or unthinking partisan would believe these events are unrelated.
The useful idiots are all over the place, but that’s exactly what they are, mere stage extras. They are impressionable adolescents, Hollywood airheads, middle-aged women who want to “assert themselves,” perpetually incited racial minorities, and Muslim activists. Many of them can be mobilized at the drop of a pin to “march for tolerance,” however that term is interpreted by those who organize the march and by politicians, like Chuck Schumer and Nancy Pelosi, who seek to increase their influence through well-prepared displays of “righteous indignation.” Please note that Schumer’s obstructionist tactics in the Senate, blocking or delaying cabinet nominees and threatening to shoot down Trump’s Supreme Court nominee, have been applied to the accompaniment of non-stop anti-Trump protests. Only a fool or unthinking partisan would believe these events are unrelated.




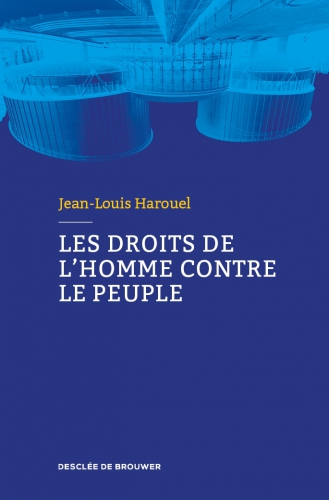

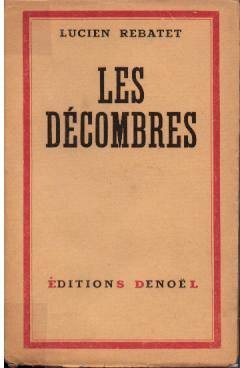 Les Etudes rebatiennes se structurent de la manière suivante : 1) Inédits 2) Entretiens et témoignages 3) Articles (critique littéraire) ; actualité rebatienne ; vie de l'association. Toutes les contributions sont les bienvenues à condition qu'elles soient œuvres de qualité. Le premier numéro devrait sortir dans un an. J'appelle les collaborateurs et souscripteurs (on peut être l'un et l'autre). En adhérant à l'association, vous souscrivez au n°1 des Etudes rebatiennes tout en contribuant à leur publication. Pour nous faire connaître un site a d'ores et déjà été créé (
Les Etudes rebatiennes se structurent de la manière suivante : 1) Inédits 2) Entretiens et témoignages 3) Articles (critique littéraire) ; actualité rebatienne ; vie de l'association. Toutes les contributions sont les bienvenues à condition qu'elles soient œuvres de qualité. Le premier numéro devrait sortir dans un an. J'appelle les collaborateurs et souscripteurs (on peut être l'un et l'autre). En adhérant à l'association, vous souscrivez au n°1 des Etudes rebatiennes tout en contribuant à leur publication. Pour nous faire connaître un site a d'ores et déjà été créé ( Comment Rebatet/Michel s'y prendra-t-il pour réussir une telle gageure ? Il va
Comment Rebatet/Michel s'y prendra-t-il pour réussir une telle gageure ? Il va  Mais tournons-nous plutôt vers le roman. Je ne crois pas que Les Deux Etendards soient une apologétique athée, non plus qu'une épopée. Michel y fait bien une tentative de conversion qui tourne en « déconversion ». Mais celle-ci n'est pas une inversion pure et simple, elle n'est pas du « Michel-Ange inversé » puisque Michel se défend d'être athée. D'ailleurs, n'était l'homophonie avec Le Diable et le Bon Dieu, le roman se fut appelé Ni Dieu ni Diable. L'agnostique Michel ne s'épuise pas plus à toujours nier, qu'il ne cherche en gémissant. L'aporie de la confrontation finale ferait-elle alors signe vers un néo-paganisme ? Plus précisément : vers la désolation que laisserait l'impossibilité d'un retour du sacré ? Michel ne se ferait-il pas parfois une plus juste idée du Christianisme qu'il ne le laisse paraître, idée au nom de laquelle il déboulonne les idoles ? Ces questions restent ouvertes.
Mais tournons-nous plutôt vers le roman. Je ne crois pas que Les Deux Etendards soient une apologétique athée, non plus qu'une épopée. Michel y fait bien une tentative de conversion qui tourne en « déconversion ». Mais celle-ci n'est pas une inversion pure et simple, elle n'est pas du « Michel-Ange inversé » puisque Michel se défend d'être athée. D'ailleurs, n'était l'homophonie avec Le Diable et le Bon Dieu, le roman se fut appelé Ni Dieu ni Diable. L'agnostique Michel ne s'épuise pas plus à toujours nier, qu'il ne cherche en gémissant. L'aporie de la confrontation finale ferait-elle alors signe vers un néo-paganisme ? Plus précisément : vers la désolation que laisserait l'impossibilité d'un retour du sacré ? Michel ne se ferait-il pas parfois une plus juste idée du Christianisme qu'il ne le laisse paraître, idée au nom de laquelle il déboulonne les idoles ? Ces questions restent ouvertes. 



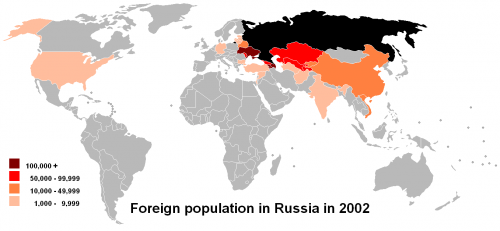




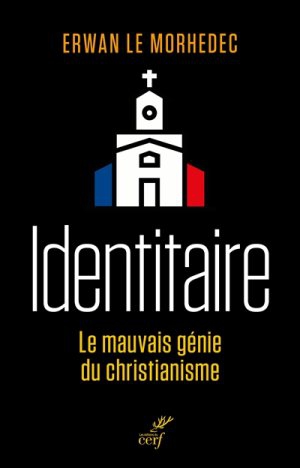 La conséquence immédiate et imprévue de cette dépaganisation a été une déchristianisation, notamment en France. Coupée des racines païennes sur lesquelles le christianisme de Constantin s’était apposée comme un vernis sur un ongle, le catholicisme dépérissait et cela a été le cas jusqu’à aujourd’hui. Dans ce conflit, le protestantisme a donc vaincu, même là où on pensait qu’il avait échoué. Le protestantisme s’est même emparé du Vatican. Seule l’Europe orthodoxe, plus païenne de fait, y a échappé pour le moment.
La conséquence immédiate et imprévue de cette dépaganisation a été une déchristianisation, notamment en France. Coupée des racines païennes sur lesquelles le christianisme de Constantin s’était apposée comme un vernis sur un ongle, le catholicisme dépérissait et cela a été le cas jusqu’à aujourd’hui. Dans ce conflit, le protestantisme a donc vaincu, même là où on pensait qu’il avait échoué. Le protestantisme s’est même emparé du Vatican. Seule l’Europe orthodoxe, plus païenne de fait, y a échappé pour le moment.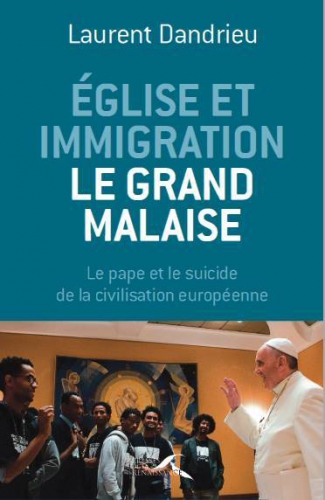 Seconde option, la rupture. A partir de la Renaissance notamment, certains penseurs ont théorisé le retour au paganisme européen, ce dernier étant de mieux en mieux connu par deux siècles d’études historiques à son propos, jusqu’à en découvrir la matrice indo-européenne avec notamment Georges Dumézil. Des organisations païennes émergent ainsi dans toute l’Europe, se revendiquant des traditions locales, que ce soit du druidisme (Draoicht), du paganisme germano-scandinave (Asatru), du paganisme slave (Rodnoverie), du paganisme grec (Hellenismos) ou de la religion romaine (Religio Romana). L’Eglise est bien consciente d’ailleurs que la réponse identitaire des Européens pourrait être la résurrection de l’antique paganisme. Au bord du tombeau, comme l’avait annoncé Nietzsche, l’Europe se ressaisira et se relèvera dans un sursaut salvateur. Je suspecte les actuelles autorités catholiques de comprendre qu’un tel mouvement peut arriver, va arriver, et qu’il s’agit de s’en prémunir en sacrifiant l’Europe, prévoyant déjà son avenir en Afrique, en Amérique méridionale et en Asie. Cela voudrait dire que par peur du paganisme, le Vatican s’allierait implicitement avec d’autres forces et ferait ainsi les yeux de Chimène au second monothéisme universel dont la présence en Europe ne cesse d’inquiéter.
Seconde option, la rupture. A partir de la Renaissance notamment, certains penseurs ont théorisé le retour au paganisme européen, ce dernier étant de mieux en mieux connu par deux siècles d’études historiques à son propos, jusqu’à en découvrir la matrice indo-européenne avec notamment Georges Dumézil. Des organisations païennes émergent ainsi dans toute l’Europe, se revendiquant des traditions locales, que ce soit du druidisme (Draoicht), du paganisme germano-scandinave (Asatru), du paganisme slave (Rodnoverie), du paganisme grec (Hellenismos) ou de la religion romaine (Religio Romana). L’Eglise est bien consciente d’ailleurs que la réponse identitaire des Européens pourrait être la résurrection de l’antique paganisme. Au bord du tombeau, comme l’avait annoncé Nietzsche, l’Europe se ressaisira et se relèvera dans un sursaut salvateur. Je suspecte les actuelles autorités catholiques de comprendre qu’un tel mouvement peut arriver, va arriver, et qu’il s’agit de s’en prémunir en sacrifiant l’Europe, prévoyant déjà son avenir en Afrique, en Amérique méridionale et en Asie. Cela voudrait dire que par peur du paganisme, le Vatican s’allierait implicitement avec d’autres forces et ferait ainsi les yeux de Chimène au second monothéisme universel dont la présence en Europe ne cesse d’inquiéter.





![ist-pog30[1].jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/02/01/2301511084.jpg)

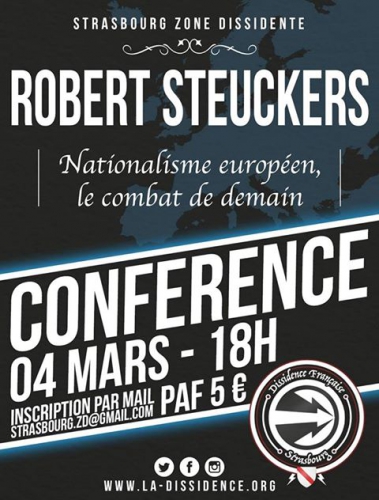



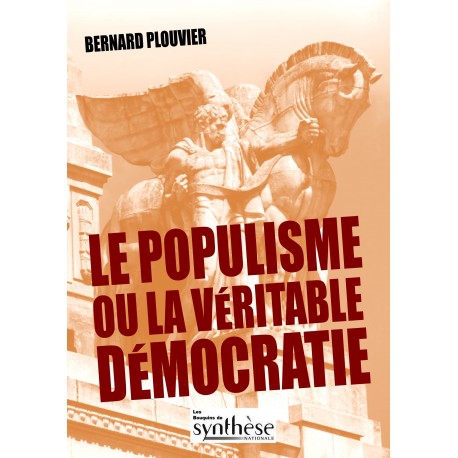 Q. Dans ce livre, vous présentez ce que les bien-pensants et bien-disants interpréteraient comme un non-sens : l’assimilation du populisme à la démocratie. Est-ce une provocation à but commercial ou l’expression d’une intime conviction ?
Q. Dans ce livre, vous présentez ce que les bien-pensants et bien-disants interpréteraient comme un non-sens : l’assimilation du populisme à la démocratie. Est-ce une provocation à but commercial ou l’expression d’une intime conviction ?
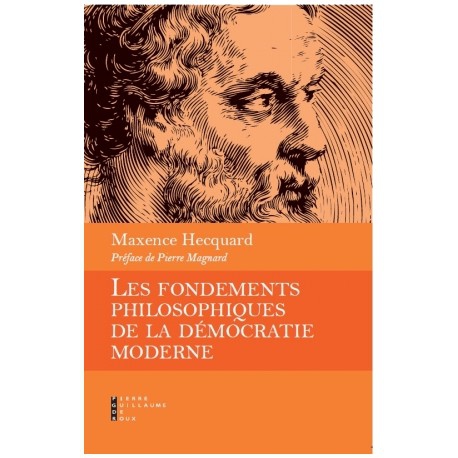
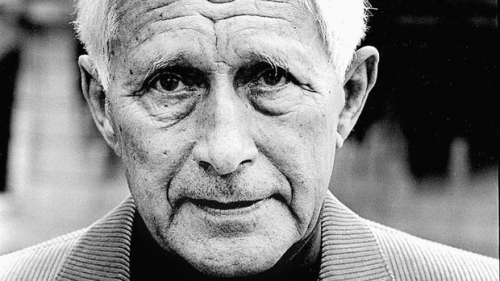




 »Konsequent, hochmütig und rücksichtslos « sei der Tonfall, den der
»Konsequent, hochmütig und rücksichtslos « sei der Tonfall, den der  1963/64 ging er für ein Forschungsprojekt über revolutionstheoretische Schriften nach Zürich. Im Rahmen dieses Projekts nahm er Kontakt zu bedeutenden Sozialisten, Kommunisten und Ex-Kommunisten wie Boris Souvarine, Giangiacomo Feltrinelli oder Oskar Lange auf. 1965 holte Hans Zehrer Sander zur Welt zurück. Zehrer starb 1966, Ende 1967 wurde Sander entlassen. Die raschen Siege der Studentenrevolte entlarvten in seinen Augen die Brüchigkeit des politischen Systems. Zwischen»liberaler Restauration wie ihrer linken Unterwanderung« führte der Weg zu dezidiert nationalen Positionen, die sich im Laufe der Jahre radikal zuspitzen sollten. 1969 promovierte Sander bei Hans-Joachim Schoeps mit der dogmengeschichtlichen Studie Marxistische Ideologie und allgemeine Kunsttheorie.
1963/64 ging er für ein Forschungsprojekt über revolutionstheoretische Schriften nach Zürich. Im Rahmen dieses Projekts nahm er Kontakt zu bedeutenden Sozialisten, Kommunisten und Ex-Kommunisten wie Boris Souvarine, Giangiacomo Feltrinelli oder Oskar Lange auf. 1965 holte Hans Zehrer Sander zur Welt zurück. Zehrer starb 1966, Ende 1967 wurde Sander entlassen. Die raschen Siege der Studentenrevolte entlarvten in seinen Augen die Brüchigkeit des politischen Systems. Zwischen»liberaler Restauration wie ihrer linken Unterwanderung« führte der Weg zu dezidiert nationalen Positionen, die sich im Laufe der Jahre radikal zuspitzen sollten. 1969 promovierte Sander bei Hans-Joachim Schoeps mit der dogmengeschichtlichen Studie Marxistische Ideologie und allgemeine Kunsttheorie.