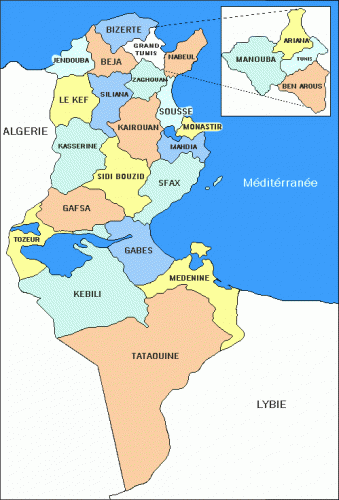dimanche, 30 janvier 2011
?Etnocentrismo o etnopluralismo? Simplemente... Eurocentrismo
00:10 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, ethnocentrisme, ethnopluralisme, différencialisme, identité, identité européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Lale Andersen - Wo die Nordseewellen...
Lale Andersen
Wo die Nordseewellen...
00:05 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lale andersen, mer du nord, suède, scandinavie, allemagne, années 30, années 40, musique, chanson |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 29 janvier 2011
Tunisie: la révolution des privilégiés?
Tunisie : la révolution des privilégiés ?
Un communiqué de Bernard Lugan :
Ex: http://synthesenationale.hautetfort.com/
En France, les tartuffes politiques ont applaudi la chute d’une dictature qu’ils fréquentaient assidûment peu auparavant, à commencer par ceux qui voulaient cacher que le RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique), le parti du président déchu était membre de l’Internationale socialiste [1].
Tous ont oublié qu’en 1987, l’accession au pouvoir du général Ben Ali avait été unanimement saluée comme une avancée démocratique, que sous sa ferme direction, la subversion islamiste avait été jugulée, que la Tunisie était devenue un pays moderne dont la crédibilité permettait un accès au marché financier international. Attirant capitaux et industries, le pays avait à ce point progressé que 80% des Tunisiens étaient devenus propriétaires de leur logement. Ce pôle de stabilité et de tolérance dans un univers musulman souvent chaotique voyait venir à lui des millions de touristes recherchant un exotisme tempéré par une grande modernité. Des milliers de patients venaient s’y faire opérer à des coûts inférieurs et pour une même qualité de soins qu’en Europe. Dans ce pays qui consacrait plus de 8% de son PIB à l’éducation, la jeunesse était scolarisée à 100%, le taux d’alphabétisation était de plus de 75%, les femmes étaient libres et ne portaient pas le voile ; quant à la démographie, avec un taux de croissance de 1,02%, elle avait atteint un quasi niveau européen. 20% du PIB national était investi dans le social et plus de 90% de la population bénéficiait d’une couverture médicale. Autant de réussites quasiment uniques dans le monde arabo-musulman, réussites d’autant plus remarquables qu’à la différence de l’Algérie et de la Libye, ses deux voisines, la Tunisie ne dispose que de faibles ressources naturelles.
Les Tunisiens étaient donc des privilégiés auxquels ne manquait qu’une liberté politique généralement inexistante dans le monde arabo-musulman. Ils se sont donc offert le luxe d’une révolution en ne voyant pas qu’ils se tiraient une balle dans le pied. Leur euphorie risque d’ailleurs d’être de courte durée car le pays va devoir faire le bilan d’évènements ayant provoqué des pertes qui s’élevaient déjà à plus de 2 milliards d’euros à la mi-janvier et qui représentaient alors 4% du PIB. La Tunisie va donc sortir de l’épreuve durablement affaiblie, à l’image du secteur touristique qui recevait annuellement plus de 7 millions de visiteurs et qui est aujourd’hui totalement sinistré, ses 350 000 employés ayant rejoint les 13,2% de chômeurs que comptait le pays en décembre 2010.
Pour le moment, les Tunisiens ont l’illusion d’être libres. Les plus naïfs croient même que la démocratie va résoudre tous leurs maux, que la corruption va disparaître, que le chômage des jeunes va être résorbé, tandis que les droits de la femme seront sauvegardés… Quand ils constateront qu’ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient en définitive relativement confortablement assis, leur réveil sera immanquablement douloureux. Déjà, dans les mosquées, les prêches radicaux ont recommencé et ils visent directement le Code de statut personnel (CSP), ce statut des femmes unique dans le monde musulman. Imposé par Bourguiba en 1956, puis renforcé par Ben Ali en 1993, il fait en effet des femmes tunisiennes les totales égales des hommes. Désormais menacée, la laïcité va peu à peu, mais directement être remise en cause par les islamistes et la Tunisie sera donc, tôt ou tard, placée devant un choix très clair : l’anarchie avec l’effondrement économique et social ou un nouveau pouvoir fort.
Toute l’Afrique du Nord subit actuellement l’onde de choc tunisienne. L’Egypte est particulièrement menacée en raison de son effarante surpopulation, de l’âge de son président, de la quasi disparition des classes moyennes et de ses considérables inégalités sociales. Partout, la première revendication est l’emploi des jeunes et notamment des jeunes diplômés qui sont les plus frappés par le chômage. En Tunisie, à la veille de la révolution, deux chômeurs sur trois avaient moins de 30 ans et ils sortaient souvent de l’université. Le paradoxe est que, de Rabat à Tunis en passant par Alger, les diplômés sont trop nombreux par rapport aux besoins. Une fois encore, le mythe du progrès à l’européenne a provoqué un désastre dans des sociétés qui, n’étant pas préparées à le recevoir, le subissent.
En Algérie, où la cleptocratie d’Etat a dilapidé les immenses richesses pétrolières et gazières découvertes et mises en activité par les Français, la jeunesse n’en peut plus de devoir supporter une oligarchie de vieillards justifiant des positions acquises et un total immobilisme social au nom de la lutte pour l’indépendance menée il y a plus d’un demi-siècle. Même si les problèmes sociaux y sont énormes, le Maroc semble quant à lui mieux armé dans la mesure où la monarchie y est garante de la stabilité, parce qu’un jeune roi a su hisser aux responsabilités une nouvelle génération et parce que l’union sacrée existe autour de la récupération des provinces sahariennes. Mais d’abord parce que le Maroc est un authentique Etat-nation dont l’histoire est millénaire. Là est toute la différence avec une Algérie dont la jeunesse ne croit pas en l’avenir car le pays n’a pas passé, la France lui ayant donné ses frontières et jusqu’à son nom.
13:01 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, afrique, affaires africaines, politique internationale, afrique du nord, monde arabe, monde arabo-musulman, tunisie, maghreb, méditerranée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Explosie Moskou: onderzoekers verdenken Russische islamist
Explosie Moskou: onderzoekers verdenken Russische islamist
 MOSKOU 27/01 (AFP) = De onderzoekers verdenken er een Russische islamist van verantwoordelijk te zijn voor de zelfmoordaanslag van maandag op
MOSKOU 27/01 (AFP) = De onderzoekers verdenken er een Russische islamist van verantwoordelijk te zijn voor de zelfmoordaanslag van maandag op
de Moskouse luchthaven Domodedovo. Hij zou samen met een vrouw de aanslag gepleegd hebben. Dat berichtte de Russische krant Kommersant donderdag.
De krant haalt politiebronnen aan. De man, met de naam Razdoboudko,
zou lid zijn van een islamistische rebellengroepering uit de regio van Stavropol. Die stad ligt in het zuiden van Rusland, in de Kaukasus.
In de Russische media circuleert de piste van een rebellengroepering die aanvankelijk een aanslag vlakbij het Rode Plein in Moskouzou gepland hebben tijdens Nieuwjaarsnacht. Een vrouw moest die aanslag uitvoeren, maar kwam om toen haar explosievengordel te vroeg
ontplofte. Een andere vrouw van de rebellengroepering zou dan de aanslag van maandag op Domodedovo gepleegd hebben.
Volgens de bronnen van Kommersant zouden de twee vrouwen onder dwang van Razdobouko gehandeld hebben, maar de man zou ook bij de aanslag maandag op de Moskouse luchthaven geweest zijn. Op de plaats van de feiten werd in elk geval het hoofd van een man gevonden, aldus Kommersant. VRW/VOC/
09:43 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, attentats, terrorisme, terreur, terrorisme tchétchène, caucase, moscou, tchétchénie, islam, islamisme, actualité, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Krantenkoppen / Januari 2011 - 10

FrontaalNaakt-blogger en medewerker van de Vrije Universiteit Amsterdam Peter Breedveld riep via Twitter de VN op om naar Nederland te komen om PVV'ers dood te schieten. Wat voor hem satire is, leidt op internet tot een stroom van verontwaardiging. Ook PVV-leider Geert Wilders reageert ontstemd: "Te walgelijk voor woorden. Die ambtenaar moet op staande voet worden ontslagen!"
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/01/bet...
Het idee dat de vrijheid van homoseksuelen en vrouwen teloor gaat door de aanwezigheid van allochtonen, is overdreven. Dat zei de Amsterdamse wethouder Andrée van Es (diversiteit, GroenLinks) vanavond tijdens een toespraak op een conferentie in de hoofdstad. ,,Het sentiment van de teloorgang van progressieve waarden is wat mij betreft onterecht.’’
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/01/hom...
Adolf Hitler werd in juni '44 flink in het ootje genomen door de Britse geheime dienst. De Britten slaagden er via een onderschepte memo in Hitler ervan te overtuigen dat D-Day niet aan de kust van Normandië, maar die van Pas de Calais zou plaatsvinden.
http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2011/01/laf...
Duitsland zal de komende tijd geen bijdragen geven aan het internationale fonds dat strijd tegen aids, tuberculose en malaria. De oosterburen besloten hiertoe na berichten over corruptie.
http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2011/01/dui...
De tsunami van moslims, die sommige personen vrezen, lijkt meer een klein golfje te worden.
De komende twintig jaar groeit het aantal moslims in Europa slechts met twee procent. Nederland telt in 2030 ruim 1,3 miljoen moslims, dat is 7,8 procent van alle Nederlanders. Dat blijkt uit een studie van het Amerikaanse Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life.
http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2011/01/35_...
Wie nog op een brief wacht van Rochus Misch, de oude radiotelegrafist van Adolf Hitler, kan het wel vergeten. De man is inmiddels zo oud dat hij de gigantische lading aan fanmail niet meer kan beantwoorden.
http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2011/01/tel...
Een imam van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas is in opspraak geraakt door in een gebed aan Allah te vragen om het vermoorden van alle joden. Hij doet de uitspraken in een twee uur durende documentaire, To Shoot the Elephant, die tegen Israël gericht is en wordt uitgezonden op Palestijnse middelbare scholen.
http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2011/01/als...
De drie Marokkaanse Nederlanders, die in november werden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme, mogen worden uitgeleverd aan België. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald.
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/terreurverdachten_...
Frankrijk steunt het Griekse plan om een hek te plaatsen langs delen van de grens met Turkije om illegale immigratie tegen te gaan. Dat heeft de Franse minister van binnenlandse zaken Brice Hortefeux donderdag gezegd.
http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article3398210.ece/Fran...
Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) gaat in hoger beroep in de zaak van het Afghaanse meisje Sahar. Hij wil van de Raad van State horen of herhaaldelijk procederen, met langdurig verblijf en verwestering tot gevolg, reden moet zijn voor verblijf. Hij vindt de zaak niet zo uitzonderlijk dat hij voor het meisje een uitzondering maakt.
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3397960.ece/L...
De SP-afdeling van Oude IJsselstreek overweegt een gang naar de rechter als de partij niet meer mag inspreken tijdens vergaderingen van de gemeenteraad. De afdeling krijgt daarbij steun van de Tweede Kamer-fractie van de partij, die een ‘gepeperde’ brief gaat schrijven naar de gemeente. „Hier wordt een grondrecht geschaad. We worden gediscrimineerd op politieke voorkeur. Dat mag niet”, vindt Maurits Gemmink van de plaatselijke SP.
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/8044619/...
„De bezuinigingen van het kabinet op het inburgeren van mensen vind ik dom”, zegt Otwin van Dijk, wethouder van de gemeente Doetinchem.
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/8043691/...
Ook al groeit alom de kritiek op Israël, Nederland is een trouwe steunpilaar gebleven. De documenten die door WikiLeaks naar buiten zijn gebracht kleuren dat beeld verder in.
http://nos.nl/artikel/214587-nederland-was-en-is-voor-isr...
Volgens de PVV worden er ,,politieke spelletjes'' gespeeld rond het debat over een nieuwe missie in Afghanistan. Een meerderheid van de Kamer wil per se donderdagavond nog het debat afronden, waar de tegenstanders van de missie PVV, SP en de PvdA meer tijd hebben gevraagd.
http://www.bnr.nl/artikel/21296767/pvv-angst-achterban-gr...
09:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : flandre, pays-bas, actualité, presse, journaux, médias, europe, affaires eruopéennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
NATO knew Hashim Thaçi was criminal
Ex: http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=201...
d=72322
"NATO knew Hashim Thaci was criminal"
Source: BBC, Guardian.co.uk LONDON -- A London newspaper has published leaked NATO documents that
LONDON -- A London newspaper has published leaked NATO documents that
describe Kosovo Albanian PM as one of the "biggest fish" in organized crime
in Kosovo.
The Guardian has published the article on the day the Parliamentary Assembly
of the Council of Europe is debating a draft resolution based on Dick
Marty's report on human organ trafficking in Kosovo, and Albania, writes the
BBC.
The article also incriminates Xhavit Haliti, "a former head of logistics for
the KLA who is now a close ally of the prime minister and a senior
parliamentarian in his ruling PDK party", whom the Marty report named as a
member of the so-called Drenica Group.
The newspaper says the NATO documents are marked secret, and reveal that
America and other western backing Kosovo's government "have had extensive
knowledge of its criminal connections for several years".
Haliti is linked with the Albanian mafia in the report, which also suggests
that he is the person who "exerts considerable control over Thaci".
Haliti is expected to be among Kosovo's official delegation to Strasbourg
tomorrow and has played a leading role in seeking to undermine the Marty
report in public, writes the Guardian.
The NATO papers, said to have originated in Kosovo in 2004, also suggest
that "behind his role as a prominent politician, Haliti is also a senior
organized criminal who carries a Czech 9mm pistol and holds considerable
sway over the prime minister"
It further says that Haliti "more or less ran a fund for the Kosovo war in
the late 1990s, profiting from the fund personally before the money dried
up. As a result, Haliti turned to organized crime on a grand scale."
The daily further quotes from the NATO documents to describe Haliti as
"highly involved in prostitution, weapons and drugs smuggling", who "serves
as a political and financial adviser to the prime minister". Haliti uses a
fake passport to travel abroad because he is black-listed in several
countries, including the U.S., according to this.
Haliti is further linked to the alleged intimidation of political opponents
in Kosovo and two suspected murders dating back to the late 1990s, "when KLA
infighting is said to have resulted in numerous killings".
"One was a political adversary who was found dead by the Kosovo border,
apparently following a dispute with Haliti. A description of the other
suspected murder - of a young journalist in Tirana, the Albanian capital -
also contains a reference to the prime minister by name, but does not
ascribe blame," writes the Guardian.
"Haliti is also named in the report by Marty, which is understood to have
drawn on NATO intelligence assessments along with reports from the FBI and
MI5," says the article.
09:24 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albanie, balkans, europe, affaires européennes, otan, kosovo |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les dernières frasques libertaires et déontologiques de BHL
Les dernières frasques libertaires et déontologiques de BHL
Ex: http://www.acrimed.org/article3520.html
 Encore BHL ? Oui, encore ! Mais pourquoi un tel acharnement ? Parce que l’année 2011 débute en fanfare pour le philosophe en chemise blanche, décidément sur tous les fronts. Et parce que cette fausse grandeur est en charge de la surveillance de plusieurs médias. Pauvres médias !
Encore BHL ? Oui, encore ! Mais pourquoi un tel acharnement ? Parce que l’année 2011 débute en fanfare pour le philosophe en chemise blanche, décidément sur tous les fronts. Et parce que cette fausse grandeur est en charge de la surveillance de plusieurs médias. Pauvres médias !
BHL a-t-il aidé à la censure de Stéphane Hessel ?
C’est en tout cas ce qu’affirme Richard Prasquier, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), dans un éditorial publié le 13 janvier sur le site du Crif. Richard Prasquier se félicite de l’annulation d’une conférence qui devait se dérouler à l’Ecole normale supérieure, en présence de Stéphane Hessel, mais aussi, entre autres, d’Elisabeth Guigou, de Benoît Hurel (Syndicat de la magistrature), de Leïla Shahid (représentante de la Palestine à Bruxelles) ou encore de Michel Warshawski (militant israélien). Le thème de la conférence était la solidarité avec les militants de la campagne de boycott d’Israël poursuivis en justice.
Le CRIF affirme que c’est grâce à son action que la directrice de l’ENS, Monique Canto-Sperber, a décidé d’annuler la conférence. Et, au détour d’une phrase, rend hommage à Valérie Pécresse, au rectorat de Paris, « ainsi qu’à Claude Cohen Tanoudij, prix Nobel de Physique, Bernard Henri Lévy et Alain Finkielkraut, tous anciens élèves de l’Ecole normale supérieure ». La phrase ne souffre d’aucune ambiguité : les trois « anciens » seraient, comme la ministre et le rectorat, intervenus auprès de la direction de l’ENS. BHL, ami d’Israël, aurait-il participé de près ou de loin à ce qui ressemble à s’y méprendre à une atteinte à la liberté d’expression ?
Pendant cinq jours, BHL ne réagit pas à l’éditorial de Richard Prasquier. C’est le 18 janvier, alors que « l’affaire » commence à faire du « buzz » (nous y reviendrons dans un prochain article), qu’il se signale. D’une curieuse manière. C’est en effet au Nouvel Obs, et non au Crif, que BHL fait parvenir le démenti qui suit :
« Je rentre des Etats-Unis et apprends qu’un débat autour de l’opération BDS a été annulé à l’Ecole normale. Contrairement à ce que laisse entendre votre site, je ne suis intervenu ni auprès de madame Canto-Sperber ni auprès de quiconque pour recommander l’annulation de ce débat. Je suis, par principe, même et surtout quand le désaccord est profond, partisan de la confrontation des points de vue – pas de leur "annulation" ».
Dont acte.
Dont acte ? Ou presque.
De deux choses l’une :
– soit le Crif dit la vérité, et BHL tente désespérément de se démarquer de cette initiative peu glorieuse, probablement en raison du « buzz » qu’elle a suscité ;
– soit le Crif ment. Mais dans ce cas, pourquoi BHL qui, chacun le sait, se sent très concerné par tout ce qui le concerne, a-t-il attendu cinq jours avant de réagir ? Pourquoi ne pas avoir exigé qu’un erratum soit publié sur le site de ceux qui sont à la source de cette « mauvaise » information, et non sur le site du Nouvel Obs, qui s’est contenté de la relayer ? Et pourquoi Richard Prasquier n’a-t-il pas, à l’heure où nous écrivons, changé la moindre virgule de son éditorial du 13 janvier ?
Autant de questions qui, pour l’instant, demeurent sans réponse. On ne doute pas que l’affaire ne manquera pas de connaître de nouveaux développements et rebondissements. A l’image d’une autre affaire impliquant BHL, celle qui l’oppose à Bernard Cassen.
BHL salit de nouveau Bernard Cassen...
Nous l’avions rapporté dans un précédent article : dans son Bloc-notes du 23 décembre, BHL commettait une bourde infamante : confondre, en évoquant les « Assises contre l’islamisation de l’Europe », Bernard Cassen, ancien directeur du Monde diplomatique, et Pierre Cassen, animateur de Riposte laïque. Cette utile confusion avait permis à Bernard-Henri de remettre au goût du jour l’un de ses thèmes favoris : les passerelles entre « rouges » et « bruns ». Si la bourde a été rapidement corrigée, BHL n’a toujours pas présenté ses excuses à Bernard Cassen. Bien au contraire...
En effet, dans son Bloc-notes du 6 janvier, il remet le couvert, évoquant « le double procès que [lui] intentent, pour le même article, un groupuscule d’extrême droite et un ancien du Monde diplo ». Par un (pas très) subtil procédé rhétorique, BHL réussit finalement là où il avait échoué deux semaines plus tôt : amalgamer Bernard Cassen et l’extrême droite. L’usage de l’expression « double procès » est en effet lourde de sens : Cassen et le Bloc identitaire n’étaient peut-être pas côte à côte aux « assises », mais ils le sont désormais dans une croisade commune contre le philosophe en chemise blanche. En somme, BHL, adepte de la prophétie auto-réalisatrice, avait raison avant tout le monde. Soyons certains que cette clairvoyance ne manquerait pas, si l’affaire devait prendre une tournure judiciaire, d’être saluée par les tribunaux.
… et offre une tribune au Bloc identitaire
Tribunaux que la direction du Point semble vouloir éviter, puisqu’elle a accordé au Bloc identitaire, sympathique groupement de jeunes gens épris de valeurs progressistes, un droit de réponse aux approximations de Bernard-Henri Lévy. Comme nous l’avions signalé, l’accusation de « tentative d’assassinat contre Jacques Chirac » portée contre cette organisation était des plus contestables : le Bloc identitaire en tant que tel n’existait pas à l’époque, et c’est Maxime Brunerie, un proche de l’ancêtre du Bloc, Unité radicale, qui avait tenté de tirer sur le chef de l’Etat.
Le Bloc identitaire a donc pu, grâce à la rigueur de BHL, s’adresser, entre autres, au lectorat du Point. Une audience quantitativement inédite pour une organisation qui, bien qu’elle récuse le terme de groupuscule, n’a pas franchement pignon sur rue. Et même si Bernard-Henri a rédigé une « mise au point » à la suite du droit de réponse, le résultat est là : BHL aura offert, à cause de la démesure et de l’emphase habituelles de ses propos, une formidable tribune au Bloc, sans aucun doute ravi de cette publicité à moindres frais. Nous présentons à BHL toutes nos félicitations, auxquelles nous nous empressons d’en ajouter d’autres, au sujet de son courage et de sa lucidité quant à la révolution tunisienne.
BHL et la Tunisie, épisode 1 : le résistant de la 26e heure
Les quelques motivés qui suivent l’actualité du philosophe médiatique ont constaté qu’il a été, durant de longues semaines, silencieux sur la situation en Tunisie. Et soudain, le miracle est arrivé.
Le 13 janvier, (veille du départ de Ben Ali), depuis les États-Unis où il se trouve alors, Bernard-Henri Lévy lance – sur l’antenne d’Europe 1 – un appel dont le retentissement dépasse, et de loin, l’Appel de Londres lancé par le général de Gaulle. Le site « officieux » de BHL se charge, dès le lendemain, de mettre en valeur cette initiative. Les bonnes causes sont avant tout celles qui sont bonnes à la promotion de BHL-Moi-Je.
Extrait : « Les Tunisiens vivent leur 1789. Et Bernard-Henri Lévy est de ceux qui ont compris que, pour gagner une bataille comme celle-ci, le Net est aujourd’hui un outil incontournable. Il sait les risques juridiques qu’il prend. Mais que faisaient d’autres ceux et celles de ses aînées qui, naguère, signaient des appels pour l’avortement ou pour l’insoumission dans la guerre d’Algérie. C’est la même logique, toujours ». Quand BHL ne met pas lui-même en scène sa légendaire modestie, ses amis se chargent de le faire pour lui.
Mais quelle est donc la prouesse qui nous a valu ce modeste éloge ? Le résistant BHL a posté un message sur Twitter via le compte de sa revue La règle du jeu : « Hackers de tous les pays, unissez-vous. Soutenez les Anonymous. Piratez, bloquez les sites officiels de la Tunisie de Ben Ali. BHL ». Les Anonymous sont des hackers qui, depuis plusieurs semaines, multipliaient les attaques informatiques contre les sites du régime tunisien… sans avoir attendu le réveil de BHL.
Et pourtant, toujours sur le site, on apprend que, malgré le retard à l’allumage de BHL, son « Tweet » « a fait le tour de la Toile ». Vérification faite, le tour fut rapide, comme en témoigne cette capture d’écran, réalisée plus de quarante-huit heures après la publication de l’appel :
Un écho international à la hauteur du courage de Bernard-Henri, résistant de la vingt-sixième heure.
BHL et la Tunisie, épisode 2 : Arabes, musulmans, même combat !
Après la chute de Ben Ali, Bernard-Henri ne tient plus en place. Dans son Bloc-notes du 18 janvier, titré « Leçons tunisiennes », il tire, à chaud, ses premiers bilans de la révolte populaire. On apprend ainsi que l’un des éléments notables du soulèvement tunisien est qu’il s’agit d’une « insurrection arabe » (c’est la deuxième « leçon ») : « Eh oui. Rappelez-vous ceux qui nous disaient qu’il y a des peuples faits pour la révolte et d’autres qui ne le sont pas ». Pour BHL, les événements de Tunisie sont la démonstration qu’il n’y a pas de peuple imperméable aux principes démocratiques : « les principes démocratiques sont des principes universels ». Même les Arabes, donc ! Saluons le courage avec lequel Bernard-Henri se défend contre la droite xénophobe et néo-coloniale...
Suit alors une prophétie quasi planétaire : « Aujourd’hui, la Tunisie. Demain, la Libye de Kadhafi. La Syrie de la famille Assad. Peut-être l’Iran d’Ahmadinejad ». Une déclaration qui nous vaudra peut-être un erratum de plus puisque, cher Bernard-Henri, les Iraniens ne sont pas Arabes : ce sont des Perses. Mais c’est vrai qu’après tout la majorité d’entre eux sont aussi des musulmans. L’amalgame est d’autant plus fâcheux qu’il est courant chez ceux que BHL prétend pourfendre dans sa chronique, « ces apôtres de la guerre des civilisations pour qui l’idée même d’un pays musulman et, en particulier, arabe ouvert aux droits de l’homme était une contradiction dans les termes ». On espère que Bernard-Henri saura, avant de nous infliger ses prochaines « leçons » politico-philosophiques, réviser ses leçons d’histoire-géographie.
Selon les fans de BHL, BHL triomphe aux Etats-Unis
Cette approximation est peut-être une conséquence de l’épuisant séjour de BHL aux États-Unis, destiné à promouvoir le livre coécrit avec Michel Houellebecq, Ennemis publics : une tournée qui, d’après le site de la revue de BHL, fut, comme l’annonce le titre de l’article qui lui est consacré, un « Triomphe, aux USA, pour Bernard-Henri Lévy et Michel Houellebecq ». Promotion réussie d’un livre, dont on nous dit qu’ « il semble qu’il soit parti pour faire un tabac ».
En témoigneraient, notamment, les critiques de la presse écrite états-unienne. Maria de França, qui a signé l’article de La règle du jeu, mentionne ainsi « la critique, excellente, signée par Sam Munson dans le Wall Street Journal ». Une critique, il est vrai, plutôt élogieuse. Puis l’article évoque « Les deux critiques, moins favorables mais importantes, signées, dans le New-York Times, par Dwight Garner (page culturelle quotidienne) et Ian Buruma (supplément Livres du week end) ».
Les extraits qui suivent, tirés de la critique de Ian Buruma, montrent ce que La règle du jeu appelle une critique « moins favorable » :
– « On peut lire ce livre, un dialogue entre deux célèbres auteurs français, comme un roman comique, une brillante satire traitant de la vanité des écrivains […] ».
– « Le running gag qui imprègne l’ensemble de la discussion est cette vaine prétention selon laquelle BHL, l’intellectuel le plus célébré et le plus médiatique [1] en France, et […] l’auteur de best-sellers Michel Houellebecq seraient détestés, persécutés et méprisés par à peu près tout le monde […] ».
– « Ce qui est hilarant […] est l’usage des hyperboles […] ».
Et encore :
– « [A propos de la façon dont BHL revendique ses « engagements » (Daniel Pearl, Ayaan Hirsi Ali, Sarajevo, etc.)] : c’est ce que les Allemands appellent un Hochstapler, quelque chose qui se situe entre le vantard et l’imposteur, une célèbre figure comique dans la littérature européenne. (...) »
– « Tout est brillamment exécuté. Mais je crains d’avoir à dire que rien de tout ceci n’est destiné à être lu comme un roman comique. Tout est fait avec le plus grand sérieux du monde ».
Etc.
Une critique « moins favorable » ? BHL et ses amis ont, décidément, le triomphe modeste, et manient tout aussi bien l’euphémisme que l’hyperbole. C’est sans doute cela, le « style BHL », complément indispensable de la rigueur et de la probité qu’il met au service du microcosme médiatique et de sa surveillance.
Parole de pape
Un style dont l’emphase et la solennité tiennent en général lieu d’argumentation.
Dans son Bloc-notes du 6 janvier, BHL professe : « Benoît XVI est parfaitement fondé à dire que les chrétiens sont, aujourd’hui, à l’échelle de la planète, le groupe religieux "en butte au plus grand nombre de persécutions" ». Aucun chiffre, aucune enquête, ne viennent étayer ce propos nuancé. Il faut dire que la source de BHL est connue pour sa modération et son objectivité.
Rideau.
Julien Salingue (avec Henri et Serge)
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, france, bhl, bernard henri lévy, frasques, sottisier, manipulations médiatiques, parisianisme, europe, affaires eruopéennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Götz Kubitschek - Konservative Subversive Aktion (KSA)
Götz Kubitschek
Konservative Subversive Aktion
KSA
00:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : subversion conservatrice, conservatisme, conservatisme révolutionnaire, allemagne, subversion, götz kubitschek |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Alexander Slavros - Portrait of Ernst Jünger
00:10 Publié dans art, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, weimar, art, peinture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Jacqueline de Romilly et la bonne Grèce

Jacqueline de Romilly et la bonne Grèce
par Claude BOURRINET
Assurément, il n’est guère correct de s’en prendre à une défunte et à son œuvre. La seule excuse à donner est que l’académicienne n’aurait pas pris la peine de réfuter ce qui suit. Cependant, le ton dithyrambique et l’encens qui ont accompagné les obsèques de l’illustre helléniste avait de quoi irriter, non seulement parce que la flagornerie, même quand il s’agit d’un mort, horripile, comme si ce supplément d’âme eût l’heur de faire oublier la catastrophe annoncée qui ruine l’enseignement du latin et du grec en France, mais on ne s’est guère demandé, et pour cause, si la bonne dame du Collège de France avait fait tout ce qu’il fallait pour qu’une telle tragédie fût devenue impensable. Il y eut bien des pétitions, des murmures de couloir, mais Jacqueline de Romilly était bien trop intégrée pour ruer comme une bacchante ou poursuivre les assassins du grec comme une Érinye assoiffée de sang.
À vrai dire, je n’ai jamais essayé de lire un de ses ouvrages sans que le livre me tombe des mains, tellement il est farci de bons sentiments, et de cette manie anachronique de démontrer l’impossible, à savoir que les Grecs, c’était nous, les modernes de 1789, de la République etc. Le paradigme politique a radicalement changé, tant le christianisme a bouleversé notre manière de voir le monde et les hommes, l’individualisme, la marchandisation, la coupure avec un ordre holiste du monde ont contribué à broyer ce qui demeurait de l’Antiquité. Au demeurant, Walter Friedrich Otto le dit très bien dans Les dieux de la Grèce; comme le souligne Détienne dans la préface de cet ouvrage fondamental : « il faut […] prendre la mesure de ce qui nous sépare, de ce qui nous rend étrangers à l’esprit grec; et en conséquence dénoncer les préjugés [positiviste et chrétien] qui nous empêchent de comprendre « les dieux de la Grèce ” ».
Et si, bien sûr, la Grèce est à l’origine de l’Europe, ce n’est pas dans le sens où les héritiers de la IIIe République l’entendent. D’une certaine manière, même si je me retrouve dans cette époque, en en partageant tous les fondements, y compris les plus scandaleux pour un moderne, et qui sont très éloignés de l’idéologie néochrétienne des droits de l’homme, la Grèce antique est complètement différente du monde contemporain. À son contact, on est en présence avec la véritable altérité (en fait notre identité). Hegel disait que pour un moderne, un Grec est aussi bizarre et étrange qu’un chien.
Voilà ce que qu’écrivait Hegel de l’Africain dans La Raison dans l’Histoire : « C’est précisément pour cette raison que nous ne pouvons vraiment nous identifier, par le sentiment, à sa nature, de la même façon que nous ne pouvons nous identifier à celle d’un chien, ou à celle d’un Grec qui s’agenouillait devant l’image de Zeus. Ce n’est que par la pensée que nous pouvons parvenir à cette compréhension de sa nature; nous ne pouvons en effet sentir que ce qui est semblable à nos sentiments. »
Le fondement de la pensée véritable, c’est ce sentiment d’étrangeté, un arrachement aux certitudes les plus convenues, pour parvenir à notre vérité profonde.
Un Grec est plus proche du Sioux, d’une certaine façon, que du kantien.
Maintenant, avec un effort d’imagination et beaucoup de caractère, on peut se sentir plus proche du Sioux que du kantien.
Jacqueline de Romilly n’a eu donc de cesse d’invoquer la Grèce antique pour louer les vertus supposées de la modernité : la démocratie, dont chacun sait qu’elle est une « invention des Grecs », l’égalité, notamment entre hommes et femmes, les droits de l’homme, etc. La presse ne s’est pas fait faute de le rappeler à satiété, comme si le retour à l’hellénisme ne pouvait que passer par les fourches caudines du politiquement correct.
La source des confusions, lorsqu’on s’avise de s’inspirer des théories politiques de l’Antiquité pour définir les modèles organisationnels de la meilleure société possible, est que nous avons affaire à deux mondes différents, et l’erreur de perspective conduit à des décalages conceptuels et symboliques, à des malentendus. Les notions qui font l’objet d’un glissement suprahistorique fallacieux, confinant à l’anachronisme, sont aisément repérables dans cette phrase, tout à fait représentative du style qu’on trouve chez nos universitaires : « Un sens de l’humanité sorti de l’histoire dont les valeurs et les idées sont toujours dans l’actualité, surtout si on a à l’esprit les remises en cause actuelles des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité, au nom du droit à la différence confinant à la différence des droits, du communautarisme encouragé par le clientélisme politique, d’un retour radical du religieux et du patriarcat déniant aux femmes qu’elles puissent être les égales de l’homme ! » (Guylain Chevrier, docteur en histoire, cf. http://www.agoravox.fr)
Tout y est, avec même le ton déclamatoire.
La réduction, dans les classes de collège et de lycée, de l’apport hellénique à la démocratie a de quoi irriter. Luciano Canfora , pour ne parler que du terme « démocratie », a démontré que, dans le préambule à la Constitution européenne de 2003, ses concepteurs, par « « bassesse » philologique », ont falsifié les « propos que Thucydide prête à Périclès » (qui était, de facto, prince – prôtos anêr, dixit Thucydide – d’Athènes) en assimilant démocratie et liberté. La « gaffe » provient de leur formation scolaire, qui leur a révélé que « la Grèce a inventé la démocratie » (« formule facile, tellement simplificatrice qu’elle se révèle fausse », écrit Canfora), sans entrevoir qu’« aucun texte écrit par un auteur athénien ne célèbre la démocratie » ! Celle-là, dans l’histoire des Grecs antiques, a été un régime minoritaire, ramassé dans le temps, qu’il n’a pas été si démocratique que cela (au sens moderne), et qu’il a été méprisé par pratiquement tous les penseurs, à commencer par le premier, Platon, qui lui reprocha d’avoir assassiné Socrate. Il faudrait analyser de plus près ce que dit Aristote, qui est plutôt pour le gouvernement des meilleurs.
D’autre part, la notion d’égalité est aussi un piège : Agamemnon par exemple est le primus inter pares. Il n’est pas question d’égalité entre êtres humains, mais entre aristocrates, entre rois. Thersite en sait quelque chose, qui reçoit de la part d’Ulysse un coup de sceptre pour avoir prôné le défaitisme, et, avant tout, pour avoir pris la parole.
Pratiquement personne n’a remis en cause l’esclavage.
Ce que l’on omet de dire, c’est que, si l’on survole l’histoire hellénique jusqu’à Rome et au-delà, le régime qui s’impose et qui, justifié par les stoïciens, les platoniciens et d’autres, semble le plus légitime, surtout après Alexandre, c’est la monarchie. L’Empire romain est fondé sur cette idéologie, comme l’a montré Jerphagnon.
Qu’en est-il de l’égalité entre l’homme et la femme ? Ce n’est pas à un Grec qu’on va faire passer cette baliverne ! Il en aurait bien ri, lui qui, sur cette question, ressemble beaucoup à un musulman, en remisant son épouse dans le gynécée. Lysistrata est une COMÉDIE, destinée à FAIRE RIRE ! Autant dire que l’idée d’égalité entre hommes et femmes était présentée comme une bouffonnerie.
Je renvoie à Vernant pour ce qui est du « mythe d’Œdipe », qu’il dénonce savamment en montrant que Freud s’était trompé sur toute la ligne.
Loin de moi l’idée de démolir la statue funèbre de Jacqueline de Romilly, mais j’avoue que les éloges actuels m’énervent un peu.
Pour apprécier en profondeur la pensée grecque (et subsidiairement romaine), autant lire Vernant, Jerphagnon (l’exquis !), Friedrich Otto, Paul Veyne, qui me semblent plus incisifs que la bonne dame pour classes terminales…
Claude Bourrinet
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=1846
00:10 Publié dans archéologie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : grèce, grèce antique, hellénisme, antiquité, jacqueline de romilly, archéologie, tradition, traditions, traditionalisme, philologie classique, huménités gréco-latines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Celtic Woman - Caledonia by Lady Avalonya
Celtic Woman
Caledonia by Lady Avalonya
00:10 Publié dans Musique, Terres d'Europe, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : calédonie, celtes, musique celtique, irlande, celticité, celtitude, musique irlandaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
D. H. Lawrence on America
D. H. Lawrence on America
Derek HAWTHORNE
Ex: http://www.counter-currents.com/
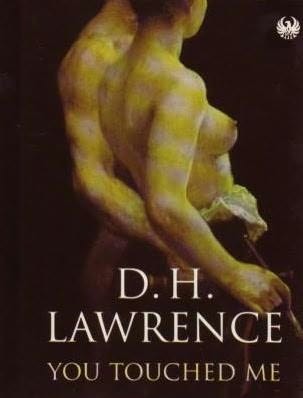 I have contributed several essays to Counter-Currents dealing with D. H. Lawrence’s critique of modernity. Those essays might lead the reader to believe that Lawrence treats modernity as a universal ideology or worldview that could be found anywhere.
I have contributed several essays to Counter-Currents dealing with D. H. Lawrence’s critique of modernity. Those essays might lead the reader to believe that Lawrence treats modernity as a universal ideology or worldview that could be found anywhere.
However, in many of his writings Lawrence treats modernity as, in effect, a spiritual disease that specifically afflicts white, northern Europeans. Everything I have said in other essays about the modern overemphasis on the “spiritual sympathetic centres” and how we starve the “lower centres” in favor of the upper, or how love and benevolence are our undoing, Lawrence usually frames in explicitly racial terms. Modernity, in other words, is the condition of white, Northern European peoples, the peoples who initiated modernity in the first place.
In a letter from October 8, 1924, when he was living in New Mexico, Lawrence writes: “I loathe winter. They gas about the Nordic races, over here, but I believe they’re dead, dead, dead. I hate all that comes from the north.” Like Nietzsche, Lawrence does not lament the “death” (or decline) of the Nordic races. He merely observes it. Nor, generally speaking, does he fall into the common error of romanticizing other races. (However, he does on occasion contrast “northern” to “southern” culture, usually to the detriment of the former.)
In Women in Love, Gerald Crich represents the white race in general; his life is an allegory of what Lawrence believes is wrong with the “northern people,” and his death symbolizes what Lawrence regarded as their degeneration. Early in the novel, Gudrun Brangwen reacts to him:
There was something northern about him that magnetised her. In his clear northern flesh and his fair hair was a glisten like sunshine refracted through crystals of ice. And he looked so new, unbroached, pure as an arctic thing. . . . “His totem is the wolf,” she repeated to herself.
Later in the novel, Birkin reflects on Gerald: “He was one of these strange white wonderful demons of the north, fulfilled in the destructive frost mystery. And was he fated to pass away in this knowledge, this one process of frost-knowledge, death by perfect cold?”
Like Gerald’s, the end of the white race shall be an ice death: a death brought about by cold ideals and abstractions; a cutting off from the source, from the life mystery. “The white races, having the Arctic north behind them, the vast abstraction of ice and snow, would fulfill a mystery of ice-destructive knowledge, snow-abstract annihilation.” It is a self-destruction, just as Gerald’s death is self-destruction.
The Great Death Continent
Though the process of snow-abstract annihilation began in Northern Europe, for Lawrence the “epicenter” of the process has shifted to North America. Lawrence’s most dramatic statement of this occurs in one of his last books, The Plumed Serpent, in a passage so important that I shall quote it at length:
Was that the clue to America, she sometimes wondered. Was it the great death-continent, the continent that destroyed again what the other continents had built up? The continent whose spirit of place fought purely to pick the eyes out of the face of God? Was that America? . . .
And did this account for the great drift to the New World, the drift of spent souls passing over to the side of godless democracy, energetic negation? The negation which is the life-breath of materialism.—And would the great negative pull of the Americas at last break the heart of the world? . . .
White men had had a soul, and lost it. The pivot of fire had been quenched in them, and their lives had started to spin in the reversed direction, widdershins [counterclockwise]. That reversed look which is in the eyes of so many white people, the look of nullity, and life wheeling in the reversed direction. Widdershins. . . .
And all the efforts of white men to bring the soul of the dark men of Mexico into final clenched being has resulted in nothing but the collapse of the white men. Against the soft, dark flow of the Indian the white man at last collapses, with his god and his energy he collapses. In attempting to convert the dark man to the white man’s way of life, the white man has fallen helplessly down the hole he wanted to fill up. Seeking to save another man’s soul, the white man lost his own, and collapsed upon himself.
There is much to digest in this passage. Lawrence is suggesting that America (by which he means North America, including Mexico and Canada) acts as a vast engine of negation, wiping away or adulterating all human characteristics and all human distinctions that are “natural,” and doing so in the name of the Ideals of democracy and materialism (i.e., commerce).
Second, Lawrence is suggesting that the soul of the “dark man” is fundamentally different from that of the white man (a point he makes again and again in the Mexican writings) and that the white man’s soul has not been shifted to the “upper centres,” or knocked widdershins and out of touch with the life mystery. Therefore, all the efforts by the white man to “civilize” the dark man are in vain and it is the latter that will in fact win the day, because in some primal sense he is “stronger.” America, in short, is the continent of nihilism; the lead actor in the final drama of white, western civilization, the Ragnarok.
One of Lawrence’s heresies is to believe in essential national and racial characters. Culture, for Lawrence, flows from natural differences between human beings—and this means that humans are not fundamentally malleable and interchangeable; certain cultures simply cannot be fitted to certain people. Nevertheless, Lawrence does not believe in any doctrine of racial superiority. (The references that Lawrence makes from time to time to an “Aryan race” and, more narrowly, to the “Nordic” type may raise eyebrows today, but such terminology was common for the time.)
The Studies in Classical American Literature
Much of Studies in Classical American Literature (1923) is devoted to developing these points. This book—one of Lawrence’s most entertaining—is misleadingly titled for it is really not so much about American literature as it is about America itself. Note that in the quote above from The Plumed Serpent Lawrence refers to America as the continent “whose spirit of place fought purely to pick the eyes out of the face of God.”
The first essay in Studies is entitled “The Spirit of Place,” Lawrence explains this term as follows:
Every continent has its own great spirit of place. Every people is polarized in some particular locality, which is home, the homeland. Different places on the face of the earth have different vital effluence, different vibration, different chemical exhalation, different polarity with different stars; call it what you like. But the spirit of place is a great reality.
America’s spirit of place, Lawrence tell us, is one which draws men who want to “get away” and to be masterless. It is the land of those drawn to a kind of negative freedom: not the freedom actually to be something, but, in essence, the freedom to not have to be anything at all, and especially not to be subject to another’s will. But as Hegel recognized this negative freedom—freedom to say no—does not translate into any positive sort of freedom at all. True freedom, Lawrence states, only comes about through finding something you “positively want to be.” Americans, on the other hand, “have always been shouting about the things they are not. Unless, of course, they are millionaires, made or in the making.”
The spirit of America, for Lawrence, thus begins to resemble very much the spirit of Gudrun Brangwen in Women in Love: negation; a fierce desire really to be nothing at all. This is American “freedom.” America is the land where the white race has gone to die, and to literally kill all its old forms: its traditions, customs, blood-ties, myths and folktales, morality, religion, high culture, even its memory of its past.
America is the land where men have come to free themselves of everything in life that is unchosen, especially when the unchosen is the natural. Again, there is a break from the primal self or true unconscious and a shift to life lived entirely from the Ideal “upper centres.” Lawrence writes, “The American has got to destroy. It is his destiny. It is his destiny to destroy the whole corpus of the white psyche, the white consciousness. And he’s got to do it secretly. As the growing of a dragon-fly inside a chrysalis or cocoon destroys the larva grub, secretly.”
The self-destruction of the white man takes place secretly, marching under the banner of the Ideal. America is the land where all the old forms are destroyed in the name of “Freedom,” “Democracy,” and, above all else, “Progress”:
Destroy! Destroy! Destroy! Hums the under-consciousness [of Americans]. Love and produce! Love and produce! cackles the upper-consciousness. And the world hears only the Love-and-produce cackle. Refuses to hear the hum of destruction underneath. Until such time as it will have to hear.
The cause of Liberty in Europe, Lawrence tells us, was something vital and life-giving. But he detects in American icons like Abraham Lincoln and Woodrow Wilson something strident, cold, and life-killing in their appeals to Democracy. American democracy, Lawrence claims, is at root a kind of “self-murder”; that is, when it is not “murdering somebody else.”
Lawrence’s analyses of American literature basically consist in showing how these American tendencies play themselves out in authors like Franklin, Hawthorne, Poe, Melville, Whitman, and others. Whitman—an author with whom Lawrence had a love-hate relationship—gets by far the roughest treatment:
ONE DIRECTION! toots Walt in the car, whizzing along [in] it. . . .
ONE DIRECTION! whoops America, and sets off also in an automobile.
ALLNESS! shrieks Walt at a cross-road, going whizz over an unwary Red Indian.
ONE IDENTITY! chants democratic En Masse, pelting behind in motor-cars, oblivious of the corpses under the wheels.
 It is Lawrence’s analysis of Melville’s Moby Dick, however, that is perhaps his most incisive. He sees in this simple story an encapsulation of the American spirit, the American thanatos itself. Here is Lawrence summing up his interpretation:
It is Lawrence’s analysis of Melville’s Moby Dick, however, that is perhaps his most incisive. He sees in this simple story an encapsulation of the American spirit, the American thanatos itself. Here is Lawrence summing up his interpretation:
What then is Moby Dick? He is the deepest blood-being of the white race; he is our deepest blood-nature.
And he is hunted, hunted, hunted by the maniacal fanaticism of our white mental consciousness. We want to hunt him down. To subject him to our will. And in this maniacal conscious hunt of ourselves we get dark races and pale to help us, red, yellow, and black, east and west, Quaker and fire-worshipper, we get them all to help us in this ghastly maniacal hunt which is our doom and our suicide.
The last phallic being of the white man. Hunted into the death of the upper consciousness and the ideal will. Our blood-self subjected to our will. Our blood-consciousness sapped by a parasitic mental or ideal consciousness.
When a people loses a sense of blood-relatedness, what basis is there for community? American community is not based on blood ties, shared history, shared religion, or shared culture: it is based on ideology. He who professes the American creed is an American—he who does not is an outcast.
The American creed is based principally on a belief in freedom, equality, and Progress. For Lawrence, the first of these is (in its American form) empty, and the other two are a lie. American equality is a lie because in fact people are not equal, and virtually everyone realizes this in their heart of hearts.
American ethics requires, however, that everyone pay lip service to the idea that no one is, or can be, fundamentally better than anyone else. This is one of the country’s core beliefs. In fact, Lawrence points out that this is so fundamental to being an American that Americans are terrified lest they somehow let on to their fellow countryman that they really don’t believe that everyone is equal, or that all opinions are equally valid and valuable. They are afraid of seeming “judgmental,” and they parrot an absurd relativism in order to be seen by others as “tolerant.” Lawrence writes of America, “I have never been in a country where the individual has such an abject fear of his fellow countrymen. Because, as I say, they are free to lynch the moment he shows he is not one of them.”
Essentially the same point was made by Alexis de Tocqueville. In his Democracy in America, Tocqueville includes a section titled “The Power Exercised by the Majority in America over Thought,” and writes as follows:
I know no country in which, speaking generally, there is less independence of mind and true freedom of discussion than in America. . . . In America the majority has enclosed thought within a formidable fence. A writer is free inside that area, but woe to the man who goes beyond it. . . . Before he goes into print, he believes he has supporters; but he feels that he has them no more once he stands revealed to all, for those who condemn him express their views loudly, while those who think as he does, but without his courage, retreat into silence as if ashamed of having told the truth. . . . Hence the majority lives in a state of perpetual self-adoration; only strangers or experience may be able to bring certain truths to the Americans’ attention. (Alexis de Tocqueville, Democracy in America, trans. George Lawrence [New York: Doubleday, 1969], 254–55)
A creedal state such as America is as intolerant as a creedal religion. A Jew who does not believe in the Exodus story does not cease thereby to be a Jew, since being Jewish is an ethnic as well as a religious identification. Similarly, Hinduism (another ethnic religion) tolerates and subsumes a vast number of doctrines and differences of emphasis. (It is even possible, in a certain sense, to be an atheist Hindu.) Christianity and Islam, however, are creedal religions and therefore much less tolerant of doctrinal deviations. One can stop being a Christian or a Muslim—immediately—by believing or not believing certain things.
America early on divided itself into ethnic communities—the English, the Germans, the Irish, etc. A genuine spirit of community existed within these groups, in virtue of their blood ties and shared history, culture, and religion. But gradually these communities mixed and lost their unique identities. The creed of “Americanism” was the only thing that then arose as something that was supposed to bind people together. But since Americanism consists mostly of the recognition of negative liberties, how effective could it be at creating community? The result is that Americans became increasingly alienated from each other.
In his Preface to Edward Dahlberg’s Bottom Dogs (1929) Lawrence speaks of the breakdown in America of “blood-sympathy” and argues that it is responsible for a seldom-discussed facet of the American character, one which Europeans find particularly strange and amusing: the American pre-occupation with hygiene and super-cleanliness:
Once the blood-sympathy breaks . . . human beings become secretly intensely repulsive to one another, physically, and sympathetic only mentally and spiritually. The secret physical repulsion between people is responsible for the perfection of American “plumbing,” American sanitation, and American kitchens, utterly white-enamelled and antiseptic. It is revealed in the awful advertisements such as those about “halitosis,” or bad breath. It is responsible for the American nausea at coughing, spitting, or any of those things. The American townships don’t mind hideous litter of tin cans and broken rubbish. But they go crazy at the sight of human excrement.
With the blood-sympathy broken, Americans seek as much as possible to isolate themselves from their fellow citizens, who they fear and find repulsive. In his essay “Men Must Work and Women as Well,” Lawrence writes presciently of how technology serves to abstract us from human relationships: “The film, the radio, the gramophone were all invented because physical effort and physical contact have become repulsive to us.”
The radio and the gramophone brought individuals and families indoors and isolated them in their individual dwellings. No longer did they sit on their front porches and converse with their neighbors. The rise of the automobile contributed to this as well. Front porches were built for the cleaner, slower paced horse-and-buggy days. Sitting on the front porch was no longer so attractive when it meant being subjected to the noise and exhaust of automobiles whizzing by. Architecture began to reflect this change in the early part of the twentieth century, with designs for new houses sometimes eliminating the front porch altogether, and often with entrances concealed from view.
In the early days of the radio and the gramophone, only some families owned them, and they would often invite the neighbors in to listen to the gramophone or to the radio. This was also the case in the early days of television. But as these technologies became cheaper, just about every family acquired them and instead of facilitating social interaction they came to positively inhibit it. One can see this same phenomenon playing itself out in an even more radical way in the age of personal computers. It is now quite common for many Americans to live almost completely isolated lives, interacting with others via the Internet and carrying on “virtual relationships.”
Progressively, the lives of Americans became denuded of most of the features that have made life worth living throughout human history: community, extended family relations, participation in rituals, customs, traditions, remembrance of the past through shared stories, and the transmission of folk wisdom through myths, fables, and songs. The lives of most Americans became entirely dominated by the concerns of what Hegel called bürgerliche Gesellschaft, or “bourgeois society”: the realm of commerce.
“Getting ahead” becomes the primary concern in life, and all else—all the products of High Culture and most of the simple pleasures of life—become distractions, impracticalities. In his essay “Europe v. America,” Lawrence writes that “the American grips himself, at the very sources of his consciousness, in a grip of care: and then, to so much of the rest of life, is indifferent. Whereas the European hasn’t got so much care in him, so he cares much more for life and living.”
This is the secret to much of the inadequacy that Americans still feel when in Europe or in European company. Partly it is the (usually correct) sense that Europeans are better educated. But it is also the sense that these people have mastered the art of life. Life for most Americans is a problem to be solved, something we will eventually be able to do better than the Old World, thanks to the marriage of commerce and science.
Hence the tendency of Americans to believe anything that is asserted by scientists and medical men, no matter how ridiculous and ill-founded, and to distrust all that comes from tradition and “the past.” As witness the bizarre American reliance on “self-help books” and “how-to” manuals, even on such subjects as making friends or raising children. Americans are aware that these things were done in the past, without manuals, but believe that “experts” can teach us how to do them better than they have ever been done before.
While we wait for science to tell us how to live, life slips by. As Lawrence writes in a letter, “They can’t trust life until they can control it. So much for them—cowards! You can have the Land of the Free, as much as I know of it.”
Perhaps Lawrence’s most eloquent and succinct summation of the difference between the New World and the Old comes is the following line from “Europe v. America”: “The Europeans still have a vague idea that the universe is greater than they are, and isn’t going to change very radically, not for all the telling of all men put together.”
With life narrowed to the concerns of “getting ahead,” and natural human sympathies submerged or obliterated, Americans began to see each other more and more merely as objects: as consumers, or competitors, or employees, or bosses, but seldom as flesh and blood human beings. Thus we find the terrible American record of exploitation of the workers; frauds committed against the consumers, often at the expense of their health or even their lives; the devastation of communities wrought by the dumping of industrial waste; and the dumping of armies of workers in massive “layoffs.”
Heidegger was right: in its disregard for human life, American capitalism reveals itself as metaphysically identical to communism. And like communism, it tramples human life in the name of Progress. In its paper-thin idealism, its inhumanity, its self-destructiveness, and in its uncertainty of exactly what it is or should be, America is Women in Love’s Gerald Crich made real on a vast scale. Or, rather, Gerald Crich—coupled with the nihilism of Gudrun Brangwen—is the spirit of America. (Remember, those two are a couple: they complement one another. See my essay on Women in Love.)
The spirit of America—at once nihilism and “benevolent” idealism—can be seen very clearly in how it has treated other peoples both on its own soil and abroad. Earlier we saw in The Plumed Serpent Lawrence commenting on the white man’s attempt to “civilize” the “dark men.” Why do Americans feel that they must bend others to their way of life? American universalism leads to the belief that inside every foreigner is an American just screaming to get out.
Americans are like fresh converts to a religion, who feel that they have to convert all their friends—subconsciously in order to reassure themselves that they have made a sound choice. Americans have given up so much that was once thought to be essential to life and to community—so they simply must be right; others must find their way the most desirable way. If they do not, then they are ignorant and don’t know what’s good for them; or their governments have prevented them from seeing the truth.
Americans have been converting foreigners into Americans for a long time now, through exporting their consumer culture (irresistibly appealing to the baser elements in all peoples), and through less peaceable means.
On their own soil, white Americans have also tried to convert the “dark man” to Americanism. In his essay “Certain Americans and an Englishman,” Lawrence speaks of Americans trying to turn the Red Man into a “wage earner.” This can be done, up to a point, but at the price of the Red Man sacrificing his soul. But ultimately Lawrence believes there can be no true harmony between different races, because they are so different, and that the attempts of white men to create “multicultural societies” will end in the destruction of the whites (an outcome he does not particularly lament).
Writing of Hector St. John de Crèvecouer in Studies, Lawrence states that he only wanted to know the Red Man in his head, abstractly because “he must have suspected that the moment he saw as the savages saw, all his fraternity and equality would go up in smoke, and his ideal world of pure sweet goodness along with it.” Later on in Studies, Lawrence writes that “The Red Man and the White Man are not blood-brothers: even when they are most friendly. When they are most friendly, it is as a rule the one betraying his race-spirit to the other.”
Lawrence’s views on America are apocalyptic. He sees no hope for the country, and seems to believe that it will drag the rest of the white world down with it. What, then, are we to make of these extreme views? Much of what Lawrence has to say about the emptiness of American ideals, and the emptiness of American lives, presages arguments that would be made by numerous social critics years later, especially in the 1950s and 1960s. I am thinking of such writers as Erich Fromm, Wilhelm Reich, Christopher Lasch, and Daniel Bell. Much of what he has to say would strike any Leftist as uncontroversial.
But once again Lawrence shows himself to be a kind of political hybrid, for his remarks on race, his opposition to the ideal of equality, and his opposition to multiculturalism seem to put him, by today’s standards, on the extreme right. Of course, contrary to what many Leftists might think, simply to point this out does not serve to refute Lawrence. Nor is it entirely convincing to accuse him of inconsistency: perhaps it is today’s Leftists and Rightists who are confused. And there is some plausibility to this suggestion.
For example, leftists today advocate both multiculturalism and “diversity,” which they tend to equate. But it is hard to see how the latter can be preserved if the former is achieved. In other words, inevitably a multicultural society would lead to the blending of peoples and the blending and watering-down of cultures, thus potentially destroying diversity rather than maintaining it. Lawrence challenges us to critique our own views, and to question their consistency—and their sanity.
There is no easy, ready-to-hand answer to Lawrence’s charges—about America in particular, or modernity in general. They strike at the heart of what is believed by most people in the West today. Whatever else one may say about his views, it is striking how their capacity to shock and to challenge us has only increased over the years.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, amérique, américanisme, littérature, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, d. h. lawrence |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 28 janvier 2011
Lou Bastioun - "Le vent se lève"
00:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nice, cinéma, ciné forum, irlande, révolution irlandaise, années 20 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Udo Ulfkotte - Kommt der Bürgerkrieg?
Udo Ulfkotte
Kommt der Bürgerkrieg?
00:20 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, guerre civile, immigration, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Programa de las I Jornadas antiglobalizacion
Programa de las I Jornadas antiglobalización
Jornadas Antiglobalización 2011,
por una Alternativa Identitaria
12 y 13 de Febrero, Zaragoza
Programa de actividades
Sábado, 12 de Febrero
11:00h. Conferencia “El origen del conflicto bélico en Oriente Medio”, por el Doctor Nasser Issa
12:00. Receso
12:30h. Conferencia “El conflicto de Oriente Medio,el terrorismo islámico y la ceguera de Occidente”, por Jorge Álvarez
13:30h. Receso
14:00h. Comida
16:00h. Conferencia “Aragón. España. Europa”, por Cristóbal Chesús Parra Ruiz
17:00h. Receso
17:30h. Presentación de libros: “Pedro Laín Entralgo. El político. El pensador. El científico.”, por José Alsina
Y
“Introducción al tradicionalismo de Julius Evola”, por Ángel Fernández
18:30h. Receso.
19:00h. Conferencia “La infiltración sionista en Iberoámerica”, por Jesús Vallés Gracia
20:00h. Fin de la Primera Jornada
Tras la cena habrá una velada musical
Domingo, 13 de febrero
11:00h. Conferencia, “El americanismo y su “doble” europeo” por Tomislav Sunic
12:00h. Receso
12:30h. Conferencia “La crisis y el poder de la banca”, por Joaquim Bochaca
13:30h. Clausura de las Jornadas, A cargo del Delegado de Aragón del MSR, Javier Bueno
Habrá varios stands
EXPOSICIÓN ARTÍSTICA A CARGO DEL PINTOR:
Borislav Prangov
Entrada para los dos días: 10€
(*) Con la entrada se obsequiará con el CD de Axis Mundi y Mara Ros: “Recuerdos”
o un libro del fondo editorial de Ediciones Nueva República.
Organiza:
Movimiento Social Republicano de Aragón
zaragoza@msr.org.es
Teléfono:
666 54 52 11
00:20 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, espagne, globalisation, antimondialisme, mondialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Local contre global
Terre & Peuple - Bannière Wallonie 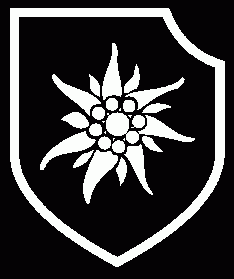
Notre prochaine activité
ONZIEMES RENCONTRES DES IDENTITAIRES DE COLOMA
le samedi 12 février 2011
LOCAL CONTRE GLOBAL
L’utopie mondialiste globalitaire ne cesse de prouver sa nuisance et son inefficacité, sauf à permettre à une super-classe cosmopolite de s’enrichir monstrueusement. Cette oligarchie tient les commandes de la manipulation macro-médiatique et macro-économique des masses. C’est sur le plan de micro-structures que la résistance à l’aliénation doit et peut s’organiser.
François-Xavier Robert : Mondialisation et mondialisme : la mondialisation est une évolution naturelle millénaire; au contraire, le mondialisme, comme l’altermondialisme, sont des idéologies totalitaires.
Arnaud de Robert : La ré-appropriation par une information locale
Jonathan Le Clercq : La ré-appropriation par une monnaie locale
Table ronde :
Jean François, Lionel Franc, Gérald Fontaine, Xavier de Launay, Olivier Bonnet et Roberto Fiorini
La ré-appropriation par la culture locale, par les habitudes alimentaires locales, par les randonnées locales, par les traditions vestimentaires, les fêtes, les rites, les lieux sacrés locaux, l’économie équitable, le mouvement coopératif, le micro-capitalisme, la perma-culture biologique, les activités éducatives et sportives locales, etc
Conclusions : Une nouvelle résistance pacifique locale
Pierre Vial : Conclusions idéologiques et stratégiques
Hervé Van Laethem : Conclusions pratiques et tactiques
Accueil : 12h30 Ouverture de la séance : 14h
petite restauration, nombreux exposants,
Au Château Coloma, 25 rue J. De Pauw à Sint-Pieters-Leeuw
Itinéraire : Sur le ring ouest de Bruxelles, prendre la sortie 16 en direction de Leeuw-Saint-Pierre (le Château Coloma est fléché en blanc sur brun) ou prendre le bus H à la gare du Midi à Bruxelles (il a son arrêt au coin de la rue De Pauw)
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Terre et Peuple - Bannière Wallonie
http://www.terreetpeuple.com
Mail: tpwallonie@gmail.com
Tel: 0032/ 472 28 10 28
Compte: 310-0302828-80
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
00:20 Publié dans Evénement, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, nouvelle droite, localisme, globalisme, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Riverdance: Irish Tap Dancing (2007)
Riverdance:
Irish Tap Dancing (2007)
00:10 Publié dans Musique, Terres d'Europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tap dancing, irlande, musique irlandaise, danse, folklore, terres d'europe, celtitude, celticité, celtes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Wikileaks - Pearl Harbor, 1941

Wikileaks - Pearl Harbor, 1941
by Srdja Trifkovic
Ex: http://www.chroniclesmagazine.org/
Over two thousand four hundred American sailors, soldiers and airmen were killed in Pearl Harbor 69 years ago today. Had we had an equivalent of WikiLeaks back in 1941, however, the course of history could have been very different. FDR would have found it much more difficult to maneuvre the country into being attacked in the Pacific in order to enable him to fight the war in Europe, which had been his ardent desire all along.
One leak—just one!—almost torpedoed Roosevelt’s grand design. In mid-1941 he incorporated the Army’s, Navy’s and Air Staff’s war-making plans into an executive policy he called “Victory Program,” effectively preparing America for war against Germany and Japan regardless of Congressional opposition and the will of the people. His intention was to lure public opinion into supporting the Program because the increase in weapons production promised meant more jobs and a healthier economy. A supporter of the America First Committee, Senator Burton K. Wheeler, obtained a copy of the Victory Program, classified Secret, from a source within the Air Corps, and leaked it to two newspapers on December 4, 1941, the Chicago Tribune (a serious newspaper back then) and the Washington Times-Herald (long defunct). Vocal public opposition to the plan erupted immediately, but ceased three days later, on December 7, 1941. Congress soon passed the Victory Program with few changes. The Japanese performed on cue.
Imagine the consequences had the Chicago Tribune and the Washington Times-Herald published a series of other leaks over the preceding few months, including the following:
Berlin, 27 September 1940. U.S. Embassy reports the signing of the Tripartite Pact, the mutual assistance treaty between Germany, Italy, and Japan: “It offers the possibility that Germany would declare war on America if America were to get into war with Japan, which may have significant implications for U.S. policy towards Japan.”
Washington, 7 October 1940. Having considered the implications of the Tripartite Pact, Lt. Cdr. Arthur McCollum, USN, of the Office of Naval Intelligence (ONI), suggests a strategy for provoking Japan into attacking the U.S., thus triggering the mutual assistance provisions of the Tripartite Pact and finally bringing America into war in Europe. The proposal called for eight specific steps aimed at provoking Japan. Its centerpiece was keeping the U.S. Fleet in Hawaii as a lure for a Japanese attack, and imposing an oil embargo against Japan. “If by these means Japan could be led to commit an overt act of war, so much the better,” the memo concluded.
Washington, 23 June 1941. One day after Hitler’s attack on Soviet Russia, Secretary of the Interior and FDR’s advisor Harold Ickes wrote a memo for the President, saying that “there might develop from the embargoing of oil to Japan such a situation as would make it not only possible but easy to get into this war in an effective way. And if we should thus indirectly be brought in, we would avoid the criticism that we had gone in as an ally of communistic Russia.”
Washington, 22 July 1941. Admiral Richmond Turner’s report states that “shutting off the American supply of petroleum to Japad will lead promptly to the invasion of Netherland East Indies: “[I]t seems certain [Japan] would also include military action against the Philippine Islands, which would immediately involve us in a Pacific war.”
Washington, 24 July 1941. President Roosevelt says, “If we had cut off the oil, they probably would have gone down to the Dutch East Indies a year ago, and you would have had war.” The following day he freezes Japanese assets in the U.S. and imposes an oil embargo against Japan.
London, 14 August 1941. After meeting the President at the Atlantic Conference, Prime Minister Winston Churchill noted the “astonishing depth of Roosevelt’s intense desire for war.” PM is aware that FDR needs to overcome the isolationist resistance to “Europe’s war” felt by most Americans and their elected representatives.
Washington, 24 September 1941. Having cracked the Japanese naval codes one year earlier, U.S. naval intelligence deciphers a message from the Naval Intelligence Headquarters in Tokyo to Japan’s consul-general in Honolulu, requesting grid of exact locations of U.S. Navy ships in the harbor. Commanders in Hawaii are not warned.
Washington, 18 October 1941. FDR’s friend and advisor Harold Ickes notes in his diary: “For a long time I have believed that our best entrance into the war would be by way of Japan.” Yet four days later opinion polls reveal that 74 percent of Americans opposed war with Japan, and only 13 percent supported it.
Washington, 25 November 1941. Secretary of War Stimson writes that FDR said an attack was likely within days, and wonders “how we should maneuver them into the position of firing the first shot without too much danger to ourselves… In spite of the risk involved, however, in letting the Japanese fire the first shot, we realized that in order to have the full support of the American people it was desirable to make sure that the Japanese be the ones to do this so that there should remain no doubt in anyone’s mind as to who were the aggressors.”
Washington, 26 November 1941. Both US aircraft carriers, the Enterprise and the Lexington, are ordered out of Pearl Harbor “as soon as possible”. The same order included stripping Pearl of 50 planes, 40 percent of its already inadequate fighter protection.
Washington, 26 November 1941. Secretary of State Hull demands the complete withdrawal of all Japanese troops from French Indochina and from China.
Tokyo, 27 November 1941. U.S. Ambassador to Japan Grew says this is “the document that touched the button that started the war.” The Japanese reacted on cue: On December 1, final authorization was given by the emperor, after a majority of Japanese leaders advised him the Hull Note would “destroy the fruits of the China incident, endanger Manchukuo and undermine Japanese control of Korea.”
San Francisco, 1 December 1941. Office of Naval Intelligence, ONI, 12th Naval District in San Francisco found the Japanese fleet by correlating reports from the four wireless news services and several shipping companies that they were getting signals west of Hawaii. There are numerous U.S. naval intelligence radio intercepts of the Japanese transmissions.
Washington, 5 December 1941, 10 a.m. President Roosevelt writes to the Australian Prime Minister that “the next four or five days will decide the matters” with Japan.
Washington, 5 December 1941, 5 p.m. At Cabinet meeting, Secretary of the Navy Frank Knox says, “Well, you know Mr. President, we know where the Japanese fleet is?” FDR replied, “Yes, I know … Well, you tell them what it is Frank.” Just as Knox was about to speak Roosevelt appeared to have second thoughts and interrupted him saying, “We haven’t got anything like perfect information as to their apparent destination.”
Washington, 6 December 1941, 9 p.m. At a White House dinner Roosevelt was given the first thirteen parts of a fifteen part decoded Japanese diplomatic declaration of war and said, “This means war!” he said to Harry Hopkins, but did not interrupt the soiree and did not issue any orders to the military to prepare for an attack.
As per that old cliché, the rest is history…
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, roosevelt, etrats-unis, pearl harbor, japon, pacifique, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, années 40 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
D. H. Lawrence's "Women in Love": Anti-Modernism in Literature
D. H. Lawrence’s Women in Love :
Anti-Modernism in Literature
Derek Hawthorne
Ex: http://www.counter-currents.com/
 D. H. Lawrence’s greatest novel is also his most anti-modern. Written between April and October of 1916 in Cornwall, during some of the darkest days of the First World War, Women in Love
D. H. Lawrence’s greatest novel is also his most anti-modern. Written between April and October of 1916 in Cornwall, during some of the darkest days of the First World War, Women in Love was conceived as a sequel to The Rainbow. (Both novels were brilliantly filmed
by Ken Russell.) Women in Love continues the story of Ursula Brangwen’s life, and the fulfillment she finds in a love affair with Rupert Birkin (who does not figure in The Rainbow at all). This relationship is, in fact, paired with another: that of Gudrun, Ursula’s sister (a very minor character in The Rainbow), and Gerald Crich, Birkin’s best friend. The novel follows the course of both relationships.
The connection between the two novels seems a tenuous one at best, however, and one can read and appreciate Women in Love without any knowledge at all of The Rainbow. This has a great deal to do with the dramatic difference in tone between the two. In a letter, Lawrence described the relationship between the two novels as follows: “There is another novel, sequel to The Rainbow, called Women in Love . . . this actually does contain the results in one’s soul of the war; it is purely destructive, not like The Rainbow, destructive-consummating.”
Women in Love is indeed “purely destructive”: it is grimly apocalyptic and misanthropic. There is little sense of the presence of nature this time: the novel moves almost entirely within the conscious and (more importantly) subconscious minds of its four main characters. And the backdrop is the ugly, human–built mechanicalness of the industrialized Midlands. It is easy to attribute the change in tone between the two novels as due to Lawrence’s horror at the war (“The war finished me,” he later said).
But one must not lose sight of the fact that the two novels do, in fact, tell one continuous story, and that the switch in tone is appropriate to what the second half of the story depicts: the fragmentary lives of individuals struggling to find fulfillment in the modern world. In his “Foreword” to the novel Lawrence wrote that it “took its final shape in the midst of the period of war, though it does not concern the war itself. I should wish the time to remain unfixed, so that the bitterness of the war may be taken for granted in the characters.” For Lawrence, as for Heidegger, the war was ultimately just an inevitable extension of the industrial age itself.
At the beginning of the story, Birkin is involved in an unhappy love affair with Hermione Roddice, the daughter of an aristocrat and a thinly-disguised portrait of Lady Ottoline Morrell. Birkin is already acquainted with Ursula professionally, as he is the local school inspector and she the school mistress. After they are brought closer together and love begins to grow between them, Birkin abandons Hermione. The memorable episode that precipitates the final break between them involves Hermione trying to bludgeon him to death with a lapis lazuli paperweight.
However, Birkin’s relationship with Ursula is, from the first, difficult in its own way. Much of the reason has to do with Birkin’s misanthropy and Schopenhauerian pessimism. At some level, Ursula sympathizes with Birkin’s views, but she is put off by his extraordinary vehemence, and, more importantly, seems to feel that if he would admit his love for her and fully surrender himself to their relationship he would be freed from his all-consuming hatred of the world. She is carrying on with life, in spite of everything, and eventually she succeeds in drawing him back into life.
The character of Rupert Birkin is universally acknowledged to be a self-portrait of Lawrence, though it would be dangerous to assume that Lawrence has no critical distance from the character (or from himself, for that matter). Nevertheless, Birkin often speaks for Lawrence. Early in the novel Birkin declares that it would be much better if humanity “were just wiped out. Essentially they don’t exist, they aren’t there.” Later, in conversation with Ursula, Birkin declares:
“Humanity is a huge aggregate lie, and a huge lie is less than a small truth. Humanity is less, far less than the individual, because the individual may sometimes be capable of truth, and humanity is a tree of lies. And they say that love is the greatest thing: they persist in saying this, the foul liars, and just look at what they do! . . . It’s a lie to say that love is the greatest. . . . What people want is hate—hate and nothing but hate. And in the name of righteousness and love they get it. . . . If we want hate, let us have it—death, murder, torture, violent destruction—let us have it: but not in the name of love. But I abhor humanity, I wish it was swept away. It could go, and there would be no absolute loss, if every human being perished tomorrow. . . .”
“So you’d like everybody in the world destroyed?” said Ursula. . . .
“Yes truly. You yourself, don’t you find it a beautiful clean thought, a world empty of people, just uninterrupted grass, and a hare sitting up?”
The pleasant sincerity of his voice made Ursula pause to consider her own proposition. And it really was attractive: a clean, lovely, humanless world. It was the really desirable. Her heart hesitated and exulted. But still, she was dissatisfied with him.
If anything, in his own correspondence Lawrence goes further than Birkin. In a letter to his friend S. S. Koteliansky, dated September 4, 1916, while Lawrence was working on Women in Love, he declares:
I must say I hate mankind—talking of hatred, I have got a perfect androphobia. When I see people in the distance, walking along the path through the fields to Zennor, I want to crouch in the bushes and shoot them silently with invisible arrows of death. I think truly the only righteousness is the destruction of mankind, as in Sodom. . . . Oh, if one could but have a great box of insect powder, and shake it over them, in the heavens, and exterminate them. Only to clear and cleanse and purify the beautiful earth, and give room for some truth and pure living.
Where Women in Love is most interesting, however, is not in such outpourings of venom, but in Lawrence’s attempts to pinpoint why things have gone so disastrously wrong in the modern world. As have many other authors, Lawrence places a great deal of weight on the materialism and mechanism of industrialized modernity. Another, later, exchange between Birkin and Ursula is particularly revealing in this regard. The pair have just bought a chair at a flea market and Birkin states:
“When I see that clear, beautiful chair, and I think of England, even Jane Austen’s England—it had living thoughts to unfold even then, and pure happiness in unfolding them. And now, we can only fish among the rubbish-heaps for the remnants of their old expression. There is no production in us now, only sordid and foul mechanicalness.”
“It isn’t true,” cried Ursula, “Why must you always praise the past at the expense of the present? Really, I don’t think so much of Jane Austen’s England. It was materialistic enough, if you like—”
“It could afford to be materialistic,” said Birkin, “because it had the power to be something other—which we haven’t. We are materialistic because we haven’t the power to be anything else—try as we may, we can’t bring off anything but materialism: mechanism, the very soul of materialism.”
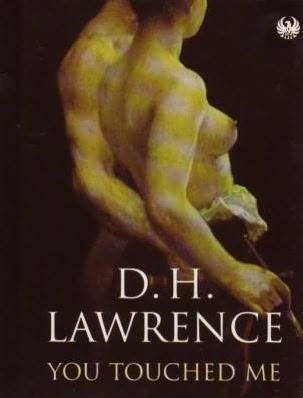 But why did Jane Austen’s England have the power to be something else? And what else did it have the power to be? For the answers to these questions we must, in essence, look back to The Rainbow. Jane Austen’s England still preserved some connection to the land—a sense of belonging to nature. What England then had the “power to be” was nothing grand and idealistic: it had the power simply to be its natural self. The people of Jane Austen’s England made and enjoyed beautiful objects—but these objects were an ornament to a life lived in relative closeness to the earth.
But why did Jane Austen’s England have the power to be something else? And what else did it have the power to be? For the answers to these questions we must, in essence, look back to The Rainbow. Jane Austen’s England still preserved some connection to the land—a sense of belonging to nature. What England then had the “power to be” was nothing grand and idealistic: it had the power simply to be its natural self. The people of Jane Austen’s England made and enjoyed beautiful objects—but these objects were an ornament to a life lived in relative closeness to the earth.
In the industrialized world of 1916, however, objects are all that human beings have. The object of life itself becomes the production and acquisition of objects. This by itself cannot, of course, provide any sense of “meaning in life,” and to fill this void we have introduced idealism and given to our materialism a moral veneer: we are making Progress, alleviating hunger and disease and want, promoting equality, and in general perfecting ourselves and the world through the marriage of science and commerce.
Gerald Crich and the Mastery of Nature
In Women in Love the coupling of industrial materialism with idealism is personified by Birkin’s friend Gerald Crich, son of the local colliery owner. On the train together, the two men speak of the modern world: “So you really think things are very bad?” Gerald asks. “Completely bad,” Birkin responds. Throughout the novel, Gerald is drawn to Birkin, fascinated by the man and his notions—yet he is repelled by him at the same time, and frightened. He encourages Birkin to explain what he means, and Birkin obliges him:
“We are such dreary liars. Our idea is to lie to ourselves. We have an ideal of a perfect world, clean and straight and sufficient. So we cover the earth with foulness; life is a blotch of labour, like insects scurrying in filth, so that your collier can have a pianoforte in his parlour, and you can have a butler and a motor-car in your up-to-date house, and as a nation we can sport the Ritz, or the Empire, Gaby Deslys and the Sunday newspapers. It is very dreary.”
But Gerald responds that he thinks the pianoforte represents “a real desire for something higher” in the collier’s life.
“Higher!” cried Birkin. “Yes. Amazing heights of upright grandeur. It makes him so much higher in his neighboring collier’s eyes. He sees himself reflected in the neighboring opinion, like in a Brocken mist, several feet taller on the strength of the pianoforte, and he is satisfied. He lives for the sake of that Brocken spectre, the reflection of himself in the human opinion.”
Material things and the zeal for material things do not lift up the average man. They merely produce what Christopher Lasch aptly called “the culture of narcissism,” and what Wendell Berry has called a “consumptive culture.” One of the absurdities of modern life is the pretence that human beings who have been reduced to the level of mere consumers are somehow more “advanced” than their ancestors.
But aside from man the consumer, what of man the producer? After all, someone has to produce all those pianofortes. This is where men like Gerald come in. Birkin asks Gerald what he lives for. Gerald answers: “I suppose I live to work, to produce something, in so far as I am a purposive being. Apart from that, I live because I am living.” Ursula remarks to Gudrun that Gerald has “got go, anyhow” and Gudrun replies, “The unfortunate thing is, where does his go go to, what becomes of it?” Ursula suggests, jokingly, that it “goes in applying the latest appliances!” This remark, however, is truer than she supposes.
The most brilliantly-written chapter of Women in Love is “The Industrial Magnate,” in which Lawrence depicts Gerald’s mastery of the mine. Gerald spends the first few years of his adult life wandering aimlessly, but always in hearty, masculine fashion: living the wild life of a student, becoming a soldier, then an adventurer. Always with Gerald there was an overweening curiosity and a desire truly to master something—a desire which masks a real, inner feeling of helplessness and lostness. He finds his true calling in running the mine, for there he believes he has found the meaning of life:
Immediately he saw the firm, he realized what he could do. He had to fight with Matter, with the earth and the coal it enclosed. This was the sole idea, to turn upon the inanimate matter of the underground, and reduce it to his will. . . . There were two opposites, his will and the resistant Matter of the earth. . . . He had his life-work now, to extend over the earth a great and perfect system in which the will of man ran smooth and unthwarted timeless, a Godhead in process.
By writing “Matter” with a capital M, Lawrence underscores the fact that for Gerald the mine is important not in itself but for what it represents. Gerald sees himself not merely as a colliery owner, but as a titanic being: a participant in the long, historical process of man’s divinization through the conquest of nature, now coming to full consummation in the industrial age.
But where has he gotten such ideas? Lawrence tells us that Gerald “refused to go to Oxford, choosing a German university,” and that he “took hold of all kinds of sociological ideas, and ideas of reform.” It is plain that Gerald has been exposed to a great deal of German philosophy. In depicting Gerald’s outlook on life, Lawrence seems to be blending ideas and terminology from three German philosophers: Fichte, Hegel, and Nietzsche.
Fichte and the Mastery of Nature
Lawrence writes that through Gerald’s domination of his will (or his ideals) over Matter “there was perfection attained, the will of mankind was perfectly enacted; for was not mankind mystically contradistinguished against inanimate Matter, was not the history of mankind just the history of the conquest of the one by the other?” The philosophy this is closest to is that of Fichte, though Lawrence is probably thinking of Hegel.
Fichte believed, essentially, that an objective world—an other standing opposed to ego—existed merely as an instrument for the expression of human will. Nature, or what Lawrence here calls “Matter,” exists as something that must be overcome and transformed by human beings according to human ideals. In doing so, human beings realize themselves. All of human history for Fichte, indeed all of reality, is the unending imposition of the ideal on the real, or the transformation of material otherness into an image of human will.
Even though Fichte’s philosophy, at first glance, appears to be something novel, in fact in a sense it is (and was) nothing new at all: it is the underlying metaphysics of modernity laid bare. In the modern world, again, human beings essentially relate to nature as raw material that must be forced to fit human designs or interests—or at best as a mere background for human action. Further, time is conceived in linear fashion and history as a movement from darkness to light, from primitivism to progressivism.
The humanism of the Renaissance becomes, in the modern period, anthropocentrism. Man is a titanic being without any natural superior, whose vocation is to better the world and other men. It is pointless to ask when, exactly, these modern attitudes took hold. In part, they are an outgrowth of Christian monotheism, which taught the idea that the earth and all its contents has been given to man by God for his exclusive use.
Renaissance humanism, which was in many ways a kind of neo-pagan revolt against Christianity, celebrated the ideal of man as Magus, and as a kind of mini-God here on earth. In part, though these Renaissance ideas were bound up with the revival of Hermetic occultism, they paved the way for the scientific revolution represented by men such as Francis Bacon.
By that point in history, belief—real belief—in the God of monotheism was dying, at least among the intelligentsia, who veered more and more toward abstract conceptions of divinity which had little to do with human life. God, in other words, had become irrelevant and human beings found themselves alone in this world that had been given to them for their mastery, with nothing watching from above. It was only a matter of time before man would declare himself God, as Fichte virtually does.
Hegel’s Idealism
Hegel took over Fichte’s ideas and, among other things, amplified them with a theological interpretation. God, for Hegel, is pure self-related Idea which becomes real and concrete in the world through human self-awareness—a self-awareness achieved primarily through the analysis and mastery of nature, as well as through art, religion, and philosophy.
Although Hegel insisted that he had not meant to make man God, a great many of his followers and detractors saw that this is precisely what his philosophy had done. The “young Hegelian” Ludwig Feuerbach saw this and in his influential work The Essence of Christianity (1841) declared that God was, in fact, nothing but an ideal projection of human consciousness, a stand-in, in fact, for humanity itself.
The Hegelian (or, perhaps, young Hegelian) element in Gerald’s metaphysics comes in when Lawrence tells us that Gerald found his “eternal and his infinite” in the endless cycle of machine production. God, as Hegel learned from Aristotle, is an eternal act. The never-ending cycles of modern, industrial production—the apex of man’s mastery of nature—becomes, for Gerald, God incarnate: “the whole productive will of man was the Godhead.”
Nietzsche, Hegel, and the End of History
What seems Nietzschean here is simply the insistence on Will. In allowing himself to be used as an instrument of the “productive will of man” Gerald believes that he is aggrandizing his own personal power. However, as I noted earlier, in believing so Gerald is deceiving himself, and in the end “the God-motion, this productive repetition ad infinitum” simply burns him away in a cold fire. However, there is more to Gerald’s Nietzscheanism than this.
The relation of Nietzsche to Hegel is a complex one, but it can be boiled down in the following way. Hegel believed that in the modern period history had, in effect, ended. This assertion seems nonsensical if we make the mistake of confusing history with time. Of course, Hegel did not think time had stopped. He merely believed that the story of mankind had come to an end in the modern age, because it was in the modern, post-Christian age that mankind came to realize its true nature as radically self-determining (and other-determining, as well). With this realization of radical human freedom, and the realization that man actualizes God in the world, Hegel believed that essentially all the important questions and controversies of human history had been answered. The destiny of man was to live in more or less liberal societies, under more or less democratic states, and to practice more or less humanistic versions of Christianity. And in this condition mankind would continue to exist and prosper.
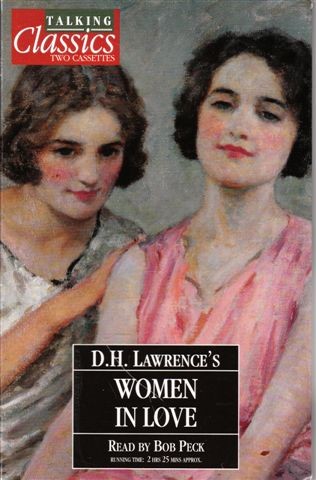 For Nietzsche, on the other hand, the end of history meant the death of everything that ennobles the human race. Without anything to struggle over or to believe in so strongly that one would be willing to fight and die for it, humanity would sink to the level of what Nietzsche called the Last Man, Homo economicus: the man whose aspirations do not rise above material comfort, safety, and security. The only hope was the arrival of the Overman, who would create new values, new systems of belief, and initiate new conflicts among human beings. In short, the Overman would re-start history. Nietzsche’s writings, in their trenchant critique of all Western beliefs and values, can be seen as an attempt to actually hasten the collapse of the modern world and usher in the Overman.
For Nietzsche, on the other hand, the end of history meant the death of everything that ennobles the human race. Without anything to struggle over or to believe in so strongly that one would be willing to fight and die for it, humanity would sink to the level of what Nietzsche called the Last Man, Homo economicus: the man whose aspirations do not rise above material comfort, safety, and security. The only hope was the arrival of the Overman, who would create new values, new systems of belief, and initiate new conflicts among human beings. In short, the Overman would re-start history. Nietzsche’s writings, in their trenchant critique of all Western beliefs and values, can be seen as an attempt to actually hasten the collapse of the modern world and usher in the Overman.
Nietzsche’s Will to Power
Essentially, Gerald Crich represents the Nietzschean Overman—or at least someone who believes himself to be a Nietzschean Overman. Gerald, himself a “great blonde beast,” is riding the tiger by riding his employees, expressing his “will to power” through mastering the mines. What Gerald doesn’t realize is that, in Nietzschean terms, he is merely, the instrument of will to power, expressing itself in the modern age as industrialism and mechanization. As Colin Milton has discussed at some length, this may actually indicate a confusion, or at least an inconsistency, in Lawrence’s understanding of Nietzsche.
Nietzsche is explicitly invoked in the novel when Ursula identifies Gerald with “Wille zur Macht.” The episode which prompts this comment from her is one of the most famous in the novel. In the chapter “Coal Dust,” Ursula and Gudrun go for a walk, but when they come to the railway crossing have to stop to wait for the colliery train to pass. As they stand there, Gerald Crich trots up riding a “red Arab mare.” The mare is frightened by the locomotive and moves away from it, but Gerald forces her back again and again, cutting into her flesh with his spurs. Ursula is horrified and cries “No—! No—! Let her go! Let her go, you fool, you fool—!” Gudrun, on the other hand, is fascinated by Gerald’s show of brute force over the mare and cries out only as he rides away, “I should think you’re proud.” As we shall see, Gudrun is Gerald’s counterpart, a portrait of the other, purely destructive side of modern will.
The episode with the mare is a good example of Lawrence’s sometimes obvious, but very effective symbolism. The mare represents nature—any and all natural beings—forced into submission before the designs and mechanisms of modernity. There is no other way to bring nature into accord with modern unnaturalism, other than by force and sheer bullying. And so later on Ursula refers to “Gerald Crich with his horse—a lust for bullying—a real Wille zur Macht—so base, so petty.”
In his essay “Blessed are the Powerful” Lawrence remarks, “A will-to-power seems to work out as bullying. And bullying is something despicable and detestable.” In short, in Women in Love Lawrence seems to understand Wille zur Macht as a kind a kind of egoistic self-aggrandizement. In fact, however, what Nietzsche teaches is the surrender to Wille zur Macht, as an impersonal force that expresses itself through us.
Interestingly, perhaps the clearest parallels to Gerald Crich’s philosophy of life, and Lawrence’s treatment of it, are two thinkers Lawrence knew nothing about when he wrote Women in Love: Oswald Spengler and Ernst Jünger, both of whom were strongly influenced by Nietzsche.
Spengler: Faustian Man and Technology
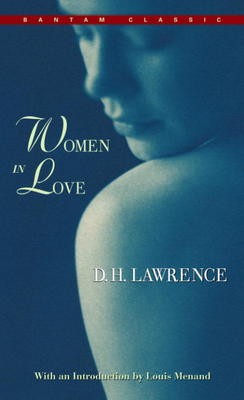 Spengler’s major work Der Untergang des Abendlandes (The Decline of the West) was published in 1918, two years after Lawrence first began working on Women in Love. According to Spengler, “Faustian man” creates a human world of artifacts and schemes not out of any economic motivation but rather out of a sheer desire for mastery.
Spengler’s major work Der Untergang des Abendlandes (The Decline of the West) was published in 1918, two years after Lawrence first began working on Women in Love. According to Spengler, “Faustian man” creates a human world of artifacts and schemes not out of any economic motivation but rather out of a sheer desire for mastery.
However, Spengler believed that in the modern world, at the very height of his technological prowess, Faustian man has begun to decline. In Mensche und Technik (Man and Technics, 1932) Spengler argued that technology had, in effect, taken on a life of its own. In building a technological world, humanity has been caught in the logic and the inevitable course of technology itself.
Technology rapidly becomes indispensable and human beings find themselves unable to do without it. Technological problems inevitably require technological solutions, and the sheer amount of gadgetry that the average human has to be conversant with grows exponentially. Technology comes to dominate the economy, so that most people find themselves not just being served by technology but working most of their lives for its advancement. In short, Faustian man, who had originally created the machines, now comes to be ruled by them.
Gerald certainly presents us with a vivid portrait of Spengler’s Faustian man. Lawrence does not explicitly make anything like Spengler’s argument concerning technology, but something like it lies beneath the surface of Women in Love and some of his other writings. Certainly Lawrence conveys the idea that Gerald foolishly believes himself to be master of the machines. Lawrence writes, “It was this inhuman principle in the mechanism he wanted to construct that inspired Gerald with an almost religious exaltation. He, the man, could interpose a perfect, changeless, godlike medium between himself and the Matter he had to subjugate.”
The medium Lawrence refers to is technology. “And Gerald was the God of the machine, Deus ex Machina.” In Man and Technics, Spengler writes: “To construct a world for himself, himself to be God—that was the Faustian inventor’s dream, from which henceforth arose all projects of the machines, which approached as closely as possible to the unachievable goal of perpetual motion.” Of course, what Gerald doesn’t realize is that he is Spengler’s Faustian man caught in the trap: servant of that which he had created.
Ernst Jünger and the Gestalt of the Worker
Ernst Jünger’s promethean, Nietzschean philosophy of technology comes uncannily close to Gerald’s own ideas. Jünger’s views were forged on the battlefields of World War I, at the very same time Lawrence was writing Women in Love. The war affected both men profoundly, but in profoundly different ways. As I have already mentioned, much of the misanthropy and apocalyptic quality of Women in Love is to be attributed to Lawrence’s horror of the war and what it had reduced men to. Jünger himself regarded the war as horrifying, and his memoir of his days as a soldier, In Stahlgewittern (The Storm of Steel, 1920), is as frightening and chastening an account of war as has ever been written. For Jünger, as for Lawrence (and, later, Heidegger) the war was essentially a technological phenomenon.
However, Jünger came to believe that technology—including the technology of war—was, in effect, a natural phenomenon: the product of some kind of primal, expressive force not unlike Schopenhauer’s Will or Nietzsche’s Will to Power. The very title In Stahlgewittern suggests this understanding of things. Michael E. Zimmerman writes in Heidegger’s Confrontation with Modernity:
On the field of battle, [Jünger] experienced himself at times as a cog in a gigantic technological movement. Yet, unexpectedly, by surrendering himself to this enormous process, he experienced an unparalleled personal elevation and intensity which he regarded as authentic individuation. Generalizing from this experience, he concluded that the best way for humanity to cope with the onslaught of technology was to embrace it wholeheartedly. (Zimmerman, 49)
In Der Arbeiter (The Worker, 1932) Jünger heralded the coming of what Zimmerman calls his “technological Overman.” The productive power underlying all of reality shall body itself forth in the “Gestalt of the worker,” who is essentially a steely-jawed soldier on perpetual march to the technological transformation and mastery of nature. Zimmerman writes how
Jünger asserted that in the nihilistic technological era, the ordinary worker either would learn to participate willingly as a mere cog in the technological order—or would perish. Only the higher types, the heroic worker-soldiers, would be capable of appreciating fully the world-creating, world-destroying technological-industrial firestorm. (Zimmerman, 54–55)
This passage rather uncannily brings to mind Lawrence’s description of the effect that Gerald’s managerial style has on his workers. This is a crucially important passage and I shall quote it at length:
But they submitted to it all. The joy went out of their lives, the hope seemed to perish as they became more and more mechanized. And yet they accepted the new conditions. They even got a further satisfaction out of them. At first they hated Gerald Crich, they swore to do something to him, to murder him. But as time went on, they accepted everything with some fatal satisfaction. Gerald was their high priest, he represented the religion they really felt. His father was forgotten already. There was a new world, a new order, strict, terrible, inhuman, but satisfying in its very destructiveness. The men were satisfied to belong to the great and wonderful machine, even whilst it destroyed them. It was what they wanted. It was the highest that man had produced, the most wonderful and superhuman. They were exalted by belonging to this great and superhuman system which was beyond feeling or reason, something really godlike. Their hearts died within them, but their souls were satisfied.
One can see here that Lawrence seems to accept the Spengler-Jünger thesis that there is an inexorable logic to the modern, technological society and that a fundamental change has come over humanity which makes it possible for men to become servants of the machine. The passage above continues, “It was what they wanted, Otherwise Gerald could never have done what he did.” Lawrence clearly believes that there is something inevitable about what human beings are becoming—but unlike Jünger he cannot embrace it. The Nietzschean-Jüngerian answer to modernity—to ride the tiger—is perhaps the best that one can do to harmonize oneself with the technological world and its apparent dehumanization. But Lawrence absolutely rejects it, and paints Gerald as a tragic, deluded figure. Why? In answering this question, we confront Lawrence’s central objection to modernity.
History: Progressive of Cyclical?
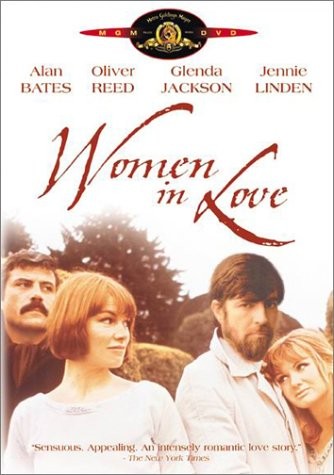 In the deleted “Prologue” to Women In Love (which is interesting for a good many other reasons), Lawrence describes Birkin in the early days of his affair with Hermione as “a youth of twenty-one, holding forth against Nietzsche.” Yet when Lawrence introduces us to Birkin’s own views they seem strikingly Nietzschean. First, however, Lawrence describes how Birkin had studied education (and become a school inspector) under the influence of what seems unmistakably like a warmed-over Hegelianism:
In the deleted “Prologue” to Women In Love (which is interesting for a good many other reasons), Lawrence describes Birkin in the early days of his affair with Hermione as “a youth of twenty-one, holding forth against Nietzsche.” Yet when Lawrence introduces us to Birkin’s own views they seem strikingly Nietzschean. First, however, Lawrence describes how Birkin had studied education (and become a school inspector) under the influence of what seems unmistakably like a warmed-over Hegelianism:
He had made a passionate study of education, only to come, gradually, to the knowledge that education is nothing but the process of building up, gradually, a complete unit of consciousness. And each unit of consciousness is the living unit of that great social, religious, philosophic idea towards which mankind, like an organism seeking its final form, is laboriously growing.
But Birkin quickly becomes disillusioned with this vision, and responds to it in true Nietzschean fashion:
But if there be no great philosophic idea, if, for the time being, mankind, instead of going through a period of growth, is going through a corresponding process of decay and decomposition from some old, fulfilled, obsolete idea, then what is the good of educating? Decay and decomposition will take their own way. It is impossible to educate for this end, impossible to teach the world how to die away from its achieved, nullified form. The autumn must take place in every individual soul, as well as in all the people, all must die, individually and socially. But education is a process of striving to a new, unanimous being, a whole organic form. But when winter has set in, when the frosts are strangling the leaves off the trees and the birds are silent knots of darkness, how can there be a unanimous movement towards a whole summer of fluorescence? There can be none of this, only submission to the death of this nature, in the winter that has come upon mankind, and a cherishing of the unknown that is unknown for many a day yet, buds that may not open till a far off season comes, when the season of death has passed away.
What is Nietzschean here is Birkin’s conviction that he is living at the end of history—but, contra Hegel, it is a time of disintegration and decay. However, unlike Nietzsche and his followers (including Gerald), Lawrence and Birkin do not see any way to transmute this situation into something that becomes life-advancing. What Gerald cannot see, but Birkin and Lawrence clearly can, is that the submission of the miners to “the Gestalt of the worker” represents the first stage in the complete breakdown of the Western world. The same passage quoted earlier from “The Industrial Magnate” chapter continues:
[Gerald] was just ahead of [his workers] in giving them what they wanted, this participation in a great and perfect system that subjected life to pure mathematical principles. This was a sort of freedom, the sort they really wanted. It was the first great step in undoing, the first great phase of chaos, the substitution of the mechanical principle for the organic, the destruction of the organic purpose, the organic unity, and the subordination of every organic unit to the great mechanical purpose. It was pure organic disintegration and pure mechanical organisation. This is the first and finest state of chaos.
Submission to or mastery of the modern, technological world—whether that world represents an advance or a degeneration—is not the answer for Lawrence because he believes that true human fulfillment lies in submission to something higher, or perhaps deeper: the true unconscious. Gerald offers his miners a kind of “freedom,” but it is the illusory freedom of the mind and ego from the call of the natural self.
Essentially, for Lawrence, the modern world is characterized by the subordination of the organic to the mechanical; of the natural to the planned, automated, and “rational.” But in severing the tie to the organic and placing themselves in the service of the machine and the idea, human beings lose their fundamental being, and their sense of having a place in the cosmos.
The real problem with Nietzsche is that although he talks a great deal about the body and about “instincts,” everything for him is still, to borrow Lawrence’s language, “in the head.” In his Genealogy of Morals, Nietzsche presents us with an attractive discussion of the healthy, “natural” morality of the master type, which values such things as health, strength, and beauty.
But Nietzsche’s own approach to morals amounts to a conscious and willful desire to relativize all values—to declare that there is no natural source, and no natural values. The Overman, in fact, gets to simply posit new values. This appears to be a purely intellectual, and largely arbitrary affair. The idea of “creating” values is psychologically implausible: how can anyone believe in, let alone fight for, values and ideals that they have consciously dreamed up?
The Impotent Übermensch
In his characterization of Gerald Crich, Lawrence gives us a realistic portrait of what would become of an “Overman” in real life. Keep in mind that it is Lawrence’s belief that when we abstract ourselves from the natural world, and from the promptings of the nature within us, we suffer and even, in a way, go mad. This is, in effect, what becomes of Gerald. In the concluding passages of the “Industrial Magnate” chapter Lawrence describes the psychological toll that mastery of Matter has taken on Gerald:
And once or twice lately, when he was alone in the evening and had nothing to do, he had suddenly stood up in terror, not knowing what he was. And he went to the mirror and looked long and closely at his own face, at his own eyes, seeking for something. He was afraid, in mortal dry fear, but he knew not what of. He looked at his own face. . . . He dared not touch it, for fear it should prove to be only a composition mask.
Inevitably, Gerald’s sense of dissociation displays itself in a sexual manner:
He had found his most satisfactory relief in women. . . . The devil of it was, it was so hard to keep up his interest in women nowadays. He didn’t care about them anymore. . . . No, women, in that sense, were useless to him any more. He felt that his mind needed acute stimulation, before he could be physically roused.
The clear suggestion is that Gerald is practically impotent. Like Clifford in Lady Chatterley’s Lover, whose impotence has a purely physical cause, Gerald is physically numb; he lives from the mind alone. Disconnected from his natural being, he no longer feels spontaneous, animal arousal for the opposite sex. He has become “re-wired,” so to speak, so that the route to the sexual center, in his case, is by way of the intellect; he can only become sexually aroused through his mind.
The irony here is that Gerald is portrayed throughout the novel as handsome, strong, and virile in both a physical and spiritual sense: he is a master of matter, and of women. In fact, however, both his physical and spiritual virility is mere appearance. He is master neither of himself nor of his world. Nor is he even master of his erection. On the other hand, Birkin, who is portrayed as physically weaker, is at least truly virile in a spiritual sense. This is the reason he manages to avoid becoming “absorbed” by Ursula.
 Lawrence is famous for characterizing relations between the sexes as a battle, or, more accurately, a struggle unto death. In Women in Love, the two couples battle each other continuously, but most of the fighting is done by the women against the men. (The famous nude wrestling match between Gerald and Birkin is a purely honest, physical contest, whose only psychological undertones are homoerotic.)
Lawrence is famous for characterizing relations between the sexes as a battle, or, more accurately, a struggle unto death. In Women in Love, the two couples battle each other continuously, but most of the fighting is done by the women against the men. (The famous nude wrestling match between Gerald and Birkin is a purely honest, physical contest, whose only psychological undertones are homoerotic.)
Birkin compromises with Ursula in settling for love rather than something “higher.” But despite this he maintains his integrity and individuality. It is a difficult feat, and even at the novel’s end we see Ursula working to try and undermine his desire for another kind of love in his life: “Aren’t I enough for you?” she asks him.
Gerald, however, cannot pull it off. He lacks Birkin’s spiritual virility: his ability to maintain himself, inviolate, even in giving himself to a woman. Gurdrun’s onslaughts are much more destructive and insidious than Ursula’s, and in the end the “manly” Gerald is broken by them.
Gudrun Brangwen, the Modern Woman
Gerald Crich is only one half of Lawrence’s portrait of the “modern individual.” The other half is Gudrun Brangwen. Of course, Birkin and Ursula are modern individuals, though in a different sense. The latter couple are both seeking some fulfilling way to live in, or in spite of, the modern world. They (especially Birkin) have achieved some critical distance from it.
Gerald and Gudrun, however, are both creatures of modernity. Gerald has consciously embraced the modern rootless prometheanism; Gudrun unconsciously. Further, Gudrun is not simply a female version of Gerald. Her “modernity” consists in certain traits which complement those of Gerald. What complicates matters is that Ursula and Gudrun also represent, for Lawrence, the two halves of femininity, and not just modern femininity.
In the first chapter of the novel, Gudrun reacts with revulsion to one of the locals as she and Ursula walk through Beldover: “A sudden fierce anger swept over the girl, violent and murderous. She would have liked them all annihilated, cleared away, so that the world was left clear for her.” It is interesting to compare this with Birkin’s (and Lawrence’s) fantasies of annihilation. Birkin, the complete misanthrope, wants to wipe the earth clean of humanity, including himself, so that there is only “uninterrupted grass, and a hare sitting up.” In Gudrun’s fantasy, she is left sitting up and everyone else is wiped away.
This small detail gives us an important clue to Gudrun’s character, which is fundamentally egoistic. A thoroughgoing egoism is always nihilistic, for it wills that all limitation or opposition to the ego be cancelled. But even the mere existence of other human beings (or anything else, for that matter) constitutes a limitation on the ego.
Just as Lawrence does with Gerald, this “self-assertion” on Gudrun’s part is connected, by allusion, with Nietzsche. This time, however, the allusion is put into the mouth of the character herself in what seems on the surface like a purely innocent remark. Enjoying the snowy Tyrol, Gudrun exclaims, “Isn’t the snow wonderful! Do you notice how it exalts everything? It is simply marvellous. One really does feel übermenschlich—more than human.”
Like Gerald, Gudrun lives in a state of abstraction from the body and from nature. In sex she remains perfectly detached. Writing of the aftermath of Gudrun’s first sexual encounter with Gerald, Lawrence emphasizes again and again her full consciousness, while Gerald lays on top of her, asleep and satiated. He tells us “she lay fully conscious.” And: “Gudrun lay wide awake, destroyed into perfect consciousness.” And: “She was suspended in perfect consciousness—and of what was she conscious?” (He does not truly answer the question.)
Gudrun is revolted by the rhythms of nature and by natural objects—even though, ironically, it is small animals that she depicts in her sculpture (perhaps this is the only way she can encounter them, as things she molds and creates herself). Holding Winifred Crich’s pet rabbit Bismarck, who puts up quite a struggle, “Gudrun stood for a moment astounded by the thunderstorm that had sprung into being in her grip. Then her colour came up, a heavy rage came over her like a cloud. . . . Her heart was arrested with fury at the mindlessness and bestial stupidity of this struggle, her wrists were badly scored by the claws of the beast, a heavy cruelty welled up in her.”
The mechanical succession of day after day revolts her. Very early in the novel she confesses to Ursula, “I get no feeling whatever from the thought of bearing children.” She looks at Ursula, who is clearly flustered by this, with a “mask-like expressionless face.” When Ursula, intimidated by her sister, stammers out a reply, “A hardness came over Gudrun’s face. She did not want to be too definite.” This desire to remain indefinite is essential to Gudrun’s character.
In fact, the essence of Gudrun is nothingness. In the first chapter, Lawrence tells us “there was a terrible void, a lack, a deficiency of being within her.” In conversation with Gerald, Birkin describes her as a “restless bird,” and says that “She drops her art if anything else catches her. Her contrariness prevents her from taking it seriously—she must never be too serious, she feels she might give herself away. And she won’t give herself away—she’s always on the defensive. That’s what I can’t stand about her type.” Gudrun’s “type” is the modern individual who cannot stand to be tied to anything, who is in constant flux, wary of anything that would compel her to make a commitment, whether to a relationship or a career, or whatever. Plato in the Republic essentially winds up describing this modern type when he attempts to characterize the sort of character produced by a democracy:
“Then,” [said Socrates], “he also lives along day by day, gratifying the desire that occurs to him, at one time drinking and listening to the flute, at another downing water and reducing; now practicing gymnastic, and again idling and neglecting everything; and sometimes spending his time as though he were occupied with philosophy. Often he engages in politics and, jumping up, says and does whatever chances to come to him; and if he ever admires any soldiers, he turns in that direction; and if it’s money-makers, in that one. And there is neither order nor necessity in his life, but calling this life sweet, free, and blessed, he follows it throughout.”
“You have,” [said Adeimantus], “described exactly the life of a man attached to the law of equality.”
Near the end of the novel, Lawrence tells us of Gudrun:
Her tomorrow was perfectly vague before her. This was what gave her pleasure. . . . Anything might come to pass on the morrow. And to-day was the white, snowy iridescent threshold of all possibility. All possibility—that was the charm to her, the lovely, iridescent, indefinite charm—pure illusion. All possibility—because death was inevitable, and nothing was possible but death.
She did not want things to materialize, to take any definite shape. She wanted, suddenly, at one moment of the journey tomorrow, to be wafted into an utterly new course, by some utterly unforeseen event, or motion.
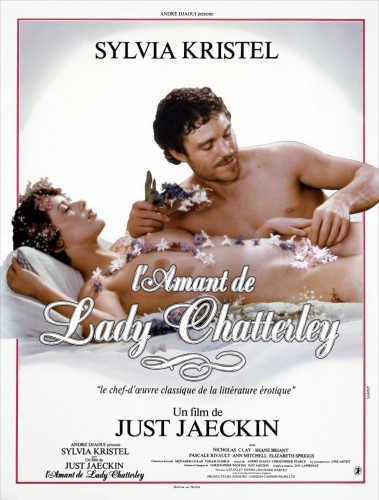 When Gudrun is asked the question wohin? (where to?) Lawrence tells us that “She never wanted it answered.”
When Gudrun is asked the question wohin? (where to?) Lawrence tells us that “She never wanted it answered.”
The quintessential modern individual does not, in fact, want to be anything at all, for to be something definite would close off other possibilities. And so the modern individual is always oriented toward the future, which contains all possibilities, rather than toward the present. In this respect, Gudrun’s character perfectly complements Gerald’s. Gerald has completely abstracted himself from the present by regarding everything else as “Matter” to be transformed according to his will.
This is, again, what Heidegger tells us is the modern perspective on nature. Because everything is merely raw material to be made over into something else, nothing is ever regarded as possessing a fixed identity. The essence of everything, really, is to become something else, something better. The being of things is thus something projected into the future; something that will be revealed at a later date, through human ingenuity. The result of this treatment of things as raw material is that it produces individuals who live for the future: for what will be, and for what they will be. This is how “abstraction” from the present occurs. A key ingredient in this, of course, is a kind of radical subjectivism and anthropocentrism: the being of things is something that will be created by human beings.
The modern world is therefore a world of individuals who are, mentally, quite literally elsewhere. On the one hand they are disconnected from the nature world (which to them is essentially “stuff”) and from their own nature, which they erroneously believe is something they can decide on or even re-make. They are disconnected, in fact, from presentness in general.
At one point Lawrence reveals to us that Gudrun suffers from the nagging feeling that she is merely an “onlooker” in life whereas her sister is a “partaker.” Indeed she is an onlooker and this is the key to her weird “consciousness” in the sex act. Gerald is an onlooker too, hence the sense of unreality he experiences when looking at himself in the mirror. They are both creatures of the mind, of idealism, and of futurity.
And this is truly the heart of Lawrence’s critique of modernity: that we have lost touch with the sense of being a part of nature, and of being in our bodies, in present time. The ultimate result of such abstraction from nature, the body, and the present is the destruction of nature, of any possibility of inner peace and fulfillment, and of community.
Both Gerald and Gudrun are fundamentally destructive, nihilating individuals, but of the two Gudrun represents destruction in its purest form. Gerald destroys in order to transform and, as we saw earlier, he believes himself to be an agent of history and of social reform. (Or, at least, this is the moral veneer he paints over his activities.) With Gudrun, there is not such self-justification. Of course, ultimately Gerald’s transformation of Matter is perfectly destructive, and so one can plausibly claim that in a sense Gudrun is the more honest of the two, though she is not self-aware in her destructiveness.
Gudrun represents the inner truth of Gerald’s prometheanism laid bare. This point is conveyed through the structure of Lawrence’s novel itself. Gudrun is a presence throughout the entire book, but by the last few chapters the story becomes focused very much on her. And it is in the last few chapters that the pure nihilism of her character is brought to the fore. At the same time, Gerald, who had earlier been a relatively strong figure, is reduced to inefficacy and becomes almost a shadowy presence. His physical death comes, in way, as merely an outward expression of an internal death that had already taken place in his soul.
Gudrun and Loerke
What seems to immediately precipitate Gerald’s suicide is that Gudrun gives every indication of leaving him for an artist named Loerke who she has met in the Tyrol. Loerke, better than Gerald, personifies Jünger’s promethean modernism. Loerke is a sculptor who shares with Gudrun and Ursula his plans for a granite frieze for a huge factory in Cologne. Churches, he tells the two sisters are “museum stuff,” and since the world is now dominated by industry, not religion, art should come together with industry to make the modern factory into a new Parthenon:
“And do you think then,” said Gudrun, “that art should serve industry?”
“Art should interpret industry as art once interpreted religion,” he said. . . .
“But is there nothing but work—mechanical work?” said Gudrun.
“Nothing but work!” he repeated, leaning forward, his eyes two darknesses, with needle-points of light. “No, it is nothing but this, serving a machine, or enjoying the motion of a machine—motion, that is all. . . .”
Loerke exhibits the same destructive, modern will we find in Gerald and Gudrun, but come to full consciousness of itself. This is what attracts Gudrun to Loerke. She has realized that Gerald is weak—he possesses the destructive will, but cannot own up to it; he must hide it under his idealism. Loerke has embraced the Will to Power without illusion:
To Gudrun, there was in Loerke the rock bottom of all life. Everybody else had their illusion, must have their illusion, their before and after. But he, with a perfect stoicism, did without any before and after, dispensed with all illusion. He did not deceive himself in the last issue. In the last issue he cared about nothing, he was troubled about nothing, he made not the slightest attempt to be at one with anything. He existed a pure, unconnected will, stoical and momentaneous. There was only his work.
Birkin describes him a bit later as “a gnawing little negation, gnawing at the roots of life.” Loerke is completely detached from nature and from the body. His sexuality is indeterminate. Though he has a male lover, he is drawn to Ursula. But he tells her that it wouldn’t matter to him if she were one hundred years old: all that matters is her mind.
The Gudrun-Gerald relationship plays itself out, and reaches its tragic end, in the Alps. The choice of locations is significant. Attentive readers of Lawrence’s fiction will note that he tends to depict his characters as either “watery” or “fiery.” In Women in Love Birkin and Ursula are the fiery pair, contrasted to Gudrun and Gerald, who are watery. Gerald meets his end in the novel when he commits suicide by wandering off into the snow and freezing to death. For Lawrence, this act represents Gerald quite literally “returning to his element.” Though Gudrun and Ursula are bound together by blood, the deeper bond is between Gudrun and Gerald, and it is metaphysical. They are the two aspects of the modern soul: one productive without a purpose; the other destructive, nihilating.
Ursula’s Primacy
In a sense it is strange to argue as I did earlier that Women in Love represents the continuation of Ursula’s story. For one thing, the novel seems to focus more directly on the Birkin-Gerald relationship. Further, Gudrun is actually a more vivid character than Ursula. Nevertheless, I would still argue that Ursula is the central character. She is the most “natural” of any major character in the novel; the least in conflict with herself.
We are made to feel closer to Birkin, as he is transparently Lawrence’s self-portrait. But Birkin is “abstracted” from life in his own way. He berates Hermione for having everything in her head and lacking real sensuosity. Yet so much of Birkin is theory and talk. He wants some kind of total, transformative experience that would give him a real sense of being alive—yet he wants to hold onto his ego boundaries. He wants love, but then again he doesn’t. He wants to give himself to Ursula, but not totally. Admirers of Lawrence the man often miss the rather obvious flaws in Birkin’s character, and are thus oblivious to how Lawrence may have achieved a critical distance from Birkin (and from himself).
In the end, Birkin’s “problems” are in large measure solved by the oldest means in the world: the force of natural love, and the institution of marriage. Up to a point (but only up to a point) Birkin simply surrenders his abstract ideas about relationships—about finding something “more” than love—and surrenders to Ursula. Ursula knows from deep within herself, the falsity of Birkin’s ideals. Through her he comes to know what Lawrence would call “the sweetness of accomplished marriage.” There is only one part of him that remains unfulfilled. But that is a subject for another essay . . .
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : d. h. lawrence, littérature, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, femme, féminisme, anti-féminisme, vitalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 27 janvier 2011
Der Iran entsendet Kriegsschiffe ins Mittelmeer und ins Rote Meer
Der Iran entsendet Kriegsschiffe ins Mittelmeer und ins Rote Meer
Redaktion
Nur 24 Stunden nach dem Scheitern der Verhandlungen mit den sechs Weltmächten über das iranische Atomprogramm in Istanbul kündigte der Iran am vergangenen Sonntag an, einen Marineverband durch den Suezkanal zu einem Übungs- und Aufklärungseinsatz ins Mittelmeer und das Rote Meer zu entsenden. Der Verband soll aus drei bis vier Schiffen bestehen, darunter ein Zerstörer aus eigener Produktion. Quellen aus Militärkreisen erklären: Ein Teil des Verbandes soll an der Süd- und Westküste Israels eingesetzt werden.
Mehr: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/red...

00:30 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iran, marine, mer rouge, méditerranée, moyen orient, proche orient, militaria |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La semaine des révélations en Turquie
La semaine des révélations en Turquie
par Jean-Gilles MALLIARAKIS
Au 4e anniversaire du meurtre, commis le 19 janvier 2007, du journaliste arménien Hrant Dink, on doit constater que le terrain judiciaire a permis à une certaine vérité d'avancer. Cela s'est surtout concrétisé d'une manière paradoxale, sans doute imprévue. Car cette affaire se rattache à un nombre impressionnant de crimes du même ordre, commis depuis plusieurs années.
Ils ont été perpétrés notamment, mais pas seulement, contre les chrétiens.
Au fil du temps, on a pu découvrir que l'intention des instigateurs s'inscrit dans le cadre d'une politique intérieure généralement mal comprise des Européens et, encore moins, des Américains. Autrefois un vieil adage du mépris de fer britannique considérait que "les nègres commencent à Calais". Heureusement les Occidentaux ont rompu avec cette erreur. Ils en commettent cependant une autre, pensant que le caractère formel des institutions démocratique de la Turquie en fait un pays en tous points semblable aux leurs.
À Istanbul et Ankara la presse que l'on qualifiera de gouvernementale, les journaux pro-AKP (1), classés à droite, mais également aussi quelques journaux de gauche, parviennent désormais à mettre en cause, et à démontrer, l'hypothèse de réseaux militaro-mafieux, stigmatisés dans ce pays sous le nom "d'État profond".
L'interminable procès du réseau serpent de mer appelé "Ergenekon" divise fortement la Turquie en deux camps. À lire respectivement "Zaman" et "Hürriyet", on en arrive à considérer que deux vérités, peut-être même deux nations se confrontent.
Le premier groupe se situe sur la défensive. Il se retrouve sur le ban des accusés du complot "Ergenekon". S'y a été ajouté le dossier du projet de coup d'État appelé "Bayloz" (2) : en tout, les officiers supérieurs, généraux, amiraux et colonels impliqués atteignaient fin 2010 le nombre de 400. Ils s'identifient au parti de la laïcité, désireuse de s'opposer à la "réaction". Mais n'oublions pas que, dans un tel pays, les militaires représentent aussi un poids économique et social considérable : avec 790 000 hommes sous les drapeaux, le taux de militarisation de la Turquie n'est dépassé dans le monde que par celui de la Corée du nord et, par ricochet, le taux de son adversaire du sud. Or, rappelons-le, contrairement aux deux parties du pays du Matin Calme, la république kémaliste n'est entourée que de petits pays. N'inversons pas les rôles : ce n'est pas la Grèce, effectivement contrainte de déployer un très coûteux effort militaire, qui menace le "pays voisin".
Depuis la rédaction de la constitution de 1982, imposée par les auteurs du coup d'État de septembre 1980, et jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2003, le pouvoir suprême était détenu par le MGK (3). Dans cet exercice, l'État-major d'Ankara, recruté par cooptation, pouvait compter aussi sur le soutien de la haute magistrature. À celle-ci l'attachaient ces tendres liens qu'on appelle "philosophiques" dans des quotidiens tels que la "Nouvelle République" de Tours, la "Dépêche" de Toulouse" ou "l'Est républicain" de Nancy. En Turquie comme en France, le jacobinisme et le laïcisme s'appuient toujours sur les mêmes réseaux.
En face d'eux se trouvent des gens, ceux du parti au pouvoir "AKP", mais également du mouvement islamo-moderniste de Fethullah Gûlen, que l'on qualifie ordinairement, mais peut-être abusivement, en tout cas vaguement, sans que les mots aient été préalablement définis, d'islamistes. À terme, ces musulmans militants et confrériques représenteraient si d'aventure leur pays entrait dans l'Europe, un danger certes beaucoup plus grand que leurs compatriotes kémalistes ou leurs coreligionnaires salafistes.
Constatons que dans le court terme, leur action a permis de mettre en lumière les faces d'ombres de l'Histoire contemporaine de leur pays.
Les occidentaux de ma génération, par exemple, avaient été bercés de la légende de ce qu'on appelait l'helléno-turquisme, les "frères ennemis Grecs et Turcs", réconciliés depuis le gouvernement de Venizelos (1928-1932). Cette rumeur optimiste prospéra jusqu'aux jours noirs de septembre 1955. Les Grecs de Constantinople furent alors victimes de violences inacceptables. Ils durent quitter une Ville, leur Ville, la Ville, que l'on disait "Immortelle", vieille comme l'Histoire humaine, et pourtant d'une beauté toujours étincelante, aujourd'hui encore sous son nom définitivement turc d'Istanbul.
Sans s'étendre sur cette page sombre et lamentable, retenons que jusqu'à une date très récente, ceux qui la connaissaient, bien peu nombreux en France, pays qui ne se connaît pas d'ennemis, en rendaient responsable le gouvernement d'Adnan Menderes. Et celui-ci avait été renversé, et pendu par les militaires kémalistes en 1961.
Or tous les documents publiés par les journaux officieux, à la faveur de la lutte entre le gouvernement civil de l'AKP et les comploteurs d'Ergenekon, prouvent le contraire de ce que nous pensions jusque-là. Tous ces crimes avaient été provoqués par "l'État profond" en vue d'une politique machiavélique.
Notre interprétation superficielle résulte précisément de la désinformation. Elle avait été fabriquée par le jacobinisme local et propagée par ses cercles de confraternité en Europe occidentale et aux États-Unis.
Le régime bipartisan avait été institué en 1946 dans le contexte de la guerre froide et du plan Marshall. Cette apparence, renforcée par l'adhésion à l'OTAN en 1952, allait certes permettre au parti démocrate de récupérer une partie du public musulman, légitimement heurté par la laïcisation à marche forcée de la République à l'époque de son fondateur.
Mais les limites de la liberté sont demeurées, cependant, étroitement surveillées par des équipes adverses, "républicaines", animées d'un nationalisme militaire ombrageux et même obsidional. "Le Turc entouré d'ennemis, inculquent-ils dès l'enfance aux petits écoliers, trahis par les siens, doit faire face et remporter la victoire". (4)
Leur habileté avait consisté à se présenter pour les sous-traitants indispensables du pacte atlantique et de la stratégie occidentale dans la région. En bons serviteurs de l'idée qu'ils se font de leur intérêt national, et d'un destin géopolitique "de l'Adriatique à la muraille de Chine", ils se préoccupent, de toute évidence, comme d'une guigne de l'Atlantique et de l'Occident. Qu'ils aient pu apparaître comme les alliés des Israéliens hier, comme les protecteurs des Arabes aujourd'hui, donne à sourire. La défunte Yougoslavie a cru aussi les compter au nombre de ses amis.
Même la Commission européenne commence à prendre conscience du sens réel des négociations. Elles ne se déroulent pas en vue de l'adhésion et ne peuvent pas aboutir à en faire vraiment un État-Membre. Elles ne sont pas menées en vue de cette fin. Les équipes rivales de l'AKP ont hérité du dossier en 2003. Elles en tirent parti, depuis, dans le sens des réformes internes, plus ou moins libérales, qu'elles souhaitent mettre en œuvre, pour des raisons spécifiques à leur islam confrérique.
Le danger à long terme que représente leur démarche réside en ceci : elle organise, beaucoup plus efficacement que ses concurrentes arabes, saoudiennes, marocaines ou égyptiennes, la propagande, le matraquage et le chantage en vue d'une reconnaissance de l'islam comme "l'une des religions de l'Europe", voire même la "deuxième religion de France". Et ces énormes mensonges s'installent peu à peu.
La thèse de l'accusation dans les procès "Ergenekon" comme dans le sous-dossier "Bayloz" tend à donner une explication commune à tous ces faits qui s'apparentent à l'assassinat de Hrant Dink, soit aussi bien :
- les persécutions du reliquat de populations chrétiennes,
- les actions directes contre les missionnaires, évalués par le MGK comme un danger stratégique pour le pays depuis 2001, et présentés comme tels par une partie de la presse,
- ainsi que les tensions perpétuelles et provocatrices avec la Grèce,
- la fermeture des frontières de l'Arménie depuis 1993,
- le refus d'une solution acceptable à Chypre depuis 1974,
- ou même la mise à mort de 37 alevis à Sivas par une foule où se mêlaient à la fois les intégristes islamistes et les loups gris (5),
- ou l'assassinat mystérieux d'un journaliste comme Ugur Mumcu :
… tout cela résultait donc d'un propos délibéré, protégé par "l'État profond".
Il s'agit, au bout du compte, de maintenir la Turquie sous le joug militaire, de présenter leur intervention comme "barrage à l'islamisme".
Les quatre coups d'État réitérés de 1960 à 1997, aux applaudissements de l'occident, trouveraient leur origine dans cette perspective ainsi que l'invasion de Chypre en 1974 et le maintien d'un régime d'occupation dans le nord de l'île. (6) Ce boulet pèse lourd, sans aucun profit pour la Turquie.
Face à cette authentique "stratégie de la tension" le fameux mot d'ordre du ministre des affaires étrangères "pas de problème avec nos voisins" remplit dès lors une fonction à usage interne.
Tout cela demeurait masqué, voilé, mis en doute par la défense des comploteurs, sûrs d'eux.
Coup de théâtre la semaine écoulée, qui correspondait au 4e anniversaire de meurtre de Hrant Dink.
Les audiences du 17 et du 18 janvier du procès ont, ainsi, mis en relief une personnalité bien significative : celle du olonel de gendarmerie en retraite Arif Dogan. (7) En septembre 2010 on apprenait ses implications dans des crimes que l'on attribue désormais à Jitem, service secret illégal de la gendarmerie turque.
Jitem, rappelons-le, correspond à une structure parallèle fonctionnant à la fois comme service de renseignement et comme "service action" exécuteur des basses besognes. En particulier, à partir des années 1980, une guerre impitoyable a ravagé le sud-est anatolien sous le drapeau du PKK, organisation marxiste-léniniste "parti des travailleurs" (8) se réclamant du Kurdistan. À la même époque l'utilisation du mot même de "Kurde" était sanctionnée par des peines très dures. Il fallait user d'un euphémisme tel que "Turc de la Montagne". En face de cette situation de négation de leur identité culturelle, les populations considérées ont représenté, dès le début de la république, et après une très courte période d'entente avec Kemal, un foyer permanent de rébellions.
Celles-ci ont pris toutes les colorations, notamment celle d'une résistance, qualifiée de féodaliste et obscurantiste. Les excès antireligieux du gouvernement d'Ankara, plaisaient beaucoup en Europe occidentale, en Union Soviétique, en Amérique et, bien entendu, au grand-orient de France.
La dernière force de révolte en date a été fondée en 1978 par un militant gauchiste appelé Abdullah Ocalan. Elle invoque, au contraire des précédantes, une idéologie révolutionnaire que l'iconographie des affiches collées dans les villes d'Europe où le PKK est implanté confirme à l'évidence. Son organisation prit les armes à partir de 1984. Le conflit doit avoir fait 44 000 victimes en un quart de siècle. Il s'agissait, il s'agit encore puisque le terrorisme a repris, d'une vraie guerre.
On ne doit donc pas s'étonner que tous les moyens pour réduire cette affaire aient semblé légitimes aux forces locales du maintien de l'ordre. Et à plusieurs reprises les "protecteurs de villages", recrutés officiellement, ont été dénoncés par les gens qui imaginent de réduire cet État aux critères de l'Europe bien-pensante et consommatrice. (9)
Dans un tel contexte, il a été révélé par le colonel Arif Dogan lui-même que, dès 1986 les réseaux du service secret turc ont suscité et armé un mouvement terroriste kurde rival lui-même, le "Hizbullah" dirigé par Husseÿn Velioglu. Ce dernier mourra en définitive, après 15 ans de violences, sous les balles de la police turque en 2000, dans le cadre d'un kidnapping qu'il avait organisé.
L'idée de recruter ainsi des musulmans fanatiques au sein de la population kurde pour servir aux fins de l'ordre turc n'a certes pas été découverte par le colonel Arif Dogan. Elle avait déjà connu une certaine notoriété à l'époque des premières exactions massives commises à l'encore des Arméniens à la fin du XIXe siècle. Fondée en 1890 sous le règne de Abdul-Hamid II l'unité de cavalerie ottomane "Hamidiyé" passe même pour avoir représenté les précurseurs, dans les années 1895-1896, du génocide de 1915. Mais la différence reste considérable entre une unité répressive d'inspiration légale et un groupe terroriste.
Or l'audience des 17 et 18 janvier a permis au colonel de se justifier, et de le faire d'une manière extrêmement violente. Tel un vieil homme usé, aosr qu'il n'est âgé que de 65 ans (10), il accédait difficilement à la barre. Mais il a explosé et rompu avec le système de défense de tout le camp kémaliste. Depuis le début, celui-ci se voulait "serein". Il nie l'existence du complot : "un simple wargame (en français : kriegspiel), une étude d'école, la réplique purement théorique du coup d'État du général Evren en septembre 1980, etc." Toutes les accusations dont nous faisons état relèveraient d'une propagande odieuse, mensongère, et, horresco referens pour les temps qui courent "islamiste". "Ergenekon" ? Une "légende urbaine" !
Patatras, ayant dirigé pendant 8 ans une lutte antiterroriste, le colonel Arif Dogan s'est mis à hurler qu'il avait défendu son pays. Effectivement. Le président lui demanda donc de se calmer. Mais la révélation était faite : oui, le Jitem avait bien orchestré une activité illégale, oui il avait suscité le Hizbullah kurde de Turquie, oui ce Hizbullah était conçu comme un "Hizb-kontra" sur le mode des "contras" latino-américains, oui ces soi-disant parangons de la laïcité et de l'intégrité du territoire avaient embrigadé des islamistes séparatistes. Sympa le colonel. Il ne restera plus à ses compagnons d'hier que la ressource de faire circuler sa photo et de nous persuader que "toute vieillesse est un naufrage".
Et puis le 19 janvier, vint le tour de l'assassin effectif de Hrant Dink. Incarcéré depuis les faits ce jeune idéaliste de 17 ans ne semble pas avoir trop souffert de son incarcération. Il semble même qu'il ait "été fêté [et nourri] comme un héros national". Or ce jour-là, Ogün Samast a reconnu avoir été envoyé vers sa victime, et encouragé dans son intention meurtrière, par des officiers de gendarmerie.
Si l'on devait croire la "fameuse" encyclopédie Wikipedia, qui ne donne guère d'autres détails à son sujet, le jeune activiste aurait eu de bonnes raisons de liquider Hrant Dink. Il prête en effet à sa victime une déclaration un peu surprenante, dont Wikipedia ne donne évidemment pas la référence : "vider un jour ce sang turc empoisonné et de remplir avec le sang neuf de l’Arménie qui après l’indépendance paraît comme l’avenir des Arméniens du monde entier". Que, quatre ans après le meurtre, Wiki demeure encore alimentée par de tels bobards, en dit long sur la source dominante des gens qui fabriquent et amplifient les rumeurs mondiales.
Rappelons aux lecteurs qu'officiellement, en Turquie, tout le monde a condamné moralement ce crime. Si ce courageux journaliste, qui se savait menacé avait prononcé une phrase pareille, aussi provocatrice, très peu de gens, y compris dans les milieux arméniens eussent pris sa défense, et il serait allé directement en prison, en application du code pénal.
La décision de le liquider semble avoir été prise à partir de 2003. Hrant Dink représentait, dans son journal "Agos", un symbole insupportable. Pour la première fois depuis les événements tragiques qui ont purgé en 1915 la Turquie de l'essentiel de sa population arménienne, puis en 1922 de l'essentiel de sa population grecque, un représentant des survivants de ces minorités osait écrire librement, revendiquant son identité sans pour autant renoncer à sa citoyenneté. Dans tous les systèmes autoritaire clos, la dissidence intérieure appuyée sur le droit, est considérée comme pire que l'exil, pire que la trahison.Quatre ans plus tard, le quotidien Zaman, proche du gouvernement, reconnaît que "Hrant Dink a été victime de la fumée".
Nous dirions plus crûment en France : de l'enfumage systématique.
Autrement dit : les inspirateurs de ses assassins ont bénéficié des puissants instruments de désinformation mis en place et protégés par la complaisance occidentale depuis l'installation en 1946 d'un bipartisme apparent. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2003, ce régime avait été limité par divers putschs militaires. Et ceux-ci ont jalonné l'Histoire de ce demi-siècle, y compris le coup d'État dit postmoderne de février 1997.
Comme dans d'autres pays musulmans d'ailleurs, la dictature policière glauque a produit le fumier qui permet à l'islamisme de fleurir.
JG Malliarakis
Apostilles
- AKP = "Adalet ve Kalkinma Partisi" (en turc : le parti de la justice et du développement, fondé et dirigé par l'actuel premier ministre Erdogan actuellement majoritaire au parlement en attendant les résultats des élections de juin 2011).
- Ce nom de Bayloz correspond à l'appellation turque. Le nom anglais "Sledgehammer" apparaît couramment dans la presse. En français ce mot se traduit par "masse" [du forgeron] ; nous dirions plutôt : "massue" [avec un "e"…].
- MGK = "Milli Guvenlik Kurulu" (en turc : le Conseil de sécurité nationale)
- cf. Une scène bouleversante du très beau film "En attendant les nuages" ("Bulutlari beklerken") de la réalisatrice Yesim Ustaoglu.
- Voir à ce sujet les images de la manif meurtrière. Pas besoin d'avoir étudié la langue d'Omar Pamuk pour comprendre…
- Sur ce point, la fable de la défense des Chypriotes-Turcs contre les [très méchants] Grecs est balayée par la réalité même de la zone nord occupée, où les autochtones, devenus minoritaires dans leur propre réduit, souvent émigrés au Royaume-Uni, n'exercent plus qu'un pouvoir de façade.
- Ne pas confondre avec le général Çetin Dogan, ancien chef de la première armée turque et principal accusé du complot "Bayloz".
- PKK = "Partiya Karkerên Kurdistan" (en kurde : parti des travailleurs du Kurdistan")
- On se reportera à à mon petit livre sur "La Question turque et l'Europe".
- Voir son transport en chaise roulante au moment de ses premiers aveux en octobre 2010.
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, turquie, méditerranée, proche orient, asie mineure, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La semaine des révélations en Turquie
La semaine des révélations en Turquie
par Jean-Gilles MALLIARAKIS
JG Malliarakis
Apostilles
- AKP = "Adalet ve Kalkinma Partisi" (en turc : le parti de la justice et du développement, fondé et dirigé par l'actuel premier ministre Erdogan actuellement majoritaire au parlement en attendant les résultats des élections de juin 2011).
- Ce nom de Bayloz correspond à l'appellation turque. Le nom anglais "Sledgehammer" apparaît couramment dans la presse. En français ce mot se traduit par "masse" [du forgeron] ; nous dirions plutôt : "massue" [avec un "e"…].
- MGK = "Milli Guvenlik Kurulu" (en turc : le Conseil de sécurité nationale)
- cf. Une scène bouleversante du très beau film "En attendant les nuages" ("Bulutlari beklerken") de la réalisatrice Yesim Ustaoglu.
- Voir à ce sujet les images de la manif meurtrière. Pas besoin d'avoir étudié la langue d'Omar Pamuk pour comprendre…
- Sur ce point, la fable de la défense des Chypriotes-Turcs contre les [très méchants] Grecs est balayée par la réalité même de la zone nord occupée, où les autochtones, devenus minoritaires dans leur propre réduit, souvent émigrés au Royaume-Uni, n'exercent plus qu'un pouvoir de façade.
- Ne pas confondre avec le général Çetin Dogan, ancien chef de la première armée turque et principal accusé du complot "Bayloz".
- PKK = "Partiya Karkerên Kurdistan" (en kurde : parti des travailleurs du Kurdistan")
- On se reportera à à mon petit livre sur "La Question turque et l'Europe".
- Voir son transport en chaise roulante au moment de ses premiers aveux en octobre 2010.
Ils ont été perpétrés notamment, mais pas seulement, contre les chrétiens.
Au fil du temps, on a pu découvrir que l'intention des instigateurs s'inscrit dans le cadre d'une politique intérieure généralement mal comprise des Européens et, encore moins, des Américains. Autrefois un vieil adage du mépris de fer britannique considérait que "les nègres commencent à Calais". Heureusement les Occidentaux ont rompu avec cette erreur. Ils en commettent cependant une autre, pensant que le caractère formel des institutions démocratique de la Turquie en fait un pays en tous points semblable aux leurs.
À Istanbul et Ankara la presse que l'on qualifiera de gouvernementale, les journaux pro-AKP (1), classés à droite, mais également aussi quelques journaux de gauche, parviennent désormais à mettre en cause, et à démontrer, l'hypothèse de réseaux militaro-mafieux, stigmatisés dans ce pays sous le nom "d'État profond".
L'interminable procès du réseau serpent de mer appelé "Ergenekon" divise fortement la Turquie en deux camps. À lire respectivement "Zaman" et "Hürriyet", on en arrive à considérer que deux vérités, peut-être même deux nations se confrontent.
Le premier groupe se situe sur la défensive. Il se retrouve sur le ban des accusés du complot "Ergenekon". S'y a été ajouté le dossier du projet de coup d'État appelé "Bayloz" (2) : en tout, les officiers supérieurs, généraux, amiraux et colonels impliqués atteignaient fin 2010 le nombre de 400. Ils s'identifient au parti de la laïcité, désireuse de s'opposer à la "réaction". Mais n'oublions pas que, dans un tel pays, les militaires représentent aussi un poids économique et social considérable : avec 790 000 hommes sous les drapeaux, le taux de militarisation de la Turquie n'est dépassé dans le monde que par celui de la Corée du nord et, par ricochet, le taux de son adversaire du sud. Or, rappelons-le, contrairement aux deux parties du pays du Matin Calme, la république kémaliste n'est entourée que de petits pays. N'inversons pas les rôles : ce n'est pas la Grèce, effectivement contrainte de déployer un très coûteux effort militaire, qui menace le "pays voisin".
Depuis la rédaction de la constitution de 1982, imposée par les auteurs du coup d'État de septembre 1980, et jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2003, le pouvoir suprême était détenu par le MGK (3). Dans cet exercice, l'État-major d'Ankara, recruté par cooptation, pouvait compter aussi sur le soutien de la haute magistrature. À celle-ci l'attachaient ces tendres liens qu'on appelle "philosophiques" dans des quotidiens tels que la "Nouvelle République" de Tours, la "Dépêche" de Toulouse" ou "l'Est républicain" de Nancy. En Turquie comme en France, le jacobinisme et le laïcisme s'appuient toujours sur les mêmes réseaux.
En face d'eux se trouvent des gens, ceux du parti au pouvoir "AKP", mais également du mouvement islamo-moderniste de Fethullah Gûlen, que l'on qualifie ordinairement, mais peut-être abusivement, en tout cas vaguement, sans que les mots aient été préalablement définis, d'islamistes. À terme, ces musulmans militants et confrériques représenteraient si d'aventure leur pays entrait dans l'Europe, un danger certes beaucoup plus grand que leurs compatriotes kémalistes ou leurs coreligionnaires salafistes.
Constatons que dans le court terme, leur action a permis de mettre en lumière les faces d'ombres de l'Histoire contemporaine de leur pays.
Les occidentaux de ma génération, par exemple, avaient été bercés de la légende de ce qu'on appelait l'helléno-turquisme, les "frères ennemis Grecs et Turcs", réconciliés depuis le gouvernement de Venizelos (1928-1932). Cette rumeur optimiste prospéra jusqu'aux jours noirs de septembre 1955. Les Grecs de Constantinople furent alors victimes de violences inacceptables. Ils durent quitter une Ville, leur Ville, la Ville, que l'on disait "Immortelle", vieille comme l'Histoire humaine, et pourtant d'une beauté toujours étincelante, aujourd'hui encore sous son nom définitivement turc d'Istanbul.
Sans s'étendre sur cette page sombre et lamentable, retenons que jusqu'à une date très récente, ceux qui la connaissaient, bien peu nombreux en France, pays qui ne se connaît pas d'ennemis, en rendaient responsable le gouvernement d'Adnan Menderes. Et celui-ci avait été renversé, et pendu par les militaires kémalistes en 1961.
Or tous les documents publiés par les journaux officieux, à la faveur de la lutte entre le gouvernement civil de l'AKP et les comploteurs d'Ergenekon, prouvent le contraire de ce que nous pensions jusque-là. Tous ces crimes avaient été provoqués par "l'État profond" en vue d'une politique machiavélique.
Notre interprétation superficielle résulte précisément de la désinformation. Elle avait été fabriquée par le jacobinisme local et propagée par ses cercles de confraternité en Europe occidentale et aux États-Unis.
Le régime bipartisan avait été institué en 1946 dans le contexte de la guerre froide et du plan Marshall. Cette apparence, renforcée par l'adhésion à l'OTAN en 1952, allait certes permettre au parti démocrate de récupérer une partie du public musulman, légitimement heurté par la laïcisation à marche forcée de la République à l'époque de son fondateur.
Mais les limites de la liberté sont demeurées, cependant, étroitement surveillées par des équipes adverses, "républicaines", animées d'un nationalisme militaire ombrageux et même obsidional. "Le Turc entouré d'ennemis, inculquent-ils dès l'enfance aux petits écoliers, trahis par les siens, doit faire face et remporter la victoire". (4)
Leur habileté avait consisté à se présenter pour les sous-traitants indispensables du pacte atlantique et de la stratégie occidentale dans la région. En bons serviteurs de l'idée qu'ils se font de leur intérêt national, et d'un destin géopolitique "de l'Adriatique à la muraille de Chine", ils se préoccupent, de toute évidence, comme d'une guigne de l'Atlantique et de l'Occident. Qu'ils aient pu apparaître comme les alliés des Israéliens hier, comme les protecteurs des Arabes aujourd'hui, donne à sourire. La défunte Yougoslavie a cru aussi les compter au nombre de ses amis.
Même la Commission européenne commence à prendre conscience du sens réel des négociations. Elles ne se déroulent pas en vue de l'adhésion et ne peuvent pas aboutir à en faire vraiment un État-Membre. Elles ne sont pas menées en vue de cette fin. Les équipes rivales de l'AKP ont hérité du dossier en 2003. Elles en tirent parti, depuis, dans le sens des réformes internes, plus ou moins libérales, qu'elles souhaitent mettre en œuvre, pour des raisons spécifiques à leur islam confrérique.
Le danger à long terme que représente leur démarche réside en ceci : elle organise, beaucoup plus efficacement que ses concurrentes arabes, saoudiennes, marocaines ou égyptiennes, la propagande, le matraquage et le chantage en vue d'une reconnaissance de l'islam comme "l'une des religions de l'Europe", voire même la "deuxième religion de France". Et ces énormes mensonges s'installent peu à peu.
La thèse de l'accusation dans les procès "Ergenekon" comme dans le sous-dossier "Bayloz" tend à donner une explication commune à tous ces faits qui s'apparentent à l'assassinat de Hrant Dink, soit aussi bien :
- les persécutions du reliquat de populations chrétiennes,
- les actions directes contre les missionnaires, évalués par le MGK comme un danger stratégique pour le pays depuis 2001, et présentés comme tels par une partie de la presse,
- ainsi que les tensions perpétuelles et provocatrices avec la Grèce,
- la fermeture des frontières de l'Arménie depuis 1993,
- le refus d'une solution acceptable à Chypre depuis 1974,
- ou même la mise à mort de 37 alevis à Sivas par une foule où se mêlaient à la fois les intégristes islamistes et les loups gris (5),
- ou l'assassinat mystérieux d'un journaliste comme Ugur Mumcu :
… tout cela résultait donc d'un propos délibéré, protégé par "l'État profond".
Il s'agit, au bout du compte, de maintenir la Turquie sous le joug militaire, de présenter leur intervention comme "barrage à l'islamisme".
Les quatre coups d'État réitérés de 1960 à 1997, aux applaudissements de l'occident, trouveraient leur origine dans cette perspective ainsi que l'invasion de Chypre en 1974 et le maintien d'un régime d'occupation dans le nord de l'île. (6) Ce boulet pèse lourd, sans aucun profit pour la Turquie.
Face à cette authentique "stratégie de la tension" le fameux mot d'ordre du ministre des affaires étrangères "pas de problème avec nos voisins" remplit dès lors une fonction à usage interne.
Tout cela demeurait masqué, voilé, mis en doute par la défense des comploteurs, sûrs d'eux.
Coup de théâtre la semaine écoulée, qui correspondait au 4e anniversaire de meurtre de Hrant Dink.
Les audiences du 17 et du 18 janvier du procès ont, ainsi, mis en relief une personnalité bien significative : celle du olonel de gendarmerie en retraite Arif Dogan. (7) En septembre 2010 on apprenait ses implications dans des crimes que l'on attribue désormais à Jitem, service secret illégal de la gendarmerie turque.
Jitem, rappelons-le, correspond à une structure parallèle fonctionnant à la fois comme service de renseignement et comme "service action" exécuteur des basses besognes. En particulier, à partir des années 1980, une guerre impitoyable a ravagé le sud-est anatolien sous le drapeau du PKK, organisation marxiste-léniniste "parti des travailleurs" (8) se réclamant du Kurdistan. À la même époque l'utilisation du mot même de "Kurde" était sanctionnée par des peines très dures. Il fallait user d'un euphémisme tel que "Turc de la Montagne". En face de cette situation de négation de leur identité culturelle, les populations considérées ont représenté, dès le début de la république, et après une très courte période d'entente avec Kemal, un foyer permanent de rébellions.
Celles-ci ont pris toutes les colorations, notamment celle d'une résistance, qualifiée de féodaliste et obscurantiste. Les excès antireligieux du gouvernement d'Ankara, plaisaient beaucoup en Europe occidentale, en Union Soviétique, en Amérique et, bien entendu, au grand-orient de France.
La dernière force de révolte en date a été fondée en 1978 par un militant gauchiste appelé Abdullah Ocalan. Elle invoque, au contraire des précédantes, une idéologie révolutionnaire que l'iconographie des affiches collées dans les villes d'Europe où le PKK est implanté confirme à l'évidence. Son organisation prit les armes à partir de 1984. Le conflit doit avoir fait 44 000 victimes en un quart de siècle. Il s'agissait, il s'agit encore puisque le terrorisme a repris, d'une vraie guerre.
On ne doit donc pas s'étonner que tous les moyens pour réduire cette affaire aient semblé légitimes aux forces locales du maintien de l'ordre. Et à plusieurs reprises les "protecteurs de villages", recrutés officiellement, ont été dénoncés par les gens qui imaginent de réduire cet État aux critères de l'Europe bien-pensante et consommatrice. (9)
Dans un tel contexte, il a été révélé par le colonel Arif Dogan lui-même que, dès 1986 les réseaux du service secret turc ont suscité et armé un mouvement terroriste kurde rival lui-même, le "Hizbullah" dirigé par Husseÿn Velioglu. Ce dernier mourra en définitive, après 15 ans de violences, sous les balles de la police turque en 2000, dans le cadre d'un kidnapping qu'il avait organisé.
L'idée de recruter ainsi des musulmans fanatiques au sein de la population kurde pour servir aux fins de l'ordre turc n'a certes pas été découverte par le colonel Arif Dogan. Elle avait déjà connu une certaine notoriété à l'époque des premières exactions massives commises à l'encore des Arméniens à la fin du XIXe siècle. Fondée en 1890 sous le règne de Abdul-Hamid II l'unité de cavalerie ottomane "Hamidiyé" passe même pour avoir représenté les précurseurs, dans les années 1895-1896, du génocide de 1915. Mais la différence reste considérable entre une unité répressive d'inspiration légale et un groupe terroriste.
Or l'audience des 17 et 18 janvier a permis au colonel de se justifier, et de le faire d'une manière extrêmement violente. Tel un vieil homme usé, aosr qu'il n'est âgé que de 65 ans (10), il accédait difficilement à la barre. Mais il a explosé et rompu avec le système de défense de tout le camp kémaliste. Depuis le début, celui-ci se voulait "serein". Il nie l'existence du complot : "un simple wargame (en français : kriegspiel), une étude d'école, la réplique purement théorique du coup d'État du général Evren en septembre 1980, etc." Toutes les accusations dont nous faisons état relèveraient d'une propagande odieuse, mensongère, et, horresco referens pour les temps qui courent "islamiste". "Ergenekon" ? Une "légende urbaine" !
Patatras, ayant dirigé pendant 8 ans une lutte antiterroriste, le colonel Arif Dogan s'est mis à hurler qu'il avait défendu son pays. Effectivement. Le président lui demanda donc de se calmer. Mais la révélation était faite : oui, le Jitem avait bien orchestré une activité illégale, oui il avait suscité le Hizbullah kurde de Turquie, oui ce Hizbullah était conçu comme un "Hizb-kontra" sur le mode des "contras" latino-américains, oui ces soi-disant parangons de la laïcité et de l'intégrité du territoire avaient embrigadé des islamistes séparatistes. Sympa le colonel. Il ne restera plus à ses compagnons d'hier que la ressource de faire circuler sa photo et de nous persuader que "toute vieillesse est un naufrage".
Et puis le 19 janvier, vint le tour de l'assassin effectif de Hrant Dink. Incarcéré depuis les faits ce jeune idéaliste de 17 ans ne semble pas avoir trop souffert de son incarcération. Il semble même qu'il ait "été fêté [et nourri] comme un héros national". Or ce jour-là, Ogün Samast a reconnu avoir été envoyé vers sa victime, et encouragé dans son intention meurtrière, par des officiers de gendarmerie.
Si l'on devait croire la "fameuse" encyclopédie Wikipedia, qui ne donne guère d'autres détails à son sujet, le jeune activiste aurait eu de bonnes raisons de liquider Hrant Dink. Il prête en effet à sa victime une déclaration un peu surprenante, dont Wikipedia ne donne évidemment pas la référence : "vider un jour ce sang turc empoisonné et de remplir avec le sang neuf de l’Arménie qui après l’indépendance paraît comme l’avenir des Arméniens du monde entier". Que, quatre ans après le meurtre, Wiki demeure encore alimentée par de tels bobards, en dit long sur la source dominante des gens qui fabriquent et amplifient les rumeurs mondiales.
Rappelons aux lecteurs qu'officiellement, en Turquie, tout le monde a condamné moralement ce crime. Si ce courageux journaliste, qui se savait menacé avait prononcé une phrase pareille, aussi provocatrice, très peu de gens, y compris dans les milieux arméniens eussent pris sa défense, et il serait allé directement en prison, en application du code pénal.
La décision de le liquider semble avoir été prise à partir de 2003. Hrant Dink représentait, dans son journal "Agos", un symbole insupportable. Pour la première fois depuis les événements tragiques qui ont purgé en 1915 la Turquie de l'essentiel de sa population arménienne, puis en 1922 de l'essentiel de sa population grecque, un représentant des survivants de ces minorités osait écrire librement, revendiquant son identité sans pour autant renoncer à sa citoyenneté. Dans tous les systèmes autoritaire clos, la dissidence intérieure appuyée sur le droit, est considérée comme pire que l'exil, pire que la trahison.Quatre ans plus tard, le quotidien Zaman, proche du gouvernement, reconnaît que "Hrant Dink a été victime de la fumée".
Nous dirions plus crûment en France : de l'enfumage systématique.
Autrement dit : les inspirateurs de ses assassins ont bénéficié des puissants instruments de désinformation mis en place et protégés par la complaisance occidentale depuis l'installation en 1946 d'un bipartisme apparent. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2003, ce régime avait été limité par divers putschs militaires. Et ceux-ci ont jalonné l'Histoire de ce demi-siècle, y compris le coup d'État dit postmoderne de février 1997.
Comme dans d'autres pays musulmans d'ailleurs, la dictature policière glauque a produit le fumier qui permet à l'islamisme de fleurir.
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, turquie, méditerranée, proche orient, asie mineure, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Udo Ulfkotte - Wie die Medien lügen
Udo Ulfkotte
Wie die Medien lügen
00:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, manipulations médiatiques, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Kosovo's Thaçi: Human Organs Trafficker

Kosovo's Thaçi: Human Organs Trafficker
by Srdja Trifkovic
The details of an elaborate KLA-run human organ harvesting ring, broadly known for years, have been confirmed by a Council of Europe report published on January 15. The report, “Inhuman treatment of people and illicit trafficking of human organs in Kosovo” identifies the province’s recently re-elected “prime minister” Hashim Thaçi as the boss of a “mafia-like” Albanian group specialized in smuggling weapons, drugs, people, and human organs all over Europe. The report reveals that Thaçi’s closest aides were taking Serbs across the border into Albania after the war, murdering them, and selling their organs on the black market. In addition, the report accuses Thaçi of having exerted “violent control” over the heroin trade for a decade.
Deliberate Destrution of Evidence – Long dismissed in the mainstream media as “Serbian propaganda,” the allegations of organ trafficking – familiar to our readers – were ignored in the West until early 2008, when Carla Del Ponte, former Prosecutor at the International Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) at The Hague, revealed in her memoirs that she had been prevented from initiating any serious investigation into its merits. She also revealed – shockingly – that some elements of proof taken by ICTY field investigators from the notorious “Yellow House” in the Albanian town of Rripe were destroyed at The Hague, thus enabling the KLA and their Western enablers to claim that “there was no evidence” for the organ trafficking allegations.
In April 2008, prompted by Del Ponte’s revelations, seventeen European parliamentarians signed a motion for a resolution calling on the Assembly to examine the allegations. The matter was referred to the Assembly’s Committee on Legal Affairs and Human Rights, which in June 2008 appointed Swiss senator Dick Marty as its rapporteur. He had gained international prominence by his previous investigation of accusations that the CIA abducted and imprisoned terrorism suspects in Europe.
“Genuine Terror” – In his Introductory Remarks Marty revealed some of the “extraordinary challenges of this assignment”: the acts alleged purportedly took place a decade ago, they were not properly investigated by any of the national and international authorities with jurisdiction over the territories concerned. In addition, Marty went on,
… efforts to establish the facts of the Kosovo conflict and punish the attendant war crimes had primarily been concentrated in one direction, based on an implicit presumption that one side were the victims and the other side the perpetrators. As we shall see, the reality seems to have been more complex. The structure of Kosovar Albanian society, still very much clan-orientated, and the absence of a true civil society have made it extremely difficult to set up contacts with local sources. This is compounded by fear, often to the point of genuine terror, which we have observed in some of our informants immediately upon broaching the subject of our inquiry. Even certain representatives of international institutions did not conceal their reluctance to grapple with these facts: “The past is the past”, we were told; “we must now look to the future.”
The report says Thaçi’s links with organized crime go back to the late 1990’s, when his Drenica Group became the dominant faction within the KLA. By 1998 he was able to grab control of “most of the illicit criminal enterprises” in Albania itself. Thaçi and four other members of the Drenica Group are named as personally guilty of assassinations, detentions and beatings:
In confidential reports spanning more than a decade, agencies dedicated to combating drug smuggling in at least five countries have named Hashim Thaçi and other members of his Drenica Group as having exerted violent control over the trade in heroin and other narcotics… Thaçi and these other Drenica Group members are consistently named as “key players” in intelligence reports on Kosovo’s mafia-like structures of organised crime. I have examined these diverse, voluminous reports with consternation and a sense of moral outrage.
Marty notes that the international community chose to ignore war crimes by the KLA, enabling Thaçi’s forces to conduct a campaign of murdereous terror against Serbs, Roma, and Albanians accused of collaborating with the Serbs. Some 500 of them “disappeared after the arrival of KFOR troops on 12 June 1999,” about a hundred Albanians and 400 others, most of them Serbs. Some of these civilians had been secretly imprisoned by the KLA at different locations in northern Albania, the report adds, “and were subjected to inhuman and degrading treatment, before ultimately disappearing.” Captives were “filtered” in ad-hoc prisons for their suitability for organ harvesting based on sex, age, health and ethnic origin. They were then sent to the last stop – a makeshift clinic near Fushë-Krujë, close to the Tirana airport:
As and when the transplant surgeons were confirmed to be in position and ready to operate, the captives were brought out of the ‘safe house’ individually, summarily executed by a KLA gunman, and their corpses transported swiftly to the operating clinic.
Thaçi the Untouchable – The report states that Thaçi’s Drenica Group “bear the greatest responsibility” for the prisons and the fate of those held in them. It criticizes the governments supportive of Kosovo’s independence for not holding to account senior Albanians in Kosovo, including Thaçi, and of lacking the will to effectively prosecute the former leaders of the KLA. The diplomatic and political support by such powers “bestowed upon Thaçi, not least in his own mind, a sense of being untouchable.”
Marty concludes that “[t]he signs of collusion between the criminal class and the highest political and institutional office holders are too numerous and too serious to be ignored,” but “the international authorities in charge of the region did not consider it necessary to conduct a detailed examination of these circumstances, or did so incompletely and superficially.”
Following Marty’s presentation of the report to the Council of Europe in Paris on December 16 it will be debated by the Parliamentary Assembly in Strasbourg on January 25.
Media Reaction – Within days of the publication of Marty’s report, numerous of excellent articles were published in the mainstream media Europe linking his revelations with the broader problem of NATO’s war against the Serbs in 1999, the precedent it had created for Afghanistan and Iraq, and the nature of the “Kosovar” society today.
Neil Clark in The Guardian assailed “the myth of liberal intervention.” Far from being Tony Blair’s “good” war, he wrote, the assault on Yugoslavia was as wrong as the invasion of Iraq:
It was a fiction many on the liberal left bought into. In 1999 Blair was seen not as a duplicitous warmonger in hock to the US but as an ethical leader taking a stand against ethnic cleansing. But if the west had wanted to act morally in the Balkans and to protect the people in Kosovo there were solutions other than war with the Serbs, and options other than backing the KLA – the most violent group in Kosovan politics… Instead, a virulently anti-Serb stance led the west into taking ever more extreme positions, and siding with an organisation which even Robert Gelbard, President Clinton’s special envoy to Kosovo, described as “without any question, a terrorist group.”
Clark reminds us that it was the KLA’s campaign of violence in 1998 which led to an escalation of the conflict with the government in Belgrade. “We were told the outbreak of war in March 1999 with NASTO was the Serbian government’s fault,” he adds, yet Lord Gilbert, the UK defence minister, admitted “the terms put to Miloševic at Rambouillet [the international conference preceding the war] were absolutely intolerable … it was quite deliberate.” Then came the NATO occupation, under which an estimated 200,000 ethnic Serbs and other minorities from south Kosovo, and almost the whole Serb population of Pristina, have been forced from their homes. But as the Iraq war has become discredited, Clark concludes,
so it is even more important for the supporters of “liberal interventionism” to promote the line that Kosovo was in some way a success. The Council of Europe’s report on the KLA’s crimes makes that position much harder to maintain. And if it plays its part in making people more sceptical about any future western “liberal interventions”, it is to be warmly welcomed.
Tony Blair has some very bizarre friends, wrote Stephen Glover in The Daily Mail, but a monster who traded in human body parts beats the lot. The prime minister of Kosovo is painted by the report as a major war criminal presiding over a corrupt and dysfunctional state, Glover says, and yet this same Mr Thaci and his associates in the so-called Kosovo Liberation Army were put in place after the U.S. and Britain launched an onslaught in March 1999 against Serbia, dropping more than 250,000 and killing an estimated 1,500 blameless civilians:
This was Mr Blair’s first big war, and it paved the way for the subsequent Western invasion of Iraq. The crucial difference is that while the Left in general and the Lib Dems in particular opposed the war against Saddam Hussein, both were among Mr Blair’s main cheerleaders as he persuaded President Bill Clinton to join forces with him in crushing Serbia.
Both London and Washington tended to ignore atrocities committed by Hashim Thaci’s KLA, Glover concludes, and offered unacceptably draconian terms to the Serbs “because by that stage Blair and Clinton preferred war”:
Those were the days, of course, when most of the media thought Tony Blair could do no wrong. His military success in 1999 convinced him that Britain could and should play the role of the world’s number two policeman to the U.S. A messianic note entered his rhetoric, as at the 2001 Labour party conference, when he raved that ‘the kaleidoscope has been shaken… Let us re-order this world about us.” … What happened in Kosovo helped shape subsequent events in Iraq and Afghanistan. It is richly ironic that ‘liberated’ Kosovo should now be a failed, gangster state… With his messianic certainties, the morally bipolar Tony Blair liked to divide the world into ‘goodies’ and ‘baddies’, having presumptuously placed himself in the first category. How fitting that this begetter of war after war should end up by receiving the Golden Medal of Freedom from a monster who traded in body parts.
U.S. Damage Limitation and Self-Censorship – Such commentary is light years away from the feeble and half-hearted reporting in the American mainstream media. The Chicago Tribune, for instance, did not deem it fit to publish a story about the Council of Europe report itself. It published two related items critical of the report instead, on the European Union expressing doubt about its factual basis and on the “government” of Kosovo planning to sue Dick Marty for libel. No major daily has published a word of doubt about Bill Clinton’s wisdom of waging a war on behalf of Thaçi and his cohorts a decade ago, or perpetuating the myth of it having been a good war today.
That Thaçi aka “The Snake” is a criminal as well as a war criminal is no news, of course. The intriguing question is who, on the European side, wanted to end his “untouchable” status, why now, and what is the U.S. Government – his principal enabler and abettor – going to do about it.
Unsurprisingly, Thaçi’s “government” dismissed the report on December 14 as “baseless and defamatory.” On that same day Hashim Thaçi wrote in a telegram to President Obama that “the death of Richard Holbrooke is a loss of a friend.” “The Snake” has many other friends in Washington, however, people like US senator (and current foe of WikiLeaks) Joseph Lieberman, who declared back in 1999 at the height of the US-led war against the Serbs that “the United States of America and the Kosovo Liberation Army stand for the same human values and principles … Fighting for the KLA is fighting for human rights and American values.” Thaçi’s photos with top U.S. officials are a virtual Who’s Who of successive Administrations over the past 12 years: Bill and Hillary Clinton, Albright, Bush, Rice, Biden, Wesley Clark…
Thaçi’s American enablers and their media minions are already embarking on a bipartisan damage-limitation exercise. Its twin pillars will be the assertion that the report rests on flimsy factual evidence, an attempt to discredit Dick Marty personally, and the claim the Council of Europe as an irrelevant talking shop.
00:22 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, albanie, kosovo, balkans, europe, affaires européennes, trafic d'organes, mafia, mafia albanaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Celtic violinist + Celtic dueling violins
Celtic violinist
Celtic dueling violins
00:13 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook