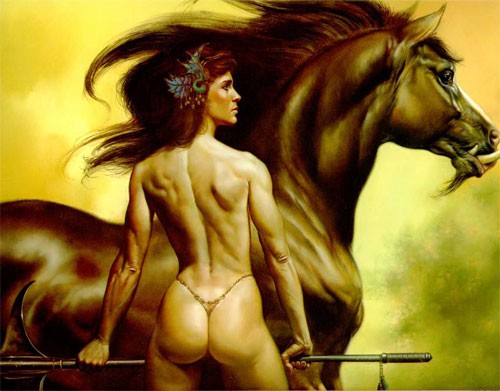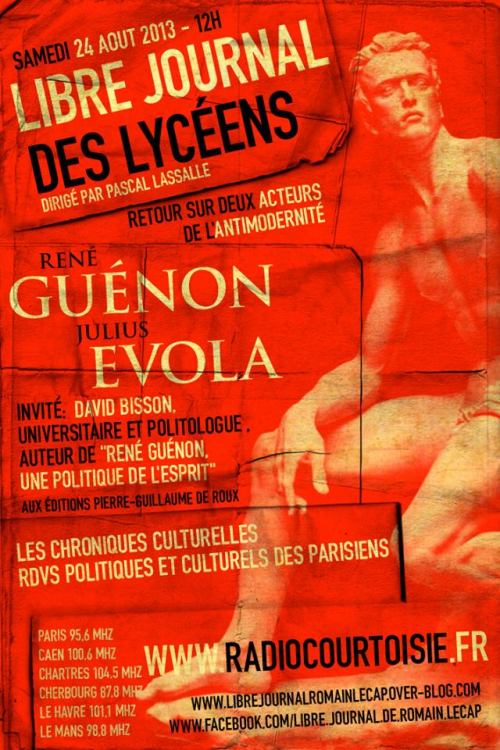dimanche, 17 novembre 2013
L'uomo che cavalcava la tigre
L'uomo che cavalcava la tigre. Il viaggio esoterico del barone Julius
di Andrea Scarabelli
 Quello che presentiamo è un autentico viaggio, realizzato attraverso le opere pittoriche evoliane, che ripercorre le tappe fondamentali della vita di quello che è uno dei protagonisti della cultura novecentesca. Un viaggio nel quale Evola non è una semplice comparsa ma autentico medium delle sue opere, trascinando il lettore all'interno del suo mondo, biografico ma soprattutto metabiografico.
Quello che presentiamo è un autentico viaggio, realizzato attraverso le opere pittoriche evoliane, che ripercorre le tappe fondamentali della vita di quello che è uno dei protagonisti della cultura novecentesca. Un viaggio nel quale Evola non è una semplice comparsa ma autentico medium delle sue opere, trascinando il lettore all'interno del suo mondo, biografico ma soprattutto metabiografico.
Un passo per volta, però. Lo sfondo di queste pagine è il vernissage di un'ipotetica esposizione: “Ea, Jagla, Julius Evola (1898-1974), poeta, pittore, filosofo. Il barone magico. Attraverso questa Mostra, promossa dalla Fondazione Julius Evola, conosceremo l'Evola pittore futurista e dadaista. È questa la prima retrospettiva a lui dedicata nel XXI secolo” (p. 13). Henriet ci invita a questa esposizione immaginaria, all'interno della quale ogni dipinto prende vita, inaugura una dimensione metatemporale e ci conduce attraverso le sillabe alchemiche dell'universo pittorico evoliano. Senza però fermarsi alle tele, a futurismo e dadaismo ma estendendosi all'interezza della “tavolozza dai molti colori dell'Irrazionalismo evoliano” (p. 13), momento altresì fondamentale per accedere alla cultura continentale novecentesca. E chi conosce il pensiero di Evola sa bene che tipo di valenza conferire al termine “irrazionale”...
Ad accompagnare il lettore altri non è che Evola stesso, a volte sostituito dal suo doppio Ea (uno degli pseudonimi con cui questi firmava taluni dei suoi contributi su Ur e Krur, alla fine degli anni Venti). Ogni dipinto “esposto” in quella che può considerarsi una galleria anzitutto interiore ridesta nel filosofo ricordi, universi, dimensioni – realtà. In ognuno dei ventisei capitoli che costituiscono il volumetto – molti dei quali recano, non casualmente, i titoli di opere evoliane, come Five o' clock tea, Nel bosco e Truppe di rincalzo sotto la pioggia – il lettore percorre i labirinti di Evola, ognuno dei quali avente una via d'accesso differente ma tutti diretti verso il cuore della sua Weltanschauung.
In questa dimensione, a metà tra la realtà fisica ed una onirico-allucinatoria, personaggi reali interagiscono con figure fantastiche – questo l'intreccio, abilmente restituito dalle pagine di Henriet. Non è difficile così scorgere un Evola intento a leggere recensioni dei suoi dipinti sulle colonne di riviste intemporali, intrattenere conversazioni con personaggi fantastici, percorrere dimensioni ontologiche ultraterrene. Ma, al contempo, a questi itinerari sono accostati momenti storici ben precisi, con il loro corollario umano - appaiono allora Arturo Reghini, Sibilla Aleramo, Arturo Onofri, Giulio Parise e gli iniziati del Gruppo di Ur.
Ed ecco evocati, come d'incanto, gli anni Venti, delle avanguardie e dei cenacoli esoterici. Ecco le feste organizzate dagli aristocratici, frequentate dal giovane Evola, nella fattispecie una, tenutasi per festeggiare la fine della Prima Guerra Mondiale: “Julius è vestito di nero, ed ha il volto coperto da una maschera aurea, provvista di un lungo naso conico” (p. 16). È l'unico, in Italia, tra i futuristi, ad apprezzare l'arte astratta. Il futurismo non è che una maschera, gli rivela la duchessa de Andri, organizzatrice della festa, liberatevene. E, tra le boutade di Marinetti e gli abiti disegnati da Depero, “egli andò oltre” (p. 22).
Non è che l'inizio: la realtà onirica diviene visione “vera” e simboli percorrono le trame dei vari capitoli, rendendoli interdipendenti tra loro: l'ape austriaca che, muovendosi a scatti con un ritmo metallico, si posa sulla tela appena conclusa di Truppe di rincalzo sotto la pioggia è la stessa che accompagna il giovane poeta Arturo Onofri tra i colpi delle granate della Grande Guerra, nella quale “la voce di Evola è a favore degli Imperi Centrali: l'Austria e la Germania” (p. 26).
Attraversati gli scandalismi e i manifesti futuristi, percorso il nichilismo dadaistico, il cammino del cinabro evoliano procede: “In un dorato pomeriggio autunnale, in Roma, nel 1921, alle ore 17, infine Evola capì. Aveva da poco smesso di dipingere. Quell'esperienza artistica era giunta alla fine, nel senso che le sue potenzialità creative si erano esaurite: tutto quel che poteva fare attraverso i quadri per procedere nella sua ricerca interiore, ebbene, lo aveva fatto” (p. 28). Alle 17.15, Evola si libera del suo doppio dadaista per procedere oltre, dopo l'abisso delle avanguardie per poi risalire, senza incappare nell'impasse dell'inconscio freudiano surrealista e della scrittura automatica. Via, verso Ur e Krur, La Torre e la sua rivolta contro la tirannia della modernità.
Come già detto, il percorso tracciato da Henriet non si arresta all'esaurimento della fase artistica, ma procede, percorrendo tutte le sue fasi fondamentali. Un altro frammento di realtà, trasfigurato e sublimato nelle serpentine dell'ermetismo pittorico del futuro filosofo: il XXI aprile 1927, dies natalis Romae, coglie il Nostro affacciato alla finestra di una torre – non d'avorio ma “di nera ossidiana” – mentre assiste da lontano ad una parata. “Tutta l'Urbe è in festa, ma Ea preferisce restarsene da solo, nel proprio salone. Per lui, in fondo, il fascismo è troppo plebeo” (p. 41). Ed ecco comparire, a cavallo di farfalle che sorvolano la Città Eterna, gli altri membri del Gruppo di Ur, quasi a formare una delle loro catene nei cieli liberi sopra la città, sopra il mondo intero, al di sopra della storia. Henriet rievoca qui le vicende legate alla celebre Grande Orma (episodio con retroscena ancora da scoprire, come testimonia il recente ottimo libro di Fabrizio Giorgio, Roma Renovata Resurgat, Settimo Sigillo, Roma 2012): “Nel 1923 hanno donato al capo del Governo un fascio formato da un'ascia di bronzo che proviene da una misteriosa e antica tomba etrusca, e dodici verghe di betulla, legate con strisce di cuoio rosso” (p. 42). La Tradizione porge la mano alla Storia, aspettando una risposta. Sono anni cruciali, questi, nei quali in poche ore possono decidersi non solo i destini di un decennio ma le sorti di un'intera civiltà. Riuscirà il fascismo a farsi depositario del proprio destino romano? Sono in molti a chiederselo. Attonito, Evola assiste al Concordato, al vanificarsi di un sogno, “ancora una volta è solo”, “uno spirito libero e aristocratico, fuori tempo e fuori luogo” (p. 42): in una parola, inattuale, in senso nietzschiano. Così, mentre le piazze gorgogliano dei singhiozzi gioiosi di quegli stessi che all'indomani del fallimento del fascismo prepareranno le forche e accenderanno i roghi, Evola se ne rimane in disparte. Alla fine della scena, una camicia nera emerge dal buio della notte, gli si avvicina, pronunciando, con una voce d'acciaio, queste parole: Il Natale romano è finito, barone. Da ora in poi, il destino degli eventi a venire è già scritto.
Ed ecco la Seconda Guerra Mondiale, la guerra civile europea, l'inizio di un nuovo ciclo, sul quale già pesa il presagio dell'ipoteca. Il viaggio nella prima mostra evoliana del XXI secolo continua, tra anticipazioni e retrospettive. Nella camera magica, Evola vede quello che sarà il suo destino: “In piedi, tra le rovine fumanti d'Europa, al termine della Seconda Guerra Mondiale, si aggira per Vienna. 1945. Una visione di morte. La tigre diventa metallo: la carne si solidifica” (p. 47). Sbalzato contro un muro dallo spostamento d'aria causato da una bomba, trascorrerà il resto della sua esistenza affetto da una semiparalisi degli arti inferiori.
Il Barone è costretto su una carrozzella, novella tigre d'acciaio. Il secondo dopoguerra. Con una certa ironia (che non sarebbe dispiaciuta al Barone ma che forse non piacerà a certi “evolomani”, come scrive Gianfranco de Turris nella sua Introduzione) l'autore immagina che proprio a cavallo di questa nuova tigre il Nostro continui la sua battaglia. Inizia a dipingere copie dei suoi dipinti degli anni Venti, dispersi (ossia venduti) durante la celebre retrospettiva del 1963. Eppure, anche in questa nuova situazione, si profilano nuovi attacchi, nuove situazioni da superare, come i Rivoluzionari del Sesso (evidente richiamo alle dottrine di Wilhelm Reich). Ed ecco gli Anti-Veglianti, Signori dell'Occhio, che tentano di impiantare un Occhio televisivo al posto di quelli biologici, teso ad uniformare Evola al mondo moderno, alla tirannia dell'homo oeconomicus e dei Mezzi di Comunicazione di Massa, che al terzo occhio ne sostituiscono uno artefatto e anestetizzante, che riduce l'uomo a Uomo Banale e Mediocre. Ma Evola riesce a fuggire.
Ennesima anticipazione: questa volta in alta montagna, molti passi sul mare, ancora di più sull'uomo, come aveva scritto Nietzsche. Eccolo assistere in anteprima alla deposizione delle sue ceneri sul ghiacciaio del Lys. Allucinato da uno dei suoi quadri, Evola ha una visione di quel che sarà: “Il vento spira freddo, la luce del sole è netta, brillante. Il silenzio domina tutto. I ghiacci eterni scintillano. V'è una gran quiete, tesa, nervosamente carica di energia in potenza” (p. 36). Per disposizione testamentaria, il suo corpo viene cremato, le ceneri disperse sulle Alpi. Così vive la propria morte Ea, Jagla, il Barone – nel libro non la conoscerà mai più, fisicamente. Si addormenterà, sognando un'intervista realizzata per la televisione svizzera nei primi anni Ottanta. Il “diamante pazzo” che scaglia bagliori qua e là, illuminando ora l'uno ora l'altro frammento del firmamento occidentale, è seduto “sulla sua tigre a dondolo, in legno aromatico e dai colori smaltati in vernice brillante” (p. 67). Certo, pensa Evola beffardamente, parlare di certe cose nel mondo moderno, servendosi dei media (chissà che avrebbe pensato oggi, nell'epoca della Rete...), non è certo ottimale. Comincia a dubitare della sua decisione di concedere l'intervista. Questa posizione a cavallo della tigre comincia ad apparirgli un po' scomoda. Risponde alle domande, ribadendo le proprie posizioni di fronte al neospiritualismo, alle censure di certe cricche intellettuali e via dicendo. Ma la realtà del suo sogno inizia a sfaldarsi. Il suo pellegrinaggio nel kali-yuga lo ha prosciugato: “Evola non immaginava che sarebbe stato così difficile. Il sogno della realtà è diventato un caos indistinto di colori acidi” (p. 71). Abbandonandosi al disfacimento dell'architettura onirica nella quale si vive morente, si spegne, “gli occhi accecati da una radianza aurea intensissima” (Ibid.). Il confine tra sogno e realtà è disciolto per sempre: Evola, che aveva visto la propria fine vivente in uno dei suoi quadri, ora vive la propria morte in un sogno.
Scritto con un registro stilistico iperbolico ed evocativo, il libro di Henriet, come messo a fuoco da de Turris nella già citata introduzione, non è però solo una rassegna di queste esperienze, quanto piuttosto una ricognizione sul senso dell'interezza del sentiero del cinabro, portato a stadio mercuriale durante il corso della vita del Nostro. Come è noto, a partire peraltro dalla sua biografia spirituale, il Cammino del cinabro, Evola diede pochissimo spazio a dettagli di ordine personale, preferendo ad essi un'impersonalità attiva fatta di testimonianze ed opere. In uno degli ultimi capitoli, Henriet scrive: “Della vita privata di Ea si sapeva poco, era come se non gli fosse accaduto nulla di personale. Egli era semplicemente il mezzo, uno dei possibili, attraverso i quali l'Io originario – la Genitrice dell'Universo, una delle Madri di Goethe – operava su quel piano della realtà, governato dalle regole del tempo e dello spazio” (p. 62). In questo può risolversi l'esercizio della prassi tradizionale, per come interpretata dal filosofo romano. Una azione nella quale l'essere un mezzo di istanze sovraindididuali non annichilisce l'Io, come vorrebbero invece talune spiritualità fideistiche sempre avversate da Evola, ma lo potenzia, finanche a realizzarlo in tutti i suoi molteplici stati. Un monito, questo, quanto mai attuale, tanto per accedere all'universo evoliano quanto per attraversare illesi il mondo moderno, sopravvivendo alle sue chimere e fascinazioni.
Alberto Henriet, L'uomo che cavalcava la tigre. Il viaggio esoterico del barone Julius. Presentazione di Gianfranco de Turris, Gruppo Editoriale Tabula Fati, Chieti 2012, pp. 80, Euro 8,00.
titolo: L'uomo che cavalcava la tigre. Il viaggio esoterico del barone Julius
autore/curatore: Andrea Scarabelli
fonte: Fondazione Julius Evola
tratto da: http://www.fondazionejuliusevola.it/Documenti/recensioneScarabelli_Sito.doc
lingua: italiano
data di pubblicazione su juliusevola.it: 10/06/2013
00:05 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, evola, traditionalisme, tradition, italie, livre, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 10 novembre 2013
LE JAPON MEDIEVAL : LE MONDE A L'ENVERS...

Rémy Valat
Le Japon médiéval est méconnu en France et grande est la tentation de le comparer à la période féodale européenne, tant il est vrai que nombreuses similitudes peuvent être constatées entre ces deux modèles de sociétés pourtant situées aux deux extrémités du continent eurasiatique.
Ce rapprochement, plutôt cette interprétation, est notamment le produit de l'historiographie nippone : le terme de « Moyen-Âge » apparaît pour la première fois sous la plume de l'historien Hara Katsurô, auteur d'une Histoire du Moyen-Âge parue en 1906. Pour lui, cette période instable et transitoire se situe entre deux sociétés stabilisées : Heian (794-1185) et Edo (1603-1867). Ce néologisme s'imposa sur l'appellation originelle des contemporains (l'« âge des guerriers »). Il est vrai que l'émiettement de l'autorité, la captation du pouvoir politique par les hommes d'armes, l'apparition de liens de vassalité, la naissance de seigneuries foncières, le phénomène monastique, l'émergence d'oppositions pour les libertés communales, l'essor économique et démographique, le développement d'une bourgeoisie urbaine favorisent le rapprochement (en dépit d'un décalage chronologique dans le développement de ce type de société au Japon).



À l'heure de la montée en puissance du nationalisme et d'une politique coloniale dynamique, le livre Hara Katsurô écrit dans le contexte de la victorieuse guerre russo-japonaise souhaite interpréter le « Moyen-Âge » comme une période fondatrice, d'affirmation de l'identité nationale, similaire à la période féodale européenne et où auraient dominé les valeurs martiales : ce discours visait à démontrer une « supériorité intrinsèque » des industries et des armées japonaises et à légitimer l'expansion coloniale en Asie. Une idée similaire sous-tend le livre de Nitobe Inazo, Le Bushidô : l'âme du Japon, ouvrage paru en 1910 et très prisé des artistes martiaux ou amoureux de la chose militaire qui tombent dans le piège tendu par l'auteur...
Le travail de Pierre-François Souyri a été de « remettre à l'endroit » l'histoire médiévale nippone et de corriger cette interprétation... L'histoire du Japon médiéval : le monde à l'envers, paru cette année au éditions Perrin-Tempus , paru en août 2013, est une réédition de l'ouvrage Monde à l'envers, la dynamique de la société médiévale, publié par la très regrettée maison d'éditions Maisonneuve et Larose en 1998. Le contenu de ce livre offre une forte similitude avec la 3ème partie (consacrée au Moyen-Âge) du même auteur de L'histoire du Japon des origines à nos jours, paru chez Hermann en 2009 avec cependant un intéressant chapitre additionnel comparant les sociétés médiévales européennes et nippones (chapitre 13. De la comparaison entre les sociétés médiévales d'Occident et du Japon). L'auteur, Pierre-François Souyri, professeur à l'université de Genève et ancien directeur la Maison Franco-japonaise de Tôkyô, est un spécialiste incontesté du sujet : on lui doit notamment la traduction du livre de Katsumata Shizuo relatif aux coalitions et ligues de la période médiévale (Ikki. Coalitions, ligues et révoltes dans le Japon d'autrefois, CNRS éditions, 2011). Enfin, le livre se fonde sur une abondante documentation et sources primaires japonaises, soigneusement confrontées et analysées.
L'« âge des guerriers » est une période foisonnante, aussi violente que créatrice. Après la victoire du clan des Minamoto sur celui des Taira (1185), un premier pouvoir militaire central s'impose : le shôgunat de Kamakura (1185-1333). Minamoto Yoritomo obtient de l'empereur le titre de sei tai shôgun (征夷大将軍 ), c'est-à-dire de « général en chef chargé de la pacification des barbares ». Mais, à la mort de ce dernier en 1199, le pouvoir réel échappe au fils du défunt (Minamoto Yoriie) ; le pouvoir est confié à un conseil de vassaux que domine le clan des Hôjô, clan dont l'influence ne cesse de s'étendre et de s'affirmer. Le shôgunat de Kamakura est resté dans toutes les mémoires en raison du célèbre épisode des tentatives d'invasions mongoles, dispersées par un typhon, un « vent divin » (1274 et 1281)... Ce long XIIIe siècle est propice à une intense réflexion spirituelle et à la contestation religieuse : des réformes sont initiées par les prédicateurs Hônen, Shinran, Nichiren et les maîtres zen, Eisai et Dôgen.
L'échec des invasions mongoles aussi est le prélude à la chute du clan Hôjô, incapable de récompenser les guerriers qui ont contribué aussi bien financièrement que par leur engagement personnel à la victoire. Une coalition de malcontents appuie l'empereur Go Daigo qui réalise une éphémère et autoritaire restauration impériale (restauration Kemmu, 1333-1336). L'empire se scinde ensuite en deux entités rivales (les cours du Nord et du Sud) ; la guerre civile fait rage, mais celle-ci profite au clan des Ashigaka, partisan de la cours kyôtoîte du Nord : en 1338, Ashikaga Takauji reprend la fonction de shôgun. Après la défaite de la « cour sudiste » en 1392 : les Ashikaga deviennent les maîtres du pays. La période Muromachi (1392-vers 1490) est entrecoupée de crises politiques et sociales sur fond d'essor économique (développement d'une économie commerciale avec échanges monétaires et premières tentatives d'accumulation de capital). C'est le « monde à l'envers » (gekokujô, 下剋上) : les mouvements civils ou religieux d'autonomie rurale et urbaine et l'irrésistible ascension de la classe des guerriers débouchent sur un affrontement général, dont l'enjeu devient l'unification du pays. Oda Nabunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu la réaliseront au prix d'une longue guerre contre les forces politiques centrifuges, conflit dont Ieyasu sort vainqueur en créant la dernière dynastie de shôgun en 1603.
Le monde à l'envers c'est surtout celui des petites gens avides d'autonomie et d'ascension sociales dans un contexte de mutation économique et sociale, mais aussi celui d'un monde flottant qui a influencé les modes de vie et la culture nippones (les parias, appelés notamment kawaramono, 河原者). Les guerriers, acteurs principaux de la période médiévale et en particulier ceux de l'est de l'île d'Honshû, s'organisent sur une base familiale et clanique et créent des liens de vassalité (bushidan, 武士団). Ils sont issus de lignées de déclassés de la cour (voire de princes de la famille impériale, c'est le cas du lignage des Taira et des Minamoto qui font s'affronter entre 1180 et 1185) venu tenter leur chance loin de la capitale ou bien proviennent du milieu des paysans aisés et de la petite notabilité rurale. Ces hommes sont très attachés à leur terroir et défendent les intérêts des travailleurs de la terre, desquels ils se désolidarisent progressivement pour les dominer. Ces militaires en quête d'ascension sociale et de récompenses sont loin de la représentation conventionnelle du serviteur fidèle et loyal façonnée à l'époque d'Edo. Leur engagement est conditionné par les revenus de leurs terres : la période des récoltes (et de la perception des redevances) venue, le souffle d'un vent politique ou militaire contraire, ces hommes s'évaporent ou changent de camp. Leurs prouesses militaires, relatées dans les « dits » servent autant à bâtir une réputation qu'à ouvrir droit à récompenses... Si la bravoure du guerrier japonais médiéval ne peut être remis en question, leur éthique et leurs motivations étaient cependant plus prosaïques...
Histoire du Japon médiéval, le monde à l'envers, de Pierre-François Souyri, aux éditions Perrin-Tempus, août 2013, 522 p.
00:09 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditioon, traditions, traditionalisme, japon, asie, samourai |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 06 novembre 2013
Un texte du 19ème siècle sur la formation du Samouraï déchiffré

Un texte du 19ème siècle sur la formation du Samouraï déchiffré
Ex: http://www.zejournal.mobi
Un texte d'entraînement, utilisé par une école d'arts martiaux pour enseigner aux membres de la classe bushi (samurai ou samouraï), a été déchiffré. Il révèle les règles que les samouraïs étaient censés suivre et ce qu'il fallait faire pour devenir un véritable maître épéiste.
Le texte est appelé Bugei no jo, ce qui signifie "Introduction aux arts martiaux" et est daté de la 15e année de Tenpo (1844).
Écrit pour les étudiants samouraïs sur le point d'apprendre le Takenouchi-Ryu, un système d'arts martiaux , il devait les préparer pour les défis qui les attendaient.
Une partie du texte traduit donne ceci: "Ces techniques de l'épée, nées à l'âge des dieux, ont été prononcées par la transmission divine. Elles forment une tradition vénérée de par le monde, mais sa magnificence se manifeste seulement quand on a pris connaissance (...). Quand [la connaissance] est arrivée à maturité, l'esprit oublie la main, la main oublie l'épée," un niveau de compétence que peu obtiennent et qui requiert un esprit calme.
Le texte comprend des citations écrites par les anciens maîtres militaires chinois et est écrit dans un style Kanbun formel: un système qui combine des éléments de l'écriture japonaise et chinoise.
Le texte a été publié à l'origine par des chercheurs en 1982, dans sa langue originale, dans un volume de l'ouvrage "Nihon Budo Taikei." Récemment, il a été partiellement traduit en anglais et analysé par Balázs Szabó, du département d'études japonaises de l'Université Eötvös Loránd à Budapest, en Hongrie.
La traduction et l'analyse sont décrites dans la dernière édition de la revue Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae.
Parmi ses nombreux enseignements, le texte dit aux élèves de montrer une grande discipline et de ne pas craindre le nombre d'ennemis. "(...) c'est comme franchir la porte d'où nous voyons l'ennemi, même nombreux, nous les voyons comme quelques uns, donc aucune crainte ne s'éveille, et nous triomphons alors que le combat vient à peine de commencer", citation d'un enseignement Sur les Sept Classiques Militaires de la Chine ancienne.
Le dernier siècle des samouraïs
En 1844, seuls les membres de la classe Samouraï étaient autorisés à recevoir une formation d'arts martiaux. Szabó explique que cette classe était strictement héréditaire et qu'il y avait peu de possibilités pour les non-samurai d'y adhérer.
Les étudiants Samurai, dans la plupart des cas, auraient participé à plusieurs écoles d'arts martiaux et, en outre, auraient appris "l'écriture chinoise, les classiques confucéens et la poésie dans les écoles du domaine ou des écoles privées", a expliqué Szabó.
Les étudiants qui commencent leur formation de Takenouchi-ryu en 1844 ne réalisaient pas qu'ils vivaient à une époque où le Japon était sur ??le point de subir d'énormes changements.
Pendant deux siècles, il y a eu des restrictions sévères sur les Occidentaux entrant au Japon. Cela a pris fin en 1853 quand le commodore américain Matthew Perry est entré dans la baie de Tokyo avec une flotte et a exigé que le Japon signe un traité avec les États-Unis.
Dans les deux décennies qui ont suivi, une série d'événements et de guerres ont éclaté qui on vu la chute du Japon Shogun, la montée d'un nouveau Japon moderne et, finalement, la fin de la classe des Samouraïs.
Les règles Samurai.
Le texte qui vient d'être traduit énonce 12 règles que les membres de l'école de Takenouchi-ryu étaient censés suivre.
Certaines d'entre elles, dont "Ne quittez pas le chemin de l'honneur !" et "Ne commettez pas de turpitude !" étaient des règles éthiques que les samouraïs étaient censés suivre.

Une règle notable, "Ne laissez pas les enseignements de l'école s'échapper !" a été créé pour protéger les techniques secrètes d'arts martiaux de l'école et à aider les élèves s'ils devaient se trouver au milieu d'un combat.
"Pour une école d'arts martiaux ... afin d'être attrayante, il était nécessaire de disposer de techniques spéciales permettant au combattant d'être efficace même contre un adversaire beaucoup plus fort. Ces techniques sophistiquées faisaient la fierté de l'école et étaient gardées secrètes, car leur fuite aurait causé une perte aussi bien économique que de prestige", écrit Szabó.
Deux autres règles, peut-être plus surprenantes, précisent que les étudiants "ne se concurrencent pas !" et "Ne racontent pas de mauvaises choses sur d'autres écoles !".
Les occidentaux modernes ont une vision populaire des samouraïs s'affrontant régulièrement, mais en 1844, ils n'étaient pas autorisés à se battre entre eux.
Le shogun Tokugawa Tsunayoshi (1646-1709) avait placé une interdiction sur les duels d'arts martiaux et a même réécrit le code que le samouraï devait suivre, en l'adaptant pour une période de paix relative. "L'apprentissage et la compétence militaire, la loyauté et la piété filiale, doit être promue, et les règles de la bienséance doivent être exécutées correctement", expliquait le shogun (traduction du livre "Études sur l'histoire intellectuelle du Japon des Tokugawa," par Masao Maruyama, Princeton University Press, 1974).
Les compétences secrètes.
Le texte propose seulement un faible aperçu des techniques secrètes que les élèves auraient appris à cette école, en séparant les descriptions en deux parties appelées "secrets les plus profonds du combat" et "secrets les plus profonds de l'escrime."
Une partie des techniques secrètes de combat à mains nues est appelé Shinsei no daiji, ce qui se traduit par "techniques divines", indiquant que ces techniques étaient considérées comme les plus puissantes.
Curieusement, une section de techniques secrètes d'escrime est répertoriée comme ?ry?ken, également connu sous le nom IJU ichinin, ce qui signifie "ceux considérés être accordés à une personne" - dans ce cas, l'héritier du directeur.
Le manque de détails décrivant ces techniques dans des cas pratiques n'est pas surprenant pour Szabó. Les directeurs avaient des raisons pour utiliser un langage crypté et l'art du secret.
Non seulement ils protégeaient le prestige de l'école, et les chances des élèves dans un combat, mais ils contribuaient à "maintenir une atmosphère mystique autour de l'école," quelque chose d'important pour un peuple qui tenait l'étude des arts martiaux en haute estime.
- Source : Les Découvertes Archéologique
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditions, traditionalisme, japon, samourai, asie, castes guerrières |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 30 octobre 2013
Il diritto negato alla tradizione
Dopo quello che abbiamo definito il falso mito del diritto alla cultura, forse suscitando l’orrore di qualcuno, ci occupiamo dell’autentico mito di un diritto negato, un diritto che può avere diversi nomi ma che qui definiremo, semplicemente, diritto alla tradizione.
Hic et nunc il termine tradizione viene assunto nella sua pura semplicità che lo rimanda, direttamente, al patrimonio simbolico e culturale trasmesso di generazione in generazione. L’Italia è un Paese di tradizioni interrotte, di culture locali che in forza di una serie di con-cause hanno cessato di essere trasmesse di Padre in Figlio, di Madre in Figlia. I tratti comuni di queste culture erano l’oralità e il dialetto (lingue sì, ma non codificate e dunque legate al vitalismo delle comunutà parlanti), e tutte manifestavano sia lo scopo di produrre la massima autonomia del singolo nella sfera produttiva, sia la qualità che, curiosamente ma nemmeno troppo, Alan W. Watts assegna al Taoismo, l’antico sistema metafisico, etico e infine religioso della Cina, nel suo celebre lavoro “Il Tao. La via dell’acqua che scorre”: “L’antica filosofia del Tao segue in modo abile ed intelligente il corso, la corrente e le venature dei fenomeni naturali, considerando la vita umana come un’integrale caratteristica del processo del mondo”. Diversa, quindi, dalla scienza occidentale che “ha posto l’accento sull’atteggiamento di oggettività – un freddo, calcolatore e distaccato atteggiamento per mezzo del quale appare che i fenomeni naturali, incluso l’organismo umano, non sono altro che meccanismi”.
Le tradizioni interrotte d’Italia erano culture in cui la sapienza si scambiava con la saggezza, in un gioco caleidoscopico di empirismo, produzione fiabesca, pragmatismo, originalità. Erano, anche, confini difficilmente superabili dal Potere, persino da quello religioso che doveva, sovente, scendere a patti con le tradizioni pre-esistenti e con le credenze ataviche delle comunità. Erano veri e propri anticorpi sociali alle pretese di “dominio” che le istituzioni del tempo coltivavano nei confronti dei propri sottoposti, emblemi di un’alterità che tracciava una demarcazione netta tra chi esercitava il potere e chi poteva ribellarvisi.
Perché e come queste tradizioni sono state interrotte e rescisse? Chi o cosa minacciavano concretamente?
La loro eliminazione era naturaliter funzionale all’affermazione dello Stato nazionale, di quella moderna unità linguistica e storica che si affermò – ancorché incompiutamente – attraverso la scuola, la guerra e, infine, attraverso la televisione, lo strumento di comunicazione, manipolazione e persuasione più potente che sia mai apparso sulla scena della storia.
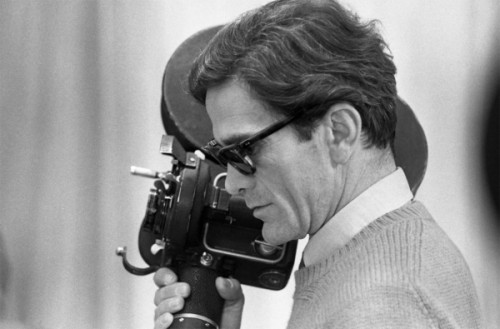
Il 9 dicembre 1973, dalle colonne del Corriere della Sera, Pier Paolo Pasolini lanciava uno storico monito dal carattere profetico: “Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è tale e incondizionata”. L’articolo prosegue: “Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – come dicevo – i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un “uomo che consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo”.
La soppressione delle culture popolari era anche un atavico obiettivo di coloro che professavano l’affermazione definitiva di una nuova fede, quella nella scienza. Oggi sappiamo, o dovremmo sapere, che nessuna verità scientifica è inconfutabile, che nulla di quanto è scientifico può non essere superato. Ciononostante, attribuiamo alla scienza un valore dogmatico. Ciononostante, abbiamo elevato la scienza a nuova religione, con i suoi riti, i suoi sacerdoti e i suoi anatemi, pagando questo scotto con la perdita di bio-diversità culturale, la disumanizzazione del lavoro, l’iper-medicalizzazione, il costante tentativo di superamento dell’ultima etica possibile, l’etica della vita o bio-etica.
Attraverso il mito della sapere scientifico, passate le co-scienze per la “spada” della televisione , siamo giunti a una nuova ortodossia del pensiero che ci avvolge da ogni lato, offrendoci risposte ma risparmiandoci domande: un nuovo totalitarismo a cui le tradizioni locali avrebbero contrapposto un anarco-liberismo del pensiero, basato sulla trasmissione “selvatica” di ciò che agli invidui spetta loro non in virtù di un inconsistente diritto sociale alla redistribuzione del reddito ma di un diritto naturale alla trasmissione di simboli – mai davvero assimilati alla cultura ufficiale, nemmeno da quella religiosa – e al loro recepimento.
Il processo di nazionalizzazione e costruzione della nazione, giustificato da un presunto “riscatto” delle masse dall’ignoranza da cui sarebbero state afflitte, si manifesta oggi come un processo di giustificazione dello Stato e dei processi persuasivi di potere, manipolazione e controllo sulle coscienze. Quanto poco efficace sia questo processo nel creare uomini liberi, lo testimonia l’analfabetismo di ritorno a cui la maggior parte della popolazione, dopo essere stata privata della sua iniziazione al sapere locale, viene condannata. Ma siamo sicuri che si tratti davvero di analfabetismo di ritorno, o forse l’unico alfabetismo che interessa alle istituzioni scolastiche è quello di instillare, nelle anime giovani, niente più che “Miti”, mere credenze e principi prodotti sotto l’egida della certezza scientifica e certificati dal complesso militare-industriale?
Può una società massificata, in cui il sapere e la cultura delle masse non sono argini all’esercizio del potere ma sue dirette emanazioni, essere davvero una società di uomini liberi?
00:05 Publié dans Philosophie, Terroirs et racines, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, pier paolo pasolini, pasolini, heimat, terroir, racines, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 octobre 2013
Remplacer les fêtes chrétiennes par Yom Kippour et l’Aïd

Remplacer les fêtes chrétiennes par Yom Kippour et l’Aïd : 80% des français disent non
Ex: http://zejournal.mobi
La France est un pays de culture et de tradition catholique, sous un régime républicain et démocratique. Je mérite sûrement la guillotine, bien affûtée, de la libre parole républicaine pour ces propos nauséabonds. Plus besoin de guillotine, elle est désormais implantée directement dans les âmes et consciences, et ce, dès l’enfance, grâce à la « ligne Buisson » de la laïcité de Vincent Peillon, et la pastorale républicaine qu’il met en place à l’école. Prochaine étape : la suppression des fêtes chrétiennes. On y vient très vite, on y est : une «sociologue» convertie à l’islam, membre de l’Observatoire de la laïcité, vient de proposer de remplacer deux fêtes chrétiennes par une fête juive et une fête musulmane…
L’Observatoire de la laïcité, organisme étatique dépendant directement du Premier Ministre de la République, a été créé en 2007, sûrement pour contrer, au moins en tant que « poudre aux yeux », la problématique du culte musulman au cœur du quotidien des citoyens. Aujourd’hui, au main des socialistes, cet observatoire devient très dangereux – comme pour nombre de lois prises sous la droite, que la droite applaudissait, et qu’elle se prend aujourd’hui en pleine poire. Dounia Bouzar, qui a été nommée dimanche à l’observatoire de la laïcité par le Premier ministre, qui est une anthropologue spécialiste du fait religieux, propose, dans un entretien à Challenges, de remplacer deux fêtes chrétiennes (au choix) par Yom Kippour et l’Aïd…
Cette experte, donc, nous informe que « la France a montré l’exemple de la laïcité au monde en instaurant la première la liberté de conscience » [sauf pour les pharmaciens ou les maires - ajout de l’ami Michel Janva]. Liberté de conscience, soit dit en passant, qui existait dès la grèce antique, sinon avant, et qui trouve d’ailleurs dans la théologie médiévale des arguments étayés. Il suffit d’ouvrir saint Thomas d’Aquin pour comprendre que l’homme créé à l’image de Dieu veut dire qu’il en est l’image en tant qu’il est libre, comme Lui, de ses actes et de ses pensées.
À la fin de cet entretien sur les cas posés par la problématique musulmane au travail et dans les cantines, le journaliste lui demande quand même s’il faut ajouter deux fêtes en plus ; et notre experte en laïcité de répondre : « le clergé y a longtemps été opposé mais il a évolué et n’y est plus hostile car il y a beaucoup de fêtes chrétiennes ». Il a « évolué ». Comprenez : le clergé sort enfin des siècles sombres, moyenâgeux et lugubres dans lesquels il était enfermé, et il en sort sous l’impulsion du « sens de l’histoire », qui file en droite ligne vers le Grand Soir socialiste, le paradis terrestre, enfin délivré de toute croyance et de toute vérité des cieux.
Et, comme toute histoire a ses prophètes, je vous en offre deux qui avait tout prévu : le prophète Jacques Attali disait déjà, en février 2003, qu’« il convient (…) d’enlever de notre société laïque les derniers restes de ses désignations d’origine religieuse. »… Pas mieux que l’autre prophète, Vincent Peillon, qui affirmait dans une vidéo de 2005 qu’il fallait détruire la religion catholique, pour imposer sa « religion laïque et républicaine » (l’équivalent, chez lui, de « socialiste »). L’enjeu, dit Peillon, est « de forger une religion qui soit non seulement, plus religieuse que le catholicisme dominant, mais qui ait davantage de force, de séduction, de persuasion et d’adhésion, que lui. ». La chose est claire ? Il parle exclusivement du catholicisme, et non des autres religions : la rivalité mimétique de la République et de l’Église, dès la Révolution française – qui n’est pas terminée, rappelons-le, est un combat, une guerre des religions qui est strictement polarisée par ces deux-là. L’islam est là de surcroit, comme un allié objectif de la République dans ce combat, quoi qu’on puisse en penser.
L’objectif est donc clairement de bâtir une société anti-chrétienne. Pourquoi autant de pessimisme et de fermeture, me direz-vous : l’espace social n’est-il pas le lieu de la « cohabitation des différences » et du « multiculturalisme » ? Oui, très bien, et alors il ne resterait qu’à nous, chrétiens, de convaincre les autres – sans pouvoir trop en parler publiquement, en se cachant dans les caves, en évitant d’être trop « visible », se faisant tout petit, et en n’intervenant surout pas dans les débats publics. Comment voulez qu’une lampe éclaire le monde si elle est placée sous la table ? Comment voulez-vous que l’avenir de la France se batisse sans son passé ? Comment voulez-vous construire une maison sans ses fondations ? Point n’est besoin de fondation, d’historicité et de continuité, puisque, dans leurs esprit peilloniens, tout commence par la Révolution, et tout finira avec la Révolution achevée : une Révolution, selon le grand-maître Peillon, qui est « un événement religieux », une « nouvelle genèse » un « nouveau commencement du monde », une « nouvelle espérance », une « incarnation théologico-politique », qu’il faut porter à son terme, à savoir : « la transformation socialiste et progressiste de la société toute entière » (La révolution française n’est pas terminée, p. 195).
« c’est encore une religion, sinon une certaine forme de religiosité, qui est encore à l’œuvre dans ce médiocre spectacle dit laïque »
Que les musulmans (et les juifs) ne se réjouissent donc pas trop vite : ils sont aujourd’hui les idiots utiles de la République, plus que les alliés objectifs. Une République qui se sert de l’islam, à sa droite, et du « multiculturalisme », à sa gauche, pour imposer sa propre religion, mais qui veut les fendre toutes, et, au premier chef, l’Église, dont elle est depuis le début la copie mondaine et le décalque horizontal. Elle veut et n’existe que pour s’imposer elle-même comme religiosité, et, grâce à Vincent Peillon, dont on peut reconnaître, au moins, la franchise, cela est rendu public. Oui il faudra répandre la bonne parole, selon le rapport de l’Observatoire de la laïcité remis le 25 juin au Premier ministre : « favoriser la diffusion de guides de la laïcité dans les municipalités, hopitaux, maternité, entreprises privées », « inventer une charte laïque » ou encore « enseigner la morale laïque à l’école » (p. 4), tout cela en s’appuyant « sur la lutte contre toutes les discriminations économiques, sociales, urbaines ». L’homme nouveau, républicain et socialiste, ouvert à tout sans n’être à rien, subissant toutes les cultures du monde sans avoir le droit à la sienne, étant partout « chez autrui » plutôt que « chez lui », sera lisse et livide, sans visage et sans porosité, homme relatif et relativiste, où tout se vaut, dans une angoisse permanente et suffoquante. Rien à quoi se rattacher. Sinon à la République laïque et socialiste qui est là, et qui tend les bras.
Oui, c’est encore une religion, sinon une certaine forme de religiosité, qui est encore à l’œuvre dans ce médiocre spectacle dit « laïque ». Les petits rituels narcissiques, ludiques ou névrotiques de l’homo festivus sont désormais les grandes-messes du monde post-moderne, avec leurs prêtres, leurs thuriféraires, leurs porte-croix, leurs fêtes de Bacchus, leurs processions infâmes et leurs vêpres télévisuelles débilisantes. Et les sermons servis au cours de ces messes profanes sont d’une violence inouïe pour toute personne attachée à la continuité, la verticalité, la transcendance et le sérieux de la vie en société. Chrétiens, vous n’êtes pas les bienvenues : vous représentez le passé, le mur, l’échaffaud sur lequel, certes – et encore ! – on a bâti la civilisation, mais qu’il faut désormais rejeter. Place aux autres, à tout le monde, sauf à vous, déchets moyenâgeux.
- Faites donc une « croix » sur deux fêtes (au choix, mais ne rêvez pas trop pour un réferundum) :
Lundi de Pâques (21 avril pour 2014)
Jeudi de l’Ascension (29 mai pour 2014)
Lundi de Pentecôte (9 juin pour 2014)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Noël (25 décembre)
Puis tournez-vous vers le dieu républicain, ses valeurs « humanistes » et immanentes, cette « transcendance flottante », cette réduction anthropologique, gage de paix, de sérénité, et surtout, comme nous le voyons tous les jours dans notre société, de beau, de vrai et de bien. Amen.
- Source : Nouvelles de France
00:07 Publié dans Actualité, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fêtes chrétiennes, fêtes musulmanes, fêtes juives, yom kippour, aïd el kebir, traditions, actualité, fête du mouton |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 octobre 2013
Niet Piet maar de Sint is het probleem

Ex: http://visionairbelgie.wordpress.com/2013/10/24/piet/
Niet Piet maar de Sint is het probleem
Shepherd
Nog maar net is het stofwolkje rond mijn kritiek op het moraalridderdom van de humanitaire gemeenschap gaan liggen, of daar komt mevrouw Verene Shepherd met een heuse VN-delegatie naar Nederland (dus niet naar België of waar dan ook, maar het vrijdenkende Holland) om te onderzoeken of die Zwarte Piet wel geen vermomde Surinaamse slaaf zou kunnen zijn.
Ik kan haar bij voorbaat gerust stellen: neen, Piet is geen Creool uit de omstreken van Paramaribo, de Hollanders zullen op een andere manier met hun koloniaal verleden moeten klaarkomen.
Wel stuitend is deze nieuwe opstoot van mondiale political correctness en mensenrechterlijke haarklieverij. Niet dus tegenover het Indische kastensysteem dat nog steeds zeer verbreid is. Niet tegen de vaginale verminking wereldwijd of de kinderarbeid of de slavernij van vandaag, of de onthoofding van homo’s in
Saudi-Arabië, of het heksengeloof dat in Afrika nog altijd vrouwen en kinderen letterlijk de woestijn in drijft. Maar dus wel tegen de 6 december-folklore waar trouwens geen enkel kind nog in gelooft, al doen ze alsof om hun ouders een goed gevoel te geven.
Afbleekmiddel
Om die Hollandse pietenhysterie te duiden, ondertussen goed voor anderhalf miljoen FaceOdinbooklikes, is het goed om even de herkomst van de traditie op te frissen. En het gaat wel degelijk over kleuren. De Christelijke Klaasfiguur is gebaseerd op de legendes rond de semi-fictieve Nicolaas van Myra, een bisschop die in de 4de eeuw zou geleefd hebben, en vooral gereputeerd was als helper-in-nood voor onbemiddelde meisjes die in de prostitutie dreigen verzeild te geraken (belangrijk voor het vervolg van ons verhaal).
De Zwarte Piet is een ander verhaal, of toch weer niet. De andere, heidense Nicolaas, die men omwille van de zieltjeswinnerij vermengde met de Christelijke versie, is namelijk een gedaante van de Germaanse oppergod Wotan, een nachtridder die met zijn achtpotige Sleipnir vooral in de twaalf donkerste dagen van het jaar de buurt onveilig maakte en in ruil voor bescherming loon-in-natura eiste. Geen gever dus, maar een nemer.
Probleem voor de Christelijke iconologie: na de nuttige vermenging van de twee klazen moest dat zwart-maffieus tintje er wel terug uit, teneinde weer een proper, deugdelijk afkooksel te bekomen dat zonder problemen in de Biblioteca Sanctorum paste.
En zo ontstond het olijke duo van de bebaarde Goedheilige Man alias de gecastreerde Wotan, en zijn donkerhuidige dommekracht, in Vlaanderen nog steeds Nicodemus genoemd. In de Angelsaksische wereld heeft men alleen Santa Claus overgehouden en de Piet zedigheidshalve gedumpt. Maar het lijdt geen twijfel: Pieterman is een afsplitsel van Sinterklaas zelf, en herinnert aan de fratsen van de seksbeluste Wotanfiguur. Mevrouw Shepherd wil dus eigenlijk de geamputeerde penis (de roe) van de weldoener op sterk water. Gevaarlijk werk voor meisjes, me dunkt.
Kinderlokker en meisjesgek
Zo zijn we direct waar we moeten wezen: niet de zwartheid van Piet is het probleem, mKlaasaar wel de witter-dan-witheid van Klaas, wiens schijnvroomheid veel stof tot contestatie biedt, zonder dat men er het racisme hoeft bij te sleuren. Er zijn m.a.w. een boel redenen om dat Klaasgedoe eens door de mangel te draaien, zomaar, zonder tussenkomst van de Verenigde Naties.
Vooreerst is het stuitend dat dit icoon van de Christelijke caritas altijd al een conservatieve functie heeft gehad: hij moest de rijken aanzetten tot vrijgevigheid, in hun eigen belang, opdat de armen niet opstandig zouden worden. In de 19de eeuw zou die meritocratische achtergrond absoluut primeren: wie rijk is, heeft dat ook verdiend, en wie arm is al evenzeer. De schoentjes van de deugdzamen worden het best gevuld, omdat ze hun mérites voor deze maatschappij bewezen hebben. De anderen moeten maar wat harder werken, eventueel aangespoord door de roe.
Vandaag stoort mij vooral de permanente ongelijkheid in het Sinterklaasverhaal, de afzichtelijke commercialisering van het ritueel, en het feit dat de vrijgevigheid van de Sint, als PR-man van de speelgoedindustrie, vooral met de draagkracht van de ouderlijke beurs is verbonden. Er zij dus kinderen die gewoon niks krijgen, nada, noppes, met de impliciete motivatie dat het met hun slecht gedrag te maken heeft. Ze zijn zwart, gebrandmerkt, veel meer dan de geschminkte Piet.
Terecht geven kinderen bij dit vertoon hun eigen onschuld maar wat graag op. Het zijn uiteindelijk zij die de Sint wandelen moeten sturen, als een verhaal vol ranzige kantjes.
In een bredere context is de link tussen braafheid en giften krijgen ronduit ranzig. Het creëert afhankelijkheid én onderdanigheid. Het maakt van de Sint een usurpator en kinderlokker, wat hij eigenlijk altijd al was. Zijn voorkeur voor jonge meisjes –liefst arm, die zijn gewilliger- is een rode draad in alle Sintlegendes, ook de Christelijke. Zijn Piet hangt er niet zo maar bij, maar is een wezenlijk onderdeel van een seksuele toeëigening die als dusdanig niet herkend wordt, juist door de tweeledigheid, de scheiding tussen wit en zwart.
Dat Pietencirkus dient dus vooral om de aandacht van de handen van de goedgeilige man zelf af te leiden. Men kan er nochtans moeilijk naast kijken, als buitenstaander. Altijd weer die kindjes op schoot, hun gekrijs omdat ze voelen dat er iets niet klopt, de witte handschoenen, het gefriemel en gefezel in het rode pluche, het grote zondenboek, de geënsceneerde aankomst per boot, het debiel-vrolijke geneuzel van Bart Peeters er rond (“Piet is zwart vanwege de schoorsteen”), de verhullende witte baard waarboven toch de uitpuilende ogen hangen van Jan Decleir, de belachelijke leugens en het gemonkel van de volwassenen,- heel dat ziekelijk vertoon is een beschaving onwaardig.
Terecht geven kinderen bij dit vertoon hun eigen onschuld maar wat graag op. Het zijn uiteindelijk zij die de Sint wandelen moeten sturen. De twaalfjarige Mozart voerde de dubieuze weldoener al ten tonele in zijn opera “Bastien und Bastienne”, gebaseerd op J.J. Rousseau’s “Le devin du village”, waar hij als Colas het herderinnetje Bastienne belooft om te bemiddelen in een ruzie met haar vriendje, maar eigenlijk zichzelf opdringt als meester en inwijder.
Sint-killer
Terug naar de negritude. Op 30 juni 1960 hield Patrice Lumumba, de eerste premier van hlumumba_speechet onafhankelijke Congo, een vlijmscherpe, niet-aangekondigde speech tegen de wandaden van de Belgische weldoener en kolonisator. Koning Boudewijn zat op de eerst rij en keerde in koude razernij huiswaarts. Het heeft toen niet veel gescheeld of Zwarte Piet werd verboden in het Koninkrijk België. Gelukkig spaarde onze diepbetreurde vorst zijn roe en gaf de opdracht om Lumumba zelf te liquideren, letterlijk: hij werd geëxecuteerd en zijn lijk opgelost in zwavelzuur. De weg voor de corrupte Joseph Mobutu lag open. De rol van de CIA, de Britse geheime dienst én het Belgische hof is in deze ondertussen historisch uitgeklaard, België bood in 2002 zelfs excuses aan. Case closed… of toch niet?
De reden waarom wij in Vlaanderen geen zin hebben om Piet te bannen, is nu net zijn subversieve betekenis. Nog altijd is een zwarte bij ons niet alleen een neger, maar het wijst tegelijk op een politiek-foute paria, iemand die men geen hand geeft zonder de handen nadien te wassen. Meteen blijkt, hoe die mevrouw Shepherd eigenlijk het omgekeerde doet van wat ze voorwendt: ze elimineert de zwarte, waarna de witte als Santa Claus het rijk voor zich alleen heeft. Vreemd geval van zelfhaat.
De reden waarom wij in Vlaanderen geen zin hebben om Piet te bannen, is nu net de dreiging die hij uitstraalt tegenover de witte weldoener.
Want in hun coëxistentie zit net de mogelijkheid van een omslag. Op elk moment kan de knecht de meester van het dak gooien of in de haard verbranden, dat gevaar is inherent aan hun relatie. Het is voor mij ook het enige motief om de doodsstrijd van Nicolaas te rekken en te wachten tot hét gebeurt: het exploot van de Sint-killer. Wat Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) al omschreef als de meester-knecht-dialectiek, nl. het feit dat gezagsrelaties altijd labiel zijn omdat de meerdere de mindere nodig heeft om zijn macht te bevestigen, bevat de dreiging van een grote vadermoord. Nicodemus alias Lumumba zal dan, zelfs als hij daarvoor achteraf wordt terecht gesteld, blijven spoken in de speelgoedwinkel en de dromen van de machthebbers teisteren.
Zwarte poes
Laten we voor de rest niet vergeten dat dit een verschrikkelijke mannenzaak is, van in de oorsprong. Na de moord op Klaas lijkt me een nieuw element van verering op zijn plaats, als we in deze donkere tijden toch moeten wegdromen: geen Zwarte Piet maar Zwarte Poes, het vrouwelijk geslacht dat als een origine du monde geeft zonder te nemen, zonder voorwaarden te stellen, zonder gehoorzaamheid te eisen, genereus en absoluut. Geen pietenschmink maar echte, diepe negritude met een matriarchale inslag. Verene Shepherd zou er best voor kunnen doorgaan, als ze toch maar die bedillerige en rancuneuze zwavelzuurtoon achterwege kon laten die ze, dat weet ik heel zeker, in het blanke maatpakkenuniversum heeft opgelopen.
00:05 Publié dans Actualité, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, saint nicolas, père fouettard, zwarte piet, sinterkallas, pays-bas, flandre, folklore |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 octobre 2013
La era de la ginecocracia
por Evgueni Golovín*
Ex: http://paginatransversal.wordpress.com
 Muchos libros en nuestro siglo se han escrito sobre la visión del mundo femenina, sobre la psicología femenina y el erotismo femenino. Muy pocos fueron escritos sobre los hombres. Y estos pocos estudios dejan una impresión bastante desoladora. Dos de ellos, escritos por conocidos sociólogos son especialmente sombríos: Paul Duval – “Hombres. El sexo en vías de extinción”, David Riseman – “El mito del hombre en América”. La multitud masculina de rostros variopintos no inspira optimismo. Al contemplar a la multitud masculina uno se entristece: “él”, “ello”, “ellos”… con sus discretos trajes, corbatas mal atadas… sus estereotipados movimientos y gestos están sometidos a la fatal estrategia de la más pulcra pesadilla. Tienen prisa porque “están ocupados”. ¿Ocupados en qué? En conseguir el dinero para sus hembras y los pequeños vampiros que están creciendo.
Muchos libros en nuestro siglo se han escrito sobre la visión del mundo femenina, sobre la psicología femenina y el erotismo femenino. Muy pocos fueron escritos sobre los hombres. Y estos pocos estudios dejan una impresión bastante desoladora. Dos de ellos, escritos por conocidos sociólogos son especialmente sombríos: Paul Duval – “Hombres. El sexo en vías de extinción”, David Riseman – “El mito del hombre en América”. La multitud masculina de rostros variopintos no inspira optimismo. Al contemplar a la multitud masculina uno se entristece: “él”, “ello”, “ellos”… con sus discretos trajes, corbatas mal atadas… sus estereotipados movimientos y gestos están sometidos a la fatal estrategia de la más pulcra pesadilla. Tienen prisa porque “están ocupados”. ¿Ocupados en qué? En conseguir el dinero para sus hembras y los pequeños vampiros que están creciendo.
Son cobardes y por eso les gusta juntarse en manadas. Si prescindimos de las refinadas divagaciones, la cobardía no es más que una tendencia centrípeta, deseo de encontrar un centro seguro y estable. Los hombres tienen miedo de sus propias ideas, de los bandidos, de los jefes, de “la opinión pública”, de las arañas que se chupan el dinero y que lo dan. Pero las mujeres son las que más miedo les dan. “Ella” camina multicolor y bien centrada, su pecho vibra tentadoramente… y los ansiosos ojos siguen sus curvas, y la carne se rebela dolorosamente. Su frialdad – qué desgracia, su compasión erótica – ¡qué felicidad! “Ella” es la materia formada de manera atrayente en este mundo material, en el que vivimos solo una vez, “ella” – es una idea, un ídolo, sus emergentes encantos saltan de los carteles, portadas de revistas y pantallas. “Ella” es un bien concreto. El cuerpo femenino bonito cuesta caro, tal vez más barato que “La maja desnuda” de Goya, pero hay que pagarlo. Una prostituta cobra por horas, la amante o la esposa, naturalmente, piden mucho más. El lema del matrimonio estadounidense es sex for support. Las puertas del paraíso sexual se abren con la llavecita de oro. El cuerpo masculino sin cualificar y sin muscular no vale nada.
La realidad de la civilización burguesa
Aunque nos acusen de cargar las tintas, la situación sigue siendo triste. La igualdad, emancipación, feminismo son los síntomas del creciente dominio femenino, porque la “igualdad de los sexos” no es más que otro fantasma demagógico de turno. El hombre y la mujer debido a la marcada diferencia de su orientación están luchando permanentemente de forma abierta o encubierta, y el carácter del ciclo histórico-social depende del dominio de uno u otro sexo. El hombre por naturaleza es centrípeto, se mueve de izquierda a derecha, hacia adelante, de abajo a arriba. En la mujer es todo al revés. El impulso “puramente masculino” es entregar y apartar, el impulso “puramente femenino” es quitar y conservar. Claro que se trata de impulsos muy esquemáticos, porque cada ser en mayor o menor medida es andrógino, pero está claro que de la ordenación y armonización de estos impulsos depende el bienestar del individuo en particular y de la sociedad en su conjunto, pero semejante armonía es imposible sin la activa irracionalidad del eje del ser, convencimiento intuitivo de la certeza del sistema de valores propios, la instintiva fe en lo acertado del camino propio. De otro modo la energía centrípeta o destrozará al hombre, o le obligará a buscar algún centro y punto de aplicación de sus fuerzas en el mundo exterior. Lo cual lleva a la destrucción de la individualidad y a la total pérdida de control del principio masculino propio. La energía erótica en vez de activar y templar el cuerpo, como ocurre en un organismo normal, comienza a dictar al cuerpo sus propias condiciones vitales.
La androginia del ser está provocada por la presencia femenina en la estructura psicosomática masculina. La “mujer oculta” se manifiesta en el nivel anímico y espiritual como el principio regulador que sujeta o el ideal estrellado del “cielo interior”. El hombre debe mantener la fidelidad hacia esta “bella dama”, la aventura amorosa es la búsqueda de su equivalente terrenal. En el caso contrario estará cometiendo una infidelidad cardinal, existencial.
¿Pero de qué estamos hablando?
Del amor.
La mayoría de los hombres actuales pensarán que se trata de tonterías románticas, que solo valen cuando se habla de los trovadores y caballeros. Oigan, nos dirán, todos nosotros – mujeres y hombres – vivimos en un mundo cruel y tecnificado en condiciones de lucha y competencia. Todos por igual dependemos de estas duras realidades, y en este sentido se puede hablar de la igualdad de los sexos. En cuanto a la dependencia del sexo, sabrá que en todos los tiempos ha habido obsesos y erotómanos. En efecto, las mujeres ahora juegan mucho mayor papel, pero no es suficiente para hablar de no se sabe qué “matriarcado”.
Ciertamente, no se puede hablar del “matriarcado” en la actualidad en el sentido estricto. Según Bachofen, el matriarcado es más bien un concepto jurídico, relacionado con el “derecho de las madres”. Pero perfectamente podemos ocuparnos de la ginecocracia, del dominio de la mujer, debido a la orientación eminentemente femenina de la Historia Moderna. Aquí está la definición de Bachofen:
“El ser ginecocrático es el naturalismo ordenado, el predominio de lo material, la supremacía del desarrollo físico”
J.J. Bachofen. Mutterrecht, 1926, p. 118
Nadie podrá negar el éxito de la Época Moderna en este sentido. A lo largo de los últimos dos siglos en la psicología humana se ha producido un cambio fundamental. De entrada a la naturaleza masculina le son antipáticas las categorías existenciales tales como “la propiedad” y el tiempo en el sentido de “duración”. El carácter centrípeto, explosivo del falicismo exige instantes y “segundos” que están fuera de la “duración”, que no se componen en “duración”. El destino ideal del hombre es avanzar hacia adelante, superar la pesadez terrenal, buscar y conquistar nuevos horizontes del ser, despreciando su vida, si por vida se entiende la existencia homogénea, rutinaria, prolongada en el tiempo. Los valores masculinos son el desinterés, la bondad, el honor, la interpretación celestial de la belleza. Desde este punto de vista, “Lord Jim” de Joseph Conrad es casi la última novela europea sobre un “hombre de verdad”. Jim, simple marinero, ofendido en su honor, no lo puede perdonar, ni superar. Por eso el autor le concedió el título, porque el honor es el privilegio y el valor de la nobleza. El justo y el caballero errante son los auténticos hombres.
Podrán replicar: si todos se ponen a hacer de Quijote o a hablar con los pájaros ¿en qué se convertirá la sociedad humana? Es difícil contestar a esta pregunta, pero es fácil observar en qué se convertiría dicha sociedad sin San Francisco y sin Don Quijote. Don Quijote es mucho más necesario para la sociedad que una docena de consorcios automovilísticos.
La civilización burguesa es medio civilización, es un sinsentido. Para crear la civilización hacen falta los esfuerzos conjuntos de los cuatro estamentos.
Decimos: centralización, centrípeto. Sin embargo no es nada fácil definir el concepto “centro”. El centro puede ser estático o errante, manifestado o no, se puede amarlo u odiarlo, se puede saber de él, o sospechar, o presentirlo con la sutilísima y engañosa antena de la intuición. Es posible haber vivido la vida sin tener ni idea acerca del centro de la existencia propia. Se trata del paradójico e inmóvil móvil de Aristóteles. En el centro coinciden las fuerzas centrífugas y las centrípetas. Cuando una de ellas apaga a la otra el sistema o explota o se detiene en una muerte gélida. Es evidente: lo incognoscible del centro garantiza su centralidad, porque el centro percibido y explicado siempre se arriesga a trasladarse hacia la periferia. De ahí la conclusión: el centro permanente no se puede conocer, hay que creer en él. Por eso Dios, honor, bien, belleza son centros permanentes. Es la condición principal de la actividad masculina dirigida, radial.
En los dos primeros estamentos – el sacerdotal y el de la nobleza – la actividad masculina, entendida de esta forma, domina sobre la femenina. Y únicamente con la posición normal, es decir alta, de estos estamentos se crea la civilización, en todo caso la civilización patriarcal. El burgués reconoce los valores ideales nominalmente, pero prefiere las virtudes más prácticas: el honor se sustituye por la honradez, la justicia por la decencia, el valor por el riesgo razonable. En el burgués la energía centrífuga está sometida a la centrípeta, pero el centro no se encuentra dentro de la esfera de su individualidad, el centro hay que afirmarlo en algún lugar del mundo exterior para convertirse en su satélite. La tendencia de “entregar y apartar” en este caso es posible como una maniobra táctica de la tendencia de “quitar, conservar, adquirir, aumentar”.
Después de la revolución burguesa francesa y la fundación de los estados unidos norteamericanos vino el derrumbe definitivo de la civilización patriarcal. La rebelión de La Vendée, seguramente, fue la última llamarada del fuego sagrado. En el siglo XIX el principio masculino se desperdigó por el mundo orientado hacia lo material, haciéndose notar en el dandismo, en las corrientes artísticas, en el pensamiento filosófico independiente, en las aventuras de los exploradores de los países desconocidos. Pero sus representantes, naturalmente, no podían detener el progreso positivista. La sociedad expresaba la admiración por sus libros, cuadros y hazañas, pero los veía con bastante suspicacia. Marx y Freud contribuyeron bastante al triunfo de la ginecocracia materialista. El primero proclamó la tendencia al bienestar económico como la principal fuerza motriz de la historia, mientras que el segundo expresó la duda global acerca de la salud psíquica de aquellas personas, cuyos intereses espirituales no sirven al “bien común”. Los portadores del auténtico principio masculino paulatinamente se convirtieron en los “hombres sobrantes” al estilo de algunos protagonistas de la literatura rusa. “Wozu ein Dichter?” (¿Para qué el poeta?) – preguntaba Hölderlin con ironía todavía a principios del siglo XIX. Ciertamente ¿para qué hacen falta en una sociedad pragmática los soñadores, los inventores de espejismos, de las doctrinas peligrosas y demás maestros de la presencia inquietante? Gotfied Benn reflejó la situación con exactitud en su maravilloso ensayo “Palas Atenea”:
“… representantes de un sexo que se está muriendo, útiles tan solo en su calidad de copartícipes en la apertura de las puertas del nacimiento… Ellos intentan conquistar la autonomía con sus sistemas, sus ilusiones negativas o contradictorias – todos estos lamas, budas, reyes divinos, santos y salvadores, quienes en realidad nunca han salvado a nadie, ni a nada – todos estos hombres trágicos, solitarios, ajenos a lo material, sordos ante la secreta llamada de la madre-tierra, lúgubres caminantes… En los estados de alta organización social, en los estados de duras alas, donde todo acaba en la normalidad con el apareamiento, los odian y toleran tan solo hasta que llegue el momento”.
Los estados de los insectos, sociedades de abejas y termitas están perfectamente organizados para los seres que “solo viven una vez”. La civilización occidental muy exitosamente se dirige hacia semejante orden ideal y en este sentido representa un episodio bastante raro en la historia. Es difícil encontrar en el pasado abarcable una formación humana, afianzada sobre las bases del ateísmo y una construcción estrictamente material del universo. Aquí no importa qué es lo que se coloca exactamente como la piedra angular: el materialismo vulgar o el materialismo dialéctico o los procesos microfísicos paradójicos. Cuando la religión se reduce al moralismo, cuando la alegría del ser se reduce a una decena de primitivos “placeres”, por los que además hay que pagar ni se sabe cuánto, cuando la muerte física aparece como “el final del todo” ¿acaso se puede hablar del impulso irracional y de la sublimación? Por eso en los años veinte Max Scheler ha desarrollado su conocida tesis sobre la “resublimación” como una de las principales tendencias del siglo. Según Scheler la joven generación ya no desea, a la manera de sus padres y abuelos, gastar las fuerzas en las improductivas búsquedas del absoluto: continuas especulaciones intelectuales exigen demasiada energía vital, que es mucho más práctico utilizar para la mejora de las condiciones concretas corporales, financieras y demás. Los hombres actuales ansían la ingenuidad, despreocupación, deporte, desean prolongar la juventud. El famoso filósofo Scheler, al parecer, saludaba semejante tendencia. ¡Si viera en lo que se ha convertido ahora este joven y empeñado en rejuvenecerse rebaño y de paso contemplara en lo que se ha convertido el deporte y otros entretenimientos saludables!
Y además.
¿Acaso la sublimación se reduce a las especulaciones intelectuales? ¿Acaso el impulso hacia adelante y hacia lo alto se reduce a los saltos de longitud y de altitud? La sublimación no se realiza en los minutos del buen estado de humor y no se acaba con la flojera. Tampoco es el éxtasis. Es un trabajo permanente y dinámico del alma para ampliar la percepción y transformar el cuerpo, es el conocimiento del mundo y de los mundos, atormentado aprendizaje del alpinismo celestial. Y además se trata de un proceso natural.
Si un hombre tiene miedo, rehúye o ni siquiera reconoce la llamada de la sublimación, es que, propiamente, no puede llamarse hombre, es decir un ser con un sistema irracional de valores marcadamente pronunciado. Incluso con la barba canosa o los bíceps imponentes seguirá siendo un niño, que depende totalmente de los caprichos de la “gran madre”. Obligando el espíritu a resolver los problemas pragmáticos, agotando el alma con la vanidad y la lascivia, siempre se arrastrará hasta sus rodillas buscando la consolación, los ánimos y el cariño.
Pero la “gran madre” no es en absoluto la amorosa Eva patriarcal, carne de la carne del hombre, es la siniestra creación de la eterna oscuridad, pariente próxima del caos primordial, no creado: bajo el nombre de Afrodita Pandemos envenena la sangre masculina con la pesadilla sexual, con el nombre de Cibeles le amenaza con la castración, la locura y le arrastra al suicidio. Algunos se preguntarán ¿qué relación tiene toda esta mitología con el conocimiento racional y ateísta? La más directa. El ateísmo no es más que una forma de teología negativa, asimilada de manera poco crítica o incluso inconsciente. El ateo cree ingenuamente en el poder total de la razón como instrumento fálico, capaz de penetrar hasta donde se quiera en las profundidades de la “madre-naturaleza”. Sucesivamente admirando la “sorprendente armonía que reina en la naturaleza” e indignándose ante las “fuerzas elementales, ciegas de la naturaleza” es como un niño mimado que quiere recibir de ella todo sin dar nada a cambio. Aunque últimamente, asustado ante las catástrofes ecológicas y la perspectiva de ser trasladado en un futuro próximo a las hospitalarias superficies de otros planetas, apela a la compasión y el humanismo.
Pero el “sol de la razón” no es más que el fuego fatuo del pantano y el instrumento fálico no es más que un juguete en las depredadoras manos de la “gran madre”. No se debe acercar al principio femenino que crea y que también mata con la misma intensidad. “Dama Natura” exige mantener la distancia y la veneración. Lo entendían bien nuestros patriarcales antepasados, teniendo cuidado de no inventar el automóvil, ni la bomba atómica, que ponían en los caminos la imagen del dios Término y escribían en las columnas de Hércules “non plus ultra”.
El espíritu se despierta en el hombre bruscamente y este proceso es duro, – esta es la tesis principal de Erich Neumann, un original seguidor de Jung, en su “Historia de la aparición de la conciencia”. El mundo orientado ginecocráticamente odia estas manifestaciones y procura acabar con ellas utilizando diferentes métodos. Lo que en la época moderna se entiende por “espiritualidad”, destaca por sus características específicamente femeninas: hacen falta memoria, erudición, conocimientos serios, profundos, un estudio pormenorizado del material – en una palabra, todo lo que se puede conseguir en las bibliotecas, archivos, museos, donde, cual si fuera el baúl de la vieja, se guardan todas las bagatelas. Si alguien se rebela contra semejante espiritualidad, siempre podrán acusarlo de ligereza, superficialidad, diletantismo, aventurerismo – características esencialmente masculinas. De aquí los degradantes compromisos y el miedo del individuo ante las leyes ginecocráticas del mundo exterior, que la psicología profunda en general y Erich Neumann en particular denominan el “miedo ante la castración”. “Tendencia a resistir, – escribe Erich Neumann, – el miedo ante la “gran madre”, miedo ante la castración son los primeros síntomas del rumbo centrípeto tomado y de la autoformación”. Y continúa:
“La superación del miedo ante la castración es el primer éxito en la superación del dominio de la materia”.
Erich Neumann. Urspruggeschichte des Bewusstseins, Munchen, 1975, p. 83
Ahora, en la era de la ginecocracia, semejante concepción constituye en verdad un acto heroico. Pero el “auténtico hombre” no tiene otro camino. Leamos unas líneas de Gotfried Benn del ya citado ensayo:
“De los procesos históricos y materiales sin sentido surge la nueva realidad, creada por la exigencia del paradigma eidético, segunda realidad, elaborada por la acción de la decisión intelectual. No existe el camino de retorno. Rezos a Ishtar, retournons a la grand mere, invocaciones al reino de la madre, entronización de Gretchen sobre Nietzsche – todo es inútil: no volveremos al estado natural”.
¿Es así?
Por un lado: conocimiento dulce, embriagador: sus vibraciones, movimientos gráciles, zonas erógenas… paraíso sexual.
Por el otro:
“Atenas, nacida de la sien de Zeus, de ojos azules, resplandeciente armadura, diosa nacida sin madre. Palas – la alegría del combate y la destrucción, cabeza de Medusa en su escudo, sobre su cabeza el lúgubre pájaro nocturno; retrocede un poco y de golpe levanta la gigantesca piedra que servía de linde – contra Marte, quien está del lado de Troya, de Helena… Palas, siempre con su casco, no fecundada, diosa sin hijos, fría y solitaria”.
1 de enero de 1999.
* Evgueni Golovín (1938-2010) fue un genio inclasificable. Situado completamente fuera del mundo actual, cuya legitimidad rechazaba de plano. “Quien camina contra el día no debe temer a la noche” – era su lema vital. Profundo conocedor de alquimia y de tradición hermética europea, también era especialista en los “autores malditos” franceses, románticos y expresionistas alemanes, traductor de libros de escritores europeos cuya obra está catalogada como “de la presencia inquietante”. Su identificación con el mundo pagano griego llegó al punto de que algunos que le conocieron íntimamente llegaron a definirlo como “Divinidad” (para empezar por el principio, Golovín aprendió el griego a los 16 años y comenzó con la lectura de Homero). En los años 60 del siglo pasado se convirtió en la figura más carismática de la llamada “clandestinidad mística moscovita”, conocido como “Almirante” (de la flotilla hermética, formada por los “místicos”). Fue el primero en la URSS en difundir la obra de autores tradicionalistas como Guénon y Évola. Ya en los años 90 y 2000 redactó la revista Splendor Solis, publicó varios libros y una recopilación de sus poemas. Veía con recelo las doctrinas orientales que consideraba poco adecuadas para el hombre europeo. Y, sobre todo, nunca buscó el centro de gravedad del ser en el mundo exterior. En su “navegación” sin fin siempre se mantuvo firmemente anclado a su interiore terra. El encuentro con Evgueni Golovín, en distintas etapas de sus vidas, fue decisivo para la formación de futuras figuras clave en la vida intelectual rusa como Geidar Dzhemal o
Alexandr Duguin
24/08/2012
Fuente: Poistine.com
(Traducido del ruso por Arturo Marián Llanos)
00:05 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : evgueni golovin, russie, littérature, littérature russe, lettres, lettres russes, traditions, gynécocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 13 octobre 2013
Living in Accordance with Our Tradition
Living in Accordance with Our Tradition
By Dominique Venner
Ex: http://www.counter-currents.com
Every great people own a primordial tradition that is different from all the others. It is the past and the future, the world of the depths, the bedrock that supports, the source from which one may draw as one sees fit. It is the stable axis at the center of the turning wheel of change. As Hannah Arendt put it, it is the “authority that chooses and names, transmits and conserves, indicates where the treasures are to be found and what their value is.”
This dynamic conception of tradition is different from the Guénonian notion of a single, universal and hermetic tradition, which is supposedly common to all peoples and all times, and which originates in a revelation from an unidentified “beyond.” That such an idea is decidedly a-historical has not bothered its theoreticians. In their view, the world and history, for three or for thousand years, is no more than a regression, a fatal involution, the negation of of the world of what they call “tradition,” that of a golden age inspired by the Vedic and Hesiodic cosmologies. One must admit that the anti-materialism of this school is stimulating. On the other hand, its syncretism is ambiguous, to the point of leading some of its adepts, and not the least of them, to convert to Islam. Moreover, its critique of modernity has only lead to an admission of impotence. Unable to go beyond an often legitimate critique and propose an alternative way of life, the traditionalist school has taken refuge in an eschatological waiting for catastrophe.[1]
That which is thinking of a high standard in Guénon or Evola, sometimes turns into sterile rhetoric among their disciples.[2] Whatever reservations we may have with regard to the Evola’s claims, we will always be indebted to him for having forcefully shown, in his work, that beyond all specific religious references, there is a spiritual path of tradition that is opposed to the materialism of which the Enlightenment was an expression. Evola was not only a creative thinker, he also proved, in his own life, the heroic values that he had developed in his work.
In order to avoid all confusion with the ordinary meaning of the old traditionalisms, however respectable they might be, we suggest a neologism, that of “traditionism.”
For Europeans, as for other peoples, the authentic tradition can only be their own. That is the tradition that opposes nihilism through the return to the sources specific to the European ancestral soul. Contrary to materialism, tradition does not explain the higher through the lower, ethics through heredity, politics through interests, love through sexuality. However, heredity has its part in ethics and culture, interest has its part in politics, and sexuality has its part in love. However, tradition orders them in a hierarchy. It constructs personal and collective existence from above to below. As in the allegory in Plato’s Timaeus, the sovereign spirit, relying on the courage of the heart, commands the appetites. But that does not mean that the spirit and the body can be separated. In the same way, authentic love is at once a communion of souls and a carnal harmony.
Tradition is not an idea. It is a way of being and of living, in accordance with the Timaeus’ precept that “the goal of human life is to establish order and harmony in one’s body and one’s soul, in the image of the order of the cosmos.” Which means that life is a path towards this goal.
In the future, the desire to live in accordance with our tradition will be felt more and more strongly, as the chaos of nihilism is exacerbated. In order to find itself again, the European soul, so often straining towards conquests and the infinite, is destined to return to itself through an effort of introspection and knowledge. Its Greek and Apollonian side, which are so rich, offers a model of wisdom in finitude, the lack of which will become more and more painful. But this pain is necessary. One must pass through the night to reach the dawn.
For Europeans, living according to their tradition first of all presupposes an awakening of consciousness, a thirst for true spirituality, practiced through personal reflection while in contact with a superior thought. One’s level of education does not constitute a barrier. “The learning of many things,” said Heraclitus, “does not teach understanding”. And he added: “To all men is granted the ability to know themselves and to think rightly.” One must also practice meditation, but austerity is not necessary. Xenophanes of Colophon even provided the following pleasant instructions: “One should hold such converse by the fire-side in the winter season, lying on a soft couch, well-fed, drinking sweet wine, nibbling peas: “‘Who are you among men, and where from?” Epicurius, who was more demanding, recommended two exercises: keeping a journal and imposing upon oneself a daily examination of conscience. That was what the stoics practiced. With the Meditations of Marcus Aurelius, they handed down to us the model for all spirtual exercises.
Taking notes, reading, re-reading, learning, repeating daily a few aphorisms from an author associated with the tradition, that is what provides one with a point of support. Homer or Aristotle, Marcus Aurelius or Epictetus, Montaigne or Nietzsche, Evola or Jünger, poets who elevate and memorialists who incite to distance. The only rule is to choose that which elevates, while enjoying one’s reading.
To live in accordance with tradition is to conform to the ideal that it embodies, to cultivate excellence in relation to one’s nature, to find one’s roots again, to transmit the heritage, to stand united with one’s own kind. It also means driving out nihilism from oneself, even if one must pretend to pay tribute to a society that remains subjugated by nihilism through the bonds of desire. This implies a certain frugality, imposing limits upon oneself in order to liberate oneself from the chains of consumerism. It also means finding one’s way back to the poetic perception of the sacred in nature, in love, in family, in pleasure and in action. To live in accordance with tradition also means giving a form to one’s existence, by being one’s own demanding judge, one’s gaze turned towards the awakened beauty of one’s heart, rather than towards the ugliness of a decomposing world.
Notes
1. Generally speaking, the pessimism intrinsic to counter-revolutionary thought – from which Evola distinguishes himself – comes from a fixation with form (political and social institutions), to the detriment of the essence of things (which persist behind change).
2. The academic Marco Tarchi, who has for a long time been interested in Evola, has criticized in him a sterile discourse peopled by dreams of “warriors” and “aristocrats” (cf. the journal Vouloir, Bruxelles, january-february 1991. This journal is edited by the philologist Robert Steuckers).
Excerpt from the book Histoire et traditions des Européens: 30,000 ans d’identité (Paris: Éditions du Rocher, 2002). (Read Michael O’Meara’s review here [2].)
Online source: http://eurocontinentalism.wordpress.com/2013/10/05/living-in-accordance-with-our-tradition-dominique-venner/ [3]
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2013/10/living-in-accordance-with-our-tradition/
00:05 Publié dans Nouvelle Droite, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique venner, nouvelle droite, traditions, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 12 octobre 2013
Romano Guardini
Romano Guardini
(Text aus dem Band Vordenker [2] des Staatspolitischen Handbuchs, Schnellroda 2012.)
Ex: http://www.sezession.de
von Harald Seubert
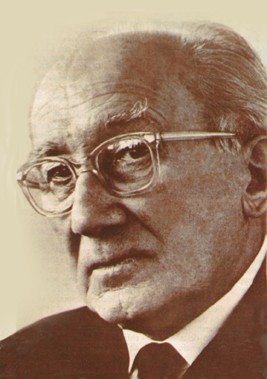 Guardini wurde als Sohn einer aus Südtirol stammenden Mutter und eines italienischen Geflügelgroßhändlers geboren. 1886 übersiedelte die Familie nach Mainz, wo Guardini das humanistische Gymnasium absolviert.
Guardini wurde als Sohn einer aus Südtirol stammenden Mutter und eines italienischen Geflügelgroßhändlers geboren. 1886 übersiedelte die Familie nach Mainz, wo Guardini das humanistische Gymnasium absolviert.
Nach Studien der Chemie und Nationalökonomie entschied er sich, zusammen mit dem Jugendfreund Karl Neundörfer, Theologie zu studieren. Romano Guardinis lebenslanger Freund, Josef Weiger, gehörte mit in den Tübinger Freundschaftskreis, der gleichermaßen von einer Neuaneignung des großen katholischen Erbes und den geistigen und ästhetischen Gärungen und Bewegungen der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bestimmt war.
1915 promovierte Guardini über Bonaventura, 1922 habilitierte er sich über denselben Kirchenlehrer. In den nächsten Jahren war Guardini an maßgeblicher Stelle in der katholischen Jugendbewegung tätig, vor allem im Quickborn mit dem Zentrum der Burg Rothfels. Neben einer Neugestaltung der gesamten Lebensführung bildete die Reform der Liturgie, wobei dem Logos ein verstärktes Gewicht gewidmet sein sollte, einen Schwerpunkt der Neuorientierung. Bis 1939 suchte Guardini die Burg Rothfels als eine Gegenwelt zu bewahren, auch wenn er seit 1934 bespitzelt wurde. Er wollte sie zu einer christlichen Akademie formen, was bis zu der erzwungenen Schließung auch weitgehend gelingen sollte.
Bereits 1923 erhielt Guardini den neuerrichteten Lehrstuhl für Christliche Weltanschauung an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität. Die Titulatur, die auch seinen späteren Münchener Lehrstuhl prägen sollte, war Programm: Inmitten des protestantisch geprägten Berlin solltendie Grundphänomene und Kräfte der eigenen Zeit aus christlicher Perspektive gedeutet werden, im Sinn einer freien, auch ästhetisch hochgebildeten Katholizität, die die großen Traditionen neu aneignete. Der Weltanschauungsbegriff folgte dabei den geistigen und methodischen Vorgaben der hermeneutischen Schule von Dilthey bis Troeltsch. Die Einlösung zeigte sich in den morphologisch souveränen Deutungen Guardinis, die von der Patristik, von Augustinus zu Platon zurückreichen, wobei er aber die thomistische Tradition nicht verleugnete. Ein polyphones Wahrheitsverständnis, das zugleich auf den absoluten Grund gerichtet ist, bildet gleichsam die Mittelachse aller Arbeiten.
Schon in den frühen dreißiger Jahren kritisierte Guardini den innerweltlichen Messianismus des NS-Regimes; er verwies auf den unlösbaren Nexus zwischen jüdischer Religion und christlichem Glauben, der sich schon aus der Existenz Jesu ergebe. In den beiden letzten Kriegsjahren lebte Guardini zurückgezogen in Mooshausen, dem Pfarrort seines Freundes Weiger. Erst nach 1945 konnte er seine öffentliche Wirksamkeit wieder aufnehmen, zunächst in Tübingen und drei Jahre später mit der Berufung auf das persönliche Ordinariat in München. Von hier aus entfaltete Guardini in den nächsten Jahren eine große Wirksamkeit. Sein virtuoser und zugleich zurückgenommener Vortragsstil wirkte weit in das Bürgertum hinein. In großen Zyklen, die sich stets der existentiellen Dimension des Denkens aussetzten, interpretierte er Platon, Augustinus, Dante, Pascal, Kierkegaard, Dostojewski und Hölderlin. Im Zentrum eines langjährigen Vorlesungszyklus stand aber die Ethik, bei Guardini verstanden als umfassende Lehre von der Kunst der Lebensgestaltung. Ergänzend dazu wirkte er als überzeugender, auf die Stunde hörender Prediger und Liturg in der St.-Ludwigs-Kirche bei den Münchener Universitätsgottesdiensten.
1950 erschien die gleichermaßen essayistisch prägnante und wegweisende Studie [3] Das Ende der Neuzeit. Guardini sieht die antike und mittelalterliche Weltsicht durch eine grundsätzliche Geschlossenheit und Ordnung, nicht zuletzt durch eine Harmonie gekennzeichnet, von der sich die Neuzeit ablöst. Diese Trennung vom Göttlichen und Hypostase des Endlichen berge immense Gefahren. Man hat dies als Ablehnung der Neuzeit mißverstanden. Deren Ressourcen sieht Guardini in der Tat an ihr Ende gelangt. Er eröffnet aber zugleich eine künftige Perspektive: auf den Glauben, der in der Moderne seine Selbstverständlichkeit verloren hat und damit ein neues eschatologisches Bewußtsein ermöglicht.
Insgesamt ist Guardini nur zu verstehen, wenn man seinen janusköpfigen Blick, zurück in die Vergangenheit und in die offene nach-neuzeitliche Zukunft voraus, würdigt. Grundlegend für Guardinis philosophische Morphologien und Phänomenologien ist seine Gegensatzlehre (u. a. 1925 und 1955 in verschiedenen Fassungen vorgelegt). Der Gegensatz verweist auf das unverfügbare Gesetz der Polarität und unterscheidet sich damit ebenso von der spekulativen Dialektik Hegels wie auch von der Dialektik der Paradoxalität bei Kierkegaard und in der Existenzphilosophie. Vom einzelnen Phänomen sucht Guardini in einem gleitenden Übergang auf das umgreifende Ganze zu gelangen und umgekehrt. Gegensätzlichkeit ist ihm zufolge »unableitbar«, weil ihre Pole nicht auseinander zu deduzieren und auch nicht aufeinander zurückzuführen sind. Überdies bedarf der Begriff der Anschauung und umgekehrt. Guardini sah sich selbst bewußt eher am Rande der akademischen Welt (es wird berichtet, daß er das Hörsaalgebäude, als Ausdruck von Distanz und Respekt gleichermaßen, vor jeder Vorlesung umrundete). So übte er eine legendäre Strahlkraft auf unterschiedliche Geister, von Hannah Arendt bis Viktor von Weizsäcker, aus, hatte aber im engeren akademischen Sinn kaum Schüler.
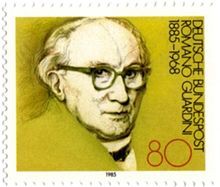 Guardinis Denkstil war wesentlich künstlerisch bestimmt, weshalb er in den späten Jahren auch in der Münchener Akademie der Schönen Künste eine herausgehobene Wirkungsstätte finden sollte. In seiner Münchener Zeit wandte sich Guardinis Deutungskunst auch Phänomenen wie dem Film zu. Wenn er schon mit der Schrift Der Heiland 1935 eine profunde christliche Kritik der NS-Ideologie vorgelegt hatte, so konnte er daran 1950 mit der Untersuchung Der Heilsbringer anknüpfen, einer bahnbrechenden Studie für das Verständnis von totalitären Ideologien als Politische Religionen. Wenig bekannt ist Guardinis Bemühung um ein hegendes »Ethos der Macht«, das gegenüber den anonymen Mächten zur Geltung zu bringen sei, die seiner Diagnose gemäß immer deutlicher zutage treten, das aber auch die charismatische Macht und Herrschaft zu domestizieren weiß.
Guardinis Denkstil war wesentlich künstlerisch bestimmt, weshalb er in den späten Jahren auch in der Münchener Akademie der Schönen Künste eine herausgehobene Wirkungsstätte finden sollte. In seiner Münchener Zeit wandte sich Guardinis Deutungskunst auch Phänomenen wie dem Film zu. Wenn er schon mit der Schrift Der Heiland 1935 eine profunde christliche Kritik der NS-Ideologie vorgelegt hatte, so konnte er daran 1950 mit der Untersuchung Der Heilsbringer anknüpfen, einer bahnbrechenden Studie für das Verständnis von totalitären Ideologien als Politische Religionen. Wenig bekannt ist Guardinis Bemühung um ein hegendes »Ethos der Macht«, das gegenüber den anonymen Mächten zur Geltung zu bringen sei, die seiner Diagnose gemäß immer deutlicher zutage treten, das aber auch die charismatische Macht und Herrschaft zu domestizieren weiß.
Schriften: Von heiligen Zeichen, Würzburg 1922; Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten, Mainz 1925; Christliches Bewußtsein. Versuche über Pascal, Leipzig 1935; Der Herr. Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu Christi, Würzburg 1937 (16. Aufl. 1997); Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen, Würzburg 1939; Der Tod des Sokrates, Bern 1945; Das Ende der Neuzeit. Ein Versuch zur Orientierung, München 1950; Die Macht. Versuch einer Wegweisung, München 1951; Ethik. Vorlesungen an der Universität München, hrsg. v. Hans Mercker, 2 Bde., Ostfildern 1993.
Literatur: Berthold Gerner: Romano Guardini in München. Beiträge zu einer Sozialbiographie, 3 Bde., München 1998–2005; Franz Henrich: Romano Guardini, Regensburg 1999; Markus Zimmermann: Die Nachfolge Jesu Christi. Eine Studie zu Romano Guardini, Paderborn 2004.
Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de
URL to article: http://www.sezession.de/41152/45-todestag-romano-guardini.html
URLs in this post:
[1] Image: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2013/02/9783935063562.jpg
[2] Vordenker: http://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/staatspolitisches-handbuch/33/staatspolitisches-handbuch-band-3-vordenker
[3] wegweisende Studie: http://www.sezession.de/3323/neues-mittelalter.html/3
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : romano guardini, théologie, philosophie, catholicisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 octobre 2013
Redécouvrez les contes de Grimm
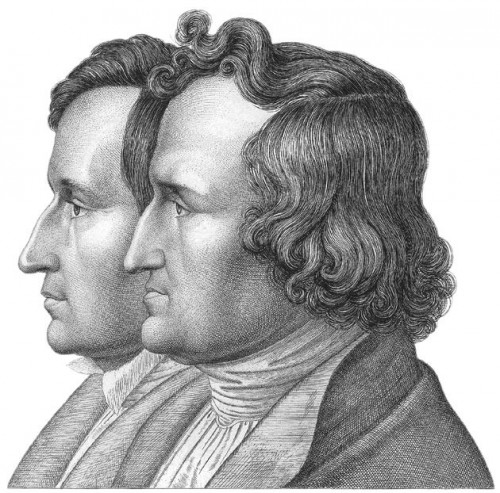
Redécouvrez les contes de Grimm
Ex: http://aucoeurdunationalisme.blogspot.com
Le 1er fils de Philipp Wilhelm Grimm et Dorothea Zimmer étant mort en bas âge, Jacob et Wilhelm Grimm furent les aînés des 8 enfants de la fratrie subsistante. La famille remonte à un Johannes Grimm, qui fut maître de poste à Hanau vers 1650. C'est dans cette ville que Jacob naît le 4 janvier 1785, 13 mois avant Wilhelm. On est alors à la frontière de 2 mondes. En France, les signes avant-coureurs de la Révolution se multiplient. Le Times est fondé à Londres. En Prusse, fonctionne la 1ère machine à vapeur ; le Grand Frédéric règne à Sanssouci.
Juriste de son état, le père Grimm est nommé fonctionnaire à Steinau en 1791. La famille déménage avec lui pour s'installer dans la Hesse, région située à la frontière de la plaine du Nord et du fossé rhénan, qui fut occupée dès le VIIIe siècle par les Francs. Cinq ans plus tard, Philipp Wilhelm Grimm disparaît ; sa femme ne lui survivra que quelques années (le fils aîné se retrouvera chef de famille à 23 ans). Jacob et Wilhelm sont envoyés chez leur tante, à Kassel, où ils fréquentent le célèbre Lyceum Friedricianum.
Au printemps de 1802, Jacob Grimm s'inscrit à l'université de Marburg pour y faire des études de droit. Agé de 17 ans, c'est alors un adolescent grave, mélancolique, au caractère réservé, qui passe déjà pour un travailleur opiniâtre. À Marburg, il se lie rapidement avec le juriste Friedrich Carl von Savigny, le fondateur de l'école du droit historique, et cette relation va exercer sur lui une empreinte déterminante. En 1803, tandis que Savigny lui fait connaître la littérature médiévale, il entre aussi en contact avec Clemens Brentano et lit avec enthousiasme les Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter de Ludwig Tieck.
En 1805, c'est l'expérience décisive. De février à septembre, Jacob Grimm accompagne Savigny à Paris - ville qu'il trouve bruyante et fort sale ! Par contre, à la Bibliothèque impériale, il découvre toute une série de manuscrits littéraires allemands du Moyen Age qui lui emplissent le cœur d'une singulière exaltation. À dater de ce jour, sa vocation est faite : il se consacrera à l'étude des monuments culturels du passé national. Tout l'y pousse, et d'abord la triste situation dans laquelle se trouve son pays.
La Prusse, en effet, depuis la défaite de Valmy (1792), connaît des jours sombres. En 1805, Jacob Grimm s'afflige de voir "l’Allemagne enserrée en des liens indignes, le pays natal bouleversé et son nom même anéanti". L'année suivante, ce sera la catastrophe. Inquiet de la formation de la Confédération du Rhin, Frédéric-Guillaume III s'allie à la Russie. Las ! En quelques mois, la coalition s'effondre. Après les défaites d'Iéna et d'Auerstedt, les troupes napoléoniennes occupent Berlin. En 1807, au traité de Tilsit, la Prusse, dépossédée de la moitié de son territoire, se voit en outre condamnée à payer des indemnités de guerre considérables. Brême, en 18l0, deviendra sous l'occupation française le chef-lieu du département des Bouches-du-Weser ! L'identité allemande, dès lors, est menacée.
Aussi bien, pour J. Grimm, l'étude de la littérature nationale n'est-elle pas qu’une simple démarche universitaire. C'est un acte de foi politique, qui participe d'une véritable réforme intellectuelle et morale. Celle-ci trouve son point d'appui dans la 1ère réaction romantique, centrée autour de l'école de Heidelberg qui, avec Arnim et Brentano, s'emploie notamment à définir les éléments constitutifs de la nationalité. "Ces écrivains, souligne Jacques Droz, ont admis qu'il ne pouvait pas y avoir de réveil du peuple si celui-ci ne prenait pas conscience qu'il recelait en son sein, s’il ne substituait pas à une culture réservée à une élite une culture véritablement populaire, si l’individu ne cherchait pas à se rattacher spirituellement à la nation tout entière" (Le romantisme politique en Allemagne, 1963, p. 23).
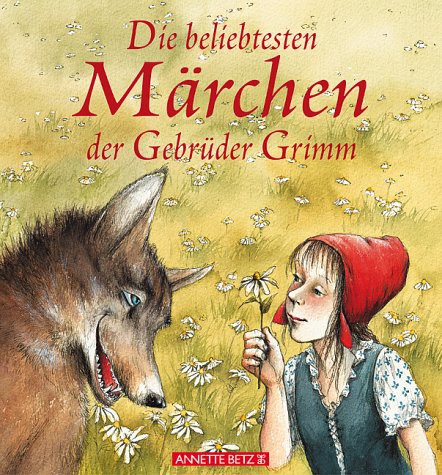 À l'heure de l’éveil des nationalités, l'entreprise des frères Grimm vise donc à faire prendre conscience aux Allemands de la richesse du patrimoine culturel qui leur est commun et à leur montrer que ce patrimoine, qui représente "l’âme germanique" dans son essence, en même temps que la "conscience nationale courbée sous l'occupation", peut servir aussi de base à leur unité politique.
À l'heure de l’éveil des nationalités, l'entreprise des frères Grimm vise donc à faire prendre conscience aux Allemands de la richesse du patrimoine culturel qui leur est commun et à leur montrer que ce patrimoine, qui représente "l’âme germanique" dans son essence, en même temps que la "conscience nationale courbée sous l'occupation", peut servir aussi de base à leur unité politique.Dans ses Souvenirs, Grimm raconte dans quel esprit il entreprit à Paris ces études auxquelles il allait consacrer toute sa vie : "Je remarquai d’abord que presque tous mes efforts ou bien étaient consacrés à l’étude de notre langue ancienne, de notre poésie ancienne, de notre droit ancien, ou bien s’y rapportaient directement. Certains peuvent avoir considéré ou considèrent encore que ces études sont sans aucun profit ; pour moi, elles me sont apparues de tout temps comme une tâche noble, sérieuse, qui se rapporte de façon précise et forte à notre patrie commune et fortifie l’amour qu’on lui porte" (Kleinere Schriften, Berlin, 1864, vol. I, p. 64).
C’est dans la même intention qu'Achim von Arnim et C. Brentano collectent les vieilles poésies populaires. En septembre 1806, Arnim écrit à Brentano : "Celui qui oublie la détresse de la patrie sera oublié de Dieu en sa détresse". Quelques jours plus tard, à la veille de la bataille d'Iéna, il distribue aux soldats de Blücher des chants guerriers de sa composition. Parallèlement, il jette les bases de la théorie de l'État populaire (Volksstaat). Systématiquement, le groupe de Heidelberg s'emploie ainsi à mettre au jour les relations qui existent entre la culture populaire et les traditions historiques. Influencé par Schelling, Carl von Savigny oppose sa conception historique du droit aux tenants du jusnaturalisme [droit naturel]. Il affirme qu'aucune institution ne peut être imposée du dehors à une nation et que le droit civil est avant tout le produit d’une tradition spécifique mise en forme par la conscience populaire au cours de l'histoire. Le droit, dit-il, est comme la langue : "Il grandit avec le peuple, se développe et meurt avec lui lorsque celui-ci vient à perdre ses particularités profondes" (De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit).
Avec les romantiques, J. Grimm proteste lui aussi contre le rationalisme des Lumières. Il exalte le peuple contre la culture des "élites". Il célèbre l'excellence des institutions du passé. Revenu à Kassel, où Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie, s’installe en 1807 au Château de Wilhelmshöhe (construit au pied d'une colline dominant la ville par le prince-électeur Guillaume Ier), il occupe avec son frère diverses fonctions dans l'administration et à la bibliothèque. À partir de 1808, ils collaborent tous 2 à la Zeitung für Einsiedler, où l'on retrouve les signatures de Brentano, Arnim, Josef Görres, etc. En 1813, ils lanceront leur propre publication, les Altdeutsche Wälder.
Le 1er livre de J. Grimm, Über den altdeutschen Meistergesang, paraît à Göttingen en 1811. Contestant les rapports établis habituellement entre la poésie raffinée du Moyen Age (Meistergesang) et le chant populaire (Minnegesang), l’auteur y défend l'idée que la "poésie naturelle" (Naturpoesie) est absolument supérieure à la "poésie artistique" (Kunstpoesie), tout comme la source jaillissante de l'âme populaire est supérieure aux œuvres des élites cultivées. La "poésie naturelle", disait déjà Herder, fait comprendre le sens de l'univers ; elle maintient vivant le lien entre l'homme et la nature. Étant l'expression même des croyances instinctives et des sentiments du peuple, elle apparaît dès que les hommes font advenir en eux à la présence ce qui les apparente au monde. La Kunstpoesie, au contraire, si belle qu'elle puisse être, est inévitablement affectée d’individualisme et d'artificialité. Au-delà de ses qualités mêmes, elle traduit une coupure "intellectuelle" qui est un germe de déclin (on retrouve ici l'idée que le raffinement équivaut déjà à une perte de puissance, à un début d'épuisement).
Contrairement à Görres, J. Grimm va jusqu'à éliminer toute activité particulière ou individuelle dans la production poétique populaire ! Celle-ci, selon lui, se manifestespontanément, de façon divine au sens propre. La vérité légendaire ou mythique, d'essence divine elle aussi, s'oppose de la même façon à la vérité historique humaine. De façon plus générale, tout ce qui se perd dans la nuit des temps, tout ce qui relève de l'ancestralité originelle, est divin. Résumant ses idées sur ce point, J. Grimm déclare vouloir montrer qu'"une grande poésie épique a vécu et régné sur toute la surface de la terre, puis a peu à peu été oubliée et abandonnée par les hommes, ou plutôt, car elle n'a pas été abandonnée tout à fait, comment les hommes s'y alimentent encore". Il ajoute : "De même que le paradis a été perdu, le jardin de l'ancienne poésie nous a été fermé". Et plus loin : "Je ne regarde pas le merveilleux comme une rêverie, une illusion, un mensonge, mais bien comme une vérité parfaitement divine ; si nous nous rapprochons de lui, il ne s'évanouit nullement à la façon d'un brouillard, mais prend toujours un caractère plus sacré et nous contraint à la prière. (...) C'est pourquoi l'épopée n'est pas simplement une histoire humaine, comme celle que nous écrivons maintenant, mais contient aussi une histoire divine, une mythologie". Cette thèse quelque peu extrême ne convainc pas Arnim, pas plus que Schlegel ou Görres, et moins encore Brentano. Des discussions passionnées s'ensuivent...
Dans les années qui suivent, les frères Grimm vont approfondir leur intuition en se penchant sur de grands textes littéraires. Ils travaillent d'abord sur la Chanson des Nibelungen, puis sur les chansons de geste, les vieux chants populaires écossais, les runes, l'Irminsul. Ils préparent aussi une nouvelle édition du Hildebrandslied et du Reinhard Fuchs, et s'attaquent à la traduction d'une partie de l'Edda. Wilhelm, de son côté, traduit les Altdänische Heldenlieder (Heidelberg, 1811), qu'il n'hésite pas à comparer aux poèmes homériques et qu'il oppose à la littérature des scaldes à la façon dont Jacob oppose Naturpoesie et Kunstpoesie. Les 2 frères, enfin, déploient une intense activité pour recueillir les contes populaires qui vont constituer la matière de leur ouvrage le plus fameux : les Contes de l’enfance et du foyer.
Le 1er volume de ces Contes (Kinder- und Hausmärchen) est publié à Noël 1812 par la Realschulbuchhandlung de Berlin. Les frères Grimm l'ont dédié à leur "chère Bettina", épouse d'Arnim et sœur de Brentano (la fille de Bettina épousera par la suite le fils de Wilhelm Grimm). Le volume suivant paraîtra en 1815. Un 3ème volume, contenant les variantes et les commentaires, sortira en 1822 à l’instigation du seul Wilhelm Grimm. Dès sa parution, l'ouvrage connaît le plus vif succès. Goethe le recommande à Mme de Stein comme un livre propre à "rendre les enfants heureux". Schlegel, Savigny, Arnim s'en déclarent enchantés. Seul C. Brentano reste réservé.
C'est en 1806, dès le retour de Jacob de Paris, que les 2 frères Grimm ont commencé leur collecte. La région dans laquelle ils vivent s'avérait d'ailleurs particulièrement propice à la réalisation de leur projet. Sur les chemins de la Hesse et de la Weser, dans le pays de Frau Holle, les "fées" semblent avoir de tout temps trouvé refuge. Entre Hanau et Brême, Steinau et Fritzlar, Munden et Alsfeld, les légendes se sont cristallisées autour des forêts et des villages, des collines et des vallées. Aujourd'hui encore, dans les bois environnants, près des vieilles maisons à colombage, aux toits de tuile rouge et aux murs recouverts d'écailles de sapins, la trace des frères Grimm est partout (1).
La plupart des contes réunis par Jacob et Wilhelm Grimm ont été recueillis auprès de gens du peuple : paysans, artisans, servantes. Deux femmes ont à cet égard joué un rôle essentiel. Il s'agit d'abord d'une paysanne de Niederzwehrn, près de Kassel, à laquelle Wilhelm Grimm donne le nom de "Frau Viehmännin" et dont le nom exact était Dorothea Viehmann (2). L'autre femme était Marie Hassenpflug (1788-1856), épouse d'un haut fonctionnaire hessois installé à Kassel ; on estime que les frères Grimm recueillirent une cinquantaine de contes par son intermédiaire. Ces 2 femmes étaient d'origine huguenote. Par sa mère, Marie Hassenpflug descendait d'une famille protestante originaire du Dauphiné. En 1685, la révocation de l'édit de Nantes conduisit en effet quelque 4 000 huguenots français à s'installer en Hesse, dont 2 000 dans la ville de Kassel.
Cette ascendance huguenote des 2 principales "informatrices" des frères Grimm a conduit quelques auteurs modernes à gloser de façon insistante sur les "emprunts français" (Heinz Rölleke) auxquels les 2 frères auraient eu recours. Certains en ont conclu à "l'inauthenticité" des contes de Grimm, qui trouveraient leur véritable origine dans les récits littéraires de Charles Perrault ou de Marie-Catherine d'Aulnoy, beaucoup plus que dans l’authentique "tradition populaire" allemande. Cette thèse, poussée à l’extrême par l'Américain John M. Ellis (One Fairy Story, Too Many. The Brothers Grimm and Their Tales, Univ. of Chicago Press, 1983) qui va jusqu'à parler de "falsification" délibérée, est en fait inacceptable. Il suffit de lire lesContes de Grimm pour s'assurer que l'immense majorité de ceux-ci ne se retrouvent ni chez Perrault ni chez Mme d'Aulnoy. Les rares contes présents chez l'un et chez l'autre auteur (Hänsel et Gretel et le petit Poucet, Aschenputtel et Cendrillon, Dornröschen et la Belle au bois dormant, etc.) ne constituent d'ailleurs pas la preuve d'un "emprunt". Perrault ayant lui-même largement puisé dans le fonds populaire, il y a tout lieu de penser que les frères Grimm ont simplement recueilli une version parallèle d'un thème européen commun. Le fait, enfin, que certains contes de Grimm aient été directement recueillis en dialecte hessois ou bas-allemand et que, de surcroît, la majeure partie d'entre eux renvoient de toute évidence à un héritage religieux germanique, montre que les accusations de John M. Ellis sont parfaitement dénuées de fondement.
En fait, pour les frères Grimm, le conte populaire fait partie de plein droit de laNationalpoesie. Au même titre que le mythe, l'épopée, le Volkslied (chant populaire), il est une "révélation de Dieu" surgie spontanément dans l'âme humaine. Évoquant les contes, dont il dit que "leur existence seule suffit à les défendre", Wilhelm Grimm écrit : "Une chose qui a, d'une façon si diverse et toujours renouvelée, charmé, instruit, ému les hommes, porte en soi sa raison d’être nécessaire et vient nécessairement de cette source éternelle où baigne toute vie. Ce n'est peut-être qu'une petite goutte de rosée retenue au creux d'une feuille, mais cette goutte étincelle des feux de la première aurore".
En retranscrivant les contes populaires qu'ils entendent autour d'eux, les 2 frères restent donc rigoureusement fidèles à leur démarche originelle. Leur but est toujours de faire éclore à la conscience allemande les sources de son identité, de redonner vie à l'esprit populaire à l'œuvre dans ces récits que le monde rural s'est retransmis au fil des siècles. Leur démarche est par-là foncièrement différente de celle des auteurs français. Tandis que l'œuvre de ces derniers s'inscrit dans un contexte littéraire et "mondain", la leur entend plonger aux sources mêmes de "l'âme nationale". Elle est un geste de piété en même temps qu'un acte radicalement politique. Certes Jacob et Wilhelm Grimm ont le souci de remettre en forme les contes qu'ils recueillent mais c'est avant tout le respect qui commande leur approche. Mus par un parti pris de fidélité, ils ne s'intéressent ni aux formes littéraires ni au "moralités" qui enchantaient Perrault. Ils ne visent pas tant à amuser les enfants ou à distraire la cour d'un prince ou d'un roi qu'à recueillir à la source, de la façon la plus minutieuse qui soit, les traces encore existantes du patrimoine auquel ils entendent se rattacher. Bref, comme l'écrit Lilyane Mourey, ils entendent travailler "au nom de la patrie allemande" (3). Tonnelat, de même, insiste sur "les rapports qu'ils croyaient apercevoir entre le conte et l'ancienne légende épique des peuples germaniques. Rapports si étroits qu'on ne peut plus, lorsqu'on va au fond des choses, distinguer l'un de l'autre. Le conte n'est qu'une sorte de transcription des grands thèmes épiques en un monde familier tout proche de la simple vie du peuple" (Les frères Grimm. Leur oeuvre de jeunesse, A. Colin, 1912, pp. 214-215).
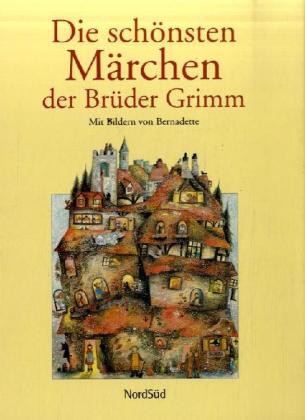 L'étude des contes populaires (Märchenforschung), dont J. et W. Grimm ont ainsi été les précurseurs, a donné lieu depuis plus d'un siècle à des travaux aussi érudits que nombreux. La matière, par ailleurs, n'a cessé d’être plus étroitement cernée. En 1910, le folkloriste finlandais Antti Aarne a publié une classification des contes par thèmes et par sujets (The Types of the Folktale, Suomaleinen Tiedeakatemia, Helsinki, 1961) qui, affinée par Stith Thompson (The Folk Tale, Dryden Press, New York, 1946 ; Motif Index of Folk Litterature, 6 vol., Indiana Univ. Press, Bloomington, 1955), est aujourd'hui universellement utilisée. Elle ne rassemble pas moins de 40 000 motifs principaux. Pour le seul domaine d'expression française, on a dénombré plus de 10 000 contes différents (cf. Paul Delarue, Le conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de France et des pays de langue française d'outre-mer, Maisonneuve et Larose, 1976), dont un grand nombre trouvent leur origine dans la matière de Bretagne.
L'étude des contes populaires (Märchenforschung), dont J. et W. Grimm ont ainsi été les précurseurs, a donné lieu depuis plus d'un siècle à des travaux aussi érudits que nombreux. La matière, par ailleurs, n'a cessé d’être plus étroitement cernée. En 1910, le folkloriste finlandais Antti Aarne a publié une classification des contes par thèmes et par sujets (The Types of the Folktale, Suomaleinen Tiedeakatemia, Helsinki, 1961) qui, affinée par Stith Thompson (The Folk Tale, Dryden Press, New York, 1946 ; Motif Index of Folk Litterature, 6 vol., Indiana Univ. Press, Bloomington, 1955), est aujourd'hui universellement utilisée. Elle ne rassemble pas moins de 40 000 motifs principaux. Pour le seul domaine d'expression française, on a dénombré plus de 10 000 contes différents (cf. Paul Delarue, Le conte populaire français. Catalogue raisonné des versions de France et des pays de langue française d'outre-mer, Maisonneuve et Larose, 1976), dont un grand nombre trouvent leur origine dans la matière de Bretagne.
S’il est admis que le conte tel que nous le connaissons apparaît aux alentours du Xe siècle, époque à laquelle il semble prendre le relais du récit héroïque ou épique, se comprend mieux alors que l'étude des filiations, des modes de transmission et des variantes représente un énorme champ de travail. Pour Cendrillon, par ex., on n'a pas dénombré moins de 345 variantes ! Selon l'école finlandaise, la comparaison de ces variantes permet le plus souvent de reconstruire une forme primordiale" (à la façon dont la comparaison des langues européennes a permis aux philologues de "reconstruire" l'indo-européen commun), mais le bien-fondé de cette démarche est contesté par certains. Ainsi que l'avait pressenti J. Grimm, le problème de l'origine des contes renvoie en fait à celui de la formation de la pensée mythique. C'est dire qu'il est impossible de la situer avec précision. Diverses thèses ont néanmoins été avancées. Plusieurs auteurs (P. Saintyves, V.J. Propp, Sergius Golowin, A. Nitzschke) ont recherché cette origine dans de très anciens rituels. Plus généralement, la parenté des contes et des mythes religieux est admise par beaucoup mais les opinions diffèrent quant à savoir si les contes représentent des "résidus" des mythes ou, au contraire, s'ils les précédent. Tout récemment, le professeur August Nitzschke, de l’université de Stuttgart, a affirmé que l'origine de certains contes pourrait remonter jusqu'à la préhistoire de la période post-glaciaire. Après Paul Saintyves (Les contes de Perrault et les récits paralléles, Émile Nourry, 1923), d'autres chercheurs, not. C.W. voit Sydow et Justinus Kerner, ont essayé de démontrer l'existence, effectivement fort probable, d'un répertoire de base indo-européen.
Dans la préface au 2nd volume de leur recueil, les frères Grimm déclarent, eux aussi, qu'il y a de bonnes raisons de penser que de nombreux contes populaires renvoient à l'ancienne religion germanique et, au-delà de celle-ci, à la mythologie commune des peuples indo-européens. Le 3ème volume propose à cet égard divers rapprochements qui, par la suite, ont été constamment repris et développés. Le thème de Cendrillon (Aschenputtel), par ex., est visiblement apparenté à l'histoire de Gudrun. L'histoire des 2 frères (conte 60) évoque la légende de Sigurd. La Belle au bois dormant (Dornröschen), dont le thème se trouve dès le XIVe siècle dans lePerceforest, est de toute évidence une version populaire de la délivrance de Brünhilde par Siegfried au terme d'une quête "labyrinthique", etc. D'autres contes renvoient probablement à des événements historiques. Il en va ainsi de Gnaste et ses 3 fils (conte 138), qui conserve apparemment le souvenir de la christianisation forcée du peuple saxon et se termine par cette apostrophe : "Bienheureux celui qui peut se soustraire à l'eau bénite !"
N'a-t-on pas été jusqu'à voir dans l'histoire de Blanche-Neige (Schneewittchen) l'écho d'un vieux conflit entre le droit saxon et le droit romain, où les 7 nains auraient représenté les 7 anciennes provinces maritimes frisonnes ? Et dans l'exclusion de la 13ème fée dans la Belle au bois dormant un souvenir du passage, chez les anciens Germains, de l'année de 13 mois à celle de 12 (Philipp Stauff) ? Certaines de ces hypothèses sont aventurées. Mais derrière les "sages femmes" dont parlent les frères Grimm, il n'est pas difficile d'identifier d’anciennes "sorcières" (Hexe) persécutées (4), tout comme les 3 fileuses incarnent les 3 Nomes, divinités germaniques du destin (5).
Bien d'autres interprétations ont été avancées, qui font appel à l'ethnologie et à la psychologie aussi bien qu'à l'histoire des religions ou à l'anthropologie : analyses formelles (Vladimir Propp), approches historiques ou structuralistes, recours à l'inconscient collectif du type jungien (Marie-Louise von Franz), études symboliques (Claudio Mutti), aspects thérapeutiques de l'école de Zurich (Verena Kast), exploitations parodiques (Iring Fetscher), etc.
L'importance qu'ont les relations de parenté dans la plupart des contes populaires a aussi donné lieu, not. chez Bruno Bettelheim (Psychanalyse des contes de fées, Laffont, 1979) et Erich Fromm (Le langage oublié, Payot, 1980), à des interprétations psychanalytiques. Pour Bettelheim, les contes ont essentiellement pour but de permettre aux enfants de se libérer sans dommage de leurs craintes inconscientes : l’heureux dénouement du récit permet au moi de s'affirmer par rapport à la libido. En fait, comme le montre Pierre Péju (La petite fille dans la forêt des contes, Laffont, 1981), cette interprétation n'est acquise qu'au prix d'une réduction qui transforme le conte en "roman familial" par le biais de la "moulinette psychanalytique". Elle laisse "l'histoire" des contes entièrement de côté, avec tous ses arrière-plans mythiques et ses variantes les plus significatives. Bettelheim, finalement, ne s'intéresse pas aux contes en tant que tels ; il n'y voit qu'un mode opératoire à mettre au service d'une théorie préformée sur la personnalité psychique - ce qui ne l'a d'ailleurs pas empêché d'exercer une profonde influence(6).
Pour Bettelheim, le conte aide l'enfant à devenir adulte. Pour Jacob Grimm, il aiderait plutôt les adultes, en les remettant au contact de l'originel, à redevenir des enfants. Ce n'est en effet qu'à une date relativement récente que les contes ont constitué un genre littéraire "pour les enfants". Le recueil des frères Grimm évoque d'ailleurs dans son titre aussi bien l'enfance que le foyer : si les enfants entendent les contes dans le cercle de famille, ils n'en sont pas pour autant les destinataires privilégiés. Dans une lettre à L.J. Arnim, Jacob Grimm écrit : "Ce n'est pas du tout pour les enfants que j'ai écrit mes contes. Je n'y aurais pas travaillé avec autant de plaisir si je n'avais pas eu la conviction qu'ils puissent avoir de l'importance pour la poésie, la mythologie et l'histoire, aussi bien à mes yeux qu'à ceux de personnes plus âgées et plus sérieuses".
Produit d'un fond culturel retransmis par voie orale pendant des siècles, sinon des millénaires, le conte populaire est en fait, comme disent les linguistes, un modèle fort qui va bien au-delà du simple divertissement. Les lois du genre en font le véhicule et le témoin privilégié d'un certain nombre de types et de valeurs, grâce auxquels l'auditeur peut à la fois s'appréhender comme l’héritier d'une culture particulière et s'orienter par rapport à son environnement.
C'est par son caractère intemporel, anhistorique, que le conte s'apparente au mythe. Tandis que le récit biblique dit : in illo tempore, "en ce temps-là" (un temps précis), le conte affirme : "il était une fois", formule qui extrait la temporalité de tout contexte linéaire ou finalisé. Avec ces mots, le conte évoque un "jadis" qui équivaut à un "nulle part" aussi bien qu'à un "toujours".
"Comme toute utopie, écrit Marthe Robert, le conte nie systématiquement les données immédiates de l'expérience dont le temps et l'espace sont les 1ers fondements mais cette négation n'est pas son véritable but ; il ne s'en sert que pour affirmer un autre temps et un autre espace, dont il révèle, par toutes ses formules, qu'ils sont en réalité un ailleurs et un avant" (Un modèle romanesque : le conte de Grimm in Preuves, juillet 1966, 25). Dans le conte, l'état civil, l'histoire et la géographie sont abolis délibérément. Les situations découlent exclusivement de relations mettant en jeu des personnages-types : le roi, le héros, la fileuse, la marâtre, la fée, le lutin, l'artisan, etc., qui sont autant de figures familières, valables à tout moment. Plus encore que le passé, c'est l'immémorial, et par-là l'éternel, que le conte fait surgir dans le présent pour y faire jaillir la source d'un avenir rénové par l'imaginaire et par la nostalgie : témoignage fondateur, qui implique que "l'antérieur" ne soit jamais clairement situé. Le conte, en d'autres termes, ne se réfère au "passé" que pour inspirer "l'avenir". Il est une métaphore destinée à inspirer tout présent. L'apparente récréation ouvre la voie d'une re-création. Loin que son caractère "merveilleux" l’éloigne de la réalité, c'est par-là au contraire que le contenu du conte est rendu compatible avec toute réalité. Pour Novalis, les contes populaires reflètent la vision supérieure d'un "âge d'or" évanoui. Cet "âge d'or", du fait même qu'il se donne comme émanant d'un temps situé au-delà du temps, peut en réalité s'actualiser aussi à chaque instant. Lorsqu'ils évoquent l'enfance, Jacob et Wilhelm Grimm n'ont pas tant à l'esprit l'âge de leurs jeunes lecteurs que cette "enfance de l'humanité" vers laquelle ils se tournent pour en extraire la source d'un nouveau commencement qui, après des siècles d’histoire "artificielle", renouerait avec l’innocence de la création spontanée.
Le conte, par ailleurs, témoigne de la parenté de tout ce qui compose le monde. Il est par-là à l'opposé de tout le dualisme propre aux religions révélées. Les frères Grimm remarquent eux-mêmes que dans les contes populaires, la nature est toujours "animée". "Le soleil, la lune et les étoiles fréquentent les hommes, leur font des cadeaux, écrit Wilhelm Grimm. (...) Les oiseaux, les plantes, les pierres parlent, savent exprimer leur compassion ; le sang lui-même crie et parle, et c'est ainsi que cette poésie exerce déjà des droits que la poésie ultérieure ne cherche à mettre en œuvre que dans les métaphores". Dans la dimension mythique qui est propre au conte, toutes les frontières nées de la dissociation inaugurale s'effacent. Le héros comprend le langage des oiseaux les bêtes communiquent avec les humains : la nature porte présage. Toutes les dimensions de visible et d'invisible se confondent, comme au temps où les dieux et les hommes vivaient ensemble dans une présence amicale. Sorte d'épopée familière liée à la "poésie naturelle", le conte traduit ici un paganisme implicite, que les frères Grimm ne se soucient pas de cerner en tant que tel, mais qu'ils fondent, toutes croyances confondues, dans l'exaltation du Divin.
On comprend mieux, dès lors, que le conte populaire n'ait cessé, à l'époque moderne, de faire l'objet des critiques les plus vives. Au XVIIIe siècle, les pédagogues des Lumières y voyaient déjà un ramassis de superstitions détestables. Par la suite, les libéraux en ont dénoncé le caractère "irrationnel" aussi bien que la violence "subversive" tandis que les socialistes y voyaient des "histoires à dormir debout" propres à désamorcer les nécessaires révoltes, en détournant les enfants des travailleurs des réalités sociales. Plus récemment, les contes ont été considérés comme "traumatisants" ou ont été attaqués pour des raisons moralo-pédagogiques ridicules (7).

Si, au XIXe siècle, le conte devient progressivement un outil pédagogique bourgeois, coupé du milieu populaire, et dont le contenu est réorienté dans un sens moralisateur censé servir de "leçon" aux enfants, son rôle n'en reste pas moins profondément ambigu. Certains auteurs ont observé que la vogue des contes est d'autant plus grande que l'état social est perçu comme menacé. Le merveilleux, porteur d'un ailleurs absolu, joue alors un rôle de compensation, en même temps qu'il constitue une sorte de recours. Les auteurs marxistes ont beau jeu de dénoncer la montée de "l'irrationnel" dans les périodes de crise ; le conte, fondamentalement duplice, va en fait bien au-delà. Loin d’être purement régressive, la "nostalgie" peut être aussi la source d'un élan. Les frères Grimm, on l'a vu, en collectant la matière de leurs Contes, voulaient d'abord lutter contre l'état d'abaissement dans lequel se trouvait leur pays. La vogue actuelle du merveilleux, désormais relayée par le cinéma et la bande dessinée, est peut-être à situer dans une perspective voisine. Que l'on pense au succès, outre-Rhin, de L'Histoire sans finde Michael Ende...
Les contes, finalement, sont beaucoup plus utiles à l'humanité que les vitamines aux enfants ! Pièces maîtresses de cette "nourriture psychique" indispensable à l'imaginaire symbolique dans lequel se déploie l'âme des peuples, ils renaissent tout naturellement lorsque l'on a besoin d'eux. Par-là, ils révèlent toute la complexité de leur nature. Modèles profonds, sources d'inspiration, ils s'adressent à tout moment à des hommes "au cœur préparé". Car, comme le constate Mircea Eliade, si le conte, trop souvent, "constitue un amusement ou une évasion, c'est uniquement pour la conscience banalisée et notamment pour la conscience de l'homme moderne ; dans la psyché profonde, les scénarios initiatiques conservent toute leur gravité et continuent à transmettre leur message, à opérer des mutations" (Aspects du mythe, Gal., 1963).
En 1816-1818, Jacob et Wilhelm Grimm (qui travaillent tous 2 désormais à la bibliothèque de Kassel) publient les Deutsche Sagen. Ce recueil de légendes a été composé selon le même principe que les Contes de l'enfance et du foyer. Une fois de plus, la légende, assimilée à la "poésie naturelle", est opposée à l'histoire. Sur son exemplaire personnel, Wilhelm Grimm écrit ce vers d’Homère : "Je ne sais rien de plus doux que de reconnaître sa patrie" (Odyssée IX, 28). À cette date, la Prusse a précisément recouvré sa liberté. Le 18 juin 1815, la bataille de Waterloo a sonné le glas des espérances napoléoniennes en Europe. Jacob Grimm, en 1814-1815, a lui-même été Legationsrat au Congrès de Vienne. Les Deutsche Sagen sont accueillies avec faveur par Goethe, qui saisit cette occasion pour attirer sur leurs auteurs l'attention des dirigeants de Berlin.
À partir de 1820-1825, les frères Grimm consacrent chacun la majeure partie de leur temps à des œuvres personnelles. Après les Irische Elfenmärchen (Leipzig, 1826), seul le Deutsches Wörterbuch sera publié sous leur double-signature. Leur champ d'études reste néanmoins le même. Wilhelm continue à travailler sur la légende héroïque médiévale (Die deutsche Heldensage, 1829), la Chanson de Roland, l'épopée danoise, etc. En 1821, se penchant sur la question de l'origine des runes (Über deutsche Runen), il affirme que l'ancienne écriture germanique découle d'un alphabet européen primitif, au même titre que les écritures grecque et latine, et ne résulte donc pas d'un emprunt. La thèse sera très contestée. Par contre, Wilhelm Grimm ne se trompe pas quand il déclare que les Germains continentaux ont dû connaître l'usage des runes au même titre que les Scandinaves et les Anglo-Saxons : l'archéologie lui a depuis donné raison.
Jacob, lui, se plonge dans un énorme travail de philologie et d'étude de la religion germanique. Les livres qu'il publie se succèdent rapidement. À côté de monuments comme la Deutsche Grammatik, la Deutsche Mythologie, la Geschichte der deutschen Sprache, on trouve des essais sur Tacite, la poésie latine des Xe et Xle siècles, l'histoire de la rime poétique, et quantité de textes et d'articles qui seront réunis dans les 8 volumes des Kleinere Schriften, publiés à Berlin à partir de 1864.
Le 1er volume de la Deutsche Grammatik paraît en 1819. Dans cet ouvrage dédié a Savigny, Jacob Grimm s'efforce de jeter les bases historiques de la grammaire allemande en transposant dans l'étude des formes linguistiques les principes appliqués par Savigny à l'étude du droit. Les règles qu'il énonce en philologie comparée le haussent d'emblée au niveau de Wilhelm von Humboldt, Franz Bopp, Rask, etc. "Aucun peuple sur terre, écrit-il dans la préface, n'a pour sa langue une histoire comparable à celle des Allemands". S'appuyant sur la longue durée, il démontre la "supériorité" des formes linguistiques anciennes. La perfection d'une déclinaison, assure-t-il, est fonction du nombre de ses flexions - c'est pourquoi l'anglais et le danois doivent être regardés comme des langues particulièrement pauvres...
À peine ce 1er volume a-t-il paru que Jacob procède à sa refonte. La nouvelle version sort en 1822 (les 3 volumes suivants seront publiés entre 1826 et 1837). Tenant compte des travaux récents qui commencent à se multiplier sur les langues indo-européennes, Jacob Grimm énonce, en matière de phonétique, une loi restée célèbre sur la façon dont les lettres de même classe tendent à se substituer les unes aux autres, ce qui lui permet de restituer les mutations consonantiques avec une grande rigueur. De l'avis général, c'est de la publication de ce texte que datent les débuts de la germanistique moderne.
Peu après, dans les Deutsche Rechtsaltertümer (Göttingen, 1828), Jacob Grimm défend, dans l'esprit des travaux de Savigny, l'identité "naturelle" du droit et de la poésie. Étudiant les textes juridiques anciens, il s'applique à démontrer la précellence du droit germanique sur le droit romain, de la tradition orale sur la tradition écrite, du droit coutumier sur celui des "élites". Les institutions juridiques les plus durables, dit-il, sont-elles aussi d'origine "divine" et spontanée (selbstgewachsen). Il n'existe pas plus de créateurs de lois que d'auteurs d'épopées : le peuple seul en est la source.
En 1835, ce sont les 2 gros volumes de la Deutsche Mythologie (rééditée en 1968 par l'Akademische Verlagsanstalt de Graz). Là encore, pour son temps, Jacob Grimm fait œuvre d'érudition au plus haut degré. Parallèlement, il réaffirme son credo : comme le langage, comme la poésie populaire, les mythes sont d'origine divine ; les peuples sont des incarnations de Dieu. Son frère Wilhelm le proclame en ces termes : "La mythologie est quelque chose d'organique, que la puissance de Dieu a créé et qui est fondé en lui. Il n'y a pas d'homme dont l'art parvienne à la construire et à l'inventer ; l'homme ne peut que la connaître et la sentir".
À leur grand déchirement, les 2 frères ont dû en 1829 abandonner Kassel pour Göttingen. Ils y professent de 1830 à 1837, date à laquelle ils sont brutalement destitués pour avoir protesté avec 5 de leurs collègues contre une violation de constitution dont le roi de Hanovre s'est rendu coupable ; c'est l'affaire des "Sept de Göttingen" (Göttingen Sieben). Ils reviennent alors à Kassel, où ils consacrent l'essentiel de leur temps à leurs travaux. Wilhelm publie son Ruolandes liet (1838) et son Wernher von Niederrhein (1839). Jacob fait paraître son histoire de la langue allemande (Geschichte der deutsche Sprache, 2 vol., 1848). Après quoi, avec son frère, il se plonge dans la rédaction d'un monumental dictionnaire en 33 volumes (Deutsches Wörterbuch), qui commencera à paraître à Leipzig en 1854. L'ouvrage, équivalent du Littré pour les Français, fait encore aujourd'hui autorité.
Les frères Grimm sont alors au sommet de leur carrière. En 1840, le roi Frédéric-Guillaume IV leur propose une chaire à l'université de Berlin et les nomme membres de l'Académie des sciences. Couverts d'honneurs, ils n'occupent toutefois leur chaire que pendant quelques années, afin de pouvoir retourner à leurs études d'histoire littéraire et de philologie. Après la révolution de mars 1848, Jacob siège au Parlement de Francfort. Durant cette période finale, il mobilise toute son énergie pour la rédaction de son dictionnaire. Wilhelm meurt le 16 décembre 1859. Son frère s'éteint 4 ans plus tard, le 20 septembre 1863.
Jacob et Wilhelm ont vécu et travaillé ensemble de leur naissance jusqu'à leur mort, sans jamais abandonner leur but : la résurrection du passé national allemand. Objectif qu'ils servirent avec un savoir et un désintéressement que tous leurs contemporains leur ont reconnu. Des 2 frères, Jacob était sans doute à la fois le plus doué, le plus savant et le plus conscient de la mission à laquelle il s'était voué. Wilhelm, d'un naturel moins "ascétique", était à la fois plus artiste et plus sociable. Tonnelat écrit : "En Jacob il y a du héros. Wilhelm fut assurément très inférieur à son frère ; mais peut-être son infériorité fut-elle la rançon de son bonheur". Telle qu'elle nous est parvenue, leur œuvre a ceci de remarquable qu'elle associe une force de conviction peu commune, touchant parfois au mysticisme, avec une méticulosité et une rigueur scientifique remarquables. Les frères Grimm comptent assurément parmi les grands savants du siècle dernier. Mais en même temps, ils n’abandonnèrent jamais l'idée qu'une nation n'est grande que lorsqu'elle conserve présente à elle-même la source toujours jaillissante de l'âme populaire, et que celle-ci, au fur et à mesure qu'elle perd sa pureté originelle, s'éloigne aussi de Dieu. "Jusqu'à leur mort, écrit Tonnelat, ils ont conservé leur foi romantique dans la sainteté et la supériorité des âges anciens". Attitude que les temps actuels semblent discréditer, mais qui apparaît pourtant fort logique dès lors que l'on comprend que le "passé" et "l'avenir" ne sont jamais que des dimensions du présent - qu'ils ne sont vivables que dans le présent -, en sorte que ce qui fut "une fois" peut être appelé aussi à revenir toujours.
Notes :
1 À Steinau, on visite la maison où ils vécurent, et un petit musée évoque leur existence.
2 Un portrait de Dorothea Viehmann, dû à un autre frère Grimm, Ludwig Emil, figure comme frontispice à la 2nde édition des Contes, publiée en 1819-1822 (qui est aussi la 1ère édition illustrée).
3 On ne saurait dire si ce nationalisme des frères Grimm explique que, début janvier 1985, le Board of Deputies, organisme représentatif de la communauté juive de Grande-Bretagne, se soit donné le ridicule de demander la saisie pour "antisémitisme" d'une édition des Contes de Grimm non expurgée du conte intitulé Le Juif dans les épines (Der Jude im Dorn, conte 110, p. 638-643 de l'édition Flammarion).
4 Dans sa Deutsche Mythologie (1835, p. 586), Jacob Grimm signale lui-même que le mot allemand Hexe (sorcière) correspond à un ancien Hagalfrau (femme sage, avisée) (vieil-ht.all. hagazussa, moyen-ht.all. hexse). Ce terme renvoie au norroishgr qui a le même sens que le latin sagus (sage, avisé). Le mot anglais witch(sorcière) est de même à rapprocher de wise (sage).
5 À noter aussi que l'étymologie la plus probable pour le mot fée renvoie au latinfata, ancien nom des Parques (cf. L. Harf-Lancner, Les fées au Moyen Age. Morgane et Mélusine, la naissance des fées, Honoré Champion,, 1984).
6 Signalons, pour ne citer qu'un exemple, que le réalisateur du film L'Empire contre-attaque (2nd volet de La guerre des étoiles), Irvin Kershner, a explicitement déclaré s’être inspiré des thèses de Bettelheim pour la mise au point de son scénario.
7 "Après les crématoires d'Auschwitz, est-il encore possible de raconter comment Hänsel et Gretel poussent la sorcière dans le feu pour la brûler ?" demande très sérieusement Manfred Jahnke dans la Stuttgarter Zeitung du 29 août 1984.
http://www.archiveseroe.eu/tradition-c18393793/45
00:04 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liitérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, traditions, traditionalisme, frères grimm, grimm, allemagne, 19ème siècle, contes, contes de fées |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 octobre 2013
Julius Evola y Hakim Bey
por Juan Manuel Garayalde – Bajo los Hielos –
Ex: http://paginatransversal.wordpress.com
Charla dictada el día 16 de Diciembre de 2004 en el Centro de Estudios Evolianos, Buenos Aires, Argentina.
I – Anarquismo Mítico y Filosófico
 Como todo pensamiento político, el anarquismo ha tenido diferentes puntos de vista. Una importante cantidad de intelectuales sitúan al nacimiento del anarquismo en el siglo XIX, cuando podemos hallar en la Metamorfosis de Ovidio, una mención a un sistema político de similares características que se lo hallaría en el inicio de una Edad de Oro, donde no habría leyes, jueces ni nada que se le parezca para sancionar a los ciudadanos, puesto que entre ellos existía una visión del mundo similar. Asimismo, no podemos olvidar a las comunidades anarquistas como los seguidores del Patriarca Gnóstico Carpócrates de Alejandría que fundó comunidades cristianas en el norte de Africa y en España en el siglo II. Diferente al anarquismo filosófico del siglo XIX, que sitúa al anarquismo al final de la historia humana, como un proceso evolutivo, tal como fue formulado de manera similar el paraíso comunista de Karl Marx.
Como todo pensamiento político, el anarquismo ha tenido diferentes puntos de vista. Una importante cantidad de intelectuales sitúan al nacimiento del anarquismo en el siglo XIX, cuando podemos hallar en la Metamorfosis de Ovidio, una mención a un sistema político de similares características que se lo hallaría en el inicio de una Edad de Oro, donde no habría leyes, jueces ni nada que se le parezca para sancionar a los ciudadanos, puesto que entre ellos existía una visión del mundo similar. Asimismo, no podemos olvidar a las comunidades anarquistas como los seguidores del Patriarca Gnóstico Carpócrates de Alejandría que fundó comunidades cristianas en el norte de Africa y en España en el siglo II. Diferente al anarquismo filosófico del siglo XIX, que sitúa al anarquismo al final de la historia humana, como un proceso evolutivo, tal como fue formulado de manera similar el paraíso comunista de Karl Marx.
Dentro de esta corriente del siglo XIX, se destacaron autores como William Godwin, Proudhon, Max Stirner, Bakunin, etc.. Stirner, el más importante exponente del individualismo anarquista, fue en contra no sólo del Estado, sino en contra de la Sociedad; fue mas lejos que cualquier pensador anarquista convirtiendo al hombre en el Absoluto, la nada creadora, en ser belicoso por naturaleza que lucha por la propiedad de si mismo, la “propiedad del único”, rechazando al Estado, la burguesía, las instituciones sociales y educativas, la familia, las leyes. Destruir las ilusiones para descubrirse a sí mismo y ser dueño de sí mismo.
Su principal obra, “El único y su propiedad”, fue recibida con hostilidad por Karl Marx, quien lo ve como una amenaza a todo su materialismo dialéctico, a lo que se dedicará con esmero a refutar sus ideas. Así, el anarquismo filosófico comienza a verse como amenaza al marxismo.
Posteriormente, será Bakunin el que desafiará el crecimiento del comunismo. Este pensador anarquista, marcará la diferencia con los otros, puesto que si dicho movimiento logró cierta presencia en la lucha social, será gracias a él. Es impensable el sindicalismo anarquista sin Bakunin (recordemos a FORJA en la historia Argentina, y la famosa “Semana Trágica” de 1919). Europa quizás nunca habría presenciado un movimiento político anarquista organizado, sino hubiese sido por la labor activa de Bakunin.
II – Anarquismo, Liberalismo y Socialismo
El surgimiento del anarquismo filosófico, está enlazado a la crisis social post-medieval. La burguesía comienza a establecer relaciones con las viejas aristocracias, en tanto se demolían los gremios y asociaciones que protegían a los pequeños productores. Ante el crecimiento del comercio y las manufacturas, los viejos gremios medievales eran una traba a ese nuevo desarrollo. Los pequeños artesanos y productores agrícolas, comenzaban a quedar desamparados ante el crecimiento de la competencia, en tanto crecían los derechos monopolistas en manos de grandes compañías industriales, agrícolas y comerciales.
Surgieron en esa época de transición dos corrientes de protesta: el Liberalismo Radical, que pretendía reformas parlamentarias para frenar el poder del Estado, y el Anarquismo. Los liberales (Locke) consideraban a la propiedad como un derecho natural, y le legaban la responsabilidad al Estado para que protegiera la misma de ataques internos y externos, permitiendo así el libre intercambio de mercaderías. Los anarquistas en cambio, decían que el Estado protege la propiedad de los ricos, y que las leyes favorecen la concentración de la propiedad. Para los anarquistas, se debía crear una sociedad igualitaria de productores pequeños y económicamente autónomos, libres de privilegios o distinciones clasistas, donde el Estado sería innecesario.
Se considera al Anarquismo una ampliación radical del Liberalismo. Esto significa, que tiene mas similitudes con el Liberalismo que con el Socialismo. Sin embargo, con este último hubo alianzas, siendo que lo único en que coincidían era en la estrategia revolucionaria contra el poder burgués. Durante el siglo XX, el anarquismo participó en dos importante acontecimientos: la Revolución Rusa de 1917 y la Guerra Civil Española de 1936. En ambas, el enemigo principal que se les manifestó, fueron los comunistas, los que llegaron a hacer ejecuciones en masa de militantes anarquistas.
El anarquismo tuvo su primera gran derrota cuando Marx se adueña de la Primera Internacional, luego de acalorados debates con Bakunin. Dicha hegemonía se mantuvo hasta 1991, con la desintegración de la URSS. Desde entonces, surgirán nuevas corriente del pensamiento anarquista, pero de todas ellas, la que aquí queremos rescatar por su nueva orientación, es el anarquismo ontológico, que tiene al británico Peter Lamborn Wilson, mas conocido como Hakim Bey como su principal exponente.
III – El Anarquismo Ontológico de Hakim Bey
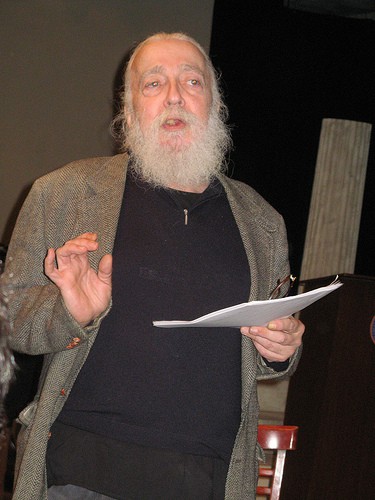 Se torna dificultoso poder definir el concepto del anarquismo ontológico, puesto que es una forma de encarar la realidad, donde no se necesitan teorías que cierren en si mismas, sino acciones que tienden a despojar al hombre de preconceptos modernos. El anarquismo ontológico es un desafío abierto a la sociedad actual, donde el Yo es puesto a prueba, para ver si es capaz de cuestionarse ciertos comportamientos y pensamientos que se manifiestan mecánicamente. Su lenguaje principal, es lo que Hakim Bey denomina el “terrorismo poético”, una forma brusca pero profunda de rechazar las convenciones de toda sociedad organizada en torno a ilusiones.
Se torna dificultoso poder definir el concepto del anarquismo ontológico, puesto que es una forma de encarar la realidad, donde no se necesitan teorías que cierren en si mismas, sino acciones que tienden a despojar al hombre de preconceptos modernos. El anarquismo ontológico es un desafío abierto a la sociedad actual, donde el Yo es puesto a prueba, para ver si es capaz de cuestionarse ciertos comportamientos y pensamientos que se manifiestan mecánicamente. Su lenguaje principal, es lo que Hakim Bey denomina el “terrorismo poético”, una forma brusca pero profunda de rechazar las convenciones de toda sociedad organizada en torno a ilusiones.
Ante la crisis espiritual que afecta principalmente a Occidente, propone Hakim Bey un nomadismo psíquico, un retorno al paleolítico, siendo mas realista que simbólico este último concepto. Como él dice, “se busca la transmutación de la cultura basura en oro contestatario”. Su frase principal es “El Caos nunca murió”, donde para él, seria el espacio donde la libertad se vive a pleno, en tanto que ve al Orden como la presentación de una serie de estructuras políticas, sociales, culturales, educativas, policiales; en sí, límites impuestos a la mente que debe poseer una naturaleza de libertad plena. Ese Orden actual, no hace más que aprisionar al hombre poniéndole por encima, leyes de una civilización que se detiene en el tiempo, para congelar y matar el Espíritu.
Bey nos dice que el Caos es derrotado por dioses jóvenes, moralistas, por sacerdotes y banqueros, señores que quieren siervos y no hombres libres. Seguidor de grupos sufíes no muy ortodoxos, plantea la jihad espiritual, la rebelión contra la civilización moderna.
El modelo social de lucha que plantea Hakim Bey, es la de la pandilla, del grupo de salteadores que tiene su propia ley. Ese es el sentido del paleolítico, la banda de cazadores y recolectores que erraban por los bosques y desiertos de una tierra antigua sin dioses tiranos.
Hace pocos años, se estrenó una película, en la cual, uno de sus realizadores, estuvo influido por los escritos de este autor. La película se llamaba “El Club de la Pelea” donde se describe un hombre sumiso al sistema económico y moral, que se le plantea una ruptura mental que lo lleva a crear un mundo real donde podía estar fuera del sistema atacándolo, burlándose del mismo continuamente.
Esto nos lleva a estudiar el aporte que consideramos el mas interesante de la obra de Hakim Bey: el concepto de TAZ, es decir, la Zona Temporalmente Autónoma.
IV – Zona Temporalmente Autónoma (TAZ)
Existe una coincidencia semántica con el pensador tradicionalista italiano, Julius Evola: Ambos autores utilizan el término “rebelión” como forma de reacción ante los síntomas de la decadencia espiritual y material del Hombre.
Para Hakim Bey, el planteo de una Revolución, implica un proceso de transformaciones donde se va de una situación caótica a un nuevo Orden, pero, un Orden al fin. El escritor nos dice: “¿Cómo es que todo mundo puesto patas arriba siempre termina por enderezarse? ¿Por qué siempre a toda revolución sigue una reacción, como una temporada en el infierno?” (1). De esta manera, un Orden dentro del Kali Yuga, implicaría retornar a una forma de conservadurismo decadente. Implica la frustración de ideales revolucionarios iniciales, ante las reacciones naturales de los que quieren volver las cosas a su cause normal, saliendo del CAOS.
H.B. utiliza los términos de “rebelión”, “revuelta” e “insurrección”, que implicaría “un momento que salta por encima del tiempo, que viola la “ley” de la historia”. En este caso, estamos muy cercanos al concepto evoliano del “idealismo mágico”.
Redondeando estas ideas: en tanto la Revolución es un proceso que va del CAOS a un Orden determinado, la rebelión que plantea H.B. es temporal: es un acto extra-ordinario, que busca cambiar el mundo y no adaptarse a él, que busca vivir la utopía y no conformarse con un Orden a medias.
Pero, si no hay un Orden determinado a crearse por parte de los anarquistas ontológicos, ¿de dónde parte la rebelión y a dónde retorna la misma una vez desatada? Allí H.B. nos habla de la TAZ, las Zonas Temporalmente Autónomas, que es un lugar físico que permite justamente un desarrollo de la libertad interior. Hay que aclarar, que la TAZ no es un concepto abstracto, sino real e histórico .. aunque esta siempre quiso manifestarse por fuera de la Historia.
Uno de los ejemplos que trata H.B., es la utopía pirata. Menciona fundamentalmente el período comprendido entre el siglo XVI y XVII. En América, la zona del Caribe es muy conocida por su historia de piratas, y el autor nos habla de la famosa Isla de la Tortuga que fue el refugio de los barcos piratas y de todo delincuente que transitó esos rumbos alejados de la civilización. Era una isla al norte de Haití, de 180 km. Cuadrados, con un mar rodeado de tiburones. En dicha isla, no existía ninguna autoridad, leyes, códigos de comercio, impuestos, y todo aquello a lo que hoy estamos sometidos para poder pertenecer a un determinado sistema social. Ellos supieron crear un sistema por fuera del Sistema, o sea, un anti-sistema, el CAOS, el lugar donde un anarquismo ontológico podía encontrar cause para su desarrollo. Si hablamos de la gente que componía los barcos piratas, hallaremos que eran de distintas razas: negros, blancos, asiáticos; distintas religiones, diferente educación y clase social de la cual quedaron desheredados: todos estaban en pie de igualdad, pero no una igualdad colectivista, sino guerrera.
Esta TAZ, esa Zona Temporalmente Autónoma que fue la Isla de la Tortuga, no duro muchos años; y esa es justamente la característica de la TAZ, su limitación en el tiempo, que según H.B. como mucho, puede durar la vida de una persona, no mas de eso, puesto que el Sistema ira en su búsqueda para destruirla. Veamos como el autor define la TAZ:
“El TAZ es como una revuelta que no se engancha con el Estado, una operación guerrillera que libera un área – de tierra, de tiempo, de imaginación- y entonces se autodisuelve para reconstruirse en cualquier otro lugar o tiempo, antes de que el Estado pueda aplastarla”. (2)
Es la estrategia de la barricada, que cuando esta viene a ser destruida, es abandonada, y levantada en otro lugar. Es el ámbito de la Internet, donde uno ingresa para criticar el sistema a través de una página web, y cuando esta cae, vuelve a aparecer en otro lugar.
Pero, sigamos con los ejemplos históricos que H.B. utiliza para describir su concepto de TAZ. En este caso, citamos un párrafo completo, con el objetivo de que puedan apreciar todos los elementos vulgares, artísticos, esotéricos, poéticos del pensador, que parece mezclar la realidad con la fantasía, con la utopía y con lo oculto. Esta forma de escribir, que como hemos dicho anteriormente, él ha definido como “terrorismo poético”:
“Por tanto, de entre los experimentos del periodo de Entreguerras me concentraré si no en la alocada república de Fiume, que es mucho menos conocida, y no se organizó para perdurar.”
“Gabriele D’Annunzio, poeta decadente, artista, músico, esteta, mujeriego, atrevido pionero aeronáutico, mago negro, genio y canalla, emergió de la I Guerra Mundial como un héroe con un pequeño ejército a sus órdenes: los “Arditi”. A falta de aventuras, decidió capturar la ciudad de Fiume en Yugoslavia y entregársela a Italia. Después de una ceremonia necromántica junto a su querida en un cementerio de Venecia partió a la conquista de Fiume, y triunfó sin mayores problemas. Sin embargo Italia rechazó su generosa oferta; el primer ministro lo tachó de loco.”
“En un arrebato, D’Annunzio decidió declarar la independencia y comprobar por cuanto tiempo podría salirse con la suya. Junto a uno de sus amigos anarquistas escribió la Constitución, que declaraba la música como el fundamento central del Estado. Los miembros de la marina (desertores y anarcosindicalistas marítimos de Milán) se autodenominaron los Uscochi, en honor de los desaparecidos piratas que una vez vivieron en islas cercanas a la costa saqueando barcos venecianos y otomanos. Los mudemos Uscochi triunfaron en algunos golpes salvajes: las ricas naves italianas dieron de pronto un futuro a la república: dinero en las arcas! Artistas, bohemios, aventureros, anarquistas (D’Annunzio mantenía correspondencia con Malatesta) fugitivos y expatriados, homosexuales, dandis militares (el uniforme era negro con la calavera y los huesos pirata; robada más tarde por las SS) y reformistas chalados de toda índole (incluyendo a budistas, teósofos y vedantistas) empezaron a presentarse en Fiume en manadas. La fiesta nunca acababa. Cada mañana D’Annunzio leía poesía y manifiestos desde el balcón; cada noche un concierto, después fuegos artificiales. Esto constituía toda la actividad del gobierno. Dieciocho meses más tarde, cuando se acabaron el vino y el dinero y la flota italiana se presentó, porfió y voleó unos cuantos proyectiles al palacio municipal, nadie tenia ya fuerzas para resistir.”
(…). En algunos aspectos fue la última de las utopías piratas (o el único ejemplo moderno); en otros aspectos quizás, fue muy posiblemente la primera TAZ moderna.” (3)
V – La TAZ en la Historia Argentina
Llegados a este punto, nos preguntamos: ¿puede hallarse un ejemplo de la TAZ en nuestra historia argentina? ¿Pudo haber hallado H.B. un ejemplo para aportar a su trabajo?. La respuesta es afirmativa, y ello lo encontramos nada mas y nada menos, que en nuestra obra cumbre de la literatura argentina: El Martín Fierro.
Esta obra, cuyo protagonista es una creación del autor, representa la confrontación entre la “Civilización” y la “Barbarie”, y forzando un poco los términos, entre la Modernidad y la Tradición. El tiempo en que se desarrolla este poema guachesco es durante el período de la organización nacional, entendido este como la adaptación de un país de carácter católico, libre y guerrero, al sistema constitucional liberal, laico, de desacralización del poder político en post de las ideologías que apuntalaron, reforzaron a la Modernidad.
Martín Fierro es el arquetipo de la “Barbarie”; el Hombre que no acepta una “Civilización” ajena a su cultura, que quiere obligarle a adoptar una nueva forma de vida, a riesgo de perderla si no obedece. Por tal motivo, Martín Fierro huye más allá de la frontera sur, a vivir con los indios. Leemos en esta obra:
“Yo sé que los caciques
amparan a los cristianos,
y que los tratan de “hermanos”
Cuando se van por su gusto
A que andar pasando sustos …
Alcemos el poncho y vamos”.
La Frontera, las tolderías, son la TAZ que supo existir en la Argentina. Allí, los hombres que estaban fuera de la ley, encontraron la libertad: fueron quienes desertaban del nuevo ejército constitucional, ladrones de ganado, asesinos, esclavos, muchachos jóvenes que huían de sus casas optando por la libertad que se vivía mas allá de la frontera. También existieron ejemplos de mujeres que cautivas de los indios, tuvieron familia, y que al regresar a la civilización, no pudieron acostumbrarse y regresaron con los indios. Martín Fierro nos describe la vida libre, hasta holgazana de vivir con los indios:
“Allá no hay que trabajar
Vive uno como un señor
De cuando en cuando un malón
Y si de él sale con vida
Lo pasa echado panza arriba
Mirando dar güelta el sol.”
Lo cierto es, que no existía mucha diferencia entre la toldería y el medio rural. La diferencia comenzó a ampliarse a medida que crecían las leyes y la coerción y se perdía la libertad que el gaucho conocía. La frontera pasa a convertirse no solo en una válvula de escape para las tensiones sociales, sino también, para las existenciales.
Pero del arquetipo, pasemos también a un ejemplo concreto, a un hombre que la literatura retrató varias veces en novelas, cuentos y obras de teatro, a lo que se le sumará muchos relatos acerca del lugar que utilizó para escapar de la “civilización”. Este hombre que hemos elegido al azar, se llamó Cervando Cardozo, conocido como Calandria por su hermosa voz para el canto. Fue un gaucho que nació en 1839 y fallece -muerto por la policía- en 1879. Tuvo una vida como cualquiera de su tiempo, pero a diferencia que decidió luchar cuando la institucionalización política del país comenzó a querer robarle su libertad. Él se incorpora a la última montonera de la historia nacional, la comandada por el caudillo entrerriano Ricardo López Jordán, al que la historia oficial, lo acusa de haber participado en asesinar al caudillo Justo J. de Urquiza, quién para entonces, era el principal responsable de las transformaciones políticas del país. Calandria peleará junto a López Jordán, y al ser derrotado su levantamiento, es obligado a incorporarse a un ejército de frontera. Calandria no acepta, y deserta. Nace así su vida de matrero, que la vivirá dentro de la provincia de Entre Ríos en la denominada Selva de Montiel, donde las fuerzas policiales jamás podrían capturarlo.
Aquí nos adentramos a una nueva TAZ: el monte. En muchas tradiciones, los bosques representan lugares prohibidos, donde abundan espíritus, criaturas fantásticas, y en donde se corría peligro de hallar una muerte horrenda. Uno de los ejemplos mas conocidos por todos, son los bosques de Sherwood donde encontraron refugio varios “fuera de la ley” que luego seguirían al famoso Roobin Hood.
En nuestra tierra, los montes representaban el lugar donde los gauchos matreros se escondían, donde hechiceros, curanderos, brujas, opas y deformes tenían su guarida. Es también el sitio donde los aquelarres se realizaban, que bien expresados están en nuestras canciones populares; por ejemplo en La Salamanca de Arturo Dávalos, dice su estribillo: “Y en las noches de luna se puede sentir, / a Mandinga y los diablos cantar”, o Bailarín de los Montes de Peteco Carabajal, en su estribillo también dice: “Soy bailarín de los montes / nacido en la Salamanca”.
Aquí haremos una breve profundización de este tema de La Salamanca: originalmente, la leyenda parte de España, de la región de Salamanca. Allí, se encontraban las famosas cuevas donde alquimistas, magos, kabbalistas, gnósticos, y otros, se reunían en secreto para eludir las persecuciones de la Inquisición. Como allí se efectuaban todo tipo de enseñanzas de carácter iniciático, quedo una leyenda negativa impulsada desde el clero católico de la época, donde allí se invocaba al demonio; y es por eso, que todo el proceso del que ingresa a la Salamanca hasta llegar frente al Diablo, es de carácter iniciático .. pero, hacia lo inferior. Es por eso, que se dice, que en la actualidad, hay dos entradas a la Salamanca con resultados diferentes, uno de ascenso y otro de descenso. La Salamanca, es para la TAZ argentina, el modelo de iniciación, en tanto se logre hallar “la otra puerta”.
Retomando, la Selva de Montiel (llamada así, por lo impenetrable de la misma) fue el refugio de muchos, como Calandria, que se resistieron al cambio, a perder su libertad y apego a la tradición a causa – como dice un motivo popular entrerriano – de la reja del arado, de la división de la tierra y del alambrado. Estos matreros conservaron en pequeña escala parte de la figura que representaron en otro momento los Caudillos, puesto que tenían un respeto y comprensión hacia los pobladores, y estos terminaban siendo cómplices silenciosos de las aventuras de estos outsiders.
Cito aquí, un párrafo de la obra de teatro “Calandria” de Martiniano Leguizamón, estrenada en 1896. En este fragmento que leeré, habla el gaucho matrero frente a la tumba de su Madre:
“¡Triste destino el mío! …. ¡Sin un rancho, sin familia, sin un día de reposo! … ¡Tendré al fin que entregarme vensido a mis perseguidores! … Y ¿pa qué? ¿Por salvar el número uno? … ¿Por el placer de vivir? … ¡No, si la libertad que me ofrecen no had ser más que una carnada! No; no agarro. ¡Qué me van a perdonar las mil diabluras que le he jugao a la polesía! ¡Me he reído tanto de ella y la he burlao tan fiero! … (Riendo) ¡La verdá que esto es como dice el refrán: andar el mundo al revés, el sorro corriendo al perro y el ladrón detrás del jues! … ¡Bah … si el que no nació pa el cielo al ñudo mira pa arriba!” (4)
Calandria no fue el único de estos gauchos matreros. Nuestro Atahualpa Yupanqui fue un gaucho matrero en los años ´30. Luego de una fallida revolución radical en la que participó, huyo a Entre Ríos y se ocultó en la Selva de Montiel. Fue en esa época que compuso la canción “Sin caballo y en Montiel”.
Pero avancemos más en esta construcción de la TAZ en nuestra tierra. Si el gaucho matrero es una representación, en pequeña escala, del Caudillo, ¿dónde podemos hallar una figura de tal magnitud que cuadre con el modelo del anarquismo ontológico?. Podremos hallar verdaderas sorpresas en nuestra historia nacional. Una de ellas, es la del joven Juan Facundo Quiroga, el “Tigre de los Llanos”, que por las descripciones que se hicieron sobre su persona, nos atrevemos a decir que fue uno de los primeros líderes anarcas que hubo en nuestra historia nacional.
Sarmiento, que conoció a Quiroga en su etapa juvenil -no ya la adulta donde se comenzaría a preocuparse por la forma organizativa que debía lograrse con la Confederación Argentina-, en su “Facundo”, entre el odio y la admiración escribe estas palabras sobre Quiroga:
“Toda la vida publica de Quiroga me parece resumida en estos datos. Veo en ellos el hombre grande, el hombre genio a su pesar, sin saberlo él, el César, el Tamerlán, el Mahoma. Ha nacido así, y no es culpa suya; se abajará en las escalas sociales para mandar, para dominar, para combatir el poder de la ciudad, la partida de la policía. Si le ofrecen una plaza en los ejércitos la desdeñará, porque no tiene paciencia para aguardar los ascensos, porque hay mucha sujeción, muchas trabas puestas a la independencia individual, hay generales que pesan sobre él, hay una casaca que oprime el cuerpo y una táctica que regla los pasos ¡todo es insufrible!. La vida de a caballo, la vida de peligros y emociones fuertes han acerado su espíritu y endurecido su corazón; tiene odio invencible, instintivo, contra las leyes que lo han perseguido, contra los jueces que lo han condenado, contra toda esa sociedad y esa organización de que se ha sustraído desde la infancia y que lo mira con prevención y menosprecio. (…) Facundo es un tipo de barbarie primitiva; no conoció sujeción de ningún género; su cólera era la de las fieras …” (5)
Y como todo anarca, Quiroga no era de los hombres que querían sentarse en un escritorio a gobernar lo que mucho le había costado conseguir. Sus batallas nunca finalizaron. Citamos nuevamente a Sarmiento:
“Quiroga, en su larga carrera, jamás se ha encargado del gobierno organizado, que abandonaba siempre a otros. Momento grande y espectable para los pueblos es siempre aquel en que una mano vigorosa se apodera de sus destinos. Las instituciones se afirman o ceden su lugar a otras nuevas más fecundas en resultados, o más confortables con las ideas que predominan. (…)
“No así cuando predomina una fuerza extraña a la civilización, cuando Atila se apodera de Roma, o Tamerlán recorre las llanuras asiáticas; los escombros quedan, pero en vano iría después a removerlos la mano de la filosofía para buscar debajo de ellos las plantas vigorosas que nacieran con el abono nutritivo de la sangre humana. Facundo, genio bárbaro, se apodera de su país; las tradiciones de gobierno desaparecen, las formas se degradan, las leyes son un juguete en manos torpes; y en medio de esta destrucción efectuada por las pisadas de los caballos, nada se sustituye, nada se establece”. (6)
Aquí se ven con claridad los conceptos de H.B. de psiquismo nómade y de un retorno al paleolítico.
VI – Anarquismo Ontológico y Tradición
Hasta aquí, hemos trazado un paralelismo entre el concepto de la TAZ de H.B. y nuestra historia nacional. Nuestra tarea a continuación es ver a donde nos puede llevar el anarquismo ontológico.
Esta postura, la creemos positiva para el impulso de un Nihilismo Activo, que consistirá en construir bases de acción que son la TAZ: su acción es decontructora, de rechazo a los valores y estructuras de pensamiento de la Modernidad. El anarquismo ontológico ha sabido descubrir en la historia a los outsiders del sistema, y este tema, es una eterna preocupación de la filosofía política contemporánea. Por ejemplo, uno de los pensadores mas importantes del neoliberalismo, Robert Nozick, (7) recientemente fallecido, nos habla de un estado de naturaleza donde paso a paso se va construyendo el Estado Liberal ideal para la sociedad actual. Nos habla de una Asociación de Protección Dominante, donde unos trabajan y otros toman el papel de defender a la comunidad de los agresores externos. De allí, se pasa al Estado Ultramínimo, que tiene como objetivo, justamente, incorporar a los outsiders .. a los fuera de la ley. Supuestamente, para Nozick, los outsiders se integrarían a la sociedad al ofrecerles protección gratuita para que puedan vivir en paz, lo que denominó principio de compensación. Dicho intento teórico fracaso, sobrándonos ejemplos reales para comprobarlo históricamente. El anarca no necesita que nadie lo proteja. El es libre de vivir y morir en su propia Ley. (8)
El Anarquismo Ontológico ha tenido una importante repercusión en los jóvenes, y esta idea de la TAZ hasta fue llevada al cine. La película “El Club de la Pelea” con Eduard Norton y Brad Pitt como actores principales, nos presenta la atmósfera de una generación de jóvenes sin ideales, con futuro incierto y, sobre todo, la revelación absoluta de su propia soledad en el mundo. Allí, como en Doctor Jekill y Mister Hyde, hay un hombre que no se atreve a liberarse de sus propias cadenas, a vivir el mundo sin tratar de controlarlo.
Una película como el Club de la Pelea nos muestra que estamos solos, que no hay nadie allá afuera con los brazos abiertos esperándonos. Uno de los personajes de esta película, Tyler Durden, en su discurso donde inaugura su TAZ, el Club de la Pelea, viviendo en un edificio abandonado en ruinas y rodeado de jóvenes rebeldes, dice: Veo en el Club a los hombres más listos y fuertes, veo tanto potencial y veo que se desperdicia. Dios mío, una generación vendiendo gasolina, sirviendo mesas, esclavos de cuello blanco y todos esos anuncios que promueven el desear autos y ropas con marcas de un tipo que nos dicta cómo debemos vernos. Hacemos trabajos odiosos para comprar lo innecesario, hijos en medio de la Historia sin propósito ni lugar…
Como nos dice con certeza H.B.: “El capitalismo, que afirma producir el Orden mediante la reproducción del deseo, de hecho se origina en la producción de la escasez, y sólo puede reproducirse en la insatisfacción, la negación y la alienación.” (9)
Y, en ese Club de la Pelea, los que lo integran, justamente, aprenden a pelear y no a huir … aprenden a reconciliarse con su propio pasado, a vencer el miedo y la angustiosa realidad materialista; y en el fondo, siempre manifestándose una lucha existencial.
Julius Evola, en su obra “El Arco y la Clava”, en oposición a ciertos movimientos juveniles modernos, describe una nueva orientación denominada anarquismo de derecha: aquí, nos habla de muchachos que no pierden su idealismo luego de pasar los 30 años. Jóvenes con un entusiasmo e impulso desmesurados, “con una entrega incondicionada, de un desapego respecto de la existencia burguesa y de los intereses puramente materiales y egoístas” (10). Una generación que puede hallarse en el presente, que asuman valores como el coraje, la lealtad, el desprecio a la mentira, “la incapacidad de traicionar, la superioridad ante cualquier mezquino egoísmo y ante cualquier bajo interés” (11); todos valores que están por encima del “bien” y del “mal”, que no caen en un plano moral, sino ontológico. Es mantenerse de pie con principios inmerso en un clima social desfavorable, agresivo; capaz de luchar por una causa perdida con una fuerza y energía sobrenatural, que termina inspirando el terror en sus rivales, y entre estos quizás, uno que logre despertar ante lo que creyó como una amenaza. Pocos hombres como estos, serían capaces de detener ejércitos en algún acantilado de la antigua Grecia, o, en los tiempos que hoy vivimos, tomar una Isla del Atlántico Sur sin matar ningún civil o soldado enemigo.
Pero, a diferencia de H.B., la TAZ, el anarquismo ontológico sólo puede ser considerado como una estrategia para la aceleración de los tiempos; pero, dentro de esa TAZ, deberán recrearse los principios de una Orden, que deberá reconstruir el mundo arrasado basándose en los principios de la Tradición Primordial.
Lo que nos separará siempre de la postura anarquista frente a la tradicional, es la aspiración de edificar un Estado Orgánico, Tradicional, y a confrontar un igualitarismo de proclama con las Jerarquías Espirituales. Como en un tiempo estuvieron unidos el Socialismo y el Anarquismo en la estrategia revolucionaria, en el presente, el Anarquismo Ontológico sigue el mismo camino postulado por el pensador italiano Julius Evola, de cabalgar el tigre, de controlar el proceso de decadencia para estar presentes el día en que el Tiempo se detenga. Quizás, cuando llegue ese día, ambas posturas estén unidas en la tarea de construir una nueva Civilización que sea inicio de una nueva Era.
En similitud el caso argentino, sin un Juan Facundo Quiroga que comenzó a desafiar la autoridad iluminista del Partido Unitario, en los años ´20 del siglo XIX, sumergiendo al país en la anarquía junto con otros Caudillos, no hubiese llegado una década mas tarde, un Juan Manuel de Rosas a comenzar a edificar la Santa Confederación Argentina: ambos son parte del Ser y del Devenir; ambos parte de la “Barbarie” en oposición al anti – espíritu alienante de la “Civilización”. El anarca y el Soberano Gibelino terminan juntos trayendo el alma del Desierto a las ciudades sin Luz interior.
No queremos concluir esta exposición sin volver a retrotraernos a nuestra tradición folclórica, a la TAZ que intentó resistir el avance de la Modernidad. Hoy, aquí reunidos, hemos conformado una TAZ. Y cuando cada uno de nosotros se haya marchado y las luces de este lugar se apaguen, la TAZ se disolverá para luego crearse en otros lugares. El espíritu rebelde del Martín Fierro, está en nosotros viviendo a través de todos estos años.
Concluimos con un fragmento de un poema con el cual nos identificamos, dedicado al gaucho Calandria, que murió peleando en su propia ley y soñando permanecer por siempre libre en su Selva de Montiel:
“En mí se ha reencarnado el alma de un matrero,
como la de Calandria, el errabundo aquél,
que amaba la espesura, igual que el puma fiero,
y que amplió las leyendas del bravío Montiel”
* * *
Notas:
(1) Hakim Bey. TAZ. Zona Temporalmente Autónoma. http://www.merzmail.net/zona.htm
(2) Hakim Bey. Ob. Cit.
(3) Idem.
(4) Leguizamón, Martiniano. Calandria. Del Viejo Tiempo. Edit. Solar/Hachette – Buenos Aires 1961. P..47.
(5) Sarmiento, Domingo F. Facundo. Civilización y Barbarie. Ed. Calpe – Madrid, 1924. p.106-107.
(6) Sarmiento, Domingo F. Ob. Cit. p. 123.
(7) Nozick, Robert. Anarquia, Estado y Utopía. FCE – Buenos Aires, 1991.
(8) Existe una diferencia entre el anarquismo (los “ismos”) y el anarca, concepción que esta mas cercana a la filosofía de Max Stirner. El escritor mexicano José Luis Ontiveros, nos da una explicación del mismo: “El anarca es un autoexiliado de la sociedad. El anarca es, también, un solitario, que cree en el valor incondicional y absoluto de los actos. A diferencia del anarquista, el anarca ha dejado de confiar en la bondad natural del ser humano, y en utopías y fórmulas filantrópicas que salven o rediman a la humanidad. Su ser se funda, en el sentido original de la voz griega anarchos “sin mando”, pero su autoridad individualista reconoce principios como la disciplina y la moral de la guerra, su combate se libra contra cuando menos dos o tres enemigos, su ámbito es el bosque, el fuego, la montaña en donde el hombre debe abandonar la máscara de la sociabilidad, para retornar a la experiencia primigenia, al ser que se otorga a sí mismo la voluntad”. Ontiveros, José Luis. Apología a la Barbarie. Ediciones Barbarroja – España 1992. p. 38.
(9) Hakim Bey. Ob. Cit.
(10) Evola, Julius. El Arco y la Clava. Editorial Heracles – Buenos Aires 1999. p. 244.
(11) Evola, Julius. Ob. Cit. p. 245.
Fuente: Bajo los Hielos
00:05 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, anarchisme, anarchisme ontologique, tradition, traditionalisme, julius evola, hakim bey |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 06 octobre 2013
Archetipi della Russia nella lettura di Elémire Zolla
Archetipi della Russia nella lettura di Elémire Zolla
Ex: http://www.centrostudilaruna.it
 Nel suo libro Archetipi (Marsilio, Venezia, 2002), Elémire Zolla descrive i modelli mitici con un linguaggio allusivo, quasi esso stesso simbolico, che lascia spazio all’intuito del lettore e ne sollecita il risveglio.
Nel suo libro Archetipi (Marsilio, Venezia, 2002), Elémire Zolla descrive i modelli mitici con un linguaggio allusivo, quasi esso stesso simbolico, che lascia spazio all’intuito del lettore e ne sollecita il risveglio.
Il superamento del dualismo io/mondo, il senso dell’Uno-Tutto, i significati archetipici dei numeri, il continuo richiamo alla loro valenza simbolica, la loro percezione emotiva e non freddamente intellettuale, la esplicazione della loro funzione: lo studioso introduce in un mondo antico, a volte addirittura primordiale, eppure straordinariamente presente nel nostro tempo.
“Un archetipo – egli scrive – è ciò che aduna in un insieme una pluralità di oggetti, coordinandoli a certi sentimenti e pensieri. Il contatto con un archetipo non si può esprimere nel linguaggio ordinario, esige esclamativi e idiotismi, comporta una certa eccitazione. Quando una mente feriale sfiori un archetipo, smarrisce il suo instabile equilibrio e cade nella disperazione. Può capitare all’improvviso: scatta l’amore durante una recita galante, scoppia la furia nell’occasione più futile, cala la disperazione quando l’ambizione è soddisfatta, il dovere compiuto, l’affetto di tutti assicurato … Una vita del tutto sensata e disciplinata è un’utopia: crede di poter ignorare gli archetipi. L’uomo ha bisogno di assiomi per la mente e di estasi per la psiche come ha bisogno di cibo per il corpo: estasi e assiomi possono provenire solo dal mondo degli archetipi. Né bastano estasi lievi, brividi modesti: la psiche cerca la pienezza del panico. L’uomo vuole periodicamente smarrirsi nella foresta degli archetipi. Lo fa quando sogna, ma i sogni non bastano. Deve sparire da sveglio, rapìto da un archetipo in pieno giorno” (p.76).
Eppure, è difficile dare una definizione precisa ed esauriente degli archetipi. Essi sono, per Zolla, “energie formanti”, ma li potremmo anche chiamare “miti mobilitanti” che parlano alla psiche dell’uomo, “idee-forza” primordiali che si rivolgono al cuore, alle emozioni, alla sensibilità e che quindi rifuggono da un inquadramento rigido nel pensiero dialettico.
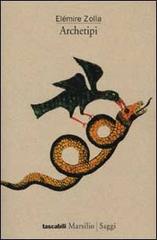 Nel quadro di un intero capitolo dedicato alla “politica archetipale”, ossia alle risonanze degli archetipi nel dominio politico, Zolla illumina anche gli archetipi che si sono manifestati nella storia russa.
Nel quadro di un intero capitolo dedicato alla “politica archetipale”, ossia alle risonanze degli archetipi nel dominio politico, Zolla illumina anche gli archetipi che si sono manifestati nella storia russa.
“Bisanzio instillò il suo ultimo mito nella Roma teocratica, ma in Russia risorse. Certi circoli ecclesiastici vi coniarono il mito di Mosca come terza e ultima Roma. Ivan III sposò nel 1472 la nipote di Costantino Paleologo. Era come se il destino russo fosse stato suggellato quando, secondo la vecchia cronaca, gli inviati di Vladimir ispezionarono per lui l’Islam, l’Occidente e Bisanzio. Nell’Islam li colpì uno scomposto fervore, nell’Occidente non ravvisarono traccia di gloria, ma la bellezza dei riti bizantini non riuscirono a scordarla.
Ivan IV il terribile assunse il titolo di zar, parola slavonica assonante con Caesar. Nel secolo XVI fu lanciata la leggenda di Augusto che aveva assegnato la Russia a Prus, avo di Rjurik, fondatore della prima dinastia” (p.104).
Vladimir, il duca di Mosca nel X secolo: tanto è antica la vocazione bizantina della Russia. La descrizione di Zolla coincide con quella di Arnold Toynbee, ma aggiunge questa importante leggenda di Augusto che esprime un richiamo ideale diretto alle origini dell’Impero Romano d’Occidente e non solo a Bisanzio; il mito si fa storia e la storia diviene incarnazione di un mito. In questa dimensione mitica possiamo cogliere l’anima russa molto più di quanto non ci dicano le cronache, le successioni dinastiche, gli intrighi diplomatici.
L’analisi di Zolla si differenzia da quella di Toynbee quando evidenzia che il mito incrollabile degli Zar fu la liberazione dell’ortodossia prigioniera dei Turchi, la conquista di Costantinopoli chiave dell’impero ecumenico.
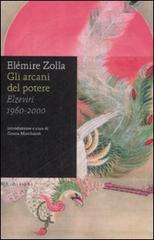 Nella storia e nella cultura russa, Zolla coglie due miti: quello “costantinianeo”- ossia il mito dell’Imperatore romano-orientale – e quello dell’imperatore-filosofo, di ascendenza ellenica e platonica che ha la sua riemersione nel pensiero, negli scritti e nell’opera di Giorgio Gemisto Pletone, che nel XV secolo pone il seme fecondo della fioritura del neoplatonismo “pagano” prima in Grecia, a Mistrà, poi in Italia, in occasione del suo viaggio nel 1439. Quando Bisanzio cadde, nel 1453, per mano dei Turchi, avvenne una divaricazione dei due miti: i neoplatonici greci si trasferirono in Italia, mentre il mito dell’imperatore “costantinianeo” rifiorì in Russia. Eppure, anche il mito dell’imperatore-filosofo trova una sua espressione nella storia russa: Pietro il Grande, nel 1721, abolì il patriarcato ortodosso di Mosca, proclamò la tolleranza religiosa e assunse il titolo latino di Imperator; il mito imperiale-filosofico eclissò, in quel momento, il mito dell’imperatore costantinianeo.
Nella storia e nella cultura russa, Zolla coglie due miti: quello “costantinianeo”- ossia il mito dell’Imperatore romano-orientale – e quello dell’imperatore-filosofo, di ascendenza ellenica e platonica che ha la sua riemersione nel pensiero, negli scritti e nell’opera di Giorgio Gemisto Pletone, che nel XV secolo pone il seme fecondo della fioritura del neoplatonismo “pagano” prima in Grecia, a Mistrà, poi in Italia, in occasione del suo viaggio nel 1439. Quando Bisanzio cadde, nel 1453, per mano dei Turchi, avvenne una divaricazione dei due miti: i neoplatonici greci si trasferirono in Italia, mentre il mito dell’imperatore “costantinianeo” rifiorì in Russia. Eppure, anche il mito dell’imperatore-filosofo trova una sua espressione nella storia russa: Pietro il Grande, nel 1721, abolì il patriarcato ortodosso di Mosca, proclamò la tolleranza religiosa e assunse il titolo latino di Imperator; il mito imperiale-filosofico eclissò, in quel momento, il mito dell’imperatore costantinianeo.
Caterina II, amica dei philosophes e imperatrice-filosofa, si presenta come Minerva o Astrea rediviva e riporta in terra il regno di Saturno come Augusto. Ella educa, però, il nipote da principe bizantino e per porlo sul trono si allea con Giuseppe II, l’imperatore-filosofo dell’Occidente.
“I due miti, il costantiniano e il filosofico – scrive Zolla – sedurranno alternativamente gli Zar che si troveranno sempre tutti impediti all’ultimo di raggiungere il Bosforo: Nicola I, Alessandro II, Nicola II” (p.105.)
La soggezione all’archetipo parve interrotta con la rivoluzione bolscevica del 1917 in cui Zolla coglie la manifestazione, su un piano materialistico, dell’archetipo romùleo, ossia l’irruzione di un modello di violenza e di forza distruttrice e creatrice, come Romolo si era affermato fondatore di Roma uccidendo Remo. In realtà, l’interruzione dell’archetipo fu solo una maya, come direbbero gli Indiani.
“Lo stemma bolscevico ripropone gli dèi delle rifondazioni, l’astro rosso di Marte, il martello di Vulcano, la falce di Saturno coi mannelli del suo regno restaurato. Il cranio sfondato di Trotzky conferì allo Stato proletario la compattezza che a Roma era venuta dal cadavere di Remo. Si compirono molte mosse simboliche oscure: la capitale riportata alla terza Roma, la Chiesa ortodossa ricostituita in patriarcato, il Fondatore mummificato come un faraone” (p. 105).
E ancora Zolla ricorda come l’ossessione del Bosforo rimase intatta nei colloqui fra Ribbentropp e Molotov.
 Riguardo ai simboli arcaici presenti nel bolscevismo, Evola e Guénon avrebbero sicuramente parlato – come del resto fecero – di segni di una contraffazione contro-iniziatica. Gli archetipi di Marte, Vulcano e Saturno agirono nelle forme di una religione rovesciata, il “credo” dell’ateismo.
Riguardo ai simboli arcaici presenti nel bolscevismo, Evola e Guénon avrebbero sicuramente parlato – come del resto fecero – di segni di una contraffazione contro-iniziatica. Gli archetipi di Marte, Vulcano e Saturno agirono nelle forme di una religione rovesciata, il “credo” dell’ateismo.
Il filo rosso della storia russa è, dunque, il costante richiamo al modello della romanità nella duplice e oscillante versione dell’imperatore costantinianeo e dell’imperatore-filosofo, fra Bisanzio e la Grecia classica, fra l’impero assolutistico di stampo più orientale e il modello romano-occidentale più tollerante e pluralista.
Comunque, pur in questa oscillazione, la Russia scelse consapevolmente di connettersi all’Impero Romano d’Oriente e di raccoglierne l’eredità, pur avendo la possibilità storica di accogliere altri modelli, come quello religioso giudaico scelto dai Kazari nel IX secolo d.C., o quello turco-islamico.
E tale costante è fondamentale per inquadrare la vocazione storica della Russia e la sua anima, nonché le basi della sua comunanza culturale con l’Europa.
00:05 Publié dans Terres d'Europe, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, terres d'europe, elémire zolla, italie, traditions, traditionalisme, archétypes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 septembre 2013
Vivir de acuerdo a la Tradición

Vivir de acuerdo a la Tradición
Para los Europeos, vivir de acuerdo a su tradición, ante todo, ha de suponer un despertar de la conciencia, una sed de verdadera espiritualidad, practicada a través de la reflexión personal mientras se está en contacto con un pensamiento superior. El nivel educativo no constituye una barrera para uno. "El aprendizaje de muchas cosas", dijo Heráclito, "no enseña el entendimiento". Y añadió: "A todos los hombres les es concedida la capacidad de conocerse a sí mismos y pensar correctamente." También uno debe practicar la meditación, aunque la austeridad no es necesaria. Jenófanes de Colofón proporcionó incluso estas amables instrucciones: "Uno debe tener esta conversación a la orilla del fuego en la temporada de invierno, acostado en un sofá suave, bien alimentado, bebiendo vino dulce y mordisqueando arvejas: "¿Quién eres tú entre los hombres, y de dónde eres?". Epicuro, que era más exigente, recomendó dos ejercicios: llevar un diario personal e imponerse a uno mismo un examen de conciencia todos los días. Eso mismo era lo que los estoicos practicaban también. Con las Meditaciones de Marco Aurelio, ellos nos legaron un modelo para todos los ejercicios espirituales.
00:05 Publié dans Nouvelle Droite, Réflexions personnelles, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, dominique venner, nouvelle droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 26 septembre 2013
Actualité de René Guénon
Actualité de René Guénon
par Georges FELTIN-TRACOL
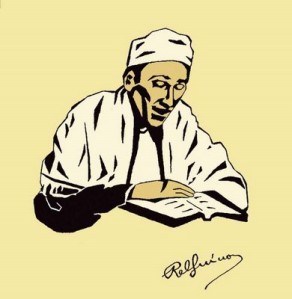 René Guénon (1886 – 1951) est mal vu des milieux identitaires qui n’apprécient pas sa conversion à l’islam soufi dès 1911 sous le nom musulman d’Abd el-Wâhed Yahia, « Serviteur de l’Unique ». Quant aux milieux contre-révolutionnaires, outre ce tropisme oriental marqué, ils l’accusent d’être passé par la franc-maçonnerie et certains cénacles gnostiques. Or ces attaques bien trop réductrices éclipsent une œuvre intellectuelle majeure. « La pensée de Guénon constitue un chapitre original, et non négligeable, de l’histoire intellectuelle (p. 488). »
René Guénon (1886 – 1951) est mal vu des milieux identitaires qui n’apprécient pas sa conversion à l’islam soufi dès 1911 sous le nom musulman d’Abd el-Wâhed Yahia, « Serviteur de l’Unique ». Quant aux milieux contre-révolutionnaires, outre ce tropisme oriental marqué, ils l’accusent d’être passé par la franc-maçonnerie et certains cénacles gnostiques. Or ces attaques bien trop réductrices éclipsent une œuvre intellectuelle majeure. « La pensée de Guénon constitue un chapitre original, et non négligeable, de l’histoire intellectuelle (p. 488). »
Par une brillante étude, David Bisson expose d’une manière précise et intelligible le parcours de ce penseur méconnu sans s’arrêter à sa seule vie et à ses idées. Il s’attache aussi à saisir son aura, directe ou non, sur ses contemporains et étudie même sa postérité intellectuelle.
Né à Blois dans un milieu catholique pratiquant, l’enfant Guénon à la santé très fragile se différencie par une intelligence vive et précoce. Sa jeunesse est occultiste, gnostique et pleine de fougue pour le martinisme du « Philosophe inconnu » Louis-Claude de Saint-Martin (1743 – 1803).
L’auteur détermine trois grandes périodes dans la vie de Guénon. De 1906 à 1920, ce sont les années de « l’apprentissage occulte »; puis de 1921 à 1930, le temps de « la reconnaissance intellectuelle », et, enfin, de 1931 à 1951, le moment de « l’accomplissement doctrinale ». Cette dernière commence le 5 mars 1930 quand Guénon part pour Le Caire sans savoir qu’il ne reviendra jamais plus en France.
L’éloignement géographique ne l’empêche pas de suivre avec attention l’activité de ses disciples. Le chercheur rapporte que l’homme du Caire relit toujours tous les articles paraissant dans la revue Études Traditionnelles. Par ailleurs, c’est un grand épistolier qui dispose d’« un réseau international de correspondants (p. 163) ».
La publication de livres, la rédaction d’articles et de recensions ainsi que l’envoi de ses missives forment un ensemble théorique complet. Guénon construit ainsi une œuvre entre l’unité intellectuelle (la métaphysique) et la réalité métahistorique (la tradition). La notion de métahistoire est très importante, car « pour Guénon, l’histoire n’est que contrefaçon. Elle correspond à la dernière étape d’un processus de déclin qui s’accélère au fur et à mesure que l’humanité avance dans l’âge sombre (p. 103) ». En revanche, hors de ce champ profane existe la Tradition. « Une partie essentielle de la pensée guénonienne tient dans cette formule imaginée : d’un côté, la Tradition se déploie en de multiples branches en fonction des conditions historiques et des aires géographiques et, de l’autre, le monde moderne a rompu avec ses attaches traditionnelles jusqu’à mettre en péril l’équilibre universel. D’où le remède envisagé : se ressourcer dans la connaissance orientale afin de retrouver son axe véritable (p. 45). » Or comment faire concrètement ? Se pose ici la question de l’initiation largement développée par l’auteur. Pour Guénon, l’initiation relève d’un groupe rattaché à une tradition viable parce que « la tradition primordiale doit effectivement déboucher sur une réalisation métaphysique, c’est-à-dire une voie de ressourcement intérieur qui engage l’individu sur le chemin de la connaissance (p. 81) ». Les modes d’accès en Occident sont la franc-maçonnerie demeurée opérative et non pas sa version spéculative et laïciste, et l’Église catholique. Mais il reconnaît que ces deux voies sont presque fermées et invite ceux qui le souhaitent à se convertir à une religion d’Orient, l’islam par exemple. Pour les personnes tentées par l’hindouisme, il les invite à s’installer en Inde. René Guénon est conscient de sa fonction de pôle intellectuel. Son « écriture […] comporte une part vocationnelle. Elle doit dire la métaphysique dans une “ langue profane ”, c’est-à-dire rappeler les principes immémoriaux de la connaissance à un monde coupé de ses racines transcendantes (p. 91). »
Les écrits de Guénon favorise au fil des années la formation de groupes soufis en Europe ainsi qu’un courant spiritualiste au sein de la franc-maçonnerie. Bien entendu, toutes ces initiatives demeurent confidentielles.
David Bisson consacre une longue partie de son essai à la période 1951 – 1980 et à l’ascendance post mortem de Guénon. Déjà, de son vivant, il intriguait déjà quelques fins lettrés : Pierre Drieu la Rochelle ou la philosophe de l’enracinement et amie indéniable du monde ouvrier Simone Weil qui « a lu avec intérêt les ouvrages de Guénon sans pour autant épouser la perspective traditionnelle (p. 295) ».
 Dès les années 1930, René Guénon rencontre un élève talentueux en la personne de Frithjof Schuon. Converti à l’islam et devenu très tôt cheikh (chef spirituel) d’une tarîqa (communauté) soufie, Schuon entend régler la question de l’initiation des Européens par l’islam. Il déclare ainsi qu’« il faut islamiser l’Europe (p. 172) » avant de revenir à des dispositions plus nuancées. Après 1945, le musulman Schuon est devenu un fin connaisseur du christianisme. Il considère que les sacrements chrétiens font des chrétiens des initiés involontaires ou ignorants. Il vouera ensuite un culte particulier à la Vierge Marie et s’ouvrira au chamanisme amérindien. En 1981, Schuon s’installe aux États-Unis dans l’Indiana d’où il décédera dix-sept ans plus tard.
Dès les années 1930, René Guénon rencontre un élève talentueux en la personne de Frithjof Schuon. Converti à l’islam et devenu très tôt cheikh (chef spirituel) d’une tarîqa (communauté) soufie, Schuon entend régler la question de l’initiation des Européens par l’islam. Il déclare ainsi qu’« il faut islamiser l’Europe (p. 172) » avant de revenir à des dispositions plus nuancées. Après 1945, le musulman Schuon est devenu un fin connaisseur du christianisme. Il considère que les sacrements chrétiens font des chrétiens des initiés involontaires ou ignorants. Il vouera ensuite un culte particulier à la Vierge Marie et s’ouvrira au chamanisme amérindien. En 1981, Schuon s’installe aux États-Unis dans l’Indiana d’où il décédera dix-sept ans plus tard.
Schuon insiste sur une « gnose universaliste (p. 332) » et s’apparente parfois à un syncrétisme qui met mal à l’aise d’autres fidèles guénoniens comme Michel Vâlsan, le gardien d’un soufisme guénonien de stricte observance. Des traditionalistes accusent Schuon de se faire « le porte-parole d’un ésotérisme universaliste ou essentialiste qui tend à dépasser le cadre limité des formes traditionnelles (p. 356) ».
Outre Schuon qui s’oriente vers de « nouvelles voies spirituelles », expression plus appropriée que « nouveaux mouvements religieux (p. 468) », David Bisson ne peut pas ne pas mentionner l’Italien Julius Evola dont les réflexions suscitent de fortes contestations de la part des milieux guénoniens. Si « l’auteur italien a trouvé […] le moyen de ne pas sombrer dans le nihilisme grâce à ses lectures traditionnelles. Ainsi, l’homme doit être capable de s’ouvrir à la transcendance pour faire de la volonté pure une source de transfiguration (p. 229) », il n’en demeure pas moins qu’Evola fait figure d’hétérodoxe de la Tradition par ses prises de position politiques radicales, ses références païennes et son engagement partisan.
Plus surprenant, on apprend que Carl Schmitt était lui aussi un lecteur assidu du Français du Caire sans être pour autant traditionaliste primordial. Il en déduit surtout une nouvelle forme d’« étaticité ». « La tradition oubliée et la religion dépecée, Schmitt tente de construire un nouveau rempart contre l’homme lui-même : l’État souverain et décisionniste (p. 281). »
David Bisson prévient toutefois que René Guénon « garde une certaine méfiance vis-à-vis des auteurs qui accordent une place trop importante à la sphère politique. Une nouvelle fois, il s’agit de protéger la Tradition de toutes récupérations partisanes (p. 170) ». Le message guénonien se veut apolitique ou même anti-politique. « À la différence du conservateur, le penseur antimoderne s’attache à la défense de valeurs établies (statu quo ante) qu’il ne projette ses propres valeurs, considérées comme éternelles, dans l’histoire présente et à venir (p. 9). » Existe cependant un cas particulier, le Roumain Mircea Eliade.
Pendant l’Entre-Deux-Guerres, ce jeune homme doué a déjà lu Guénon et a séjourné en Inde de 1929 à 1931. Puis, de retour en Roumanie, de 1932 à 1935, ses centres d’intérêt sont philosophiques, religieux et historiques. Il se détourne de la politique et ne se commet pas avec la Garde de Fer de Corneliu Codreanu. Si certains guénoniens roumains s’en détournent, d’autres au contraire le rejoignent avec enthousiasme. Puis, entre 1935 et 1938, Eliade milite au sein de la Légion de l’Archange Saint-Michel en compagnie d’un autre grand esprit dace du XXe siècle, Cioran. Suite à quelques avanies politiques, Eliade cesse toute activité militante en 1938, prend ses distances avec la Tradition et commence à travailler sur l’histoire des religions. La distanciation avec la politique semble être une constante dans la pensée guénonienne. Néanmoins, David Bisson estime que la pensée de Guénon porte en elle une indéniable part politique qui se vérifient avec le parcours d’Eliade. « Plus que l’engagement politique des années trente, circonstancié et ponctuel, c’est le cadre normatif dans lequel Eliade inscrit toute sa pensée qui le relie à Guénon. Si les deux hommes ne partagent pas exactement les mêmes conceptions, ils forgent leurs idées dans le même creuset idéologique (p. 388). » Sa brillante carrière postérieure à la seconde Guerre mondiale a soulevé de virulentes controverses. désormais universitaire reconnu aux États-Unis, Eliade ne préoccupe que de l’homo religiosus, sujet bien éloigné de ses engagements de jeunesse. David Bisson fait preuve à ce sujet d’une grande objectivité intellectuelle, contrairement aux dénommés Alexandra Laignel – Lavastine et Daniel Dubuisson, petits épurateurs de la douze millième heure…
Nombreux sont les héritiers, revendiqués ou putatifs, de Guénon. L’auteur mentionne Raymond Abellio qui veut « partir de Guénon pour mieux le dépasser (p. 429) ». de ce fait, les thèmes abelliennes, concrétisés par la « Structure absolue », célèbrent l’« auto-initiation de l’individu, [la] création d’une nouvelle dialectique, [la] dimension messianique de l’Occident, etc. (p. 430) », qui vont à l’encontre des orientations traditionnelles. Le désaccord majeur entre Guénon et Abellio porte sur l’initiation. « Là où Guénon évoque la transmission d’une influence spirituelle au sein de groupes initiatiques légitimement constitués, Abellio insiste sur la dimension individuelle et le processus rationnel qui débouche sur la transfiguration du monde dans l’homme. Ce qui évite, d’une part, les débats “ sectaires ” relatifs à la régularité de telle ou telle chaîne initiatique et permet, d’autre part, la reprise sans cesse renouvelé du chemin gnostique (pp. 432 – 433). »
Dans son Manifeste de la nouvelle gnose (Gallimard, coll. « N.R.F. – Essais », 1989), Abellio qualifie René Guénon d’« ésotériste réactionnaire (Abellio, op. cit., p. 60) » et, hormis Schuon envers qui il se montre élogieux, il critique « les traditionalistes guénoniens [qui] refusent de considérer que l’œuvre de Guénon, si efficace qu’elle ait été dans l’« épuration » du fatras occultiste des siècles passés et notamment du XIXe siècle, est essentiellement non dialectique et, comme telle, improductive pour l’avenir. Aussi en sont-ils réduits à répéter pieusement les anathèmes de leur maître (Abellio, op. cit., note 32, p. 95) ».
En Iran, lecteur de Guénon et disciple de Schuon, Seyyed Hossein Nasr élabore en accord avec le Shah un cadre traditionaliste-intégral musulman. Bisson le signale rapidement mais une partie des sources théoriques de la révolution islamique de 1979 qui obligera Nasr à s’exiler aux États-Unis ont pour noms Guénon et Heidegger… Mais c’est dans l’Université française qu’on assiste à une lente découverte de la pensée de Guénon. En général, « le nom de Guénon est très rarement cité dans les ouvrages scientifiques alors même que certains de leurs auteurs puisent dans ces textes une source non négligeable d’inspiration (p. 379) ». Sans le nommer ouvertement, Henry Corbin s’en inspire. Ami de Denis de Rougemont, lecteur de Heidegger et spécialiste réputé du chiisme iranien, Corbin « partage le sentiment de nombreux non-conformistes qui prônent dans un même élan la révolution spirituelle (contre l’esprit matérialiste) et la libération individuelle (contre la société bourgeoise) (p. 393) ».
Il n’entérine pas totalement l’enseignement du Cairote d’origine française. « Chez Guénon, toutes les traditions religieuses proviennent d’un noyau primordial et ésotérique tandis que chez Corbin, toutes les gnoses monothéistes confluent vers le même sommet herméneutique (p. 403). » L’auteur signale que le seul universitaire qui se réfère clairement à Guénon est l’« intellectuel antimoderne (p. 407) » Gilbert Durand. Inspiré par son ami Corbin et par « Nietzsche, Spengler, Maistre, etc. (p. 408) », Durand travaille en faveur d’une « science traditionnelle (p. 406) » et pose des « jalons pour une réaction antimoderne (p. 409) ». Corbin, Eliade, Durand, Carl Gustav Jung, etc., participent chaque année aux « rencontres d’Eranos » en Suisse. Bisson y voit dans ces réunions annuelles « un réseau intellectuel international (p. 414) » de sensibilité non-moderne.
La présence de Guénon est plus forte encore chez « Jean Hani, Jean Biès et Jean Borella [qui] tiennent finalement une place particulière dans la galaxie traditionniste. Outre leur formation universitaire, ils ont toujours cherché à concilier Guénon, le “ maître de doctrine ”, avec son principal continuateur, Schuon, le “ maître de spiritualité ”. […] Ils peuvent être considérés comme les premiers intellectuels chrétiens d’inspiration guénonienne (p. 479) ». Le philosophe eurasiste russe et orthodoxe vieux-croyant Alexandre Douguine reconnaît volontiers la dette qu’il doit à l’auteur d’Orient et Occident. Il cite d’ailleurs cet ouvrage dans son essai Pour une théorie du monde multipolaire (Ars Magna Éditions, 2013).
David Bisson constate dans la décennie 1960 l’essor oxymorique d’un « ésotérisme de masse » sous la férule de l’homme de presse Louis Pauwels. Co-auteur du Matin des magiciens avec Jacques Bergier qui méconnaît Guénon et exècre Evola, Pauwels poursuit sa démarche de vulgarisation ésotérique avec la revue Planète quand bien même des thèmes non traditionnelles (extra-terrestres, télépathie…). Pourquoi l’auteur étend-il ensuite ses recherches à la « Nouvelle Droite » (N.D.) ? La personnalité de Pauwels sert-elle de fil-conducteur ou bien parce que ce courant de pensée reprend à son compte le concept de métapolitique ? Alain de Benoist « réactualise le terme “ métapolitique ” dans deux sens complémentaires : la constitution d’un “ appareil d’action intellectuelle ” et le façonnement d’une socialité organique (p. 454) ». Or, terme technique de l’idéalisme allemand, repris par Joseph de Maistre dans son Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines, la métapolitique « ancre le politique (versant critique et propositionnel) dans un socle métaphysique (versant idéel et référentiel). C’est ensuite un adjectif qualificatif (“ le combat métapolitique ”) qui caractérise une posture intellectuelle de surplomb par rapport aux luttes partisans (p. 19) ». David Bisson avoue la grande complexité de démêler les multiples influences de la N.D. Toutefois, Guénon ne représente pas une figure tutélaire à la différence de Julius Evola. Quant à Alain de Benoist, il eut peut-être une période traditionaliste à la fin des années 1980, marqué par un recueil intitulé L’empire intérieur (1995) avant de suivre une autre direction plus post-moderne…
Finalement, sous une apparence volontairement détachée de la politique, la pensée de René Guénon serait très politique, ce qui renforcerait ses liens avec à son « véritable maître caché […] Joseph de Maistre. […] Ce sont des traditionalistes illuminés, c’est-à-dire des penseurs qui réinterprètent la tradition à l’aune de leurs propres révélations (p. 131) ». Quoi qu’il en soit, il importe de relire ou de découvrir l’œuvre considérable de Guénon et de prendre connaissance du livre captivant de David Bisson qui doit faire date dans l’histoire des idées.
Georges Feltin-Tracol
• David Bisson, René Guénon. Une politique de l’esprit, Pierre-Guillaume de Roux, 2013, 527 p., 29,90 €.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=3317
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené guénon, traditionalisme, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 23 septembre 2013
René Guénon and Eric Voegelin on the Degeneration of Right Order
René Guénon and Eric Voegelin on the Degeneration of Right Order
Ex: http://www.brusselsjournal.com
I. Introduction. No area of Western history is quite as recondite as that of the Diadochic empires, the successor-kingdoms that sprang up in the wake of Alexander the Great’s meteoric campaigns (334 – 323 BC) to subdue the world under militaristic Hellenism. One knows that the unity of Alexander’s Imperium, ever tenuous and improvisatory, broke down immediately on his death, when his “companions” fell to bellicose squabbling over bleeding chunks of the whole. Of Ptolemy’s Macedonian Egypt, one knows something – largely because the realm’s newly built Greek metropolis, Alexandria, became culturally the most important polis in the Mediterranean world, even after Octavian conquered Cleopatra and organized her Macedonian rump-state into Rome’s emergent world-federation. To transit from historical fair-certainty to historical incertitude, however, requires only that one switch focus from the Ptolemaic kingdom in the Nile Delta to the Seleucid... Indeed, to the Seleucid what? For Seleucus’ prize in the wars of the successors stretched in geographic space from Syria and Cilicia, and associated insular territories, eastward through portions of Mesopotamia and Asia Minor into the hinterlands of Parthia and Bactria. The Seleucid kingdom’s borders, as distinct from those of the more stable Ptolemaic kingdom in Egypt, remained, like the Heraclitean river, in constant flux; moreover, the Seleucid kingdom steadily withdrew in the direction of the sunrise, sacrificing its westerly regions for the defensibility of its easterly keeps, until in its last act, as the remnant Greco-Bactrian principality, it attempted to perpetuate itself against political mortality by an exodus-through-conquest from Central Asia across the Hindu Kush into Northern India.
One progresses, it seems, from obscurity to super-obscurity, as one might progress from Antioch, a polity known more or less in the annals of Western history (it served Seleucus for a capital city), to Pushkalavati, a polity all but unknown in those annals. These murky events in half-legendary places nevertheless issued in archeologically and literarily documentable consequences. When the Maurya emperor Ashoka (304 – 232 BC) converted to Buddhism around 250 BC and established it as his state religion, for example, he had to promulgate his policy in the northwest provinces of his expansive kingdom in Greek as well as in the indigenous languages. As late the First Century BC, Greek communities – if not actual poleis – still existed in what would today be Pakistan and Afghanistan, the original name of whose second largest city, Alexandria, corrupted itself over the centuries into the barbarism Kandahar. A post-Bactrian dux bellorum, Strato II, controlled a territory in the Indus Valley as late as 10 BC. Under the Seleucids and their heirs, the canons of Greek art influenced local sculpture and painting. The Bamiyan Buddhas, completed around 500 and dynamited by the Taliban in 2001, still reflected stylistic elements of Hellenistic statuary. Finally, it was through the Seleucid kingdom and its sequelae that India and the Mediterranean came into significant communication with one another so that Brahmanism and Buddhism might be known and studied by the Greek-speaking scholars of the Serapeum and something of the dialectical method might be adopted by Hindu philosophy.

This précis of Hellenistic penetration into the Near East and Central Asia in the great age of competing empires that consummated itself in the ascendancy of Rome in the West is by way of introduction to a modest comparative study of René Guénon’s Spiritual Authority & Temporal Power (1929) and Eric Voegelin’s Ecumenic Age (1974), the fourth volume of his five-volume Order and History (incipit 1956, with Israel and Revelation). The “Bactrian” chapter of the Alexandrian Drang nach Osten provides an important object of study in both books. Voegelin (1901 – 1985) could not, of course, have been known to Guénon (1886 – 1951) and it seems relatively unlikely that this particular book by Guénon would have been known to Voegelin, who, however, might have been familiar with The Crisis of the Modern Age (1927) and The Reign of Quantity & the Signs of the Times (1945); Spiritual Authority is something of a sequel to The Crisis, whose topics The Reign of Quantity revisits. Of interest is that Guénon and Voegelin, while quite different in the style of their thinking, nevertheless identify in the phenomenon of the Bactrian episode (including its Indian prequel) the same historical and spiritual significances and see in closely similar ways the relevance of that episode to an understanding of the modern phase of Western history. It goes almost without saying that for both Guénon and Voegelin, modernity is a disorderly and corrupt period in which the dominant elites have betrayed the hard-earned wisdom of philosophy and revelation and believe themselves anointed to remake a wicked world into a rational paradise liberated from superstition and bigotry, a project necessarily entailing the destruction of tradition. Modernity is “Gnostic,” in Voegelin’s term. Gnosticism designates a markedly low order of mental activity, in spiteful rebellion against the difficulties entailed by a contrasting openness to and participation in reality. Following chronology, it is natural to begin with Guénon.
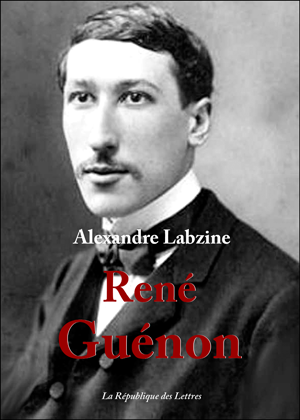 II. Guénon. A student of comparative religion, Guénon took lively interest in Hinduism, Brahmanism, and Buddhism. The Hindu scriptures especially provided him with a rich symbolism, which he found that he could instructively put in parallel with, among other vocabularies, that of the Platonic lexicon. Spiritual Authority & Temporal power draws on Guénon’s knowledge of the Vedas and related documents – a propensity that can at first stymie a reader uninitiated in the specialist vocabulary. (I put myself in the category.) However, Spiritual Authority repays readerly perseverance; the references to Plato give context to the exploration of caste not as an item of sociological but rather as one of metaphysical importance. A central political-philosophical question, who should govern, as Guénon points out, is shared by Hindu religious speculation and Platonic discourse. Guénon declares the topic of his essay to be “principles that, because they stand outside of time, can be said to possess as it were a permanent actuality.” Respecting the debate about the fundamental legitimacy of temporal offices, Guénon asserts, “the most striking thing is that nobody, on either side, seems concerned to place these questions on their ground or to distinguish in a precise way between the essential and the accidental, between necessary principles and contingent circumstances.” The petulant habit of deliberately ignoring first things by itself merely provides “a fresh example [so writes Guénon] of the confusion reigning today in all domains that we consider to be eminently characteristic of the modern world for reasons already explained in our previous works.” Guénon’s phrase for the Twentieth-Century contemporaneity of his book is “the modern deviation.”
II. Guénon. A student of comparative religion, Guénon took lively interest in Hinduism, Brahmanism, and Buddhism. The Hindu scriptures especially provided him with a rich symbolism, which he found that he could instructively put in parallel with, among other vocabularies, that of the Platonic lexicon. Spiritual Authority & Temporal power draws on Guénon’s knowledge of the Vedas and related documents – a propensity that can at first stymie a reader uninitiated in the specialist vocabulary. (I put myself in the category.) However, Spiritual Authority repays readerly perseverance; the references to Plato give context to the exploration of caste not as an item of sociological but rather as one of metaphysical importance. A central political-philosophical question, who should govern, as Guénon points out, is shared by Hindu religious speculation and Platonic discourse. Guénon declares the topic of his essay to be “principles that, because they stand outside of time, can be said to possess as it were a permanent actuality.” Respecting the debate about the fundamental legitimacy of temporal offices, Guénon asserts, “the most striking thing is that nobody, on either side, seems concerned to place these questions on their ground or to distinguish in a precise way between the essential and the accidental, between necessary principles and contingent circumstances.” The petulant habit of deliberately ignoring first things by itself merely provides “a fresh example [so writes Guénon] of the confusion reigning today in all domains that we consider to be eminently characteristic of the modern world for reasons already explained in our previous works.” Guénon’s phrase for the Twentieth-Century contemporaneity of his book is “the modern deviation.”
Where Voegelin stands out as above all an exegete of symbols, Guénon strikes one as rather more a modern mythopoeic thinker who takes symbols as his main stuff of purveyance, but this is not to say that he lacks analytical ability. Rather, Guénon grasps that symbols and myths – while they might be, as Voegelin would later call them, compact – articulate reality more fully and more truly than the clichés of modern reductive thinking and that therefore one best wrests intoxicated minds from the drug of those clichés by jerking them around (rhetorically, of course) so as to get them to face and contemplate the symbols in their numinous fullness. It belongs to Guénon’s suasory strategy that the strangeness of Hindu or even European Medieval symbols can fascinate the modern subject even when, as usual, that subject diametrically misunderstands them. Get their attention, Guénon seems to say – interrupt the trance; explanations can come later. Guénon’s unblushing references to a primordial tradition, “as old as the world,” can cause him, in the case of a superficial reader, to resemble a Theosophist or a spiritualist. It is worth remembering that the hard-headed Guénon wrote studies exposing Theosophy as a “pseudo-religion” and spiritualism as mountebank hocus-pocus. But if modernity were a “deviation,” then from what would it have deviated? Although Guénon’s first chapter in Spiritual Authority bears the title “Authority and Hierarchy,” the actual topics are caste and hierarchy, two of the range of first principles that modernity has insouciantly rejected.
Caste and authority relate to one another in complex ways. Modernity bristles at one or the other of the two terms with equal righteousness, but whereas traditionalists and reactionaries acknowledge the necessity of authority, they too might nevertheless feel aversion to caste, as it has manifested itself in India since the Muslim conquest. Guénon reminds his sympathetic but possibly skeptical readers that the existing caste-system of the British Raj of his time is itself a latter-day deviation and quite as acute a one as any aspect of the Western deviation into modernity. Guénon finds the true definition of caste in the Sanskrit etymologies. Accordingly, “The principle of the institution of castes, so completely misunderstood by Westerners, is nothing else but the differing natures of human individuals; it establishes among them a hierarchy the incomprehension of which only brings disorder and confusion, and it is precisely this incomprehension that is implied in the ‘egalitarian’ theory so dear to the modern world.” Additionally, “The words used to designate caste in India signify nothing but ‘individual nature,’ implying all the characteristics attaching to the ‘specific’ human nature that [differentiates] individuals from each other.” Finally, “One could say that the distinction between castes… constitutes a veritable natural classification to which the distribution of social functions necessarily corresponds.” Guénon also asserts that caste, even in the moment when it appears, suggests a fallen condition, “a rupture of the primordial unity” by which “the spiritual power and the temporal power appear separate from one another.” The assertion will disturb no one familiar with the Platonic relation between the realm of the ideas and the realm of social action; or with the Augustinian distinction between the City of God and the City of Man.
In classical Indian society, the roles of authority on the one hand and of power on the other fell respectively to the Brahmins, or the priestly caste, and the Kshatriyas, or the warrior caste. What is at first a harmonious functional distinction becomes, however, in the course of time, “opposition and rivalry,” or so Guénon states. The functionaries of the two castes yield to their baser instincts; they commence a struggle for absolute domination in the society. The struggle finds its outcome “in total confusion, negation, and the overthrow of all hierarchy.” Long before the climax, the real functions of the two castes have lapsed in desuetude. “As for the priesthood, its essential function is the conservation and transmission of the traditional doctrine, in which every regular social organization finds its fundamental principles.” In rivalry with the warrior caste, the priesthood abandons “its proper attribute,” which is “wisdom.” As for the warrior caste, its essential function is active policing of right order within the society, including the maintenance of the priesthood, and defense of the society against external predation. In rivalry with the priesthood, the warrior caste repudiates its guidance under wisdom, whereupon its virtues (heroism, nobility, rectitude) become unintelligible. The rebellious warrior caste claims that no power exists superior to its own, a boast brutally plausible once the community has lost sight of transcendence and “where knowledge is denied any value.”
In addressing the phenomenon of “insubordination,” which as he says modernity instantiates in extremis, Guénon in fact has a particular historical episode in mind, which he treats in the chapters of Spiritual Authority called “The Revolt of the Kshatriyas” and “Usurpations of Royalty and their Consequences.” Guénon cites no dates and names no names, but the episode in question belongs to the career of the Bactrian Greeks in India. A few facts will help to vivify Guénon’s purely abstract account. I take the facts from The Greeks in Bactria and India (1951) by William Woodthorpe Tarn. The chronology runs from the late Third Century to the middle Second Century BC. The main players on the Greco-Bactrian side of the drama are Demetrius I (reigned 200 – 190 or 180 BC); two of his sons, Demetrius II (reigned 175 – 170 BC) and Apollodotus (reigned 174 – 165 BC); and a general, Menander, who soon acquired kingship (reigned 155 – 130 BC). The two sons of the first Demetrius just mentioned, and their sons and grandsons, and Menander, ruled over Indian territories exclusively, the Bactrian Kingdom itself having succumbed by degrees to nomadic invaders (the Yueh-chi) during this period, ceasing to exist after 130 BC. The main players on the Indian side of the drama are the Maurya emperors, who were Buddhists, and their usurper-successors the Sunga emperors, beginning with Pushyamitra (reigned 185 – 149), who were Brahmins. Demetrius II, Apollodotus, and Menander were likely by profession also Buddhists.
When Demetrius I with his sons and Menander as generals invaded India, he was both responding opportunistically to events in Indian politics and acting on the ambition-provoking model of concupiscential militarism, as established by Alexander and the successors. As for Pushyamitra – when he deposed the last Maurya emperor by assassination, he merely continued a long-simmering civil conflict between Brahmins and Buddhists that had been begun by Chandragupta, the first Maurya emperor, who climbed to power by promoting the Buddhist Kshatriyas against the Brahmin overlord class. Tarn notes that in this period “the Brahman was the natural enemy of the Greek,” whom the priestly class categorized under the caste system as Kshatriyas. The corollary of priestly ire against the Greeks was Buddhist (that is, Kshatriya) interest in Greek military support against the Sunga dynasts. Tarn writes, “Both Apollodotus and Menander on their coins… called themselves Soter, ‘the Saviour.’” The discussion will return to the numerous implications of these details in the section on Voegelin, to follow. At this point, we will switch focus back to Guénon and Spiritual Authority.
In the chapter on “The Revolt of the Kshatriyas,” Guénon writes, “Among almost all peoples and throughout diverse epochs – and with mounting frequency as we approach our times – the wielders of temporal power have tried… to free themselves of all superior authority, claiming to hold their power alone, and so to separate completely the spiritual from the temporal.” When the office of the purely temporal order “becomes predominant over that representing the spiritual authority,” Guénon argues, the result will be social chaos masquerading as order under blatantly “anti-metaphysical doctrines.” A doctrine qualifies as “anti-metaphysical” for Guénon when it “denies the immutable by placing… being entirely in the world of ‘becoming.’” To deny first or transcendent principles is equivalent to submitting unconditionally to what Guénon dubs “succession.” The sequence of names in the Bactro-Indian “Who’s Who” – Chandragupta, Pushyamitra, Demetrius, Apollodotus, Menander, and Eucratides – suggests the resounding vanity of mere “succession.” Guénon reminds his readers that: “Modern ‘evolutionist’ theories… are not the only examples of this error that consists in placing all reality in ‘becoming’”; rather, “theories of this kind have existed since antiquity, notably among the Greeks, and also in certain schools of Buddhism.” Let it be noted that Guénon criticizes only the political Buddhism of the Indian Time of Troubles, not the original Buddhism of the Gautama, which “never denied… the permanent and immutable principle of… being.” Guénon implicitly also criticizes the politicized Brahmanism of the same Time of Troubles, which, entangling itself in grossly temporal affairs, forfeited its legitimacy under the law of spiritual immutability.
“Immutable being” is the same as reality; it is a verbal symbol of reality taken as the inalterable nature of the totality of things. To rebel against immutable being is therefore to rebel against reality, with inevitable consequences, the same in every case. As Guénon writes, the Revolt of the Kshatriyas “overshot its mark.” The immediate victors “were not able to stop it at the precise point where they could have reaped advantage from what they had set in motion.” The denial of “Atman,” the Brahmanic First Principle, led to the denial of caste, which led to the usurpation of offices by individuals unsuited to exercise them. It fell out that the Kshatriyas, in dispossessing the Brahmins, made themselves vulnerable to rebellious dispossession by the classes formerly arranged beneath them in the social hierarchy. “The denial of caste opened the door to [one and] every usurpation, and men of the lowest caste, the Shudras, were not long in taking advantage of it.” In fact, “the denial of caste” created a power-crisis in the Indus Valley and adjacent areas that eventually drew in, first, the Persians, then Alexander himself, and then in their turn the Bactrians, who were Alexander’s epigones of the nth degree, and finally a wave of nomadic destroyer-invaders. A familiar theme in Indian politics, foreign occupation, has a history that begins long before the British Empire. Northern India had Greco-Bactrian rulers from the time of Demetrius II, Apollodotus, and Menander until the time of Julius Caesar in the West.
Guénon insists that the Revolt of the Kshatriyas with its aftermath provides only an instance of a general pattern, pedagogically useful in its starkness whose essential features appear, however, in other instances. In the chapter in Spiritual Authority on “Usurpations of Royalty and their Consequences,” Guénon writes of “an incontestable analogy… between the social organization of India and that of the Western Middle Ages,” adding that “the castes of the one and the classes of the other” reveal how “all institutions presenting a truly traditional character rest on the same natural foundations.” Similarly, the Western Middle Ages know parallel experiences to the Revolt of the Kshatriyas. “Long before the ‘humanists’ of the Renaissance, the ‘jurists’ of Philip the Fair were already the real precursors of modern secularism; and it is to this period, that is, the beginning of the Fourteenth Century, that we must in reality trace the rupture of the Western world from its own tradition.” Even before Louis IV, Philip pursued the policy of consolidating all power in France in the kingship. Guénon writes that, “Temporal ‘centralization’ is generally the sign of an opposition to spiritual authority, the influence of which governments try to neutralize in order to substitute their own.”
The analyst may follow the line from Philip in France through the Protestants in Northern Europe, with their national churches, to the secular revolutionary movements that ensue from the Jacobin usurpation of national power in France in the events of 1789 and beyond that to the political-ideological chaos of the Twentieth Century.
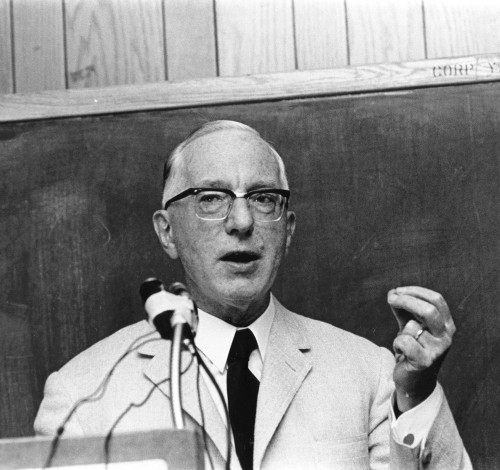
III. Voegelin. The fourth volume of Order and History bears the title The Ecumenic Age. The term ecumene functions centrally in Voegelin’s theory that the order of history emerges through the history of order, that is, as successive differentiations of consciousness and the concomitant increases in noetic clarity. But what is the ecumene and what is meant by The Ecumenic Age? Etymologically, the word ecumene refers to any organized district (the English word economy shares the same Greek root); by the time of the historian Polybius (200 – 118 BC), however, ecumene, which Polybius uses, had come to mean any – or rather the – geographical area over which rival empires or empire-builders might compete. Since by Polybius’ day this geographical area included everything that Alexander had conquered or tried to conquer in the East and everything that Rome had conquered in the West through the Third Punic War, the word effectively meant the known world, from Spain and Gaul to Bactria and India. In one of Voegelin’s several definitions in The Ecumenic Age, the ecumene arises when “empire as an enterprise of institutionalized power” becomes (in the phrase) “separated from the organization of a concrete society,” as happened for the first time in the case of Achamaenid expansion beyond the boundaries of the traditional Persian state in the Sixth Century BC. Persian conquests in the Greek field soon enough produced a reaction in the form of Alexander, who subdued Persia on his way to India; on Alexander’s death, as we have noted, his generals tried to wrest his conquests for themselves – the result being the Diadochic kingdoms. Voegelin writes that, “The new empires [beginning with Persia] apparently are not organized societies at all, but organizational shells that will expand indefinitely to engulf former concrete societies.” The ecumene may additionally be defined as, “the fatality of a power vacuum that attracted, and even sucked into itself, unused organizational force from outside”; and which therefore “originated in circumstances beyond control rather than in deliberate planning.”
Again in The Ecumenic Age, Voegelin writes how, in distinction to the polis, which organizes itself on the lines of a subject, the ecumene “is an object of organization rather than a subject.” This geographical-political phenomenon of the ecumene appears moreover not as “an entity given once and for all as an object for exploration,” the way the earth was given to Eratosthenes or Strabo; “it rather was something,” Voegelin writes, “that increased or diminished correlative with the expansion or contraction of imperial power” radiating from an “imperial center.” Working up to a striking phrase, “The ecumene… was not a subject of order but an object of conquest and organization; it was a graveyard of societies, including those of the conquerors, rather than a society in its own right” (emphasis added). As for the Ecumenic Age – it is the datable period, beginning with Persian expansion and ending with the disintegration of the Roman Empire in the West during which, amidst the destruction of the traditional, concrete societies, the actors of the drama forgot how to heed received wisdom while the victims of their agency had to rethink basic questions about the meaning of existence. In this way, ironically, “the Ecumenic was the age in which the great religions had their origin, and above all Christianity,” but including Buddhism, which had a Greek phase.
It will perhaps have begun to be apparent why Voegelin should take an interest in the Bactrian episode. The Bactrian episode runs its course at the farthest end of the Western ecumene, as defined by the imperial expansions of Darius and Alexander; and in the campaign of Demetrius and his sons it replicates in miniature the concupiscential exodus that Darius and Alexander enacted in setting forth to subdue the world. In the Bactrian episode, the Western ecumene comes into contact with the Indian and the Chinese ecumenes. This contact affected India more than the West, and China hardly at all, but the episode remains instructive. “In the wake of Alexander’s campaign in the Punjab,” Voegelin writes, “the scene of imperial foundations expands to India.” In exploring the significance of the Bactrian episode, Voegelin promises to “refrain from drawing the all-too-obvious parallels with the phenomenon of imperial retreat and expansion we can observe in our own time,” a statement that naturally directs readerly attention to those very parallels. Concerning Chandragupta, whom we have already encountered in our discussion of Guénon’s Spiritual Authority, Voegelin records that, “Among other Indian princes he had come to the camp of Alexander at Patala, 325 B.C.” When the last Macedonian governor departed the Punjab in 317, the ambitious prince “established himself in the new power vacuum with the help of the northwestern tribes and then descended on the kingdom of Maghada,” whose ruling dynasts he ruthlessly exterminated – man, woman, and child. Chandragupta with deft diplomacy avoided conflict when Alexander’s successor Seleucus revisited “Asia.” Concluding a treaty to fix the frontier, Chandragupta received from Seleucus one of the Macedonian’s daughters for a princess-bride; Seleucus received from Chandragupta a squadron of war-elephants.
What seemed a brilliant stroke of self-interested negotiation on the Indian’s part illustrates, in fact, Voegelin’s contention: The ecumene, despite its weird ontology, has the real power to draw in those who inhabit its periphery. The attraction exerted itself reciprocally: Indians were drawn into the Seleucid and Bactrian spheres and Seleucids and Bactrians were drawn into the Indian sphere; every conqueror-usurper generated his own conqueror-usurper, and the degeneration reached its nadir in barbarian incursions and desertification of whole provinces. In Voegelin’s description, “When a general of the last Maurya ruler, Pushyamitra Sunga, assassinated his master… an imperial power vacuum was created, comparable to the earlier one, after the death of Alexander”; and “as the earlier vacuum had attracted the Maurya Chandragupta, so the present one invited Demetrius, the king of Bactria, to conquering action.” Demetrius found success in his venture partly because of the Brahmin-Buddhist split; he could appeal to the Kshatriya caste as their Soter – their “liberator” or “savior” – against the Brahmin caste. Saving and liberating belong, in Voegelin’s analysis, to a “new symbolism of the Ecumenic Age,” with the codicil that its newness equates to its degeneracy. “An age of ecumenic imperialism throws up of necessity… the curious phenomenon which is today called ‘liberation,’ i.e., the replacement of an obnoxious imperial ruler by another one who is a shade less obnoxious.”
Voegelin’s account points up the existential ironies of the Bactrian episode – naturally, because he is dealing in historical specifics – more than Guénon’s account. Demetrius having conquered India, the Seleucids saw in his absence from Bactria the ripe opportunity to reincorporate that former province. Antiochus IV sent Eucratides to complete the task; when Demetrius returned from his Indian triumph to confront the invader, he succumbed in the engagement. Voegelin speculates that Eucratides, who came with only a small army, found crucial support among the Macedonian faction in Bactria that resented Demetrius’ policy of fusion with the native Bactrians. Voegelin characterizes Eucratides as “another Savior, this time of Macedonians and Greeks from a ruler who favored the native barbarians.” While Bactria reverted temporarily to the by-now-much-truncated Seleucid kingdom, northern India found itself under Greek domination in the kingdom of Menander, who, consolidating the work of Demetrius and his sons, declared independence. In a final blow of absurdity, the Parthians invaded the re-Seleucized Bactria and Eucratides fell battling them in 159 BC.
The sequence of events that constitutes the Bactrian episode resembles the plot of one of those operas of the Late Baroque or Early Classical periods, like the Zoroastre (1749) of Jean-Philippe Rameau or the Mitridate (1770) of Wolfgang Mozart: It has five acts, plays for three hours, and boasts so many characters that the audience can hardly keep track of them while struggling to extract the meaning. The spectators leave the performance feeling dazed and disoriented. We recall that the Bactrian episode is merely a recapitulation, and to some extent an anticipation, in miniature, of the entirety of the Ecumenic Age. Voegelin writes: “During the Ecumenic Age itself… the violent diminution, destruction, and disappearance of older societies, as well as the embarrassing search, by the conquering powers, for the identity of their foundations, was the bewildering experience that engendered the ‘ecumene’ as the hitherto unsuspected subject of the historical process.” Overlooking Voegelin’s use of the term “subject” in this sentence (one of his few lapses in ambiguity) while remembering that the ecumene is an object rather than a subject it is worth examining the paradoxes that stem from the question, already posed, how to define the Polybian lexeme. “For,” as Voegelin writes, “the ecumene was not a society in concretely organized existence, but the telos of a conquest to be perpetrated.” In addition, “one could not conquer the non-existent ecumene without destroying the existent societies, and one could not destroy them without becoming aware that the new imperial society, established by destructive conquest, was just as destructible as the societies now conquered.”
The instigators of concupiscential conquest think no such thoughts; in abandoning wisdom for the purely pragmatic adventure of the conquistador they bring about the divorce in their home societies between wisdom and action – the very same divorce whose exemplar Guénon discovers in the Revolt of Kshatriyas. Voegelin’s way of describing this spiteful repudiation of wisdom and even of knowledge is the formula, “humanity contracted to its libidinous self.” Such humanity condemns itself to endure the reduction of being to becoming – to the endless and meaningless temporal succession that it instigates. And what is most wicked is that it drags the rest of humanity along with it. Voegelin sketches a phenomenology of the conqueror: “These imperial entrepreneurs of the Ecumenic Age understood the meaning of life as success… in the expansion of their power” and in no other way; worse – and tellingly – they experienced any checks against their ambitions as instances of outrageous “victimization.” They and their rhetorical sycophants also invented “the games by which the power-self makes itself the fictitious master of history,” for example, as a “Savior.” Who does think the thoughts that lead to the identification of the ecumene as existentially meaningless and intolerable?
The answer to the question of who thinks those thoughts is, obviously, the ecumene’s non-sympathetic survivors, who, however, avoid thinking of themselves in selfishly victimary terms. They are those who remember wisdom or at least remember that such a thing as wisdom exists and may be sought for even in the spiritual desert of wrecked civilizations. The meaning of history, and therefore the meaning of human existence, emerges only by exodus from the ecumene; this will be a spiritual exodus aimed at reclaiming wisdom and restoring transcendence, either to the society, should it be extant, or for the sake of a new society not yet founded, which might arise from the wreckage and accord itself with reality. Indeed, in Voegelin’s words, “the relation between the concupiscential and the spiritual exodus is the great issue of the Ecumenic Age.”
IV. Guénon, Voegelin, and the Modern Crisis. Responding to the Siren Song of the ecumene to conquer and possess it qualifies as Voegelin’s privative exodus in at least two senses. Pragmatically, the conqueror in going forth leaves home; he generally leaves it, moreover, with the cream of the young men and a significant portion of the collective wealth in the forms of his provisions and armaments. Very likely he leaves behind him a vacuum of confusion, and a fat opportunity for mischief. Philosophically or metaphysically, the conqueror in going forth demonstratively exempts himself from the wisdom that, like his homeland, he leaves behind; under the pomp and color of his banners he declares himself indeed the prime mover of reality, a gesture of hubris in the highest degree. For in declaring himself such, he declares nothing less than the abolition of reality, as though it were his prerogative to guarantee what is possible and what is not and so to make patent his success before it occurs. Homer knew this at the beginning of the polis civilization. Agamemnon goes forth to conquer but brings about only the reduction to rubble of the heroic world, including his own murdered corpse; Odysseus, involuntarily alienated from home, struggles back to purge his household of uninvited mischief-makers. One sign of the rebellion against reality by the conquistadors of the Ecumenic Age, which entails the abolition of actually existing “concrete societies,” is their insistence on auto-apotheosis, as when Seleucus or Demetrius or Menander identifies himself on his coinage with Helios Aniketos, “The Unvanquished Sun,” or the equivalent. To paraphrase Voegelin: The ecumene is not only a graveyard of societies, but it is also a graveyard of the Helioi Aniketoi; and thus, amid the debris left by their late passage, of their innumerable victims.
In its dumb absurdity, the myriad of tombs affirms reality against concupiscential insouciance by pointing back to the violated wisdom as its cause. Guénon in Spiritual Authority puts it this way: “All that is, in whatever mode it may be, necessarily participates in universal principles, and nothing exists except by participating in these principles, which are eternal and immutable essences contained in the permanent actuality of the divine Intellect; consequently, one can say that all things, however contingent they may be in themselves, express or represent these principles in their own manner and according to their own order of existence, for other wise they would only be a pure nothingness.” Voegelin would recognize in Guénon’s balanced phrases one of the essential differentiations of consciousness with which his Order and History is concerned. The concupiscential campaigner can begin in only one way, by blanking out the knowledge of his own contingency; and if anyone should remind him of his contingency, he must blank out that person. He would not be stymied, or as he sees it, victimized.
Voegelin argues generally that differentiations of consciousness are irreversible, that they remain available after they occur; but he admits into his theory the concession that “diremptions” and “derailments” can also prevail during which the old symbols of wisdom no longer effectively signify and new symbols have not yet achieved full articulation. When Christianity emerges against the background of meaningless imperial succession, for example, it includes in its peculiar differentiations all the previous differentiations achieved in revelation and philosophy, from Moses to Plato. Nevertheless between the decline of philosophy and the consolidation of Christianity, there falls a long, anxiety-ridden stretch of ad hoc syncretism, thaumaturgy, Gnosticism, orgiastic enthusiasm, and general disorientation. The mental disorder of such things is the spiritual counterpart of the destruction of concrete societies under the ecumenic empires. People can for a time repudiate or lose touch with the luminous articulations that, formerly, reconciled them to reality; they either die off or recover something of clairvoyance. It happens that in The Ecumenic Age, Voegelin repeatedly references one of the earliest of the Western, reality-reconciling articulations, the one in respect of which the “Saviors” of the Ecumenic wars behaved with conspicuous heedlessness. Anaximander (610 – 546 BC, a contemporary of the Buddha) wrote: “The origin (arche) of things is the Apeiron… It is necessary for things to perish into that from which they were born; for they pay one another penalty for their injustice (adikia) according to the ordinance of Time.” Whether it is the Kshatriyas repudiating the Brahmins or Alexander repudiating Aristotle – payment of the Anximandrian “penalty” falls due and the interest on the debt begins to build up.
Both Guénon in Spiritual Authority and Voegelin in The Ecumenic Age take care to avoid topicality. Guénon writes of his intention “to remain exclusively in the domain of principles, which allows us to remain aloof from all those discussions, polemics, and quarrels of school or party in which we have no wish to be involved, directly or indirectly, in any way or to any degree.” In Voegelin’s terminology, Guénon’s authorship, at least where it concerns Spiritual Authority, corresponds to the positive exodus by which the man in search of wisdom withdraws in contemplation from the endless pragmatic exodus of the ecumene. Guénon adds, however, that “we leave everyone free to draw from these conclusions whatever application may be deemed suitable for particular cases.” Voegelin is less strict than Guénon in this respect, but in The Ecumenic Age he does mainly isolate his topical asides in his introductory and concluding chapters. These asides are nevertheless provocative, wherever they occur in the text. One will be sufficient to indicate the meaning of the Bactrian episode, which occupies the structural center of The Ecumenic Age, with respect to the modern crisis. We have previously cited Voegelin’s remark on “the games by which the power-self makes itself the fictitious master of history.” In a brief continuation of the same remark, Voegelin adds that those games “are still played today.”
It will undoubtedly have impressed those who have followed the argument so far that, simply at the level of descriptive phraseology, many of Guénon’s constructions and Voegelin’s suggest their own application to the contemporary state of affairs in the incipient Twenty-First Century. Guénon in Spiritual Authority mentions the origins of étatisme, with its relentless centralization of political power, in Fourteenth Century France. Voegelin in The Ecumenic Age refers to the ecumenic empires as “organizational shells that will expand indefinitely to engulf former concrete societies.” The centripetal and centrifugal movements might seem opposite to one another and therefore non-compossible, but they are in fact simultaneous and complementary. They describe in structural terms the libidinous process by which the bearers of “moral apocalypse” – that is, the Gnostic reformers of society – progressively obliterate the concrete societies that come under their imperial-entrepreneurial sway. Whether it is the arrogantly self-aggrandizing Federal Government in the United States of America or the inhumanly bureaucratic Brussels Parliament of the European Union in Western Europe, the attitude of the reigning elites towards the world is none other than the attitude of the auto-apotheotic conquistador toward the ecumene.
The goal of the new concupiscential exodus does not end with conquest, however; it has the jurisdictional goal beyond conquest of what it calls transformation or “change” but what can only be experienced by those who do not elect it as annihilation in the mode of total undifferentiation.
The point of view of the resistors is the true one: The mantra of “change,” so dear to the Left, is Newspeak (“disorder,” writes Guénon, “is nothing but change reduced to itself”); and the celebratory invocation by the Left of “difference” or “diversity” is likewise Newspeak. It requires only a smidgen of acuity to notice that the endless parade of “diverse people” who witness on behalf of “change” all say the same thing and tell the same stereotyped story; the “diversity” of the propagandists never exceeds the categories of skin-color, number of skin-piercings, peculiarity of dress, or deflected erotic interest because mentally they are all already completely assimilated to the narrow gnosis on the basis of which the regime claims its legitimacy. The succession of speakers in the lecture-calendar replicates in small the meaningless temporal succession of titled eminences in the ecumene. One might also notice that the ceaseless doctrinal self-justification of the modern rebellious elites resembles the soteriological propaganda of the ancient ecumenic campaigners; for in annihilating tradition the regime through its spokesmen claims to be engaging in a vast program of salvation or redemption. For ten years they have been redeeming the place formerly called Bactria.
The difference between the “Saviors” of the Ecumenic Age and those of today consists in this: Whereas the men of the Alexandrian succession did not intend to wreck the societies that they left behind and whereas that wreckage came about as an unintended side effect of campaigning elsewhere (“backwash,” in modern jargon); the modern “Saviors” by distinction explicitly intend to wreck the societies from which they have treacherously defected. That is their main motivation. They say so unashamedly, over and over. They have captured education from the kindergartens to the doctoral programs and they train new cohorts every year to carry out the project of calling forth a new ecumene and perpetrating Ausratiertung on everything in it. To convince themselves and others that their toxic whimsies stand free of any ethical or practical limitation, they have developed a baroque anti-epistemology that they call, appropriately, Deconstruction which would obliterate logic itself and even knowledge. This makes their obsession with “change” all the more pernicious. In Spiritual Authority, Guénon reminds his readers that, “Change would be impossible without a principle from which it proceeds and which, by the very fact that it is the principle of change, cannot itself be subject to change.” In a parallel comment, Guénon adds that, “Action, which belongs to the world of change, cannot have its principle in itself.” Yet the modern “Saviors,” through their “Action Committees,” invariably claim to be champions of principle. We all live in Bactria now and may not fire back.
The Gnostic rebellion against reality denies limitations, but it is, of course, subject to them because it is subject to reality; the rebellion is moreover radically maladapted to reality (denying logic and repudiating knowledge are bad bets in the Darwinian game) and it will eventually have to pay its penalty to Anaximander’s “Unlimited.” Or, we might say, to God. When the rebellion will reach its limit, however, only God knows. The instruments of torture with which O’Brien threatens Smith in 1984 are old and rusty; the regime has been in place for a long time, dragging the whole of Anglo-Saxon humanity with it into the Big-Brother nightmare. In The Ecumenic Age, Voegelin has these wise words: “A ‘modern age’ in which the thinkers who ought to be philosophers prefer the role of imperial entrepreneurs will have to go through many convulsions before it has got rid of itself, together with the arrogance of its revolt, and found the way back to the dialogue of mankind with its humility.”
00:05 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erich voegelin, rené guénon, tradition, traditionalisme, politologie, sciences politiques, théorie politique, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 19 septembre 2013
L’Alevismo Turco

L’Alevismo Turco
Ex: http://www.statopotenza.eu
L’Alevismo nella odierna Turchia è un elemento religioso molto interessante che si è sviluppato nei secoli, attualmente vivono in Turchia più di 10 milioni di Aleviti che non sono da confondere con gli Alawiti che vivono in Siria e Libano, discendono entrambi però da gruppi sciiti che vedremo nello specifico, nel mondo islamico la divisione tra sunniti e sciiti, risale agli avvenimenti seguiti alla morte del profeta Muhammad (pace su di lui), la questione della successione, di chi prenderà il suo posto, la lotta per il Califfato. Per i sunniti il successore doveva essere Abu Baker, per gli sciiti invece Ali (sas) marito di Fatima (sas) la figlia di Muhammad (pace su di lui), è destinato a prendere il posto del Profeta. Tra gli sciiti, come tra i sunniti, ci sono poi correnti diverse. Gli Aleviti non rientrano in nessuna di queste correnti.
L’Alevismo è una setta unica si pensa che le tribù turche e iraniche e azere del nord dell’Iran e dell’Anatolia Orientale furono convertite allo Sciismo durante l’Ikhanato Mongolo che dominava la Persia e l’Iraq all’epoca e parte dell’Anatolia. Il poeta Yunus Emre e il santo Hajji Bektash furono i primi santi di quel periodo e più tardi vennero associati con l’Alevismo. Gli Aleviti emersero in questo contesto come un ordine sufi militante con base ad Ardabil nell’odierno Iraq, il cui leader Shah Ismail riuscì a conquistare la Persia e dare vita alla dinastia Safavide. Ora nell’ambito dell’Islam sciita duodecimano, dal momento che gli Aleviti accettano si il credo sciita riguardo Ali (as) e i dodici Imam (as), ci sono dei distinguo, alcuni Aleviti non vogliono essere descritti come Sciiti ortodossi, a causa di grosse differenze nella filosofia, abitudini e rituali rispetto alle forme prevalenti dello Sciismo dell’Iraq e del moderno Iran nonostante questo, l’Ayatollah Ruhollah Khomeini (r.a.) nel 1970 ha dichiarato gli Aleviti parte della linea tradizionale sciita.
Gli Aleviti credono e professano i dodici imam come discendenti del Profeta, Imam che torneranno un giorno a portare pace e giustizia nel mondo, elementi che avvicinano gli Aleviti agli Sciiti. Nella teologia e nella pratica ci sono però molte differenze e vedremo quali, per esempio la ritualità Alevita non prevede le cinque preghiere quotidiane, non c’è il mese del digiuno (il Ramadan) e neppure il pellegrinaggio alla Mecca. La credenza nella uguaglianza tra uomini e donne che condividono lo stesso spazio nella preghiera, l’esistenza di un semah, cioè un rituale sufi che consiste in una danza esoterica e gnostica detta “dei pianeti” l’uso della musica, l’uso degli alcolici nelle cerimonie, sono tutti elementi che mostrano quanto gli Aleviti siano lontani dalla Tradizione Sciita. Nelle cerimonie Alevite si parla molto dei fatti di Karbala nell’odierno Iraq, città dove nel 680 d.C. l’esercito Omayyade di Yazid l’usurpatore assassinò Hussein nipote di Muhammad (pace su di lui). Il ruolo della sofferenza, del martirio sono importanti così come nella tradizione sciita. L’ingiustizia patita a Karbala da Ali nel corso della lotta per la successione, l’avvelenamento di suo figlio Hasan (as) e l’uccisione del fratello Hussein (as) sono elementi importanti tra gli Aleviti ma anche qui ci sono differenze rilevanti soprattutto per quanto riguarda il dolore e la sua manifestazione. La questione del lutto e del Martirio tra gli sciiti è molto importante, durante il periodo del Muharram e di Ashura cioè le cerimonie di lutto che si celebrano in questo mese , si possono vedere queste differenze. Ferirsi, tagliarsi, colpirsi con delle catene, anche se si tratta di tradizioni che stanno perdendo la loro forza e per inciso in Iran sono vietate ma il folklore popolare a volte si manifesta in questi atti sono elementi caratteristici del mondo sciita.
Tra gli Aleviti queste tradizioni sono completamente assenti. Il ricordo dei fatti di Karbala avviene durante le cerimonie chiamate “Cem” dentro le Cemevi che sono case assemblative in luogo delle moschee che non esistono nell’Alevismo, attraverso orazioni funebri, con una modalità poetica ed artistica queste cerimonie vengono celebrate senza le tradizionali letture coraniche o formule di richiesta a Dio, questa è una differenza importante. Un’altra differenza è che nella cerimonia del Cem il momento in cui si ricorda l’ascensione di Muhammad (pace su di lui) al fianco d Allah (SwT) e chiamato “miraclama”, in questa fase assistiamo anche alla divinizzazione della figura di Ali, questa una differenza fondamentale e importante rispetto a gran parte del mondo Sciita. Una nota a parte merita la confraternita “Sciita” dei Bektashi ancora oggi presente nei Balcani, Albania, Grecia e Turchia. I Bektashi sono una confraternita e quindi chiunque può diventare Bektashi, certo, ma l’Alevismo è qualcosa che passa attraverso di essa, il padre e la madre, i bektashi eleggono i loro “dede” cioè i loro maestri , i loro leader spirituali mentre per gli Aleviti il dede è una carica che si trasmette tra le generazioni, da padre in figlio. La confraternita dei bektashi è stata considerata il braccio spirituale dei giannizzeri, il corpo militare d’élite dello stato ottomano. Con le riforme del Sultano Mahmut II, la modernizzazione ottomana ha soppresso i giannizzeri ed allo stesso tempo la confraternita poiché visti come sciiti e quindi sospettati di cospirazione con l’Impero Persiano Safavide sciita, in epoca ottomana ogni professione, gruppo o corporazione, aveva legami privilegiati con una confraternita religiosa, molto fiorenti in Turchia e tra le migliori come quella dei Mevlevi di Rumi o i Jerrahi-Halveti. I giannizzeri erano legati ai Bektashi i quali erano spesso legati agli Aleviti , il problema è guardare l’Impero Ottomano come uno stato nazionale moderno e in questa prospettiva vedere le relazioni tra confraternite e il centro come unidimensionali. Molti intellettuali Aleviti vedevano di cattivo occhio una relazione tra i Bektashi ed il potere ottomano.
Nel mondo Turco c’erano diversi rapporti di forza e i Bektashi possono aver avuto una relazione privilegiata con i giannizzeri, del resto molti esponenti di spicco dei giannizzeri erano Bektashi e gli stessi erano cristiani convertiti all’Islam, perché era particolare il carattere dei giannizzeri formati da bambini cristiani, reclutati secondo il sistema della devsirme, ovvero venivano rapiti dalle famiglie di origine e poi spesso affidati a famiglie Alevite-bektashi poiché gli Aleviti non facevano discriminazioni rispetto ai loro figli naturali, quindi le famiglie Alevite rappresentavano un ambiente ideale per crescere i futuri soldati. La religione nel mondo ottomano non aveva però un carattere così conservatore come vorrebbero gli islamisti odierni, difatti il Salafismo è una ideologia moderna come lo sono i Fratelli Musulmani nati negli anni 20′ del ’900, i Sunniti non avevano una posizione così predominante e il potere ottomano intrecciava relazioni coi differenti gruppi religiosi in modo pragmatico, strumentale a seconda delle circostanze, si può dire che almeno fino al XVI secolo nell’Islam sia impossibile parlare di una ortodossia consolidata. Quindi possiamo dire che in questo contesto non è possibile parlare neanche di eterodossia.
Dopo il XVI secolo si può parlare tuttavia di una ortodossia Sunnita Hanafita cioè una delle 4 scuole teologiche che preferisce l’intelletto e la moderazione , ora bisogna vedere se possibile parlare di ortodossia nella Turchia contemporanea che oggi è un paese laico ma probabilmente esiste ancora una ortodossia ufficiosa di origine sufi , come lo sono Gul o Erdogan per esempio di scuola Naqsbanhdi .Il carattere “moderato” turco non sempre è stato manifestato dagli stessi…anzi per esempio nel 1993 , il 2 luglio precisamente ci fu il triste massacro di Sivas dove morirono degli Aleviti per mano dei Sunniti , quel giorno cantanti, scrittori e filosofi Aleviti si riunirono per celebrare la festa di Pir Sultan Abdal, una loro importante figura storico culturale nell’ambito musicale Alevita , la festa venne celebrata nell’hotel Madimak e poco dopo una folla di 20.000 sunniti si riuni’ e circondò l’edificio, dandolo alle fiamme, bersagliandolo con pietre mentre intonavano slogan anti-Alevismo e pro-Sharia. Il massacro durò diverse ore durante nei quali ne i pompieri, la polizia e la gendarmeria fecero nulla per fermare il massacro, alcuni filmati mostreranno come le richieste d’aiuto furono respinte, alla fine della strage si conteranno 33 morti, tutti Aleviti., nel 1997 la polizia arrestò 31 presunti responsabili e li condanno a morte, ma poi la pena di morte venne trasformato in carcere a vita. Altro episodio nel 1995 dove questa volta ci fu una sparatoria da un’auto nel quartiere Gazi di Istanbul che causò la morte di alcuni Aleviti. Durante le manifestazioni di protesta, la polizia aprì più volte il fuoco contro i dimostranti che abbatterono altri 15 Aleviti.
Oggi gli Aleviti politicamente sono contrapposti al fondamentalismo Sunnita e al Salafismo con le sue ramificazioni, assicurando la continuazione del secolarismo turco Kemalista. sono i principali alleati delle forze secolari e alla sinistra, cercano anche l’alleanza dei Sunniti moderati contro gli estremisti. Richiedono che lo stato riconosca l’Alevismo come una comunità ufficiale islamica, con gli stessi diritti del, ma diversa dal, Sunnismo interessante è il pensiero Alevita secondo cui tutti gli sviluppi negativi dell’Islam sono visti come un fallimento della società e delle caratteristiche Arabe. Il Sunnismo, secondo gli Aleviti, non è vero Islam, ma un’aberrazione il cui stretto legalismo si oppone al pensiero libero e indipendente ed è visto come reazionario, bigotto, fanatico e antidemocratico. Gli Aleviti credono che il nazionalismo Sunnita sia intollerante, dominatore e settario credono fermamente che il Sunnismo sia una propria peculiarità araba e fallimentare come i loro popoli e strutture governative e l’Alevismo sia la vera Tradizione Religiosa Turca e Anatolica.
Mustafà
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alévites, turquie, traditions, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 septembre 2013
Monothéismes et paganismes
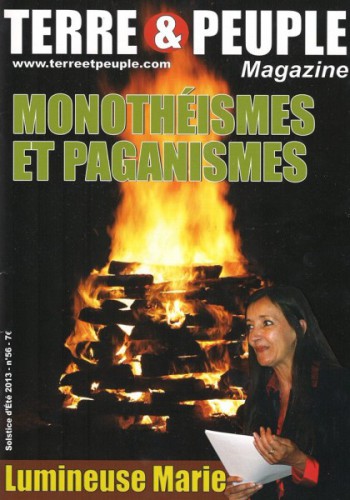
Monothéismes et paganismes
Le numéro 56 de TERRE & PEUPLE Magazine est presque tout entier consacré aux monothéismes et aux paganismes.
Pierre Vial consacre son éditorial à un pieux hommage qu’il rend à ‘l’âme altière’ de Dominique Venner, derrière qui il a lui-même marché depuis ses quinze ans, car il n’a jamais suivi d’autre chef que lui. Il nous engage ‘à nous orienter sur cette ‘étoile polaire’. Il cite Bruno de Cessole, pour qui le dernier geste de Dominique Venner n’a rien du désespoir. C’est au contraire un sacrifice accompli pour réveiller nos consciences.
Pierre Vial ouvre ensuite le dossier ‘Monothéismes et paganismes’ pour souligner que l’islam se trouve dans un rapport de filiation avec les deux autres monothéismes et qu’un gouffre sépare ces trois religions du désert des religions de la forêt. Il se réfère aux archéologues israéliens Finkelstein et Silbermann, pour qui la saga biblique n’est qu’un produit de l’imagination, conçu sous la dynastie davidique, et à Jean Soler, qui a démontré que les épisodes d’Abraham et de Moïse ne peuvent plus être considérés comme historiques. Les dominations étrangères, assyrienne et perse, et les déportations des Hébreux ont alors été interprétées comme une punition pour leur tolérance à l’égard de dieux étrangers, ce qui doit les faire passer à la monolâtrie (pour un Dieu national), qui se muera bientôt dans une alliance privilégiée avec le Dieu unique et universel et justifiera une réécriture de la Bible à la fin du IVe siècle seulement.
Pour les Indo-Européens, Jean Haudry souligne que leur polythéisme s’est accommodé d’accumuler la tradition, sans jamais en retrancher ni craindre les contradictions et les paradoxes. Avec les temps historiques, les dieux, frères des hommes, ont tendance à s’en éloigner, peut-être suite au feu qui leur a été volé par Prométhée, et suite aux comportements inamicaux des héros, ‘contempteurs des dieux’. En Grèce, l’athéisme va apparaître avec l’atomisme matérialiste et l’épicurisme. Chez les Iraniens, le mazdéisme, avec son dieu suprême Ahura Mazda (Seigneur Sagesse), est une tentative avortée de monothéisme. Dans l’hindouisme, la recherche de l’unité fait évoluer le polythéisme en panthéisme. Toutefois, Brahma et Civa forment avec Vishnu le Trimurti ou Trinité, mais les trois composantes de la triade (avec les trois couleurs, blanche, rouge, noire qui leur sont associées) leur sont préexistantes.
Traitant la distinction entre monothéisme et polythéisme, Robert Dragan remarque que la Bible désigne paradoxalement le Dieu unique par le pluriel Eloïm, alors que Aristote (sur qui saint Thomas d’Aquin appuiera largement sa Somme théologique) pose les preuves d’un Dieu créateur qui est de nature différente des autres dieux, qui ne sont que représentation du monde, donc des créations des hommes. La clé métaphysique des païens n’est pas la révélation dogmatique, mais la contemplation muette qu’on n’atteint par recherche par ascèse, notamment celle des mystiques chrétiens.
Claude Perrin rappelle que les juifs sont passés du polythéisme à la monolâtrie d’un Dieu réservé au seul peuple juif. Les chrétiens en feront le Dieu de tous les peuples, notamment tous les peuples conquis par l’Empire romain, ce qui ne pouvait que séduire l’Empereur Constantin. Tard venu, le monothéisme a fait d’innombrables emprunts au polythéisme. Rare substitut qui subsiste aux dieux anciens : le Père Noël.
Claude Valsardieu dresse une fiche ‘théométrique’ extraordinairement fouillée d’Apollon, divinité solaire de la conscience éclairée, qui surclasse l’intelligence mercurienne, de l’esprit prophétique, qui transcende la raison logique, de l’harmonie supérieure, de la beauté radieuse, de l’espérance. Dieux guérisseur pourfendeur du Python, il dirige ses flèches contre la maladie. D’origine hyperboréenne, ses premières représentations sont égyptiennes.
Pierre Vial esquisse les traits les plus marquants de notre néo-paganisme : le ré-enchantement d’un monde qui a été diabolisé, méprisé et honteusement maltraité. Notre paganisme est une réalité charnelle et vécue, c’est le rejet de l’intolérance des religions fanatiques, c’est la revendication de la dignité des hommes libres et responsables d’eux-mêmes. C’est un paganisme de méditation, de sagesse, de combat, de fécondité, d’enracinement, de sublimation par le culte du sacré, un paganisme de fidélité, à la tradition de nos anciens, à notre sang et à notre terre.
Alain Cagnat retrace la voie qui a mené du monothéisme à l’universalisme mondialiste. On attribue à Aménophis IV Akhenaton, pharaon de la XVIIIe dynastie (XIIIe AC) la paternité d’un monothéisme qui a été sans lendemain. Moïse ne remonterait qu’au VIIIe siècle AC, mais le monothéisme juif serait en fait beaucoup plus récent. Yahveh, dieu unique n’est au départ qu’un dieu national qui ne tolère pas le culte d’autres divinités par les juifs. C’est la condition contractuelle de leur suprématie, voire de leur surhumanité. Le christianisme est le même monothéisme étendu par saint Paul à tous les peuples du monde. Adopté par Constantin, le monothéisme chrétien est imposé à tous les peuples de l’Empire romain. Cette adoption lui assure un triomphe sur ces peuples jusqu’à la fracture interne de la réforme des protestants et la contestation. Celle des humanistes d’abord et ensuite celle des Lumières d’un esprit sanctifié par une influence maçonnique évidente, qui édifie un nouvel universalisme, avec une nouvelle métaphysique du progrès illimité, poursuivi dans le cadre d’un Contrat social régi par des Droits de l’Homme, révélés eux aussi par le même esprit saint laïc. Les Droits de l’Homme sont le credo insurpassable de la tolérance, lequel prescrit l’intolérance contre les ennemis de la liberté obligatoire. Comme il prescrit le droit et bientôt le devoir d’ingérence pour sanctionner les dissidents. Engendré par le libéralisme, l’individu doit pouvoir se libérer de tout lien qui l’attache à un groupe, fût-ce sa famille et rien ne peut entraver son activité économique sur un marché de libre concurrence. En soignant son propre bien, il fait le bien de tous, de toute l’humanité car le marché de doit pas connaître de frontières, surtout pas nationales, car il y a une équation entre nation et shoah. Il ne peut y avoir d’autre règle que l’auto-régulation du marché par l’équilibre de l’offre et de la demande. Elle s’impose aussi bien au travail qu’aux marchandises et services et le chômage exerce sur le prix du travail une pression bénéfique pour le prix des produits, qu’elle s’exerce par la concurrence des travailleurs des pays à bas salaires ou des travailleurs immigrés, dessinant avec les délocalisations le spectre d’un nouvel esclavagisme. Le mondialisme a connu un grand essor avec l’effondrement de l’URSS et la disparition du monde bipolaire et avec l’intégration des pays BRIC (Brésil/Russie/Inde/Chine) dans le grand marché sans nations. Celui-ci favorise la consolidation de quelques dizaines de multinationales, Certaines de ces ‘majors’, avec les banques qui leur sont associées par participations croisées, sont plus puissantes qu’un état comme la France et nombre de dirigeants politiques démocratiques sont issus de leur sérail (Goldman Sachs). Cette maffia a eu l’habileté d’inciter les états à s’endetter, non plus auprès de leurs administrés, mais auprès du capitalisme apatride. Marx, qui dénonçait cette dictature de la troisième fonction promettait de la renverser par la dictature du prolétariat, non moins matérialiste ni non moins mondialiste. L’Eglise catholique, mondialiste par définition même, avait vu ses prêtres ouvriers attirés par le marxisme, se syndiquer à la CGT, voire adhérer au parti. Dans les colonies, les missionnaires ont alors ressuscité la Controverse de Valladolid (sur la légitimité de la colonisation), et se sont plus préoccupés du bien temporel des indigènes que de leur bien spirituel. Pie XII intimera aux missionnaires l’ordre de ne plus occidentaliser les indigènes, mais de respecter leur identité et de promouvoir leur indépendance. Nombre de chrétiens soutiendront activement le Vietminh et les égorgeurs du FLN. La théologie de la libération fait la synthèse du marxisme et du message chrétien. C’est la cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, qui condamnera la trop grande implication du clergé dans la révolution politique. Délaissant le marxisme moribond, les tenants de la théologie de la libération vont s’engager dans les combats modernes de l’altermondialisme et de l’antiracisme, lequel va notamment obtenir que le mot ‘race’ soit supprimé » de tous les textes officiels français. Toute recherche d’identité est condamnée comme discriminatoire. Jusque là, on reconnaissait communément les races bibliques issues des trois fils de Noé, avec une multitude de subdivisions. Le mythe de l’ancêtre commun né en Afrique, rapidement invalidé par les découvertes scientifiques, n’est plus reçu que par les Noirs. L’antiracisme s’est rapidement étendu à toute discrimination, physique, sexuelle, religieuse. Le mixage que poursuit le multiculturalisme est une machine à tuer les peuples. Il ne débouche pas du tout sur un mélange généralisé des races, mais sur le communautarisme ou repli de chaque groupe dans des ghettos, avec une sérieuse perspective de guerre interethnique. La fin du cycle est proche.
Sous le titre ‘Gouverner par le chaos’, Thibault, membre de la rédaction du scriptoblog, répond à la question que posait, en 1929 déjà, le Dr Edward Bernays, l’auteur de ‘Propaganda, comment manipuler l’opinion en démocratie’ : « Ne pourrait-on pas mobiliser les masses sans qu’elles s’en rendent compte ? ». Neveu de Freud, Bernays est avec Walter Lippmann, un des fondateurs de l’ingénierie sociale, technique scientifique qui prétend par le contrôle de toutes les sphères du vivant pouvoir écraser toute déviance à la pensée correcte. Notamment par l’association d’idées (le chien de Pavlov qui salivait au seul tintement de la sonnette qui accompagnait tous ses repas ou la diabolisation des contestataires d’aujourd’hui par leur reductio ad hitlerum). L’institut Tavistock, financé par Rockefeller, a théorisé ces méthodes dites de contre-insurrection. Le projet exprimé est de mettre en place « un fascisme à visage démocratique », en affaiblissant notre moral, par des crises suscitées, des désordres entretenus, un management négatif, l’immigration de remplacement et le communautarisme, la discrimination positive de minorités ethniques, religieuses, sexuelles, la déstabilisation par l’affolement dans la submersion dans une surabondance d’information, le neuro-marketing. Les ingénieurs sociaux analysent et mesurent les réactions chimiques aux stimuli qu’ils administrent à leurs cobayes humains, rythmes, couleurs, poses, gestuelle. Un des objectifs à terme de cette guerre cognitive serait la cybernétisation de l’humanité.
00:05 Publié dans Nouvelle Droite, Revue, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paganisme, monothéisme, christianisme, nouvelle droite, revue, terre et peuple |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 09 septembre 2013
Pour une entrée en Tradition

18) Pour un exposé synthétique des rapports entre les 2 disciplines, cf.R. Guénon, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, 1921, Deuxième partie : « Les modes généraux de la pensée orientale », chapitre VIII : « Pensée métaphysique et pensée philosophique », Trédaniel, 1997, pp. 123-140.
20) Ludwig Wittgenstein, Tractacus logico-philosophicus, Vienne, 1918. Nous citons d'après la traduction due à Pierre Klossowski, Gallimard/Tel, 1989, p. 107 (texte suivi par les Investigations philosophiques).
32) René Guénon, La métaphysique orientale, op. cit., p. 10.
33) « Une réponse qui ne peut être exprimée suppose une question qui elle non plus ne peut être exprimée. L'énigme n'existe pas. Si une question se peut absolument poser, elle peut aussi trouver sa réponse » (Tractacus logico-philosophicus, op. cit., p. 105 (65), souligné dans le texte).
35) Ibidem.
45) Le ressaisissement se trouve tout à la fois au début de la Réalisation et à sa conclusion, celui-là apparaissant comme la préfiguration “possibilisante” de celle-ci. « La première chose à faire pour qui veut parvenir véritablement à la connaissance métaphysique, écrit Guénon, c'est de se placer hors du temps, nous dirions volontiers dans le “non-temps” si une telle expression ne devait pas paraître trop singulière et inusitée. Cette conscience de l'intemporel peut d'ailleurs être atteinte d'une certaine façon, sans doute très incomplète, mais déjà bien réelle pourtant, bien avant que soit obtenu dans sa plénitude cet “état primordial” dont nous venons de parler » (La métaphysique orientale, op. cit., p. 18).
46) La signification ultime de ce Voile, qui est celui d'lsis et que l'Hindouisme connaît comme Maya et l'Islam comme Hijâb, a été exposée par Frithjof Schuon dans une étude intitulée « Le mystère du Voile » publiée in L'ésotérisme comme Principe et comme Voie, Dervy, coll. L'Être et l'Esprit, 1997, pp. 45-62.
49) Cf. Le théosophisme : histoire d'une pseudo-religion, 1921, Éd. Traditionnelles, 1966, et L'erreur spirite, 1923, mêmes éditions, 1952 (l'expression « œuvre d'assainissement » est due à Raymond Abellio et figure in « L'esprit moderne et la Tradition », introduction à Paul Sérant, Au seuil de l'ésotérisme, Grasset, coll. Correspondances, 1955, pp. 9-81, cit. p. 81).
57) Comment discriminer le spectateur du spectacle ? (Drg - drçya - viveka), traduction par Michel Sauton d'après la version anglaise du swâmi Nikhilânanda, éd. Adrien Maisonneuve, coll. Vandé Mâtram, Paris, 1945.
60) Nous pourrions tout aussi bien écrire « les diverses Réalités », puisque, pour n'importe quel être, son Monde est le Monde. C'est en ce sens qu' il faut entendre la formule conclusive du Règne de la quantité et les Signes des temps (op. cit., p. 272) : « Et c'est ainsi que, si l'on veut aller jusqu'à la réalité de l'ordre le plus profond, on peut dire en toute rigueur que la “fin d'un monde” n'est jamais et ne peut jamais être autre chose que la fin d une illusion ».
63) Walpurgisnacht, 1917, traduit de l'allemand par A. D. Sampiéri : La nuit de Walpurgis, Bibliothèque Marabout, 1973, pp. 90-91, souligné dans le texte. Précisons que nous sommes tout à fait conscient des réticences que suscite souvent la mention du nom d'un auteur que beaucoup de traditionnistes, à commencer par René Guénon lui-même, ont condamné dans les termes les plus sévères. Mais les zones d'ombre du personnage ne doivent pas interdire de reconnaître l'intérêt majeur que son œuvre présente.
64) C'est ce qu'Arthur Avalon (Sir John Woodroffe) exprime en disant du Mantra, qu'il définit comme « en un mot, une puissance (Shakti), la puissance sous la forme du son », que celui-ci « se prête impartialement à tout usage ». The Serpent Power, traduit de l'anglais par Charles Vachot d'après la 4° édition de 1950 : La puissance du Serpent : Introduction au tantrisme, Dervy-Livres, coll. Mystiques et Religions, 1990, pp. 88 et 87.
00:05 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-paul lippi, tradition, traditionalisme, métaphysique, métaphysique opérative |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 septembre 2013
Nietzsche e o Mundo Homérico

Nietzsche e o Mundo Homérico
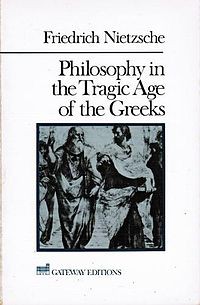 Nietzsche desde o princípio apresentou um apego ao mundo grego, uma idealização deste como estrutura social, ideológica e intelectual. Esta aproximação não é especificamente com a época clássica, mas com a época arcaica que é representada através dos poemas homéricos.
Nietzsche desde o princípio apresentou um apego ao mundo grego, uma idealização deste como estrutura social, ideológica e intelectual. Esta aproximação não é especificamente com a época clássica, mas com a época arcaica que é representada através dos poemas homéricos.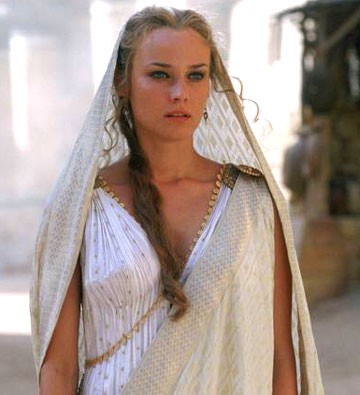 Tomando esta citação compreendemos que a aristocracia se conforma a partir de sua riqueza, e devido a isto é fundamental entre os nobres fomentar vínculos com seus iguais, o qual se dá através da hospitalidade, já que se atende a alguém do mesmo valor moral e social. Neste sentido também se volta importante uma espécie de relação de parentesco dentro da que surge certo intercâmbio econômico representado em presentes (hedna). Na Odisséia se faz patente esta relação de hospitalidade através da narração da viagem de Telêmaco pelas cortes gregas, onde é bem recebido e por sua vez se atende tal como se formara parte da família, sem importar de onde venha, nem as fronteiras que os separam. Outro exemplo chave é o fato que conduz à Guerra de Tróia, a falta da hospitalidade de Paris (Alexandre) frente a Menelau ao raptar Helena.
Tomando esta citação compreendemos que a aristocracia se conforma a partir de sua riqueza, e devido a isto é fundamental entre os nobres fomentar vínculos com seus iguais, o qual se dá através da hospitalidade, já que se atende a alguém do mesmo valor moral e social. Neste sentido também se volta importante uma espécie de relação de parentesco dentro da que surge certo intercâmbio econômico representado em presentes (hedna). Na Odisséia se faz patente esta relação de hospitalidade através da narração da viagem de Telêmaco pelas cortes gregas, onde é bem recebido e por sua vez se atende tal como se formara parte da família, sem importar de onde venha, nem as fronteiras que os separam. Outro exemplo chave é o fato que conduz à Guerra de Tróia, a falta da hospitalidade de Paris (Alexandre) frente a Menelau ao raptar Helena.
00:05 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iliade, monde homérique, nietzsche, tradition, mythologie, traditionalisme, homère, grèce antique, philologie classique, hellénité, hellénisme, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 30 août 2013
D. H. Lawrence’s Phallic Traditionalism
D. H. Lawrence’s Phallic Traditionalism
By Derek Hawthorne
Ex: http://www.counter-currents.com
Sex and Religion
D. H. Lawrence argues that through the sex act, individuals participate in some kind of mysterious power running through nature. But does this momentary experience have any kind of long-term effect on them? Lawrence directly addresses this question. When the sex act is over, he writes, “The two individuals are separate again. But are they as they were before? Is the air the same after a thunderstorm as before? No. The air is as it were new, fresh, tingling with newness. So is the blood of man and woman after successful coition.” He states further that coition alters “the very quality of being, in both.”[1]
But how? Not surprisingly, Lawrence actually says little about how the experience changes the woman, but as for the man he has plenty to say. After coitus, “The heart craves for a new activity. For new collective activity. That is, for a new polarized connection with other beings, other men.”[2] As we have seen, Lawrence believes that sex involves an encounter with the creative force at the basis of nature. This encounter renews the male’s own creativity. He is eager, after the encounter, to break away from the woman for a time and to take action in the world, to bring something new into being: “Men, being themselves made new after the action of coition, wish to make the world anew. A new, passionate polarity springs up between men who are bent on the same activity, the polarity between man and woman sinks to passivity. It is now daytime, and time to forget sex, time to be busy making a new world.”[3]
The man yearns for union with the woman. At the time, all other considerations other than that union become trivial. Union must be achieved. But once it is achieved, he is renewed and yearns now to come together with other men in a new kind of union: a union directed toward the accomplishment of purposive activity. Again, however, what of the woman in all of this? Doesn’t she yearn for a purposive activity beyond the marriage bed? Lawrence answers that, in the main, this is not the case. He writes, “Primarily and supremely man is always the pioneer of life, adventuring onward into the unknown, alone with his own temerarious, dauntless soul. Woman for him exists only in the twilight, by the camp fire, when day has departed. Evening and the night are hers.”[4]
Lawrence’s view is that in life we must oscillate between an encounter with the source—through sex, for example—and purposive, creative activity. In other words, we must oscillate between blood-consciousness and mental consciousness. Lawrence is not anti-intellectual. Mental consciousness exists in order to allow us to carry out the inspirations we have received from blood-consciousness (recall that “it is through the phallic roots that inspiration enters the soul”). It is when mental consciousness is cut off from blood-consciousness and tries to make itself radically autonomous that problems result.
Lawrence at one point frames the issue of the relation of the two forms of consciousness in terms of “nighttime” and “daytime” selves:
Well, then, we have night-time selves. And the night-self is the very basis of the dynamic self. The blood-consciousness and the blood-passion is the very source and origin of us. Not that we can stay at the source. Nor even make a goal of the source, as Freud does. The business of living is to travel away from the source. But you must start every single day fresh from the source. You must rise every day afresh out of the dark sea of the blood.
When you go to sleep at night you have to say: “Here dies the man I am and know myself to be.” And when you rise in the morning you have to say: “Here rises an unknown quantity which is still myself.”[5]
When Lawrence speaks of rising in the morning, he means emerging from the world of dreams. Like Jung, Lawrence believed that we encounter our primal, pre-mental selves in dream. But he does not just mean this. He means that whenever we emerge from an encounter with the source – whenever we have sloughed off, for a time, our individuality and then put it back on again – we must be prepared to be changed, to be inspired with something that has emerged from the source. We must be willing to bring this into the light. He alludes to this idea in Studies in Classic American Literature when he tell us he believes “That my soul is a dark forest” and “That gods, strange gods, come forth from the forest into the clearing of my known self, and then go back.”[6]
Human beings generally make the mistake of absolutizing either the daytime self or the nighttime self; either making sex the be all and end all, to the exclusion of purposive activity, or vice versa. Lawrence writes that “With sex as the one accepted prime motive, the world drifts into despair and anarchy.”[7] In the sex act, as we have said, the sense of individuality, of personal identity is lost and the participants have the sense of merging into some larger unity. But what of the rest of life? We must live as individuals, with a sense of ourselves as separate beings for most of our waking existence.
But what are we to make of our individuality? Some people find the burden of separate, individual existence so great that they seek to have the sort of transcendence one can experience through sex on an almost constant basis, through alcohol or drugs or thrill-seeking. And what we often find with such individuals is that their lives come to pieces, they drift into “despair and anarchy.”
We have, according to Lawrence, two selves: the nighttime self which is the same in all of us, and which is an offshoot of the worldself, the life mystery; and the daytime self, which is different in each of us, and individual. To deny either is unnatural. We must shuttle back and forth between the two. If we absolutize the nighttime self, then we are destroyed as individuals. And any society that tries to found itself on the nighttime self would quite literally descend into chaos. (Consider the case of Woodstock, for example.) “Assert sex as the predominant fulfillment, and you get the collapse of living purpose in man. You get anarchy.”[8]
But it is equally mistaken to assert purpose above everything. This is, in effect, the mistake of idealism. There are individuals who deny sex or any act that involves a contact with the source. Such acts involve a loss of control, and a temporary breakdown in the sense of individual separateness. And this is terrifying to many people. So they live, as it were, from the neck up and devote themselves wholly to achievement, to productive work, to purpose. This is essentially what Freud means by the sublimation of the libido. Such individuals may not literally cease to have sex, but their sex is mechanical and without any real sensual depth. “Assert purposiveness as the one supreme and pure activity of life,” Lawrence writes, “and you drift into barren sterility, like our business life of today, and our political life.”[9]
Lawrence sees in these observations a key to understanding world history. “You become sterile, you make anarchy inevitable,” he says.[10] In other words, if a society asserts purposiveness above all, eventually it reaches a mass psychological breaking point, and the society will abandon itself to pure sensuousness. If this happens, however, things are destined to cycle back again. Someone or some movement will arise in response to this sensuous anarchy, and it will put forward the solution: abandon sensuousness, in favor of pure purpose, or pure idealism. And so on. To quote Anaximander (one of Lawrence’s favorite philosophers), “they pay penalty and retribution to each other for their injustice according to the assessment of time.”[11]
For Lawrence, the solution to this problem is for individuals to live in complete acceptance of sex and the blood-consciousness. They must accept these not only without guilt, but with positive reverence. Sex and all that puts us into touch with the primal, chthonic source is to be regarded as the touchstone of life. All plans and purposes of human beings are to draw their inspiration from the encounter with this source, and must be compatible with the free, regular, sensual contact with it.
Lawrence writes that “no great purposive passion can endure long unless it is established upon the fulfillment in the vast majority of individuals of the true sexual passion. No great motive or ideal or social principle can endure for any length of time unless based upon the sexual fulfillment of the vast majority of individuals concerned.” And just to make sure we have gotten his point, he says again a few lines later, “You have got to base your great purposive activity upon the intense sexual fulfillment of all your individuals.”[12] (Mysteriously, he adds, “That was how Egypt endured.”)
To sum up, it is certainly true to say that Lawrence was preoccupied with sex. But that was because for him sex was religion. In sex we awaken the deepest part of ourselves; we become that part, which is itself part of the life energy of which we are an expression. In sex we contact this mystery, and draw creative strength from it. Lawrence insists, however, that we cannot dwell forever in this mystery. Our lives must be a perpetual shifting back and forth between blood-consciousness and mental consciousness. Contact with the chthonic blood mystery spurs us on to purposive action. And in terms of what our purposes are to be, we draw inspiration from opening ourselves to the chthonic and whatever it may bring forth.
Sex in the Head
Ideally, sex should not be the only means by which we contact the life mystery, but for modern people it usually is. That is, when they can manage to have fulfilling sex at all. The trouble is that modern people live almost exclusively from the intellect, from conscious, mental awareness. And they live with rigid conceptions of selfhood. These are constructions of the intellect and, not surprisingly, they make intellect central to selfhood.
We tend to think, in other words, that we are minds simpliciter. But it is actually worse than that. We tend to think of ourselves almost as disembodied minds, and we relate as one disembodied mind to another. We invest a tremendous amount in maintaining these conceptions. Anything that would break down or challenge our sense of individual distinction is regarded as a threat.
Consequently, as Lawrence tells us over and over again, we have “got our sex into our head.”[13] This is a favorite expression of his. As much as we may locate our sense of self in the head, we cannot ever fully extinguish thereby the flame of the “lower self.” Rather than cede any of its power to the lower self, intellect must find some way to get sex into the head and control it. Sex becomes a matter of ego-aggrandizement, and the object of myriad neuroses. Even sexual arousal comes to be controlled by the head. The instinctual, animal sexual response that nature equips us with is suppressed by intellect. The head develops its own fixations and these become “cues” which trigger arousal.
For example, fetishism is a sexual response triggered not by the presence of an actual man or woman, or male or female genitalia, but by something which somehow symbolizes or refers to these. For example, the fetishist who gets excited over women’s underwear but has difficulty getting excited in the presence of a real woman. This is a person whose response is, again, intellectual and unnatural. He is disconnected from natural sexual feelings, and achieves arousal by routing information through the intellect: “I associate panties with women’s crotches, and they’re sexy, therefore this is sexy.”
The head may even declare some sexual feelings “wrong,” because they are incompatible with the ego’s self-conception. Repression and terrible inner conflict are the result. The more we get our sex into our head, the more a natural, fulfilling sexual response becomes impossible. The end result is almost inevitably impotence in the man and frigidity in the woman. Lawrence would not have been surprised at all had he lived to see the plethora of drugs that have now become available to treat sexual dysfunction, and the massive profits made by the companies that produce them.
One would think that getting sex into the head would put modern people off of sex, but instead it actually makes them terrifically hungry for repeated, transient sexual experiences. Lawrence writes, “The more individual the man or woman, the more unsatisfactory is a non-individual connection: promiscuity.”[14] By identifying only with the “daytime self,” with the mental self alone, we in effect disown our bodies and their sensations and urges. But the urges remain, and we must satisfy them. So we go to a sexual encounter, but because we have rendered our bodies largely insensate, we wind up feeling very little. And because we are terrified of anything that might break down or transform our sense of ourselves, we emerge from the act unchanged.
We are unwilling to surrender ego and make ourselves vulnerable, and so the sex act becomes merely a gymnastic exercise, followed by some mildly pleasurable muscular contractions. Dimly, we sense that something is missing—or that we have missed out on something. So we are driven to go on to another encounter, but the old pattern repeats itself. Of course, part of what drives us to another encounter is the biological sex urge itself, but Lawrence believes that the sex urge alone cannot explain the extraordinary promiscuity of modern people.
A solution to promiscuity, of course, is to find a steady partner, ideally one to hold onto for a lifetime. But modern people tend to approach this from the head as well. Lawrence writes,
We have made the mistake of idealism again. We have thought that the woman who thinks and talks as we do will be the blood-answer. . . . We have made love and sex a matter of seeing and hearing and of day-conscious manipulation. We have made men and women come together on the grounds of the superficial likeness and commonality—their mental and upper sympathetic consciousness. And so we have forced the blood into submission. Which means we force it into disintegration.[15]
We relate to potential love partners through the head, looking for intellectual agreement and a “shared mutuality of values.” This is much more so the case today than when Lawrence wrote. It has become increasingly the case in today’s world that one feels obliged in certain contexts (for example, the workplace) to suppress one’s feelings of magnetic attraction to the opposite sex, and certainly never to give voice to it. Some find an expression of such feelings to be somehow degrading or demeaning, no matter the context. And so men and women tend now to relate to each other primarily through talking, and talking mainly about ideas, opinions, and preferences.
The other side of the coin, of course, is relationships based upon physical attraction. While these may seem superficially more healthy than the relationships just described, in their modern form they are in fact no better. Modern people, as I have said, are caught up in preserving ego boundaries, and that means they are caught up in not losing themselves in the other, in not going too far in the direction of sensuous abandon. Hence, after a while, modern relationships based upon sex reach a dead end, where neither partner is willing to go further for fear of actually becoming something other than what he or she already is. The sex becomes overly familiar, overly mechanical, and, for lack of anything else to sustain it, the relationship ends.
Between dissatisfying sexual encounters, modern people (especially males) steel themselves against the possibility that the next time might be a profound, transformative experience by making a smirking joke of sex; by treating sex as a game in which numbers count: number of conquests, number of orgasms, minutes elapsed before ejaculation, inches of erection, etc. Sex becomes a possession of the ego, something I do which elevates me in my own eyes, a selfish pursuit. What it should be, in fact, is the most selfless pursuit of all—not in the sense of being altruistic, but in the sense of being egoless and ecstatic:
But today, all is image consciousness. Sex does not exist; there is only sexuality. And sexuality is merely a greedy, blind self-seeking. Self-seeking is the real motive of sexuality. And therefore, since the thing sought is the same, the self, the mode of seeking is not very important. Heterosexual, homosexual, narcissistic, normal, or incest, it is all the same thing. . . . Every man, every woman just seeks his own self, her own self, in the sexual experience.[16]
Contrary to appearance, modern people hate and fear sex. They hate and fear the loss of control, the loss of ego, and the abandonment to the life mystery that real, “blood-conscious” sex involves. So they reduce sex to smut and laugh at it, and at themselves for wanting it. In his essay “Pornography and Obscenity,” Lawrence writes, “Pornography is the attempt to insult sex, to do dirt on it. This is unpardonable.”[17] Further, as we have already discussed, scientism conspires with pornography to deflate the sex mystery and render it all a mundane matter of chemicals and “procreative drive.” “The scientific fact of sex is no more sex than a skeleton is a man,” Lawrence writes. “Yet you’d think twice before you stuck a skeleton in front of a lad and said, ‘You see, my boy, this is what you are when you come to know yourself.’”[18]
The “scientific” approach to deflating sex is largely the hard-headed approach of the sexually-repressed male. The sexually-repressed female has given us the “lovey-dovey” approach. Sex is “something wonderful and extra lovey-dovey, a bill-and-coo process of obtaining a sweet little baby.” Both approaches are, Lawrence tells us, “disastrous to the deep sexual life.” “But perhaps,” he adds, “that is what we want.”[19] We want, at some level, to destroy the sexual life because it threatens the ego and the control of intellect.
Phallic Traditionalism
Fear of sex, Lawrence tells us in John Thomas and Lady Jane is “fear of the phallus”:
This is the root fear of all mankind. Hence the frenzied efforts of mankind to despise the phallus, and to nullify it. All out of fear. Hence the modern jazz desire to make the phallus quite trivial, a silly little popgun. Fear, just the same. Fear of this alter ego, this homunculus, this little master which is inside a man, the phallus. Men and women alike committed endless obscenities, in order to be rid of this little master, to be free of it! Free! Free! Freedom![20]
Remember that the phallus—the erect penis—is the second man within the man: the expression of the primal, chthonic self. It is the bodying-forth in the male’s body of the unconscious, or the blood-consciousness. It is not a thing of intellect; its roots go much deeper. And because of this, it is an affront to the intellect, which prides itself on its autonomy. Lawrence is telling us that all of our reductive scientism, our pornography, our sanitized “lovey-dovey” smarm about sex, indeed most of modern life, are a concerted effort to deny the power of the phallus and to assert the radical autonomy of intellect.
It would be a mistake to understand Lawrence as simply saying that modern men and women fear a physical organ. In a way, Lawrence is saying this. The erect penis represents, in the minds of most people, the primal self within the self, deeper than intellect. And, indeed, it is under the control of that primal self; again, an erection cannot be “willed.” But recall also that for Lawrence the phallus is an expression of the life mystery that permeates all of nature.
The fear of the phallus thus represents, in another way, the fear and hatred of that which is greater than ourselves. It is no accident that the scientific “deflation” of sex usually goes hand in hand with atheism. They spring from the very same sort of mentality, the mentality that fears losing itself in something that would break the bounds of ego. To prevent this from ever happening, it must deny mystery, beauty, and God. These are all, in a way, the phallus. It must deny these or somehow explain them away. And above all it must deny itself pleasure. The fear of the phallus goes hand in hand with a fear of pleasure, for pleasure threatens to carry us away and give us a transcendent experience in which we feel absorbed into something greater than ourselves. As a Shaivite text says: “every pleasure is a divine experience. The entire universe springs forth from enjoyment. Pleasure is at the origin of all that exists.”
In “A Propos of ‘Lady Chatterley’s Lover’” Lawrence writes that “the bridge to the future is the phallus, and there’s the end of it.” At this point, as strange as it may seem, it should be unsurprising to hear Lawrence make such a claim. What is surprising, however, is that he insists that he is not saying that the bridge to the future is sex. In the same essay, Lawrence goes on to say that if England (and, by extension, the entire modern, Western world) is to be “regenerated . . . then it will be by the arising of a new blood contact, a new touch, and a new marriage. It will be a phallic rather than a sexual regeneration. For the phallus is the only great old symbol of godly vitality in a man, and of immediate contact.”[21]
What can Lawrence mean by “phallic rather than sexual”? One must keep in mind that which the phallus represents. Lawrence is calling upon us to return to consciousness of the life mystery, in every way that we can. Sex is only one way. The phallus is “only the great old symbol of godly vitality in a man,” and it is this godly vitality that we must put ourselves back in touch with. But what does Lawrence mean when he says, further, that the phallus is the old symbol of “immediate contact”?
Here he refers to his provocative claim, discussed earlier, that the phallus “is a column of blood that fills the valley of blood of a woman.” The phallus is the means by which the two great rivers, which are metaphysical opposites, are brought together wordlessly, and more profoundly than any words or ideas could convey. The phallus represents this and all other forms of “blood-contact,” meaning instinctive or intuitive, non-verbal contact between individuals.
Lawrence believes that individuals relate to each other in countless, mysterious ways that he often designates by the term “vibrations.” We relate to the opposite sex through these vibrations. No matter our sexual orientation, the vibrations are there. We relate to members of our own family, or our own ethnic group, or to members of another, different ethnic group through these vibrations. We must learn somehow to recover our awareness of these, and cease attempting to relate to one another exclusively through words and ideas. But this is only part of what we must do to get back in touch with “the phallus.”
In the same essay, Lawrence speaks of the necessity of establishing an entire life lived in connection to the phallus:
We must get back into relation, vivid and nourishing relation to the cosmos and the universe. The way is through daily ritual, and the re-awakening. We must once more practise the ritual of dawn and noon and sunset, the ritual of the kindling fire and pouring water, the ritual of the first breath, and the last. This is an affair of the individual and the household, a ritual of day. The ritual of the moon in her phases, of the morning star and the evening star is for men and women separate. Then the ritual of the seasons, with the Drama and Passion of the soul embodied in procession and dance, this is for the community, in togetherness. And the ritual of the great events in the year of stars is for nations and whole peoples. To these rituals we must return: or we must evolve them to suit our needs.[22]
This is, of course, a description of the kind of life our distant ancestors lived. It was a life lived, in effect, in constant meditation upon and connection with the phallic mystery, the pan power. The phallus is the “bridge to the future,” but this bridge takes us roundabout and back again to the distant past.
Notes
[1] D. H. Lawrence, Fantasia of the Unconscious in Fantasia of the Unconscious and Psychoanalysis and the Unconscious (New York: Penguin, 1971), 107.
[2] Fantasia, 108.
[3] Fantasia, 108.
[4] Fantasia, 109.
[5] Fantasia, 182–83.
[6] D. H. Lawrence, Studies in Classic American Literature (New York: Penguin, 1977), 22. Italics in original.
[7] Fantasia, 110. Later in the same text he declares, “Sex as an end in itself is a disaster: a vice” (Ibid., 187).
[8] Fantasia, 111.
[9] Fantasia, 111.
[10] Fantasia, 111.
[11] The Presocratic Philosophers, trans. G. S. Kirk, J. E. Raven, and M. Schofield (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 118.
[12] Fantasia, 110–11.
[13] Fantasia, 85.
[14] Fantasia, 175.
[15] Fantasia, 175.
[16] D. H. Lawrence, Phoenix, ed. Edward McDonald (New York: Viking, 1968), 381–82 (Review of Trigant Burrow, The Social Basis of Consciousness).
[17] Phoenix, 175 (“Pornography and Obscenity”).
[18] Fantasia, 114.
[19] Fantasia, 114.
[20] John Thomas and Lady Jane, 239.
[21] D. H. Lawrence, Phoenix II, ed. Warren Roberts and Harry T. Moore (New York: Viking, 1971), 508 (“A Propos of ‘Lady Chatterley’s Lover’”).
[22] Phoenix II, 510 (“A Propos of ‘Lady Chatterley’s Lover’”).
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2013/08/d-h-lawrences-phallic-traditionalism/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/08/phalluses-delos-greece.jpg
[2] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/08/woman-phallus.jpg
[3] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/08/shintophallus2.jpg
[4] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/08/shintophallus3.jpg
[5] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/08/shintophallus1.jpg
00:05 Publié dans Littérature, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature anglaise, lettres, lettres anglaises, culte duphallus, phallus, d. h. lawrence, tradition, traditions, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 23 août 2013
Libre Journal des Lycéens: Guénon, Evola
11:53 Publié dans Evénement, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené guénon, julius evola, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Leggere Tucci per comprendere la Cina
Leggere Tucci per comprendere la Cina
Autore: Giovanni Balducci
Ex: http://www.centrostudilaruna.it
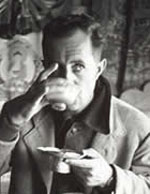 Grande più o meno quanto l’intera Europa, la Cina è il paese più popoloso del pianeta, con 1 miliardo e 300 milioni di abitanti. Con l’introduzione della riforma economica capitalista, nel 1978 diventa il paese con lo sviluppo economico più rapido al mondo, sino a divenire nel 2010 il più grande esportatore di merci su scala globale, imponendosi prepotentemente dinanzi alla comunità internazionale come nuova superpotenza economica. Tuttavia la Cina è un paese dalle mille contraddizioni, una realtà che include – in maniera a dir poco stridente – 130 milioni di ricchi e 300 milioni di abitanti sotto la soglia di povertà, milioni di fruitori di elettrodomestici hi-tech nelle città e mancanza di acqua e luce elettrica nei villaggi.
Grande più o meno quanto l’intera Europa, la Cina è il paese più popoloso del pianeta, con 1 miliardo e 300 milioni di abitanti. Con l’introduzione della riforma economica capitalista, nel 1978 diventa il paese con lo sviluppo economico più rapido al mondo, sino a divenire nel 2010 il più grande esportatore di merci su scala globale, imponendosi prepotentemente dinanzi alla comunità internazionale come nuova superpotenza economica. Tuttavia la Cina è un paese dalle mille contraddizioni, una realtà che include – in maniera a dir poco stridente – 130 milioni di ricchi e 300 milioni di abitanti sotto la soglia di povertà, milioni di fruitori di elettrodomestici hi-tech nelle città e mancanza di acqua e luce elettrica nei villaggi.
Ma la Cina è anche una delle civiltà più antiche della storia, un paese dalle grandi tradizioni culturali, artistiche e filosofiche, è la patria dei saggi Confucio e Lao Tze, è il paese il cui connaturato fascino colpì i grandi viaggiatori europei a cominciare da Marco Polo e Matteo Ricci, affascinati non solo dalla civiltà, ma anche dalle grandi scoperte ed invenzioni che il paese dei Dragoni aveva realizzato nel corso della sua storia plurimillenaria: come la bussola, la carta, la polvere da sparo e la stampa.
Pari al mercante veneziano del Milione ed al sinologo gesuita – per altro suo concittadino maceratese – un altro folgorato sulla via del Catai fu – senza dubbio – Giuseppe Tucci, a detta di molti il più insigne orientalista italiano del XX secolo, ed in particolare – secondo l’opinione corrente – il maggiore fra i tibetologi.
Tucci cominciò sin da giovanissimo a studiare il cinese, e si appassionò ben presto al pensiero di Confucio, incentrato sul buon governo e sulla ricerca di una saggezza tesa al benessere dello stato e del popolo. Insegnamenti, questi confuciani, che avevano già destato nel XVIII secolo l’interesse di Voltaire, e che susciteranno viva ammirazione in Ezra Pound. Ben presto però, dalla lettura del legista Confucio, l’interesse del Tucci si sposterà sugli aforismi di Lao-tze e Chuang-tze sul Tao. Ma il Nostro non abbandonò mai una strada per l’altra, anzi tenne sempre presente il quadro suggestivo dei due principali indirizzi di pensiero su cui si fonda la visione della vita cinese: il confucianesimo e il taoismo, la via della probità e la via della spontaneità.
Nel 1933, insieme a Giovanni Gentile, Tucci promuove la fondazione dell’Istituto Italiano per il Medio e l’Estremo Oriente (IsMEO), diventato oggi IsIAO, Istituto per l’Africa e l’Oriente, di cui sarà presidente dal 1947 al 1978; e presidente onorario dal 1979, dando un grande impulso allo sviluppo dei rapporti culturali tra l’Italia e l’Oriente, in particolare con la Cina e con l’India. Lo stesso Mussolini ebbe a finanziare le molteplici spedizioni asiatiche di Tucci, forse intenzionato a fare di lui un’agente al servizio della politica internazionale italiana. Ma Tucci non fu mai il Lawrence d’Arabia italiano. Non amava particolarmente la politica, e se ne teneva distante quanto possibile, anche se gli vanno riconosciute indubbie doti diplomatiche (molti ritengono che proprio alla sua intercessione si debba la visita in Italia del Mahatma Gandhi nel 1931), che gli valsero il patrocinio e la protezione del Duce durante il Ventennio, e di Andreotti durante gli anni della Democrazia Cristiana.
Tucci non fu solo un fine erudito, il suo studio delle fonti letterarie si accompagnò sempre ad un fervido interesse per la conoscenza e l’esperienza diretta dei paesi, delle tradizioni e dei popoli d’Oriente (tra le altre cose, fu fra i primi europei a visitare la «città proibita» del Tibet). Ricorda lo scrittore e reporter Stefano Malatesta, che «molto spesso Tucci auspicava il riavvicinamento tra la cultura occidentale e quella orientale. Eppure lui, meglio di chiunque altro, sapeva l’enorme distanza dei due modi di essere: noi pensiamo che l’asceta dell’Oriente dissipi vanamente il tempo che passa correndo dietro a fantasmi e visioni. Loro hanno pietà di noi che andiamo alla ricerca di cose che non sono nostre e mai lo saranno».
 Si dirà che il pensiero di Tucci poteva andar bene il secolo scorso, non di certo oggigiorno dinanzi ad una Cina moderna, cosmopolita, aperta agli affari, che ha ormai accantonato il suo passato. Ma provate a farvi un giro nei quartieri più antichi delle metropoli cinesi, o magari recatevi in una delle numerose sale da tè, e ditemi se non intuite il profondo fascino della Cina tradizionale. E se proprio non riuscite a sentire nulla, andate al tempio del Buddha di Giada a Shangai, che sfida il tempo innalzandosi ieratico tra i palazzoni – come un fior di loto nel fango, per usare un’immagine proprio del Buddha – e osserva fiero le orde di turisti profani e le ancor più profane guide turistiche che quotidianamente lo prendono d’assalto. Fatevi quattro chiacchiere con i nuovi ricchi cinesi, e vedrete che malgrado l’evidente omologazione con “l’industrializzato Occidente”, anche il manager della “Pechino da bere”, conserva il rispetto per l’importanza dei legami sociali e di parentela, secondo le regole della tradizione. Se non vi basta, fate un salto alla Città Proibita o alla Grande Muraglia a prendervi una boccata d’arte e di cultura millenaria.
Si dirà che il pensiero di Tucci poteva andar bene il secolo scorso, non di certo oggigiorno dinanzi ad una Cina moderna, cosmopolita, aperta agli affari, che ha ormai accantonato il suo passato. Ma provate a farvi un giro nei quartieri più antichi delle metropoli cinesi, o magari recatevi in una delle numerose sale da tè, e ditemi se non intuite il profondo fascino della Cina tradizionale. E se proprio non riuscite a sentire nulla, andate al tempio del Buddha di Giada a Shangai, che sfida il tempo innalzandosi ieratico tra i palazzoni – come un fior di loto nel fango, per usare un’immagine proprio del Buddha – e osserva fiero le orde di turisti profani e le ancor più profane guide turistiche che quotidianamente lo prendono d’assalto. Fatevi quattro chiacchiere con i nuovi ricchi cinesi, e vedrete che malgrado l’evidente omologazione con “l’industrializzato Occidente”, anche il manager della “Pechino da bere”, conserva il rispetto per l’importanza dei legami sociali e di parentela, secondo le regole della tradizione. Se non vi basta, fate un salto alla Città Proibita o alla Grande Muraglia a prendervi una boccata d’arte e di cultura millenaria.
Fatto sta che Giuseppe Tucci, nella sua Storia della filosofia indiana, aveva già intravisto la riscossa dell’Oriente, soprattutto dei due giganti Cina ed India: «L’avvenimento maggiore al quale oggi assistiamo – scriverà – è fuori di dubbio l’ingresso dell’Asia nella storia: voglio dire che l’Asia fino a ieri subiva la storia ed oggi ne è fattore di primo piano». Ma Giuseppe Tucci ci ha soprattutto trasmesso la sua fervida ed acuta dimostrazione dell’unità culturale dell’Eurasia, e una ferma presa di coscienza del fatto che, giunti come siamo ad un tornante della storia, essa dovrebbe ipso facto tradursi in un’effettiva unità geopolitica.
* * *
BIBLIOGRAFIA
Storia della filosofia indiana, Giuseppe Tucci, Laterza, 2012.
00:08 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chine, giuseppe tucci, tradition, traditionalisme, asie, spiritualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 13 août 2013
The Importance of Ritual

The Importance of Ritual
By Gregory Hood
Ex: http://www.counter-currents.com/
The culture comes from the cult, and without the cult, we’re just kidding ourselves.
Radical Traditionalists are excellent critics. They can analyze the collapse of a civilization. They can pinpoint the mistaken premises that have led to the wasteland of modernity. They can discover in the most minute expressions of pop culture or contemporary vocabulary the egalitarian rot that is poisoning even the most petty social interaction.
Yet criticism is only a means. The objective is not just to bemoan the Kali Yuga but to restore – or failing that, create – an organic society that can facilitate the upward development of the race [2]. This requires something beyond intellect, criticism, and reason. It requires laying the foundation of a new order of society which can encompass all those necessary to make it function. This means weaving a tapestry of meaning and experience that can enmesh the worker with the philosopher and overcome differences of class, education, and wealth with a shared cultural context. This means religion. To put it more precisely, this means a cult.
Neo-paganism today is largely an intellectual exercise, what Collin Cleary has called [3] “paganism without gods.” Arguably this has been true since the days of Julian the Apostate, when the emperor vainly tried to resurrect the ancient gods through polemics, crackdowns on Christianity, and animal sacrifice. Even in the late Roman Empire, paganism was an aesthetic choice, a sign of cultural rebellion against Christianity, rather than a vital “faith” that had the power of literal belief behind it. Despite the scathing contempt of a Galen [4] or the slashing criticism of the Emperor Julian, Christianity would ultimately subsume the Roman Empire and the last pagan to wear the purple would mournfully cry, “You have won, Galilean.”
The contemporary heathen lives in a world of disbelief and is himself a product of that disbelief, most likely having rebelled against the Christianity of his fathers and grandfathers. Reason, irony, and iconoclasm are the hallmarks of the age and this manifests itself in the tepid spiritual practice of contemporary paganism. For contemporary pagans, their new age “faith” is simply an attempt to rebel against the “restrictions” of Christianity without challenging any of its deeper moral suppositions. Feminist Wiccans, universalist “heathens,” and Renaissance Faire Vikings litter the American landscape, and these supposed rebels align themselves even more firmly with the egalitarian Zeitgeist than the most committed evangelical. One has to ask the universalists [5] and the practitioners of “Wiccatru” – why not just become Unitarians?
“Reconstructionist” heathens present their own challenges, poring over incomplete pagan texts most likely saved by Christian authors and arguing like Byzantine clerics over what are the “correct” interpretations and practices. Like Civil War re-enactors insisting on using historically accurate buttons, this is simply a flight into fancy, interesting and entertaining but without real importance. Learning abut the past is always a worthy effort, but the attempt to escape into a bygone era is an admission of impotence. Dressing in medieval garb or affecting archaic speech is less a rejection of modernity than a surrender to it. The luxury of escapism is a product of affluence and leisure, not a consistent effort to Revolt Against the Modern World [6].
If being a heathen is to stand for anything, it has to offer an authentic spiritual experience and cultural framework that is meaningful within the modern world. In the same way that a Christian church can offer something to both the humble parishioner and the sophisticated theologian, Ásatrú has to forge bonds of spiritual community regardless of a person’s intellectualism and chosen level of involvement. More to the point, in order to avoid the embarrassing debacles of Christian apologists defending [7] such things as young earth creationism, heathen “theology,” for lack of a better word, has to be open to correct understandings of science and the nature of existence.
It begins with, as Collin Cleary suggests, simply premising that the gods exist and that we have in some sense lost our “openness” to them. However, in a deeper sense, to be a heathen in the modern world is to live out the mythology. To the authentic pagan, every social interaction, sexual relationship, meal, creation, struggle, or accomplishment is fraught with meaning, and open to ritual and magic. Instead of simply premising that the gods exist or that there is a divine sphere, the heathen and magical practitioner must regard himself as a character in his own saga, capable of tapping into the power of the gods through study and discipline combined with ecstatic experience.
Such a revolution in thinking is not easy and therefore it must begin with something even Christians regard as otherworldly – ritual. In the High Church tradition of Traditional Catholics or the Orthodox, the Mass is an attempt to bring heaven to Earth, to literally transport the consciousness of the individual to another world. In Germanic paganism, we quite literally seek to bring the gods to ourselves, either as present during a ritual or as a kind of possession within us. This requires a physical and mental separation from the workaday world, accomplished through the archetypal heathen practice of “hallowing.”
Though the specifics differ from group to group, the gothi will carve out a space separate from the rest of the world through the power of Mjölnir [8] (Thor’s hammer), Gungnir [9] (Odin’s spear), or some other instrument. This represents a psychological break with the mundane, as within the vé [10] (or sacred enclosure), it is accepted that reality itself has changed. As one practitioner put it, “Outside the vé, I am an atheist, inside the vé I am a religious fanatic.” Through changes in physical appearance, ritualistic chanting, music, and other practices, consciousness itself is changed, as the holy is separated from the mundane. The demarcation between the sacred and the profane is arguably at the root of all cultural identity, and the very definition of what separates one people from another.
Some could sneer that this is simply a pointless “light” show to “trick” the brain into seeing what is not there. If this is true, so too is the design of the Hagia Sophia (an earthly attempt to imitate heaven), or the use of incense during mass, or even the communal singing and chanting of just about any church service. However, in a greater sense, the ritual is the “lowest” attempt to transform consciousness above the mundane. As the modern world has removed the sacred (indeed, is characterized by the removal of the sacred), beginning practitioners must use extreme methods to “shock” their consciousness into openness to the divine.
This does not mean throwing on a wolf skin and running around screaming will lead to a person meeting the Allfather in the woods one day. However, if done properly, ritual and magic introduces the necessary openness to spiritual experience that begins a transformative process. The point is not simply to perform a ritual once in a while and enjoy fellowship with those of like mind, although this in and of itself is healthy. The point is to understand that the gods, the lore, the runes, and the process of spiritual transformation can be applied to oneself and one’s folk through a kind of psychological programming.
In normal time, one does not have to take a position on whether the gods are literally real or merely cultural archetypes. Instead, whether the gods are real or not, ritual begins a process of mental transformation that works on a continuous basis. This is best described by Aleister Crowley’s [11] view of magic – “the methods of science, the aim of religion.”
In the Hávamál (the words of the High One), we are told how Odin grasped the secret of the runes.
I ween that I hung on the windy tree,
Hung there for nights full nine;
With the spear I was wounded, and offered I was
To Othin, myself to myself,
On the tree that none may ever know
What root beneath it runs
None made me happy with loaf or horn,
And there below I looked;
I took up the runes, shrieking I took them,
And forthwith back I fell.
The Allfather grasps the runes in a moment of ecstasy, but before this moment there is a long period of deprivation, suffering, and discipline. The nine days pinned to Yggdrasil suggests an entry into an alternate form of consciousness, a higher state of awareness similar to that claimed by Christian saints who practiced fasting or sexual abstinence. The acquisition of supreme wisdom comes from the sacrifice of “oneself to oneself,” regulated through ritual, prepared by conscious study, enabled by ecstatic experience.
A talented musician or gifted general may benefit from a blinding insight at a critical moment, but this kind of divine “Odinic” inspiration doesn’t just show up randomly. It is the product of a lifetime of conscious study, united with the unconscious forces within the human mind that seem beyond deliberate control. Anyone can feel the “Muse” – but for the insight to be worthwhile, the ground must first be prepared.
Excellence, said Aristotle (another great pagan) is a habit. We are what we repeatedly do. In pagan societies, ritual is a way of elevating mundane conduct to a higher level of meaning and regulating our baser impulses to give way to a more elevated sensibility. In feudal Japan, for example, the samurai [12] pursued both combat and artistic expression (through such means as the “tea ceremony [13]”) towards the aim of perfection in everything they did. For the heathen, occasional ritual should be the beginning of a process of transformation that eventually informs every action he takes.
Nietzsche called for the Übermensch to live his entire life as a work of art. Total mastery for the heathen would mean turning one’s entire life into a ritual, a Great Work that would transform both his own nature and the world around him through a kind of spiritual alchemy. In the Traditionalist understanding of history, there was a Golden Age when men were one with the gods and their purity of blood, mind, and spirit allowed to them to work wonders and reach depths of understanding denied to the denizens of the Kali Yuga. Ritual, correct practice, discipline, and Odinic frenzy allow the heathen to enable the process of transformation to once again reach for that Golden Age. As it says in the Hávamál,
Knowest how one shall write, knowest how one shall rede?
Knowest how one shall tint, knowest how one makes trial?
Knowest how one shall ask, knowest how one shall offer?
Knowest how one shall send, knowest how one shall sacrifice?
The modern man is at war with nature, at war with his fellows, at war with himself. The heathen seeks to align his spirit with that of the cycles of nature, discover frith [14] with his kinsfolk through organic community, and master himself so he is no longer a slave to his baser impulses. While Christianity suppresses the Will, heathenism glories in it, provided that it can be controlled and understood. To be a heathen is not just to be “open” to the gods, but to pursue the god within. Once properly understood, the heathen carves out in his blood his own Vinlandic Saga each and every day, and even the most mundane activities become a kind of elevating practice.
This requires real experience – real, authentic practice either as a solitary apprentice or, preferably, as part of a kindred or tribe. To rebuild organic culture means creating a shared experience as a community. Heathenism can not be limited to books – or, worse – to the internet. It is to be lived through blood and sweat, the frenzy of inspiration, the toil of shared physical activity, the comradeship and community of shared practice.
Though our sources for “reconstructing how our ancestors did it” are limited, that is relatively unimportant. What is important is taking what we know and embarking on a sincere quest to understand the ancient mysteries, and in so doing, restore our link with Primordial Tradition. The metapolitics, metaphysics, and moral principles of Ásatrú must be explained and defended through every medium possible, but in the end, tens of thousands of words do not carry the power of one authentic “Odinic” experience.
Authentic ritual also allows us to build real community on a level that does not need to be rationally explained. People join groups for one of three reasons – ideological, material, and social. The weakness of abstract, purely “ideological” groups prone to infighting and division is self-evident here. In material terms, a real “kindred” or “tribe” can develop the ability to support its own members through labor, financial aid, and job connections, particularly among working class whites that are cast out on their own by society. However, most importantly, communal ritual, communal symbolism, and communal gatherings “create” a people, and give them their own definition of “good” and “evil,” as described in Thus Spake Zarathustra. It is not whites as they are that we defend, but whites as they could become, and that process of transformation and folk creation has to begin with the establishment of the sacred.
Christianity asks us to rationally believe the unbelievable. Heathens should not compete in apologetics, or take refuge in abstraction. It remains for them to write their own saga by living out the mythology in the modern world. It is not a question of “believing” in Odin, but walking his path, and in so doing, becoming one with the gods. In the end, Ásatrú isn’t something you believe. It’s something you live. It’s not just a tradition “for” a folk. It’s a practice that can create one.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2013/08/the-importance-of-ritual/
URLs in this post:
[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2013/08/odin745.jpg
[2] upward development of the race: http://www.counter-currents.com/2013/05/race-the-first-principle/
[3] called: http://www.counter-currents.com/2011/06/introduction-to-summoning-the-gods/
[4] Galen: http://www.tertullian.org/rpearse/galen_on_jews_and_christians.htm
[5] One has to ask the universalists: http://www.counter-currents.com/2012/10/asatru-and-the-political/
[6] Revolt Against the Modern World: http://www.amazon.com/gp/product/089281506X/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=089281506X&linkCode=as2&tag=countercurren-20
[7] defending: http://www.counter-currents.com/2012/04/the-de-germanization-of-late-american-christianity/
[8] Mjölnir: http://en.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lnir
[9] Gungnir: http://en.wikipedia.org/wiki/Gungnir
[10] vé: http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9_(shrine)
[11] Aleister Crowley’s: http://www.arktos.com/crowley-thoughts-perspectives.html
[12] samurai: http://www.counter-currents.com/2012/05/the-last-samurai/
[13] tea ceremony: http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_tea_ceremony
[14] frith: http://en.wikipedia.org/wiki/Frith
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ritual, ritualisation, rites, religion, religiosité, tradition, traditions, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 juillet 2013
LE RETOUR DES MOINES GUERRIERS

La question islamiste en terre bouddhiste
Rémy Valat
Ex: http://metamag.fr
Le numéro de juillet de l’hebdomadaire américain Time aborde le problème de la radicalisation du clergé bouddhiste face à l’Islam en Asie (Thaïlande du Sud et Birmanie). L’article de Beech Hannah, When Buddhists go bad, fait actuellement scandale en Birmanie. Il a notamment heurté de nombreux membres de la communauté bouddhiste qui ne se sent pas solidaire du discours du moine islamophobe Ashin Wirathu.
Qu’en est-il exactement ?
La guerre religieuse et d’indépendance, qui débuta en 2004, continue de faire rage dans le sud de la Thaïlande. La Thaïlande se compose d’une population majoritairement bouddhiste, mais le Bouddhisme n’est pas la religion officielle du pays. Les musulmans représentent 5 % de la population, dont la majorité (4/5e) sont des locuteurs malais (les musulmans thaïlandophones représentent environ 20%), implantés dans les cinq provinces frontalières à la Malaisie (Narathiwat, Pattani, Satun, Songkla et Yala). Ces régions rurales et pauvres ont subi une politique d’assimilation forcée du gouvernement de Bangkok dans les années 1960. Deux mouvements indépendantistes, le Pattani United Liberation Organization (PULO) et le Barisan Revolusi Nasional (BRN) ont pris une première fois les armes entre 1976 et 1981, puis les mouvements se cantonnèrent dans l’activisme politique et l’extorsion de fonds. En réponse aux mesures musclées du chef du gouvernement deThaskin Shinawatra, la minorité religieuse mit en avant ses droits et réclama notamment le port du Hijab pour les femmes musulmanes dans les lieux publics, l’ouverture de mosquées et l’expansion des études islamiques dans les écoles publiques. C’est sur ce terreau favorable que le conflit armé latent depuis 2001 débuta en 2004. Il oppose toujours les forces gouvernementales aux mouvements indépendantistes, essentiellement, aux groupes terroristes islamistes, le Pattani Islamic Mujahadeen Movement ou Gerakan Mujahideen Islam Pattani, qui a déclaré la djihad contre les populations bouddhistes et la monarchie-junte militaire thaïlandaise.

Deux moines bouddhistes sous la protection de soldats Thaïlandais (province de Pattani)
Les sources de financement des groupes insurrectionnels ne sont pas claires : l’importation de techniques et de fonds serait la main du « terrorisme international » d’Al Qaida, selon les services de renseignement nord-américains, mais rien ne l’atteste irréfutablement. Le mouvement serait plutôt un cocktail religieux, identitaire et passéiste... Selon Pak Abu, un professeur d’école coranique et chef des affaires internes du Pulo, l’objectif du mouvement serait la « libération du Patani Darussalam - la terre islamique de Patani - de l'occupation des infidèles» et de revenir au temps idéalisé (mais révolu) du sultanat de Pattani....  Localisation du conflit. Les cinq provinces malaises embrasées par la guerre religieuse et d’indépendance ont été rattachées au Siam par le traité de Bangkok (10 mars 1909) signés par la Grande-Bretagne et le royaume du Siam
Localisation du conflit. Les cinq provinces malaises embrasées par la guerre religieuse et d’indépendance ont été rattachées au Siam par le traité de Bangkok (10 mars 1909) signés par la Grande-Bretagne et le royaume du Siam
Un autre responsable du mouvement islamiste aurait déclaré à un journaliste du Figaro que les réseaux sont peu structurés, très violents et capables de planifier leurs actions : l’ensemble représenterait environ 3 000 individus majoritairement des jeunes de moins de 20 ans. Selon lui, le BRN-Coordination est une « coalition informelle d'individus», cimentée par un « haine commune à l’encontre des populations siamoises. «Nous avons fait, déclare-t-il, le serment de sacrifier notre vie pour libérer notre terre ancestrale de l'occupation des infidèles.» Il précise que les jeunes combattants (les juwae) ont « été repérés à la crèche, recrutés dans les écoles coraniques et mènent une guérilla urbaine de plus en plus sophistiquée» Surtout, l’indicateur du Figaro reconnaît que «le degré de brutalité» de la nouvelle génération «est parfois une source d'embarras» et déplore la « criminalisation » des troupes : «30% des combattants vendent leurs services à la mafia et aux trafiquants de drogue». Leurs méthodes sont en effet radicales : attentats à l’explosif contre des cibles civiles, embuscades sur les axes routiers, assassinats, incinérations vivantes, voire décapitations de civils, d’agents symboles de l’Etat (fonctionnaires thaïlandais et religieux bouddhistes). Plus de 5 000 morts et 8 000 blessés (globalement le bilan de la guerre civile algérienne en France entre 1955 et 1962) ont été recensés entre 2004 et 2012 et le bilan ne cesse de s’alourdir, les négociations étant toujours à l’heure actuelle dans l’impasse.

Bilan humain du conflit (tués et blessés)
Les agressions contre le personnel religieux bouddhiste ont obligé l’armée royale à transformer les monastères en bases militaires et à organiser les populations bouddhistes en groupes d’autodéfense (70 000 volontaires bouddhistes) : selon Duncan McCargo, enseignant à l’université de Leeds, des rumeurs courent sur la présence dans les communautés bouddhistes d’anciens militaires ordonnés moines et sur l’armement d’une fraction des religieux : une réminiscence des moines guerriers du Japon médiéval (les sôhei) ou de Shaolin ? Non, une simple ressemblance sur la forme sans plus, les moines guerriers nippons ayant surtout pour vocation de protéger leur temple et d'y maintenir l'ordre : ils étaient aussi une force politique et armée non négligeable. Nous sommes ici dans un réel contexte de guerre de religions. Il ne fait aucun doute que le discours de quelques religieux bouddhistes tend à se radicaliser : « Il n’y a pas d’autres choix, nous ne pouvons plus séparer le bouddhisme des armes désormais », aurait déclaré le lieutenant Sawai Kongsit, de l’armée royale thaïlandaise (Time). Les moines estiment que les Musulmans utilisent les mosquées pour entreposer des armes, que chaque imam est armé : « L’islam est une religion de violence » déclare Phratong Jiratamo, un moine ayant servi dans le corps des troupes de marines thaïlandaises (Time).

Le moine birman, Ashin Wirathu, tête de file du mouvement 969
Cette radicalisation est nette dans le discours islamophobe du moine bouddhiste Ashin Wirathu (Mandalay, Birmanie) : discours à l’origine de lynchages, de meurtres et de comportements racistes à l’encontre des musulmans birmans (les Rohingyas) qui représentent entre 4% et 9% de la population du pays. Ashin Wirathu appelle de ses voeux un schisme entre les populations bamars (majoritairement bouddhistes) et les Rohingyas musulmans. Un nouvel et tragique épisode du « choc des civilisations »...
En savoir plus : Faker Korchane, "Time" Klein Victor, L’Islam en Thaïlande, de l’intégration au déchirement, blog sur l’Asie du Sud-EstLauras Didier, En Thaïlande des temples transformés en casernes .
00:05 Publié dans Islam, Traditions | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique internationale, thaïlande, islamisme, islam, bouddhisme, aise, affaires asiatiques, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 03 juillet 2013
Le baron von Ungern vénéré dans les temples mongols
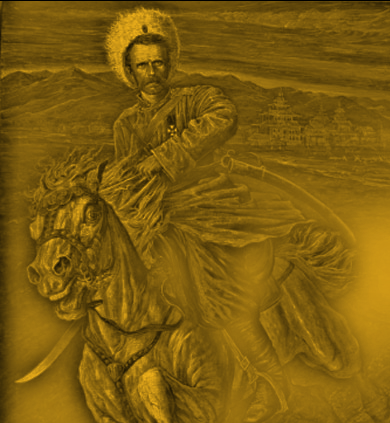
Le baron von Ungern vénéré dans les temples mongols
Depuis peu, on ne cesse d’écrire sur une figure qui, malgré sa stature extraordinaire, était passée presque inaperçue dans le tumulte consécutif à la précédente guerre: celle du baron Ungern-Sternberg. Ossendovski avait été le premier à s’intéresser à lui, à grands renforts d’effets dramatiques, dans son célèbre et très controversé Bêtes, hommes et dieux. Il a été suivi par une vie «romancée» du baron von Ungern, publiée par Vladimir Pozner sous le titre de La Mort aux dents; puis, par une seconde vie romancée, de B. Krauthoff: Ich befehle: Kampf und Tragödie des Barons Ungern-Sternberg.
Ces livres semblent toutefois donner une image inadéquate du baron von Ungern, dont la figure, la vie et l’activité sont susceptibles de laisser une grande latitude à la fantaisie en raison de leurs aspects complexes et énigmatiques. René Guénon, le célèbre écrivain traditionaliste, contribua à mieux faire connaître le baron en publiant des passages de lettres écrites en 1924 par le major Alexandrovitch, qui avait commandé l’artillerie mongole en 1918 et en 1919 sous les ordres directs de von Ungern; et ces données, d’une authenticité incontestable, laissent à penser que les auteurs de ces vies romancées se sont souvent appuyés sur des informations inexactes, même en ce qui concerne la fin du baron.
Descendant d’une vieille famille balte, von Ungern peut être considéré comme le dernier adversaire acharné de la révolution bolchevique, qu’il combattit avec une haine implacable et inextinguible. Ses principaux faits d’armes se déroulèrent dans une atmosphère saturée de surnaturel et de magie, au cœur de l’Asie, sous le règne du dalaï-lama, le «Bouddha vivant». Ses ennemis l’appelaient «le baron sanguinaire»; ses disciples, le «petit père sévère» (c’est le tsar que l’on appelait «petit père»). Quant aux Mongols et aux Tibétains, ils le considéraient comme une manifestation de la force invincible du dieu de la guerre, de la même force surnaturelle que celle de laquelle, selon la légende, serait «né» Gengis Khan, le grand conquérant mongol. Ils ne croient pas à la mort de von Ungern – il semble que, dans divers temples, ils en conservent encore l’image, symbole de sa «présence».
Lorsqu’éclata la révolution bolchevique, von Ungern, fonctionnaire russe, leva en Orient une petite armée, la «Division asiatique de cavalerie», qui fut la dernière à tenir tête aux troupes russes après la défaite de Wrangel et de Kolchak et accomplit des exploits presque légendaires. Avec ces troupes, von Ungern libéra la Mongolie, occupée alors par des troupes chinoises soutenues par Moscou; après qu’il eut fait évader, par un coup de main extrêmement audacieux, le dalaï-lama, celui-ci le fit premier prince et régent de la Mongolie et lui donna le titre de prêtre. Von Ungern devait entrer en relation, non seulement avec le dalaï-lama, mais aussi avec des représentants asiatiques de l’islam et des personnalités de la Chine traditionnelle et du Japon. Il semble qu’il ait caressé l’idée de créer en grand empire asiatique fondé sur une idée transcendante et traditionnelle, pour lutter, non seulement contre le bolchevisme, mais aussi contre toute la civilisation matérialiste moderne, dont le bolchevisme, pour lui, était la conséquence extrême. Et tout laisse à penser que von Ungern, à cet égard, ne suivit pas une simple initiative individuelle, mais agit dans le sens voulu par quelqu’un qui était, pour ainsi dire, dans les coulisses.
Le mépris de von Ungern pour la mort dépassait toutes les limites et avait pour contrepartie une invulnérabilité légendaire. Chef, guerrier et stratège, le «baron sanguinaire» était doté en même temps d’une intelligence supérieure et d’une vaste culture et, de surcroît, d’une sorte de clairvoyance: par exemple, il avait la faculté de juger infailliblement tous ceux qu’il fixait du regard et de reconnaître en eux, au premier coup d’œil, l’espion, le traître ou l’homme le plus qualifié pour un poste donné ou une fonction donnée. Pour ce qui est de son caractère, voici ce qu’écrit son compagnon d’armes, Alexandrovitch: «Il était brutal et impitoyable comme seul un ascète peut l’être. Son insensibilité dépassait tout ce que l’on peut imaginer et semblait ne pouvoir se rencontrer que chez un être incorporel, à l’âme froide comme la glace, ne connaissant ni la douleur, ni la pitié, ni la joie, ni la tristesse». Il nous paraît ridicule d’essayer, comme l’a fait Krauthoff, d’attribuer ces qualités au contrecoup occasionné par la mort tragique d’une femme qu’aurait aimée von Ungern. C’est toujours la même histoire: les biographes et les romanciers modernes n’ont point de cesse qu’ils n’aient introduit partout le thème obligatoire de l’amour et de la femme, même là où il est le moins justifié. Même si l’on tient compte du fait que von Ungern était bouddhiste par tradition familiale (c’était la religion à laquelle s’était converti un de ces ancêtres, qui était allé faire la guerre en Orient), tout laisse à penser que les qualités indiquées par Alexandrovitch se rapportent au contraire à une supériorité réelle et qu’elles sont celles qui apparaissent dans tous ceux qui sont en contact avec un plan vraiment transcendant, supra-humain, auquel ne peuvent plus s’appliquer les normes ordinaires, les notions communes du bien et du mal et les limitations de la sentimentalité, mais où règne la loi de l’action absolue et inexorable. Le baron von Ungern aurait probablement pu devenir un «homme du destin», si les circonstances lui avaient été favorables. Il n’en fut rien et c’est ainsi que son existence fut semblable à la lueur fugace et tragique d’un météore.
Après avoir libéré la Mongolie, von Ungern marche sur la Sibérie, prenant tout seul l’initiative de l’attaque contre les troupes du «Napoléon rouge», le général bolchevique Blücher. Il devient la terreur des bolcheviques, qu’il combat impitoyablement, jusqu’au bout, même s’il comprend que son combat est sans espoir. Il obtient d’importants succès, occupe plusieurs villes. Finalement, à Verchnevdiusk, attaqué par des forces bolcheviques plus de dix fois supérieures aux siennes et décidées à en finir avec leur dernier antagoniste, il est contraint de se replier après un long et âpre combat.
À partir de ce moment, on ne sait plus rien de précis sur le sort de von Ungern. D’après les deux auteurs de sa biographie «romancée», Pozner et Krauthoff, il aurait été trahi par une partie de son armée, serait tombé dans un état de prostration et de démoralisation et, fait prisonnier, il aurait été fusillé par les rouges. Krauthoff imagine même une entrevue dramatique entre le «Napoléon rouge» et von Ungern, au cours de laquelle celui-ci aurait refusé la proposition que celui-là lui aurait fait de lui laisser la vie sauve s’il servait la cause des rouges comme général soviétique. Il semble toutefois que tout cela ne soit que pure invention: d’après les informations publiées par Guénon et auxquelles nous avons fait allusion plus haut, von Ungern n’aurait nullement été fait prisonnier, mais serait mort de mort naturelle près de la frontière tibétaine. *
Cependant, les diverses versions concordent singulièrement sur un détail, c’est-à-dire sur le fait que von Ungern aurait connu avec exactitude le jour de sa mort. D’ailleurs, un lama lui avait prédit qu’il aurait été blessé – au cours de l’attaque des troupes rouges à la station de Dauria. Et ce ne sont pas là les seuls éléments qui rendent suggestive l’étrange figure du «baron sanguinaire». Voici un curieux témoignage sur les effets que, à certains moments, son regard produisait sur ceux qu’il fixait: «Il éprouva une sensation inconnue, inexplicable, de terreur: une sorte de son emplit sa poitrine, semblable à celui d’un cercle d’acier qui se resserre de plus en plus». Le fait est que, pour ceux qui étaient proches de lui, son prestige et le caractère irrésistible de sa force de commandement revêtaient quelque chose de surnaturel et le distinguaient ainsi d’un simple chef militaire.
Encore un fait singulier: d’après ce que rapporte Guénon, des phénomènes énigmatiques, de nature «psychique», se sont produits ces derniers temps dans le château de von Ungern, comme si la force et la haine de celui qui fut considéré au Tibet comme une manifestation du «dieu de la guerre» brandie contre la subversion rouge avait survécu à sa mort, sous forme de résidus agités de cette figure tragique, qui a, sous plus d’un aspect, les traits d’un symbole.
* * *
* Les archives soviétiques indiquent que von Ungern fut effectivement trahi, capturé, jugé et fusillé sur les ordres de Lénine.
De La Stampa, 15.III.1943 – XXI E.F.
source: Evola As He Is
00:05 Publié dans Histoire, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, ungern von sternberg, histoire, révolution russe, révolution bolchevique, armées blanches, russie, sibérie, eurasie, eurasisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook