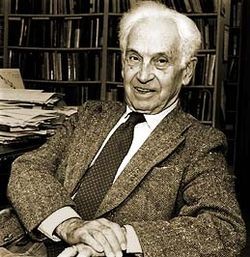Le Monde diplomatique, Août 2008 : "Jusqu’à présent, la qualité des médias audiovisuels, public et privé confondus, n’était pas vraiment un sujet. Puis le président de la République découvre que la télévision est mauvaise. Il exige de la culture. En attendant que la culture advienne, l’animateur Patrick Sabatier fait son retour sur le service public. En revanche, des émissions littéraires disparaissent. C’est la culture qui va être contente.
Avec l’alibi de quelques programmes culturels ou de quelques fictions « créatrices », les défenseurs du service public le trouvaient bon. Ils ne sont pas difficiles. Comme si, à l’instar d’une vulgaire télévision commerciale, on n’y avait pas le regard rivé à l’Audimat. Comme si la démagogie y était moins abondante qu’ailleurs.
Les médias ont su donner des dimensions monstrueuses à l’universel désir de stupidité qui sommeille même au fond de l’intellectuel le plus élitiste. Ce phénomène est capable de détruire une société, de rendre dérisoire tout effort politique. A quoi bon s’échiner à réformer l’école et l’Université ? Le travail éducatif est saccagé par la bêtise médiatique, la bouffonnerie érigée en moyen d’expression, le déferlement des valeurs de l’argent, de l’apparence et de l’individualisme étroit diffusées par la publicité, ultime raison d’être des grands groupes médiatiques. Bouygues envoie Jules Ferry aux oubliettes de l’histoire.
Lorsqu’on les attaque sur l’ineptie de leurs programmes, les marchands de vulgarité répliquent en général deux choses : primo, on ne donne au public que ce qu’il demande ; secundo, ceux qui les cri-tiquent sont des élitistes incapables d’admettre le simple besoin de divertissement. Il n’est pas nécessairement élitiste de réclamer juste un peu moins d’ineptie. Il y a de vrais spectacles populaires de bonne qualité. Le public demande ce qu’on le conditionne à demander. On a presque abandonné l’idée d’un accès progressif à la culture par le spectacle populaire. Victor Hugo, Charlie Chaplin, Molière, René Clair, Jacques Prévert, Jean Vilar, Gérard Philipe étaient de grands artistes, et ils étaient populaires. Ils parvenaient à faire réfléchir et à divertir. L’industrie médiatique ne se fatigue pas : elle va au plus bas.
Chacun a le droit de se détendre devant un spectacle facile. Mais, au point où en sont arrivées les émissions dites de « divertissement », il ne s’agit plus d’une simple distraction. Ces images, ces mots plient l’esprit à certaines formes de représentation, les légitiment, habituent à croire qu’il est normal de parler, penser, agir de cette manière. Laideur, agressivité, voyeurisme, narcissisme, vulgarité, inculture, stupidité invitent le spectateur à se complaire dans une image infantilisée et dégradée de lui-même, sans ambition de sortir de soi, de sa personne, de son milieu, de son groupe, de ses « choix ». Les producteurs de télé-réalité — « Loft story », « Koh-Lanta », « L’île de la tentation » —, les dirigeants des chaînes privées ne sont pas toujours ou pas seulement des imbéciles. Ce sont aussi des malfaiteurs. On admet qu’une nourriture ou qu’un air viciés puissent être néfastes au corps. Il y a des représentations qui polluent l’esprit.
Si les médias des régimes totalitaires parviennent, dans une certaine mesure, à enchaîner les pensées, ceux du capitalisme triomphant les battent à plate couture. Et tout cela, bien entendu, grâce à la liberté. C’est pour offrir des cerveaux humains à Coca-Cola que nous aurions conquis la liberté d’expression, que la gauche a « libéré » les médias. Nous, qui nous trouvons si intelligents, fruits de millénaires de « progrès », jugeons la plèbe romaine bien barbare de s’être complu aux jeux du cirque. Mais le contenu de nos distractions télévisées sera sans doute un objet de dégoût et de dérision pour les générations futures.
On a le choix ? Bien peu, et pour combien de temps ? La concentration capitaliste réunit entre les mêmes mains les maisons d’édition, les journaux, les télévisions, les réseaux téléphoniques et la vente d’armement. L’actuel président de la République est lié à plusieurs grands patrons de groupes audiovisuels privés, la ministre de la culture envisage de remettre en cause les lois qui limitent la concentration médiatique, la machine à abrutir reçoit la bénédiction de l’Etat (1). Les aimables déclarations récentes sur l’intérêt des études classiques pèsent bien peu à côté de cela.
Quelle liberté ? La bêtise médiatique s’universalise. L’esprit tabloïd contamine jusqu’aux quotidiens les plus sérieux. Les médias publics courent après la démagogie des médias privés. Le vide des informations complète la stupidité des divertissements. Car il paraît qu’en plus d’être divertis nous sommes informés. Informés sur quoi ? Comment vit-on en Ethiopie ? Sous quel régime ? Où en sont les Indiens du Chiapas ? Quels sont les problèmes d’un petit éleveur de montagne ? Qui nous informe et qui maîtrise l’information ? On s’en fout. Nous sommes informés sur ce qu’il y a eu à la télévision hier, sur les amours du président, la garde-robe ou le dernier disque de la présidente, les accidents de voiture de Britney Spears. La plupart des citoyens ne connaissent ni la loi, ni le fonctionnement de la justice, des institutions, de leurs universités, ni la Constitution de leur Etat, ni la géographie du monde qui les entoure, ni le passé de leur pays, en dehors de quelques images d’Epinal.
Un des plus grands chefs d’orchestre du monde dirige le Don Giovanni de Mozart. Le journaliste consacre l’interview à lui demander s’il n’a pas oublié son parapluie, en cas d’averse. Chanteurs, acteurs, sportifs bredouillent à longueur d’antenne, dans un vocabulaire approximatif, des idées reçues. Des guerres rayent de la carte des populations entières dans des pays peu connus. Mais les Français apprennent, grâce à la télévision, qu’un scout a eu une crise d’asthme.
Le plus important, ce sont les gens qui tapent dans des balles ou qui tournent sur des circuits. Après la Coupe de France de football, Roland-Garros, et puis le Tour de France, et puis le Championnat d’Europe de football, et puis... Il y a toujours une coupe de quelque chose. « On la veut tous », titrent les journaux, n’imaginant pas qu’on puisse penser autrement. L’annonce de la non-sélection de Truc ou de Machin, enjeu national, passe en boucle sur France Info. Ça, c’est de l’information. La France retient son souffle. On diffuse à longueur d’année des interviews de joueurs. On leur demande s’ils pensent gagner. Ils répondent invariablement qu’ils vont faire tout leur possible ; ils ajoutent : « C’est à nous maintenant de concrétiser. » Ça, c’est de l’information.
On va interroger les enfants des écoles pour savoir s’ils trouvent que Bidule a bien tapé dans la balle, si c’est « cool ». Afin d’animer le débat politique, les journalistes se demandent si Untel envisage d’être candidat, pense à l’envisager, ne renonce pas à y songer, a peut-être laissé entendre qu’il y pensait. On interpelle les citoyens dans les embouteillages pour deviner s’ils trouvent ça long. Pendant les canicules pour savoir s’ils trouvent ça chaud. Pendant les vacances pour savoir s’ils sont contents d’être en vacances. Ça, c’est de l’information. A la veille du bac, on questionne une pharmacienne pour savoir quelle poudre de perlimpinpin vendre aux étudiants afin qu’ils pensent plus fort. Des journalistes du service public passent une demi-heure à interroger un « blogueur », qui serait le premier à avoir annoncé que Duchose avait dit qu’il pensait sérieusement à se présenter à la présidence de quelque machin. Il s’agit de savoir comment il l’a appris avant les autres. Ça, c’est de l’information. Dès qu’il y a une manifestation, une grève, un mouvement social, quels que soient ses motifs, les problèmes réels, pêcheurs, enseignants, routiers, c’est une « grogne ». Pas une protestation, une colère, un mécontentement, non, une grogne. La France grogne. Ça, c’est de l’information.
On demande au premier venu ce qu’il pense de n’importe quoi, et cette pensée est considérée comme digne du plus grand intérêt. Après quoi, on informe les citoyens de ce qu’ils ont pensé. Ainsi, les Français se regardent. Les journalistes, convaincus d’avoir affaire à des imbéciles, leur donnent du vide. Le public avale ? Les journalistes y voient la preuve que c’est ce qu’il demande.
Cela, c’est 95 % de l’information, même sur les chaînes publiques. Les 5 % restants permettent aux employés d’une industrie médiatique qui vend des voitures et des téléphones de croire qu’ils exercent encore le métier de journalistes. Ce qui est martelé à la télévision, à la radio envahit les serveurs Internet, les journaux, les objets, les vêtements, tout ce qui nous entoure. Le cinéma devient une annexe de la pub. La littérature capitule à son tour.Le triomphe de l’autofiction n’est qu’un phénomène auxiliaire de la « peopolisation » généralisée, c’est-à-dire de l’anéantissement de la réflexion critique par l’absolutisme du : « C’est moi, c’est mon choix, donc c’est intéressant, c’est respectable. »
La bêtise médiatique n’est pas un épiphénomène. Elle conduit une guerre d’anéantissement contre la culture. Il y a beaucoup de combats à mener. Mais, si l’industrie médiatique gagne sa guerre contre l’esprit, tous seront perdus."
A lire
>>> Pierre Jourde, La littérature sans estomac, Ed. L'Esprit des péninsules, 2002.
>>> Jourde - Naulleau, Précis de littérature du XXIe siècle, Mots et Cie, 2008.
dimanche, 28 décembre 2008
"La machine à abrutir" de Pierre Jourde
La machine à abrutir par Pierre Jourde
00:10 Publié dans Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, sociologie, manipulations médiatiques, médias, philosophie, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
"Merde pour la république!": les soulèvements paysans de Wallonie (1795-1800)
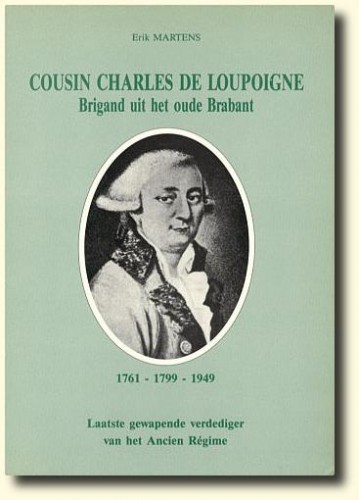
« Merde pour la République ! » : les soulèvements paysans de Wallonie (1795-1800)
I.
Nous sommes à Jodoigne, en Brabant wallon, fin novembre 2008. A l’Hôtel des Libertés s’ouvre une exposition qui s’intitule « La révolte des Chouans en Hesbaye Brabançonne ». Cette ouverture est assortie d’une conférence sur le sujet et d’une marche commémorative dans les villages avoisinants, avec figurants costumés selon les modes des années 1795 à 1800.
Toutes ces activités, qui ramenaient la petite ville du Brabant wallon dans l’atmosphère de la fin du 18ème siècle, avaient un seul objectif : maintenir vivant le souvenir de la « Guerre des Paysans », celle qui éclata dans le Brabant wallon. L’insurrection débuta dans les villages d’Opprebais, de Roux-Miroir et d’Incourt ; les insurgés anti-français réussirent par deux fois à prendre la ville de Jodoigne. En fin de compte, les « brigands », comme les appelaient les Français, eurent le dessous et furent impitoyablement massacrés à Beauvechain, Piétrain et Hasselt. La cause de ce soulèvement populaire dans cette partie de la Hesbaye, qui fait actuellement partie du Brabant wallon, fut la même que dans les deux Flandres, le Limbourg et l’actuel Brabant flamand ; une résistance contre la politique anticléricale des Français et un soulèvement contre la conscription par tirage au sort.
La commémoration en Wallonie de ces événements, qui datent de 210 ans, révèle deux choses. D’abord, qu’il y a eu en Wallonie un soulèvement paysan en bonne et due forme. Ensuite, que le souvenir de cette révolte n’a pas entièrement disparu. Dans la première partie de notre exposé, nous allons nous pencher essentiellement sur la dite « révolte des brigands » en Wallonie. Dans la seconde partie, nous consacrerons plutôt notre attention sur la place que prend ce soulèvement dans la mémoire collective des Wallons.
Immédiatement après la fameuse bataille de Jemappes en 1792 et l’occupation française des Pays-Bas autrichiens qui s’ensuivit, des révoltes anti-françaises eurent lieu en Wallonie. Des milices bourgeoises et des paysans armés dans les régions frontalières de Chimay, Bertrix et Florenville livrèrent bataille contre les troupes françaises avant le soulèvement général des paysans en 1796. Pour reprendre le contrôle de la région de Chimay, les Français durent envoyer une armée entière dans la « botte » du Hainaut.
La figure centrale du soulèvement paysan wallon est indubitablement Charles-François Jacqmin ou Charles de Loupoigne (1761-1799), connu aussi sous le sobriquet de « Charelpoeng » en Flandre. Ce Brabançon wallon était originaire de Braine-l’Alleud, avait servi de sergent recruteur pour l’Armée Impériale & Royale autrichienne et avait commandé des milices populaires pro-autrichiennes après la seconde défaite des armées impériales et royales à Fleurus en 1794. Bien avant la « Guerre des Paysans » proprement dite, qui éclata en 1798, Charles Jacqmin de Loupoigne avait organisé une guérilla contre l’oppresseur français. Qui se déroulait souvent de manière ludique. On désarmait les soldats français, on pillait les caisses communales, on abattait les « arbres de la liberté », on libérait les conscrits et on intimidait les collaborateurs. Cette guérilla ne fit pratiquement pas couler de sang.
Charles de Loupoigne s’activait essentiellement dans la région de Genappe et Wavre. Il ne réussit pas à prendre Louvain et Jodoigne. Les Français le condamnèrent à mort par contumace, mais ne purent jamais le capturer. Les nombreuses forêts, chemins creux et cachettes du Brabant wallon étaient idéaux pour mener une guerre de guérilla. En 1799, les Français n’avaient pas encore réussi à capturer Charles de Loupoigne. En juin de cette année, leur chasse à l’homme finit par aboutir, plutôt par hasard : dans un combat livré aux gendarmes français, « Charelpoeng » tomba les armes à la main à Loonbeek près de Huldenberg en Brabant flamand. Ce fut la fin de sa légende.
Mais Charles de Loupoigne ne fut pas le seul « brigand » wallon. Dans la région de Virton, en Gaume, la population rurale résistait, elle aussi, aux Français. On connaît mieux la « Klöppelkrieg » du Luxembourg germanophone, un soulèvement de septembre 1798 qui s’est étendu également à la Wallonie, dans les régions de Vielsalm et de Stavelot. A Neufchâteau, dans les Ardennes luxembourgeoises, les annales signalent en novembre 1798 un soulèvement anti-français. Les insurgés démolissent de fond en comble la « mairie » en hurlant « Merde pour la République ! ».
Dans la région située entre Sambre et Meuse, on abattit les « arbres de la liberté » dans de nombreux villages. Cette région a donc connu une résistance mais sans soulèvement armé.
Dans la région de Jodoigne, le soulèvement fut bel et bien armé et ce sont ces événements-là que l’on vient de commémorer. Le chef de cette « Guerre des Paysans » en Brabant wallon n’était pas Charles Jacqmin de Loupoigne mais un certain Antoine Constant (1749-1799). Celui-ci parvient en novembre 1798 à prendre Jodoigne et à en chasser les Français. Dans les semaines qui suivirent, Antoine Constant mena ses actions dans le département de l’Ourthe (l’actuelle province de Liège) et marcha à la tête de ses compagnies sur Hasselt pour aller rejoindre les insurgés flamands. A Hasselt, l’armée rurale des Pays-Bas autrichiens fut définitivement écrasée.
Antoine Constant y fut fait prisonnier. Les Français le jugèrent et il fut exécuté le 9 février 1799. Le paysannat insurgé était exsangue. La révolte étouffée dans le sang.
II.
Dans la première partie de notre brève étude sur les soulèvements paysans contre le républicanisme français, nous avons parlé de quelques événements de cette lutte populaire d’il y a 210 ans, qui a connu des épisodes marquants en Wallonie, contrairement à ce que l’on croit habituellement, en prétendant que cette révolte n’a été qu’une affaire flamande ou luxembourgeoise. Cette ignorance vient du fait que les francophones belges ne se souviennent plus guère aujourd’hui de ce soulèvement paysan. Des commémorations comme celle qui a eu lieu à Jodoigne le mois dernier sont exceptionnelles. Comment cela se fait-il que cette période de l’histoire soit perçue différemment chez les Francophones et chez les Flamands ?
Est-ce un impact de la langue et de la culture françaises, qui fait que les liens avec l’occupant français étaient plus forts ? Les Wallons ont-ils été des « fans » de la révolution française ? Les historiens doutent que les idées révolutionnaires aient été populaires en Wallonie. L’historien Erik Martens, qui a principalement axé ses recherches sur cette période, explique la moindre virulence du soulèvement paysan en Wallonie par la situation géographique des provinces romanes des Pays-Bas autrichiens. Elles étaient plus éloignées de l’Angleterre, d’où aurait pu venir une aide, et plus proches de la frontière française où étaient casernées de solides garnisons comme à Maubeuge, Avesnes, Mariembourg, Givet et Sedan. Il est exact aussi qu’une partie du soulèvement wallon a été directement inspirée par la Flandre, le long de la frontière linguistique. Sur l’axe Tournai-Enghien, ce furent surtout des milices flamandes venues de Renaix (Ronse) et du Pajottenland qui provoquèrent les escarmouches avec les troupes françaises. Malgré cela, il faut dire que les principaux soulèvements du Brabant wallon ont une origine purement locale, tout comme celui qui a animé les forêts des Ardennes luxembourgeoises et comme la guérilla anti-française qui a fait rage autour de Chimay.
Alors pourquoi la « Guerre des Paysans » n’est-elle pas inscrite dans la mémoire collective des Wallons d’aujourd’hui ? Nous pourrions poser la question autrement. Pourquoi cette guerre paysanne est-elle, ou a-t-elle été, pendant si longtemps commémorée en Flandre ? La réponse est simple : elle y a toujours été considérée comme une révolte contre une de ces occupations étrangères, française de surcroît, que l’histoire des pays flamands a si souvent connues ; l’historiographie flamande n’a jamais cessé de braquer ses projecteurs contre ce genre de soulèvements. Cette disposition d’esprit explique aussi l’immense succès qu’a connu la commémoration du centenaire de la « Guerre des Paysans » en 1898. La « Guerre des Paysans » étant un soulèvement populaire contre la France, elle trouvait parfaitement sa place dans l’univers mental du mouvement flamand.
En Belgique francophone, rien de tout cela. Car, surtout après 1918, la Belgique francophone a pris, comme jamais auparavant, une attitude pro-française. La France était subitement devenue l’alliée et les épisodes désagréables de l’histoire wallonne, où les Français s’étaient méconduits dans les provinces romanes des Pays-Bas espagnols puis autrichiens, furent recouverts d’un silence de plomb. Après 1918, les castes dominantes francophones ont fait l’impasse sur l’histoire propre de la Wallonie, pour aller fabriquer une « nouvelle histoire ». Ce fut principalement le cas dans les cénacles maçonniques et wallingants (en fait rattachistes), où l’on se mit à exalter, de la manière la plus irrationnelle et la plus dévote, les acquis, faits et gestes de la période d’occupation française (1792-1814). Dans cette littérature pieuse, on raconte, sans rire, que cette occupation violente fut une « libération » de l’Ancien Régime et, surtout, qu’elle nous a ouvert, à nous pauvres sauvages mal dégrossis de Flandre, de Wallonie et de Rhénanie, les portes de la culture française, posée comme « universelle » et « supérieure ». Dans les cercles wallingants, on va jusqu’à considérer que la bataille de Waterloo a été une défaite !
En Wallonie, on ne trouve donc aucun monument commémoratif nous rappelant l’héroïsme du peuple en armes contre la barbarie moderne des sans-culottes. Tout au plus reste-t-il l’un ou l’autre indice dans les folklores locaux, exploitable par le tourisme. Dans tout le Brabant wallon, on ne trouve que deux rues qui portent le nom de Charles Jacqmin de Loupoigne. Il existe toutefois un circuit touristique pour randonneurs pédestres et cyclistes qui porte le nom de ce courageux capitaine. Il n’existe qu’un seul monument à l’honneur de « Charelpoeng » ; il se trouvait à Loonbeek en Brabant flamand, au lieu où il tomba les armes à la main en 1799. Ce monument avait été commandité par Paul Verhaegen, belgiciste et francophone de Flandre, qui fut pendant un certain laps de temps Président de la Cour de Cassation. Paul Verhaegen avait fait ériger ce monument car il estimait que Charles de Loupoigne avait été « un grand Belge ».
L’ironie de l’histoire veut que dans les années 30 du vingtième siècle, et jusqu’en 1944, les Flamands venaient fêter sous ce monument le souvenir de la défaite de la Chevalerie française devant Courtrai en 1302, lors de la fameuse « Bataille des Eperons d’Or ». Charles de Loupoigne est devenu ainsi un « héros flamand », alors qu’il était un pur Wallon. Dans les années 40, les cercles inféodés à la collaboration y ont également tenu des manifestations, si bien qu’en septembre 1944, le monument fut partiellement détruit par les résistancialistes. Après la guerre, il n’a plus été question de replacer le monument en son lieu d’origine et de le restaurer car, disaient les esprits bornés, il rappelait l’occupant allemand ! En 1949, des fidèles l’ont transporté dans une chapelle à Sint-Joris-Weert où il a finalement été placé contre le mur extérieur du petit édifice religieux. Il s’y trouve toujours.
Parce que le lien a été fait entre la « Guerre des Paysans » et le mouvement flamand, la Belgique francophone a fini par considérer que ce soulèvement populaire de la fin du 18ème siècle avait été « antipatriotique ». Cependant le débat autour de la « Guerre des Paysans » demeure sensible côté francophone parce que certains historiens soulignent qu’il y a un rapport entre la « Guerre des Paysans » et le soulèvement des « chouans » et des Vendéens dans l’Ouest de la France. En 1793, la population de cette région royaliste a été décimée et parfois exterminée par les sans-culottes. Dans bon nombre de cercles de la droite conservatrice française, on demande que ce crime politique soit reconnu comme un génocide. La France républicaine ne veut rien entendre, bien sûr, parce qu’elle estime que ce serait faire une concession à « l’extrême droite » et que cela ruinerait le mythe de la « révolution française ». C’est pourquoi la Belgique francophone, toujours servilement à la remorque des modes, des folies et des veuleries parisiennes, se montre très réticente et hésite à parler de manière positive de la « Guerre des Paysans ».
Ceux qui osent émettre un jugement positif sur cet épisode héroïque de l’histoire des Pays-Bas du Sud, risque immédiatement l’excommunication hors de l’église des gauches.
« Picard » / « ‘t Pallieterke ».
(article paru en deux parties dans « ‘t Pallieterke », numéros 51 & 52/2008 (jg. 63) ; traduction française : Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : flandre, wallonie, belgicana, belgique, révolution française, république, révolte paysanne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 27 décembre 2008
Afrikanisering van Europa
| Afrikanisering van Europa
“Hoe verdwijnt een beschaving, hoe verdwijnt de democratie? Democratie kun je niet invoeren, democratie moet te verwerven”. Eén van de vele treffende opmerkingen van mevrouw Marcia Luyten in haar boek Ziende blind in de sauna, waarin ze met veel verve waarschuwt voor een Afrikanisering van Nederland – en bij uitbreiding van Vlaanderen en Europa. Nederland gaat steeds meer op Afrika lijken, schrijft ze. Marcia Luyten (geboren in 1971) is journaliste, cultuurhistorica en econome, ze schrijft voor verschillende kranten en woonde van 2001 tot 2003 in Rwanda, en sinds 2007 in Oeganda. Ze kent de Afrikaanse cultuur vrij goed en beseft dus maar al te goed de draagwijdte van haar woorden. En hoewel ze zich blijft opstellen als een ‘progressief’ auteur, merkt men op elke bladzijde de sterke (soms onmerkbare trouwens) invloed van overtuigd conservatieve denkers als Dalrymple, die in zijn kritiek op het links-libertaire al wees op hun verpletterende verantwoordelijkheid in het ontkennen van elke publieke moraal. Mevrouw Luyten haalt Joep Dohmen aan: “Waarden als identiteit, individualiteit en vrijheid veronderstellen dat het individu door de samenleving een zekere morele vorming heeft ondergaan”.
Zo roept ze op “de vrijheid en de eigenzinnigheid te veroveren op de fanatiekelingen die zich in de jaren 60 van vorige eeuw hebben toegeëigend maar die daaraan behalve de emancipatie vooral één dimensie hebben: die van de permissiviteit”. Ze lijkt de politieke en metapolitieke rechterzijde na te zeggen dat “alles kan, alles mag” een deel van het probleem van Europa, van Vlaanderen en van Nederland is. Over economie – toch wel zéér actueel, meen ik – schrijft Luyten heel treffende zinnen neer, vooral over het korte termijn winstbejag van aandeelhouders in multinationals, over de kip met de gouden eieren. En ook hier weer de parallel met Afrika: “Het aanstekelijke, bewonderenswaardige ‘leven in het moment’ van Afrika heeft een schaduwzijde: het maakt van armoede een gesloten cirkel”. Niet alleen de economie, maar ook de politiek is ‘verafrikaniseerd’. Afrika kent vooral een politiek van aanhankelijkheden. Maar ook in Europa groeit het cliëntelisme sterk. Het gaat in de politiek – ook in België, ook in Nederland – steeds minder om politieke programma’s, om ideeën. Macht in Afrika dient vooral en bijna uitsluitend om de eigen achterban goed te verzorgen. Is dat het lot dat de politiek in Europa te wachten staat? Maar lees ook haar bladzijden over de massamediacultuur, lees haar vernietigend oordeel over allerlei schoolse experimenten! Dit boekje van Marcia Luyten is echter geen programmabrochure van een politieke partij. Mevrouw Luyten schrijft met veel schroom, té veel schroom allicht, over de uitwassen van de multiculturele maatschappij. Maar toch is ook bij haar het taboe, om er liever niets over te schrijven dan slecht, gevallen. Zo noteert ze: “Toen een delegatie van het Nederlands Centrum voor Terrorismebestrijding het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer bezocht, na de moord op Van Gogh, keken de bezoekers op van de hoeveelheid schotelantennes die er als geraniums balkons sierden”. Inderdaad, onze maatschappij is niet weinig verkleurd, mevrouw Luyten. Het zal niemand verbazen dat geregeld wordt verwezen naar stevige Nederlandse conservatieve filosofen als Kinneging. Toch wil mevrouw Luyten verder door het leven als progressief auteur, niet zonder de arrogantie van links er stevig van links te geven. “Terug naar dat karakter (als een van de bouwstenen van een gezonde samenleving). Welke karaktereigenschappen zijn daarvoor nodig? Een schets van zo’n persoonlijkheid is niet ongevaarlijk. Voor je het weet, word je in een hoek gezet waar je niet wil zijn – bijvoorbeeld die van de conservatieven – want dat is wat sommige linkse mensen graag doen met andere linkse mensen die het over cultuur en moraal hebben”. Jaja, de verdraagzaamheid van links is een mooi ding… Dit boek – maar dat had u al begrepen, beste lezer – bevat zeer veel stof tot nadenken. Veel introspectie in een maatschappij die wat ver in de ene richting is doorgeschoten. Marcia Luyten brengt noodzakelijke correcties aan. (Peter Logghe) Ziende blind in de sauna, 220 pagina’s |
00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : affaires européennes, europe, immigration, afrique, sociologie, pays-bas, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
"Faune mordu" par Jef Lambeaux

00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sculpture, art, belgique, belgicana, art plastique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Vilfreedo Pareto and Political Irrationality

Vilfredo Pareto and Political Irrationality
Tomislav Sunic
Few political thinkers have stirred so much controversy as Franco-Italian sociologist and economist Vilfredo Pareto (1848-1923). In the beginning of the twentieth century, Pareto exerted a considerable influence on European conservative thinkers, although his popularity rapidly declined after the Second World War. The Italian Fascists who used and abused Pareto's intellectual legacy were probably the main cause of his subsequent fall into oblivion.
Pareto's political sociology is in any case irreconcilable with the modern egalitarian outlook. In fact, Pareto was one to its most severe critics. Yet his focus extends beyond a mere attack on modernity; his work is a meticulous scrutiny of the energy and driving forces that underlie political ideas and beliefs. From his study, he concludes that irrespective of their apparent utility or validity, ideas and beliefs often dissimulate morbid behavior. Some of Pareto's students went to so far as to draw a parallel between him and Freud, noting that while Freud attempted to uncover pathological behavior among seemingly normal individuals, Pareto tried to unmask irrational social conduct that lay camouflaged in respectable ideologies and political beliefs.
In general, Pareto argues that governments try to preserve their institutional framework and internal harmony by a posteriori justification of the behavior of their ruling elite--a procedure that stands in sharp contrast to the original objectives of government. This means that governments must "sanitize" violent and sometimes criminal behavior by adopting such self-rationalizing labels as "democracy," "democratic necessity," and "struggle for peace," to name but a few. It would be wrong, however, to assume that improper behavior is exclusively the result of governmental conspiracy or of corrupted politicians bent on fooling the people. Politicians and even ordinary people tend to perceive a social phenomenon as if it were reflected in a convex mirror. They assess its value only after having first deformed its objective reality. Thus, some social phenomena, such as riots, coups, or terrorist acts, are viewed through the prism of personal convictions, and result in opinions based on the relative strength or weakness of these convictions. Pareto argues that it is a serious error to assume that because his subjects or constituents feel cheated or oppressed, a leader of an oppressive regime is necessarily a liar or a crook. More than likely, such a leader is a victim of self-delusions, the attributes of which he considers "scientifically" and accurately based, and which he benevolently wishes to share with his subjects. To illustrate the power of self-delusion, Pareto points to the example of socialist intellectuals. He observes that "many people are not socialists because they have been persuaded by reasoning. Quite to the contrary, these people acquiesce to such reasoning because they are (already) socialists."
Modern Ideologies and Neuroses
In his essay on Pareto, Guillaume Faye, one of the founders of the European "New Right," notes that liberals and socialists are scandalized by Pareto's comparison of modern ideologies to neuroses: to latent manifestation of unreal effects, though these ideologies--socialism and liberalism--claim to present rational and "scientific" findings. In Freud's theory, psychic complexes manifest themselves in obsessional ideas: namely, neuroses, and paranoias. In Pareto's theory, by contrast, psychic impulses--which are called residues--manifest themselves in ideological derivatives. Rhetoric about historical necessity, self-evident truths, or economic and historical determinism are the mere derivatives that express residual psychic drives and forces such as the persistence of groups once formed and the instinct for combination.
For Pareto, no belief system or ideology is fully immune to the power of residues, although in due time each belief system or ideology must undergo the process of demythologization. The ultimate result is the decline of a belief or an ideology as well as the decline of the elite that has put it into practice.
Like many European conservatives before the war, Pareto repudiated the modern liberal, socialist myth that history showed an inevitable progression leading to social peace and prosperity. Along with his German contemporary Oswald Spengler, Pareto believed that no matter how sophisticated the appearance of some belief or ideology, it would almost certainly decay, given time. Not surprisingly, Pareto's attempts to denounce the illusion of progress and to disclose the nature of socialism and liberalism prompted many contemporary theorists to distance themselves from his thought.
Pareto argues that political ideologies seldom attract because of their empirical or scientific character--although, of course, every ideology claims those qualities--but because of their enormous sentimental power over the populace. For example, an obscure religion from Galilee mobilized masses of people who were willing to die, willing to be tortured. In the Age of Reason, the prevailing "religion" was rationalism and the belief in boundless human progress. Then came Marx with scientific socialism, followed by modern liberals and their "self-evident religion of human rights and equality." According to Pareto, underlying residues are likely to materialize in different ideological forms or derivatives, depending on each historical epoch. Since people need to transcend reality and make frequent excursions into the spheres of the unreal and the imaginary, it is natural that they embrace religious and ideological justifications, however intellectually indefensible these devices may appear to a later generation. In analyzing this phenomenon, Pareto takes the example of Marxist "true believers" and notes: "This is a current mental framework of some educated and intelligent Marxists with regard to the theory of value. From the logical point of view they are wrong; from the practical point of view and utility to their cause, they are probably right." Unfortunately, continues Pareto, these true believers who clamor for social change know only what to destroy and how to destroy it; they are full of illusions as to what they have to replace it with: "And if they could imagine it, a large number among them would be struck with horror and amazement."
Ideology and History
The residues of each ideology are so powerful that they can completely obscure reason and the sense of reality; in addition, they are not likely to disappear even when they assume a different "cover" in a seemingly more respectable myth or ideology. For Pareto this is a disturbing historical process to which there is no end in sight:
"Essentially, social physiology and social pathology are still in their infancy. If we wish to compare them to human physiology and pathology, it is not to Hippocrates that we have to reach but far beyond him. Governments behave like ignorant physicians who randomly pick drugs in a pharmacy and administer them to patients."
So what remains out of this much vaunted modern belief in progress, asks Pareto? Almost nothing, given that history continues to be a perpetual and cosmic eternal return, with victims and victors, heroes and henchmen alternating their roles, bewailing and bemoaning their fate when they are in positions of weakness, abusing the weaker when they are in positions of strength. For Pareto, the only language people understand is that of force. And with his usual sarcasm, he adds: "There are some people who imagine that they can disarm their enemy by complacent flattery. They are wrong. The world has always belonged to the stronger and will belong to them for many years to come. Men only respect those who make themselves respected. Whoever becomes a lamb will find a wolf to eat him."
Nations, empires, and states never die from foreign conquest, says Pareto, but from suicide. When a nation, class, party, or state becomes averse to bitter struggle--which seems to be the case with modern liberal societies--then a more powerful counterpart surfaces and attracts the following of the people, irrespective of the utility or validity of the new political ideology or theology:
"A sign which almost always accompanies the decadence of an aristocracy is the invasion of humanitarian sentiments and delicate "sob-stuff" which renders it incapable of defending its position. We must not confuse violence and force. Violence usually accompanies weakness. We can observe individuals and classes, who, having lost the force to maintain themselves in power, become more and more odious by resorting to indiscriminate violence. A strong man strikes only when it is absolutely necessary--and then nothing stops him. Trajan was strong but not violent; Caligula was violent but not strong."
Armed with the dreams of justice, equality, and freedom, what weapons do liberal democracies have today at their disposal against the downtrodden populations of the world? The sense of morbid culpability, which paralyzed a number of conservative politicians with regard to those deprived and downtrodden, remains a scant solace against tomorrow's conquerors. For, had Africans and Asians had the Gatling gun, had they been at the same technological level as Europeans, what kind of a destiny would they have reserved for their victims? Indeed, this is something that Pareto likes speculating about. True, neither the Moors nor Turks thought of conquering Europe with the Koran alone; they understood well the importance of the sword:
"Each people which is horrified by blood to the point of not knowing how to defend itself, sooner or later will become a prey of some bellicose people. There is probably not a single foot of land on earth that has not been conquered by the sword, or where people occupying this land have not maintained themselves by force. If Negroes were stronger than Europeans, it would be Negroes dividing Europe and not Europeans Africa. The alleged "right" which the people have arrogated themselves with the titles "civilized"--in order to conquer other peoples whom they got accustomed to calling "non-civilized"--is absolutely ridiculous, or rather this right is nothing but force. As long as Europeans remain stronger than Chinese, they will impose upon them their will, but if Chinese became stronger than Europeans, those roles would be reversed."
Power Politics
For Pareto, might comes first, right a distant second; therefore all those who assume that their passionate pleas for justice and brotherhood will be heeded by those who were previously enslaved are gravely mistaken. In general, new victors teach their former masters that signs of weakness result in proportionally increased punishment. The lack of resolve in the hour of decision becomes the willingness to surrender oneself to the anticipated generosity of new victors. It is desirable for society to save itself from such degenerate citizens before it is sacrificed to their cowardice. Should, however, the old elite be ousted and a new "humanitarian" elite come to power, the cherished ideals of justice and equality will again appear as distant and unattainable goals. Possibly, argues Pareto, such a new elite will be worse and more oppressive than the former one, all the more so as the new "world improvers" will not hesitate to make use of ingenious rhetoric to justify their oppression. Peace may thus become a word for war, democracy for totalitarianism, and humanity for bestiality. The distorted "wooden language" of communist elites indicates how correct Pareto was in predicting the baffling stability of contemporary communist systems.
Unfortunately, from Pareto's perspective, it is hard to deal with such hypocrisy. What underlies it, after all, is not a faulty intellectual or moral judgment, but an inflexible psychic need. Even so, Pareto strongly challenged the quasi-religious postulates of egalitarian humanism and democracy--in which he saw not only utopias but also errors and lies of vested interest. Applied to the ideology of "human rights," Pareto's analysis of political beliefs can shed more light on which ideology is a "derivative," or justification of a residual pseudo-humanitarian complex. In addition, his analysis may also provide more insight into how to define human rights and the main architects behind these definitions.
It must be noted, however, that although Pareto discerns in every political belief an irrational source, he never disputes their importance as indispensable unifying and mobilizing factors in each society. For example, when he affirms the absurdity of a doctrine, he does not suggest that the doctrine or ideology is necessarily harmful to society; in fact, it may be beneficial. By contrast, when he speaks of a doctrine's utility he does not mean that it is necessarily a truthful reflection of human behavior. On the matters of value, however, Pareto remains silent; for him, reasoned arguments about good and evil are no longer tenable.
Pareto's methodology is often portrayed as belonging to the tradition of intellectual polytheism. With Hobbes, Machiavelli, Spengler, and Carl Schmitt, Pareto denies the reality of a unique and absolute truth. He sees the world containing many truths and a plurality of values, with each being truthful within the confines of a given historical epoch and a specific people. Furthermore, Pareto's relativism concerning the meaning of political truth is also relevant in reexamining those beliefs and political sentiments claiming to be nondoctrinal. It is worth nothing that Pareto denies the modern ideologies of socialism and liberalism any form of objectivity. Instead, he considers them both as having derived from psychic needs, which they both disguise.
The New Class
For his attempts to demystify modern political beliefs, it should not come as a surprise that Pareto's theory of nonlogical actions and pathological residues continues to embarrass many modern political theorists; consequently his books are not easily accessible. Certainly with regard to communist countries, this is more demonstrably the case, for Pareto was the first to predict the rise of the "new class"--a class much more oppressive than traditional ruling elites. But noncommunist intellectuals also have difficulties coming to grips with Pareto. Thus, in a recent edition of Pareto's essays, Ronald Fletcher writes that he was told by market researchers of British publishers that Pareto is "not on the reading list," and is "not taught" in current courses on sociological theory in the universities. Similar responses from publishers are quite predictable in view of the fact that Pareto's analyses smack of cynicism and amorality--an unforgivable blasphemy for many modern scholars.
Nevertheless, despite the probity of his analysis, Pareto's work demands caution. Historian Zev Sternhell, in his remarkable book La droite revolutionnaire, observes that political ideas, like political deeds, can never be innocent, and that sophisticated political ideas often justify a sophisticated political crime. In the late 1920s, during a period of great moral and economic stress that profoundly shook the European intelligentsia, Pareto's theories provided a rationale for fascist suppression of political opponents. It is understandable, then, why Pareto was welcomed by the disillusioned conservative intelligentsia, who were disgusted, on the one hand, by Bolshevik violence, and on the other, by liberal democratic materialism. During the subsequent war, profane application of Pareto's theories contributed to the intellectual chaos and violence whose results continue to be seen.
More broadly speaking, however, one must admit that on many counts Pareto was correct. From history, he knew that not a single nation had obtained legitimacy by solely preaching peace and love, that even the American Bill of Rights and the antipodean spread of modern democracy necessitated initial repression of the many--unknowns who were either not deemed ripe for democracy, or worse, who were not deemed people at all (those who, as Koestler once wrote, "perished with a shrug of eternity"). For Pareto the future remains in Pandora's box and violence will likely continue to be man's destiny.
The Vengeance of Democratic Sciences
Pareto's books still command respect sixty-five years after his death. If the Left had possessed such an intellectual giant, he never would have slipped so easily into oblivion. Yet Pareto's range of influence includes such names as Gustave Le Bon, Robert Michels, Joseph Schumpeter, and Rayond Aron. But unfortunately, as long as Pareto's name is shrouded in silence, his contribution to political science and sociology will not be properly acknowledged. Fletcher writes that the postwar scholarly resurgence of such schools of thought as "system analysis," "behavioralism," "reformulations," and "new paradigms," did not include Pareto's because it was considered undemocratic. The result, of course, is subtle intellectual annihilation of Pareto's staggering erudition--an erudition that spans from linguistics to economics, from the knowledge of Hellenic literature to modern sexology.
But Pareto's analyses of the power of residues are useful for examining the fickleness of such intellectual coteries. And his studies of intellectual mimicry illustrate the pathology of those who for a long time espoused "scientific" socialism only to awaken to the siren sound of "self-evident" neoconservativism--those who, as some French writer recently noted, descended with impunity from the "pinnacle of Mao into the Rotary Club." Given the dubious and often amoral history of the twentieth-century intelligentsia, Pareto's study of political pathology remains, as always, apt.
Tomislave Sunic, a Croatian political theorist, has contributed a long essay to Yugoslavia: The Failure of Democratic Communism (New York, 1988).
[The World and I (New York), April, 1988]
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, sciences politiques, sociologie, économie, italie, école machiavellienne, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 26 décembre 2008
A l'Est, du nouveau...
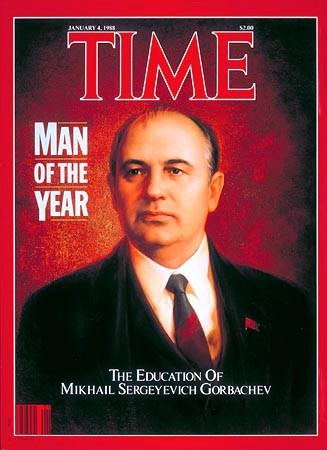
Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - LE COURRIER DES PAYS-BAS FRANçAIS (Lille) - VOULOIR (Bruxelles) - DÉCEMBRE 1989
Ce texte issu de nos archives montre, une fois de plus, quels espoirs fous soulevaient nos coeurs au moment de la disparition du Mur de Berlin ! Nos espoirs, faut-il le dire, n'ont pas été exaucés. La responsabilité de cette trahison vient de l'impéritie et de la veulerie du personnel politique européen, que nous n'avons pas eu le courage de jeter aux poubelles de l'histoire, comme les Est-Européens avaient jeté leurs apparatchiks communistes en descendant en masse dans la rue. Et aujourd'hui, y a-t-il eu foule en Belgique pour qu'on demande l'emprisonnement et la condamnation des immondes banksters? Et des flics ripoux qui pillent les librairies? Honte sur nous !
A l'Est, du nouveau
par Fabrice GOETHALS
L'ère de Yalta s'achève. Le rideau de fer, sinistre ba-lafre portée au cœur du continent européen, a craqué le 11 septembre dernier, lorsque la Hon-grie a ouvert ses frontières à l'Ouest. Deux mois plus tard, le Mur de Berlin était démantelé sous les acclamations du peuple allemand vivant des deux côtés de la frontière, tandis que le monde entier n'en croyait pas ses yeux. Ne nous payons pas de mots. Si, depuis 1945, il y a eu en Europe des événements proprement historiques, ce sont bien ceux auxquels nous venons d'assister au cours de ces dernières semaines. Evénements symbo-liques, mais aussi annonciateurs d'une époque qui ne pourra jamais plus avoir le même visage.
La première leçon que l'on peut tirer du spectacle qui se déroule à l'Est aujourd'hui, c'est qu'il constitue un démenti flagrant à bien des théories énoncées avec aplomb par les politolo-gues occidentaux. On nous dé-crivait l'Union Soviétique comme un mal absolu, quasi onto-logique et, comme tel, incapable de se ré-former lui-même. Mikha'il Gorbatchev (dont nul n'avait non plus prévu l'arrivée au pouvoir) a répondu à sa façon à cette représentation aussi specta-culaire que fantasmatique. Le fait que la peres-troïka soit une ré-volution accomplie par le haut dément, à elle seule, les analyses classiques des soviétologues libéraux. En réalité, comme l'a noté Paul Thibaud, "le totalitarisme absolu, sans faille, n'a jamais existé. S'il existait, il serait littéralement increvable" (Le Nouvel Observa-teur, 2-11-1989). S'écroulent du même coup l'image d'une bureaucratie "indéracinable", pri-son-nière d'un lobby militaro-industriel tout puissant, et d'un pouvoir installé dans l'irréversible, qui ne pourrait s'achever que dans la guerre et le sang.
Identité allemande et "Mitteleuropa"
Mais la fin du Mur de Berlin démontre encore autre chose. Elle démontre quels sont les enjeux historiques et les forces politiques les plus es-sentiels. Elle dé-montre que, sur la longue durée, ce sont les exigences des peuples, la reven-dication identitaire des commu-nautés nationales et les lois de la géopolitique qui fi-nissent tou-jours par l'emporter. Pendant des décen-nies, les hommes politiques occidentaux —allemands y compris— ont feint de croire que la vieille "question allemande" pouvait être mise per-pétuellement sous le boisseau. Comme l'a dé-claré ingénument l'ancien Premier ministre bri-tannique Edward Heath: "Bien sûr, nous disions que nous croyions à la réunification, mais c'est parce que nous savions que cela n'arriverait pas!". Il faut aujourd'hui se rendre à l'évidence: le re-foulé revient toujours au galop. L'évolution de l'opinion en RFA depuis quelques années, le regain d'intérêt pour la "Mitteleuropa" étaient des signes avant-coureurs qui ne trompaient pas. Tout récemment encore, l'exode massif des Allemands de l'Est vers la RFA, via la Hongrie et la Tchécoslovaquie, a brutale-ment rappelé aux observateurs que pour les Alle-mands, la "question nationale" n'est toujours pas ré-glée, et que les jeunes Allemands sont aujourd'hui les seuls à ne pas avoir d'identité propre en Europe.
Certes, la réunification allemande n'est pas encore faite. Elle se heurtera à bien des résis-tances! Gorbatchev, d'ailleurs, souligne lui-mê-me avec force que l'existence de deux Etats allemands fait aujourd'hui partie des "réalités existantes" en Europe. Mais qu'en sera-t-il demain?
Bien que l'attitude soviétique reste éminemment pro-blématique, compte tenu de la multitude des para-mètres à prendre en compte, il est clair, con-cernant l'Allemagne, que l'intérêt des Russes est de conserver pour l'avenir quelque chose de négociable. En clair, de "vendre" la réunification le plus cher possible. Dans l'immédiat, on aurait tort de sous-estimer la dyna-mique mise en œuvre par les derniers événements.
En RDA, la libéralisation politique a en effet nécessai-rement une résonnance différente de celle qu'elle peut avoir dans les autres pays de l'Est, dont l'existence nationale n'est pas en question. La division de l'Allemagne est directe-ment liée à l'existence d'un ré-gime communiste. Que ce régime s'affaiblisse, et la frontière née de cette division apparaîtra comme plus artificielle encore.
L'histoire revient au grand galop
Rapprocher la structure politico-institutionnelle des as-pirations populaires revient alors imman-quablement à rapprocher le temps de la réunifi-cation. Rétablir la libre circulation entre les deux parties d'une ville —et qui plus est, d'une ancienne capitale— traversée par la frontière Est-Ouest, c'est faire en sorte que cette fron-tière perde toute signification. Après cela, toute une sé-rie de cliquets vont jouer.
Une chose est sûre, et c'est elle qui donne aux événe-ments leur véritable dimension: l'Alle-magne, du fait de sa situation géopolitique, reste au cœur de l'Europe et de ses contradictions. L'unité de l'Europe passe par la réunification allemande et, inversement, toute évolu-tion du statut de l'Allemagne ne peut à terme qu'affecter le statut de l'Europe toute entière. Pour l'heure, la grande interrogation des Occidentaux est de savoir si la réunification est "compatible avec l'Europe". En un sens, ils n'ont pas tort: dans les an-nées qui viennent, c'est la nature de la coo-pération al-lemande avec l'Est qui va déter-miner la future structure de la Communauté européenne.
Mais en même temps, leur raisonnement est fautif, précisément parce qu'en parlant d'Europe, ils n'ont en tête que la "petite" CEE. Or, l'Eu-rope ne se ramène pas à son promontoire occi-dental. Elle est un conti-nent, dont les peuples aspirent à retrouver les voies de l'autonomie, de la puissance et de l'identité, perspec-tive qui implique l'abandon de la seule logique économique et marchande et l'émergence d'une "troi-sième Europe", sortie de l'affrontement stérile des blocs.
Alors qu'aux Etat-Unis, la mode est aujourd'hui de spéculer sur la "fin de l'histoire", tout se passe au contraire comme si, brusquement, l'histoire faisait re-tour. Et de fait, c'est toute une dynamique proprement historicisante qui s'en-clen-che actuellement, prenant de court les futurologues et la classe politique, toutes nuances con-fondues. Certes, il reste bien des incerti-tudes, et nous restons mal informés sur l'exacte signification des réformes entreprises en Union Soviétique, comme sur l'avenir de la perestroïka. On peut envisa-ger des phases de recul. Mais déjà, l'essentiel est fait. Si toute l'Europe de l'Est s'ébranle, les Russes, de-main, ne pourront pas envoyer les chars partout. L'histoire redevient ou-verte, et l'on peut déjà parier que, parmi ceux qui applaudissent aujourd'hui à la destruction du Mur, il s'en trouvera beaucoup demain pour regretter à mi-vois la "stabilité" de l'époque de la guerre froide. Donner l'initiative aux peuples, sortir de la logique des blocs, c'est en effet entrer dans la zone de l'imprévisible. Mais l'histoire est faite de cette im-prévisibilité-là. Et c'est pour cela que l'homme lui-même est toujours "ouvert": il se construit historiquement.
Fabrice GOETHALS.
Texte paru dans Le Courrier des Pays-Bas Français (n°62, nov. 89), lettre mensuelle éditée par la SEDPBF. Tout courrier à SEDPBF, 46 rue Saint-Luc, 59.800 Lille. Abonnement annuel (10 numéros): 100 FF ou 650 FB.
00:05 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : urss, russie, europe, allemagne, mitteleuropa, histoire, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 25 décembre 2008
"Global Trends 2025" : le rapport des services secrets américains
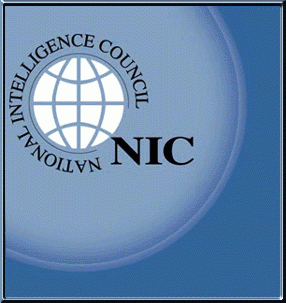
Günther DESCHNER :
« Global Trends 2025 » : le rapport des services secrets américains
Trois ans après la disparition du Rideau de Fer, les présidents américains estimaient encore que le monde était « OK ». George Bush Senior ne doutait pas un instant, à l’époque, qu’avec « l’aide de Dieu », il gagnerait bientôt la Guerre Froide et qu’il récolterait les fruits, à l’échelle globale, de cette épreuve de force qui avait duré quelques décennies. Il disait : « Un monde qui était jadis partagé entre deux camps armés reconnaît désormais une seule grande puissance hégémonique, celle des Etats-Unis d’Amérique. Les peuples du monde sauront apprécier cette situation et ils nous font confiance de toutes leurs forces ».
Depuis ce « Discours à la Nation », seize années se sont écoulées qui ont ébranlé la conscience de soi des Américains jusqu’en ses fondements et, surtout, qui ont changé radicalement le monde. Les plans pour sauver le monde, qu’avait jadis concocté le successeur de Reagan, ont échoué et pas seulement à cause de la démesure de son fils George W. Bush ou à cause des attentats du 11 septembre 2001 ou des guerres en Afghanistan et en Irak. L’effondrement du système financier américain, le déficit toujours constant et croissant du budget de l’Etat américain, les graves problèmes économiques et l’état désastreux de la société américaine elle-même, jettent toujours davantage le doute dans l’esprit des observateurs : ils se demandent si l’Amérique sera en mesure, dans les années à venir, de conserver son rôle d’unique puissance internationale capable de maintenir l’ordre dans le monde.
Des guerres civiles et ensuite l’effondrement du pays ?
Les titres des journaux et les interrogations se succèdent : « Est-ce la fin de l’ère américaine ? » ; « Le monde post-américain » ; « Le modèle américain a fait son temps » ; « Que s’est-il passé avec l’Empire américain ? ». Il n’a pas fallu attendre la crise financière pour que les titres de livres ou d’articles de cet acabit se repèrent largement dans les médias, où l’on prévoit ainsi, de manière récurrente, le déclin de « l’hyper-puissance américaine » et où l’on prophétise des constellations de puissance entièrement nouvelles sur l’échiquier géopolitique. L’étude, qui est allé le plus loin dans ce sens, a été commencée il y a une dizaine d’années et a été achevée et présentée en novembre dernier ; elle émane de la « Faculté des Relations Internationales » de l’Académie Diplomatique du ministère russe des affaires étrangères. Son Doyen, le politologue Igor Panarine, pronostique, dans les conclusions de l’enquête, que les dissensions qui déchirent d’ores et déjà la société américaine déboucheront, dans les prochaines décennies, sur des guerres civiles et sur l’effondrement du pays qui se morcellera en plusieurs parties.
Certes, derrière toutes ces thèses et ces slogans sur le déclin éventuel de la superpuissance américaine, se profilent les habituels vœux pieux des Anti-Américains de tous acabits ou une volonté de broyer du noir ; il n’empêche qu’aux Etats-Unis aussi ce genre de spéculations ont cours désormais. Ainsi, le NIC (« National Intelligence Council »), émanation des services secrets et cellule centrale en charge de formuler les prévisions pour le moyen et le long termes, centralise les informations et les analyses de pas moins de dix-huit services de renseignements américains et considère aujourd’hui que la domination globale qu’exercent les Etats-Unis est sur la voie du déclin. Le NIC analyse la situation de la seule superpuissance encore en lice et prévoit qu’au cours des vingt prochaines années elle perdra très nettement de la puissance sur les plans économique et politique. Les prévisions du NIC n’excluent pas l’émergence de guerres nouvelles.
Dans l’étude publiée par le NIC et intitulée « Global Trends 2025 », on trouve cette phrase significative : « En 2025, on ne reconnaîtra presque plus le système international, qui s’est constitué après la seconde guerre mondiale ». La cause de cette mutation globale provient surtout, d’après le NIC, de la montée en puissance d’autres grands acteurs globaux, de la croissance de pays encore émergents aujourd’hui, de la globalisation de l’économie et du transfert historique du développement et de la puissance économique de l’Ouest vers l’Est. Le texte annonce aussi la possible émergence de conflits internationaux pour les matières premières et les ressources. Dans les deux décennies qui s’annoncent, il y aura plus de troubles et de conflits dans le monde. Les denrées alimentaires et l’eau potable se raréfieront et les armes prolifèreront.
Jamais auparavant, ce rapport du NIC, qui est établi tous les quatre ans et qui se base sur une vaste enquête, menée auprès d’experts dans le monde entier et d’estimations dérivées d’analyses posées par des services secrets, n’avait eu un ton aussi pessimiste quant à la position des Etats-Unis dans le monde. Thomas Fingar, chez qui arrivent tous les rapports des analystes et des experts avant la rédaction finale, considère qu’en 2025 les Etats-Unis resteront certes « la plus grande puissance au monde » mais qu’ils seront « moins hégémoniques » qu’avant. Fingar est l’homme qui fut vice-directeur des autorités officielles en charge de collecter de tels renseignements et analyses. Depuis, il est devenu le chef du NIC. Fingar parle allemand et chinois ; il a d’abord enseigné dans diverses universités et hautes écoles, ensuite, il fut, pendant de nombreuses années, le principal analyste des questions militaires, attaché au quartier général de l’armée américaine à Heidelberg en Allemagne ; à ce titre, il dépendait du département des services secrets et de la recherche du ministère américain des affaires étrangères.
L’étude « Global Trends 2025 » cite toute une série de raisons expliquant l’évolution des vicissitudes politiques, telles que les perçoivent les services secrets américains : le processus de globalisation se poursuivra, explique le rapport du NIC, et il apportera, d’une part, un accroissement de l’abondance, et, d’autre part, de plus fortes inégalités. « Le fossé entre riches et pauvres, aux niveaux international, régional et intra-étatique, ne cessera de croître ».
L’hégémonie américaine sera soumise à une forte érosion au sein du système international, sur les plans militaire, politique, économique et culturel ; « et cette érosion ira en s’accélérant, sauf sur le plan militaire ». Même si la dimension militaire des Etats-Unis sera encore longtemps celle d’un géant, c’est sans doute le domaine qui s’avèrera le moins important. « Personne ne nous attaquera avec des forces conventionnelles et massives. Car la dissuasion nucléaire fonctionnera ». Les analystes de Fingar prévoient toutefois une perte d’importance dramatique pour les grandes organisations internationales : elles seront de moins en moins en mesure d’affronter les nouveaux défis d’un monde globalisé. Ce seront surtout l’ONU, l’OMC, le FMI, la Banque Mondiale, et aussi l’OTAN qui seront frappés par ce désintérêt général et ce déclin. « Nous avons besoin d’autres institutions ou de transformer ou de réanimer celles qui existent, afin qu’elles puissent s’occuper des conséquences de la globalisation ».
Les Etats-Unis sont plus stables sur le plan démographique que l’Europe, la Russie et le Japon
Fingar craint toutefois que le mécontentement dans le monde face à la politique américaine devienne si important que toute idée lancée par l’Amérique, pour qu’elle soit mise à l’ordre du jour, soit d’emblée discréditée, aussi bonne soit elle. Les propositions formulées par la Russie, la Chine, l’Inde ou l’UE seront elles aussi dépourvues de crédibilité chez les puissances tierces et grevées de doutes et de scepticisme. « Personne ne sera en mesure, pendant assez longtemps, de prendre en charge le leadership dans le monde et d’aider à promouvoir les changements nécessaires dans le système international ».
Les modifications climatiques, estime l’étude du NIC, auront des conséquences politiques, bien qu’indirectes, et provoqueront des chutes de gouvernement et des guerres. Ces modifications climatiques n’auront peut-être pas le poids nécessaire pour faire basculer seules les choses mais elles seront, dans bon nombre de cas, le petit élément de trop, pareil « au brin de paille qui brise l’échine du chameau », c’est-à-dire le complément inattendu, imprévu, qui donnera le coup de grâce à des gouvernements faibles ou à des Etats en voie de décomposition ».
Les migrations augmenteront partout dans le monde et en modifieront les structures politiques : toujours davantage d’hommes voudront quitter leurs pays appauvris et chercher de meilleures conditions de vie dans des Etats prospères et moins frappés par les modifications climatiques.
L’étude laisse une place importante au facteur démographique : l’Europe occidentale, la Russie et le Japon, dans une vingtaine d’années, se retrouveront dans une situation où pour chaque citoyen actif, il faudra compter deux retraités. « C’est là une charge fort lourde pour la croissance économique », conclut le rapport. C’est donc à ce niveau démographique que Fingar estime que les Etats-Unis se trouvent dans une meilleure position : « Parmi les pays hautement développés, nous sommes presque seuls dans ce cas : nous aurons toujours une croissance démographique en hausse ».
L’étude estime ensuite que les questions de sécurité énergétique pèseront d’un poids politique plus considérable que les idéologies : le désir de s’assurer des matières premières énergétiques ne cessera de croître et pas seulement en Occident, surtout chez les puissances émergentes comme la Chine et l’Inde.
Parmi les autres thématiques de ce travail considérable, riche d’idées : les conséquences de la catastrophe financière de 2008, le changement climatique, les technologies du futur, le rôle stratégique de l’Arctique, la raréfaction de l’eau potable, les conflits armés de l’avenir, la fin d’Al Qaeda, le danger des pandémies globales.
Günther DESCHNER.
(article paru dans « Junge Freiheit », Berlin, n°52/2000 – N°1/2009, traduction française : Robert Steuckers).
L’étude du NIC, intitulée « Global Trends 2025 » se lit sur internet : http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf
00:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : etats-unis, services secrets, futurologie, prospective, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Espace et temps chez Ezra Pound
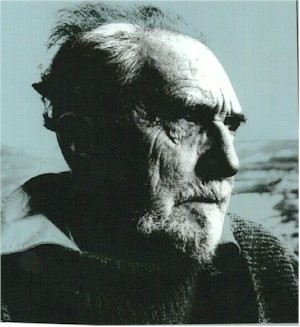
Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - VOULOIR (Bruxelles) - Janvier 1986
Vintilia HORIA:
Espace et temps chez Ezra Pound
Pour avoir défendu une position similaire, pour s'être attaqué à l'usure comme procédé hétérodoxe dans le cadre de l'Eglise de son temps, Dante perdit sa patrie, fut condamné à mort et dut passer le reste de ses jours loin des siens. Au XXème siècle, Ezra Pound subit le même sort…
Ce qu'on pourrait appeler "le plan vital" dans la poésie d'Ezra POUND ne peut trouver qu'une seule comparaison, ancienne mais toujours valable: l'œuvre de DANTE. La poésie que ce grand Italien a produite ne se limite pas à La Divine Comédie mais comprend aussi De la Monarchie, œuvre en prose contenant le projet d'une société basée sur l'idée impériale. Cette idée recèle une transcendance que l'homme doit conquérir en subissant les épreuves de l'enfer, épreuves de la connaissance en profondeur; en tant qu'être inférieur, il doit surpasser les purifications du purgatoire afin de trouver, avec l'aide de l'amour, considéré comme possibilité maximale de sagesse, les dernières perfections du Paradis. Dans cette optique, la Vie serait un voyage, comme l'imaginaient les Romantiques ainsi que RILKE et JOYCE. Dans l'œuvre de POUND, ce qui nous rapproche de La Divine Comédie, ce sont les Cantos Pisans. Dans toute la poésie et la prose de POUND, comme dans tous les gestes de son existence, on repérera un souci quasi mondain de la perfection, confinant au métaphysique. L'homme, dans cette perspective, doit se perfectionner, non seulement sur le plan de la transcendance et de l'esprit, mais aussi dans le feu des affrontements momentanés qui composent sa vie de pauvre mortel. La perfection spirituelle dépend de l'héroïcité déployée dans le quotidien. "La lumière plane sur les ténèbres comme le soleil sur l'échine d'une bourrique".
Une révolte contre le monde moderne
Le pire, chez DANTE, l'ennemi qu'il combattit tout au long de sa vie d'exilé, fut la confusion consciente entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. La tâche du Pape, c'était de s'occuper de la santé et du salut des âmes. L'Empereur, lui, devait s'occuper du monde visible, sans jamais perdre de vue le but ultime. Le Souverain Pontife ne devait s'abstenir de lutter contre les maux du quotidien. L'homme est une combinaison d'antagonismes complémentaires. Sa complexe constitution psychosomatique révèle un désir d'harmonie finale, désir qui s'exprime sans cesse conformément à la "coincidentia opposi- torum". L'affrontement politique, qui caractérisa et marqua l'existence de DANTE, constitue finalement le sceau typique d'un être capable de vivre et d'assumer la même essence, tant dans sa trajectoire vitale que dans son œuvre; la marque de l'affrontement politique confèrera une aura tragique à POUND également. Cette similitude dévoile non seulement une certaine unité de destin commune aux deux poètes mais aussi l'immuabilité de la tragédie humaine, (de l'homme en tant que zoon politikon, NdT), à travers les siècles. Le poète nord-américain ne put échapper au XXème siècle à ce sort qui frappa le Florentin six cents ans plus tôt. On constate une relation perverse avec la politique qui affecte l'homme et lui est dictée par le droit, ou plutôt le devoir, de se scruter sous l'angle du péché originel. La politique est le terrain où l'homme trouvera, avec le maximum de probabilités, une tribune pour se faire comprendre aisément et rendra ses pensers accessibles aux commentateurs.
La révolte de Pound contre le monde moderne est une attitude quasi générique, consubstantielle à sa génération. En effet, c'est cette lost generation nord-américaine qui abandonna sa patrie lorsque le puritanisme céda le pas au pragmatisme, dans un mouvement comparable à la révolte de KAFKA contre la technique considérée comme inhumaine. Mais ce n'est pas la technique qui définit le désastre. HEIDEGGER a consacré un essai entier à ce problème crucial et nous savons désormais combien les machines et leur développement peuvent être nocives et ceci seulement par le fait qu'il y a malignité chez ceux qui les manipulent. Le problème nous apparaît dès lors beaucoup plus profond. Il s'agit de l'homme lui-même et non des œuvres qu'il produit. Il s'agit de la cause, non de l'effet. Déjà les romanciers catholiques français de la fin du XIXème, tout comme le Russe DOSTOIEVSKI, avaient souligné ce fait. C'est le manque de foi, la perte du sens religieux qui octroye à l'homme des pouvoirs terrestres illimités.
Le problème n'est donc pas physique mais métaphysique. POUND n'est certes pas un poète catholique. C'est un homme soulevé par une religiosité profonde qui se situe dans une forme d'ésotérisme compris comme technique de la connaissance. Ce qui lui permet d'utiliser les mêmes sources et de chercher les mêmes fins que BERNANOS ou CLAUDEL. Il n'est donc pas difficile de rencontrer des points communs -et d'impétueux déchaînements au départ d'une même exégèse- entre POUND et l'auteur du Journal d'un curé de campagne, qui lança de terribles attaques contre notre monde actuel après la seconde guerre mondiale.
Le Mal, c'est l'usure
En conséquence, nous pouvons affirmer que, de son premier à son dernier bilan, POUND sait où se trouve le mal. Il le définit par le terme usure, tout en se proclamant combattant contre tout système voué à l'utiliser sous les formes de l'exploitation, de l'oppression ou de la dénaturation de l'être humain et contre toute Weltanschauung ne se basant pas sur le spirituel. C'est là que les attaques de POUND contre l'usure, présentes dans les Cantos, trouvent leurs origines, ainsi que ses critiques d'un capitalisme exclusivement basé sur ce type d'exploitation et son désir de s'allier à une régime politique ressemblant à l'Empire défendu et illustré par DANTE.
Ses émissions de Radio-Rome dirigées contre ROOSEVELT durant les dernières années de la guerre sont, dans ce sens, à mettre en parallèle avec les meilleurs passages des Cantos. Pour avoir défendu une position similaire, pour s'être attaqué à l'usure comme procédé hétérodoxe dans le cadre de l'Eglise de son temps, DANTE perdit sa patrie, fut condamné à mort et dut passer le reste de ses jours loin des siens. Ezra POUND subit le même sort. Lorsque les troupes nord-américaines submergèrent l'Italie, POUND fut arrêté, moisit plusieurs mois en prison et, pour avoir manifesté son désaccord avec un régime d'usure, un tribunal le fit interner dans un asile d'aliénés mentaux. Son anti-conformisme fut taxé d'aliénation mentale. Cette leçon de cynisme brutal, d'autres défenseurs d'un régime d'usure, je veux dire de l'autre face de l'usure, celle de l'exploitation de l'homme en masse, l'apprendront. Cette usure-là engendre les mêmes résultats, en plus spectaculaire peut-être puisque le goulag concentre davantage d'anti-conformistes déclarés tels et condamnés en conséquence.
"L'usure tue l'enfant dans les entrailles de sa mère" déclare un des vers de la célèbre finale du Cantos XV. Cet enfant pourrait bien être le XXIème siècle, celui que POUND prépara avec tant de passion, avec un soin quasi paternel. Ce siècle à venir est déjà menacé de tous les vices prévus par le poète, contrairement à sa volonté et à ses jugements empreints de sagesse.
Vintilia HORIA.
(traduit de l'espagnol par Rogelio PETE, décembre 1985).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres américaines, littérature américaine, littérature, etats-unis, modernité, usure |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 24 décembre 2008
L'Agence US CANVAS organise les manifestations anti-Chavez

Ferdinando CALDA:
L’agence américaine CANVAS organise les manifestations anti-Chavez au Venezuela
Qui se profile donc derrière le mouvement étudiant qui, depuis des mois, manifeste au Venezuela contre le gouvernement de Chavez? Qui organise ces manifestations? Qui sont ces étudiants qui scandent leur slogans sur les places publiques pour protester contre un régime qu’ils qualifient de “dictatorial”? La réponse est claire: c’est le “Centre for Applied NonViolent Action & Strategies” ou CANVAS.
CANVAS n’est pas autre chose qu’un avatar récent du mouvement OTPOR (qui signifie “Résistance”), un mouvement étudiant serbe qui, à partir d’octobre 2000, se profilait derrière toutes les manifestations hostiles au Président serbe Slobodan Milosevic et avait finalement provoqué sa chute, parce que sa politique était contraire aux intérêts de Washington. Le symbole de CANVAS est le même que celui d’OTPOR: un poing fermé en signe de révolte et de protestation. Simple différence: il est entouré de trois flèches signifiant le “recyclage”. Sur le site du Centre CANVAS, les responsables de l’organisation donnent la Serbie en exemple car OTPOR y a obtenu “une victoire de la guerre non violente contre Milosevic”, victoire “qui a finalement ouvert les portes à la démocratie et à la possibilité de forger un avenir meilleur pour le pays”.
Mais il ne faut pas oublier qu’avant d’arriver au Venezuela, le symbole du poing fermé d’OTPOR a d’abord transité par la Géorgie, où, à partir de novembre 2003, la dite “révolution des roses” a porté au pouvoir l’américanophile Mikhail Saakachvili, si sûr d’obtenir toujours le soutien de Washington, qu’il n’a pas hésité à attaquer la Russie en Ossétie du Sud, au mois d’août dernier. Dans le cas de la “révolution des roses”, ce sont les étudiants du mouvement “KMARA” (terme qui signifie “ça suffit!” en géorgien) qui ont téléguidé les protestations contre les prétendues embrouilles électorales du Président Edouard Chevarnadzé; eux aussi avaient pour symbole le poing fermé d’OTPOR, non plus blanc sur fond noir, mais bleu sur fond orange.
Les vétérans d’OTPOR ont également organisé un mouvement étudiant en Biélorussie, hostile au pouvoir en place. En effet, en novembre 2004, ces étudiants, rassemblés au sein du mouvement ZUBR (terme qui signifie “Bison” en biélorusse), ont protesté lors du référendum tenu pour prolonger le mandat du président Alexandre Loukachenko. A Minsk, toutefois, le mouvement n’a enregistré aucun succès. Outre en Serbie et en Géorgie, CANVAS se profile également derrière ce que ses organisateurs appellent eux-mêmes une “concrétisation parfaite de l’action stratégique non violente”, soit la “révolution orange” en Ukraine. En Ukraine, ce sont aussi les instructeurs de l’agence CANVAS qui ont instruit les jeunes du mouvement “PORA” (“C’est l’heure!”), pour qu’ils puissent porter en avant leur “lutte non violente” et réussir leur coup. En Ukraine, les élections présidentielles du 21 novembre 2004 ont vu s’affronter le premier ministre pro-russe Victor Yanoukovitch et le candidat de l’opposition Victor Iouchtchenko, plus proche des intérêts “occidentaux”. Fort des résultats des sondages, Iouchtchenko a immédiatement contesté les résultats des élections qui avaient donné l’avantage au parti du premier ministre Yanoukovitch. Ces élections furent d’emblée décrétées “frauduleuses”. Après de nombreuses journées de protestations et de manifestations, la Cour suprême d’Ukraine a invalidé les résultats électoraux et a ordonné que de nouvelles élections soient tenues le 26 décembre. Cette fois-là, Iouchtchenko, candidat pro-occidental, a obtenu la victoire.
Aujourd’hui, CANVAS opère sur deux “champs de bataille”: le Zimbabwé de Mugabe et le Venezuela de Chavez. Mais question: qui se trouve de fait derrière ces véritables mercenaires de la révolution fabriquée? Qui porte en avant et finance ces organisations protestataires, portées par des groupes très réduits d’activistes qui parviennent pourtant à déstabiliser tout gouvernement considéré à Washington comme “illégitime”? Quels sont les financiers de ces opérations médiatiques colossales, qui paie tous ces drapeaux, T-shirts, auto-collants et autres gadgets permettant une identification immédiate, de type publicitaire, du bon camp “révolutionnaire et démocratique”? Sur le site de CANVAS, on trouve tout de suite une piste car on y indique quelles sont les “organisations qui pourraient être utiles pour apporter aides et/ou soutiens aux mouvements non violents”. Ces organisations sont: “Albert Einstein Institution”, “National Endowment for Democracy” (NED), “International Republican Institute”, “National Democratic Institute for International Affairs”. Ces deux dernières organisations dépendent respectivement du parti républicain et du parti démocrate américains et reçoivent des financements du NED. Cette dernière est une organisation privée, créée en 1983 dans le but, lit-on sur le site, de “renforcer les institutions démocratiques dans le monde par le biais d’actions non gouvernementales”.
Les financements qui soutiennent le NED proviennent directement du gouvernement américain. Dans un entretien accordé au “Washington Post”, le 2 mars 2008, le Sénateur de l’Illinois, Barack Obama, promettait “d’augmenter substantiellement les fonds à accorder au ‘National Endowment for Democracy’ et aux autres organisations non gouvernementales qui soutiennent les activistes qui militent dans les sociétés répressives”. Parmi les organisations non gouvernementales qui s’efforcent d’exporter la “démocratie” et dont parlait Obama dans son interview, il y a la “Albert Einstein Institution” (AEI), fondée en 1983 par Gene Sharp, un homme influent que beaucoup considèrent comme l’inspirateur des “révolutions colorées”. Sharp, dans ses livres, analyse en fait tous les instruments susceptibles de faire modifier ou chuter un gouvernement par le truchement de la lutte non violente. L’AEI se vante très ouvertement d’avoir eu de nombreux contacts avec les étudiants d’OTPOR. Ensuite, parmi bien d’autres choses avouées, on apprend qu’en avril 2003 deux consultants de l’AEI, Chris Miller et Robert Helvey (ancien officier de l’armée américaine), se sont rendus à Caracas pour rencontrer les représentants de l’opposition anti-Chavez. Le but de ces quelques journées de consultation, explique l’AEI, a été de “fournir à l’opposition démocratique vénézuélienne la capacité de développer une stratégie non violente pour réinstaller à terme la démocratie dans le pays”.
Parmi les autres organisations non gouvernementales particulièrement actives en ce domaine: la “Freedom House” (FH). “Que ce soit en Ukraine ou en Serbie’, lit-on sur le site, “la Freedom House a travaillé étroitement avec des groupes locaux, responsables des révolutions pacifiques et démocratiques. Au Venezuela, elle a travaillé avec ceux qui cherchent à défendre et à promouvoir les droits de l’homme dans une situation politique difficile”. Ce n’est donc pas un hasard si la Freedom House emploie deux membres d’OTPOR, les Serbes Aleksandar Maric et Stanko Lazendic, comme “conseillers spéciaux” pour l’Ukraine. A signaler également l’ “Open Society Institute” de Georges Sörös, qui fut tout particulièrement actif en Serbie et en Géorgie (avec l’ “Open Society Georgia Foundation”).
Comment agissent ces organisations pour culbuter les gouvernements considérés comme “peu démocratiques”? Les exemples de la Serbie, de la Géorgie, de l’Ukraine et, plus récemment, du Venezuela, montrent qu’elles ont une capacité notoire à organiser de véritables campagnes médiatiques internationales qui permettent au monde entier d’identifier immédiatement un “symbole” ou une couleur qui distingue, de manière totalement fabriquée, la “révolution” colorée et démocratique aux yeux de l’opinion publique mondiale. Elles sont aussi capables de produire des “sondages” qui suggèrent toujours que l’exécutif visé perd toute légitimité populaire.
Autre protagoniste dans ce champ d’action: la société américaine “Penn, Schoen & Berland Associates” (PSBA), qui s’est spécialisée, comme elle l’explique elle-même, dans l’art de “former la perception que le groupe, visant le pouvoir dans le pays en question, bénéficie d’une ample popularité”. La PSBA a été célébrée dans la presse américaine comme l’une des chevilles ouvrières majeures des mutations non violentes en Serbie, contre Milosevic, et comme un élément clef dans les bouleversements qui ont eu lieu ou devront avoir lieu en Ukraine et au Venezuela. En août 2004, la PSBA se distingue négativement en faisant montre d’un comportement emblématique qui explique toutefois fort bien les “modi operandi” du système mis au point à Washington. A l’occasion du référendum anti-Chavez, la PSBA a diffusé un “exit poll”, soit des résultats, alors que les urnes n’avaient pas encore été closes, en violation de la loi. Dans ces résultats purement fictifs, l’agence annonçait la victoire du “oui” et, par conséquent, la défaite du président Chavez, alors que ce dernier a finalement obtenu la victoire avec 58% des votes. La note diffusée par la PSBA risquait d’alimenter des tensions dangereuses pour la stabilité et la paix civile dans le pays.
Une autre société spécialisée dans les “sondages” se distingue généralement en Amérique latine: l’ “Ecoanalistica Opinion Publica” (EOP). L’EOP avait diffusé, au cours des jours précédant le vote référendaire vénézuélien, un sondage affirmant que 65% des Vénézuéliens étaient opposés à la réélection présidentielle illimitée. Malgré que ce sondage avait été “commissionné” plus ou moins trois mois auparavant, ces résultats ont été publiés seulement après que le Président Chavez ait formulé son intention de procéder à sa réélection.
Face à tous ces événements et si l’on songe aux enseignements de Gene Sharp qui sont fidèlement repris par CANVAS, on pourra repérer facilement la logique d’airain qui sous-tend l’ensemble de ces actions de déstabilisation. En fait, dès le moment où un gouvernement, quelque part sur la Terre, en vient à être considéré comme “illégitime”, tous les moyens “non violents” pour le déstabiliser deviennent “légitimes”. Le but évident de l’action lancée est alors de frapper ceux que l’on définit comme les “piliers de soutien du pouvoir”. Ces piliers sont la police, la bureaucratie, le système éducatif et les organisations religieuses.
En résumé, le gouvernement des Etats-Unis finance toute une série d’organisations non gouvernementales qui ont pour objectif de s’immiscer dans la politique quotidienne des Etats jugés non suffisamment démocratiques, dans le but évident de promouvoir des actions de déstabilisation contre les gouvernements retenus comme “illégitimes”.
Tout ce que les médias présentent comme des manifestations du peuple contre des gouvernements posés a priori comme “despotiques” et “corrompus” sont en réalité des actions téléguidées par une seule et même régie, soutenue par les même financiers.
Ferdinando CALDA.
(article paru dans “Rinascita”, Rome, 13-14 décembre 2008; traduction française: Robert Steuckers).
00:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : manipulations médiatiques, médias, propagande, révolution orange, ukraine, venezuela, biélorussie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le système financier n'est pas réformable
LE SYSTÈME FINANCIER N’EST PAS RÉFORMABLE
trouvé sur: http://unitepopulaire.org/

« Ainsi donc tout était possible. Une intervention financière massive de l’Etat. L’oubli des contraintes du pacte de stabilité européen. Une capitulation des banques centrales devant l’urgence d’une relance. La mise à l’index des paradis fiscaux. Tout était possible car il fallait sauver les banques.
Pendant trente ans, la moindre idée d’une altération quelconque des fondements de l’ordre libéral afin, par exemple, d’améliorer les conditions d’existence de la majorité de la population s’était pourtant heurtée au même type de réponse : tout ceci est bien archaïque ; la mondialisation est notre loi ; les caisses sont vides ; les marchés n’accepteront pas ; savez-vous que le mur de Berlin est tombé ? Et pendant trente ans, la "réforme" s’est faite, mais dans l’autre sens. Celui d’une révolution conservatrice qui livra à la finance des tranches toujours plus épaisses et plus juteuses du bien commun, comme ces services publics privatisés et métamorphosés en machines à cash "créant de la valeur" pour l’actionnaire. Celui d’une libéralisation des échanges qui attaqua les salaires et la protection sociale, contraignant des dizaines de millions de personnes à s’endetter pour préserver leur pouvoir d’achat, à "investir" (en Bourse, dans des assurances) pour garantir leur éducation, parer à la maladie, préparer leur retraite. La déflation salariale et l’érosion des protections sociales ont donc enfanté puis conforté la démesure financière ; créer le risque a encouragé à se garantir contre lui. La bulle spéculative s’est très vite emparée du logement, qu’elle transforma en placement. Sans cesse, elle fut regonflée par l’hélium idéologique de la pensée de marché. Et les mentalités changèrent, plus individualistes, plus calculatrices, moins solidaires. Le krach de 2008 n’est donc pas d’abord technique, amendable par des palliatifs tels que la "moralisation" ou la fin des abus. C’est tout un système qui est à terre.
Autour de lui déjà s’affairent ceux qui espèrent le relever, le replâtrer, le ripoliner, afin que demain il inflige à la société quelque nouveau tour pendable. Les médecins qui miment l’indignation devant les (in)conséquences du libéralisme sont ceux-là mêmes qui lui fournirent tous les aphrodisiaques — budgétaires, réglementaires, fiscaux, idéologiques — grâce auxquels il s’est dépensé sans compter. Ils devraient se juger disqualifiés. Mais ils savent que toute une armée politique et médiatique va s’employer à les blanchir. Ainsi, MM. Gordon Brown, l’ancien ministre des finances britannique dont la première mesure fut d’accorder son "indépendance" à la Banque d’Angleterre, José Manuel Barroso, qui préside une Commission européenne obsédée par la concurrence, Nicolas Sarkozy, artisan du "bouclier fiscal", du travail le dimanche, de la privatisation de La Poste : ces trois-là s’emploient, paraît-il, à "refonder le capitalisme"... (...)
Alors qui proposera la mise en cause du cœur du système, le libre-échange ? Utopique ? Aujourd’hui tout est possible quand il s’agit des banques... »
Serge Halimi, "Penser l’Impensable", Le Monde Diplomatique, novembre 2008
00:35 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : finances, économie, crise, usure, usurocratie, banques, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Dehaene en Staatshervorming
00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, belgicana, flandre, wallonie, politique, caricature, dehaene |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Erasmus Darwin (1731-1802)
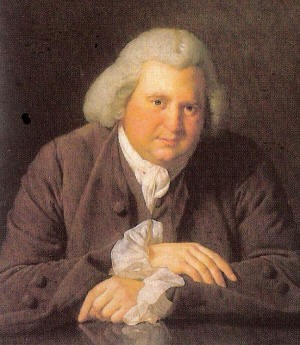
Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - DÉCEMBRE 1992
Robert STEUCKERS:
DARWIN, Erasmus (1731-1802)
Né à Elston Hall le 12 décembre 1731, Erasmus Darwin fréquente d'abord l'école de Chesterfield avant d'entrer en 1750 au St. John's College de Cambridge, où il obtint le grade de Bachelor of Art. En 1754, il part à Edimbourg pour y étudier la médecine. En 1756, il est médecin, d'abord à Nottingham puis à Lichfield et à Radbourne Hall, après son second mariage. Médecin dévoué, Erasmus Darwin se rend célèbre en préchant contre les excès d'alcool. Poète fougueux, sceptique en matières religieuses, matérialiste dans l'esprit du XVIIIième siècle, correspondant de Rousseau, Erasmus Darwin est un précurseur du lamarckisme et de l'évolutionnisme de son petit-fils Charles Darwin. Bon observateur des phénomènes naturels, Erasmus Darwin n'a cependant pas pu transformer ses observations empiriques en théories, comme le fit en 1859 son très célèbre petit-fils. Son ouvrage majeur en quatre volumes, la Zoonomie, est un monument de la médecine théorique de son époque, qui a indubitablement préparé la voie vers la biologie moderne. Erasmus Darwin meurt le 18 avril 1802 à la suite d'un malaise cardiaque. Ses travaux s'inscrivent dans un contexte familial très précis: son frère aîné, Robert Waring Darwin, écrivit un ouvrage intitulé Principia Botanica, où l'on découvre déjà des notes très particulières sur les phénomènes biologiques. L'aîné de ses trois fils, issus de son premier mariage, étudie la médecine mais meurt accidentellement d'un malencontreux coup de bistouri lors d'une dissection. Le troisième fils de son premier mariage est le second Robert Waring Darwin, père de Charles Robert, initiateur de l'évolutionnisme. La fille aînée de son second mariage, Violetta Darwin, épouse S. Tertius Galton et sera la mère de Francis Galton, théoricien de l'eugénisme.
Zoonomia, or, the Laws of Organic Life (Zoonomie, ou lois de la vie organique), 1794-1796
L'intention de l'auteur nous est d'emblée révélée par son traducteur, le médecin gantois Joseph-François Kluyskens: "Faire connaître les loix qui gouvernent tous les corps organisés; partir de ces mêmes loix, dans les corps les plus simples, pour remonter jusqu'à celles qui régissent l'homme, l'être le plus parfait; réduire toutes ces loix qui ont rapport à la vie organique en classes, ordres, genres et espèces, et les faire servir enfin à l'explication des causes des maladies; tel fut le but que se proposa la Docteur Darwin lorsqu'il composa la Zoonomie...".
Erasmus Darwin perçoit un lien entre métaphysique et physiologie, dans le sens où il affirme que nos facultés intellectuelles sont l'effet nécessaire de nos facultés physiques. Descartes, Mallebranche, Locke, Condillac et Hume, explique Erasmus Darwin, manquaient des notions physiologiques nécessaires pour percevoir cet état de chose ou ont négligé d'en faire l'application à leur système. Le corps de la démonstration, dans la Zoonomie, consiste en une exploration des facultés dites "sensoriales" (néologisme utilisé en français par le traducteur de la Zoonomie, le Dr. Kluyskens). Celles-ci se répartissent en quatre classes, irritation, sensation, volition, association, auxquelles correspondent quatre classes de maladies.
Les réflexions d'Erasmus Darwin sur l'instinct méritent amplement d'être évoquées; pour notre auteur, l'instinct n'est pas invariable; il est au contraire une sagacité susceptible de modification, se développant d'une manière différente suivant les différentes conjonctures qui en déterminent l'exercice. L'instinct provient donc d'une détermination raisonnée et non pas d'une obéissance aveugle et mécanique à une loi de la nature. La théorie zoonomique d'Erasmus Darwin, très proche du lamarckisme, repose sur un concept d'évolution, où l'action d'une "force vitale intérieure", amorcée par un filament primal originel de substance vivante, provoque le développement graduel de l'ensemble des diverses formes de vie par un processus analogue à celui de la reproduction des végétaux. La Zoonomie contient de ce fait un ensemble de réflexions sur la génération, qui font la nouveauté absolue des idées d'Erasmus Darwin. Sa méthode généalogique part d'une observation des bourgeons dans les arbres pour aboutir aux mammifères en passant par tous les animaux de la création.
Pour Erasme Darwin, toute pathologie dérive d'un excès ou d'un défaut, d'un mouvement rétrograde des facultés du sensorium; les pathologies consistent de ce fait dans l'aberration des mouvements des fibres vivantes.
(Robert Steuckers).
- Bibliographie. Poésie: The Botanic Garden (1794-95); The Temple of Nature or the Origin of Society (1803; publication posthume). Ouvrages scientifiques: Zoonomia; or, the Laws of Organic Life, in four volumes, London, J. Johnson, 1794-96 (la traduction française est basée sur la 3ième édition anglaise de 1801; Zoonomie, ou lois de la vie organique, trad. de Joseph-François Kluyskens, en quatre volumes, Gand, P.F. de Goesin-Verhaeghe, 1810); Phytologia, or the Philosophy of Agriculture and Gardening (1800). Autres ouvrages: A Plan for the Conduct of female Education in Boarding Schools (1797).
- Sur Erasmus Darwin: Ernst Krause, Erasmus Darwin, trad. anglaise de W.S. Dallas, avec notice préliminaire de Charles Robert Darwin, 1879; Anna Seward, Memoirs of the Life of Dr. Darwin, 1804 (voir également la correspondance de Miss Anna Seward); Memoirs of Richard Lovell Edgeworth; John Dowson, Erasmus Darwin, Philosopher, Poet and Physician, 1861; cf. également, Samuel Butler (l'auteur d'Erewhon), Evolution Old and New, où le célèbre romancier tente de faire revivre l'ancien évolutionnisme d'Erasmus Darwin contre le nouvel évolutionnisme de son petit-fils Charles; Leslie Stephen, "Erasmus Darwin", in Leslie Stephen (ed.), Dictionary of National Biography, vol. XIV, London, Smith, Elder & Co., 1888; D. M. Hassler, Erasmus Darwin, Twayne, New York, 1973; D. King-Hele, Doctor Darwin: The Life and Genius of Erasmus Darwin, Faber, London, 1977; cf. également: D.R. Oldroyd, Darwinian Impacts. An Introduction to the Darwinian Revolution, New South Wales University Press, Kensington (Australia), 1980, Open University Press, Milton Keynes (England), 1980.
00:05 Publié dans Biographie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : biologie, darwinisme, sciences, sciences biologiques, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 23 décembre 2008
Les nouvelles pratiques du néo-colonialisme en Afrique subsaharienne

« M. »/ « ‘t Pallieterke » :
Les nouvelles pratiques du néo-colonialisme en Afrique subsaharienne
Il y a quelques semaines, on faisait sauter les bouchons de champagne au siège principal de « Daewoo Logistics » en Corée du Sud. La grande firme venait d’acquérir, par le biais d’accords de leasing bien ficelés et pour une période de 99 ans, plus d’un million d’hectares de terres cultivables à Madagascar. En utilisant essentiellement de la main-d’œuvre sud-africaine, les Coréens vont pouvoir, chaque année, tirer de ce sol malgache plusieurs millions de tonnes de céréales et d’huile de palme qui prendront la direction de Séoul.
A quelques exceptions près, la conclusion de cet accord n’a eu que très peu d’échos dans la presse. C’est bien étrange car cet accord est terriblement important pour plusieurs raisons. A commencer par l’ampleur et l’objet de la transaction. Acquérir d’un seul coup un million d’hectares est chose bien peu courante. Par ailleurs, ce « deal » révèle une tendance de plus en plus fréquente : des pays comme la Chine, le Pakistan, voire quelques Etats du Moyen-Orient, achètent de plus en plus souvent de vastes étendues de terres arables dans les pays en voie de développement. Il s’agit non seulement d’une réponse à l’augmentation du prix des denrées alimentaires mais aussi d’une manière de s’assurer leurs approvisionnements sur le long terme.
A l’évidence, les conséquences de ces transactions sont importantes pour les pays en voie de développement eux-mêmes. Au point que le chef de l’agence alimentaire des Nations Unies, Jacques Diouf, évoque, sans circonlocutions inutiles, une forme de « néo-colonialisme ».
Pour la sécurité alimentaire !
Vers la fin du mois de novembre dernier, le journal britannique « The Guardian » publiait une carte du monde qui était on ne peut plus claire. En utilisant des flèches de couleurs différentes, le graphiste du quotidien anglais nous offrait une image globale de ces transactions et nous montrait quels étaient les pays acheteurs et les régions du monde où ils acquéraient ces terres arables. Ce n’est pas la Chine qui arrive en tête des acheteurs mais la Corée du Sud, qui a acquis 2,3 millions d’hectares, non seulement à Madagascar mais aussi ailleurs en Afrique et en Mongolie. La Chine, elle, talonne les Sud-Coréens et a acheté 2,1 millions d’hectares, surtout en Asie du Sud. Quelques pays arabes s’activent également avec zèle : l’Arabie Saoudite (1,6 million d’hectares), les Emirats Arabes Unis (1,2 millions d’hectares), etc.
On peut comprendre que des Etats exigus cherchent ainsi à acquérir du sol arable complémentaire, mais cette démarche s’explique plus difficilement dans le cas de la Chine. L’Empire du Milieu ne manque pas de terres, pourrait-on penser. Le problème des Chinois n’est pas tant le sol lui-même que l’eau nécessaire à l’irrigation. La motivation principale qui pousse à de telles transactions est évidemment l’augmentation croissante du prix des denrées alimentaires. Il ne faut pas chercher plus loin. Mais ces transactions ont à la base une vision sur le long terme. Vu le réchauffement de la planète, bon nombre de terres arables pourraient perdre une partie de leur fertilité. Les transactions participent donc d’un esprit de clairvoyance. Or gouverner, n’est-ce pas prévoir ?
En octobre, l’ONG internationale GRAIN, qui s’occupe d’agriculture durable et de biodiversité, a publié une étude intéressante. Si l’on jette un regard synoptique sur toutes les transactions importantes en matière de terres arables, on s’apercevra d’abord de l’ampleur de ces opérations mais aussi des instances qui se dissimulent derrière elles. « A première vue, ces accords semblent purement d’ordre privé », remarque un intermédiaire qui participe à ces ventes. « Si l’on prend la peine de fouiller un peu, on remarquera qu’une politique de sécurité alimentaire se profile derrière de telles opérations. Les entreprises qui achètent peuvent compter sur le ferme soutien de leurs pouvoirs publics respectifs. La quantité de terres achetées augmente systématiquement. Dans le temps, une vente de 100.000 hectares relevait de la norme. La récente transaction malgache des Sud-Coréens vient de décupler cette norme ».
A tout cela s’ajoute encore un élément purement financier. En ces temps de crise financière, beaucoup d’investisseurs estiment plus raisonnable de placer leurs avoirs dans des terres arables plutôt que dans des produits financiers peu sûrs.
Néo-colonialisme ?
Jadis, on formulait quantité de promesses pour soutenir les agriculteurs et les éleveurs africains ; et aujourd’hui, qui s’en soucie encore vraiment ? En effet, quand le moment de prendre la décision arrive, chacun veut détenir un atout qui lui rapporte de l’argent. Peut-être que certaines belles âmes croient qu’un soutien complémentaire aux paysans d’Afrique poussera la production à la hausse et offrira une solution au problème du prix des denrées alimentaires ? Si l’on a quelques rudiments de raison d’Etat dans la tête, on se rendra bien vite compte de l’inanité d’un tel raisonnement.
Doit-on ajouter que cette tendance nouvelle est sévèrement critiquée par les tiers-mondistes ? « Vol de terres », « colonialisme par la porte de service » : les accusations qu’ils profèrent sont légion. Et elles sont partiellement justes. Autre élément que soulignent les scientifiques : comment ces terres seront-elles exploitées ? On pourrait facilement y utiliser des procédés de type industriel qui, à terme, tueront définitivement leur fertilité. Comment peut-on parler d’une solution sur le long terme si, en visant une rentabilité maximale de ces terres, on hypothèque gravement les potentialités du sol ? C’est là sans nul doute que réside le paradoxe de cette nouvelle tendance.
De surcroît, y a-t-il suffisamment de terres disponibles en Afrique et en Asie ? Sur cette question de la disponibilité des terres arables, les opinions divergent, et souvent considérablement. Tandis que certains cénacles en Occident poussent des cris d’orfraie, certains pays africains sont aux anges. Ils constatent que les caisses de leurs Etats sont étoffées, ainsi que l’escarcelle personnelle de leurs dirigeants. Finalement, dernière question, qu’en est-il de la population ?
« Ces accords ne doivent pas être rejetés a priori parce qu’ils apportent souvent des avantages pour la population locale », remarque un observateur autochtone. « Elles ont alors du travail, elles bénéficient de soins de santé, d’un enseignement, etc. Nous avons effectivement des exemples d’entreprises qui couplent à leurs objectifs commerciaux des buts philanthropiques ». Exploitation, vol de terres mais aussi, quelques fois, une certaine abondance et un certain bien-être pour la population locale. Nous avons affaire à une fringale de gains, parfois tempérée par des soucis humanitaires. Mais ce sont là autant de facettes de l’ère coloniale que l’on croyait révolue. Alors, nous trouvons-nous tout de même face à un néo-colonialisme ?
« M. » / « ‘t Pallieterke ».
(article paru dans « ‘t Pallieterke », Anvers, 17 déc. 2008 ; trad.. franc. : Robert Steuckers).
00:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, asie, afrique, politique internationale, alimentation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Paul von Krannhals (1883-1934)
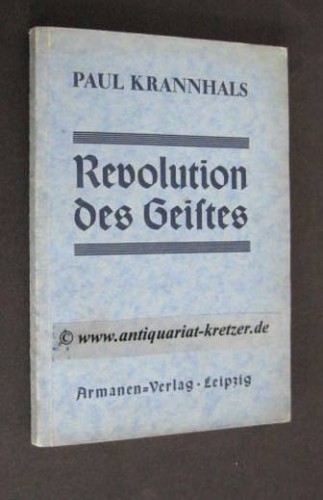
Paul von KRANNHALS (1883-1934)
Né le 14 novembre 1883 à Riga, Paul von Krannhals, chimiste de formation, participe à la première guerre mondiale et reste longtemps prisonnier en Russie. Après son retour au pays, il enseigne à titre privé. Son œuvre est un essai de transposition de l'organicisme implicite des sciences chimiques et biologiques dans les sphères historique, politique et religieuse. Son ouvrage majeur, Das organische Weltbild, récapitule toutes les étapes de la pensée et les théories à connotations organicistes afin d'en faire une synthèse instrumentalisable en politique. Il meurt le 18 août 1934 à Dresde.
La vue du monde organique (Das organische Weltbild), 1928
Gros ouvrage en deux volumes, Das organische Weltbild constitue une protestation contre la mécanicisation du monde et l'emprise des idéologèmes mécanicistes dans les sciences humaines. Krannhals réclame, dans tous les domaines, un «respect pour la vie». En science politique et en économie, l'individualisme a engendré l'absurdité de la lutte de tous contre tous, camouflée derrière l'idéologie du contrat qui transforme l'Etat en Zweckverband, en association d'intérêt. Tout ordre juridique basé sur le contractualisme est au service du seul bien-être matériel d'une certaine catégorie de la population. L'Etat organisé selon les principes du contractualisme ne génère pas d'éthique propre, ne suscite chez ses citoyens aucun sens du devoir, vertus qui ne sont possibles que si l'on accepte l'existence d'une totalité (Ganzheit) supérieure aux individus. L'absence d'éthique conduit à une existence privée de sens et de valeur. Le rationalisme mécaniciste fractionne et mutile l'unité de la vie. Mécanicisation est synonyme de pétrification. Se référant à l'œuvre de Ferdinand Tönnies, qui avait posé la distinction entre Kürwille (volonté arbitraire) et Wesenswille (volonté essentielle), Krannhals constate que la conjonction de l'individualisme et de l'idéologie du contrat a détruit les communautés (Gemeinschaft) pour faire place à la société (Gesellschaft). Dans ce processus, c'est un principe masculin guerrier et destructeur qui fait œuvre de dissolution et sépare les éléments constitutifs des communautés, en s'opposant à un principe féminin créateur et constructif. Les personnalités politiques, elles, sont le produit d'une fusion harmonieuse entre ces deux principes. Reprenant les dichotomies propres à la pensée vitaliste/organiciste, propre à une certaine idéologie conservatrice, Krannhals oppose, d'une part, la culture, la communauté, le sentiment, l'intuitive Wesenschau (la vision intuitive de l'essence ou des essences) et la conscience raciale (Artbewußtsein) à la civilisation mécaniciste/techniciste, à la société et aux modes éphémères successives qu'elles produisent, où la forme s'impose provisoirement comme règle obligatoire de comportement sans qu'elle n'ait contenu éthique qualitatif et durable. Krannhals définit l'essence de la conception politique organiciste, pour laquelle l'Etat organique est le contraire radical de l'Etat rébarbatif et fonctionnaire, pure construction formelle et fruit d'une logique sans âme. L'Etat organique s'oppose également à l'Etat absolutiste qui confond volontairement la direction de l'Etat (en l'occurrence le souverain) et l'Etat (Louis XIV: l'Etat, c'est moi!). Krannhals, en posant cette déclaration de principe, renoue avec Kant, dont l'œuvre tardive signale une volonté très nette de dépasser la conception de l'Etat qui repose sur le seul individu et ne vise que son «petit bonheur». Kant, affirme Krannhals, a voulu ancrer l'Etat de droit dans l'idée de la liberté éthique, justice et éthique étant ici inséparables. L'idée d'un Etat organique est précisément ce que postule la conscience éthique. Celle-ci demande au peuple, âme de l'Etat, de suivre librement, sans contraintes et en éliminant les contraintes artificielles auxquelles il pourrait avoir à faire face, les lois de la vie, qui s'incarnent dans les formes vitales naturelles. La piste organiciste inaugurée par Kant se poursuit chez Fichte et Hegel, prétend Krannhals, en dépit de la méthode dialectique. Elle se poursuit dans les travaux de l'école du droit historique (Savigny, von Eichhorn) et chez les théoriciens qui entendent «biologiser» les théories politiques, comme le géopoliticien et politologue suédois Rudolf Kjellén ou le philosophe français Gustave Le Bon. Krannhals se réfère plus explicitement à H.G. Holle pour qui le Volk est primordial et l'Etat, secondaire, simple forme organisée et organisatrice du peuple. Portée par une démarche racisante, la définition que donnent Krannhals et Holle du Volk n'exclut par pour autant les peuples mixés. Là où il y a mélange racial, il peut subsister un peuple tant que le noyau originel homogène —le völkischer Grundstock— continue à déterminer la culture. La conscience éthique d'un peuple n'est rien d'autre que la pleine acceptation et l'épanouissement de la conscience intime propre qu'il a de lui-même, en temps que phénomène naturel. Au regard de ces définitions organicistes/biologisantes, Krannhals conclut que l'objectif de tout ordre juridique véritable consiste à protéger les nécessités biologiques de la vie communautaire du peuple. La politique organique doit empêcher les groupes d'intérêts de dominer l'Etat. Le libéralisme n'assure pas la liberté au sens éthique du terme. Krannhals oppose, dans la ligne de Sombart, le marxisme au «véritable socialisme». La tâche de l'Etat et du «véritable socialisme» est d'organiser et de fédérer les différences sociales et non pas de perpétuer leurs antagonismes dans des jeux parlementaires stériles parce que purement discursifs. Dans son chapitre définissant l'économie organique, Krannhals récapitule toutes les grandes orientations de l'école des économistes organicistes, mélange d'autarcie fichtéenne, de socialisme de la chaire et de corporatisme conservateur. Par une dichotomie didactique où la volonté polémique n'est pas absente, Krannhals oppose l'argent (Geld) au sang (Blut), soit un principe quantitatif (et qui transforme tout qualitatif en quantitatif) à un principe qualitatif (qui transforme tout quantitatif en qualitatif). L'objectif de l'économie organique est de parvenir à la domination du sang sur l'argent, de la personnalité sur les choses. La science s'est effondrée et patine car elle s'est isolée du vécu. Elle ne pourra progresser que par une revalorisation de ses dimensions instinctives. Le vécu est source inépuisable dans le processus de formation des concepts. Le savoir doit s'organiser à partir du vécu local, de l'expérience nationale du peuple. L'art et la religion doivent également emprunter des pistes organiques s'ils veulent échapper à la stérilisation provoquée par la domination des idéologèmes mécanicistes.
(Robert Steuckers).
- Bibliographie: Das organische Weltbild. Grundlagen einer neuentstehenden deutschen Kultur (avec une introduction de Hermann Oncken), 2 vol., 1928; Lebendige Wissenschaft, 1937 (extraits de Das organische Weltbild, op. cit.); Der Weltsinn der Technik als Schlüssel zu ihrer Kulturbedeutung, 1932; Religion als Sinnerfüllung des Lebens. Ein Bekenntnis zur schöpferischen Weltheiligung, 1933; Der Glaubensweg des deutschen Menschen, 1934-35; Revolution des Geistes. Eine Einführung in die Schöpfungswelt organischen Denkens, 1935.
- Sur Paul von Krannhals: cf. Armin Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1989 (3ième éd.).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, sciences, philosophie, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L. F. Clauss: "L'âme des races"

L'âme des races - L.F. Clauss
Né le 8 février 1892 à Offenburg dans la région du Taunus, l'anthropologue Ludwig Ferdinand Clauss est rapidement devenu l'un des raciologues et islamologues les plus réputés de l'entre-deux-guerre, cumulant dans son oeuvre une approche spirituelle et caractérielle des diverses composantes raciales de la population européenne, d'une part, et une étude approfondie de la psyché bédouine, après de longs séjours au sein des tribus de la Transjordanie. L'originalité de sa méthode d'investigation raciologique a été de renoncer à tous les zoologismes des théories raciales conventionnelles, nés dans la foulée du darwinisme. Clauss renonce aux comparaisons trop faciles entre l'homme et l'animal et focalise ses recherches sur les expressions du visage et du corps qui sont spécifiquement humaines ainsi que sur l'âme et le caractère.
Sous le IIIème Reich, Clauss a tenté de faire passer sa méthodologie et sa théorie des carcatères dans les instances officielles. En vain. Les autorités israéliennes ont fait planter un arbre en son honneur à Yad Vashem en 1979. Car sa fidélité qui le liait à son pays et son travail au Département VI C 13 du RSHA (Reichssicherheitshauptamt), en tant que spécialiste du Moyen-Orient n'a toutefois pas empêché l'amitié qui liait Clauss à sa secrétaire Margarete Landé (d'origine juive) qu'il sauva des camps de concentration.
-------------------------------------------
INTRODUCTION DE L'AUTEUR : LE PROBLÈME DES VALEURS
Chaque fois qu’une nouveauté surgit dans l'histoire, les clameurs ne se font pas attendre. Ce que la recherche allemande en racio-psychologie a dû affronter, un certain temps en Allemagne même, fut en réalité le lot de toute la raciologie allemande de la part du reste du monde. Les reproches les plus inouïs lui furent adressés. La plupart étaient d'ailleurs si niais que le temps en fit rapidement litière. Peu à peu cependant, les armes dirigées contre nous s'affinèrent. Mais, toujours, la question des valeurs fut au centre de l'argumentaire qui devait nous abattre. On nous accusa de tenir la race nordique pour la seule valable, toutes les autres étant supposées l'être moins... Là où cet « argument » fut cru, il nous fit d'autant plus de mal que l'épithète « nordique », à l'origine de tant de méprises chez le profane, se prête à toutes sortes de manipulations gratuites, allant de la malhonnêteté à la bêtise.
Le Vatican, hélas, joignit sa voix aux vociférations contre les acquis de la raciologie. Il nous attaqua en particulier, avec les arguments habituels, dans un article de l'Osservatore Romano du 30 avril 1938. Comme mes livres furent également la cible de ces attaques, il est de mon devoir, me semble-t-il, de mettre ici les choses au point en quelques lignes, tout au moins en ce qui me concerne. Même si ces propos anticipent sur le contenu de l'ouvrage qu'ils sont censés préfacer.
Il y a trois erreurs par lesquelles ces attaques essaient de nous brouiller avec nos voisins. La première consiste à donner l'impression que la raciologie allemande attribuerait à chaque race, comme le maître à ses élèves, un rang déterminé. Selon cette erreur, elle assignerait ainsi une place à chaque race, la première revenant à la race nordique. Ce qui impliquerait que la race méditerranéenne, par exemple, dût se contenter de la seconde, ou d'une place inférieure encore.
Rien n'est plus faux. Certes, des livres et des brochures, parus en Allemagne et à l'étranger, ont affirmé cela. Mais la racio-psychologie, dont la seule mission, en fin de compte, est de déterminer les valeurs liées à l'âme de telle ou telle race, nous enseigne d'emblée, très explicitement, que chaque race représente en elle-même et pour elle-même la valeur suprême. Chaque race porte son ordre et ses critères de valeurs. Elle ne peut être appréciée au moyen des critères d'une autre race. Il est donc absurde et de surcroît anti-scientifique de voir, par exemple, la race méditerranéenne avec les yeux de la race nordique et de porter sur elle un jugement de valeur selon des critères nordiques - et l'inverse est tout aussi vrai. Bien sûr, de telles bévues se produisent sans cesse dans la vie quotidienne, et c'est inévitable. Mais pour la science, c'est là un manquement à la logique la plus élémentaire.
Pour juger « objectivement » de la valeur d'une race humaine, il faudrait être au-dessus de toutes les races ! Chose impossible car être homme, c'est être déterminé par des caractères raciaux.
Dieu, peut-être, a-t-il son échelle de valeurs. Pas nous.
La science a donc pour mission de trouver la loi qui gouverne la constitution physique et mentale de chaque race. Cette loi particulière renferme également le système de valeurs spécifique, inhérent à cette race. On peut comparer ces systèmes de valeurs : l'échelle de valeurs spécifique à la race nordique, par exemple, peut être comparée à celle de la race méditerranéenne.
Ces comparaisons sont même instructives car toute chose, dans le monde où nous vivons, ne dévoile sa nature que si elle se distingue d'une autre, différente. Mais ces ordres de valeurs ne peuvent être jugés « en soi », à partir d'une axiologie « surplombante » puisqu'une telle axiologie, à notre connaissance, n'existe pas.
Que le Nordique soit nordique et le Méditerranéen méditerranéen ! Car ce n'est que si l'un et l'autre reste lui-même qu'il sera « bon », chacun à sa façon ! C'est la conviction de la racio-psychologie allemande que j'ai l'honneur de représenter, et cette conviction, la politique raciale allemande l'a reprise à son compte : le Bureau de la politique raciale du NSDAP a ainsi fait imprimer et distribuer dans les écoles des planches illustrées où l'on peut lire en gros caractères :
« TOUTES LES RACES SONT UNE VALEUR SUPRÊME »
La deuxième illusion que l'Osservatore Romano voudrait propager est la suivante : pour la science allemande, une race se distinguerait d'une autre par la possession de telles qualités, telle autre race ayant telles autres qualités. La race nordique, par exemple, se signalerait par son discernement, son dynamisme, son sens des responsabilités, son caractère consciencieux, son héroïsme - les autres races étant dépourvues de toutes ces qualités. Il n'est pas niable que de nombreux traités d'anthropologie anciens, dont certains furent rédigés par des Allemands, contiennent ce genre d'affirmations bien peu psychologiques.
Cela dit, ne vaut-il pas mieux consulter un cordonnier pour ses chaussures, un marin sur la navigation et un psychologue plutôt qu'un anatomiste sur les lois de la psychologie ?
Depuis 1921, la racio-psychologie allemande nous enseigne clairement ceci : l'âme d'une race ne réside pas dans telle ou telle « qualité ». Les qualités sont affaire individuelle : untel aura telles qualités, untel telles autres. La qualité « héroïsme » se rencontre sans aucun doute chez de nombreux Nordiques, mais également chez d'autres races. Il en est de même du dynamisme, du discernement, etc... L'âme d'une race ne consiste pas à posséder telle ou telle « qualité », elle réside dans le mouvement à travers lequel cette qualité se manifeste quand elle est présente chez un individu. L'héroïsme d'un Nordique et d'un Méditerranéen peut être « égal », il n'en reste pas moins que ces deux héroïsmes ne se présentent pas de la même façon : ils opèrent de manière différente, par des mouvements différents.
Le procédé parfaitement puéril consistant à rassembler une somme de qualités relevées chez quelques représentants individuels d'une race donnée, disons de la race nordique, et à (faire) croire que c'est dans la possession de ces qualités que réside le fait racial, est à peu près aussi intelligent que de vouloir décrire l'aspect physique de la race nordique, par exemple, en disant : elle a un nez, une bouche, des bras, des mains. Sans nul doute, cette race possède tout cela, et bien d'autres choses encore. Mais toutes les races possèdent un nez, une bouche, des bras et des mains. Ce n'est donc pas là, dans la possession de telle ou telle partie du corps, qu'il faut chercher le fait racial. Ce qui, en revanche, est déterminé racialement, c'est la forme du nez, de la bouche, et la manière dont on s'en sert. Même chose pour la forme des bras, des mains, et la façon dont ils se meuvent. Que l'homme de race méditerranéenne évolue dans l'espace différemment du Nordique, qu'il marche et danse différemment, qu'il accompagne son discours de gestes différents, cela est indéniable, il suffit d'ouvrir les yeux. Quant à savoir quels mouvements du corps, quelle gestuelle, ont le plus de « valeur », ceux du Méditerranéen ou ceux du Nordique, c'est là une question vide de sens. La réponse est : tous les deux, chacun à sa manière, chacun selon son style propre.
Les mouvements du corps sont l'expression des mouvements de l'âme, comme en témoignent le jeu des muscles de la face et les gestes des bras et des mains qui ponctuent l'élocution. Pourquoi le locuteur agite-t-il ses mains de telle façon et non pas autrement ? Parce que le rythme auquel vit son âme lui dicte cette façon-là de remuer les mains. Le style des mouvements de l'âme détermine le style des mouvements du corps, car tous deux ne font qu'un.
Un exemple simple, tiré de l'observation quotidienne, illustrera ce propos : lequel, du Nordique ou du Méditerranéen, est le plus « doué » pour conduire une automobile ? Question, ici encore, vide de sens : ce n'est pas "le" Nordique, ni "le" Méditerranéen, qui a le don de ceci ou de cela, de nombreux êtres humains, appartenant à ces deux races, sont capables de conduire une automobile. Mais les Nordiques le seront d'une certaine manière, et c'est cette manière qui les fera apparaître comme tels. De même, les Méditerranéens le seront à la manière méditerranéenne, et c'est à cela qu'on les reconnaît comme méditerranéens. Voici la différence entre ces deux styles de conduite : le conducteur méditerranéen est maître de l'instant : où qu'il se trouve, il y est dans la perfection achevée du moment présent. D'un mouvement brusque du volant, il abordera un virage à toute vitesse, évitera un obstacle et freinera avec effet immédiat. Plus l'action est folle, dangereuse, plus le jeu sera magnifique. L'automobiliste nordique ne le suit pas sur ce terrain-là : non parce qu'il est piètre conducteur, mais parce que la loi qui préside aux mouvements de son âme et de son corps lui dicte un style de conduite différent. Le Nordique ne vit pas dans ce qui est, il vit toujours dans ce qui viendra : il n'est pas le maître de l'instant, il est le maître du lointain. Il n'abordera pas un virage de façon brusquée, il décrira au contraire un vaste arc de cercle : pour lui, le virage est « beau » s'il l'a prévu et s'il l'accentue le moins possible. Le Méditerranéen affectionne la surprise, l'imprévu : par là, il s'affirme comme le maître de l'instant présent. Le Nordique, lui, essaie toujours de pressentir, de prévoir ce qui va venir, même si cela n'est pas certain. C'est pourquoi il se crée un code de la route pensé jusque dans ses ultimes éventualités - ce qui exaspère le Méditerranéen. Car pour ce dernier, supprimer l'excitation de la surprise, ce n'est pas lui simplifier la tâche !
La troisième erreur que commet l'Osservatore Romano consiste à affirmer ceci : le peuple allemand se confond avec la race nordique, le peuple italien avec la race méditerranéenne. Si ce n'est pas dit explicitement, c'est admis implicitement. Or, le peuple allemand est composé de plusieurs races, parmi lesquelles la nordique prédomine bien sûr, mais elle n'est pas exclusive : il y a du sang méditerranéen dans le peuple allemand.
D'ailleurs, le peuple italien lui-même est constitué de plusieurs races, parmi lesquelles la race méditerranéenne domine certes (du moins dans la moitié Sud de la péninsule) ; mais il y a d'autres apports dans le peuple italien, par exemple beaucoup de sang nordique. Il n'existe pas de frontière raciale rigide entre les deux peuples, ils ont au contraire de nombreux traits communs, y compris au niveau du sang. Cette parenté biologique remonte très loin dans la Rome primitive et a, depuis, été renouvelée par plusieurs apports. Au sein des deux cultures, la germanique et la latine, les lois de la nordicité coexistent avec celles de la latinité mais le résultat en est différent d'une culture à l'autre : ces deux civilisations se sont formées ensemble, au contact l'une de l'autre. La latine est plus ancienne, la germanique plus récente. Laquelle a le plus de valeur, la plus ancienne ou la plus jeune ? Là encore, le problème nous paraît mal posé.
Le piège qui consiste à faire porter le soupçon sur la politique raciale allemande pour semer la méfiance entre peuples amis ne peut aujourd'hui leurrer que les naïfs. Tous les actes de la politique internationale, ou coloniale, viennent corroborer les acquis de la racio-psychologie et confirment son utilité pratique dans les relations avec des peuples différents. Son but n'est pas de séparer les peuples, mais de les rapprocher en fondant entre les divers types humains une compréhension mutuelle éclairée par la science.
Ludwig Ferdinand Clauss, « L’âme des races ».
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, racialisme, racisme, anti-racisme, anthropologie, ethnologie, raciologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 décembre 2008
Pour une nouvelle Ostpolitik

Michael WIESBERG:
Pour une nouvelle “Ostpolitik”
Récemment, les tentatives unilatérales des Etats-Unis d’élargir l’OTAN, en y incluant la Géorgie et l’Ukraine et en contournant de la sorte des décisions antérieures et claires, lancent dans le débat quelques questions fondamentales, appelant les partenaires européens des Etats-Unis au sein de l’Alliance atlantique, dont l’Allemagne, à prendre position dans l’avenir. La situation actuelle suscite avant toute chose la question suivante: comment les relations transatlantiques futures s’agenceront-elles? La Russie ne laisse planer aucun doute: elle considère que l’élargissement de l’OTAN à la Géorgie et à l’Ukraine relève de la pure provocation. Concrètement, nous courrons le danger d’une nouvelle période de gel sinon celui d’une nouvelle Guerre Froide avec la Russie.
Ce glissement vers une nouvelle Guerre Froide ne va pas dans le sens des intérêts européens et allemands, pour plusieurs raisons. Déjà les rapports étaient fort tendus, à cause de la Guerre d’Août dans le Caucase en 2008 et du projet américain d’installer des fusées en Europe de l’est. La Russie considère qu’elle est de plus en plus menacée par l’OTAN et en particulier par les Etats-Unis. Ainsi, le Président russe Dimitri Medvedev déplore dans son discours sur l’état de la nation, tenu le 5 novembre dernier, que l’on s’active à mettre en place “un nouveau système global de missiles anti-missiles” et que la Russie est actuellement “encerclée par des bases militaires”, tandis que l’OTAN tente de s’élargir sans la moindre retenue. Medevedev a ensuite évoqué les contre-mesures russes, qu’il a qualifiées de “contraintes et forcées”. Comme son prédecesseur Poutine, Medvedev a rappelé que le monde “ne peut être dirigé depuis une seule capitale” et a demandé que “l’architecture d’une sécurité globale” soit mise en place, qui engloberait la Russie, les Etats-Unis et l’UE.
Jusqu’à présent, les Etats-Unis ont ignoré froidement ces avances et, pire, ont poursuivi sans sourciller leur politique des coups d’épingle contre les intérêts stratégiques russes. Même les partenaires européens des Etats-Unis ne comprennent guère quels sont les motifs géopolitiques de cette attitude américaine. Expriment-elles le fait qu’une superpuissance comme les Etats-Unis soit soumise à des dynamiques spécifiques qui impliquent “un besoin permanent d’intervention”, ainsi que l’a qualifié le politologue berlinois Herfried Münkler? D’après lui, les Etats-Unis ne pourront réaffirmer leur rôle de superpuissance que s’ils s’avèrent capables de contrôler réellement les “flux de capitaux de l’économie mondiale” et de déterminer “les rythmes de l’économie mondiale”.
De telles capacités sont désormais remises en question, vu la crise financière actuelle. Dans cette optique, un rapport récent (“Global Trends 2025”), émis par le NIC (“National Intelligence Council”), explique que nous sommes au beau milieu d’une phase de transition et que nous nous acheminons vers un “nouveau système” qui s’installera graduellement au cours des vingt prochaines années. Dans ce “nouveau système”, les Etats-Unis demeureront sans conteste le “principal acteur” sur la scène internationale, mais leur position sera “moins dominante” qu’auparavant. Les Etats-Unis, poursuit le rapport, ne pourront maintenir et défendre leur statut que s’ils continuent à jouer un rôle décisif dans “l’espace eurasien”, où vivent les trois quarts de la population mondiale. Ce n’est donc pas un hasard si les principaux challengeurs des Etats-Unis (la Chine, l’Inde et la Russie) se situent justement dans cet espace. Si les Etats-Unis y perdent leur influence, cela reviendrait à perdre leur position hégémonique sur le globe.
Mais dans cette volonté de se maintenir dans “l’espace eurasien”, les Etats-Unis butent contre une difficulté majeure: ils sont là-bas une “raumfremde Macht”, une “puissance étrangère à l’espace”; ils doivent donc se maintenir et s’affirmer sur une masse continentale où ils ne sont pas chez eux et où ils demeurent par conséquent vulnérables. Cette constellation oblige les Etats-Unis à multiplier leurs manoeuvres, à mouvoir constamment leurs pions sur l’échiquier eurasien, selon l’expression du stratégiste Zbigniew Brzezinski, aujourd’hui devenu conseiller d’Obama. Si ces manoeuvres sont souvent dirigées contre la Russie, c’est parce que celle-ci occupe une position centrale sur cette masse continentale eurasienne.
On peut me rétorquer, ici, que la Russie n’est certainement pas la puissance la plus solide de l’espace eurasien et que, dans l’avenir, elle ne pourra guère concurrencer l’UE et la Chine. Le publiciste allemand Hauke Ritz nous explique clairement pourquoi les Etats-Unis sont néanmoins portés à affaiblir constamment la Russie. C’est parce que cette dernière, vu sa position géographique et ses richesses en matières premières, est en mesure de concrétiser des “coopérations inter-eurasiennes”, notamment sous la forme de “relations économiques approfondies” avec l’UE. L’Europe y gagnerait en “indépendance” et, à la longue, cela mettrait en danger l’orientation transatlantique de sa politique depuis 1945.
Cette vision des choses est tout à fait plausible vu la complémentarité de bon nombre d’intérêts européens et russes. Par exemple: l’Europe ne peut pas réellement assurer ses apporvisionnements énergétiques sans la Russie; quant à la Russie, elle a un besoin énorme en technologie européenne. Cette complémentarité inquiète énormément les stratégistes américains, comme l’atteste, entre autres choses, la teneur du dernier livre de Brzezinski, “The Second Chance”, paru en 2007. Il y explique qu’il faut plus ou moins isoler la Russie en scellant des accords avec l’Europe et avec la Chine. La volonté américaine d’élargir l’OTAN encore plus à l’Est correspond pleinement à ces injonctions de Brzezinski, dans le sens où elles débouchent sur un morcellement complémentaire des sphères d’influence russes.
Une telle stratégie vise à créer un système de sécurité dominé par les Etats-Unis et englobant l’ensemble du continent européen jusqu’à ces confins caucasiens. Mais elle ne résussira que si elle reçoit l’aval et le soutien inconditionnels de l’Europe. Or, dans le rapport du NIC, celle-ci est décrite, avec mépris et condescendance, comme “un géant boiteux”, incapable de transformer sa puissance économique en puissance politique. Ce qui n’empêchera pas ce “géant boiteux” de devoir tôt ou tard prendre une position claire: peut-être acceptera-t-il la logique hégémoniste des Etats-Unis mais cela équivaudra à renoncer aux intérêts propres de l’Europe. Or un renoncement pareil ne constitue nullement une option politique valable pour le long terme. Il est donc grand temps que le “géant boiteux” apprenne à marcher droit.
Michael WIEBERG.
(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°50/2008, traduction française: Robert Steuckers).
00:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, russie, allemagne, affaires européennes, europe centrale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le Grand Dérangement des Acadiens
 Le Grand Dérangement
Le Grand Dérangement
La Déportation des Acadiens, ou le Grand Dérangement, est une expression utilisée pour désigner l’expropriation massive et la déportation des Acadiens, peuple francophone d’Amérique, lors de la prise de possession, par les Britanniques, des anciennes colonies françaises en Amérique.
Par le Traité d’Utrecht signé en 1713, la partie la plus peuplée de l’Acadie et ses 1 700 habitants sont cédés à la Grande-Bretagne. 400 soldats britanniques restent sur place et un gouvernement militaire évite à la Grande-Bretagne de devoir créer une législature à majorité acadienne.
La partie cédée à la Grande-Bretagne prend le nom de Nouvelle-Écosse. La France conserve l’Île Royale (aujourd’hui Île du Cap Breton). Les Acadiens tentent de demeurer « neutres » dans les conflits entre les deux métropoles et refusent de prêter le serment d’allégeance au roi de Grande-Bretagne qui est exigé par les autorités coloniales. Cependant, la « paix » franco-britannique est toute relative dans cette région de l’Amérique. La guérilla amérindienne, alliée à la France, est constante : 100 navires capturés par les Micmacs et les Malécites entre 1713 et 1760 en témoignent.
La population acadienne passe de 1 700 en 1713 à plus de 15 000 en 1755. Cependant, les colons britanniques qui affluent après la fondation de Halifax convoitent les terres des Acadiens et réclament une Chambre d’Assemblée comme cela est la règle dans les colonies britanniques, ce que la Couronne n’est pas prête à accorder à une population majoritairement francophone et catholique.
En 1754, la crise éclate avec le début de la 4e guerre intercoloniale (French and Indian War en anglais). Le conflit commence avec des victoires françaises dans la vallée de l’Ohio. La panique gagne les colonies britanniques. Charles Lawrence devient gouverneur de la Nouvelle-Écosse. Il discute avec William Shirley, gouverneur du Massachusetts, de la possibilité de remplacer les Acadiens par des colons anglo-américains.
En 1755, 1 800 soldats de la Nouvelle-Angleterre arrivent en Nouvelle-Écosse. Ce débarquement est suivi de la prise des forts français par le général Monckton. Lawrence confisque les armes des Acadiens. En juin, il rencontre des délégués acadiens et exige d’eux un nouveau serment d’allégeance inconditionnelle en échange du retour des armes. Les Acadiens refusent.
Après la victoire dans la bataille de Fort Beauséjour et la prise de Fort Gaspareaux, en juin 1755, Lawrence ordonne aux commandants de Beaubassin, Pisiquid et Annapolis Royal d’attirer les hommes français de leurs districts respectifs, dans les ports, de les y arrêter et de les y détenir. Des navires viennent les chercher pendant que d’autres troupes vont arrêter les femmes et les enfants chez eux. Les déportés sont divisés par groupes d’âge et de sexe, puis embarqués sur les navires. En tout, de 8 000 à 10 000 Acadiens seront déportés à Annapolis Royal. Le commandant John Hansfield qui avait marié une Acadienne ne suit pas l’ordre mais attend en novembre soit trois mois plus tard pour déporter les Acadiens. Il ne sépare pas les familles. On pense que 20% de la population d’Annapolis Royale a pu s’échapper. Dictionnaire biographique du Canada John Handfield
On les éparpille le long de la côte atlantique. Ils y arrivent sans avoir été annoncés aux autorités locales, qui les considèrent comme une possible « 5e colonne ». Les déportés connaîtront des sorts divers. La Virginie et la Caroline du Nord refusent les 1 500 Français qui restent à bord des bateaux ou sur les plages jusqu’en mai 1756, moment où ils sont expulsés vers l’Angleterre. La traversée est difficile : deux vieux bateaux, le Violet et le Duke William coulent en cours de route. Après trois mois de navigation, les survivants arrivent en Angleterre où ils sont très mal reçus.
Les 1 226 Acadiens survivants sont répartis en 4 groupes, 336 à Liverpool, 340 à Southampton, 300 à Bristol, 250 à Penryn (Falmouth). Commence alors pour eux une détention qui durera 7 ans.
On sait peu de choses sur les conditions de vie de ces Français. À Southampton, ils vivent dans des baraquements sur les quais ; à Liverpool, ils logent dans les ruines d’ateliers de potiers ; à Bristol, où personne ne les attend, ils restent trois jours et trois nuits sur les quais avant d’être parqués dans une vieille bâtisse ; à Falmouth, ils sont un peu mieux traités, des jeunes trouvent même du travail. Ils reçoivent, comme prisonniers de guerre, une somme de 6 sols par jour avec l’obligation de subvenir à leurs besoins.
Pendant tout leur séjour, le gouvernement britannique essaie par tous les moyens de les faire devenir citoyens anglais, mais sans résultats. Le 3 novembre 1762, le Traité de Paris est signé, le calvaire des Français va prendre fin.
En janvier 1763, il ne reste, en Angleterre, que 866 personnes sur les 1 226 débarquées, et de plus il y a eu quelques naissances. Louis XV et Choiseul les font libérer, leur promettant des secours, ainsi que leur installation en France et, surtout, remboursent à l’Angleterre leurs dettes et une partie de leur solde.
En Virginie, la colonie refuse platement de recevoir les 1 500 Acadiens qui, en conséquence, sont expédiés en Angleterre.
En Géorgie, colonie pénitentiaire, ils sont d’abord complètement ignorés et livrés à eux-mêmes, puis tous arrêtés en 1756. En 1763, on leur donne 18 mois pour partir. La plupart émigreront à Saint-Domingue.
En Caroline du Sud, une importante communauté de Huguenots est paniquée à l’arrivée des « papistes ». On les force à rester à bord des navires surpeuplés. Une trentaine réussissent à s’évader. En 1756, on organise une levée de fonds pour payer leur expulsion… vers la Nouvelle-Écosse ! Ils rejoindront les partisans de Boishébert qui lutte contre les Britanniques.
Au Maryland et en Pennsylvanie, on les emploie à divers travaux serviles. Aucun logement ni nourriture ne sont fournis. En 1756, la législature du Maryland adopte une loi qui prévoit la prison pour ceux qui n’ont pas d’emploi. À la frontière ouest, les troupes reçoivent l’ordre de tirer à vue sur ceux qui tenteraient de quitter la colonie. Tout Acadien qui désire s’éloigner de plus de 16 km de sa résidence doit avoir un passeport.
En Pennsylvanie également, le gouverneur Morris place les arrivants sous garde armée. Ils sont décimés par les maladies infectieuses et mis en quarantaine. Confiés aux county townships (juridictions locales) sous la direction du warden of the poor (« Gardien des pauvres », magistrat chargé de s’occuper des indigents), ils s’assemblent dans un bidonville de Philadelphie. On leur refuse du travail, mais on force leurs enfants à fréquenter les écoles anglophones. En 1763, les Acadiens du Maryland et de la Pennsylvanie partent pour la Louisiane. Certains s’arrêteront à Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti) où le gouverneur comte d’Estaing les met aux travaux forcés pour la construction d’une forteresse.
Le New Jersey refuse de recevoir des Acadiens. À New York, on les parque à Staten Island et à Long Island. Environ un tiers sont employés comme indentured servants (servitude à contrat d’une durée limitée). Plusieurs s’évaderont. Finalement, les prisonniers partiront pour Saint-Domingue après le Traité de Paris.
Au Connecticut, ils sont gardés sous surveillance, puis expédiés vers Saint-Domingue en 1763. En 1767, un certain nombre s’installent au Nouveau-Brunswick.
Au moins 2 000 Acadiens arrivent au Massachusetts où une épidémie de variole les décime. Ils ne reçoivent aucune assistance du gouvernement local. En 1756, on les engage comme indentured servants. On interdit aux navires de les engager comme marins. En 1757, on leur interdit de quitter les villes où ils sont assignés à résidence. En 1763, certains partent pour Saint-Domingue, mais la majorité pour le Canada.
Environ 3 500 Acadiens se réfugient en « Acadie française », le long du fleuve Saint-Jean et de la rivière Miramichi (Nouveau-Brunswick actuel) sous la direction de l’Abbé Le Guerne. Beaucoup d’entre eux meurent de faim et de froid durant l’hiver 1756-1757, vu l’impossibilité de pratiquer les industries traditionnelles (pêche, agriculture) pendant la guerre. De plus, entre 1756 et 1758, les autorités de la Nouvelle-Écosse offrent des primes pour les prisonniers acadiens et, moins officiellement, pour leurs scalps. Tous ces camps de réfugiés sont détruits par l’avance des troupes britanniques dans les années qui suivent.
En 1763, la France cède ses colonies américaines à la Grande-Bretagne et le gouvernement britannique donne 18 mois aux Acadiens pour quitter l’Empire britannique et gagner une colonie française.
En 1766, les Acadiens sont officiellement autorisés à s’installer au Québec, où plusieurs s’étaient réfugiés avant 1759, mais, dans les provinces maritimes (ancienne Acadie), les droits politiques leur seront refusés jusque dans les années 1830.
Vers 1766 aussi, d’autres Acadiens, les Cajuns, commenceront à se regrouper en Louisiane, devenue colonie espagnole.
Un peu à la manière de l’Acadie, Belle-Île-en-Mer était occupée par les Britanniques, mais le traité de Paris (10 février 1763), qui donnait le Canada aux Britanniques, a permis à la France de récupérer Belle-Île le 11 avril 1763. Un mois plus tard les Acadiens prisonniers en Grande-Bretagne sont libérés et viennent grossir le nombre des réfugiés dans les ports français.
Plusieurs projets d’installation des Acadiens sont proposés, dont celui de Belle-Île (8 ans avant le projet poitevin). Dès juillet 1763, trois chefs de famille acadiens, Honoré Le Blanc, Joseph Trahan et Simon Granger, se rendent à Belle-Île, afin de juger de la possibilité d’une implantation sur cette île bretonne. Le Baron de Waren, gouverneur de l’île juge ce premier contact positif, « ils ont paru très contents de ma réception et s’en sont retournés le 27. Comme ils sont gens fort industrieux et habiles cultivateurs, je serais enchanté de les voir arriver : ce serait un bon boulevard contre ceux qui les ont maltraités. »
Mais tout n’est pas si rose : les Acadiens, soutenus par l’abbé Le Loutre, veulent rester groupés sur l’île dans une même paroisse, ce qui n’est pas du goût de Waren qui veut au contraire les disperser sur l’ensemble du territoire « afin que tous les habitants ne fassent qu’un seul esprit et qu’un même peuple ». L’abbé Le Loutre, qui a participé à cette première visite, prend les affaires en main et en janvier, il annonce a Waren qu’il a trouvé 77 familles déterminées à s’installer sur l’île. Mais les affaires traînent en longueur, les habitants de l’île ne sont pas très heureux de voir débarquer ces réfugiés, rien n’est prêt, il manque des maisons, il faut commander des chariots, des charrues, du bois, des bœufs, des vaches… C’est l’abbé Le Loutre qui gère tout cela.
En septembre 1765, Granger et Le Blanc sont chargés de préparer l’hébergement des 77 familles, les premières arrivent le 22 septembre, d’autres le 1er octobre, puis le 18 et enfin le 30 octobre. Elles sont logées provisoirement dans « les grands magasins aux avoines » qui sont une halle. Les Acadiens participent aux travaux de construction des maisons, certains, qui étaient marins, embarquent avec des patrons pêcheurs du pays.
Pour arriver à un partage des terres équitable qui tient compte de la composition des familles, de l’origine, de la parenté, des affinités, Isambert à imaginé un système original avec des « lotties » et des « brigades ». Les lotties sont des lots de terres bien précis et numérotés ; les brigades, au nombre de 13, sont constituées de 6 familles, chacune dotée d’un « chef de brigade » chargé de tirer au sort la lottie attribuée à chacune des brigades.
Les Acadiens apportaient dans leurs bagages des pommes de terre qu’ils ont cultivées à Belle-Ile avant son introduction en France par Parmentier en 1769.
La majorité des populations se qualifiant d’acadiennes se trouvent aujourd’hui au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, aux îles de la Madeleine et en Gaspésie (Québec), à Terre-Neuve-et-Labrador, dans le Maine (États-Unis), en Louisiane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Des historiens américains estiment que, sur une population totale évaluée entre 12 000 et 18 000 Acadiens en 1755, de 7 500 à 9 000 périrent entre 1755 et 1763, soit des effets de la déportation, soit en tentant d’y échapper.
Une demande officielle d’un député d’ascendance acadienne du Bloc québécois a été déposée pour qu’il y ait reconnaissance par la Couronne britannique du massacre. Le Gouverneur général du Canada – l’institution représentant aujourd’hui la Couronne canadienne au pays, mais qui, avant le Statut de Westminster de 1931, représentait la Couronne britannique – a pour sa part reconnu la Déportation des Acadiens. En décembre 2003, la gouverneure générale Adrienne Clarkson a reconnu le drame humain de la déportation, mais sans offrir d’excuses formelles. Depuis, le 28 juillet est un jour de commémoration de l’évènement.
Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : canada, amérique, francité, histoire, etats-unis, 18ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Dali par Arno Breker

00:05 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sculpture, art, allemagne, espagne, surréalisme, dali |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Deux livres sur l'Europe

Deux livres sur l'Europe
Herbert KRAUS, «Großeuropa». Eine Konföderation vom Atlantik bis Wladiwostok, Langen-Müller, München, 1990, 147 S., DM 28, ISBN 3-7844-2197-0.
A cause des problèmes en Allemagne de l'Est, de la situation catastrophique de l'économie polonaise, de l'intervention des militaires soviétiques à Vilnius, de la fragilisation de la position de Gorbatchev à Moscou, l'unification grande-continentale, de l'Atlantique au Pacifique, la communauté de destin euro-soviétique est postposée. Cette remise aux calendes grecques d'un processus nécessaire ne doit pas pour autant nous empêcher de réfléchir à son advenance, de la préparer. Herbert Kraus, expert autrichien des questions d'Europe orientale, fondateur du parti libéral autrichien, l'a soulevée dans un livre qui a la forme d'un manifeste et qui appelle à la consitution de la «Grande Confédération». Pour Kraus, ressortissant d'un petit Etat neutre, sis à la charnière de l'Est et de l'Ouest, les Européens doivent préparer l'avènement d'un Etat multiculturel englobant tous les pays d'Europe et l'ensemble du territoire aujourd'hui soviétique. Dans cet immense espace, tous les Européens devraient pouvoir avoir le droit de travailler, de commercer ou de fonder des entreprises. L'heure de l'Etat-Nation, étroit, trop exigu pour les impératifs qui s'annoncent, a sonné. Il doit faire place au «grand espace». Ce processus de méta/macromorphose doit s'accompagner d'un socialisme acceptable pour tous, d'une déconstruction des antagonismes militaristes du passé afin de construire une gigantesque armée confédérative. La Russie a un rôle tout particulier à jouer dans cette évolution: elle doit transformer l'URSS qu'elle domine par son poids en une confédération-modèle que l'Ouest pourra imiter, tandis que les réussites de la CEE en matière d'intégration devront servir de modèles à l'Est. La confédération devra être plus souple, plus soucieuse des tissus locaux, moins centralisatrice en matières économiques. Logiques intégratives et identitaires doivent pouvoir jouer simultanément.
Otto MOLDEN, Die europäische Nation. Die neue Supermacht vom Atlantik bis zur Ukraine, Herbig, München, 1990, 323 S., DM 39,80, ISBN 3-7766-1649-0.
Ancien chef de la résistance autrichienne contre le nazisme, Otto Molden, homme politique et historien, a toujours eu la volonté de forger un «patriotisme européen», reposant sur une interprétation «culturo-morphologique» de son histoire, qui n'est pas sans rappelé Spengler et Toynbee. La disparition du Rideau de fer, pense Molden, va activer la constitution d'une Europe unie et faire d'elle la première puissance culturelle, économique et financière du globe, laissant les Etats-Unis stagner loin derrière elle. Paradoxalement, poursuit Molden, ce sont les dangers venus de la steppe asiatique, les invasions hunniques, avares, magyares et mongoles, qui ont, à certains moments de l'histoire, donné aux Européens l'idée d'une communauté de destin. Pour Molden, l'ère des Etats-Nations, incapables de gérer leurs problèmes de minorités, doit être close. Ces problèmes de minorités doivent être résolus, non seulement à l'Est, mais aussi à l'Ouest (Irlande, Pays Basque), de façon à ce que l'on obtienne une nation constituée de peuples et de citoyens solidaires. Pour organiser ce gigantesque ensemble, il faut inventer une représentation nouvelle, fondée sur le «fédéralisme intégral des communautés de voisinage». Une telle représentation permettra à moyen ou long terme de resouder les tissus sociaux ravagés par la révolution industrielle.
(Robert Steuckers)
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, europe, eurasie, eurasisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 21 décembre 2008
Nous allons vers une nouvelle guerre froide...

Nous allons vers une nouvelle « Guerre Froide »…
Entretien avec le Prof. Dr. Peter Scholl-Latour
Propos recueillis par Moritz Schwarz
Q. : Professeur Scholl-Latour, la Russie réagit fermement au déploiement des missiles anti-missiles américains en Pologne et en République Tchèque ; elle riposte en déployant à son tour des engins balistiques à moyenne portée à Königsberg en Prusse orientale. La Guerre Froide revient-elle au galop ?
PSL : De fait, la réaction russe correspond au modèle classique de la guerre froide, à plus d’un point de vue. Les Russes répondent à ce qu’ils perçoivent comme une provocation américaine. Ils procèdent exactement comme le fit l’OTAN au début des années 80 qui, pour répondre à l’installation des fusées SS-20 soviétiques, avait déployé les Pershing-2 américaines. A cette époque, j’étais rédacteur en chef du « Stern » et, dans la rédaction, le seul à avoir pris position pour le réarmement occidental. C’est pourquoi je comprends bien les Russes aujourd’hui. Mais je reviens à votre question : « La Guerre Froide revient-elle ? ». Je réponds « Non ». Car la nouvelle « guerre froide » n’est pas l’ancienne. Raison pour laquelle j’ai intentionnellement intitulé mon livre « La voie vers la nouvelle guerre froide ».
Q. : Et qu’est-ce qui distingue la nouvelle de l’ancienne ?
PSL : L’ancienne guerre froide était bien plus prévisible que celle que nous vivons aujourd’hui. A l’époque existait un contact permanent entre Washington et Moscou. Quand la situation devenait alarmante, on utilisait le téléphone rouge et on cherchait tout de suite à aplanir la situation. On oublie un peu vite qu’Eisenhower et Khrouchtchev se sont opposés de concert au débarquement insensé des Français et des Britanniques à Suez en 1956, en leur lançant un ultimatum. De plus, n’oublions pas que les Soviétiques, avant d’entrer en Tchécoslovaquie en 1968, avaient préalablement averti les Américains.
Q. : Votre livre est finalement un recueil d’articles, ce qui lui donne un caractère purement descriptif. La pertinence analytique qui caractérise généralement vos travaux semble cette fois absente. Pensez-vous que cela satisfera vos lecteurs ?
PSL : En 2003, quand j’ai dit que la guerre en Irak pourrait se terminer par un désastre, on m’a appelé « le vieux roi des prophètes de malheurs ». Ce que je présente dans mon nouveau livre, c’est l’évolution graduelle de la situation de 2001 à nos jours. Je n’ai pas changé un seul mot dans tous les articles que j’ai sélectionnés pour ce livre : le premier date du 22 octobre 2001, alors que l’offensive contre l’Afghanistan venait de commencer, et le dernier date du 5 novembre 2008, un jour après l’élection d’Obama. Dans ce vaste éventail d’articles, le lecteur pourra aisément constater que l’évolution des choses nous portait bien à la situation actuelle et que tout était donc parfaitement prévisible.
Q. : Le blocus de Berlin en 1948 est considéré comme la « première bataille » de l’ancienne guerre froide. Pour la nouvelle guerre froide, vous considérez que c’est l’attaque américaine contre l’Afghanistan qui constitue le premier acte, même si dans ce conflit, les Etats-Unis ne font pas face à une autre grande puissance…
PSL : La Guerre froide du passé résultait d’une confrontation bipolaire. Aujourd’hui les Etats-Unis ne sont plus la puissance hégémonique universelle. Ils en sont eux-mêmes conscients, comme le révèle d’ailleurs une étude interne des services secrets américains. La principale différence entre l’ancienne et la nouvelle guerre froide réside dans la nature multipolaire de la nouvelle confrontation. Aux côtés des rivaux traditionnels que sont les Etats-Unis et l’Union Soviétique (dont la Russie est l’héritière, ndt), de nouveaux acteurs sont entrés en lice, comme la Chine, l’Inde et le monde islamique. La guerre en Afghanistan témoigne de la nouvelle acuité de la confrontation avec l’islam.
Q. : Est-ce utile de lier les rivalités entre grandes puissances au conflit avec l’islamisme ? Samuel Huntington a forgé, pour ce conflit tout particulièrement, la notion de « choc des civilisations » ; cette notion s’avère-t-elle pertinente pour distinguer ce conflit contre l’islamisme du conflit classique entre puissances, que vous évoquez sous la formule de « guerre froide » ?
PSL : Le 21ème siècle est d’ores et déjà marqué par le parallélisme entre divers conflits. Aujourd’hui, nous nous en apercevons, notamment lors des derniers événements d’Inde, où des islamistes ont défié l’Etat indien en perpétrant le massacre de Bombay. Le terrorisme international, que l’on appelle à Washington la lutte contre « l’islamo-fascisme » alors que je préfèrerais l’appeler la « révolution islamique », est un boulet que doivent traîner tous les « global players ». Dans cette optique, il faut tenir compte d’une chose : ici les véritables acteurs ne sont pas des Etats mais des mouvements insurrectionnels diffus, soutenus par la population, qui prennent de plus en plus souvent des attitudes antioccidentales. En principe, les attentats visent les gouvernements locaux et sont antioccidentaux surtout dans la mesure où l’Occident soutient ces gouvernements. Si l’ancienne guerre froide était une grande affaire planétaire sur laquelle on pouvait encore jeter un regard synoptique, la nouvelle se caractérise surtout par ses imbrications si complexes qu’elles ne sont plus immédiatement perceptibles.
Q. : La confrontation de type classique entre les Etats-Unis et la Russie aura-t-elle encore son point de gravitation principale en Europe centrale ?
PSL : La Russie n’est plus une puissance mondiale capable d’assurer un hégémon comme le fut jadis l’Union Soviétique. Mais elle reste, malgré tout, une grande puissance. Surtout parce qu’elle dispose d’un potentiel nucléaire, qui équivaut peu ou prou à celui des Etats-Unis.
Q. : Les Russes ont envoyé récemment une flotte avec pour navire amiral le croiseur atomique « Pierre le Grand », le principal bâtiment de leur flotte de l’Arctique et le plus grand navire de guerre du monde, au Venezuela. Dans l’avenir, n’y a-t-il pas là-bas le risque d’une nouvelle crise de Cuba ?
PSL : Je ne crois pas qu’on en arrivera là mais, quoi qu’il en soit, les Russes pourront équiper le Venezuela du Président Hugo Chavez d’armes qui ne seront certes pas aussi perfectionnées que celles des Américains mais qui confèreront aux Vénézuéliens un poids militaire important dans la région. N’oublions pas que quelques temps auparavant, les Etats-Unis avaient envoyé des navires de guerre en Mer Noire pour aller cingler face au littoral de la Géorgie. Les Russes ont réagi en adoptant le même mode de comportement. Ce genre d’incident se répétera dans l’avenir jusqu’au jour où les Etats-Unis reconnaîtront qu’ils doivent traiter la Russie comme un partenaire égal.
Q. : L’ex-général américain Wesley Clark a déclaré récemment dans un entretien avec « Junge Freiheit » (Berlin ; n°36/2008) que ces gesticulations russes n’étaient rien d’autre que du « boucan et des hurlements de colère », indices de l’impuissance de Moscou…
PSL : Mouais… je me souviens, moi, du conflit des Balkans en 1999, quand ce général Clark voulait jeter les Russes manu militari hors du Kosovo. Le Général britannique Mike Jackson lui avait rétorqué : « Je ne tolèrerai pas que l’on déclenche ici une troisième guerre mondiale ». La grande erreur du gouvernement Bush a été d’acculer sans cesse la Russie et de susciter de la sorte une animosité permanente à l’endroit de Washington qui, au départ, n’existait pas.
Q. : Vous écrivez également que la nouvelle guerre froide sera marquée par un déclin relatif de la Russie assorti d’un renforcement concomitant de la Chine…
PSL : Dans l’avenir, le véritable adversaire de l’Amérique sera la Chine qui, stratégiquement parlant, deviendra, à partir de 2025, l’égale des Etats-Unis. Les Russes entretiennent certes de bonnes relations avec la Chine, mais ils se sentent néanmoins menacés par l’énorme pression démographique chinoise en Sibérie orientale, surtout dans la province de Primorié, littorale du Pacifique. Cette province connaît actuellement une immigration chinoise massive, comme on l’a toujours craint, mais aujourd’hui la Russie est consciente que ses territoires d’Extrême Orient se dépeuplent à grande échelle (i. e. perdent leur peuplement slave). Face à ce vide démographique se masse le long du fleuve Amour et en Mandchourie une population de 130 millions de Chinois, qui connaît un développement fort dynamique. Les Russes savent que leur déficit démographique —la Russie, avec ses 142 millions d’habitants compte à peine plus de citoyens que la France et l’Allemagne réunies— menace leur statut de grande puissance. Or l’avenir annonce encore un ressac démographique : la population russe perd chaque année 800.000 âmes. L’époque où l’on parlait du « rouleau compresseur » russe, slogan du temps de ma jeunesse, est bien révolue. Ce ressac s’avère d’autant plus dramatique qu’environ 25 millions de musulmans vivent au sein de la Fédération de Russie, appartenant majoritairement aux peuples de souche turque ; ceux-ci ont une croissance démographique en hausse contrairement aux Slaves. Face à ces problèmes russes, l’Amérique à son tour présente des symptômes d’affaiblissement. Pensons à cette tragicomédie qui se déroule actuellement face aux côtes de la Somalie où la marine américaine, si puissante, n’a pu se trouver sur place à temps pour contrer l’action des pirates locaux.
Q. : La caractéristique majeure de l’ancienne guerre froide était d’être une guerre par parties interposées. Ce type de conflits reviendra-t-il avec la nouvelle guerre froide ?
PSL : C’est déjà le cas. Mais on ne les appelle plus de la sorte. Songeons à ce propos au conflit qui vient de secouer le Caucase en août dernier, en opposant la Géorgie à la Russie pour le contrôle de l’Ossétie du Sud. Les Américains avaient déployé 140 conseillers militaires en Géorgie qui auraient pu avertir immédiatement le Pentagone des intentions offensives du Président géorgien Saakachvili. Un simple coup de fil de George Bush à Tbilissi aurait suffi pour mettre tout de suite un terme à l’aventure. Mais les Etats-Unis ont délibérément laissé venir l’épreuve de force.
Q. : Leur objectif est donc bel et bien d’étendre le territoire de l’OTAN à l’Ukraine et à la Géorgie…
PSL : Du point de vue russe, il s’agit ici, une fois de plus, d’une pure provocation. Kiev, la capitale de l’Ukraine, est considérée par l’historiographie russe comme « la mère de toutes les villes russes ». En première instance, les Etats-Unis veulent évidemment placer des oléoducs et des gazoducs, afin d’acheminer directement les richesses en hydrocarbures de l’ancienne Union Soviétique vers l’Ouest sans passer par les territoires russe et iranien. L’enjeu n’est évidemment pas la liberté de la Géorgie, une liberté fort compromise par le régime imposé par Saakachvili. Pour ce qui concerne l’Ukraine, il faut se rappeler que nous avons affaire à un pays profondément divisé. Si les Européens avaient encore une once de courage politique, ils imposeraient à leur allié américain de cesser toute tentative d’expansion de l’OTAN vers l’Est.
Q. : Qu’est-ce que cela signifierait pour nous si l’OTAN s’élargissait à Kiev et à Tbilissi ?
PSL : D’un point de vue militaire, ce serait totalement inutile car la Russie aurait bien des difficultés à lancer une guerre d’agression contre l’Europe.
Q. : Qu’en est-il de la puissance militaire russe ? Et du nationalisme russe ?
PSL : Les Russes ont bien d’autres soucis aujourd’hui pour qu’ils songent à mener une guerre de conquête à l’Ouest. Ils ne peuvent même pas se permettre une telle agression. Ce que nous entendons dans les médias à ce sujet relève d’une pure propagande, bien ciblée contre Moscou.
Q. : Et nous devrions réagir contre les effets de cette propagande…
PSL : A Berlin, nous devrions enfin avoir le courage de dire aux Américains (ce qui irait d’ailleurs aussi dans le sens de leurs propres intérêts) : « Nous ne participons plus ! ». L’Allemagne est un partenaire important de l’OTAN et n’a nul besoin de conserver ses lumières sous le boisseau. Si la Chancelière fédérale avait de bons conseillers, elle coopèrerait étroitement avec la France mais, à l’évidence, entre elle et Sarközy, les rapports sont plutôt tendus.
Q. : Les Etats-Unis n’ont-ils que la seule Russie dans le collimateur en envisageant un tel élargissement de l’OTAN ?
PSL : Non. Il s’agit aussi de créer et de maintenir une tension permanente entre l’Europe et la Russie. Les néo-conservateurs de l’entourage de Bush veulent surtout éviter que ne se créent entre l’Allemagne et la Russie des rapports de bon voisinage, assortis d’une profonde imbrication économique et politique de leurs atouts respectifs. En disant cela, je ne plaide nullement pour un changement d’alliance : nous devons nous garder d’un nouveau Rapallo ou de répéter l’alliance russo-prussienne de Tauroggen ; pour moi, l’Allemagne doit rester orientée vers l’Atlantique ! Cependant, l’Europe et la Russie se complètent naturellement : les Russes disposent des matières premières dont nous avons besoin et nous disposons des infrastructures techniques dont la Russie a besoin pour moderniser les siennes, qui sont dans un état lamentable.
Q. : Peut-on dire que les Américains font un mauvais usage de l’OTAN ?
PSL : D’une certaine manière, oui car l’OTAN, au départ, était une alliance défensive. Les Etats-Unis cherchent désormais à transformer l’OTAN en un instrument de leur politique hégémoniste globale. Nous devrions revenir à l’ancienne et solide politique de sécurité commune qui alliait l’Europe à l’Amérique.
Q. : L’ancienne guerre froide, disait-on, avait été provoquée par les Soviétiques, qui entendaient étendre leur pouvoir à l’Europe occidentale. Si l’on suit aujourd’hui vos analyses, les Etats-Unis portent la responsabilité d’avoir déclenché la nouvelle guerre froide.
PSL : Le gouvernement de Bush porte de lourdes responsabilités à ce niveau. Que cherchait-il, par exemple, en pratiquant sa politique constante de coups d’épingle contre la Chine, politique à laquelle participent d’ailleurs les Allemands ? Les présidents Clinton et Bush Senior se sont montrés bien plus flexibles face à la Chine. La situation actuelle provient tout entière des errements idéologiques des néo-conservateurs et de la cupidité insatiable des consortiums américains du pétrole, qui cherchent à s’emparer des hydrocarbures d’Asie centrale. L’Amérique, en ce domaine, a sauvé l’honneur car sa presse est bien plus critique à l’égard de cette politique agressive des pétroliers et des néo-conservateurs que notre propre presse allemande, qui, victime d’un éclairage historique fallacieux, considère encore et toujours que les Américains sont les vainqueurs et les libérateurs de 1945.
Q. : Beaucoup placent de grands espoirs en Obama. Sera-t-il le Richard Nixon ou le Jimmy Carter de la nouvelle guerre froide, c’est-à-dire le président qui tentera de remplacer la confrontation par la coopération ?
PSL : Obama se trouve dans une situation incomparablement plus difficile que ses prédécesseurs Nixon ou Carter. S’il est intelligent, il comprendra que Moscou et Washington font face aux mêmes forces ennemies. Ainsi, nous avons les forces de la révolution islamique, que tant la Russie que les Etats-Unis considèrent comme une menace. Un jour viendra peut-être où la confrontation avec l’islamisme militant partira des républiques autonomes musulmanes du Daghestan ou du Tatarstan pour ne pas évoquer la Tchétchénie qui n’est que temporairement pacifiée. La situation actuelle est donc préoccupante parce que ni à Washington ni à Berlin on n’envisage ni n’ébauche de contre-mesures appropriées pour cette nouvelle forme de guerre froide. A Berlin, nous ne trouvons personne de nos jours qui soit capable d’énoncer une conception cohérente et définitive en matière de politique étrangère ou de stratégie. La guerre froide d’antan avait, elle, ses règles fixes et les plans défensifs de l’alliance atlantique contre l’Union Soviétique s’inscrivaient dans un cadre bien défini. A l’époque, cela paraissait tout naturel que les Etats-Unis gardassent le leadership militaire. Aujourd’hui, les intérêts respectifs de l’Europe et de l’Amérique sont tout au plus parallèles : ils ne sont en tout cas plus identiques. Le Président Obama se voit obligé de faire d’abord face à la catastrophe économique dans laquelle son pays est plongé. Mais il devra également envisager une refondation complète de l’alliance et au moins annoncer à ses adversaires qu’il est prêt à dialoguer.
(entretien paru dans « Junge Freiheit », Berlin, n°50/2008 ; trad. franç. : Robert Steuckers).
00:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, europe, etats-unis, affaires européennes, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ein Konzept, das der Wirklichkeit widerspricht

Ein Konzept, das der Wirklichkeit widerspricht
„MenschInnen“-Autorin Barbara Rosenkranz im ZZ-Gespräch über Hintergründe, Einfluß und Folgen der „Gender-Mainstreaming“-Ideologie sowie über mögliche Gegenmaßnahmen
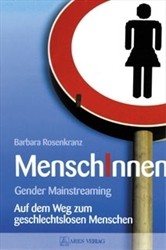
Frau Landesrat, was hat Sie dazu bewogen, das Buch „MenschInnen“ zu schreiben?
Barbara Rosenkranz: Es ist wichtig, daß die Gleichberechtigung der Frauen auf einer soliden, rationalen Grundlage argumentiert wird. Denn ich schätze vernunftbezogene Argumentationen und halte es für gefährlich, auf einer sehr zweifelhaften theoretischen Grundlage die notwendige Gleichberechtigung der Frauen zu verfechten.
Wenn man sich die Reaktionen auf Ihr Buch anschaut, so wurde unter anderem behauptet, es finde eine Umschreibung der Wirklichkeit statt. Trifft dieser Vorwurf nicht eigentlich auf die „Gender Mainstreamer“ zu?
Rosenkranz: Ich habe mich erfolgreich bemüht – es hat bis jetzt keinen sachlichen, inhaltlichen Widerspruch gegeben – alle meine Argumente durch Zitate und Belege aus den Aussagen und Schriften der Gender-„ExpertInnen“ zu stützen. Ich behaupte nichts, was nicht zu beweisen ist.
Warum ist das Gender Mainstreaming eine zweifelhafte theoretische Grundlage?
Rosenkranz: Der Kernsatz, mit dem sich feministische Bewegungen darstellen, aus denen das „Gender Mainstreaming“ hervorgeht, ist der über engere Kreise hinaus bekanntgewordene Satz von Simone de Beauvoir: „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“. Daß dieser Satz falsch ist, sagt nicht nur der Augenschein, sondern das bestätigen mittlerweile auch die Humangenetik und die modernen Neurowissenschaften. Natürlich ist Biologie nicht Schicksal, aber Biologie muß der Ausgangspunkt jeder Diskussion sein.
Den „Gender Mainstreamern“ wird vorgeworfen, einen neuen Menschen schaffen wollen. Trifft dieser Vorwurf zu?
Rosenkranz: Es ist so, daß die Gender-Theorie behauptet, daß zwischen dem biologischen Geschlecht und der Geschlechterrolle – dem „Gender“ – keinerlei Zusammenhang besteht, und daß deshalb jeder Mann oder jede Frau das soziale Geschlecht, „Gender“, frei wählen kann. Das ist eine neue Idee, die leugnet, wovon wir vernünftigerweise immer ausgegangen sind, nämlich, daß das biologische Geschlecht natürlich auch die Geschlechterrolle prägt.
Was bezwecken Ihrer Meinung nach die Befürworter des Gender Mainstreaming?
Rosenkranz: Daß Gender Mainstreaming nicht nur ein Programm für Frauen ist, sondern für die Veränderung der Gesellschaft insgesamt, und auch mit den Männern einiges vorhat, können Sie in allen Texten lesen, die „Gender-ExpertInnen“ veröffentlichen. Wahrscheinlich wollte man wohlmeinend dafür sorgen, daß keinerlei Diskriminierung passiert. Aber man muß Diskriminierung vermeiden, ohne daß man sich auf eine mehr als fragwürdige Grundlage begibt. Und zum anderen ist es das Bestreben – und das zeigt jetzt die Besetzung der Ministerien in Österreich sehr deutlich – Frauen völlig unabhängig von ihrer Mutterrolle zur Verfügung zu haben, was sich auch mit den Wünschen einer Wirtschaft deckt, die sehr kurzfristig denkt. Jetzt haben wir in Österreich kein eigenes Familienministerium mehr, sondern nur mehr ein Familienstaatssekretariat, und das wurde – was ein klares Signal ist – auch dem Wirtschaftsministerium zugeordnet.
Im Regierungsprogramm kommt dreimal das Wort „Gender“ vor, und auch auf EU-Ebene gibt es unzählige Gender-Programme. Diese Ideologie ist doch eigentlich schon sehr weit fortgeschritten und konnte schon sehr viele Bereiche für sich vereinnahmen können.
Rosenkranz: Das ist auch das Ziel und die erklärte Absicht. „Mainstreaming“ bedeutet, dass eine Strategie auf allen Ebenen, von der obersten Organisationsebene – ich meine Brüssel – bis hinunter zur Bezirksverwaltungsbehörde, und in allen Bereichen, vom Bundesheer bis zum Gesundheitsministerium, durchgezogen wird. Daher muß die Genderperspektive in allen Bereichen und auf allen Ebenen berücksichtigt werden.
Welche Strategien können bzw. sollten eigentlich gegen das Gender Mainstreaming unternommen werden?
Rosenkranz: Das wichtigste ist, eine öffentliche Diskussion über dieses Thema zustandezubringen. Das war auch der Anstoß für mein Buch, denn es ist ja eine eigenartige Sache, daß ein Konzept, das alle Bereiche prägen soll und muß, das rechtlich in Verträgen verankert ist, der Bevölkerung weitgehend unbekannt ist. Und ich halte es für notwendig, daß darüber zumindest eine breite Debatte zu führen ist, wenn das absolut nicht umstoßbare Ziel der Gleichberechtigung durch ein weiterreichendes und auch völlig daran vorbeigehendes Konzept abgelöst werden soll, wie es beim Gender Mainstreaming der Fall ist.
Glauben Sie, daß die Gender-Ideologie dahingehend erfolgreich sein wird, einen neuen Menschen zu schaffen?
Rosenkranz: Es ist ganz offenkundig, daß der Mensch als Mann und Frau besteht. Es wird nicht möglich sein, das zu ändern, auch wenn es der abgetretene Sozialminister (Erwin Buchinger, Anm.) in einem Interview mit dem Magazin „Profil“ gesagt hat. Er wurde vom „Profil“ ein bißchen ungläubig gefragt, „und wie wollen Sie nun die Geschlechter abschaffen“ und hat geantwortet: „Das biologische Geschlecht wird bleiben, als soziales Konstrukt verschwindet es. Abgesehen von der kurzen Phase des Kindergebärens sehe ich keine Unterschiede. Grundlage für soziales Verhalten ist die Gleichstellung.“ Man hat also vor, hier wirklich ein völlig anderes Rollenbild zu schaffen. Aber gelingen im positiven Sinn kann es nicht, weil es völlig gegen die Wirklichkeit gerichtet ist. Allerdings kann man gewaltige Zerstörungen anrichten.
Welche Zerstörungen wären das?
Rosenkranz: Sie brauchen sich nur anzuschauen, was unter dem Titel „geschlechtssensible Pädagogik“ praktiziert wird: Daß nämlich in öffentlich geförderten Kindergärten Mädchen ein sogenanntes weibliches Verhalten nicht zeigen dürfen und daß sie statt dessen angeregt und ermuntert werden, ein sogenanntes männliches Verhalten – Kratzen, Beißen, Raufen – anzunehmen und sie dafür gelobt werden.
Umgekehrt werden Buben für ein solches Verhalten bestraft und zu einem völlig anderen Verhalten angeleitet. Ihnen bringt man Massagekörbe und ermuntert sie dazu, in Prinzessinnenkleidung zu schlüpfen und ihre Nägel zu lackieren.
Gender Mainstreaming ist eben nicht ein Förderprogramm für Frauen, sondern hat, wie man in den theoretischen Schriften nachlesen kann, auch mit den Männern einiges vor. Einer der Pioniere auf dem Gebiet der sogenannten Burschenarbeit sagt es auch ganz deutlich: „Das Ziel ist nicht ein anderer Junge, das Ziel ist gar kein Junge.“ Das sollten wir unseren Kindern nicht zumuten.
Das Gespräch führte Bernhard Tomaschitz.
00:20 Publié dans Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : féminisme, femmes, political correctness, manipulations médiatiques, gender studies, actualité, sociologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Breve glossario delnociano
BREVE GLOSSARIO DELNOCIANO
http://patriaeliberta.myblog.it
Breve glossario delnociano: conservazione, reazione e tradizione

Mi permetto di sottoporvi una breve nota terminologica a chiarimento ed esposizione dei concetti di conservazione, reazione e tradizione, tratta da A. Del Noce, I caratteri generali del pensiero politico contemporaneo, vol. I. Lezioni sul marxismo (Giuffrè, Milano 1972). Secondo il filosofo torinese questi concetti vanno assolutamente mantenuti distinti.
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, politique, théorie politique, italie, conservatisme, réaction, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 décembre 2008
Noël, fête religieuse et familiale, non orgie consumériste
Noël, fête religieuse et familiale, pas orgie consumériste…
 La période de Noël est un moment idéal pour tester la solidité de ses convictions et la cohérence de ses engagements politiques, notamment sur les questions de l’écologie et de l’anti-consumérisme.
La période de Noël est un moment idéal pour tester la solidité de ses convictions et la cohérence de ses engagements politiques, notamment sur les questions de l’écologie et de l’anti-consumérisme.
« Dis moi ce que tu reçois et fais comme cadeaux, je te dirais quel type du militant tu es ! » pourrait être la devise planant au dessus des têtes de tous ceux qui prétendent avoir une conscience politique et sociale.
En effet, à l’heure où l’armada publicitaire est en ordre de marche pour tirer le maximum de bénéfices de la course aux jouets et aux gadgets qu’est devenu le mois de décembre dans les sociétés occidentales, l’attitude du militant identitaire doit être clairement et concrètement en rupture avec cette névrose matérialiste totalement vide de sens.
Loin des brillantes conférences et des articles enflammés, voici venu les jours qui offrent à chacun, à sa place et à sa mesure, l’occasion de mettre en application les principes de mesure, de frugalité, de souci environnemental et de simplicité volontaire.
Il ne s’agit nullement bien sûr de prôner un froid ascétisme mais d’en appeler au bon sens, au raisonnable et à l’éthique.
Dans notre approche des « cadeaux » (qui, rappelons-le, ne sont pas le « but » ni le « cœur » des fêtes de Noël mais simplement un agrément secondaire à celles-ci), un souci constant de cohérence et de morale doit nous accompagner et nous conduire fort loin des gadgets aux composants électroniques ultra polluants, des inutilités clinquantes et dispendieuses, des marques vestimentaires esclavagistes, des pseudo « nouveautés » imposées par le matraquage médiatique… Offrons au contraire du beau, de l’artisanal, de l’utile, du porteur de sens, du sain et de l’éthique. Nous poserons ainsi les actes, modestes mais impérieux, de notre cohérence qui est la première marche de la crédibilité.
Rappelons également que Noël est aussi le temps de la charité et de l’offrande et que très nombreux, des sans abris de SDF aux enfants serbes du Kosovo en passant par l’habitant du feu rouge qui tend la main le long des voitures indifférentes, sont ceux qui en ont besoin.
Identité, Solidarité, Action. Dans les petits gestes, comme dans les grands…
P.Chatov pour Novopress France
00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noël, fêtes, consommation, consumérisme, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Ernst Mayr wird 100
| |
|
Von Martin Lohmann (http://konservativ.de )
Kaum eine andere naturwissenschaftliche Lehre hatte einen vergleichbaren revolutionären Einfluß auf das moderne Weltbild wie die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Ihr zufolge sollen alle Lebewesen, und somit auch der Mensch, nicht durch einen göttlichen Schöpfungsakt ins Dasein gekommen sein, sondern durch eine Ansammlung zufälliger Mutationen, die durch anschließende natürliche Selektion im "Kampf ums Dasein" zu einer steten Höherentwicklung allen Lebens aus gemeinsamen Vorfahren führten. Diese auch als Darwinismus bezeichnete Lehre entzog dem Christentum jede naturwissenschaftliche Basis; der Mensch brauchte sich dadurch mit allen Konsequenzen für die bis dahin geltenden Moralbegriffe in seinem Handeln nicht länger einer ihm übergeordneten Instanz verantwortlich fühlen. Darwins im 19. Jahrhundert entwickelte Evolutionstheorie wies jedoch gravierende Schwächen auf. So ging Darwin von einer allmählichen langsamen Entwicklung der Arten mit vielen Zwischenstufen aus, was sich seiner Hoffnung zufolge auch bald im Fossilbericht bestätigen ließe. Die Paläontologen haben diesen Ansatz jedoch bis heute nicht bestätigen können: neue Arten tauchen urplötzlich auf, zwischen den Stufen einzelner Entwicklungslinien klaffen riesige Lücken. Die gesuchten Bindeglieder, die "Missing Links", sind bis heute unauffindbar. Das Verdienst, diesen Widerspruch zwischen Darwins Theorie und dem paläontologischen Befund beseitigt zu haben, wird dem Evolutionsbiologen Ernst Mayr zugeschrieben, der diese Woche 100 Jahre alt geworden ist. Der am 5. Juli 1904 in Kempten geborene und 1931 in die USA ausgewanderte Mayr war in den 1940er Jahren maßgeblich mitbeteiligt an der Formulierung der inzwischen allgemein akzeptierten "Synthetischen Evolutionstheorie", einer Präzisierung des Darwinismus. Ihr zufolge verlaufen Mutation und Selektion in einem schnellen Tempo in kleinen, geographisch geschlossenen Einheiten, so daß sich von diesen "Gründerpopulationen" keine versteinerten Überreste auffinden lassen. Profan ausgedrückt wird der Inzest zum Motor der Evolution erhoben. Mit dieser These gelang es Mayr zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: zum einen überbrückte er ein entscheidendes Problem im Darwinismus, zum anderen entzog er ihn hiermit jeder Beweispflicht. In einem evolutionskritischen Buch verriss der Journalist Reinhard Eichelbeck Mayrs These der "Gründerpopulationen": "Abgesehen davon, daß Inzucht normalerweise genetische Defekte hervorruft und keine Verbesserungen, die einen Vorteil im 'Kampf ums Dasein' darstellen könnten, ist dies eine Beweisführung, mit der man alles beweisen kann. Wenn ein theoretisches Konstrukt, das auf nichtvorhandenen Indizien aufgebaut ist, als wissenschaftliche Tatsache gehandelt wird, dann ist dieses Denkmodell offensichtlich auf dem Niveau angekommen, wo sich die Wissenschaft vor Darwin befand: auf dem Niveau des dogmatischen biblischen Schöpfungsmythos." Mit anderen Worten: mehr als 150 Jahren nach Darwin haben auch Mayrs Forschungen nichts daran geändert, daß es der Evolutionstheorie an einem ordentlichen Fundament fehlt. Bis heute kann sie natürliche Phänomene wie beispielsweise die Entstehung des Auges oder des genetischen Code nicht zufriedenstellend rekonstruieren. Ernst Mayr ficht derartige Kritik bislang nicht an, er nimmt sie nicht einmal zur Kenntnis. In der Vermessenheit der eigenen geistigen Vollkommenheit hält er jeden, der an die "Tatsache" der Evolutionstheorie zweifelt, für "ungebildet". Bescheidenheit ist ihm fremd. Wenn ihn die Fachwelt als "Darwin unserer Zeit" feiert, nimmt er derartige Huldigungen gerne an. Aus seinem Mund wird erst deutlich, wie weitreichend der Einfluß des Darwinismus selbst das Denken der Durchschnittsmenschen geprägt hat: "Die moderne Anschauung geht in fast allen Bereichen irgendwo auf darwinsche Gedanken zurück." Dennoch formiert sich Widerstand. In Abkehr vom früheren klerikalen Dogmatismus entwickelte eine Anzahl ernstzunehmender Wissenschaftler das Konzept des "intelligenten Design", welches die Entstehung der Arten mit naturwissenschaftlichen Methoden unter Verzicht auf religiöse Quellen einem Schöpfungsakt zuzuschreiben versucht, wobei die Identität des "Designers" bewußt offengehalten wird. Die Vertreter dieses Modell grenzen sich ebenso gegen den "Kreationismus" ab, dessen in wortwörtlicher Interpretation des biblischen Genesis-Berichts entworfenen Vorstellungen eines Schöpfungsaktes in sechs Tagen und einer erst 10 000 Jahre alten Erde sie scharf ablehnen. Während das intelligente Design“ in den USA recht erfolgreich ist, wird es hierzulande heftig bekämpft. Erst im vergangenen Jahr sorgte der Kasseler Biologe Ulrich Kutschera für die Kaltstellung des am Kölner Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung tätigen Genetikers Wolf-Ekkehard Lönnig. In einer als inquisitorisch zu bezeichnenden Kampagne erreichte der Darwinist Kutschera, daß Lönnig auf Weisung der Institutsleitung seine Internetseiten, in denen er für das "Intelligente Design" warb, vom Server des Instituts löschen mußte. In dieser Kampagne im Sinne der "biological correctness" kamen nicht nur Kampfbegriffe wie "pseudowissenschaftliche Ideologie" und "christlicher Fundamentalismus" gegen Lönnig zu Einsatz, auch sein Bekenntnis als Zeuge Jehovas wurde auf unsachliche Weise gegen ihn verwandt. Letztlich blieb die Freiheit von Forschung und Lehre auf der Strecke. Niemand macht in den Naturwissenschaften Karriere, wenn er nicht vorbehaltlos die Evolutionstheorie akzeptiert. Lönnig sieht in dieser Kampagne den Beweis dafür, daß die Evolutionstheorie "ein totalitär geschlossenes philosophisch-naturalistisches System" ist, weil es von vornherein "jeden wissenschaftlichen Ansatz für Intelligentes Design a priori und absolut ausschließt". Ebenso heftig kontrovers diskutiert wurde im April in Italien der Plan der Bildungsministerin Letizia Moratti, im Unterricht des Landes dem christlichen Schöpfungsmodell den Vorrang einzuräumen, obwohl selbst der Papst in der Evolutionstheorie "mehr als eine Hypothese" sieht. Unter dem Druck zahlreicher italienischer Wissenschaftler, die in einer Petition den Plan als schädlich für die wissenschaftliche Kultur kommender Generationen“ bezeichneten und davor warnten, daß mit der Ignorierung der Evolutionstheorie die wissenschaftliche Neugier der Jugend angeblich untergraben werde, nahm sie ihr Vorhaben kleinlaut zurück. In solchen Kulturkämpfen entlarvt sich die Evolutionstheorie als ein im naturwissenschaftlichen Gewand ummantelter Mythos, der die Grundlage für den modernen Atheismus bildet. Wo die Christen Gott am Werke sehen, ersetzen ihn die Darwinisten durch die "Natur". Ihren Siegeszug verdankt die Evolutionstheorie dem Umstand, daß sie Generationen von Schülern als "Tatsache" indoktriniert wurde, oftmals unter dem Vorwand der Trennung von Kirche und Staat. Ihr Fundament beruht nicht auf einer rationalen Überprüfung standhaltenden Beweisen, sondern auf einem rein materialistisch ausgerichteten Glauben. Mit seinem Beitrag hat sich der "Hard-Core-Darwinist" Ernst Mayr zum obersten Hohepriester dieses atheistischen Mythos gemacht. Weiterführende Literatur: 1. Philip E. Johnson Darwin im Kreuzverhör Christliche Literaturverbreitung Bielefeld ISBN: 3-89397-952-2 2. Reinhard Eichelbeck Das Darwin-Komplott - Aufstieg und Fall eines pseudowissenschaftlichen Weltbildes Riemann Verlag ISBN: 3-570-50002-0 3. Reinhard Junker / Siegfried Scherer Evolution - Ein kritisches Lehrbuch Weyel Biologie ISBN: 3-921046-10-6 |
00:05 Publié dans Sciences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : biologie, évolution, darwinisme, sciences biologiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Erwin Guido Kolbenheyer
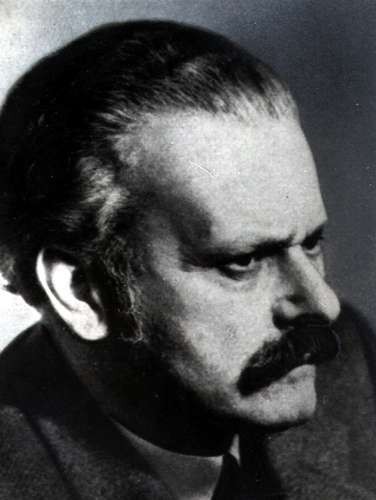
Erwin Guido Kolbenheyer (1878-1962)
Robert Steuckers
Né le 30 décembre 1878 à Budapest, Erwin Guido Kolbenheyer, poète, dramaturge et philosophe, voit le jour dans le foyer d'un célèbre architecte austro-hongrois. Orphelin dès 1881, il s'installe avec sa mère à Karlsbad, dans le pays des Sudètes, où il fréquente le Gymnasium. En 1900, il part à Vienne pour y étudier la zoologie et la philosophie, notamment sous la tutelle des professeurs Hatschek et A. Stöhr. C'est avec l'appui de ce dernier qu'il acquiert son titre de docteur en philosophie en 1904. Mais il renonce à toute carrière universitaire pour se consacrer entièrement à sa poésie, ses drames et ses romans. En 1925, il fait paraître une première version de son ouvrage philosophique majeur, Die Bauhütte, qui sera définitivement achevé en 1940. Honoré de plusieurs prix, il continuera à ¦uvrer jusqu'à sa mort, survenue le 12 avril 1962. Dans toute sonoeuvre, tant philosophique que poétique ou romanesque, Kolbenheyer pose des héros qui incarnent l'être le plus profond de l'homme germanique, caractérisé par un élan vital sans repos; partant, ses héros recherchent, infatigables et tragiques, une connaissance, une puissance, un absolu, un idéal, un dieu, eux-mêmes. Son Paracelse, par exemple, est toujours en errance, toujours à la recherche de la connaissance suprême; dans ce cheminement interminable, Paracelse, précurseur de Faust, s'éloigne toujours davantage de l'Eglise et de ses lois. Il cherche, dans la foi, une liberté totale et, en Dieu, le repos éternel, sans jamais trouver ni l'une ni l'autre. Chacun des volumes de sa trilogie paracelsienne est précédé d'un dialogue entre le Christ et Wotan et contient plusieurs dialogues entre Paracelse et un représentant de la "vieille culture" classique, désormais incapable d'étancher la "soif métaphysique" des hommes. A un représentant de la Curie romaine, venu en Allemagne pour enquêter sur les progrès de la Réforme, Paracelse reproche de défendre des formes, figées et raidies, sans contenu, sans substance. Le Réforme est, aux yeux de Kolbenheyer, le retour de l'humanité germanique à la substance vitale, au-delà des formes figées, imposées par l'Eglise de Rome. Dans l'¦uvre de Kolbenheyer, resurgissent tous les débats de la réforme et de la renaissance, de l'humanisme et de la nouvelle vision du cosmos (celle d'un Giordano Bruno notamment), autant de Schwellenzeiten, d'époques-seuil, où il est impératif d'adapter l'esprit au temps. Pour notre auteur, l'histoire de la pensée européenne est marquée par l'opposition entre, d'une part, un dynamisme adaptatif/mouvant/plastique, ancré dans un humus populaire précis, et un statisme absolu rigide, immobile et planant au-dessus de l'oikos des hommes. Spinoza, Paracelse, Giordano Bruno, le personnage de Kolbenheyer Meister Joachim Pausewang, sont des représentants du dynamisme. Les églises et les dogmes, religieux ou laïques, sont des éléments de statisme, des cangues dont il faut sortir.
L'atelier. Eléments pour une métaphysique des temps présents (Die Bauhütte. Grundzüge einer Metaphysik der Gegenwart) 1925-1952
Idée centrale de cet ouvrage philosophique de Kolbenheyer: l'humanité, fascinée par les absolus postulés par les métaphysiques désincarnées, ne parvient plus à s'adapter aux impératifs des temps présents. Ceux-ci exigent une métaphysique souple, plastique, sans forme systématique définitive. L'homme a besoin de métaphysique pour s'orienter dans l'avalanche de données que lui communique le monde. La métaphysique lui sert de fil d'Ariane. Sans elle, il tâtonne. Les métaphysiques classiques ont toutes été des systèmes qui se voulaient définitifs et absolus, qui avaient pour but d'ordonner les idées, les connaissances et les valeurs humaines selon une idée centrale, généralement une conception de Dieu ou du monde, issue d'un état particulier d'adaptation de l'homme au monde dans un contexte spatio-temporel déterminé mais révolu. Mais quand le monde change sous la pression des événements, quand le changement provoque à l'échelle européenne une "crise de conscience", les métaphysiques classiques, de Pascal à Leibniz et à Rousseau, s'effondrent. On tente de les remplacer par l'idée du Moi, l'idée de la matière ou l'idée de l'esprit, l'idée de la collectivité ou l'idée du rien (nihilisme), sans se rendre compte que ces idées n'ont pas de contenu réel correspondant au nouvel état d'adaptation de l'humanité. Pire: ces idées sans contenu réel ont servi à construire des systèmes que l'on a posé comme définitifs, alors que la vitesse des changements, donc la nécessité vitale d'adaptations rapides successives, impliquait de se débarrasser de toute espèce de rigidité.
Question majeure que pose Kolbenheyer: qu'est-ce que la pensée? Elle est 1) l'intégration consciente de tout ce que nous vivons dans le monde de la conscience et 2) le fait de compléter, de classer et de construire sans cesse ces diverses sensations. Le siège de ce processus d'intégration, de complétement, de classification et de construction est le cerveau humain, conditionné par une biologie et une hérédité précises. Ce site, différent d'une multitude d'autres sites analogues, exclut la croyance naïve et dépassée en un esprit d'essence indépendante. Ces déterminations du siège de la pensée, c'est-à-dire du cerveau, lié à d'autres cerveaux par le jeu infini et kaléidoscopique du code génétique, se heurtent à des résistances continuelles qu'il faut vaincre, dépasser ou contourner. Les communautés de cerveaux unies par un même code génétique, lequel est variable à l'infini, produisent des idées directrices qui font montre d'une certaine durée dans l'histoire. Ces idées directrices sont métaphysiques, selon Kolbenheyer, car elles transcendent les individualités qui les incarnent plus ou moins bien. La métaphysique, de cette façon, est descendue de l'au-delà dans le monde réel. Les données du problème de la métaphysique sont les hommes, les hommes dans la vie et la vie dans les hommes et non pas un au-delà quelconque auquel il s'agit d'arriver, non pas un absolu fixé d'avance, indéterminé et indéterminable auquel l'homme doit adapter sa vie. La métaphysique est de ce fait "un point parfait d'adaptation intérieure et extérieure de l'homme" qui, nécessairement, diffère d'un individu à l'autre, d'un peuple à l'autre. De cette définition différenciée à l'infini de la métaphysique découle un dépassement de l'idéalisme et du rationalisme; ces systèmes faisaient de la pensée un "cadre" sans contenu. Pour Kolbenheyer, la pensée est et cadre et contenu en interaction ininterrompue. La pensée est ainsi à la foi force absorbante et force créatrice et n'a de valeur et d'importance que si elle remplit ce double rôle.
L'horizon de la pensée est, chez Kolbenheyer, celui de la "vie plasmatique", qui n'est pas un être en soi supérieur auquel les formes d'individuation sont subordonnées; il n'existe pas d'être plasmatique en dehors des formes d'individuation, ce qui n'empêche pas de penser à un rapport originel et générateur entre les formes d'individuation sur le plan de l'évolution générale. Ce qui existe en tant que vie, est de la vie différenciée, de la vie en train de s'adapter. Kolbenheyer dégage les lois de la "plasmogénèse" c'est-à-dire de l'individuation du plasma et de sa conservation dans les individus; le plasma adapté (c'est-à-dire l'individu) ne peut être ramené à un degré d'individuation par lequel il a passé précédemment; la part de plasma dont les capacités ne résistent pas par l'adaptation au changement des époques géologiques cosmiques disparaît. La substance vitale, le plasma, est répartie entre tous les peuples de la terre. Pour parfaire leur rôle historique, pour créer des formes culturelles viables et sublimes, pour exprimer les potentialités de ce plasma qui leur est échu, les peuples épuisent graduellement leur capital en plasma. Les peuples jeunes sont ceux qui disposent encore d'une grande quantité de plasma non transformé en formes. Plus la quantité de plasma résiduel est importante, plus la vitalité du peuple est intense. Les peuples trop encombrés de formes ont terminé leur cycle et se retirent petit à petit de la scène du monde.
De cette vision biologico-mystique, Kolbenheyer déduit une éthique individuelle répondant à une maxime paraphrasant Kant: "Agis toujours de façon telle, que tu puisses être convaincu d'avoir fait par tes actions le meilleur et le maximum pour que le type humain, dont tu es issu, puisse être maintenu et se développer". L'individualité est, dans cette optique, "exposant de fonction"; il est une modalité de l'adaptation au réel du donné plasmatique. Par conséquent, ne sont immortelles que les prestations de l'individualité qui ont accru les capacités adaptatives du plasma. De la maxime énoncée ci-dessus et de cette notion d'immortalité des prestations, découle une éthique du devoir. L'individualité doit maintenir et développer la vie, au-delà de sa propre existence individuelle, et mettre en ¦uvre, dans ce but, toutes ses énergies. L'individu en soi, dans la perspective kolbenheyerienne, n'existe pas car tous les hommes sont reliés au paracosmos, et ont ainsi en commun bon nombre de traits supra-individuels; de plus, l'individualité, au cours de son existence, change et est appelée à jouer des rôles différents: celui de l'enfant, puis celui de l'époux, du père, celui que postule sa fonction sociale, etc. Il y a différenciation constante, ruinant toute rigidité posée comme en soi. On a parlé de l'¦uvre philosophique de Kolbenheyer comme d'un "naturalisme métaphysique" (R. König) ou d'un "matérialisme biologique" (E. Keller).
(Robert Steuckers).
- Bibliographie non exhaustive; nous ne reprenons que les ouvrages littéraires de Kolbenheyer ayant un intérêt philosophique; une bibliographie complète, établie par Kay Nieschling, se trouve dans Peter Dimt (cf. infra); par ailleurs, le lecteur pourra s'adresser à la Kolbenheyer-Gesellschaft e. V., Schnieglinger Straße 244, D-8500 Nürnberg, pour tout renseignement sur l'auteur. Cette société édite également un périodique d'exégèse de l'¦uvre d'EGK, intitulé Der Bauhütten-Brief.
Giordano Bruno, 1903 (tragédie); Die sensorielle Theorie der optischen Raumempfindung, 1905 (thèse); Amor Dei, 1908 (roman sur Spinoza); Meister Joachim Pausewang, 1910 (roman où intervient la figure de Jakob Böhme); Montsalvach, 1912; Die Kindheit des Paracelsus, 1917 (premier tome de la trilogie paracelsienne); Wem bleibt der Sieg?, 1919; Das Gestirn des Paracelsus, 1922 (tome 2); Die Bauhütte. Grundzüge einer Metaphysik der Gegenwart, 1925 (première version); Das dritte Reich des Paracelsus, 1926 (tome 3); Heroische Leidenschaften, 1929 (nouvelle mouture de Giordano Bruno); Aufruf an die Universitäten, 1930 (discours); Das Gesetz in dir, 1931 (théâtre); Die volksbiologischen Grundlagen der Freiheitsbewegung, 1933 (essai); Gregor und Heinrich, 1934 (pièce de théâtre mettant en scène le Pape et l'Empereur et les valeurs qu'ils incarnent); Unser Befreiungskampf und die deutsche Dichtung, 1934 (discours); Der Lebensstand der geistig Schaffenden und das neue Deutschland, 1934 (discours); Arbeitsnot und Wirtschaftskrise biologisch gesehen, 1935 (article); Das gottgelobte Herz, 1938 (roman avec pour thème la mystique allemande); Der Einzelne und die Gemeinschaft, 1939 (discours); Goethes Denkprinzipien und der biologischen Naturalismus, 1939 (discours); Die Bauhütte, 1940 (nouvelle version); Das Geistesleben in seiner volksbiologischen Bedeutung, 1942 (discours); Menschen und Götter, 1944 (tétralogie dramatique); Die Bauhütten-Philosophie, 1952 (troisième édition, complétée de textes nouveaux); Sebastian Karst über sein Leben und seine Zeit, I, 1957 (autobiographie); Sebastian Karst über sein Leben und seine Zeit, II & III, 1958 (autobiographie, suite); Metaphysica viva, 1960; éditions posthumes: Wem bleibt der Sieg?, 1966 (anthologie comprenant le texte de 1919 portant le même titre); Vorträge, Aufsätze, Reden, 1966 (‘uvres complètes, 2/VII); Die Bauhütte, 1968 (4ième éd.); Mensch auf der Schwelle, 1969; Du sollst ein Wegstück mit mir gehn, 1973 (anthologie); Gesittung. Ihr Ursprung und Aufbau, 1973; Kämpfer und Mensch. Theoretischer Nachlaß, 1978; Rationalismus und Gemeinschaftsleben, 1982. Les ‘uvres complètes, publiées à l'initiative de la Kolbenheyer-Gesellschaft, sont parues entre 1956 et 1969.
- Sur Kolbenheyer: Conrad Wandrey, Kolbenheyer. Der Dichter, der Philosoph, Langen/Müller, Munich, 1934; Franz Westhoff, E.G. Kolbenheyers Paracelsus-Trilogie - eine Metaphysik des deutschen Menschen, Thèse, Münster, 1937; Ernst Heinrich Reclam, Die Gestalt des Paracelsus in der Dichtung. Studien zu Kolbenheyers Trilogie, Thèse, Leipzig, 1938; H. Vetterlein, "Kolbenheyer-Bibliographie", in Dichtung und Volkstum (Euphorion), 40, 1939, pp. 94-109; E. Fuchs, Das Individuum und die überindividuelle Individualität in Kolbenheyers historischen Romanen, 1940; Franz Koch, "E.G. Kolbenheyers Bauhütte und die Geisteswissenschaften", in Dichtung und Volkstum (Euphorion), 41, 1941, pp. 269-296; H. Seidler, "Kolbenheyer über die Dichtkunst", in Dichtung und Volkstum (Euphorion), 41, 1941, pp. 296-321; Paul Lespagnard, "Erwin Guido Kolbenheyer", in Bulletin de l'Ouest, Bruxelles, 15 avril 1942, 2, pp. 18-20; Paul Lespagnard, "L'oeuvre de E.G. Kolbenheyer. La "Bauhuette"", in Bulletin de l'Ouest, Bruxelles, 15 nov. 1943, 20, pp. 230-233 et 30 nov. 1943, 21, pp. 241-244; St. R; Townsend, Kolbenheyers Conception of the German Spirit and the Conflict with Christianity, 1947; H.D. Dohms, Die epische Technik in Kolbenheyers Roman "Das gottgelobte Herz", 1948; Franz Koch, Kolbenheyer, Göttinger Verlagsanstalt, Göttingen, 1953; Robert König, Von Giordano Bruno zu E.G. Kolbenheyer, Kolbenheyer-Gesellschaft, Nuremberg, 1961; A.D. White, The Development of the Thought of E.G. Kolbenheyer from 1901 to 1934, 1967; Otto Schaumann, Die Triebrichtungen des Gewissens, Orion-Heimreiter, Francfort s.M., 1967; Ernst Frank, Jahre des Glücks. Jahre des Leids. Eine Kolbenheyer-Biographie, blick + bild, Velbert, 1969 (principale biographie de l'auteur; avec 95 ill.); Ernst Keller, "Der Weg zum deutschen Gott: E.G. Kolbenheyer", in Ernst Keller, Nationalismus und Literatur, Francke, Berne/Munich, 1970; Robert König, Der metaphysische Naturalismus E.G. Kolbenheyers, Kolbenheyer-Gesellschaft, Nuremberg, 1971; Robert König, Ein Gedenkblatt zu seinem 10. Todestag am 12. April 1972, Kolbenheyer-Gesellschaft, Nuremberg, 1972; Alain de Benoist, "Paracelsus: roman d'Erwin Guido Kolbenheyer", in Nouvelle Ecole, 29, 1976, pp. 126-131; Robert Steuckers, "Le centenaire de Kolbenheyer", in Pour une renaissance européenne, Bruxelles, 27/28, 1979, pp. 270-276; Herbert Seidler, "Erwin Guido Kolbenheyer", in Neue Deutsche Biographie, Band 12, Duncker u. Humblot, Berlin, 1980; Peter Dimt, Schlederloher Teestunde. Vierzig Anekdoten um Erwin Guido Kolbenheyer, Türmer, Berg, 1985 (avec bibliographie complète des ¦uvres de EGK); Hedwig Laube, Von Erwin Guido Kolbenheyers Ethos aus Naturerkenntnis, Kolbenheyer-Gesellschaft, Nuremberg, 1985; Hedwig Laube, Religion in Kolbenheyers Werk, tiré à part édité par la Kolbenheyer-Gesellschaft, Nuremberg, 1989; Karl Hein, "Er hieß Kolbenheyer und schuf den biologischen Sozialismus für das 21. Jahrhundert", in Elemente, Kassel, 4, 1990.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, allemagne, autriche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook