Editor’s Note:
This is the transcript by V. S. of Richard Spencer’s Vanguard Podcast interview of Jonathan Bowden about the Frankfurt School and Cultural Marxism, released on February 16, 2012. You can listen to the podcast here [2].
Richard Spencer: Hello, everyone, and welcome back to Vanguard! And welcome back, Jonathan Bowden, as well, my partner in thought crime! How are you, Jonathan?
Jonathan Bowden: Yes, pleased to be here!
RS: Well, I mentioned thought crime. That’s quite an apt term for the subject of discussion this week and that is cultural Marxism, critical theory, and the Frankfurt School. Those are, of course, three distinct things, but they’re obviously interrelated as well and I think they can be discussed as one.
Jonathan, to get the discussion started I think it’d be a good idea to look at cultural Marxism historically and ask where it’s coming from and, in particular, what was the milieu like in interwar Germany where so many of these figures like Adorno and Benjamin and Horkheimer arose.
JB: Yes, I think you’ve got waves of feminism, as we discussed in a previous podcast, and now you’ve got waves of Marxism or waves within waves. Marxism, when it started out of course, had a lot of cultural theory attached to it, and Marx was heavily influenced by utopian socialist theory early on in the so-called Paris Manuscripts and that sort of thing. That was all junked, and Marxism became a heavily economically-concentric discourse, very reductive economically. An alleged science, now regarded 150 years on from those events as a sort of pseudo-science. This remained in play into the early stages of the 20th century, and Marxist parties tended to replicate that at a lower sort of political level.
But in and around the First World War with Gramsci’s ideas, which he wrote down in The Prison Notebooks when he was interned, a type of cultural discourse began to emerge whereby Gramsci had the idea that the superstructure and the base of society were disconnected so that things could exist at a cultural level which were not totally economically determined and couldn’t be held completely to be economically managed. Also, in order to discuss them you needed a wide field of reference.
Partly this was the desire of frustrated intellectuals who wanted to use Marxism. They also wanted to discuss culture, which was their abiding source of interest, but it was also an attempt to broaden the appeal of Marxian ideas. In the ’20s and ’30s in Germany, schools of writers began to emerge that were only concerned with man and society, in John Plamenatz’s term, and were not concerned really with econometrics or economic determinism at all and were only Marxian in this newfangled way and had a heavily theoretical take on life.
I remember a Marxian deconstructionist lecturer once telling me 30 years ago that the bourgeois goes to life with common sense but the Marxist with his theory. This theoretical overload whereby everything in life has to be theorized and every text that one comes across has to be subjected to critical analysis or critical theory gave rise to this school that was concerned with the examination of literary texts, with cultural anthropology, with sociology, with social psychology, with adaptations of most of the social sciences to life and were only vaguely concerned with economics.
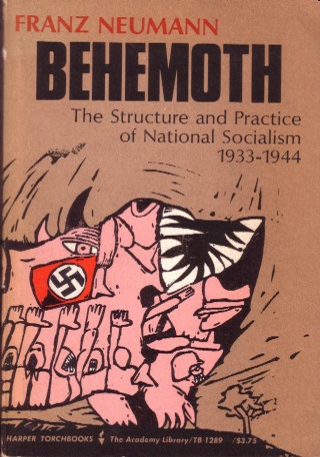 For instance, Franz Neumann’s large book, Behemoth, which is a Marxian analysis of the economics of National Socialist Germany, was one of the few works of economics that was ever written that came out of the Frankfurt School. Most of it was concerned with cultural critique and critical cultural theory involving very outlandish areas such as sociology of music, which was a particular area of Adorno’s concern.
For instance, Franz Neumann’s large book, Behemoth, which is a Marxian analysis of the economics of National Socialist Germany, was one of the few works of economics that was ever written that came out of the Frankfurt School. Most of it was concerned with cultural critique and critical cultural theory involving very outlandish areas such as sociology of music, which was a particular area of Adorno’s concern.
RS: Let me jump in here and mention a few things. It’s worth pointing out that the Marxist project had failed on its own terms by the 1930s in the sense that Gramsci – and I think that some of his writings weren’t really known until much later in the ’50s – was put in prison by Fascists. In Italy, the Fascists had won, and they had defeated a lot of the Marxist parties. They had some proletarian support, I’m sure, and things like this. The whole Marxian project and economic determinism of capitalism creating these contradictions that create some sort of apocalyptic scenario and the proletariat rises up, that really hadn’t happened.
And also with Frankfurt School members, at least ostensibly they were highly critical of what the Soviet Union had become. The Soviet Union wasn’t really it. It wasn’t the utopia. It was maybe something they deemed a perversion.
So, those were certainly important factors, and also it’s worth pointing out that if we’re talking about the Frankfurt School milieu of Adorno and Benjamin you had people that probably weren’t that interested in economics. Benjamin, some of his great writings are on 19th-century culture in one book, but aphoristic writings about life in the modern age, and certainly Adorno was sort of a classical music snob. He was very interested in Beethoven and something like that.
Anyway, it’s a very interesting milieu that all of this came out of. But anyway, Jonathan, maybe you can talk about two things. Where was it going and what was really the essence of their cultural project?
JB: I think the essence of their cultural project was to revolutionarily change the way in which Western culture was thought about and received. So, it was a grandstanding ambition, at any rate. It was to totally change the way in which Western culture was perceived by those who had created it and by those who were the receptors of its creation. I think this involved, basically, an attempt to go back to the theory that pre-existed the French Revolution, because the big book by Horkheimer and Adorno, Dialectic of Enlightenment, is really about the pre-revolutionary theories and is a critique of the Enlightenment from the Left, not the Right.
But they begin by going back, as radical theorists always do, to first principles and criticize the Enlightenment. Their criticism of the Enlightenment is essentially that it is an attempt by scientific man or would-be scientific man to place himself at the heart of the universe to dominate nature and in so doing enact an enormous revenge. The great theory about Fascism in Dialectic of Enlightenment by Adorno and Horkheimer is that Fascism represents the revenge of a violated nature and is the revenge of a sociobiological current that would not exist if there weren’t attempts to entrap nature within the nexus of progress.
So, already you’re getting a strange idea here. You’re getting a sort of anti-progressive Leftism. You’re getting Leftism which is critical of capitalism and modernity whereas classical Marxism is extraordinarily in favor of capitalism and modernity but just wished to succeed it with another state: socialism and late modernity.
RS: Right. Or hypermodernity.
JB: Hypermodernity, yes.
RS: Well, let’s talk a little bit about this because, as we were talking about off-air when we were first thinking about doing a podcast on this, the mainstream conservative movement, at least in America, is actually somewhat familiar with the Frankfurt School. At least, its intellectuals are and they think they know it as the source of the 1960s and political correctness and so on and so forth. But I always feel that I don’t recognize Cultural Marxism in the way that it’s often depicted by movement ideologues.
So, let’s talk a little about this, put a little pressure on the idea of Enlightenment and dialectic of enlightenment. One of the key scenes, if you will, in that book, which I guess is worth reading but it’s an extremely difficult text to read . . . Just as an aside, I met this German when I was in graduate school and he mentioned that he only read Adorno in English translation because even in the original German language it’s extremely dense.
 But anyway, Adorno and Horkheimer aren’t just seeing that Fascism is some reaction of capitalist forces against the Communist wave or something like that. They’re seeing Fascism as coming out of a bourgeois world, and they’re seeing something really wrong at the heart of bourgeois modernity, and I think they picture this in the form of Odysseus who wants to be bound at the mast and is going to renounce man’s more natural being and instead embrace a stern, hard modern man. There’s a world to be made, and we’ve got to go build it.
But anyway, Adorno and Horkheimer aren’t just seeing that Fascism is some reaction of capitalist forces against the Communist wave or something like that. They’re seeing Fascism as coming out of a bourgeois world, and they’re seeing something really wrong at the heart of bourgeois modernity, and I think they picture this in the form of Odysseus who wants to be bound at the mast and is going to renounce man’s more natural being and instead embrace a stern, hard modern man. There’s a world to be made, and we’ve got to go build it.
So, maybe talk a little more about this concept of enlightenment on the part of Horkheimer and Adorno and how this led to a kind of New Left. One that might even have some conservative tendencies in the sense of the abuses against nature.
JB: Yes, it’s an odd one actually, because it’s a sort of would-be foundational Leftism strongly influenced by Hegel, strongly influenced by the early Marx, strongly influenced by Plekhanov who taught Lenin a lot of his Marxism and was a Menshevik, technically, strongly influenced by Gramsci, whose texts would have been known to Marxian intellectuals at that time, and strongly influenced by the “culture of critique,” you could say.
Instead of seeing the Enlightenment as progressive, they see the Enlightenment as an Endarkenment, as a period that’s propriety to bourgeois revolutions which may not be entirely progressive and were afflicted with terror. So, they have a differentiated appreciation of these things. They also have to find the enemy somewhere else, because if the enemy is not really as classical Marxism depicted it and its alleged revolution led to Leninism and Stalinism they have to find their enemy somewhere else, and the enemy for the New Left influenced by the Frankfurt School is alienation. Alienation from modernity, alienation from culture which is capitalist in its predicates, alienation from what they call the culture industry, whereby modern man is totally trapped within the cultural space created by the economy and where there is no room at all for, in conservative terms, folk-based authenticity.
They would never use those sorts of terms, of course, and they would consider them to be reactionary, hubristic terms, but because there is a cultural pessimism, particularly about the cultural life of the masses under capitalist economics and even under socialist economics in the Eastern Bloc to a lesser extent, there is an opening out to vistas of cultural conservatism. This is the Frankfurt School’s inner secret.
I remember professor Roger Scruton, the conservative intellectual, about 25 years ago now included conservative features of the Frankfurt School under one of the headings of cultural conservatism in his dictionary of political philosophy and this caused a little bit of a stir.
But when you look at the fact that, although they sort of found Wagner rather loathsome in relation to what they regarded it as leading to, the classical sort of Schumann, Schubert, Mozart, Beethoven, Bruckner, sort of icons of Germanic, Middle European culture are exactly the icons that in particular they are the most in favor of. Just as classical Marxism is in favor of bourgeois politics and revolutionism over and against the mercantilism and semi-feudalism that preceded it as it looked to the socialism that it thought was going to replace it, they are in favor of radical bourgeois subjectivity epitomized by Beethoven, in their view, and his symphonies, which proclaims the sort of seniority of the bourgeois subject at a moment when the bourgeois subject feels itself to be empowered and all-conquering and the fleeting identification of the meta-subjectivity of the subject that Beethoven accords Napoleon Bonaparte, as he sees him to be an embodiment of the will of bourgeois man.
All of these ideas are there in Adorno’s sociology of music, which is in some ways a sort of Marxian cultural appreciation of great Western icons which could be considered as slightly rueful and slightly conservative with a small “c.” It’s as if he arrives at certain tentative cultural conclusions which are themselves outside of the nature of the theory which he’s allegedly espousing. He’s certainly not alienated by these sorts of musicologists at all.
The point, of course, is that they are the springboard for the modernist experiments of Schoenberg, Webern, and Berg, but that was a radical thing to say when they said it. That’s now regarded as an old hat statement in classical musical criticism. But that’s what they were with Mahler as an intermediary. Mahler between Bruckner and Schoenberg. That sort of thinking and a rejection of Sibelius, who was insulted quite severely by Adorno and the adoration of early to late Schoenberg as the future of music. This became the standard repertoire. The irony is it’s in culture that that theory had its most direct impact. Politically, they’ve had very little impact. It’s in the politics of culture that they’ve not conquered the board but they entered the fabric of what now exists at university level.
RS: Yes, I agree. Even in the fact of criticizing Wagner, the fact that you treat him as this major figure that must be confronted is way reactionary and has conservative tendencies. I mean, I don’t see anyone in the contemporary conservative movement to have much interest in these Romantic titans at all in that sense.
Let’s talk a little bit about the Frankfurt School’s journey to America. It’s quite an interesting one. The Frankfurt School was almost entirely Jewish. I don’t know if there were actually any exceptions to that. There might be.

JB: No, there aren’t. It’s unique in that sense. It’s almost stereotypical. Adorno was half Jewish, and a few of the others were this and that, but basically yes they were almost in toto.
RS: Right. And not only were they Jews but they were Marxists, so needless to say they weren’t accepted in the Third Reich, although they weren’t really directly . . . I guess the Frankfurt School was shut down. I don’t think any of them were, at least personally, persecuted. I know Adorno was even traveling back to Germany on occasion at that time. But anyway, they did move and they went to America and there was actually a kind of exile community in which I believe Schoenberg and Thomas Mann and Theodor Adorno were all living together in a Los Angeles suburb or something like that. It’s quite interesting!
But they also were received, ironically, by the elite. A lot of the Frankfurt School members actually worked for the OSS, which would eventually become the CIA during the Second World War, and they were also getting grants. I believe Adorno got a Rockefeller grant working at Columbia University. They definitely had a reception by the more elite American opinions.
Was it the Rockefeller grant that actually sponsored The Authoritarian Personality?
JB: Yes, that’s right.
RS: Yeah. So, let’s talk a little about this, the next stage of their journey when they became Americans.
JB: Yes, the American stage was interesting because in many ways it contradicts the pure theorizing that they were into, because, although they were given grants and cultural access by these people and seen as sort of honorific rebels against Fascism who had to be supported in the war of ideas, they had to change and water down their theory. They also had to adopt a lot more empirical studies, which was anathema to people like Adorno who hated empiricism. But, of course, empiricism is the Anglo-American way of looking at things. They had to adapt or die, basically. They had to adapt and they had to come up with theoretically-based nostrums that could lead to epidemiological testing and criminological types of testing and almost tick-box forms which ended in the slightly reductive program known as the pursuit of an authoritarian personality with this notorious F-Scale. F for Fascism.
Many of these tests are regarded as slightly embarrassing now and are quite redundant and also not very much used, because although certain people do have more authoritarian casts of personality than others it’s not really a predicate for political positioning because there’s all sorts of hard social democratic positions and authoritarian far Left positions, for example.
RS: Right.
JB: Which go with more authoritarian character structure and don’t align into the F-Scale which these people would like to make out.
However, they were very influential in the rebuilding of Germany after the Second World War, and this is where their theory enters into the mainstream in many ways, because one of their great points is, “What do you do in a democratic society with all the institutions of control, with all the valences of state and other forms of oppressiveness?” as they would see it: the military-industrial complex, the people who work in the security services, the people who work analyzing information on behalf of those services, the people who work in the large prisons and psychiatric environments that exist in all societies, particularly in Western societies?
They always had the view that these people needed to be watched in a way and needed to be prevented from having some of the natural affinities that they would otherwise have if you let them outside of the remit of your theory. This idea that you almost watched the authoritarian gatekeepers in society for signs of “incorrectness” has entered into the mainstream. Very much so.
RS: Yes, I agree that the conservative movement, the mainstream view of the Frankfurt School, that view is really one of Adorno and The Authoritarian Personality. That’s where their criticism really fits, but of course there’s so much more. But that’s certainly a way where you see critical theorists most directly attacking normal bourgeois people. If you have some, what we might call, healthy patriotic opinions that’s high up on the F-Scale.
JB: That’s right, yes.
RS: So, I think in some ways The Authoritarian Personality is probably Adorno and the rest of them at their most cartoonish or something, and it’s not really the most interesting.
JB: That’s right, and there’s a sort of theory by explicators of that school, like Martin Jay and others, that what they’re well known for, such as the F-Scale and so on which was really a concession to their friends and to the people that were giving them grants because what really interested them was this extraordinarily elaborate theory whereby everything in life, particularly in cultural life, was theorized in books like Negative Dialectics by Adorno and Aesthetic Theory, which was unfinished at his death and dedicated to Samuel Beckett, and his support for elements of the avant-garde in the counter-culture during the 1960s, which is a perverse Marxian support because it’s not based on the fact that it’s radical and that it’s coming from the age and that it’s countering that which exists formally, although there’s a little bit of that.
The reason he supports these things is that he believes that the cultural industry is so monolithic, the culture of entertainment and the degradation of the masses is so absolute that only in these little fissures and these tiny, little spaces which are opened up by the critical avant-garde, who often deny easy understanding and deny mediation and deny the audience the collateral of a closure at the end of a piece so that people go away happy or satisfied and that sort of thing, what they are doing is opening a space for genuine culture to exist. That’s why he dedicated it to Beckett, you see.
So, underneath a lot of this theorizing there is a pessimistic despair, a sort of morphology of despair, and that’s very unusual for a Leftist position. It’s usually associated with a Spenglerian, conservative cultural disdain and pessimism for the degradation of the masses under all forms of life and that wish the life of culture could extend and be deeper and be more transvaluated than it is.

RS: Right. You know, this is all quite interesting and at the risk of pushing this Adorno as conservative idea too far, actually recently there was a book of his music criticism. I guess not too recent. It was a book of translations and probably published in 2004 or so. I remember reading it, and he had an interesting essay where he in some ways rethought Wagner and had many positive things to say about Wagner. Believe it or not, he actually had positive things to say about Houston Stewart Chamberlain in the sense that Houston Stewart Chamberlain was a racialist thinker, a god of the far Right, racialist Right, and he said that he saw that one of his reactions against the culture of England and his Romantic embrace of Germany was a kind of reaction against the tyranny of industrialization and that he imagined a more unalienated, authentic world in Germany and that almost these Right-wing strivings were that reaction against capitalism or something. So, again, there is a lot of complexity to all these people and they’re not easily pigeon-holed.
I do want to talk about the 1960s, but before that let’s just put a little more pressure on the culture industry because I think that’s a very useful term for us. I think that’s a term we should be using and maybe even using it in a lot of the same ways that Adorno did. But maybe just talk a little bit more about that idea of the culture industry, what it is, and what Adorno was seeing in mid-20th century America.
JB: Yes, he basically had the idea that the masses were totally degraded by a capitalist and market-driven culture whereby from advertising through to popular cinema to the popular television that was beginning and that would replace cinema and add to it and was an extension of it you have a totally seamless environment in which the masses live which today would be characterized by the popular internet, by the big TV channels, by MTV, by pop music videos, by pop music in all of its various forms.
Don’t forget, Adorno was extraordinarily scathing about jazz, which is regarded as deeply unprogressive and his disgust and distaste for jazz is almost visceral.
RS: Racist!
JB: Yes, almost. In contemporary terms and the terms of the New Left, there is this sort of despairing mid-20th century Viennese intellectual who despises the culture of the masses and that comes very close to an elitist position. It may be a Left-wing elitist position, but it’s an elitist position nonetheless, and once you admit elitism in any area, even if it’s only the cultural one, cultural selectivity, you begin to adopt ramifications elsewhere that are unstoppable.
Although he could never be seen as a neo-conservative figure — these are people who believe that the family is a gun in the hands of the bourgeoisie and that criminality is directly proportionate to its punishment — in other words, you get more criminality because you punish people who are only victims anyway — so don’t forget, these are the sorts of conceits that the Frankfurt School believes in, but the very complexity of their analysis alienates them from populist Left-wing politics and alienates them from easy sloganeering, which is why they’ve been taken up by intellectuals and yet not by mainstream Leftist political movements because their work is just too difficult, it’s too abstruse, it’s too obsessed with fine art and high culture, particularly musical but also in the cinema.
Going back to an analyst called Kracauer in the 1920s, the intellectual analysis of Weimar cinema and expressionist cinema at that was very important to them and they saw that time of cinema’s use of the unconscious, as people would begin to call it later in the century after Freud’s cultural influence, led them into slightly interesting and creative cultural vistas that are not simple and are not reducible to political slogans, but they do ultimately tend to a type of rather pessimistic ultra-Leftist postmodernism.
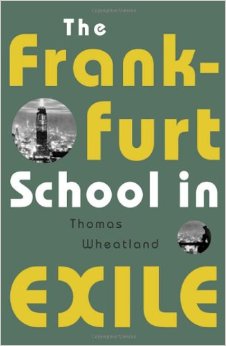
RS: Yes. Well, let’s talk about the 1960s and the New Left and the hippies and the ’68 violent protests and so on and so forth.
What do you think the connections are between the two of them? I know that supposedly — I wasn’t there, of course — in Berkeley in 1968, they were chanting, “Marx, Mao, Marcuse!” Herbert Marcuse was, of course, from the same milieu as Adorno. He was a Hegelian professor and had an upper bourgeois Jewish background. He remained in America. Adorno would return to Central Europe, but he remained, and he is writing books like Eros and Civilization that were a kind of Marxian-Freudian liberation philosophy kind of thing that the future was about polymorphous perversity. These kinds of things. And certainly very different from Adorno’s more kind of fastidious bourgeois nature.
So, what are the connections between the youth movement of the 1960s and the Frankfurt School? Because in some ways it’s strange bedfellows. It’s different generations. The hippies and anti-war protestors probably couldn’t spell Hegel. A very wide gulf between the people like Adorno and these new kids. So, what are the connections? Do you think as the conservative movement would like to believe that the Frankfurt School were kind of the prophets of sick 1968 or is it a little more difficult?
JB: They are and they aren’t. I think that what happened is intermediate theorists emerged who are not as complicated and whose work could be assimilated to political struggle and sloganeering.
Marcuse is that example. Marcuse wrote several books, the most prominent of which is One-Dimensional Man and Eros and Civilization. One of which is a full-on Left-American attack on modern corporate America, where he anathematizes what will come to be known as the military-industrial complex and what was called the welfare-warfare state whereby welfare is paid in order to keep the masses bedded down and at the same time the perfect society is always engineered out of existence by endless wars in the Second and Third World which are always for the prospect of peace, but the peace never arrives, and there’s always just another war just around the corner, and, of course, the wars are to make profits for the military-industrial complex which is increasingly considered to be the most advanced capitalist part of America in which the political class is totally embedded.
RS: Right. So, what you’re saying is that they were absolutely correct.
JB: Of course, there are many similarities on the other side politically, because Harry Elmer Barnes edited a very large volume called Perpetual War for Perpetual Peace, which is very similar from a revisionist sort of school whether isolationist or American nationalist or American libertarian. The people who contributed to that book had a very similar analysis to the one that Marcuse would have of American foreign policy.
Of course, this was occurring in the era of the Cold War when the threat was seen to be the Soviet Union and, to a lesser extent, Maoist China and by arguing for pacifism and isolation you’re arguing for Communist victory elsewhere in the world by the logic of power politics. That’s how Cold War warriors and anti-Communists would have responded to the Marcuse front.
But Marcuse enabled Frankfurt School-related ideas to be politically assimilated by the growing forces of the student New Left, and that’s why they used him as the theorist of choice, because he’s exportable in student terms. He also put himself forward as a student leader, at least theoretically, something which the other Frankfurters were too fey and too theoretical and too abstract and abstruse ever to do. They never would have thought students would listen to their lectures even if they were talking Marxian analysis. Adorno, of course, died as a result of a student action in Germany in the late 1960s when the podium was stormed by some action front hippies or yippies who embraced Adorno — whether they had flowers in their hair, metaphorically, I’m not too sure — and they chanted that as an institution “Adorno is dead,” and Adorno collapsed and had a heart attack relatively soon afterwards and died.
RS: Oh gosh.
JB: This is taken as a sort metaphorization in a way that despite his sort of would-be leadership role of the theorist in relation to these people they were two different universes and the Frankfurt School intellectuals were deeply shocked actually that the West German popular press, particularly the center Right press, held them responsible morally for the emergence of terrorist organizations in West Germany, such as the Baader-Meinhof which later morphed into the Red Army Faction or RAF.
It’s only, of course, come out retrospectively during the latter stages of the Cold War and after the wall came down that the Stasi when the traditional sources of power in East Germany were heavily behind the RAF gave them military expertise and explosives and told them which sites to attack and so on, so that they were as much an extension of the oldest parts of the old Left as they were of the newest parts of the New Left.
Nevertheless, theorists are not always insightful about how the world will use their theory and the Frankfurt School is a classic example of ivory tower intellectuals who partly get a little bit broken up and mangled on the wheel of history.
But Marcuse is an intermediate speaker who the student Left are able to make use of because they can understand what he’s saying. Adorno and Horkheimer and Löwenthal are too abstract, basically. They’re on their own as theorists.

RS: Yeah. Jonathan, to bring the discussion to a close, what do you think is the legacy of these thinkers? In some ways, this is a very big question, because I’m also kind of asking what is the legacy of the New Left and all of this and what is political correctness today. What does it mean and how is it connected with these 20th-century Marxisms?
JB: Yes, this is a difficult one because it’s so diffuse. Yet what I think has happened is they’ve changed the entire temperature which existed, particularly at the university level and amorphously the general media level that feeds out of that at the higher end. What’s happened is that once they lost the hard Left accretions of sympathy for the Soviet Union — witness a text like Marcuse’s Soviet Marxism, which although very short is extremely critical and he’d had been sent to a psychiatric unit or put in a camp for a text like that if he had produced that inside one of those societies, as Marcuse well knew.
You’ve got this great sort of uniformity and diffuseness of the contemporary Left which has collapsed into liberalism, seamlessly taken parts of its agenda over, is no longer associated with apologetic statements about Stalinism, distances itself from all Left-wing atrocities and has critiques of those as well, is part of the seamless liberal-Leftist course that straddles the center and goes right out to the softer reaches of the far Left, bifurcated from the hard Left beyond it.
In all of these institutions, Frankfurt School views play a role. They play a role in defeating the culture of conservatism in all areas: racial and ethnic, criminological and social, areas such as police studies, PhDs written about the prison service, modern theories about cinema. In all of these areas, in cultural studies is a discourse which has only emerged from art colleges in the last 20 years, which is heavily saturated with Frankfurt School-ish types of ideas.
You see the deconstruction and the breaking down of the prior cultural conservatism. They are the intellectual tip of the liberal society which has stepped away from the conservative societies of the 1950s and 1960s.
Up until the ’60s in the West, you had largely a stereotypical center Right to Rightish conservative society, polity, academy, media, and culture, and after that you have a step change to a liberal instead of a conservative society, media, culture, and cultural disseminating strata. This has continued throughout the decades since the 1960s. You’ve had about 50 years now. So, you have a situation where over this 50 year period throughout all of the institutions that matter soft Left theory, theory without hard edges and without endorsement of anti-humanist crimes committed by the ultra-Left all over the world, has become the default position for many people in the arts, in psychology, in medical practice, in psychiatric practice, in nearly all institutions of the state. With the exception of the military and the raw force-based criterion, the areas of state power that rely on the use of force, almost all other areas have been infected by these types of theory. Psychiatric institutions have been and, although it’s a bit of a stretch, the anti-psychiatric movement through R. D. Laing, through Fromm, and through Marcuse, is heavily influenced by at least a proportion of these sorts of ideas.
In the theory of Lyotard and in the theory of Deleuze, is the bourgeois really insane? Are schizophrenics the sane who walk amongst us? Deleuze and Guattari’s text Anti-Oedipus in which the schizophrenic is seen as the last redoubt of sanity in a mad capitalist world, which is by any rational credence insane. Therefore, you have to look to the insane to find the redoubt of sanity.
These sorts of ideas, post-Foucault in the late 20th century, are no longer that eccentric. They were once the most eccentric ideas you could have which conservatives essentially just laughed at. Now, they’ve taken over the institutions. But it’s been in a gradualist and would-be well-meaning and soft-minded sort of way, because this theory has taken over and cultural conservatives have retreated before it to such a degree that there’s hardly any of them left.
RS: I agree. You know, I might disagree with you slightly. I think Cultural Marxism has infected the military in the United States. It’s kind of incredible, but yet we have a major Army general claiming that diversity is the great strength of America’s armed forces as they go overseas to bring women into undergraduate colleges. So, it’s been quite a triumph!
One thing I would just mention, picking up on all these ideas you’ve put forward. I’ve always thought about this; there’s this staying power of let’s call it the postmodern New Left or Cultural Marxism. It’s had this long, decades-long staying power, and if you think about major avant-garde, modernist movements, they were a candle that burned really quickly. They almost burned themselves out.
If you just look at — just to pick one at random — the Blue Rider group or something like that. This is something that lasted maybe 4 years. Dadaism would kind of make a splash and then dissipate and go off into other movements and things like this.

If you look at the art galleries — conceptual art, postmodern art — they’ve been doing the same stuff for maybe 40 or 50 years now! If you look at women’s studies, African-American studies, critical race theory, all this kind of stuff, Foucault . . . I mean, it’s obviously changing, but it’s had this staying power that it’s almost become conservative, and I think this is a great irony.
I don’t know where avant-garde art can go. I don’t know how many times you need to, proverbially speaking, put a crucifix in piss. It’s one attempt to shock the bourgeoisie after another to the point that it becomes old and stale and certainly institutionalized in the sense that many people will go to get masters in fine arts in all these institutions and learn from the great masters of conceptual shock. So, this is a very strange thing about our culture where we have this conservatism amongst postmodern Cultural Marxism.
Do you think this is going to break down, or do you think, Jonathan, that because political correctness has become so obvious or because it’s become something easily ridiculed that it’s going to be overturned or at least come to an end? Do you see that or is that being a little too optimistic?
JB: It might be a bit too optimistic in the short run. I think it’s become institutionalized in a way which those art movements you categorized earlier on have not been for several reasons.
1) It’s a non-fictional area. It’s an academic area, and academics have tenure in mind, and these art movements are sudden, instantaneous, bohemian, and largely outsider movements. They usually row intensely with the major figures who sort of break from each other over a finite period. Surrealism almost came to an end when Breton insisted that they all join the Communist Party in France, but many of them didn’t want to do that. They joined it for discussion and alcoholic treats and to meet women and that sort of thing and to have a chance to exhibit. That’s why most people join art movements.
It’s also not particularly concerned with creation either. It’s concerned with reflexive creativity academically. So, somebody will go through the process of a first degree or second degree, they’ll get the PhD, which is influenced by one of these theoretical figures, and then they’ll become a tenured lecturer over time, and they provide a paradigm or a model for their students as they come up. So, the thing becomes replicating over a career path.
What you’ve had is you’ve had a couple of generations who’ve now done this within the academy, and they’ve also worked for a situation where there’s very little kick against them because there’s very little Right-wing left in the academy. It’s almost totally gone now. It almost can’t survive the pressure valves that have been put on it to such a degree that it’s almost impossible for it to survive. This has meant the rather desert-like, arid terrain of the new left, small “n,” small “l,” really, now dominates the tertiary sector of education, which is why the Left is so strong.
In a mass capitalist world where they feel that people are degraded by the cultural industry, nevertheless what you might call the PBS culture, the national endowments for the arts culture, is completely saturated with this sort of material, and there’s little way to shake it at the present time unless they’re radically disfunded or unless a way can be worked for forces of counter-culture to enter the university space again. Probably only on the internet is the space that they can now adopt and that, of course, is what’s happened for all of these ideas, such as this podcast we’re having today. They’ve gravitated towards the internet, because this is the only space left.
RS: Well, Jonathan, we are the counter-culture. I think that’s one thing that’s been clear to me for some time. But thank you once again for being on the podcast. This was a brilliant discussion, and I look forward to another one next week.
JB: Thanks very much! All the best!rticle printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com





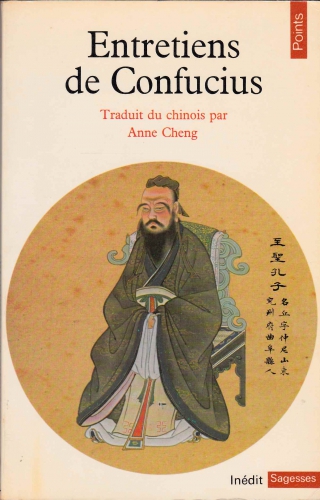
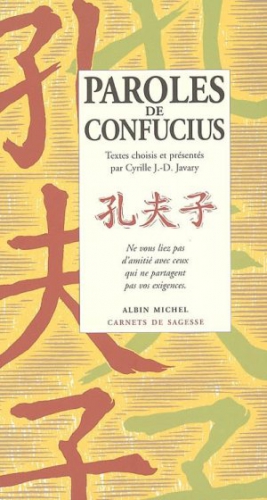 Konfuzius geht es nicht um eine abstrakt definierte Moral, sondern um eine individuelle, durch persönliches Beispiel gelebte Sittlichkeit. Er lehrte nicht durch logische Erklärungen, sondern Umschreibungen. „Als der Stall niederbrannte und Konfuzius zurück kehrte, fragte er: ‚Wurde jemand verletzt?‘ Er fragte nicht nach den Pferden.“ Dieses berühmte Zitat beleuchtet die Lehrweise Konfuzius und wie er Menschlichkeit definiert. Er sorgt sich nicht um den Besitz – die Pferde. Aber er sagt es nicht direkt, das Gleichnis umschreibt es nur. Es ist eben kein Kantianischer Imperativ, sondern eine Ermutigung zum persönlichen Vorbild. Von ihm stammt die berühmte Goldene Regel: „Füge anderen nicht zu, was du nicht willst, dass dir zugefügt wird.“ Dabei steht der Konfuzianismus zwischen den Extremen des Universalismus und Tribalismus. Es gibt eine Moral, eben die Menschlichkeit, die man allen Menschen gegenüber walten lässt; dennoch ist das Verhältnis der Einzelnen zueinander wichtig. Man verhält sich den Obigen gegenüber mit Respekt, den Unteren gegenüber mit Milde. Die Eltern leiten die Kinder mit Strenge und Güte, die Kinder achten die Eltern mit Respekt. Dies setzt sich in allen Bereichen fort: es gibt eben keine Gleichheit, aus der die Moral entspringt, sondern was sittlich ist, bestimmt das Verhältnis der Menschen, wie sie zueinander stehen. Damit wird die gesellschaftliche Ordnung aufrecht erhalten. Die Rollen der Menschen sind eben unterschiedlich, und das Urbild dazu ist die Familie. Der Vater als Beschützer und Leiter, die Mutter als nährend und umsorgend, die Kinder folgsam und respektvoll. Auch die Rollen von Mann und Frau können nicht die gleichen sein, sie sind Abbilder von Yin und Yang, dem männlichen Himmelsprinzip und dem weiblichen der Erde: der Himmel beleuchtet und überwölbt, die Erde trägt und nährt. Es ist keine Unfreiheit, keine Ungleichheit der Würde, aber es sind sich ergänzende Rollen, wie eben im Yin-Yang Symbol: zwei Teile deren gegensätzliche Rollen einander zu einem Ganzen ergänzen, da sie sich ihren natürlichen Anlagen entsprechend einbringen. Ethik von der Familie als Kern aus zu denken, ist die Balance zwischen Universalismus und Tribalismus. Die Familie steht einem näher als alle anderen, ihr ist man zuhöchst verpflichtet, danach kommt die eigene Region, und dann die Nation, der Staat, und erst danach die Menschheit als Ganzes. Es ist aber auch kein Tribalismus, in dem nur dem eigenen Stamm moralische Pflicht gilt. Die Menschlichkeit und Gerechtigkeit gelten gegen alle, aber die moralische Pflicht ist vom inneren Kreise, von der Familie ausgehend, abgestuft. Dem Eigenen gilt die höhere Pflicht als dem Fremden.
Konfuzius geht es nicht um eine abstrakt definierte Moral, sondern um eine individuelle, durch persönliches Beispiel gelebte Sittlichkeit. Er lehrte nicht durch logische Erklärungen, sondern Umschreibungen. „Als der Stall niederbrannte und Konfuzius zurück kehrte, fragte er: ‚Wurde jemand verletzt?‘ Er fragte nicht nach den Pferden.“ Dieses berühmte Zitat beleuchtet die Lehrweise Konfuzius und wie er Menschlichkeit definiert. Er sorgt sich nicht um den Besitz – die Pferde. Aber er sagt es nicht direkt, das Gleichnis umschreibt es nur. Es ist eben kein Kantianischer Imperativ, sondern eine Ermutigung zum persönlichen Vorbild. Von ihm stammt die berühmte Goldene Regel: „Füge anderen nicht zu, was du nicht willst, dass dir zugefügt wird.“ Dabei steht der Konfuzianismus zwischen den Extremen des Universalismus und Tribalismus. Es gibt eine Moral, eben die Menschlichkeit, die man allen Menschen gegenüber walten lässt; dennoch ist das Verhältnis der Einzelnen zueinander wichtig. Man verhält sich den Obigen gegenüber mit Respekt, den Unteren gegenüber mit Milde. Die Eltern leiten die Kinder mit Strenge und Güte, die Kinder achten die Eltern mit Respekt. Dies setzt sich in allen Bereichen fort: es gibt eben keine Gleichheit, aus der die Moral entspringt, sondern was sittlich ist, bestimmt das Verhältnis der Menschen, wie sie zueinander stehen. Damit wird die gesellschaftliche Ordnung aufrecht erhalten. Die Rollen der Menschen sind eben unterschiedlich, und das Urbild dazu ist die Familie. Der Vater als Beschützer und Leiter, die Mutter als nährend und umsorgend, die Kinder folgsam und respektvoll. Auch die Rollen von Mann und Frau können nicht die gleichen sein, sie sind Abbilder von Yin und Yang, dem männlichen Himmelsprinzip und dem weiblichen der Erde: der Himmel beleuchtet und überwölbt, die Erde trägt und nährt. Es ist keine Unfreiheit, keine Ungleichheit der Würde, aber es sind sich ergänzende Rollen, wie eben im Yin-Yang Symbol: zwei Teile deren gegensätzliche Rollen einander zu einem Ganzen ergänzen, da sie sich ihren natürlichen Anlagen entsprechend einbringen. Ethik von der Familie als Kern aus zu denken, ist die Balance zwischen Universalismus und Tribalismus. Die Familie steht einem näher als alle anderen, ihr ist man zuhöchst verpflichtet, danach kommt die eigene Region, und dann die Nation, der Staat, und erst danach die Menschheit als Ganzes. Es ist aber auch kein Tribalismus, in dem nur dem eigenen Stamm moralische Pflicht gilt. Die Menschlichkeit und Gerechtigkeit gelten gegen alle, aber die moralische Pflicht ist vom inneren Kreise, von der Familie ausgehend, abgestuft. Dem Eigenen gilt die höhere Pflicht als dem Fremden.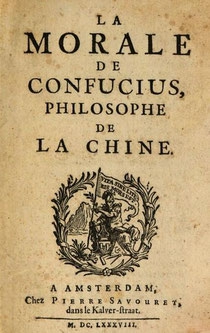 Den fünften Grundpfeiler macht die Bildung, sie ist für Konfuzius Mittel und Selbstzweck zugleich. Unbildung war für ihn ein großer Fluch. „Ein Volk ohne Bildung in den Krieg führen, das heißt, es dem Untergang weihen.“ Hier kommen zwei Übel zusammen: ein ungebildetes Volk und eine Führung in Krieg und Gewalt: das kann nur schlecht ausgehen. Nur Bildung ermöglicht Verstehen, ermöglicht, seinen Platz und seinen Weg in der Gemeinschaft finden. Aber für Konfuzius, der sein Leben lang nicht den Erfolg seiner Lehre erlebte, war Bildung auch ein Trost, etwas um das man sich immer bemüht, um sein Wissen und seinen Charakter immer zu bessern. Für Konfuzius bezeichnet der Weg des Edlen Fleiß, Hingabe und immer wieder Selbstverbesserung, Lernen und Bildung erlangen. „Wer sich nie schämt, wie kann der sich bessern?“ Es ist diese Scham, die den Menschen heute abhanden gekommen ist im Westen. Man will sich nicht bessern, ja man kann sich gar nicht mehr bessern, weil keiner mehr ein rechtes Gefühl für die eigenen Unzulänglichkeiten hat. Jeder ist ein kleiner König, von Kindesbeinen an werden Menschen ermutigt, sich nicht zu ändern, dass alles was sie tun recht und billig sei. Wir wurden überschwemmt mit Ratgebern, die uns sagen, wir sind ok, egal wie wir sind, wir müssen alles akzeptieren und eine kritische Selbst-Befragung, die Notwendigkeit sich zu bessern, haben wir damit verloren. Es wurde den Menschen aberzogen sich zu schämen. Dumme, rohe, derbe Menschen werden uns überall vorgeführt, im Fernsehen, in der Politik ebenso. Es sind oben wie unten Menschen unfähig der Scham, eine schamlose Gesellschaft, die keinen Sinn für die eigenen Charakterschwächen mehr hat, die eigene Unbildung und Primitivität. „Die Alten hielten mit ihren Worten zurück, denn sie schämten sich, mit ihren Taten hinter ihren Worten zurück zu bleiben.“ Heute agieren die Leute im Westen genau umgekehrt: wer am lautesten Schreit und am größten angibt, der bekommt. Damit kommen die Dummen und die Primitiven nach oben.
Den fünften Grundpfeiler macht die Bildung, sie ist für Konfuzius Mittel und Selbstzweck zugleich. Unbildung war für ihn ein großer Fluch. „Ein Volk ohne Bildung in den Krieg führen, das heißt, es dem Untergang weihen.“ Hier kommen zwei Übel zusammen: ein ungebildetes Volk und eine Führung in Krieg und Gewalt: das kann nur schlecht ausgehen. Nur Bildung ermöglicht Verstehen, ermöglicht, seinen Platz und seinen Weg in der Gemeinschaft finden. Aber für Konfuzius, der sein Leben lang nicht den Erfolg seiner Lehre erlebte, war Bildung auch ein Trost, etwas um das man sich immer bemüht, um sein Wissen und seinen Charakter immer zu bessern. Für Konfuzius bezeichnet der Weg des Edlen Fleiß, Hingabe und immer wieder Selbstverbesserung, Lernen und Bildung erlangen. „Wer sich nie schämt, wie kann der sich bessern?“ Es ist diese Scham, die den Menschen heute abhanden gekommen ist im Westen. Man will sich nicht bessern, ja man kann sich gar nicht mehr bessern, weil keiner mehr ein rechtes Gefühl für die eigenen Unzulänglichkeiten hat. Jeder ist ein kleiner König, von Kindesbeinen an werden Menschen ermutigt, sich nicht zu ändern, dass alles was sie tun recht und billig sei. Wir wurden überschwemmt mit Ratgebern, die uns sagen, wir sind ok, egal wie wir sind, wir müssen alles akzeptieren und eine kritische Selbst-Befragung, die Notwendigkeit sich zu bessern, haben wir damit verloren. Es wurde den Menschen aberzogen sich zu schämen. Dumme, rohe, derbe Menschen werden uns überall vorgeführt, im Fernsehen, in der Politik ebenso. Es sind oben wie unten Menschen unfähig der Scham, eine schamlose Gesellschaft, die keinen Sinn für die eigenen Charakterschwächen mehr hat, die eigene Unbildung und Primitivität. „Die Alten hielten mit ihren Worten zurück, denn sie schämten sich, mit ihren Taten hinter ihren Worten zurück zu bleiben.“ Heute agieren die Leute im Westen genau umgekehrt: wer am lautesten Schreit und am größten angibt, der bekommt. Damit kommen die Dummen und die Primitiven nach oben.
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg



 Le philosophe catholique belge
Le philosophe catholique belge 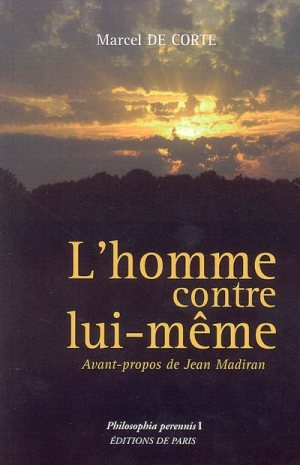 Marcel de Corte, nourri par une solide philosophie réaliste de l’être, tirée d’Aristote et de Saint Thomas d’Aquin, a analysé avec une grande profondeur, à travers une anthropologie et une psychologie originales, ce trait caractéristique de l’homme moderne qu’il a appelé le rationalisme pratique. L’homme en effet vit désormais massivement son rationalisme.
Marcel de Corte, nourri par une solide philosophie réaliste de l’être, tirée d’Aristote et de Saint Thomas d’Aquin, a analysé avec une grande profondeur, à travers une anthropologie et une psychologie originales, ce trait caractéristique de l’homme moderne qu’il a appelé le rationalisme pratique. L’homme en effet vit désormais massivement son rationalisme.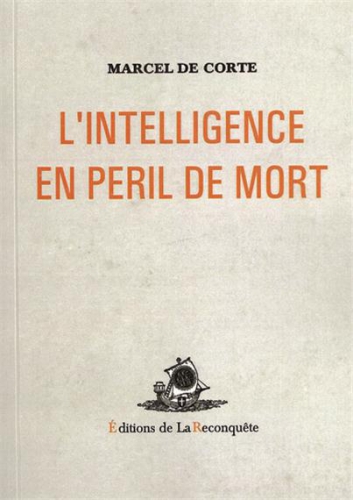 Contre une idée répandue, Marcel de Corte refuse de penser que c’est la technique qui a produit la civilisation contemporaine : c’est d’abord et avant tout une forte dévitalisation de la civilisation ancienne, particulièrement sensible au XVIIIe siècle, mais naturelle au cycle de la vie auquel est régie toute civilisation, qui s’est traduite dans une diffusion du rationalisme renforcée par la technique que le rationalisme a produit. En un sens, la civilisation contemporaine, traversée par la révolution permanente et les multiples « crises de croissance » (mythe du progrès oblige), n’est qu’une longue agonie que l’esprit désincarné cherche à compenser mais prolonge dans une forte mécanisation de ses mœurs, celle-ci n’étant que le mime de la vie dont il manque.
Contre une idée répandue, Marcel de Corte refuse de penser que c’est la technique qui a produit la civilisation contemporaine : c’est d’abord et avant tout une forte dévitalisation de la civilisation ancienne, particulièrement sensible au XVIIIe siècle, mais naturelle au cycle de la vie auquel est régie toute civilisation, qui s’est traduite dans une diffusion du rationalisme renforcée par la technique que le rationalisme a produit. En un sens, la civilisation contemporaine, traversée par la révolution permanente et les multiples « crises de croissance » (mythe du progrès oblige), n’est qu’une longue agonie que l’esprit désincarné cherche à compenser mais prolonge dans une forte mécanisation de ses mœurs, celle-ci n’étant que le mime de la vie dont il manque.
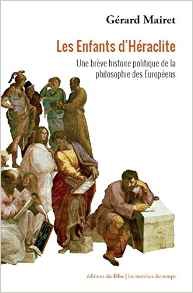
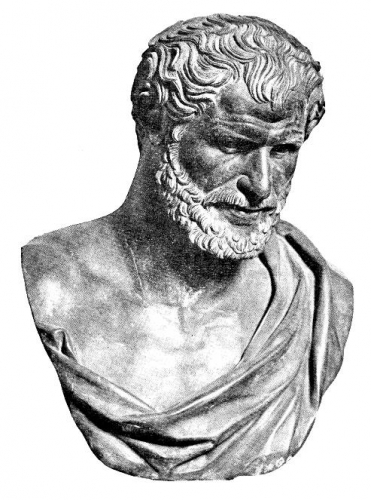
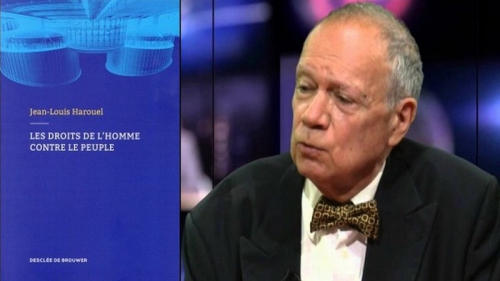
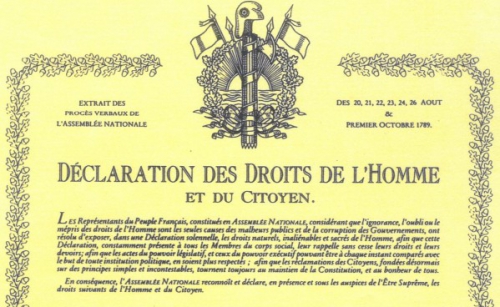






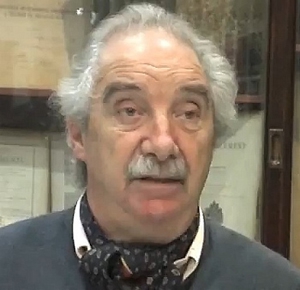



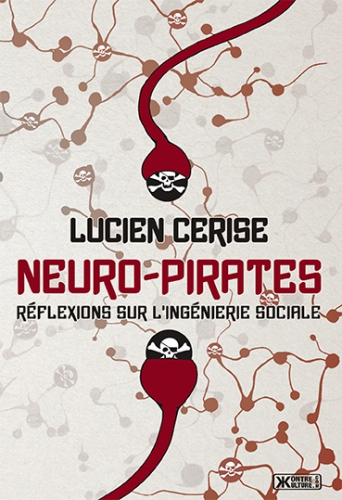

 Des officiels israéliens ont dit également préférer l’État islamique (Daech) à l’Iran. Évidemment, le terrorisme islamiste supervisé par les services spéciaux israéliens, anglo-saxons, français, ne s’arrête pas aux frontières du Proche-Orient : le suivi des filières est assuré jusqu’en Europe et en Amérique, où ces services spéciaux sont carrément chez eux, dans une perspective de stratégie de la tension, en référence au réseau Gladio de l’OTAN. À la fin, pour des raisons d’efficacité, les attentats en Occident sont réalisés par les services occidentaux eux-mêmes, mais attribués dans la narration officielle médiatique aux individus qui ont effectivement fréquenté des groupes activistes et possèdent donc le bon parcours biographique, ce qui en fait des coupables idéaux. Un principe de l’attentat sous faux drapeau : pour écrire une « légende », c’est-à-dire un faux CV dans le jargon du renseignement, il faut un minimum de vraisemblance. Le terrorisme d’État est aujourd’hui le principal bras armé de ce conflit triangulé généralisé.
Des officiels israéliens ont dit également préférer l’État islamique (Daech) à l’Iran. Évidemment, le terrorisme islamiste supervisé par les services spéciaux israéliens, anglo-saxons, français, ne s’arrête pas aux frontières du Proche-Orient : le suivi des filières est assuré jusqu’en Europe et en Amérique, où ces services spéciaux sont carrément chez eux, dans une perspective de stratégie de la tension, en référence au réseau Gladio de l’OTAN. À la fin, pour des raisons d’efficacité, les attentats en Occident sont réalisés par les services occidentaux eux-mêmes, mais attribués dans la narration officielle médiatique aux individus qui ont effectivement fréquenté des groupes activistes et possèdent donc le bon parcours biographique, ce qui en fait des coupables idéaux. Un principe de l’attentat sous faux drapeau : pour écrire une « légende », c’est-à-dire un faux CV dans le jargon du renseignement, il faut un minimum de vraisemblance. Le terrorisme d’État est aujourd’hui le principal bras armé de ce conflit triangulé généralisé.
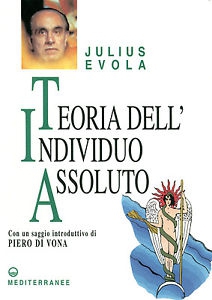 Si Evola naît dans une famille catholique et bourgeoise, il en rejette rapidement ces deux aspects. Le catholicisme, moral et sentimental, lui semble étranger à une véritable sacralité et une haute ascèse, loin de l’idéal « viril et aristocratique » du bouddhisme aryen. Son mépris de la vie bourgeoise lui fait refuser une chaire universitaire.
Si Evola naît dans une famille catholique et bourgeoise, il en rejette rapidement ces deux aspects. Le catholicisme, moral et sentimental, lui semble étranger à une véritable sacralité et une haute ascèse, loin de l’idéal « viril et aristocratique » du bouddhisme aryen. Son mépris de la vie bourgeoise lui fait refuser une chaire universitaire. Son ouvrage Chevaucher le tigre est un bilan de ses expériences, et un constat de réalisme ferme : rien ne peut être fait, ni artistiquement, ni religieusement, ni politiquement, pour provoquer un bouleversement positif au sein du monde moderne. Le seul horizon, c’est le chaos. Ce livre s’adresse aux hommes différenciés, ceux qui n’appartiennent pas intérieurement au monde moderne, qui sont de l’autre civilisation. Selon une image extrême-orientale, « si l’on réussit à chevaucher un tigre, on l’empêche de se jeter sur vous et, […] en outre, si l’on ne descend pas, si l’on maintient la prise, il se peut que l’on ait, à la fin, raison de lui. » Evola s’adresse aux « convives de pierre », aux Individus absolus, ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se détacher du monde actuel, et qui sont prêts à y vivre « sous les formes les plus paroxystiques ». Evola y examine, sous formes d’orientations existentielles, les possibilités d’émancipation totale de l’être par la mise en confrontation avec les processus destructeurs du monde moderne.
Son ouvrage Chevaucher le tigre est un bilan de ses expériences, et un constat de réalisme ferme : rien ne peut être fait, ni artistiquement, ni religieusement, ni politiquement, pour provoquer un bouleversement positif au sein du monde moderne. Le seul horizon, c’est le chaos. Ce livre s’adresse aux hommes différenciés, ceux qui n’appartiennent pas intérieurement au monde moderne, qui sont de l’autre civilisation. Selon une image extrême-orientale, « si l’on réussit à chevaucher un tigre, on l’empêche de se jeter sur vous et, […] en outre, si l’on ne descend pas, si l’on maintient la prise, il se peut que l’on ait, à la fin, raison de lui. » Evola s’adresse aux « convives de pierre », aux Individus absolus, ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se détacher du monde actuel, et qui sont prêts à y vivre « sous les formes les plus paroxystiques ». Evola y examine, sous formes d’orientations existentielles, les possibilités d’émancipation totale de l’être par la mise en confrontation avec les processus destructeurs du monde moderne.
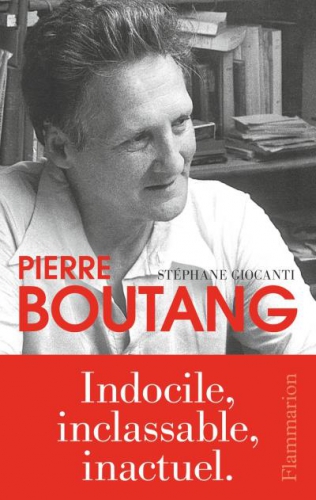 Prenons un récent exemple, que nous développerons sans doute dans une prochaine note : qui aurait pu croire que le lion d'Espagne,
Prenons un récent exemple, que nous développerons sans doute dans une prochaine note : qui aurait pu croire que le lion d'Espagne,  Je commencerai par la critique la plus féroce, capable sans doute de porter un coup fatal à l'exercice biographique auquel Stéphane Giocanti s'est livré, puisque Pierre Boutang, comme il ne cesse d'ailleurs de nous le répéter, non seulement était un homme du secret, mais, une fois pour toute, a dit tout ce qu'il pouvait dire sur lui-même dans son
Je commencerai par la critique la plus féroce, capable sans doute de porter un coup fatal à l'exercice biographique auquel Stéphane Giocanti s'est livré, puisque Pierre Boutang, comme il ne cesse d'ailleurs de nous le répéter, non seulement était un homme du secret, mais, une fois pour toute, a dit tout ce qu'il pouvait dire sur lui-même dans son  Cette pesante insistance de Stéphane Giocanti sur la sexualité débridée de Pierre Boutang, considéré comme «une espèce d'ogre du lit, des soupentes et des porches» (p. 245), taraudé selon son biographe par le «démon qui va le distraire du regard intérieur de la mort et de la mélancolie de la pensée» (p. 66), est finalement la petite lorgnette commode par laquelle le secret fondamental de l'auteur n'est qu'à peine entrevu. Ce secret est peut-être bien réel après tout, mais, prudemment, Stéphane Giocanti, ne fait que l'évoquer dans les pages denses, parfois quelque peu confuses ou anecdotiques (4), qu'il consacre au rôle et à l'action politique de Boutang, surtout pendant la Guerre d'Algérie. Quel a été le rôle exact de Pierre Boutang dans la volonté de s'allier aux gaullistes pour favoriser le retour d'un Roi au pouvoir et, aussi, dans l'assassinat de Darlan, aux abords du trouble personnage qu'était Henri d'Astier de La Vigerie ? : «Un secret qui, sous le soleil d'une épopée paternelle, ne saurait être connu que de lui-même» (p. 111). Stéphane Giocanti se tait (a raison de se taire) et conclut sobrement : «En tout et pour tout, Boutang aura été chef d'un cabinet ministériel pendant deux mois et demi. L'aventure auprès de Jean Rigault, d'Astier, du comte de Paris, d'Alfred Pose et d'autres conspirateurs laissera des traces durables dans sa vie et sa pensée», notamment l'idée, commune à un Dominique de Roux qu'appréciera Boutang (cf. p. 272), selon laquelle «des minorités agissantes peuvent faire pencher la balance de l'histoire, et réintroduire l'idée monarchique dans le jeu des forces politiques» (p. 117). En tout cas, les pages évoquant l'évolution politique de Pierre Boutang (cf. p. 199) sont peut-être les plus intéressantes de la biographie de Stéphane Giocanti, qui s'efforce, non sans mal, d'expliquer la relation qu'entretint le penseur et bretteur avec le général de Gaulle.
Cette pesante insistance de Stéphane Giocanti sur la sexualité débridée de Pierre Boutang, considéré comme «une espèce d'ogre du lit, des soupentes et des porches» (p. 245), taraudé selon son biographe par le «démon qui va le distraire du regard intérieur de la mort et de la mélancolie de la pensée» (p. 66), est finalement la petite lorgnette commode par laquelle le secret fondamental de l'auteur n'est qu'à peine entrevu. Ce secret est peut-être bien réel après tout, mais, prudemment, Stéphane Giocanti, ne fait que l'évoquer dans les pages denses, parfois quelque peu confuses ou anecdotiques (4), qu'il consacre au rôle et à l'action politique de Boutang, surtout pendant la Guerre d'Algérie. Quel a été le rôle exact de Pierre Boutang dans la volonté de s'allier aux gaullistes pour favoriser le retour d'un Roi au pouvoir et, aussi, dans l'assassinat de Darlan, aux abords du trouble personnage qu'était Henri d'Astier de La Vigerie ? : «Un secret qui, sous le soleil d'une épopée paternelle, ne saurait être connu que de lui-même» (p. 111). Stéphane Giocanti se tait (a raison de se taire) et conclut sobrement : «En tout et pour tout, Boutang aura été chef d'un cabinet ministériel pendant deux mois et demi. L'aventure auprès de Jean Rigault, d'Astier, du comte de Paris, d'Alfred Pose et d'autres conspirateurs laissera des traces durables dans sa vie et sa pensée», notamment l'idée, commune à un Dominique de Roux qu'appréciera Boutang (cf. p. 272), selon laquelle «des minorités agissantes peuvent faire pencher la balance de l'histoire, et réintroduire l'idée monarchique dans le jeu des forces politiques» (p. 117). En tout cas, les pages évoquant l'évolution politique de Pierre Boutang (cf. p. 199) sont peut-être les plus intéressantes de la biographie de Stéphane Giocanti, qui s'efforce, non sans mal, d'expliquer la relation qu'entretint le penseur et bretteur avec le général de Gaulle.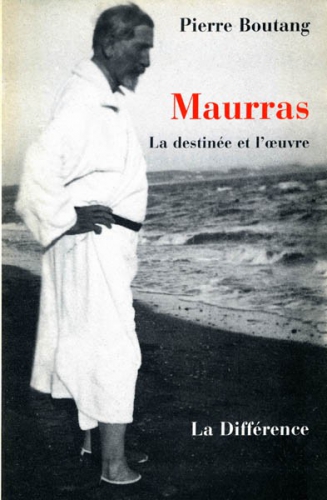 Il y a plus, mais nous nous aventurons là dans un territoire que Pierre Boutang, plutôt qu'il ne l'a vraiment arpenté, n'a fait qu'entrevoir au loin, contrée où seul il peut s'aventurer, sous le regard de Dieu dont il se pressent ou se sait l'espion (6) : «Je sens en moi», écrit-il ainsi, «l'épreuve d'une «élection» divine aussi inexplicable que celle du peuple juif» (p. 287, Cahier 10, 3 septembre 1973, p. 15). C'est peut-être supposer, au-delà même d'un secret et de l'obliquité, de «la part d'ombre», corollaire indispensable d'une sorte de «tenue du langage qui comporte la tension de la recherche métaphysique, avec la volonté de ne pas trop céder au dévoilement» (p. 48), un rôle que nul ne peut sonder, puisqu'il entre dans les seules raisons, impénétrables, de Dieu. Ce serait aussi postuler l'existence de plus d'un point commun entre Pierre Boutang et Léon Bloy (cf. p. 391), dont Stéphane Giocanti nous assure qu'il a été proche, par la pensée bien sûr, durant ses dernières années de vie. Ce ne serait donc pas simplement Pierre Boutang qui pourrait rêver «d'une parole qui serait l'instrument de la colère de Dieu», ce ne seraient pas seulement ses propres colères qui serviraient les «causes, les vérités ou les valeurs auxquelles il tient par-dessus tout» et que Giocanti rappelle («la France, l'honneur, la foi chrétienne», la «liberté intérieure, le roi, l'exigence de la plus haute culture», p. 345), c'est son âme tout entière qu'il faudrait rêver de pouvoir placer sous la lumière d'une enquête métaphysique qui parviendrait à rattacher ce fabuleux et héroïque destin à celui d'Adam (7), qui fascina durant presque toute sa vie Pierre Boutang.
Il y a plus, mais nous nous aventurons là dans un territoire que Pierre Boutang, plutôt qu'il ne l'a vraiment arpenté, n'a fait qu'entrevoir au loin, contrée où seul il peut s'aventurer, sous le regard de Dieu dont il se pressent ou se sait l'espion (6) : «Je sens en moi», écrit-il ainsi, «l'épreuve d'une «élection» divine aussi inexplicable que celle du peuple juif» (p. 287, Cahier 10, 3 septembre 1973, p. 15). C'est peut-être supposer, au-delà même d'un secret et de l'obliquité, de «la part d'ombre», corollaire indispensable d'une sorte de «tenue du langage qui comporte la tension de la recherche métaphysique, avec la volonté de ne pas trop céder au dévoilement» (p. 48), un rôle que nul ne peut sonder, puisqu'il entre dans les seules raisons, impénétrables, de Dieu. Ce serait aussi postuler l'existence de plus d'un point commun entre Pierre Boutang et Léon Bloy (cf. p. 391), dont Stéphane Giocanti nous assure qu'il a été proche, par la pensée bien sûr, durant ses dernières années de vie. Ce ne serait donc pas simplement Pierre Boutang qui pourrait rêver «d'une parole qui serait l'instrument de la colère de Dieu», ce ne seraient pas seulement ses propres colères qui serviraient les «causes, les vérités ou les valeurs auxquelles il tient par-dessus tout» et que Giocanti rappelle («la France, l'honneur, la foi chrétienne», la «liberté intérieure, le roi, l'exigence de la plus haute culture», p. 345), c'est son âme tout entière qu'il faudrait rêver de pouvoir placer sous la lumière d'une enquête métaphysique qui parviendrait à rattacher ce fabuleux et héroïque destin à celui d'Adam (7), qui fascina durant presque toute sa vie Pierre Boutang.  It is not enough to view intellectuals as the makers of political change through their transmutation of culture. It is also necessary to consider the state and the elite who will rule it. Politics becomes impossible to conduct without the type of hardworking, ruthless, and ambitious people who generally make up the political class.
It is not enough to view intellectuals as the makers of political change through their transmutation of culture. It is also necessary to consider the state and the elite who will rule it. Politics becomes impossible to conduct without the type of hardworking, ruthless, and ambitious people who generally make up the political class.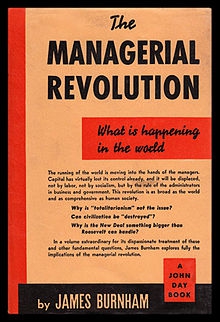 His books of greatst interest are The Machiavellians and The Managerial Revolution. The first one is mainly about the political theories of a number of thinkers who Burnham considered to be a part of what he called the Machiavellian tradition. The main argument of the book is that politics, defined as a struggle for power, can never be removed from human existence. In every society, there must be one group of people who rule, and one group who is the subject of that rule. In the second book, Burnham makes the case that a revolution is well under way, but not the type of revolution which is often advocated by the Left. The managerial revolution is taking place within the bureaucracy of the modern state, and is the revolution of the managers, at the expense of other forms of leadership.
His books of greatst interest are The Machiavellians and The Managerial Revolution. The first one is mainly about the political theories of a number of thinkers who Burnham considered to be a part of what he called the Machiavellian tradition. The main argument of the book is that politics, defined as a struggle for power, can never be removed from human existence. In every society, there must be one group of people who rule, and one group who is the subject of that rule. In the second book, Burnham makes the case that a revolution is well under way, but not the type of revolution which is often advocated by the Left. The managerial revolution is taking place within the bureaucracy of the modern state, and is the revolution of the managers, at the expense of other forms of leadership.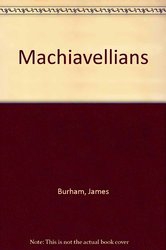 When it comes to Dante, Burnham goes on to place his seemingly independent normative principles in their proper context. He shows that Dante had been involved in an extensive and lengthy conflict between the Ghibelline and the Guelph factions. Dante and the faction to which he belonged lost to their rivals, and he went to the Holy Roman Emperor to ask for his support. When these facts were presented, it became quite clear that Dante had put forward his principles with the hope of winning the good graces of the Emperor, and thus attempted to justify his rule. That is the true meaning of De Monarchia, as Burnham sees it.
When it comes to Dante, Burnham goes on to place his seemingly independent normative principles in their proper context. He shows that Dante had been involved in an extensive and lengthy conflict between the Ghibelline and the Guelph factions. Dante and the faction to which he belonged lost to their rivals, and he went to the Holy Roman Emperor to ask for his support. When these facts were presented, it became quite clear that Dante had put forward his principles with the hope of winning the good graces of the Emperor, and thus attempted to justify his rule. That is the true meaning of De Monarchia, as Burnham sees it.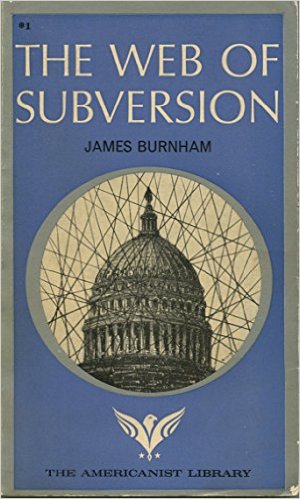 It is important not to overlook the importance of the managerial state, and the importance of the state in general. It is not enough to merely philosophise; there needs to be a political elite and a physical structure which underpins this elite. We can take Sweden as an example. Sweden took a turn toward the Left during the 1960s and never really recuperated. This was not achieved solely through the work of intellectuals and Leftist philosophical theories. What happened in addition to this was that a large number of people were recruited to work as functionaries and civil servants in the ever-growing state machinery. Social workers, teachers, and administrators were recruited and formed a bureaucracy the like of which Sweden had never experienced before. They became the new class of managers. Regardless of what kind of government gets elected, this establishment stays more or less the same.
It is important not to overlook the importance of the managerial state, and the importance of the state in general. It is not enough to merely philosophise; there needs to be a political elite and a physical structure which underpins this elite. We can take Sweden as an example. Sweden took a turn toward the Left during the 1960s and never really recuperated. This was not achieved solely through the work of intellectuals and Leftist philosophical theories. What happened in addition to this was that a large number of people were recruited to work as functionaries and civil servants in the ever-growing state machinery. Social workers, teachers, and administrators were recruited and formed a bureaucracy the like of which Sweden had never experienced before. They became the new class of managers. Regardless of what kind of government gets elected, this establishment stays more or less the same.
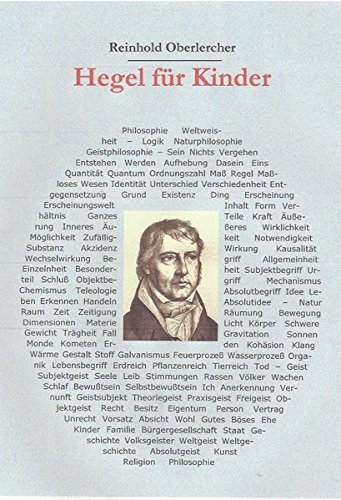 Oberlerchers philosophischer Totalitätsanspruch sollte indessen erst in den folgenden Dekaden ganz hervortreten: Das 1986 vollendete enzyklopädische System der Sozialwissenschaften wurde 1994 in eine sozialphilosophische Lehre vom Gemeinwesen überführt und 2014 von einem holistischen
Oberlerchers philosophischer Totalitätsanspruch sollte indessen erst in den folgenden Dekaden ganz hervortreten: Das 1986 vollendete enzyklopädische System der Sozialwissenschaften wurde 1994 in eine sozialphilosophische Lehre vom Gemeinwesen überführt und 2014 von einem holistischen  In Opposition zu einer gesetzes- und vertragsförmig normierten Weltgesellschaft aus entwurzelten Individuen fordert Oberlercher folgerichtig die rechts- und ordnungsgemäße Wiedereinwurzelung von souveränen Volksgemeinschaften, wie sie nur eine »völkische Weltrevolution« durchsetzen könnte.
In Opposition zu einer gesetzes- und vertragsförmig normierten Weltgesellschaft aus entwurzelten Individuen fordert Oberlercher folgerichtig die rechts- und ordnungsgemäße Wiedereinwurzelung von souveränen Volksgemeinschaften, wie sie nur eine »völkische Weltrevolution« durchsetzen könnte.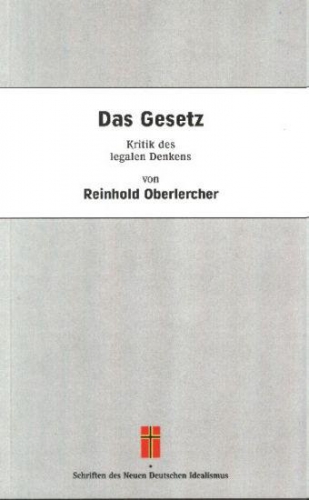 Mit sicherem Gespür für den würdigen Feind attackierte er den »kafkaesken Professor« Theodor W. Adorno, der in seinen philosophischen Fragmenten einen Angriff auf das deutsche Systemdenken geführt und das »Ganze« zum »Unwahren« erklärt hatte.
Mit sicherem Gespür für den würdigen Feind attackierte er den »kafkaesken Professor« Theodor W. Adorno, der in seinen philosophischen Fragmenten einen Angriff auf das deutsche Systemdenken geführt und das »Ganze« zum »Unwahren« erklärt hatte.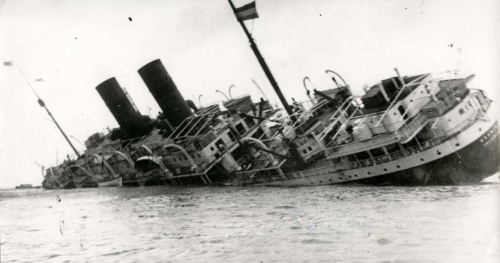
 Onze cultuur, de cultuur van het Avondland, ziet Spengler als 'Faustisch', naar het toneelstuk 'Faust' van Goethe. Het idee is dat de mens van onze cultuur streeft naar onbeperkte kennis, zelfs als hij daarvoor – net als Faust – een pact met de duivel moet sluiten. Als poëtisch beeld voor deze cultuur geeft Spengler “de oneindige ruimte”. Het ruimtevaartprogramma zou hij als een typerende cultuuruiting van het Avondland zien.
Onze cultuur, de cultuur van het Avondland, ziet Spengler als 'Faustisch', naar het toneelstuk 'Faust' van Goethe. Het idee is dat de mens van onze cultuur streeft naar onbeperkte kennis, zelfs als hij daarvoor – net als Faust – een pact met de duivel moet sluiten. Als poëtisch beeld voor deze cultuur geeft Spengler “de oneindige ruimte”. Het ruimtevaartprogramma zou hij als een typerende cultuuruiting van het Avondland zien.
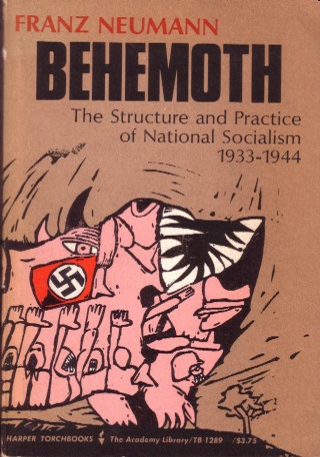 For instance, Franz Neumann’s large book, Behemoth, which is a Marxian analysis of the economics of National Socialist Germany, was one of the few works of economics that was ever written that came out of the Frankfurt School. Most of it was concerned with cultural critique and critical cultural theory involving very outlandish areas such as sociology of music, which was a particular area of Adorno’s concern.
For instance, Franz Neumann’s large book, Behemoth, which is a Marxian analysis of the economics of National Socialist Germany, was one of the few works of economics that was ever written that came out of the Frankfurt School. Most of it was concerned with cultural critique and critical cultural theory involving very outlandish areas such as sociology of music, which was a particular area of Adorno’s concern. But anyway, Adorno and Horkheimer aren’t just seeing that Fascism is some reaction of capitalist forces against the Communist wave or something like that. They’re seeing Fascism as coming out of a bourgeois world, and they’re seeing something really wrong at the heart of bourgeois modernity, and I think they picture this in the form of Odysseus who wants to be bound at the mast and is going to renounce man’s more natural being and instead embrace a stern, hard modern man. There’s a world to be made, and we’ve got to go build it.
But anyway, Adorno and Horkheimer aren’t just seeing that Fascism is some reaction of capitalist forces against the Communist wave or something like that. They’re seeing Fascism as coming out of a bourgeois world, and they’re seeing something really wrong at the heart of bourgeois modernity, and I think they picture this in the form of Odysseus who wants to be bound at the mast and is going to renounce man’s more natural being and instead embrace a stern, hard modern man. There’s a world to be made, and we’ve got to go build it.

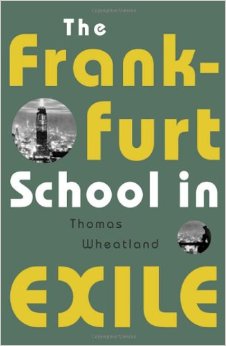



 Les quatre visions ne sont, du reste, pas incompatibles (l'on peut, par exemple, penser que les hommes bricolent des pseudo-explications avec des faits pour légitimer des valeurs, parce qu'ils sont victimes d'une fausse conscience...). Il est permis de penser qu'elles ont toutes leur part de vérité, dans la mesure où elles décrivent le rôle des idéologies. Une idéologie, ce n'est pas seulement une idée à laquelle on peut adhérer ou pas, ce n'est même pas un corpus, un ensemble de notions et affirmations ayant une relation de cohérence entre elles, c'est un code : une machine à produire de nouvelles interprétations conformes aux finalités du modèle. Une idéologie permet tout à la fois de rêver, de croire que l'on possède une explication du monde, de s'imaginer que l'on échappe à l'idéologie (c'est une différence avec la foi : chacun dit "je le crois parce que c'est ma religion", personne ne dit "je le crois parce que c'est mon idéologie"). Enfin l'idéologie sert à rentrer dans une communauté (avec tous ceux qui partagent la même vérité que vous) et, ce n'est peut-être pas le moins important, à se faire des ennemis. Où au moins à désigner le mal : l'idéologie adverse. Toute idéologie est en effet une "pensée contre" qui s'oppose aux idées mauvaises ou fausses (ce qu'elle nomme justement "idéologies"), ne vit que dans le conflit avec elle et avec une autre communauté de croyants et se condamne par là même à convaincre sans cesse, à augmenter les nombre de ses adhérents (au détriment de l'erreur et du mal). Du reste on reconnaît assez bien un discours idéologique à ceci qu'il explique qu'il faut se battre pour libérer l'humanité du poison des idéologies perverses : néolibéralisme, nationalisme archaïque, islamisme, tiers-mondisme anti-américain, utopisme altermondialisme, populisme sécuritaire fascisant suivant le cas..
Les quatre visions ne sont, du reste, pas incompatibles (l'on peut, par exemple, penser que les hommes bricolent des pseudo-explications avec des faits pour légitimer des valeurs, parce qu'ils sont victimes d'une fausse conscience...). Il est permis de penser qu'elles ont toutes leur part de vérité, dans la mesure où elles décrivent le rôle des idéologies. Une idéologie, ce n'est pas seulement une idée à laquelle on peut adhérer ou pas, ce n'est même pas un corpus, un ensemble de notions et affirmations ayant une relation de cohérence entre elles, c'est un code : une machine à produire de nouvelles interprétations conformes aux finalités du modèle. Une idéologie permet tout à la fois de rêver, de croire que l'on possède une explication du monde, de s'imaginer que l'on échappe à l'idéologie (c'est une différence avec la foi : chacun dit "je le crois parce que c'est ma religion", personne ne dit "je le crois parce que c'est mon idéologie"). Enfin l'idéologie sert à rentrer dans une communauté (avec tous ceux qui partagent la même vérité que vous) et, ce n'est peut-être pas le moins important, à se faire des ennemis. Où au moins à désigner le mal : l'idéologie adverse. Toute idéologie est en effet une "pensée contre" qui s'oppose aux idées mauvaises ou fausses (ce qu'elle nomme justement "idéologies"), ne vit que dans le conflit avec elle et avec une autre communauté de croyants et se condamne par là même à convaincre sans cesse, à augmenter les nombre de ses adhérents (au détriment de l'erreur et du mal). Du reste on reconnaît assez bien un discours idéologique à ceci qu'il explique qu'il faut se battre pour libérer l'humanité du poison des idéologies perverses : néolibéralisme, nationalisme archaïque, islamisme, tiers-mondisme anti-américain, utopisme altermondialisme, populisme sécuritaire fascisant suivant le cas..
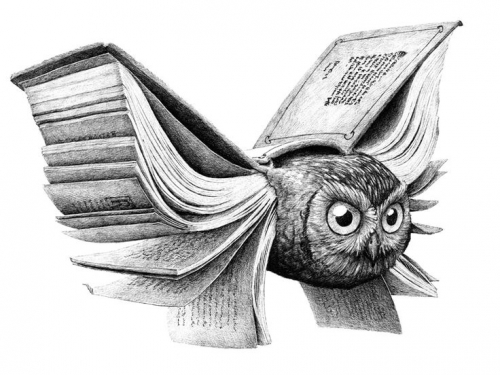

 Devant la menace terroriste, il ne sert à rien de pousser des couinements d’effroi, tout simplement parce que cette menace n’est pas nouvelle et qu’il faut d’abord comprendre sa nature avant de lui répondre. Rien ne montre mieux la déculturation de l’Occident que ces couinements. Nous ne savons plus ce qu’est un homme. Nous ne savons plus que sa dignité réside non pas dans une jolie intégration dans le monde, mais en une ascension au-dessus de ce monde. Le terrorisme consiste en un refus de l’ordre du monde, non point par ascension mais par descente dans le sang des massacres. Mais refus il y a et ce refus est le propre de l’homme.
Devant la menace terroriste, il ne sert à rien de pousser des couinements d’effroi, tout simplement parce que cette menace n’est pas nouvelle et qu’il faut d’abord comprendre sa nature avant de lui répondre. Rien ne montre mieux la déculturation de l’Occident que ces couinements. Nous ne savons plus ce qu’est un homme. Nous ne savons plus que sa dignité réside non pas dans une jolie intégration dans le monde, mais en une ascension au-dessus de ce monde. Le terrorisme consiste en un refus de l’ordre du monde, non point par ascension mais par descente dans le sang des massacres. Mais refus il y a et ce refus est le propre de l’homme.

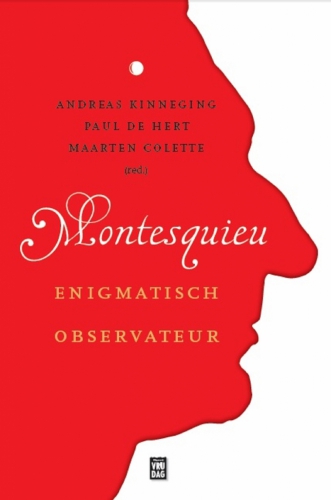 Het onderwerp scheiding der machten is actueler dan ooit, nu dat kostbare beginsel weer moet worden verdedigd tegen de her en der dreigende sharia. In zijn hoofdwerk, De l’Esprit des Lois (Over de geest van de wetten) staat het bewuste principe centraal, net zoals dat van de checks and balances (zoiets als controles en waarborgen). Veelal getypeerd als een liberaal geeft Montesquieu in De l’Esprit aan dat hij na rijp beraad kiest voor een gematigde regering, gematigd door middel van de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Liefst dan nog een regering waarin de adel een belangrijke rol vervult. Die machtenscheiding en de checks and balances liggen aan de basis van de Amerikaanse constitutie en die van een pak andere democratische landen, zonder die adel dan.
Het onderwerp scheiding der machten is actueler dan ooit, nu dat kostbare beginsel weer moet worden verdedigd tegen de her en der dreigende sharia. In zijn hoofdwerk, De l’Esprit des Lois (Over de geest van de wetten) staat het bewuste principe centraal, net zoals dat van de checks and balances (zoiets als controles en waarborgen). Veelal getypeerd als een liberaal geeft Montesquieu in De l’Esprit aan dat hij na rijp beraad kiest voor een gematigde regering, gematigd door middel van de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Liefst dan nog een regering waarin de adel een belangrijke rol vervult. Die machtenscheiding en de checks and balances liggen aan de basis van de Amerikaanse constitutie en die van een pak andere democratische landen, zonder die adel dan.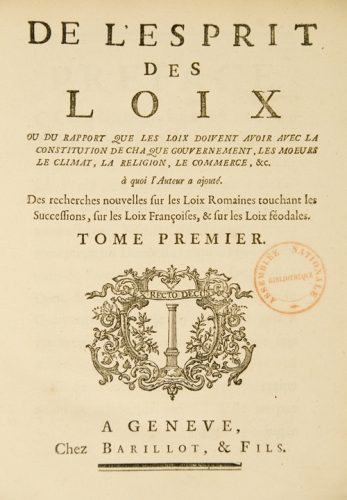 Montesquieu zet zijn lezers vaak op het verkeerde been. Allicht verwijst de kwalificatie ‘enigmatisch’ in de titel hiernaar. Zo lezen we in de bijdrage van Jean-Marc Piret dat Montesquieu best kan leven met cliëntelisme, het uitdelen van postjes, waarbij de uitvoerende macht steun zoekt tegen de wetgevende kamers in. Wie geen voordelen uit die hoek hoeft te verwachten, zal dan weer zijn hoop op één van beide kamers stellen. Risico is daarbij dat teleurstelling mensen kan doen overlopen naar de tegenpartij. Schaamteloos opportunisme ? Volgens Montesquieu, die zich geen illusies maakt over hoe het er in de politiek toegaat, is dit juist een teken van de ‘pluralistische vitaliteit van de maatschappij’.
Montesquieu zet zijn lezers vaak op het verkeerde been. Allicht verwijst de kwalificatie ‘enigmatisch’ in de titel hiernaar. Zo lezen we in de bijdrage van Jean-Marc Piret dat Montesquieu best kan leven met cliëntelisme, het uitdelen van postjes, waarbij de uitvoerende macht steun zoekt tegen de wetgevende kamers in. Wie geen voordelen uit die hoek hoeft te verwachten, zal dan weer zijn hoop op één van beide kamers stellen. Risico is daarbij dat teleurstelling mensen kan doen overlopen naar de tegenpartij. Schaamteloos opportunisme ? Volgens Montesquieu, die zich geen illusies maakt over hoe het er in de politiek toegaat, is dit juist een teken van de ‘pluralistische vitaliteit van de maatschappij’.

 Jean-Yves Pranchère : L’initiative est venue de Justine Lacroix, qui s’est engagée il y a six ans dans le projet d’une étude des résistances contemporaines aux droits de l’homme ; elle en a exposé les attendus dans deux articles programmatiques,
Jean-Yves Pranchère : L’initiative est venue de Justine Lacroix, qui s’est engagée il y a six ans dans le projet d’une étude des résistances contemporaines aux droits de l’homme ; elle en a exposé les attendus dans deux articles programmatiques, 


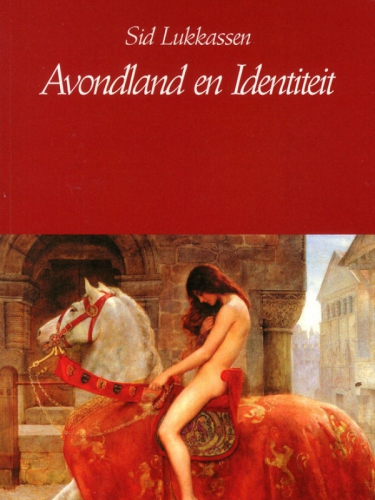 Door het boek heen laat Sid niet na de lezer in te prenten dat hij weinig op heeft met het Marxisme, en meer in het bijzonder met het cultuurmarxisme. Het ‘cultuurmarxistische denken’ is verfoeilijk aldus Sid. Je kunt er bij hem van op aan dat hij de stelling huldigt dat het Marxisme de economie en de welvaart uiteindelijk heeft gesmoord en dat na gedane zaken – of terwijl die verbouwing gaande was – men er parallel toe is overgegaan de winkel open te houden om ook de cultuur naar de vaantjes te helpen. De basis daarvoor vormde de verdere veredeling van het Westers Christelijke schuld- en zondebesef. Via social engeneering werkte de generatie ’68 toe naar een cultuur waarin de intrinsieke validiteit middels het oordeelsvermogen plaats maakte voor een politiek correcte wereld waarin (goede) intenties de maatstaf zijn en waar alles wat zwak oogt (in een slachtofferrol) vooral correct benaderd moet worden. Volgens dit cultuurmarxisme is het eigen oordeels- en analytische vermogen van het individu slecht en zou dat tot uitsluiting leiden. De keerzijde van de medaille is dat alles wat sterk is of een duidelijke eigen mening koestert wordt uitgesloten. Immers argumenteren volgens de termen ‘logica’, ‘objectiviteit’, ‘universele geldigheid‘ kan kwetsend zijn voor degenen die zich in het kamp van de slachtoffer-rol-aanhangers van de politiek correcten bevinden. Ergo, afwijking wordt bestraft met uitsluiting uit de heilstaat van de politiek-correcten. Het laat zich raden dat Sid van mening is dat de Westerse (blanke) man die ook nog eens hetero is, als eerste ten slachtoffer valt aan dat cultuurmarxisme van de politiek-correcten. Ofschoon hij de ontwikkelingen soms wat zwartwit benadert, heeft hij wellicht tot schrik van vele politiek-correct denkenden zeker niet geheel ongelijk. Vele instituties en cultureel geldende waarden zijn in de loop der tijd op de schop gegaan. Het normatieve gelijkheidsbeginsel heeft er toe geleid dat het beter werd om het hoofd niet te ver boven het maaiveld uit de steken en maar liever vooral in de pas te lopen met wat als politiek-correct werd en wordt gezien, iets wat overigens veelal opgeld doet in de ambtelijke bureaucratieën. Het boek ademt dan ook zeker de opvattingen van de auteur dat het postmoderne denken en het feminisme te ver zijn doorgeschoten. Vast staat in ieder geval dat Sid van mening is dat de maakbare samenleving niet bestaat en de Europese cultuur ten onder zal gaan aan ‘wensdenken’ en in de pas lopen. De (meest zuivere) vrijheid van meningsuiting is verworden tot ‘vrijheid van toegestane meningsuiting‘, aldus Sid Lukkassen.
Door het boek heen laat Sid niet na de lezer in te prenten dat hij weinig op heeft met het Marxisme, en meer in het bijzonder met het cultuurmarxisme. Het ‘cultuurmarxistische denken’ is verfoeilijk aldus Sid. Je kunt er bij hem van op aan dat hij de stelling huldigt dat het Marxisme de economie en de welvaart uiteindelijk heeft gesmoord en dat na gedane zaken – of terwijl die verbouwing gaande was – men er parallel toe is overgegaan de winkel open te houden om ook de cultuur naar de vaantjes te helpen. De basis daarvoor vormde de verdere veredeling van het Westers Christelijke schuld- en zondebesef. Via social engeneering werkte de generatie ’68 toe naar een cultuur waarin de intrinsieke validiteit middels het oordeelsvermogen plaats maakte voor een politiek correcte wereld waarin (goede) intenties de maatstaf zijn en waar alles wat zwak oogt (in een slachtofferrol) vooral correct benaderd moet worden. Volgens dit cultuurmarxisme is het eigen oordeels- en analytische vermogen van het individu slecht en zou dat tot uitsluiting leiden. De keerzijde van de medaille is dat alles wat sterk is of een duidelijke eigen mening koestert wordt uitgesloten. Immers argumenteren volgens de termen ‘logica’, ‘objectiviteit’, ‘universele geldigheid‘ kan kwetsend zijn voor degenen die zich in het kamp van de slachtoffer-rol-aanhangers van de politiek correcten bevinden. Ergo, afwijking wordt bestraft met uitsluiting uit de heilstaat van de politiek-correcten. Het laat zich raden dat Sid van mening is dat de Westerse (blanke) man die ook nog eens hetero is, als eerste ten slachtoffer valt aan dat cultuurmarxisme van de politiek-correcten. Ofschoon hij de ontwikkelingen soms wat zwartwit benadert, heeft hij wellicht tot schrik van vele politiek-correct denkenden zeker niet geheel ongelijk. Vele instituties en cultureel geldende waarden zijn in de loop der tijd op de schop gegaan. Het normatieve gelijkheidsbeginsel heeft er toe geleid dat het beter werd om het hoofd niet te ver boven het maaiveld uit de steken en maar liever vooral in de pas te lopen met wat als politiek-correct werd en wordt gezien, iets wat overigens veelal opgeld doet in de ambtelijke bureaucratieën. Het boek ademt dan ook zeker de opvattingen van de auteur dat het postmoderne denken en het feminisme te ver zijn doorgeschoten. Vast staat in ieder geval dat Sid van mening is dat de maakbare samenleving niet bestaat en de Europese cultuur ten onder zal gaan aan ‘wensdenken’ en in de pas lopen. De (meest zuivere) vrijheid van meningsuiting is verworden tot ‘vrijheid van toegestane meningsuiting‘, aldus Sid Lukkassen.
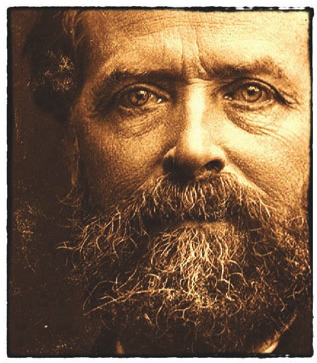 Il se manifeste depuis quelque temps une véritable ferveur dans les sentiments d’amour qui rattachent les hommes d’art et de science à la nature. Les voyageurs se répandent en essaims dans toutes les contrées d’un accès facile, remarquables par la beauté de leurs sites ou le charme de leur climat. Des légions de peintres, de dessinateurs, de photographes, parcourent le monde des bords du Yang-Tse Kiang à ceux du fleuve des Amazones ; ils étudient la terre, la mer, les forêts sous leurs aspects les plus variés ; ils nous révèlent toutes les magnificences de la planète que nous habitons, et grâce à leur fréquentation de plus en plus intime avec la nature, grâce aux œuvres d’art rapportées de ces innombrables voyages, tous les hommes cultivés peuvent maintenant se rendre compte des traits et de la physionomie des diverses contrées du globe.
Il se manifeste depuis quelque temps une véritable ferveur dans les sentiments d’amour qui rattachent les hommes d’art et de science à la nature. Les voyageurs se répandent en essaims dans toutes les contrées d’un accès facile, remarquables par la beauté de leurs sites ou le charme de leur climat. Des légions de peintres, de dessinateurs, de photographes, parcourent le monde des bords du Yang-Tse Kiang à ceux du fleuve des Amazones ; ils étudient la terre, la mer, les forêts sous leurs aspects les plus variés ; ils nous révèlent toutes les magnificences de la planète que nous habitons, et grâce à leur fréquentation de plus en plus intime avec la nature, grâce aux œuvres d’art rapportées de ces innombrables voyages, tous les hommes cultivés peuvent maintenant se rendre compte des traits et de la physionomie des diverses contrées du globe. 


